
















p. 26-29
Jean-Philippe Lachaux

Chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, il propose des clés pour renforcer sa concentration.


















p. 26-29
Jean-Philippe Lachaux

Chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, il propose des clés pour renforcer sa concentration.


Rédacteur en chef
p. 30-33
Christophe André Psychiatre et spécialiste de la méditation, il nous explique comment mieux accepter et gérer nos émotions au quotidien.
p. 34-36
Sylvie Chokron

Responsable de l’Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild, à Paris, elle s’intéresse aux moyens de faire progresser notre mémoire.

«Nul besoin de temples, nul besoin de philosophies compliquées. Notre cerveau et notre cœur sont nos temples. »
Jamais sans doute cette citation du dalaïlama ne sera autant entrée en résonance avec les neurosciences. Le cerveau humain, ausculté sous toutes les coutures par des milliers de laboratoires de par le monde depuis un demi-siècle, est devenu un centre d’attention pour des millions de personnes, chercheurs, enseignants, parents, managers, artistes, hommes et femmes qui souhaitent comprendre comment fonctionne leur for intérieur pour mieux vivre, peser leurs choix personnels et publics, ou trouver le sens de leur action.
Depuis la parution de son premier numéro en mars 2003, Cerveau & Psycho s’est fait le témoin de cette aventure, en prenant le pari que le xxi e siècle allait être celui du cerveau, trait d’union tant attendu entre la biologie de l’humain, d’un côté, et sa subjectivité, son esprit et sa culture, de l’autre. Le mouvement a pris, et même enflé, faisant de cet organe un objet incontournable du débat public, à tel point qu’on se tourne vers lui pour démêler des situations de plus en plus épineuses : comment changer nos comportements pour relever le défi climatique ? Comment renforcer notre esprit critique face à la désinformation et aux fake news ? Quelle attitude adopter face au numérique ?
p. 50-53
Emmanuelle Volle
Chercheuse à l’Institut du cerveau à Paris, elle dévoile les mécanismes cérébraux de la créativité pour mieux marier imagination et raisonnement.
Les réponses ne sont pas immédiates, ni définitives, elles évoluent au fil des connaissances. Mais ces connaissances sont cumulatives. En ce sens elles esquissent un progrès réel et représentent un véritable espoir. Cela valait bien de contempler le chemin parcouru, en nous retournant sur vingt ans de neurosciences, pour en retirer les meilleures leçons afin de faire fructifier le trésor qui dort entre nos deux oreilles. £
N° 152 MARS 2023
p. 10 p. 12
p. 25-69
p. 25
p. 38 PSYCHONUTRITION
BIEN ALIMENTER
SON CERVEAU
p. 6-23
p. 6 ACTUALITÉS
Musicien(ne)s : quelle séduction !
Les religions, une solution vers la sobriété ?
Alzheimer : maladie sexiste ?
Anxiété des ados : « Il est temps d’organiser une prévention adaptée »
p. 12 CAS CLINIQUE
Louis a l’air d’un surdoué. Mais ses difficultés scolaires et relationnelles n’ont rien à voir avec son haut potentiel.
Grégory Michel
p. 20 L’INFOGRAPHIE
Du prix Nobel pour l’invention de l’IRM en 2003, à la découverte des bases de la narcolepsie en 2023, les faits marquants de deux décennies de neurosciences
vues par Cerveau & Psycho
Tanguy Sourd
Les plus grands experts du cerveau livrent leurs conseils, sur la base des découvertes les mieux validées dans leur domaine. De quoi libérer votre potentiel de matière grise.

p. 26 SCIENCES COGNITIVES MIEUX SE CONCENTRER
Jean-Philippe Lachaux
p. 30 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Christophe André
p. 34 PSYCHOLOGIE
Sylvie Chokron
Guillaume Fond
p. 42 NEUROBIOLOGIE
COMBATTRE
LE DÉCLIN CÉRÉBRAL
François Maquestiaux
p. 46 COGNITION
DÉPLOYER
SON INTELLIGENCE
Sandrine Rossi
p. 50 NEUROSCIENCES
LIBÉRER
SA CRÉATIVITÉ
Emmanuelle Volle
p. 54 PSYCHOLOGIE SOCIALE
CULTIVER
SON EMPATHIE
Rebecca Shankland
p. 58 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
RENFORCER
SA MOTIVATION
Yves-Alexandre Thalmann
p. 62 MÉTACOGNITION
AFFÛTER
SON ESPRIT CRITIQUE
Grégoire Borst
p. 66 NEUROTECHNOLOGIES
AMÉLIORER SON CERVEAU…
À TOUT PRIX ?
Michel Le Van Quyen
p. 70 p. 74
p. 94
p. 82 p. 88
p. 92
p. 70-80
p. 82-90
p. 92-97
70
Comment les évaluations que nous laissons sur des sites marchands sont utilisées pour percer à jour nos désirs profonds.

Sara Novak
p. 74 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Des entreprises proposent à leurs clients de simuler leur enterrement. Un business profitable, basé sur de la vraie science. Yves-Alexandre Thalmann
p. 78 RAISON ET DÉRAISON

Les fans de football les plus enfiévrés basculeraient dans un état psychologique « limite » que l’on commence à décrypter.
Nicolas Gauvritp. 82 ÉMOTIONS
Moral au plus bas, puis hausse d’humeur… Les fluctuations hormonales du cycle menstruel ont un impact sur le cerveau.
 Verena Schuster
Verena Schuster
p. 88 L’ÉCOLE DES CERVEAUX
À la différence d’un ordinateur, le cerveau humain est capable de « comprendre ». Sa force est de savoir dialoguer avec le corps. Jean-Philippe Lachaux
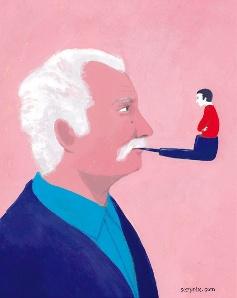
p. 92 SÉLECTION DE LIVRES

L’Instinct de conscience
The Good Life
Le Nouveau Monde des drogues
L’Intelligence émotionnelle à l’école et en famille Vieillir ? Et alors !

Un esprit libéré
p. 94 NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE
Georges Brassens chantait que les « cons » étaient condamnés à le rester. Pas sûr que les neurosciences confirment.
Sebastian DieguezLouis est bon élève, mais il a de sérieuses difficultés relationnelles à l’école. On lui « détecte » alors un HPI (haut potentiel intellectuel), ce qui soulage sa mère, pour qui cela explique tout. Mais derrière cette étiquette se cache une autre réalité.
EN BREF
£ Une mère surinvestie pour son fils Louis pense que ses difficultés à l’école sont dues au fait qu’il est surdoué, ou HPI.
£ Mais l’intelligence n’est pas une maladie. Le garçon présente en revanche des symptômes d’autres troubles :
TDAH et anxiété.
£ Heureusement, son HPI va l’aider à canaliser son hyperactivité, à mieux se concentrer et à lui redonner confiance en lui.
Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université de Bordeaux, chercheur à l’Institut des sciences criminelles et de la justice, psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral, et expert auprès des tribunaux.

Il y a quelques années, des parents, inquiets pour leur fils, m’appellent un matin, craignant qu’il ne soit trop intelligent… « Bonjour Professeur, notre fils a été diagnostiqué HPI. »
Comprenez « haut potentiel intellectuel ». Mais qui ne connaît pas cet acronyme tant ce dernier est devenu fréquent dans notre société ? Déferlement non seulement d’ouvrages, dont certains flirtent avec la mode du développement personnel, relayés par les réseaux sociaux, mais aussi de sites alimentés de vidéos, de témoignages pseudoscientifiques, ce qui donne même lieu à la création de nombreux centres prétendument experts en « détection des HPI », partout en France.
HPI, LE TERME À LA MODE À n’en pas douter, le HPI est à la mode. En atteste aussi le retentissement médiatique, avec notamment la création d’une série télévisée et de bandes dessinées. Ainsi l’ampleur sociétale de ce phénomène a-t-elle bien évidemment des répercussions sur la façon dont certains parents se sont saisis de la question du haut potentiel intellectuel au sujet de leur enfant…
C’est le cas de Louis, dont les parents me contactent ce jeudi matin de décembre : « Notre médecin nous a dit que, comme il a été diagnostiqué HPI l’an passé, il doit être suivi par un spécialiste. » Je m’étonne : « Diagnostic, HPI ? Vous pouvez préciser s’il vous plaît ? » Car le haut potentiel intellectuel n’étant pas une pathologie, la notion de diagnostic est – très – inappropriée. « Nous venons d’arriver dans la région et mon fils a arrêté son suivi psychologique, précise la maman. Je crains qu’il ait les mêmes difficultés que dans son ancienne école. » En effet, la particularité de son fils, liée à
son HPI, le conduirait à être trop souvent incompris des autres enfants, ainsi que de ses professeurs, et tout cela se serait accentué depuis la rentrée. Très vite, je reçois donc Louis accompagné de sa maman. Dans la salle d’attente, sans écran à la main ni magazine, ils sont tous deux plongés dans leur livre respectif. Le jeune garçon, cheveux bruns et petites lunettes rondes, sweat sur chemise à boutons, chino bleu marine et baskets de marque, dégage une impression à la fois branchée et élégante. Et à l’appel de son prénom, il est tellement absorbé par son livre d’aventures qu’il met un temps à se lever.
Avec impétuosité, il entre ensuite dans le cabinet en devançant sa mère et s’installe le premier, à la hâte, mais avec assurance, sur le fauteuil, en me regardant droit dans les yeux. Sa mère reprend ce qu’elle m’a dit au téléphone : « Comme Louis est HPI, c’est difficile avec les autres, il n’est pas toujours compris. Et comme il est hypersensible, il réagit parfois très mal. » Louis interrompt sa mère : « Oui, je suis plus intelligent que les autres. J’ai un QI de plus de 130. » Sa mère surenchérit : « Oui, il est très intelligent. Il est “zèbre” comme son père. »
Il y a plus de deux ans, en regardant une émission télévisée traitant du HPI, elle a souhaité que son fils soit évalué. « Dans ce qu’ils racontaient, j’ai tout de suite reconnu Louis : sa sensibilité, son émotivité et sa précocité, évoquée par l’une de ses professeurs. Alors j’ai décidé de lui faire passer un test dans un centre parisien. Ils l’ont diagnostiqué HPI. Puis Louis a été suivi depuis. »
Le garçon entamait alors son CE2 et commençait à être en difficulté à l’école, non dans ses apprentissages, mais davantage dans ses rapports sociaux. « Son institutrice se plaignait de ses interventions en classe et avait même tendance à lui interdire de répondre aux questions… Car, comme il connaissait toutes les solutions, il empêchait les autres élèves d’intervenir. » Ses résultats scolaires étaient excellents, néanmoins, bien qu’entouré de
Bien sûr, et heureusement ! Le cerveau est une vraie machine à s’améliorer ! Comme l’explique la chercheuse Sandrine Rossi dans ces pages, il tient un registre de ses propres erreurs pour corriger le tir la fois suivante. Et le simple fait d’en avoir conscience nous rend plus intelligents ! Alors, ayons confiance en un « meilleur cerveau ». Sans forcément y implanter des électrodes ou des neurones artificiels – même si la question est étudiée soigneusement en fin de partie par Michel Le Van Quyen. Dans ce dossier, les moyens simples d’agir sur notre mémoire, nos émotions, notre intelligence et bien d’autres fonctions cognitives sont présentés par les meilleurs spécialistes de leur domaine. Ici, pas question de devenir un génie du jour en lendemain, mais de « savoir comment ça marche à l’intérieur », pour ensuite mieux décider quel ressort activer au bon moment. Un exemple ? Quand on cherche une idée nouvelle et créative, observer les moments où notre imagination dérive trop loin et la recadrer avec un réseau de contrôle cérébral qui veille au réalisme des solutions. Encore faut-il savoir que ces deux réseaux existent. En ce sens, savoir c’est pouvoir – dans une certaine mesure dont vous pourrez juger par vous-même. Bonne lecture !
Sébastien Boulery arriver.
etit exercice de concentration : à partir de maintenant, comptez simplement dans votre tête le nombre de mots contenus dans le premier paragraphe de ce texte le plus vite possible, puis reprenez votre lecture à partir de la phrase qui suit. Combien de mots avez-vous comptés ? Vous vous en doutez, je n’irai pas vérifier. Maintenant, répondez à cette seconde question : qu’avez-vous retenu de ce premier paragraphe ? Si vous êtes comme une majorité de lecteurs, la réponse est : « pas grand-chose », voire « rien du tout ». Vous avez fait l’expérience de la difficulté de se concentrer sur deux tâches à la fois.
Pour compter le nombre de mots, vous avez dû balayer chacun d’entre eux avec votre regard en y faisant attention séquentiellement et en vous prononçant à chaque fois le décompte correspondant (« un », « deux », « trois », etc.). Vous avez dû également maintenir ces valeurs avec ce qu’on appelle la « boucle phonologique » de la mémoire de travail (qui s’identifie ici à ce qu’on nomme
communément la « petite voix » : celle qui sert à se parler à soi-même, dans sa tête).
Si vous aviez voulu comprendre le sens de ce paragraphe, vous auriez dû également faire attention à ses mots, mais en engageant à chaque fois d’autres processus cognitifs, pour accéder à leur sens, les convertir sous forme de sons mentaux avec cette même petite voix (une conversion dite « grapho-phonémique ») et les maintenir dans votre mémoire de travail (celle qui garde à l’esprit les informations dont vous avez besoin pour résoudre un problème, juste le temps de résoudre ce problème) pour appréhender les phrases dans leur ensemble. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que vous n’ayez pas pu comprendre ce paragraphe
Mieux se concentrer suppose de bien définir trois éléments essentiels.
➊ L’intention : qu’est-ce que je cherche à faire ?
Abordez toujours une activité avec une intention unique et aussi claire que possible, que vous gagnerez à vous formuler explicitement. Cela vous permettra notamment
de découper l’activité en une suite d’étapes simples, que « vous voyez immédiatement comment faire ».
➋ L’attention : à quoi dois-je faire attention ? Définissez précisément votre cible perceptive. Les fautes d’orthographe dans un texte ? Les panneaux de signalisation le long de la route ? Savoir ce
Comment rester focalisé efficacement sur une tâche pour la mener à bien sans se laisser distraire ? Adoptez trois réflexes qui vous aideront à
l y a quelques années encore, nous étions capables de retenir un grand nombre de numéros de téléphone, mais également les dates d’anniversaire, les adresses et les codes de porte de nos plus proches amis et nous osions même circuler en voiture en nous basant sur notre GPS interne et non sur une quelconque application. Ce temps nous semble si loin ! Un peu comme si peu à peu nous avions délaissé notre mémoire au profit de celle de notre téléphone, de notre ordinateur ou de tout autre outil technologique. Paradoxalement, tout se passe comme si l’accès de plus en plus facile à une multitude d’informations sur des serveurs externes s’accompagnait d’une difficulté de plus en plus grande à encoder, stocker et mémoriser ces informations au sein de notre propre mémoire. Un peu comme si l’augmentation de la taille de cette mémoire externe allait irrémédiablement de pair avec une réduction du volume et de la qualité de notre mémoire interne.
Qu’arrive-t-il à nos souvenirs pour qu’ils soient devenus moins fiables et moins utiles que ces données stockées sur des disques durs externes, voire sur le cloud. Encodées sans attention, stockées sans lien avec ce que nous connaissons, mal organisées, jamais recherchées, les traces mnésiques se révèlent parfois totalement inutilisables. Et cela semble devenir de plus en plus fréquent. Les consultations sur la mémoire n’ont d’ailleurs jamais été aussi remplies…
Cela ne vaut pas seulement pour les sujets vieillissants comme c’était le cas par le passé, mais également pour les personnes jeunes, qui ont autour de la trentaine, voire d’enfants, qui se plaignent de ne plus pouvoir mémoriser de nouvelles connaissances, ou de ne plus être capables d’évoquer des souvenirs anciens. La plupart du temps, fort heureusement, il ne s’agit que d’une plainte subjective sans perte objective des capacités mnésiques et les évaluations révèlent la présence de capacités mnésiques tout à fait intègres, mais qui peinent à être utilisées. La cause en est simple. Une bonne mémoire est une mémoire qui nous permet d’encoder, de stocker et de rappeler des informations à la demande. Alors pourquoi nous semble-t-il aujourd’hui et depuis quelque temps, que notre mémoire ne nous obéit plus au doigt et à l’œil ?
Notre mémoire se nourrit autant du contexte que des émotions qui nous traversent, et de la fréquence à laquelle nous ravivons nos souvenirs. Il en découle de multiples façons d’en jouer et d’en décupler la portée au quotidien.
La première cause tient très probablement au fait que, face aux nouvelles technologies, il nous semble que notre mémoire ne fait pas le poids. Convaincus qu’elle est moins bonne que celle de notre téléphone ou de notre ordinateur, nous avons tendance à la désinvestir et à la sous-utiliser. Les internes en médecine vous le diront, Google est leur meilleur allié. Pourquoi mémoriser toute l’anatomie du corps si en un clic il est possible de retrouver le nom d’un muscle ou d’un os sur le moteur de recherche de son téléphone ?
Le problème, c’est qu’à externaliser en permanence notre mémoire, nous perdons tout simplement la capacité de nous en servir de manière rapide et efficace au moment où nous le souhaitons. Essayez de vous souvenir de la dernière cérémonie à laquelle vous avez assisté. C’est difficile ?

Probablement parce que vous avez suivi l’événement à travers l’écran de votre téléphone et non pas véritablement avec vos yeux. Il y avait d’ailleurs sans doute devant vous une mer d’écrans tendus par des bras identiques au vôtre. La conséquence ? Votre mémoire n’a pas fait ce travail de construction de la scène vécue, avec tout ce que cela comporte de détails visuels, sonores, émotionnels, affectifs. Pire, sachant que tout était stocké dans votre téléphone, vous n’avez peut-être même pas évoqué ce moment fort après coup. Sans cette
N. M. Roüast & M. Schönauer, Continuously changing memories : a framework for proactive and non-linear consolidation, Trends Neurosci., 2023.
M. Korte, The impact of the digital revolution on human brain and behavior : where do we stand ?, Dialogues Clin. Neurosci., 2020.
K. K. Loh & R. Kanai, How Has the Internet Reshaped Human Cognition ?, Neuroscientist, 2016.

F. Dégeilh et al., Cognitive and brain development of memory from infancy to early adulthood, Biol. Aujourdhui, 2015.
étape de reconstruction, le souvenir ne s’ancre pas durablement dans notre esprit.
Car la mémoire a ceci de particulier qu’un souvenir est d’autant mieux stocké et mémorisé qu’il est évoqué. Alors que l’on pensait avant que pour bien retenir une information il fallait l’encoder plusieurs fois, à l’image d’un cours que l’on aurait lu et relu, on sait aujourd’hui que pour bien ancrer un souvenir en mémoire, et le récupérer facilement, il faut aller le chercher le plus fréquemment possible. En effet, on envisage aujourd’hui chaque souvenir comme un réseau de nouvelles connexions, c’est-à-dire comme un chemin spécifique entre différents neurones. À chaque fois que vous allez chercher un souvenir, vous empruntez à nouveau tout le chemin qui le constitue, et repassez par les étapes d’encodage, de stockage et de rappel, comme au premier jour où vous l’avez créé. Et rappel après rappel, la route que vous suivez devient ainsi de mieux en mieux goudronnée, de plus en plus large et praticable. En quelque sorte, rappeler régulièrement un souvenir, c’est transformer un chemin semé d’embûches en une autoroute à quatre voies bien goudronnée… Là où reprendre connaissance d’une information (en la lisant par exemple une énième fois) ne stimule que son encodage, aller chercher cette connaissance en mémoire,
Dès lors, en 1999, dans la prestigieuse revue Nature, l’Américain Arthur Kramer et ses collègues, de l’université de l’Illinois, aux États-Unis, ont proposé l’hypothèse – aujourd’hui très influente – selon laquelle l’augmentation de la capacité cardiorespiratoire améliorerait l’efficacité de l’ensemble des processus cognitifs exécutifs. D’où de meilleures facultés pour s’adapter à la nouveauté et atteindre ses objectifs.
On vieillit – inexorablement –et notre cerveau également, le « déclin cognitif lié à l’âge » touchant tout un chacun à un moment donné. Mémorisation, attention, concentration, inhibition d’automatismes, planification de tâches ou d’actions, flexibilité mentale – des fonctions cognitives dites « exécutives » – se détériorent avec le temps qui passe. Comment les préserver ? Le sport serait un bon moyen de lutte contre le vieillissement non seulement physique, mais aussi psychique. C’est d’ailleurs souvent ce que l’on pense lorsque, malgré les années, on tente de conserver une activité hebdomadaire de course à pied, de vélo, de marche en forêt, de yoga… Mais est-ce vraiment bénéfique ?
Depuis un peu plus de vingt ans, les bienfaits physiques et psychologiques du sport font l’objet de recherches pluridisciplinaires, mêlant sciences du sport, médecine et sciences cognitives. Au cours des années 1990, plusieurs équipes avaient déjà montré que des activités physiques développant la capacité cardiorespiratoire des séniors augmentaient leurs performances mentales, c’est-à-dire leurs scores à des tests mesurant divers processus cognitifs.
En effet, chez toute personne vieillissante, on observe un déclin progressif des processus exécutifs et des structures cérébrales associées, notamment les cortex préfrontal et frontal. Par ailleurs, des expériences ont révélé, chez des
➊ Pour lutter contre le déclin cognitif lié à l’âge, à savoir un affaiblissement de nos capacités dites « exécutives », (mémorisation, raisonnement, concentration, planification), la science le dit : il faut bouger !
➋ Une activité physique « raisonnée », c’est-à-dire adaptée à sa santé globale, est toujours envisageable. De façon générale, il s’agit de privilégier les pratiques dites « aérobies », qui développent la capacité cardiovasculaire. Ce sont celles qui proposent un effort prolongé, comme la marche, la course
à pied, la natation, le vélo, les jeux de ballon et de raquette…
➌ Les chercheurs proposent par exemple de réaliser divers exercices aérobiques pendant une heure, deux fois par semaine, avec dix minutes d’échauffement, quarante minutes d’activités, puis dix minutes de retour au calme. Testé chez des personnes âgées, ce programme a livré de bons résultats. Il est même efficace en exergaming, quand on joue à des jeux vidéo sportifs en bougeant face à son écran, comme le propose la Nintendo Wii.
Pour freiner la perte progressive de nos capacités cognitives avec l’âge, il faut notamment de... l’exercice physique !
FRANÇOIS MAQUESTIAUX est professeur de psychologie cognitive et chercheur au Centre de recherche sur les fonctionnements psychologiques à Rouen, ainsi qu’au Laboratoire de recherches intégratives, à Besançon.

rongeurs âgés, des améliorations métaboliques et neurochimiques dans leur cerveau lorsqu’ils ont la possibilité de développer leurs capacités cardiorespiratoires en courant dans une roue.
Pour tester cette hypothèse, l’équipe de Kramer a donc comparé les performances des fonctions exécutives de 124 individus sédentaires (pratiquant très peu d’activité physique) âgés de 60 à 75 ans, avant et après six mois d’un programme, soit de marche pour le groupe dit « aérobie » (dans lequel la capacité cardiorespiratoire est sollicitée), soit d’étirements et de tonus corporel pour le groupe dit « anaérobie ». Résultat : seuls les séniors du groupe aérobie ont vu leurs fonctions exécutives s’améliorer.
En 2013, Francis Langlois et Louis Bherer, de l’université de Montréal, ont aussi montré que les bénéfices physiques et cognitifs d’une activité
Toute activité physique mettant en jeu les capacités cardiovasculaires des séniors, comme la marche ou la natation, est bénéfique à leur santé non seulement physique, mais aussi mentale.

aérobie s’observaient de la même façon chez les personnes âgées les plus fragiles, souffrant de syndromes gériatriques, comme une faiblesse musculaire, une marche plus lente, une plus grande fatigabilité, voire un amaigrissement non voulu. Et, malgré leurs difficultés physiques, ces séniors ont bien adhéré au programme d’activités.
D’autres synthèses d’études empiriques ont confirmé que le sport « aérobique » améliore la santé cognitive des personnes âgées sédentaires. Dans l’une d’elles, en 2003, Stanley Colcombe et Arthur Kramer précisent ainsi que les bénéfices s’observent sur une large gamme de fonctions cognitives : vitesse de traitement des informations, mémoire visuospatiale à court terme, sélection rapide de réponses, contrôle exécutif. Qui plus est, au Centre de recherches sur la cognition et l’apprentissage (Cerca) de l’université de Poitiers, les nombreux travaux menés par Michel Audiffren et Cédric Albinet ont permis d’identifier que ce sont
a fin du XIXe siècle est marquée par l’ouverture, en France, de l’instruction obligatoire et par l’établissement d’écoles publiques et gratuites sur tout le territoire, ce qui aura rapidement pour conséquence d’orienter les élèves en difficulté d’apprentissage scolaire. Alfred Binet, pédagogue et psychologue français, va être sollicité pour travailler à l’élaboration d’un outil à même de relever ce défi. Avec Théodore Simon, psychiatre français, ils publient en 1905 la première échelle métrique de mesure de l’intelligence dans la revue L’Année psychologique sous le titre « Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux ». Une intelligence faible, troublée, est considérée comme une anomalie dans le développement de la personne.
La notion d’intelligence est en marche, et son importance ne fera que s’accentuer, ce qui pose la question : comment la développer ? Pour la quantifier, on inventera un nouveau concept : le QI ou quotient intellectuel. C’est en 1912 que le psychologue allemand William Stern introduit le fameux QI, mesuré aujourd’hui à travers une série
d’épreuves initialement conçues par le psychiatre américain David Wechsler. On recourt fréquemment aux échelles de Wechsler, destinées aux personnes âgées de 6 à 80 ans, notamment en vue de statuer sur la demande de soutien matériel et/ ou financier auprès des Maisons départementales des personnes handicapées. Le niveau d’intelligence peut ainsi revêtir une importance non négligeable dans le parcours de vie de l’individu. Les tests de QI nous renseignent sur l’efficience de fonctions mentales telles que l’attention, le langage, la mémoire, ou encore le raisonnement,
Quelques attitudes clés permettront de faire progresser vos capacités mentales.
➊ Savoir que l’intelligence n’est pas une donnée fixée une fois pour toutes, et que le travail compte plus que le talent : cela suffit à faire progresser ses capacités au jour le jour.
➋ Constamment se demander ce que l’on peut retenir d’un échec, car cela stimule la capacité d’apprentissage de notre cerveau fondée sur les « erreurs de prédiction ».
➌ Le contrôle cognitif (planifier, alterner les stratégies, maîtriser ses impulsions) exercé quotidiennement favorise le développement de l’intelligence.
➍ La métacognition, ou connaissance de ses propres processus mentaux, est au moins aussi importante que le QI pur, et se cultive par l’entraînement.
L’intelligence évolue au cours de la vie grâce à la plasticité de notre cerveau… Stimuler celle-ci demande quelques ingrédients clés comme la flexibilité mentale, la curiosité ou une approche constructive de l’échec.
SANDRINE ROSSI est professeuse en psychologie cognitive et de l’éducation au Laboratoire de psychologie de l’université de Caen Normandie.

AUTEUR BIO AUTEUR AUTEUR
hil iquatiam, verum net re as adi endipsus eserferiaem et re con con nimet laborup ttiis erum fuga. Ut maio beruptur sit laborum quuntur aut lam
mais sans évaluer nos capacités motrices, émotionnelles, créatives, motivationnelles, d’interactions sociales, ou encore notre sens moral. Ils ne prennent pas en compte toutes les aptitudes nécessaires à l’intelligence telle que nous la définissons aujourd’hui : être intelligent, c’est être capable de s’adapter à son environnement.
Selon la psychologue américaine Carole Dweck, de l’université Stanford, nous différons par notre conception de l’intelligence. Certains croient qu’elle est innée, et par conséquent difficilement modifiable. Pour d’autres, elle est de nature à évoluer au fil du temps. Dans le premier cas, on parle de « conception fixiste », et dans le second de « conception malléable » de l’intelligence. Or les études réalisées par Carol Dweck ont montré qu’une conception fixiste conduit les personnes à faire peu d’efforts, à ne pas persévérer et à mettre en place des stratégies d’évitement, comme le fait de dissimuler ses incompétences, de vouloir gagner du temps, de s’éparpiller dans ses activités, de remettre la tâche à plus tard, mais aussi à se comparer aux autres et à développer une forme d’anxiété face à la performance. Alors que, bien au contraire, le fait de disposer d’une conception malléable de l’intelligence conduit à s’engager dans l’effort et la persévérance, à développer notamment l’organisation, la relecture, la recherche du soutien, l’autoévaluation, la réussite étant considérée comme un défi qui procure du plaisir. Mieux vaut, par conséquent, considérer que l’intelligence n’est pas une donnée établie une fois pour toutes dans la vie, mais qu’elle peut se développer en fonction du contexte.
Le connectome de notre cerveau, l’ensemble des connexions à longue distance entre aires cérébrales, déterminerait en partie nos capacités d’intelligence fluide et de raisonnement abstrait. Or ces connexions sont modulables au fil de la vie...

Et les conséquences sont parfois profondes. Ainsi, notre conception de l’intelligence affecte notre parcours académique autant que professionnel. Nos capacités intrinsèques ne suffisent pas pour relever tous les défis d’une vie. Le plus important est de les appréhender avec un état d’esprit en expansion. Pour cela, il est particulièrement utile de se rappeler quelques principes essentiels.
Tout d’abord, il ne faut surtout pas avoir peur de l’échec, car se tromper c’est apprendre ! Notre cerveau calcule en permanence le décalage existant entre nos attentes et ce qui se produit effectivement. Par exemple, si vous pensez avoir répondu tout juste dans un questionnaire, et que l’obtention des résultats laisse apparaître plusieurs erreurs, votre cerveau va comparer l’écart entre ses « prédictions » et la réalité, et corriger le tir en fonction. Selon le psychologue et neuroscientifique Stanislas Dehaene, ce « retour sur erreur » est l’un des piliers de l’apprentissage. Autrement dit, l’échec est parfois douloureux mais
a créativité est souvent décrite comme « la compétence du XXIe siècle », encore inégalée par la machine, une capacité qui doit être recherchée, encouragée et développée, notamment dans l’éducation ou l’innovation. Mais comment la définir exactement et… la stimuler ?
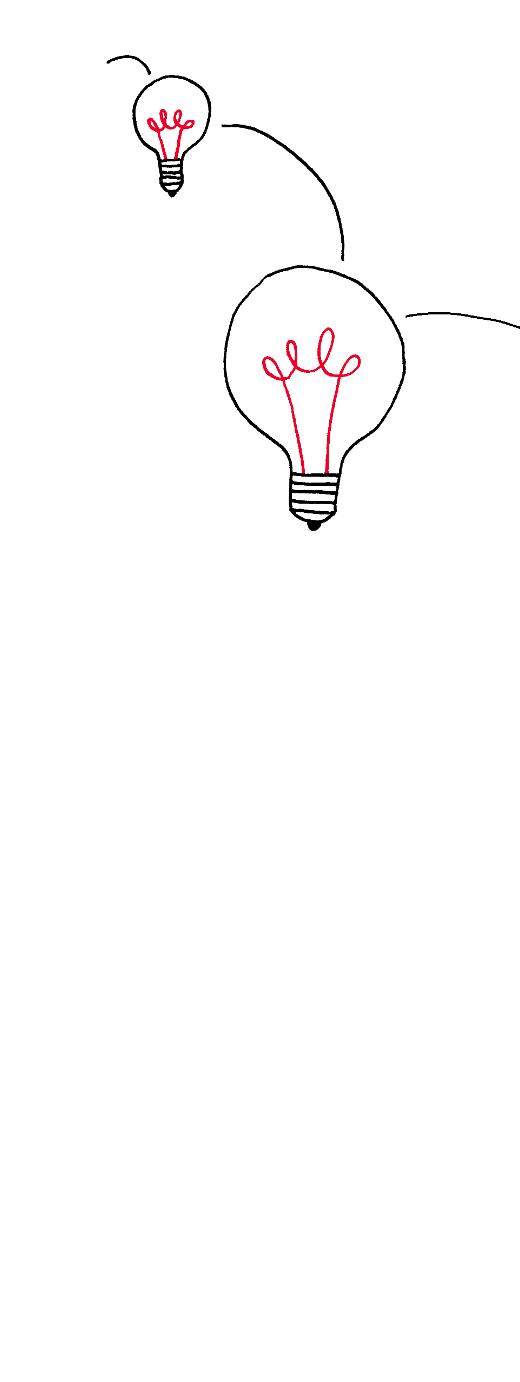
Tout d’abord, un point de définition. La créativité désigne une capacité à réaliser une production (un objet, une idée, un système, etc.) à la fois originale et adaptée au contexte et à des contraintes fixées à l’avance. Ainsi, une production littéraire fictionnelle (un roman, par exemple) sera qualifiée de créative si elle propose une intrigue originale tout en respectant des contraintes (sur le plan de la syntaxe, de la cohérence, de la longueur – une nouvelle de trois pages n’est pas un roman ! –, etc.) De façon générale, trouver des solutions inédites, résoudre des problèmes nouveaux, innover, s’adapter au
➊ Laisser reposer un problème après l’avoir étudié. Les solutions innovantes émergeront alors plus facilement de l’activité de vos trois réseaux neuronaux sous-tendant la créativité. Ne pas hésiter à insérer des moments de repos ou de sommeil.
➋ S’entourer d’un contexte socioémotionnel favorable : environnement motivant, travail d’équipe, émulation, collaboration voire compétition dans certains cas, peuvent se révéler féconds.
Créer mobilise trois réseaux de neurones dans notre cerveau ! Savoir les mobiliser est un atout unique pour trouver des solutions plus originales…

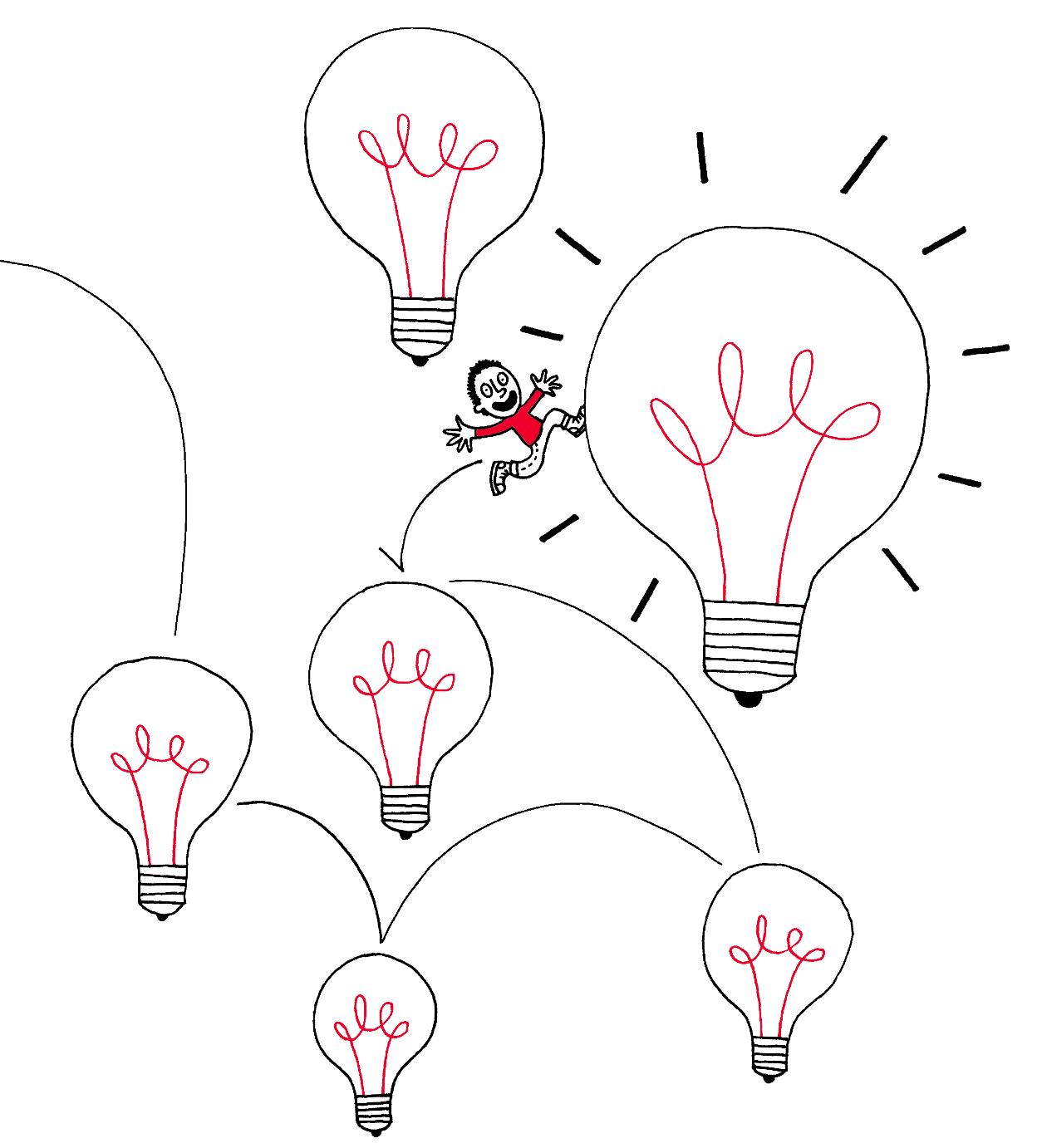
Comment développer en soi les capacités d’empathie qui permettent de mieux comprendre autrui et bonifient les relations humaines ? Des techniques efficaces existent, mais il est tout aussi important d’éviter certains effets secondaires, comme le risque de favoriser ceux qui nous ressemblent.

i nous voulons devenir des personnes meilleures et bienveillantes, si nous voulons rendre le monde meilleur, alors nous ferions mieux de laisser l’empathie de côté », préconisait, provocateur, le professeur de psychologie américain Paul Bloom, dans son ouvrage Against Empathy (« Contre l’empathie »), publié en 2016. De fait, tout un débat a émergé récemment sur les effets potentiellement délétères de cette faculté. Sans nier ces effets, les recherches actuelles considèrent malgré tout l’empathie comme une caractéristique essentielle, aussi bien individuellement que collectivement. À condition d’apprendre à l’apprivoiser.
Dans sa définition la plus commune, l’empathie est la tendance spontanée à reconnaître et percevoir ce que l’autre ressent, avec une dimension affective (on entre en résonance avec les émotions d’autrui) et une dimension cognitive (on devine ses états mentaux) – cette dernière dimension étant aussi appelée « théorie de l’esprit ». Cette faculté est essentielle pour agir de
REBECCA SHANKLAND est professeuse de psychologie du développement à l’université Lumière Lyon 2 et membre de l’Institut universitaire de France.

AUTEUR BIO AUTEUR AUTEUR hil iquatiam, verum net re as adi endipsus eserferiaem et re con con nimet laborup ttiis erum fuga. Ut maio beruptur sit laborum quuntur aut lam
manière constructive envers les autres, en tenant compte de leurs besoins et de leur ressenti. Dès les années 1980, les expériences menées par le psychologue américain Daniel Batson ont, en outre, montré que plus nous éprouvons de l’empathie pour nos congénères, plus nous avons tendance à leur venir en aide, même lorsque nous pouvons facilement nous détourner de leurs difficultés. Dans l’une de ces expériences, par exemple, les participants devaient en lire la description faite par une tierce personne, avant de voir cette dernière subir des chocs électriques (bien sûr fictifs). Quand la description était rédigée de façon personnelle, propre à éveiller l’empathie, plus de 80 % d’entre eux se sont indignés et ont exigé qu’on arrête l’expérience. Quand la description était neutre, en revanche, la proportion chutait à moins de un sur cinq…
GARE AUX PIÈGES DE L’EMPATHIE !
L’empathie est particulièrement importante dans certaines professions, notamment médicales. Ainsi, des patients qui se sentent compris et soutenus par leur médecin seront plus en confiance et suivront mieux les traitements prescrits. Toutefois, les recherches montrent aussi que l’empathie présente certaines limites. Le fait qu’elle s’oriente spontanément vers nos proches et vers les personnes qui nous ressemblent, notamment, risque d’augmenter les violences ou les discriminations envers les autres communautés, vite considérées comme menaçantes. À travers sa

Méditer régulièrement semble libérer de l’ocytocine, cette molécule couramment surnommée « hormone de l’amour », qui favorise le lien entre les personnes.
puiser en soi l’énergie de mener ses projets à bien ? Se lancer
erdre du poids. Se lancer dans un programme de révisions intensives. Privilégier le vélo à la voiture... Nos aspirations ne manquent pas quand il s’agit de bien faire. Mais pour passer à l’action, il faut un ingrédient clé qu’on appelle la « motivation ». Autrement dit, l’énergie qui permet de dépasser la simple envie afin de tenir ses objectifs sur le long terme. Comment faire ?
Le plus souvent, on distingue deux types de motivation : la motivation intrinsèque et extrinsèque. Une distinction qui découle de la célèbre théorie de l’autodétermination de Richard Ryan et Edward Deci. Ces chercheurs avaient à l’époque nuancé les conclusions tirées d’un courant de psychologie appelé « béhaviorisme », selon lequel l’attrait des récompenses et
Pour augmenter vos chances d’atteindre un but fixé, pensez à actionner trois leviers motivationnels.
LEVIER AFFECTIF
Le système cérébral de la motivation est sensible à la progression et à la curiosité. Se fixer un objectif temporel, augmenter le niveau de difficulté, introduire de la compétition avec soi-même ou autrui : tout cela active le système de la motivation et augmente les chances de succès. Faire un pari avec un ami pour un régime, se fixer une date limite, etc. À vous de jouer !
LEVIER COGNITIF
Il s’agit ici de jouer sur le besoin de notre cerveau de trouver du sens et de l’utilité à nos actions. C’est le moteur de certaines professions comme celles de la santé. Demandezvous ce que cela apportera à votre équilibre, aux autres, à la planète, etc.
LEVIER CONTEXTUEL
Le but est de jouer sur les conséquences de vos actions, en s’octroyant
l’évitement des punitions constituaient le moteur ultime de nos comportements, autrement dit la motivation extrinsèque (déterminée de l’extérieur, par des récompenses ou des sanctions). Or les deux psychologues ont montré que certaines actions sont effectuées pour le seul plaisir qu’elles apportent sur le moment, sans autre finalité ni récompense – comme lorsque nous nous adonnons à une activité de loisirs. Ce
des récompenses en cas de succès, ou au contraire en mettant en place un système de pénalité automatique : si je n’ai pas perdu 2 kilos dans un mois, je m’engage solennellement devant tous mes amis à les inviter dans le meilleur restaurant de France… On intervient ici sur le rapport coûts/bénéfices de ses agissements.
des défis, se questionner sur le sens de son action, voire s’infliger des punitions à l’avance en cas d’échec – autant de stratégies validées et souvent efficaces !
YVES-ALEXANDRE THALMANN est professeur de psychologie au collège Saint-Michel et collaborateur scientifique à l’université de Fribourg, en Suisse.


et de théories parfois indémêlables, il est crucial de distinguer ce qui est crédible de ce qui ne l’est pas. Notre cerveau est équipé pour cela – encore fautil l’y préparer.
vaccinés contre le Covid-19 en soins critiques (plus de 50 %) une preuve de l’inefficacité du vaccin. Sauf qu’à cette date, neuf fois plus de personnes étant vaccinées au sein de la population éligible, les soins critiques accueillaient 29 nonvaccinés par million de personnes non vaccinées et 3 vaccinés par million de personnes vaccinées, preuve s’il en est de l’efficacité des injections.
Le 6 janvier 2021, une foule abreuvée de fausses informations et de thèses complotistes sur une prétendue fraude électorale massive lors de la présidentielle américaine envahit le Capitole, à Washington, faisant vaciller pendant quelques heures l’une des plus anciennes et puissantes démocraties mondiales. Cet événement s’inscrit dans une tendance plus globale, où des thèses fantaisistes ne cessent de fleurir sur des complots ourdis par des gouvernements ou des organisations secrètes, voire les deux, qui chercheraient à contrôler les populations au bénéfice de quelques-uns. L’Organisation mondiale de la santé considère aujourd’hui que la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux constitue l’un des principaux dangers pour la santé des populations. Sans doute à raison ! Bien que la vaccination ait démontré son efficacité – les campagnes de vaccination permettant de sauver plusieurs millions de vies par an dans le monde –, l’hésitation à recevoir une injection reste forte, en France notamment, comme l’a douloureusement rappelé la campagne d’immunisation massive contre le Covid-19 lancée à la fin de 2020. Si l’efficacité de la vaccination contre le Covid-19 ne fait plus débat dans le monde médical, elle n’en reste pas moins contestée dans certaines sphères de la société qui voyaient, en novembre 2021, dans la proportion de patients
Cet exemple, comme d’autres, suggère que toutes nos décisions ne relèvent pas d’un traitement purement rationnel, délibératif et analytique des informations, et que certains biais cognitifs, émotionnels et sociaux identifiés dans le domaine de la prise de décision économique, notamment par Daniel Kahneman, psychologue
➊ Dans une conversation, devant un média, face à un problème, apprendre à détecter les moments de doute qui nous saisissent parfois de manière très fugace, quand on subodore qu’on est peut-être en train de répondre trop vite à une question, ou d’adhérer trop rapidement à une thèse séduisante.
➋ Dans un deuxième temps, avoir le réflexe de « geler » le processus d’adhésion au message, ou de « bloquer » la réponse immédiate,
instinctive qu’on voudrait donner à une question – c’est l’action du cortex préfrontal. Et se forcer à prendre un temps de réflexion supplémentaire.
➌ Répéter ce schéma plusieurs fois, au fil des rencontres, des conversations, en surfant sur internet ou en écoutant les informations. La perception du doute interne et le blocage des raccourcis mentaux se feront de plus en plus facilement.
Dans un monde saturé d’informations
32 euros. Pour ceux qui cherchent encore la réponse, le stylo coûte en fait 1 euro. Notre cerveau commet cette erreur car il est piégé par la formulation du problème : « plus que » déclenche automatiquement une heuristique du type « plus que = soustraction » qui fonctionne très bien pour résoudre certains problèmes mais pas celui-là.
AUTEUR BIO AUTEUR AUTEUR
GRÉGOIRE BORST
est professeur de psychologie et de neurosciences cognitives du développement à l’université Paris-Cité et directeur du LaPsyDÉ – CNRS.
hil iquatiam, verum net re as adi endipsus eserferiaem et re con con nimet laborup ttiis erum fuga. Ut maio beruptur sit laborum quuntur aut lam
et Prix Nobel d’économie en 2002, ont tendance à influencer notre capacité à faire des choix éclairés et rationnels. Nous serions prompts à des raccourcis de pensée appelés « heuristiques », qui permettent une prise de décision à la fois rapide et peu coûteuse en ressources cognitives, très adaptée à certaines situations mais trompeuse dans d’autres. Ce qui expliquerait notre part d’irrationalité dans certaines situations.
Prenons un exemple. Imaginez que vous deviez résoudre très rapidement le problème suivant : « Un carnet et un stylo coûtent 32 euros. Le carnet coûte 30 euros de plus que le stylo. Combien coûte le stylo ? » La plupart d’entre nous répondent spontanément 2 euros. Mais c’est une erreur ! Si le stylo coûte 2 euros et que le carnet coûte 30 euros de plus que le stylo, le carnet coûtera à lui seul
Selon un récent sondage Ifop, un jeune sur six âgé de 18 à 24 ans considérerait comme crédible l’hypothèse selon laquelle la Terre serait plate. Faire preuve d’esprit critique dans ce cas ne consiste pas à remettre en cause ce qu’on nous dit, mais la façon dont nous décidons de croire ou non ce qu’on nous dit.

Olivier Houdé, psychologue du développement et directeur honoraire du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ), a été l’un des premiers à mettre en évidence que notre capacité à raisonner de manière logique dans ce type de situation repose, pour partie, sur notre capacité à résister à (on dit aussi « inhiber » ou « bloquer ») certaines heuristiques qui interfèrent avec notre pensée analytique et délibérative. Les aires préfrontales de notre cerveau, et notamment le gyrus frontal inférieur (voir la figure page 64), sous-tendent cette capacité à inhiber les heuristiques trompeuses, quel que soit le type de raisonnement déductif (falsification/ vérification de règles conditionnelles de type « si… alors… » ou raisonnement syllogistique) dans lequel nous nous engageons (voir l’encadré cicontre). Notre cerveau est même en mesure, à l’aide d’une autre région de notre cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, de détecter très rapidement qu’il se trouve dans un contexte dans lequel une heuristique interfère avec notre pensée logique avant même que nous soyons en mesure de l’inhiber. La capacité à détecter ce type de contexte

Implanter des puces électroniques dans notre cerveau pour décupler nos facultés mentales ou notre bien-être : les neurotechnologies laissent entrevoir un marché immense. Mais quelle est la part d’espoir et de dangers derrière cet engouement ?
Fin 2022, le milliardaire américain Elon Musk annonce qu’un implant cérébral mis au point par sa start-up Neuralink est prêt à être utilisé chez l’être humain. Après six ans de développement, cette puce composée de plusieurs milliers d’électrodes capables d’enregistrer l’activité électrique d’une multitude de neurones, et communiquant avec l’extérieur par Bluetooth, va permettre aux futurs utilisateurs de communiquer directement avec un ordinateur, un téléphone ou d’autres appareils électroniques, uniquement par la pensée. Un an plus tôt, une vidéo a fait le buzz en montrant un singe en train de jouer à un jeu vidéo avec cet implant, sans faire le moindre mouvement. Tout est prêt pour passer à l’humain, il ne manque plus que l’aval de l’agence américaine en charge de la santé publique, la Food and Drug Administration (FDA).
En réalité, les applications potentielles des puces électroniques vont bien au-delà d’une sorte de « télécommande télépathique ». Les dirigeants de Neuralink espèrent que ces implants pourront
être rapidement utilisés pour compenser ou remplacer des fonctions cérébrales perdues à la suite d’un accident ou d’une maladie neurodégénérative. Il s’agit, par exemple, de rendre une mobilité aux personnes paralysées ou la vue aux aveugles. Les puces serviraient, dans le premier cas, à mesurer les commandes motrices dans le cerveau afin de stimuler directement les muscles de façon adéquate, et, dans le second cas, à activer le cortex visuel à partir des images captées par une caméra. Et ces applications médicales ne seraient qu’une étape : à terme, l’objectif est de commercialiser ces dispositifs pour le grand public, afin d’améliorer des capacités cognitives comme la mémoire ou la concentration. Ces perspectives étonnantes, et parfois inquiétantes, sont autant de promesses des neurotechnologies, un domaine actuellement en plein essor.
Tempérons tout de suite cet enthousiasme : nous sommes encore très loin d’atteindre ces objectifs. La technologie Neuralink est capable d’enregistrer jusqu’à environ 3 000 neurones avec ses électrodes, une prouesse en soi impressionnante, mais très insuffisante pour appréhender l’immensité des signaux cérébraux. Rappelons que le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones, qui constituent un réseau d’une extrême complexité. Les promesses d’Elon Musk ne doivent pas non plus faire oublier que cette technologie présente de nombreux risques,
AUTEUR BIO AUTEUR AUTEUR hil iquatiam, verum net re as adi endipsus eserferiaem et re con con nimet laborup ttiis erum fuga. Ut maio beruptur sit laborum quuntur aut lam
MICHEL LE VAN QUYEN est chercheur en neurosciences au Laboratoire d’imagerie biomédicale (Inserm-Sorbonne Université-CNRS) et cofondateur de l’entreprise NaoX Technologies.



Directeur de recherche à l’Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Comprendre est le graal de tout élève – ou individu en situation d’apprentissage. Notre cerveau y parvient en mettant en relation des informations et des sensations corporelles. Chose que ne savent toujours pas faire les IA, y compris la prodigieuse ChatGPT, qui a récemment défrayé la chronique.
En des temps anciens, le latin a été ma matière scolaire la plus faible… tellement faible que, lors des versions latines en seconde, j’en étais réduit à rechercher chaque mot dans le dictionnaire dans l’espoir de trouver des bouts de phrase correspondant précisément à la traduction demandée, pour les recopier bêtement sans rien y comprendre. Si je vous raconte cet épisode désastreux de ma carrière scolaire, c’est pour aborder avec vous le thème de la compréhension. Comme bien d’autres, j’ai été récemment ébahi par les prouesses de l’application ChatGPT, intelligence artificielle conçue par OpenAI. ChatGPT transforme votre smartphone en un agent conversationnel aux capacités
démesurées par rapport à celles de Siri ou l’assistant Google. En quelques secondes, il répond à n’importe quelle question formulée en langage naturel par une réponse très claire et détaillée, en grande majorité exacte (ce qui m’a bien aidé pour expliquer à ma fille pourquoi le ciel est bleu).
Mais peut-on dire pour autant que ChatGPT comprend mes questions, alors qu’il ne fait que puiser ses réponses dans une très vaste base de données à la recherche de correspondances statistiques ? En réalité, ChatGPT – tout comme l’auteur de ces lignes pendant ses contrôles
de latin – ne fait que reproduire le schéma que le philosophe américain John Searle avait envisagé à travers l’expérience de la « chambre chinoise » pour démontrer qu’une machine ne pourra jamais posséder les mêmes capacités de compréhension qu’un être humain. Dans cette expérience de pensée, Searle imagine une personne ne parlant pas le chinois cachée dans une chambre, et recevant par écrit des questions formulées par un Chinois… en chinois. Puis, utilisant un « manuel » précisant toutes les régularités syntaxiques et statistiques de cette langue, elle assemble en secret des mots pour produire une réponse écrite qui, selon le philosophe, pourrait être impossible à distinguer de celle que formulerait un véritable
Chinois, bien que l’auteur des réponses n’ait aucune compréhension de ce qu’il lit ou écrit. Searle conclurait donc que ChatGPT ne « comprend » ni les questions qu’on lui pose, ni les réponses qu’il livre en retour… ce qui nous laisse perplexe, car si un élève produisait ce niveau de réponse dans une copie, n’importe quel professeur jurerait probablement qu’il comprend parfaitement ce dont il parle. Qu’y a-t-il donc de plus dans l’idée de « compréhension », qui échappe totalement à ChatGPT ? Et qu’attend-on vraiment d’un élève quand on lui demande de comprendre un texte ou une notion ?
Les théories contemporaines concernant la compréhension du langage par le cerveau humain fournissent un précieux
élément de réponse : ce qui manquerait à cet agent conversationnel, c’est la capacité à associer un concept à une expérience sensorielle ou motrice concrète. En somme, il faut avoir des organes des sens et un corps, et s’en être servi, pour réellement interagir avec le monde physique, pour accéder à la signification profonde du langage : la compréhension est donc pleinement « incarnée ». Ces théories s’appuient sur de nombreuses expériences de neuro-imagerie, montrant une implication des cortex sensoriel et moteur lors de la compréhension de phrases ou de mots isolés. On observe par exemple que le mot « cannelle » évoque une activité au sein des régions chargées de la perception olfactive, ou

que le mot « lancer » active les zones impliquées dans la motricité du haut du corps. Ces résultats suggèrent fortement que la véritable compréhension d’un texte implique qu’on le « vive » avec ses sens et son corps, à partir de souvenirs de ce que l’on a déjà vécu en tant qu’être vivant… tout ce dont ChatGPT est parfaitement incapable, en somme.
Les débats actuels concernant ces théories de la compréhension incarnée portent principalement sur la réaction du cerveau à des mots abstraits comme « joie » ou « liberté », pour lesquels l’accès aux sens semble également utiliser des mécanismes différents – bien qu’il y ait presque toujours une possibilité d’association avec des expériences sensorielles
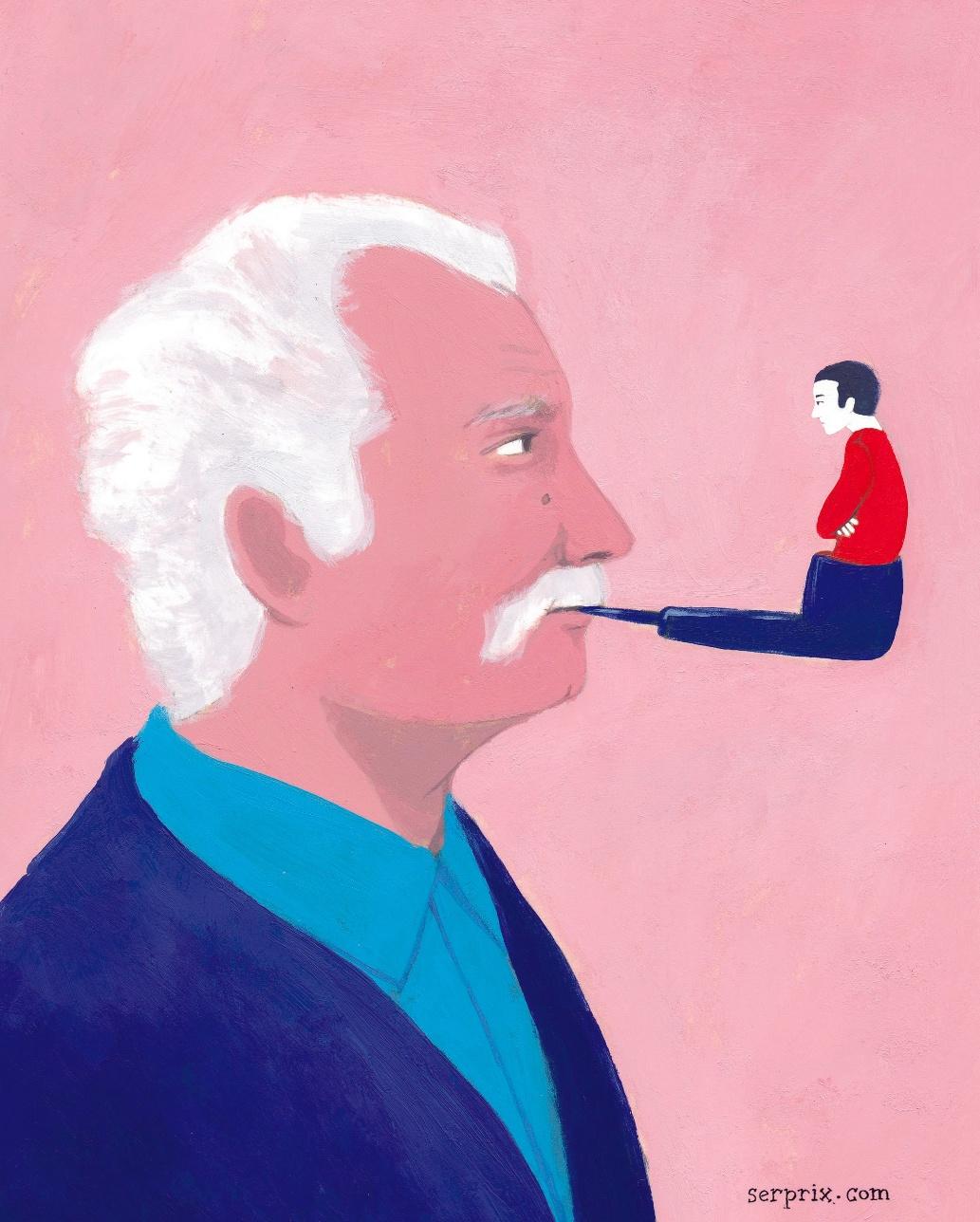
Chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’université de Fribourg, en Suisse.
k boomer ! » En 2019, ce slogan avait affolé les réseaux sociaux : nouvel avatar des clivages générationnels, il permettait de discréditer à peu de frais la parole des plus anciens d’entre nous. Jugés sexistes, pollueurs, privilégiés, réactionnaires, égoïstes et généralement ringards, les « babyboomers », cette génération née entre 1945 et 1960, pouvaient désormais être congédiés en une phrase lapidaire, signifiant en gros : « C’est bon, on t’a entendu, le fossile, mais tu ne nous intéresses pas. » Ou pour le dire plus brutalement : « Ta gueule, vieux con ! »
Mais n’est-ce pas une démonstration de plus de l’insolence et de l’ignorance historique des nouvelles générations, successivement appelées « Millennials », « X », « Y » et « Z » ? Savent-elles seulement ce qu’est un « boomer » ? N’y a-t-il pas un côté puéril à s’en prendre ainsi aux personnes en

£ Dans le langage courant, la connerie désigne tantôt de faibles aptitudes intellectuelles, tantôt la tendance à mal se comporter.
£ S’il est possible d’évoluer, divers mécanismes psychologiques s’opposent au changement.
£ Un phénomène appelé « illusion de la fin de l’histoire » nous conduit par exemple à croire que nous avons atteint une maturité définitive.
fonction de leur âge ? Décidément, il n’y a plus de jeunesse, ou pour parler plus franchement : « Quelle bande de petits cons ! »
Ainsi posés, les termes du débat ne sont guère encourageants. Surtout, ils ne sont pas très neufs. On trouve aisément des propos semblables dans l’Antiquité, critiquant l’arrogance et l’incurie de la jeunesse, ou décriant l’immobilisme et l’incompétence des aïeux. Sommes-nous vraiment condamnés à passer du statut de jeune con immature à celui de vieux con gâteux, sans autre espoir de changement ? Pour examiner cette question, peut-être vaut-il la peine d’entendre l’« impartial message » d’un observateur « qui balance entre deux âges ».
Il s’agit bien entendu de Georges Brassens, qui, alors âgé de 40 ans, avait posé ce diagnostic en 1961 : « Quand on est con, on est con. »
Dans cette chanson, Georges Brassens semble dire que les « cons » sont condamnés à le rester. Est-ce si sûr que cela ?
Des entreprises sud-coréennes proposent de simuler vos propres funérailles, avec rédaction de votre épitaphe, habillement funéraire traditionnel et enfermement (temporaire) dans un cercueil, de quoi méditer sur la valeur de l’existence.
On reconnaîtrait un supporteur fanatique au fait qu’il demande toujours la même bière au comptoir lors des matchs de son équipe et que, fétichiste, il collectionne des objets ayant appartenu à des joueurs.
Les anciens Grecs décrivaient volontiers les femmes comme hystériques, car leur humeur aurait été assujettie à leur utérus (hysteros), en témoignaient les fréquentes fluctuations émotionnelles au cours de leurs règles. Platon lui-même supposait que leur dépit venait alors de ne pas avoir conçu d’enfant… Aujourd’hui, les neuroscientifiques explorent plus sérieusement les liens entre menstruations et variations de l’humeur.
21 %
des Français adultes sont amenés à souffrir, au moins une fois dans leur vie, d’un trouble anxieux.
La fameuse IA qui répond à toutes les questions dans un langage clair et sensé serait un exemple de « chambre chinoise », mécanisme décrit par le philosophe John Searle, qui assemble des mots de façon à produire des phrases qui ont un sens, mais qui n’en perçoit aucunement la signification.
Visiter un temple bouddhiste augmenterait la capacité à renoncer à des plaisirs instantanés pour en retirer des bénéfices plus tard. Moins de consommation tout de suite, une meilleure planète pour nos enfants ?
Les schémas de connexion des neurones à longue distance dans notre cerveau formeraient une empreinte appelée « connectome », qui prédit en partie nos capacités d’intelligence fluide, ou raisonnement abstrait.
« Le connard type serait, en moyenne, un homme de 42 ans – époux, copain, collègue, chef – arrogant, raciste, exigeant et grossier »
Sebastian Dieguez, université de Fribourg
retrouver dans ce numéro









