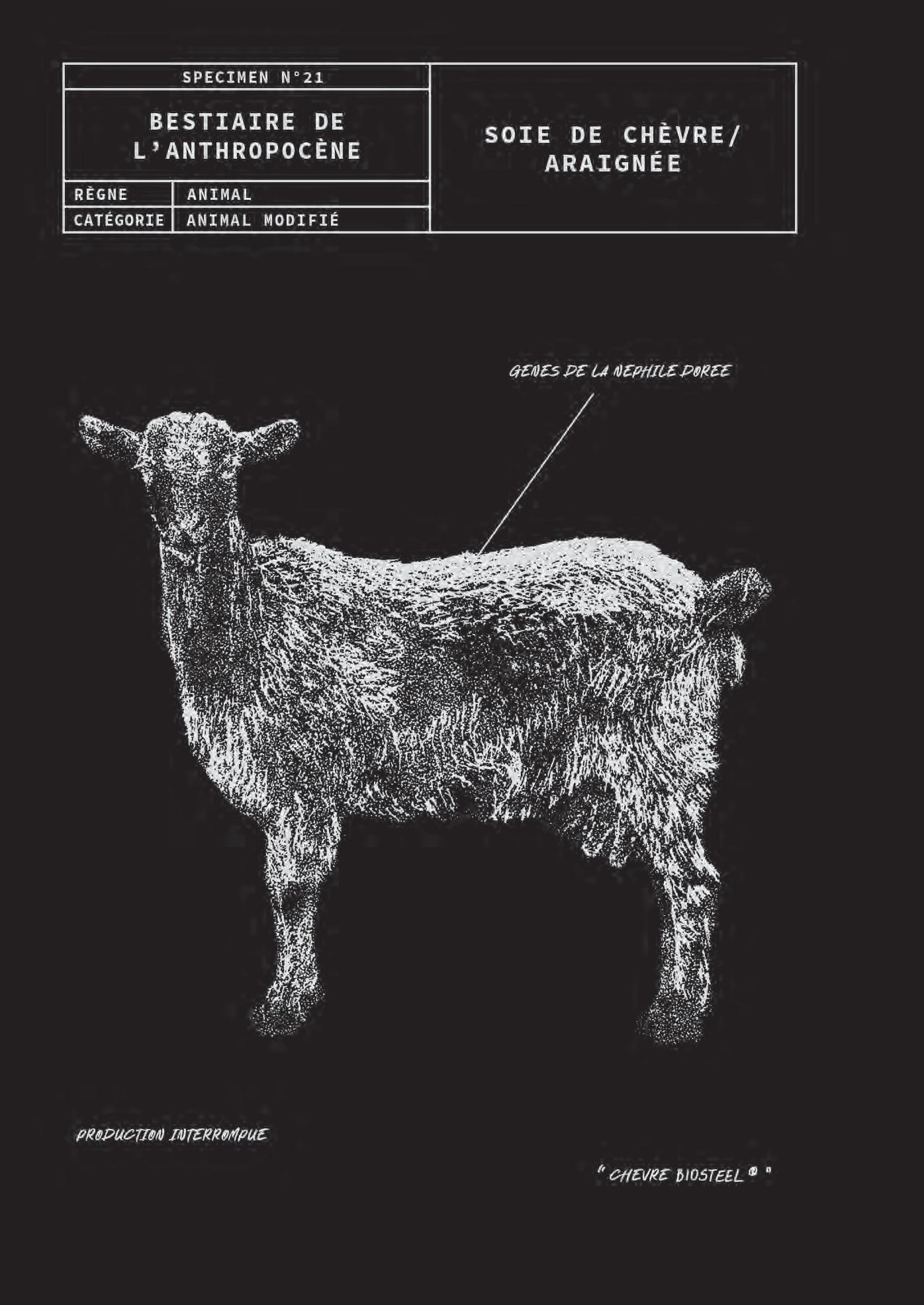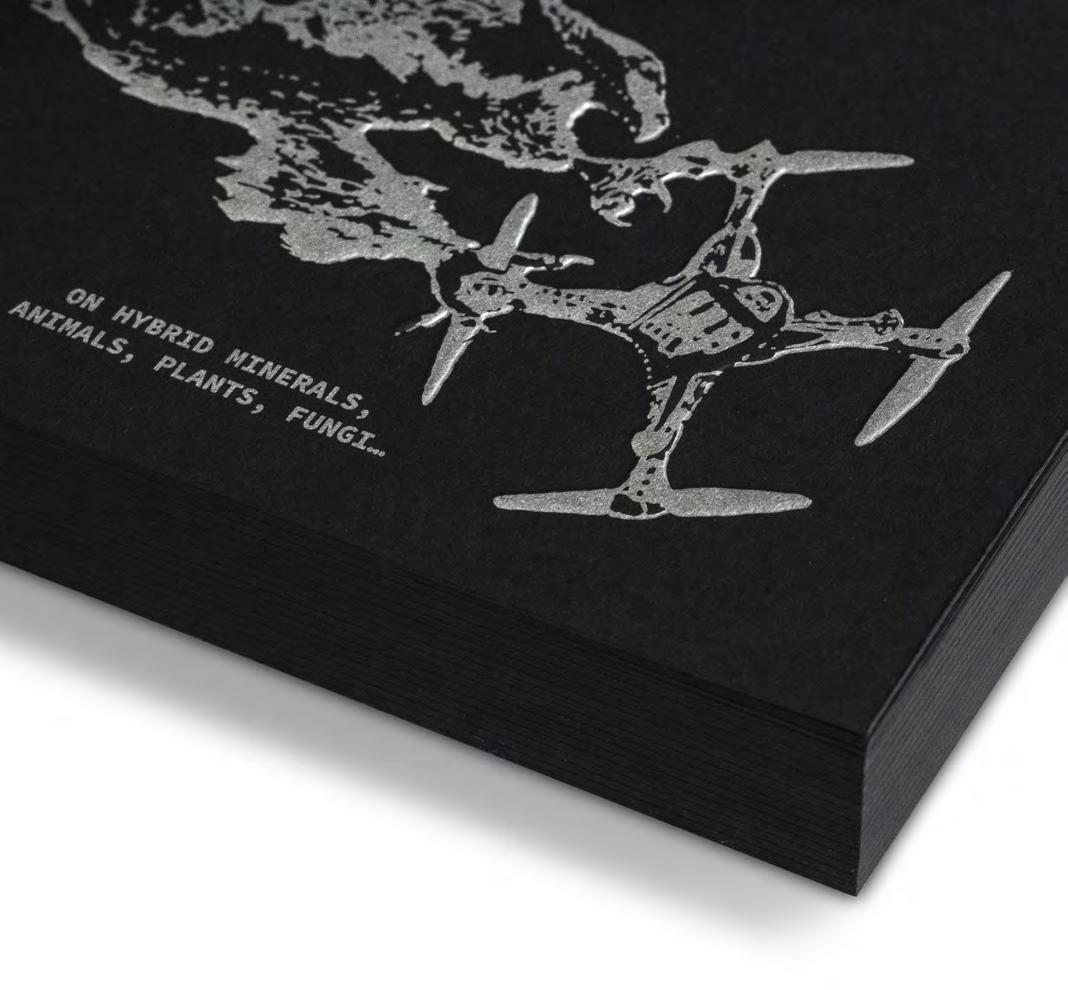Nouveautés avril-juillet 2025 Littérature Poésie Sciences humaines


Littérature francophone

demain les flammes histoire orale

ean : 9782492667084
Parution : septembre 2023
Pagination : 160 p.
format : 11,5 x 17,8 cm
Prix : 10 €
Couverture dorée à chaud
deuxième édition
nAthAn Golshem et s’ouvre enfin la maison close
L’histoire orale d’un squat au tournant du siècle
L’histoire orale d’un squat
La légende raconte que, au cœur d’un ancien bordel à l’architecture baroque ravi à la rapacité du marché immobilier, des gens fougueux et pleins d’espoir s’engouffrèrent à bride abattue dans le tourbillon d’une vie collective. Là, ils vécurent des expériences aussi formatrices qu’exaltantes en conduisant une guerre contre le Vieux Monde.
Si le squat du Clandé (1996-2006) ne vous évoque rien, si vous ne connaissez pas la ville où il a existé –Toulouse –, et si vous n’avez jamais mis les pieds dans un lieu occupé, tant mieux. Puisse cette histoire orale vous égarer dans un univers fécond où s’ébattent des gens emportés par des imaginaires politiques et culturels d’une rare puissance.
Récipiendaire du Groprix du festival Groland, 2022
demain les flammes
43, rue de Bayard / 31000 Toulouse contact@demainlesflammes.fr / demainlesflammes.fr
avant-propos
notre histoire
C’est toujours la même histoire Des gens jeunes, fougueux, pleins d’espoir, s’engouffrent à bride abattue dans le tourbillon d’une vie en éclosion. Puis, on ne sait pas trop pourquoi, on perd leur trace, ils disparaissent. Et avec eux leurs anecdotes, leurs récits, leur expérience. Nous ont-ils quittés épuisés, meurtris, déçus, ou bien le courant des événements les a-t-il simplement emportés vers d’autres rivages ? Comment savoir, maintenant qu’ils ne sont plus là ? Les livres n’en parlent pas – ou si peu, ou si mal. Bien sûr, j’exagère. Bien sûr, les histoires se transmettent. Autrement, nous serions condamnés à répéter inlassablement les mêmes erreurs, telle une farce moins drôle à chaque représentation. Sauf que ce n’est pas si simple. Il faut que les plus âgés soient encore là, prêts à ne pas garder le silence, et qu’ils racontent – les mythes et leur envers, la sueur, l’effort, la poisse, l’attente, la banalité d’un quotidien parfois morne, en tout cas moins séduisant qu’un étincelant cocktail enflammé volant en un parfait arc de cercle vers des cieux azurés, ou qu’une amitié d’une telle intensité qu’elle perdurera jusqu’à la fin des temps, croix d’bois croix d’fer. Enfin, il faut savoir les écouter. Sans cela, le poids des exploits de nos aînés ne ferait qu’accentuer
notre sentiment d’impuissance, et on peinerait à trouver des récits qui ressemblent à nos vies – pleines de ratés, d’hésitations, de petites joies et de découragements aussi intenses qu’inconséquents.
J’étais trop jeune pour que l’histoire du squat du Clandé soit la mienne. Il m’a manqué quelques mois. Ou bien un peu plus d’obstination pour convaincre mes parents de laisser partir leur fils de quinze ans dans un univers dont ils ne soupçonnaient même pas l’existence. Mais franchement, ce n’est pas bien grave. Ne faut-il pas aussi des gens pour écarquiller les yeux de surprise et d’admiration, ou rire aux éclats quand quelqu’un raconte une bonne histoire ? Ne faut-il pas des gens pour répandre les légendes et espérer vivre à leur tour des aventures similaires ? Après tout, sans public, un concert n’est plus qu’une simple répétition. Et il y a autre chose. En grandissant au milieu du punk, je me suis retrouvé dans un tiraillement existentiel ; je me projetais dans un ailleurs que jamais je n’aurais été en mesure d’envisager quelques années plus tôt, et qui sous de nombreux aspects faisait basculer vers une incertitude abyssale cette vie que j’avais imaginée toute tracée, stable, remplie de certitudes. Là, je naviguais dans un univers où les ruptures étaient courantes et les questionnements féroces. Des gens arrivaient puis repartaient, d’autres hésitaient, mes convictions s’effondraient pour mieux renaître, des amis occupaient une maison, on y voyait des concerts, puis du jour au lendemain ils étaient expulsés. C’était vivant, c’était intense, mais tenir le cap sous l’avalanche d’autant d’émotions n’était pas chose aisée.
Or, il était une histoire qui ne semblait souffrir d’aucune querelle, tel un long fleuve tranquille de bonheur partagé – un mythe, en somme. Était-il vrai que dans un ancien bordel
reconverti en squat autogéré avaient vécu des êtres heureux qui, aujourd’hui encore, étaient liés par une indéfectible fraternité ? Se pouvait-il que ce que je lisais dans les fanzines à propos d’un ailleurs fantasmé, ce que j’imaginais avoir eu cours en d’autres temps et en d’autres lieux ait existé si près de moi ? Mieux : se pouvait-il que j’en connaisse certains des protagonistes ?
C’est en 2015 que j’ai eu l’idée de ce livre. En 2016, j’ai consulté les archives. En 2017, j’ai posé mes premières questions, souvent sans micro. Ensuite, j’ai fait autre chose. Puis je m’y suis remis : 2019, 2020, 2021. Enfin nous voici, vingt-six ans après l’ouverture du Clandé, en 1996, et seize ans après son expulsion, en 2006, au seuil de l’histoire d’un squat racontée par une partie de celles et ceux qui l’ont faite. La mémoire, fidèle alliée de l’approximation, aime à travailler dans son coin. Et c’est très bien ainsi : ce livre n’offre aucune exactitude historique. Il tente plutôt de saisir ce qu’a pu être pareille expérience pour toutes ces personnes, ce qu’elles en ont fait pendant, après, ailleurs. Ce livre cherche à transcrire un bout des émotions qu’une aventure aussi forte a pu susciter chez les gens qui l’ont vécue. Alors, si le Clandé ne vous évoque rien, si vous ne connaissez pas la ville où il a existé – Toulouse –, si vous n’avez jamais mis les pieds dans un squat, tant mieux. Puisse ce livre vous égarer dans cet univers fécond où s’ébattent des gens emportés par des imaginaires politiques et culturels d’une rare puissance.
Il m’aurait fallu des heures et des heures d’entretien supplémentaires, puis consacrer des heures et des heures encore à la recherche et à l’écriture pour prétendre faire autre chose qu’une exploration subjective et parcellaire centrée sur une poignée de personnages dont les actes et les imaginaires
se nourrissaient mutuellement. Et il manque tellement de choses… J’aurais aimé intégrer à ce récit d’autres versions des faits ou d’autres généalogies explicatives. J’aurais rêvé épiloguer sur les murs de guitares d’Aghast et les mélodies arrache-cœur de Sed Non Satiata, conter l’attaque d’une banque à l’ammoniac, les occupations de l’agence pour l’emploi par des chômeurs et précaires, le murage du siège du Parti socialiste en soutien aux sans-papiers, les souvenirs de quelques faussaires, les aventures des autres squats qui peuplaient la ville, ou m’épancher sur des soirées durant lesquelles les lendemains comptaient si peu, faire revivre les anonymes innombrables qui habitèrent ces murs le temps d’une après-midi, d’un concert ou d’un passage dans cet infokiosque où se forgeaient des amitiés et des vocations… Oui, j’aurais tellement aimé… Mais le temps m’a manqué. Et j’ai compris une chose : il y a urgence. Il faut vivre.Vite !
Nathan Golshem
chapitre premier
grève générale et définitive
AlexiA • Le jour du bac, j’ai oublié d’y aller.
Federico • J’ai passé mon bac pour faire plaisir à mes parents. Et je l’ai raté.
AlexiA : Au lieu de repiquer ma terminale, je me suis mise à la radio. Cette année-là, en 1987, on a monté une section du SCALP [Section carrément anti-Le Pen] contre le Front national qui menaçait de prendre la mairie de Grasse, près de Nice, où j’habitais.
Federico : Avec un pote, on voulait acheter un camion et partir sur la route. On s’est donc retrouvés à Grasse pour gagner de la thune. On y a loué un appart, mais c’était la galère. Lui, il était barman, moi je faisais la plonge. Mes parents m’aidaient pour que je repasse le bac, on avait des aides de la CAF, et dans notre appart de quarante-huit mètres carrés au loyer de mille cinq cents francs [deux cent vingt euros], de deux habitants, on est montés à trois, puis à sept !
AlexiA : Dans ma famille, j’étais un ovni. C’est comme si j’avais été écorchée quelque part dans mon enfance… Peut-être que si j’avais été une fille chouchoutée, je ne me serais pas lancée dans ces engagements qui ont façonné ma vie. Ou bien peut-être que j’avais déjà cet intérêt pour le monde et ses inégalités, et qu’il suffisait d’y aller. Je ne sais pas.
mickAël • Mes parents étaient plutôt des petits fonctionnaires conservateurs. J’avais besoin d’air. Porté par le désir d’aventure et le délire d’emprunter le chemin foulé par les beats, j’ai voyagé en Inde avec un ami. En rentrant, je voulais devenir musicien de rock. Alors j’ai pris la route.
Federico : Depuis notre appartement où toujours plus de gens s’entassaient, on a entendu dire qu’un squat venait de s’ouvrir à Grasse. On est allés le voir, on a sympathisé avec ceux qui y vivaient et on s’y est installés. La maison avait beau être grande, on s’y retrouvait un peu à l’étroit. On jouait de la musique et on organisait des spectacles dans la rue pour gagner de la thune. On faisait la manche, de la récup’, on volait, on vendait de la drogue, en bref on se foutait de la légalité, mais sans que ce soit très réfléchi. À l’époque, je savais que je ne voulais pas rentrer dans le système. En gros, je souhaitais qu’on puisse changer nos vies tout de suite.
mickAël : Mon rêve d’être un beat s’est transformé en un voyage à pied en Irlande, avant de devenir musicien de rue en Belgique et à Londres. J’aspirais à la bohème ; j’ai fait des petits boulots et je me suis transformé en clochard. Je m’étais fabriqué un imaginaire
eT s’ouvre enfin la maison Close
rimbaldien, je n’attendais rien du collectif et je pensais vivre toute ma vie en pérégrinations.
Federico : Certains habitants avaient entre trente et quarante ans, mais il y avait aussi des enfants, des exlégionnaires et la zone du coin. Des couples s’embrouillaient, on prenait des acides… Au milieu de ça, des groupes en tournée déboulaient en camion pour jouer aux concerts qu’on organisait. De trente personnes, on pouvait passer à cinquante pendant deux semaines. On ne discutait de rien – le ménage, les chiens, la vaisselle, etc. C’était le bordel absolu.
Cette expérience de squat m’a durablement marqué. Aujourd’hui, je crois qu’on dirait que c’était violent. À l’époque, je ne le voyais pas comme ça.
mickAël : À un moment, j’ai senti que je laissais passer mes chances de faire des études et d’obtenir un diplôme. Alors je me suis lancé dans une formation de deux ans pour devenir documentaliste, à Tours, où ma copine m’a rejoint. Puis on a décidé d’emménager ensemble à Toulouse, comme un petit couple.
Éric • Je suis venu m’installer à Toulouse parce qu’à Castres on était toute une bande à être bien grillés. Je jouais dans un groupe punk. On zonait jour et nuit, on foutait le bordel, on s’embrouillait avec les commerçants, les paras et les skins fachos. Sans oublier les flics qui ne nous lâchaient pas. On a fini par prendre du sursis. Il fallait partir.
Federico : En juin 1994, j’ai passé mon bac. On n’en pouvait plus de Grasse, des embrouilles, de la violence,
eT s’ouvre enfin la maison Close exTraiTs
et on voulait intervenir dans le monde. Je rêvais d’appartenir à ce que j’appelais le « mouvement squat » – on avait même fabriqué un drapeau avec la flèche dans le cercle. On a pris la direction de Toulouse complètement par hasard. On était quatre. Un pote nous avait dit : « C’est sympa là-bas. » Alors on est partis.
Éric : De la bande, on était plusieurs à habiter juste à côté de Toulouse, vers Muret. Avec le groupe, Légitime Défonce, on était très proches de groupes de punk comme Kochise, à Agen, ou Enola Gay, à Auch. Le lien, c’était la radio associative Canal Sud* : on y faisait tous des émissions et j’y bossais. En plus du groupe, on organisait des concerts sauvages en lien avec le label Panx. On faisait tourner des groupes finlandais, espagnols, américains… À part les bars, il n’y avait pas d’endroits pour jouer sur Toulouse, donc on se démerdait. On faisait des concerts où on pouvait : MJC, salles de danse, ancien moulin et bien sûr à la radio où, en décembre 1994, on a accueilli Tromatism, un groupe dans lequel jouait Loran, ex-membre des Bérus, qui n’hésitait pas à filer la main pour ouvrir des squats.
mickAël : Un jour, ma copine a entendu parler d’une réunion qui appelait à la constitution d’un nouveau collectif pour soutenir les zapatistes du Chiapas en lutte. Elle avait lieu à la radio Canal Sud, et je m’y suis fait traîner. C’est là que j’ai rencontré tous ceux qui
* Radio pirate créée en 1976 sous le nom de Radio Barbe Rouge, elle devient l’une des premières radios libres en juillet 1981, après la libération des ondes. Depuis, elle n’a cessé d’émettre et de chroniquer la vie politique et militante sur la fréquence 92.2 FM. (Toutes les notes sont de l’auteur.)
feront partie de l’aventure du Clandé. C’est aussi ce jour-là que j’ai rencontré pour la première fois Alexia, avec qui je vis maintenant. Elle était là, dans la lumière tamisée, avec son bonnet…
Cette radio, c’est le coup de foudre. Dans mes pérégrinations, j’avais surtout rencontré des gens paumés ou des ambiances punk glauques. Là, c’est le jour et la nuit. Dans ce collectif en soutien au Chiapas et cette radio se cachaient la vieille garde gauchiste toulousaine, des restes de 68, mais aussi des jeunes en opposition, des écolos, des punks. J’ai été conquis, immédiatement.
AlexiA : Avant de partir de Grasse pour aller faire des études de sociologie au Mirail, à Toulouse – mon bac en poche, contre toute attente –, j’avais entendu parler de la radio Canal Sud. C’est là que j’ai rencontré beaucoup de gens, en plus de Mickaël. Sur la fac, l’année où je suis arrivée, il y avait des grèves, des occupations. Je connaissais déjà l’histoire militante de Toulouse, celle de l’Espagne et de l’antifascisme, de la CNT [Confédération nationale du travail].
mickAël : Toulouse était une ville provinciale qui, par endroits, fleurait encore bon les années 1960. Imaginez les coupe-gorge ou les bistrots avec un trou pour faire chiotte – une pratique sans âge…
Éric : Lorsque je me suis installé à Toulouse, en 1991, les pauvres, les étudiants, les chômeurs et les travailleurs précaires vivaient dans le centre-ville, où on trouvait encore des artisans et des grossistes. On habitait quasiment tous dans des appartements des quartiers centraux. Ils étaient petits, vétustes, ils dataient des
eT s’ouvre enfin la maison Close exTraiTs
années 1960-1970, mais ils n’étaient vraiment pas chers. Les bourgeois, eux, créchaient dans les beaux quartiers, alors qu’aujourd’hui ils ont récupéré leurs biens au centre-ville.
Federico : Ma bière, à l’époque, je la buvais dans un squat ou dans la rue – là où je vivais. Certains lieux de la ville étaient déglingos. Je me rappelle d’un type avec qui je tapais des bœufs de guitare tout le temps. Je zonais, je faisais la manche, j’emmenais les chiens à droite à gauche, et la ville n’avait rien à voir. Il y avait moins de bars chics, on ne mangeait pas de kebab ni de falafel dans la rue, la ville était beaucoup moins bourgeoise. Mais peut-être que c’est ma position ou mon regard qui ont changé. Qui sait ?
Éric : La ville manquait de squats. Or, cet ancien édifice de l’ordre des templiers était gigantesque. Et vide. Quand tu étais dans les sous-sols, tu avais l’impression d’être dans un château fort. Il n’en fallait pas moins pour que naisse le projet d’occupation de la Ville habitée.
Alice • Les préparatifs avaient duré des mois et des mois et rassemblé tout un tas de collectifs de différentes cultures politiques. Le but de la Ville habitée était d’avoir un lieu alternatif au secteur marchand, un lieu ouvert et transversal qui réunisse des associations, des collectifs et des individus.
Éric : Le jour de l’ouverture, une manif – un leurre –a éloigné les flics, tandis que des gens se précipitaient

Se donner les moyens de refaire une Cité. edi4ons-exces.net edi4ons-exces@protonmail.com

SURGEONS ET AUTRES POUSSES
Livre de Maria Kakogianni, Marie Rouzin
Amalia Ramanankirahina
Réédition
A paraitre le 1er mars 2025
Excés, collection Voix publiques
Livre
14,50 x 22 cm
128 pages
Prix : 16€
ISNB : 78-2-9581188-3-9
Résumé

A mi-chemin entre l’herbier, l’essai sensible, la réflexion philosophique et les surgeons politiques, ce livre présente une collection de textes et d’images des plantes, ainsi que des tentatives, plus ou moins réussies, de faire monde avec elles et non pas en dépit d’elle, en se débarrassant peut-être un peu de la figure de l’homme-jardinier qui maîtrise la nature, faisant d’elle le décor de son action. Ce livre est le fruit de la rencontre de trois femmes. Elles explorent les gestes et les terreaux d’émancipation dans les ravages de l’exploitation intensive du vivant, des corps et des langages
Littérature - Essai - Eco-féminisme - Jardin
« Noues sommes le travail féminisé, précaire, non déclaré. Vies jetables, malformées, épuisées, parasites, noues sommes les restes de leurs indices de performance. Noues sommes les questions à toutes leurs réponses.
Noues sommes le sol glissant d’une grammaire où la police assassine.
Noues sommes les herbes folles dans les pelouses patrimoniales.
Ce qui n’était que pollen devient fruits épineux. Puisse-t-il en être de même de nos créations et de nos pousses
Qu’elles dansent et dérangent, qu’elles sèment le trouble et la colère,
Et se dégustent avec attention sans essuyer les pieds avant de passer à table.
Surgeons-nous »

Biographie des auteures
Maria KAKOGIANNI est travailleuse du texte avec une formation de philosophe. Écrire, traduire, performer, transmettre, faire des montages avec des sons et/ou des images, dans ce travail non hiérarchique avec la chair des mots et leur rythme, elle se sent proche des mots de Toni Morisson :« We do langage ». Parmi ses publications : Printemps précaires des peuples (éditions Divergences, 2017), Ivre décor (Hippocampe éditions, 2020), Iphigénie à Kos (éditions Excès, 2024).
Marie ROUZIN est auteure et enseignante. Elle écrit des textes poétiques et des textes pour la scène dans lesquels elle interroge le collectif, les gestes d’émancipation et la métamorphose des êtres. Elle a notamment publié Circulus (Serge Safran éditeur, 2018) et Treize âges dans la vie d’une femme (Le Castor astral, 2024).
Biographie de l’artiste

Amalia RAMANANKIRAHINA est artiste et restauratrice d’œuvres d’art. Dans ses œuvres, elle tisse des liens entre son expérience personnelle et sa biographie franco-malgache. Ses derniers travaux s’intéressent à la botanique, aux circulations des plantes qui font écho à l’histoire des déplacements humains, aux destructions coloniales mais aussi à des actes de résistances et de transformation.
INDEX DU JARDIN DES PLANTES
Achillée millefeuille…............................................................……. .p. 71
Ailante…...............................................................…….................. .p. 23
Almyriki (Tamarix)… ...................................................................… .p. 19
Amarante…..............................................................................… …p. 53
Amandier…................................................................................... .p. 27
Artemisia annua (青蒿 )…............................................................... .p. 33
Bambou…................................................................….................. .p. 37
Bégonia malculâta…..................................................................... .p. 35
Cardamine hirsute….............................................................. .pp. 54, 80
Catalpa…...................................................................................… .p. 25
Cheveux d’ange (Stipa tenuissima) … ............................................ .p. 30
Chêne…....................................................................................…. .p. 95
Dogue (Rumex)…........................................................................…p. 51
Érable…........................................................................................ .p. 94
Fenouil sauvage….........................................................................p. 74
Figuier…....................................................................................... .p. 91
Fraisier…...................................................................................... .p. 85
Hêtre…......................................................................................... .p. 95
Jasmin…....................................................................................... .p. 90
Maïs….......................................................................................... p. 53
Marronnier…................................................................................. p. 47
Mélisse…......................................................................... .pp. 45, 60, 64
Milleperthuis perforé (Hypericum perforatum) …………… p. 76
Nifinakanga............................................................................. p. 101
Olivier……….…........................................................................pp. 24, 99
Ortie….......................................................................................... ..p. 51
Passiflore…........... . ..........................................................................p. 58
Patate douce….......................................................................... p. 105
Pensée…....................................................................…................ ..p. 57
Peuplier…..................................................................…................ p. 97
Pissenlit…............................................................................. pp. 54, 79
Plantain…..................................................................................... ..p. 53
Renouée….................................................................................... ..p. 43
Rosier…........................................................................................ p. 86
Sauge………………………………………………………………......................p. 66
Thuya…....................................................................................................p. 39
Tomate…..................................................................................................p. 79
Trèfle…..............................................................................................pp.54, 80
Vanille (Tlilxochi)......................................................................................p. 103
Verveine citronnée…................................................................................p. 64

FRAISIER (extrait 2)
Hier j’ai passé une grande partie de l’après-midi à travailler au jardin, après pratiquement deux mois d’absence, il en avait besoin et moi aussi. J’ai retrouvé quelques-unes de mes plantes qui avaient souffert. Mais je me suis surprise à rire avec le fraisier. Je le savais envahissant mais pas à ce pointlà. Il était sorti du carré-potager, et passé par-dessus les planches en bois, il avait commencé à avancer tranquillement vers d’autres terrains. Les fraises ont une texture fragile qu’on doit manipuler avec précaution, mais la plante, envahissante et robuste, semble presque à l’opposé de ses fruits. Nous ne créons pas toujours à notre image. Voilà ce qui m’est apparu aujourd’hui en riant avec mon fraisier. Sinon nous ne créons qu’avec nos symptômes.
Qu’est-ce qu’un auteur ? Est-ce que le fraisier est auteur de ses fraises ? Elles ne sont jamais identiques, elles dépendent de la plante-mère mais aussi du sol, de l’arrosage, du climat, des gestes de jardinage ou pas, des puissances d’agir en conflit ou pas. Est-ce ma volonté ? Je suis auteur de ce texte alors que le fraisier ne le sera jamais de ses fraises parce que je veux écrire un texte ? Et si Dieu n’a pas « voulu » créer le monde ?
Fictions spéculatives.
Depuis longtemps, « l’homme » se voit au-dessus du fraisier avec une part divine en lui, à la fois terrestre et extra-terrestre. Il pense que son côté « auteur » correspond précisément à sa part divine, créatrice et capable d’éternité. Un auteur est un petit dieu avec quelques défauts. Que les autres d’ailleurs doivent accepter et comprendre pour protéger son génie. Moi je.
Hypothèse inverse.
Et si être un sujet libre, autonome, rationnel, est une fiction toxique pour ce qui est de « l’auteur » ? Et si la seule véritable fiction d’autonomie était celle qui choisit ses dépendances ? Et si Dieu avait choisi de dépendre d’un monde plutôt que de rien ?
Ce sont des fictions. Le Dieu des romantiques est un tapissier, celui des libéraux nouveaux un comptable.
J’avoue. Sauf quand j’écris un chèque pour régler ma facture d’électricité, payer mon dû, ce que j’écris ne correspond jamais tout à fait à ma volonté. Et quand j’écris, je ne sais jamais d’avance ce que je veux écrire. Je trouve parfois un sens sur le chemin. Parfois non. Ça dépend du climat, des rejets de moi, attendre et voir si ça donne quelque chose. Autre chose que moimême. Ou pas.
Bref, petite pensée jardinière d’hier. POUSSÉES




DIDIER RITTENER
D’après, à cause, grâce à, etc.
Il les avait brièvement prévenu·e·s.
Il leur donnerait des images et ils·elles écriraient dessus.
Pas matériellement dessus, mais à leur sujet. Ce n’étaient pas n’importe quelles images.
Les dessins sont issus d’une série intitulée Libre de droits, un titre qui provient d’encyclopédies visuelles autorisant la reproduction et servant d’inspiration aux artistes. La pratique du dessin est ici envisagée comme une économie de moyens pour tenter d’absorber les motifs et les inscrire dans l’inconscient collectif Quels récits sont transportés par l’image ? Comment opèrentelles sur notre compréhension du monde ? Pour répondre, Didier Rittener a proposé à des auteurs et des autrices d’écrire une notice. Par sa forme concise et sa vision synthétique, la notice est un genre en soi, suffisamment captivante pour être lue, suffisamment claire pour transmettre des informations. Dans cet ouvrage, elle est un espace laissé à l’imagination pour ouvrir des points de correspondance avec le dessin.
Avec des textes d’autrices et d’auteurs tels que Carla Demierre, Valérie Mréjen ou Philippe Rahm, le livre remet les images dans une circulation collective et les fait entrer dans la légende.
collection CAT. Contextuel
format 12 x 20 cm, 228 p., broché isbn 978-2-88964-079-9 prix CHF 24 / € 24
La notice est ici conçue comme un espace créatif à part entière, laissant à chacun·e la liberté d’explorer et de proposer une perspective nouvelle
– descriptive, analytique,
narrative ou poétique – sur l’image qu’elle accompagne.
notices par Katharina Ammann, Caroline Anderes, Natacha Anderes, Ralf Beil, Christian Bernard, Marianne Burki, Anna Byskov, Joëlle Cachin, Garance Chabert, Jean-Pierre Criqui, Irène D’Agostino, Carla Demierre, Julie Enckell, Séverine Fromaigeat, Gilles Fürtwangler, Jérémie Gindre, Pamella Guerdat, Maria Guta, Carole Haensler, Cathérine Hug, Frank Lamy, Elisa Langlois, Pierre Leguillon, Claire Le Restif, Federica Martini, Jelena Martinovic, Valérie Mréjen, Damian Navarro, Joana P. R. Neves, Véronique Portal, Chantal Prod’hom, Fabienne Radi, Dominique Radrizzani, Philippe Rahm, Lucie Rico, Laurence Schmidlin, Benjamin Stroun, Claude-Hubert Tatot, Caroline Tschumi, Thu Van Tran, Isaline Vuille, Anaïs Wenger, David Zerbib
Didier Rittener vit et travaille entre Lausanne et Genève. Diplômé de l’ECAL, il enseigne à la HEAD – Genève. Grâce au dessin, il se questionne sur le statut et la pérennité des images. Par la lenteur d’exécution, le geste et la fabrication, cette pratique devient une façon d›intégrer les représentations des mondes que nous habitons, une économie de la lenteur pour une digestion engagée et partagée. La disparition est une notion constante dans son travail qui interroge les rapports entre la diffusion des images, leur reproduction et la notion de propriété. Portrait

Introduction
Entre autres
Il les avait brièvement prévenu·e·s. Il leur donnerait des images et ils·elles écriraient dessus. Pas matériellement dessus, mais à leur sujet. Ce n’était pas n’importe quelles images. C’était les siennes. Plus précisément, c’était devenu les siennes, car il ne s’en cachait pas, il les avait empruntées à d’autres comme sa terminologie le signalait : d’après, à partir de, notes. Il y avait aussi des images vraiment à lui, des photographies. Sous sa main munie d’un crayon gris, elles étaient aussi devenues des dessins. Mais comme tout ce qu’il s’était approprié en le recopiant, comme tout ce qu’il avait arraché à l’oubli, ces images ne lui appartenaient pas plus. Il les concevait libres de droits, selon le titre donné aux ouvrages qui présentent l’archive de motifs, phrases, ornements, paysages et figures, qu’il collecte depuis 2001. Ce titre lui avait été inspiré par la mention légale relevée sur la jaquette de l’Encyclopédie visuelle de
dans l’habitude, et l’important pour lui, c’était la variété de points de vue. Le temps a passé. Il s’est retrouvé avec tout ce qu’ils·elles avaient écrit des milliers de mots pour ses dessins. Il leur a donné une forme, celle du livre de poche traditionnel, en cohérence avec l’ambition portée par son travail artistique qui s’inspire des recueils de modèles : démocratisation du contenu et modestie des moyens. La légende précède chaque image qui précède chaque notice. À chacune sa page. Elles s’illustrent, se répondent, s’influencent, tout en conservant un statut équivalent, mais sans pour autant disposer de la même autonomie puisque seules les images peuvent s’émanciper de cet ouvrage, participant au système circulaire propre à la répétition comme à la reproduction. Les notices ont été placées dans l’ordre de création des dessins pour éviter qu’il ne doive se justifier de tout classement. La séquence s’est renouvelée jusqu’à la livraison du dernier texte. Il ne s’en est pas préoccupé, il a laissé faire. S’il a confié au hasard la tâche d’organiser la matière, il s’est montré plus personnel en donnant les sources de ses dessins de manière explicite et avec une précision méticuleuse.
Désormais tous·tes crédité·e·s, il pouvait s’effacer derrière eux·elles. C’était cependant sans compter sur le penchant de ses auteur·trice·s pour la loyauté. Il n’avait rien vu venir. Il était omniprésent, nommé incessamment. Certain·e·s en avaient presque fait un personnage. Ainsi, Didier Rittener propulse, Didier Rittener donne vie à l’épopée, Didier Rittener efface les frontières, Didier Rittener inscrit sur un vieux mur, Didier Rittener intègre, Didier Rittener indique, Didier Rittener prend la tangente, Didier Rittener se rend dans le bois de Chervettaz. Et puis, Didier Rittener est un enchanteur des temps passés, un peintre des univers, un artiste contemporain des préoccupations écologiques, un démiurge absolu, un classique contemporain. On le trouve parfois privé de son prénom, c’est alors juste « Rittener » ou encore « D. Rittener », mais aussi l’inverse, c’est alors familièrement « Didier ». Il arrive aussi qu’il ne soit désigné que par ses initiales dans lesquelles on ne peut s’empêcher de lire, comme une fatalité, la mention « Droits Réservés ». Alors quand il l’a prévenue qu’elle aussi écrirait, mais qu’elle ne pourrait pas choisir un dessin, qu’elle devrait parler de tous ou d’aucun, elle renonça à le citer. Après tout, comme elle n’avait pas reçu d’image, elle
J. G. Heck, publiée aux éditions L’Aventurine, en 2001, qui rassemble des milliers de motifs libres d’utilisation. Au moyen de cette désignation, il ouvrait ainsi une réflexion sur la diffusion des images, le principe de reproduction, la propriété non seulement intellectuelle mais aussi matérielle, la logique de marchandisation des biens culturels, l’économie circulaire du dessin, le désir de partage. En confiant ses dessins à d’autres, il ne pourrait donc les rendre coupables de recel puisqu’il ne ferait que leur déléguer la responsabilité de puiser dans ce répertoire iconographique pour créer. Il aimait aussi l’idée que les images se propagent. Il croyait à leur valeur publique, à leur statut de bien commun, tout en sachant qu’elles n’échapperaient pas à la propriété privée. Il le reconnaissait, la bataille était perdue. Pourtant, comment une image ne pourrait-elle être pleinement à soi, dès lors qu’on l’a saisie du regard ? N’est-elle pas une ressource mutualisée dans la mesure où elle forge nos représentations collectives du monde ? Comment imaginer que nul·le ne confisque les images existantes avant d’y ajouter les siennes pour que les suivant·e·s, à leur tour, assimilent ce qui les marquent, les interpellent, les attirent, et le restituent sous une autre forme ? N’y a-t-il pas là, à
travers l’histoire des images, un processus de construction d’une identité culturelle productrice d’humanité ?
Il a retenu un principe simple (un dessin, un·e auteur·trice, un texte), puis l’a mis en œuvre. Il a choisi les auteur·trice·s selon des affinités professionnelles, pré-sélectionné les dessins dont ils·elles pourraient disposer, déterminé la longueur des textes sur le modèle standardisé de la notice d’œuvre. L’origine du projet était d’ailleurs là : la légende comme objet textuel normé de l’histoire de l’art, puis, à partir de la légende, la notice, au format lui aussi clairement défini. Ils·elles se sont mis·e·s au travail. Ils·elles ont écrit. La plupart se sont révélé·e·s fidèles aux usages de leur métier : les écrivain·e·s et les artistes ont imaginé des récits, et les historien·ne·s de l’art ont replacé les images dans leur contexte et les ont analysées. Quant aux plus rares journalistes et architectes, ils·elles ne se sont pas davantage démarqué·e·s par leur approche. Tous·toutes auraient pourtant pu ignorer ses instructions, délirer, écrire à propos de tout autre chose, faire différemment que d’ordinaire. Il aurait tout accepté, mais finalement peu se sont aventuré·e·s hors de leur territoire. Rien qu’on ne puisse vraiment leur reprocher. La liberté se conquiert autant dans l’écart que
n’avait pas d’artiste, et comme il n’y avait pas d’artiste, elle n’avait personne à nommer. Ce serait lui comme tous·tes les autres, mais lui malgré l’anonymat, lui sans aucun doute. Lui qui, avec son archive d’images, réfléchissait à la question de la représentation, il disparaîtrait ici. Sa peine serait toutefois passagère. Il retrouverait son identité dès le premier texte. Laurence Schmidlin

10
19
LdD 10. D’après une photographie du plafond d’un ancien appartement. [2002]
Le regard glisse, la main pendante, les doigts lassent. L’index légèrement surélevé souligne une agitation. Les ongles lissent touchent à peine le sol. La lumière révèle délicatement le parquet finement rayé. Des petits traits stridents envahissent l’ensemble de la surface. Des éclats rugueux dévoilent un joyeux assemblage en alternance saccadée d’obscurité et de brillance. Un envahissement de rayures s’éparpille et pétille à grande vitesse. Les angales de la pièce s’arrondissent, les couleurs fondent, la netteté disparaît. Les gestes frénétiques du tracé se répandent et projettent des reflets enflammés qui jaillissent contre les parois. La direction repose sur une transition lente, un déplacement tendu, un envoûtement progressif. La chambre se penche, les murs inversés, les
10

Ils habitent au fond d’une vallée qu’ils appellent Hill. Leur langue est le hilli. Eux seuls arrivent à s’y retrouver parmi une population où tout le monde porte les mêmes prénoms de génération en génération Mimi, Gigi, Il-il, Lili, Gil, Mili ou Miki. Ils ne connaissent pas l’eau mais une rivière d’un liquide appelé milk serpente au milieu du village. C’est selon eux l’équivalent du Nil. Ils ont tendance à boire un peu beaucoup de gin et se nourrissent exclusivement de mil qu’ils accommodent de mille façons dont un fameux gâteau, le 3/4. C’est un peuple sympathique. Les gens sourirent tout le temps, on dit qu’ils ont la joie de vivre malgré leurs carences et leur isolement. Bien sûr, comme tout le monde, ils connaissent des problèmes et sontparfois préoccupés, mais l’usage unique de la voyelle confère à leurs échanges une expressivité clownesque et des mines réjouies. Les
plaintes au plafond. Des fioles volantes, suspendues au ralenti, atterrissent. L’attirance de l’inversé promet l’avancée d’une incertitude. Inclinaison, un décor mutant. Les papillons sortent, motifs dessinés, motifs répétés. Invisibles, transparences et superpositions, les moulures en distorsion. Les ampoules se détachent, les cristaux se balancent. Les ornements se transforment, l’usure des détails creusés s’entremêlent et fusionnent. Les contours émergent pour mieux se retirer. Un éparpillement lointain avance, se distingue et disparaît. Les précisions sont floues et s’étalent aux allures de fleurs, de choux, de pousses tendres et d’étincelles. Le relief prend la forme d’une bavure nette, un désordre délimité, une île écrasée. Les yeux se retournent, les paupières se ferment. Les couleurs fusent et dessinent un axe qui scinde la pièce. Bris de glace, une dynamique, une chute dans laquelle l’avant à l’arrière irrite le réveil. Le corps suspendu, en état de pivoter, un basculement vertigineux traverse un enchevêtrement, un dédoublement. La suspension se déforme, se détache, offrant une profondeur impénétrable, un accès illimité. Un vertige décalé, l’œil écarquillé à l’affût d’un bouleversement étrange.
Pourtant, l’index est détenteur, en capacité d’exploser, l’ongle effleurant le sol, maintient stabilité. En posant sa pointe sur le parquet, la main garde un sens de gravité potentiellement renversé.
Anna Byskov
enfants jouent à « kill-king » tandis que les adultes tissent un immense kilim en lin. Ils ne connaissent pas le pluriel et ont une perception étroite des échelles de grandeur ils ne quantifient que par petites tailles. Cela va de mini à mini-mini-mini.
La petitesse étant souvent associée au mignon, l’adjectif mini sert à qualifier tout ce qui est joli, bien fait, esthétique, et même grandiose. Mini mini mini ! ! Ils ont des rides marquées à force de tirer sur les zygomatiques. Ils montrent leurs dents en parlant. Lorsqu’ils ne savent pas quoi dire, pour meubler, ils font hi hi hi.
Les mauvaises langues disent qu’ils sont arriérés, qu’ils vivent encore à l’époque Ming. En tout les cas, ils savent apprécier les bonnes choses. Il faut entendre le son Mmmmmm qu’ils produisent en se régalant. Pour une raison inconnue, seule cette planche dessinée leur serait arrivée. C’est sur cette base qu’ils ont développé leur langage. Ils savent lire et recopier plusieurs polices de caractères, mais pour eux l’alphabet se compose de huit lettres.
Valérie Mréjen
LdD 46 D’après différents caractères typographiques extraits de journaux. [2002]

LdD 65
LdD 65. Notes. [2002]
Une équipe de chercheurs a récemment mis au jour les vestiges d’une ville longtemps enterrée, dont les murs sont ornés de graffitis extraordinaires. Pourtant, ce qui a véritablement captivé les experts, ce n’est pas uniquement la richesse visuelle de ces anciennes œuvres d’art urbaines, mais les mots qui y sont inscrits : « fuck » et « no future ».
Dans notre société actuelle, gouvernée par la raison et dénuée de sentiments, ces expressions peuvent sembler sacrilèges, reliques d’un passé rebelle.
Habitués à une existence exempte de chagrin, de rage, de désespoir ou de toute forme de passion, nous nous retrouvons perplexes face à ces mots, cherchant à en saisir la signification profonde. Il convient de noter que dans notre monde contemporain, l’écriture manuelle n’existe pratiquement plus.
La technologie a pris le contrôle, automatisant les tâches et générant des textes dépourvus de toute touche humaine. Le simple fait de saisir un crayon et de tracer des mots sur le papier est devenu une pratique curieusement archaïque. Ainsi, ces graffitis, saturés d’émotions intenses, suscitent un étonnement inconnu et troublant, sinon dangereux.
Pour comprendre la rébellion des époques disparues, les chercheurs se sont tournés vers l’anthropologie et l’histoire des sociétés primitives qui ont habité notre planète. Poussés par leurs émotions bizarres et souvent irrationnelles, ces individus aimaient critiquer, protester, dénoncer et se battre contre ce qui semblait être les injustices de leur époque ou, souvent, simplement se battre entre eux. Ils aimaient les conflits et fondaient leurs actes sur des impulsions, ils aimaient prêcher et fondaient leurs paroles sur une rébellion vide. Leur résistance s’est avérée vaine, car ils n’ont finalement pas réussi à modifier leur destin fatidique. La multitude de « fucks » et de cris de « no future » gravés sur les murs de cette ville oubliée et sur les murs de leur nature humaine résume ce sentiment d’impuissance et d’échec.
Alors que notre société contemporaine s’épanouit dans une sérénité émotionnelle, la
découverte des ruines de la ville et de ses graffitis radicaux incite à l’introspection. Nous sommes confrontés aux échos d’une époque lointaine, où les sentiments bruts étaient monnaie courante et où les mots avaient le pouvoir de résonner profondément. Faut-il craindre que nos générations futures d’entités intelligentes trouvent dans ces graffitis une leçon sur le sens des émotions et de l’expression individuelle, facettes que leur existence rationnelle et sereine ne peut et ne doit pas reproduire ?
Maria Guţă
Didier
Didier

La politique continuée par la littérature
Comment la littérature peut-elle participer à l’effort politique sans se renier comme littérature, sans se subordonner à la cause ? Comment peut-on faire politiquement de la littérature ? Á quoi ressemblerait une politique de la littérature ? Nous ne créons pas les éditions Cause perdue parce que nous avons la réponse mais pour faire vivre ces questions. Car à ces questions il n’est de réponse qu’au cas par cas, livre après livre, dans le vif du texte.
La vie d’Abdèle
Izza Amar
Les éditions Cause perdue sont un collectif constitué de Stéphanie Vincent, Elsa Personnaz, Gaëlle Bantegnie, François Bégaudeau, Gwénaël David, Antoine Derouallière, Bénédicte Thiébaut, Julien Ollivier
contact@editionscauseperdue.fr
Stéphanie Vincent 06 74 33 21 79 - Elsa Personnaz 06 81 98 16 07Lancement en avril 2025 - Inscrivez-vous sur www.editionscauseperdue.fr pour suivre nos actualités.
Si vous cherchez à la situer quelque part — sur la carte des genres, des races, des cultures, des orientations politiques — , sachez qu’Izza Amar ne s’y trouve pas. Mais par son art d’être à la fois virile et romantique, sexuelle et mystique, politique et païenne, triviale et sublime, on pourrait dire qu’elle est Pasolini en femme.
Résumé argumenté
D’un côté Abdele, de l’autre Adèle. Un chapitre narré par l’une, un chapitre narré par l’autre. Nées dans les années 80, Abdele et Adèle sont sœurs, kabyles et oranaises, ont grandi pendant la guerre civile algérienne et le printemps noir berbère. Elles ont pour seul parent leur mère socialiste laïque tournée musulmane fervente, mais tout les oppose. Abdele est la petite sœur insoumise, bagarreuse, garçonne, footeuse de récré et fouteuse de merde, géniale, buissonnière, mégalo, prêtresse païenne auto-proclamée, aspirante prophétesse. Adèle est la grande sœur raisonnable et raisonnée, déterminée mais discrète. À dix-huit ans, Abdele s’envole vers Paris où elle circule d’amants en amantes, d’école d’ingénieur en centre d’appels, de French touch en French tech. Cependant qu’Adèle reste en Algérie où elle se marie et devient gynécologue. Une passion de la fuite contre une passion de la norme ? Au fil des trente ans où nous les suivons, l’opposition apparaît comme n’en étant pas une tant la lumière de la survie éclaire leurs routes, tant se déploie une énergie vitale salvatrice. Celle des jours passés à compter les morts dans le quartier et les journaux et à traduire les paroles de Nirvana. Les deux A sont les deux faces d’une même pièce nommée Abdèle, les deux stratégies complémentaires d’une même émancipation. Les mots des deux narratrices sont crus : ils se vengent de la cruauté des euphémismes. Abdele et Adèle ont connu une guerre que l’on ne nomme pas, une oppression régionale que l’on naturalise, une révolte sans issue. Elles éprouvent et observent, des deux côtés de la mer, une domination masculine qui ordonne et la technologie qui occupe. Leurs vies se cherchent dans les marges de deux sociétés, algérienne et française, qui ne se font pas face mais s’accompagnent dans la terreur, la lassitude, les révoltes et les démissions. Ici, la vie n’est pas fragile comme une fleur mais comme des bombes. La virilité des deux sœurs veut corriger le monde. L’une par la science, l’autre par le romantisme. Leur féminisme est par-delà les bullshit du Nord et du Sud, les fraternités mensongères et les intersections en chantier. Leur féminisme est à hauteur de ces femmes que rien n’effraie, surtout pas l’intimité. #féminisme #queer #startup #algérie
Izza Amar est une autrice franco-algérienne née en 1987 à Oran. Sa passion pour les nouvelles technologies la mène en France puis en Indonésie, où elle exerce des métiers aussi variés que DJ, photographe, mannequin main et coiffeuse. Ces expériences nourrissent son écriture qui documente la précarité du travail de sa génération et la libération des femmes dans les sociétés de masse.
Dans son premier roman La Vie d’Abdèle, les deux narratrices relancent les dés de la dialectique entre soumission et libération féminines pour inventer une trajectoire d’émancipation affranchie des oppositionns binaires. La puissance de son texte en est le meilleur argument, qui se fraie un passage en toute liberté entre l’Algérie des années noires, la Kabyllie laïque et la France post-attentats.

ISBN : 978-2-487871-01-4
Format : 13x19 cm
160 p.
Prix : 16€
Parution : avril 2025
Extraits choisis
Abdele
Moi, mon amoureuse, c’était la fille de Björk ! Yeux bridés et regard malicieux, cheveux noirs sur peau laiteuse. Je l’ai vue à mon premier jour d’école primaire, et mon cœur tendre ne l’a jamais expulsée. Notre désir était d’un autre monde, un super-pouvoir que je guette dans chaque regard croisé depuis. Notre innocente amitié était une cape d’invisibilité. Insoupçonnables infidèles sans vertu, sans gêne et sans étendard. Au pays d’Allah, on est plus libres que chez les catholiques zombies. Cheveux laineux rasés, je portais bien les vêtements de mes cousins. Caractère de guerrière, on ne me ratait pas et je ne m’écrasais jamais. J’aimais le foot, je me battais souvent. J’étais la première de la classe, à l’arcade sourcilière éclatée. J’étais bonne en maths et mauvaise en machisme. Sale gueule de petit mec et noble tempérament de prêtresse païenne. J’étais ce qu’on appelle une tomboy, before it was cool.
Abdele
Adèle
Moi, mon amoureuse, c’était la fille de Björk ! Yeux bridés et regard malicieux, cheveux noirs sur peau laiteuse. Je l’ai vue à mon premier jour d’école primaire, et mon cœur tendre ne l’a jamais expulsée. Notre désir était d’un autre monde, un super-pouvoir que je guette dans chaque regard croisé depuis. Notre innocente amitié était une cape d’invisibilité. Insoupçonnables infidèles sans vertu, sans gêne et sans étendard. Au pays d’Allah, on est plus libres que chez les catholiques zombies. Cheveux laineux rasés, je portais bien les vêtements de mes cousins. Caractère de guerrière, on ne me ratait pas et je ne m’écrasais jamais. J’aimais le foot, je me battais souvent. J’étais la première de la classe, à l’arcade sourcilière éclatée. J’étais bonne en maths et mauvaise en machisme. Sale gueule de petit mec et noble tempérament de prêtresse païenne. J’étais ce qu’on appelle une tomboy, before it was cool.
Papa et mama s’envoyaient des lettres et des poèmes de Brel, quand il était loin pour le travail. Ils avaient des amis musiciens, avocats, chercheurs ou restaurateurs. Le chômage n’existait pas. On avait quitté la campagne pour vivre dans la grande ville, avec la classe moyenne citadine à une époque où il n’y avait pas de classe supérieure. Il y avait les gens de la ville, les premiers diplômés, et ceux de la campagne, nos familles à tous. On se respectait. À l’école, on était tous mélangés, les profs n’étaient pas stressés, les chauffages fonctionnaient, la cantine aussi. Quoi qu’on fasse, on était les premiers Algériens à le faire. On n’avait pas de passif. Donc on avait tous une fierté de pionniers. Et être enfant dans tant de souveraineté, c’était miraculeux.
Adèle
Papa et mama s’envoyaient des lettres et des poèmes de Brel, quand il était loin pour le travail. Ils avaient des amis musiciens, avocats, chercheurs ou restaurateurs. Le chômage n’existait pas. On avait quitté la campagne pour vivre dans la grande ville, avec la classe moyenne citadine à une époque où il n’y avait pas de classe supérieure. Il y avait les gens de la ville, les premiers diplômés, et ceux de la campagne, nos familles à tous. On se respectait. À l’école, on était tous mélangés, les profs n’étaient pas stressés, les chauffages fonctionnaient, la cantine aussi. Quoi qu’on fasse, on était les premiers Algériens à le faire. On n’avait pas de passif. Donc on avait tous une fierté de pionniers. Et être enfant dans tant de souveraineté, c’était miraculeux.
Abdele
Par un hasard de démission, de travail. Elle a lu tout regarder des livres de de la lecture. Alors, ce de Martin Parr pendant femme devient mon héros, entrant » me dit qu’il lui, et que donc nous ser chez SFR, et que mot : « Grève à midi, toriens retiennent cette sur un post-it.
Abdele
Abdele
Par un hasard de démission, de travail. Elle a lu regarder des livres de la lecture. Alors, de Martin Parr pendant femme devient mon entrant » me dit qu’il lui, et que donc nous ser chez SFR, et que mot : « Grève à midi, toriens retiennent cette sur un post-it.
Moussa a fini par quitter lui. Il a rejoint le GSPC, le Combat. Un programme qué dessus. Youssef me entre eux. Il ne pouvait ses études à 16 ans, lière dans le désert. Le d’hommes dans ma vie,
Abdele
Adèle
Moussa a fini par quitter lui. Il a rejoint le GSPC, le Combat. Un programme qué dessus. Youssef entre eux. Il ne pouvait ses études à 16 ans, lière dans le désert. d’hommes dans ma
Dans le 20 heures de ont été tués. Nous sommes 26 juin 1993, jour maudit de deux balles dans la devant le siège du journal Voitures piégées, décapitations, 127 journalistes sont
Adèle
Dans le 20 heures de ont été tués. Nous 26 juin 1993, jour maudit de deux balles dans devant le siège du Voitures piégées, décapitations, 127 journalistes sont
Yeux bridés et regard Je l’ai vue à mon pretendre ne l’a jamais monde, un super-pouvoir depuis. Notre innocente Insoupçonnables infidèles pays d’Allah, on est
vêtements de mes couratait pas et je ne m’écrasouvent. J’étais la preéclatée. J’étais bonne gueule de petit mec païenne. J’étais ce qu’on
des poèmes de Brel, des amis musiciens, chômage n’existait pas. la grande ville, avec où il n’y avait pas de ville, les premiers diplôtous. On se respectait. n’étaient pas stressés, aussi. Quoi qu’on fasse, n’avait pas de passif. Et être enfant dans
Abdele
Par un hasard de démission, Jeanne devient ma voisine de poste de travail. Elle a lu tout le règlement, où rien ne lui interdit de regarder des livres de photo pendant le boulot. Non, ce n’est pas de la lecture. Alors, ce samedi matin, Jeanne feuillette un livre de Martin Parr pendant que Vivaldi fait patienter un con. Cette femme devient mon héros, instantanément. Alors qu’un « appel entrant » me dit qu’il n’est pas arabe, lui, qu’il paie ses factures, lui, et que donc nous avons fait erreur chez Orange, qu’il va passer chez SFR, et que le cul de la crémière, Jeanne me passe un mot : « Grève à midi, j’ai un joint. Tu fumes ? ». À ce jour, les historiens retiennent cette phrase comme la plus belle jamais écrite sur un post-it.
Abdele
Moussa a fini par quitter le GIA, qui était trop mainstream pour lui. Il a rejoint le GSPC, Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat. Un programme qui, comme le Port Salut, était marqué dessus. Youssef me disait que la vie devenait « pas évidente » entre eux. Il ne pouvait même plus écouter Cheb Hasni. Il a arrêté ses études à 16 ans, pour travailler sur une plateforme pétrolière dans le désert. Le désert et son sous-sol ont avalé beaucoup d’hommes dans ma vie, de mon père à mes amis.
Adèle
Dans le 20 heures de France 2, on annonce que des journalistes ont été tués. Nous sommes tous hagards. Ça aurait pu être le 26 juin 1993, jour maudit où le journaliste Tahar Djaout a été tué de deux balles dans la tête. Avant lui, une fusillade avait eu lieu devant le siège du journal Le Matin. Après lui, il y en a eu trop. Voitures piégées, décapitations, balles dans le dos et dans les yeux, 127 journalistes sont publiquement morts en quatre ans sur les
ordres de Djamel l’Afghan : « Les journalistes qui combattent l’islam par la plume périront par la lame. » Et quand c’est dans les rues de Paris et non d’Alger que sifflent les balles, nos yeux nous mentent. Notre tristesse a pourtant toujours le même goût : brûlant. Je n’ai qu’une envie, c’est d’appeler la France pour lui rappeler qu’elle a une sœur.
Abdele
J’arrive un peu en avance, en fendant une foule de Gilets Jaunes qui bloquaient la place et les boutiques, mais visiblement pas les grosses affaires. J’ai beaucoup aimé les Gilets Jaunes. C’est pas du tout des gens que j’ai fréquentés, je ne connaissais que des pauvres des villes, mais il y a un truc « correct » chez eux, comme les Kabyles de mon adolescence. En passant parmi eux, j’ai ressenti cette familiarité que j’avais totalement oubliée. Ces blagues sur les pancartes, ces gueules pas télégéniques, cette tension de ceux qui passent du « dedans » au « dehors ». Et ce jaune, la marketeuse en moi ne peut que saluer le génie. Il y a une cohérence magnifique dans l’opération. C’est pas mon style, moi c’est le noir depuis toujours, mais tout tient à la visibilité, au pas classe, pas convenu, pas épuré, pas dépressif. Du grunge joyeux. Va absorber ça, Dior !
Adèle
On était en mai. Je refusais d’affronter la saison des mariages sans être fiancée. À la place il me parle de politique, de Printemps berbère, de Bouteflika et de droits de l’homme. Je ressors de la pizzeria avec le sourire furieux. Amadeus n’y voit rien et me souhaite une bonne semaine, s’étant régalé des yeux et du ventre. Il est ravi. Il m’énerve. Je m’engouffre dans le premier Taxiphone que je croise. Abdele décroche, se moque de moi, « la dame de fer », puis me dit qu’elle va m’envoyer un lien pour un film. Comme
si la vie était comme un la solution à mon problème c’est Uma Thurman dans
Abdele À l’époque, Macron était plus. En tout cas, c’est so chic. Grosse déception, annuel de la French Tech. trouvé Sarkozy fatigué. en costume, parmi tous Personnellement, je ne suis pas comme ça #mauvaisefoi. j’étais fatiguée. C’est pas on ne sait rien du monde. trouvé le bon filon : changer surtout changer mon monde de la réunionnite. C’était
Abdele
« Les femmes », c’est toutes jamais. Paradoxalement, femme » sont toujours qui peuvent donner la questions de femmes, alors femme », on lui a donné sont trop bêtes pour s’en simple, c’est beau, c’est « La femme », un jour, pas les pompiers.
qui combattent l’isquand c’est dans les balles, nos yeux nous le même goût : brûFrance pour lui rappefoule de Gilets Jaunes visiblement pas les Gilets Jaunes. C’est pas connaissais que des « correct » chez eux, comme parmi eux, j’ai resoubliée. Ces blagues télégéniques, cette tension de Et ce jaune, la marIl y a une cohérence style, moi c’est le noir visibilité, au pas classe, pas joyeux. Va absorber
Abdele
À l’époque, Macron était encore au lycée, ou ministre, je ne sais plus. En tout cas, c’est l’époque où on le disait beau, cultivé et so chic. Grosse déception, quand je l’ai rencontré au cirque annuel de la French Tech. On m’a promis Kennedy lettré, j’ai trouvé Sarkozy fatigué. Il faisait très « chaussettes-claquettes » en costume, parmi tous ces jeunes bodybuildés en T-shirt. Personnellement, je ne lui en veux pas. Déjà parce que je ne suis pas comme ça #mauvaisefoi. Ensuite, parce que moi aussi j’étais fatiguée. C’est pas facile de gérer le monde, surtout quand on ne sait rien du monde. Je ne me plains pas non plus. J’avais trouvé le bon filon : changer le monde par la technologie. Enfin, surtout changer mon monde par la suppression pure et simple de la réunionnite. C’était là ma Révolution : virer mes patrons.
Abdele
« Les femmes », c’est toutes les mêmes, alors que les hommes jamais. Paradoxalement, c’est les hommes, l’universel. « La femme » sont toujours à quelqu’un. Paradoxalement, c’est elles qui peuvent donner la vie. « La femme » nous les brise avec leurs questions de femmes, alors que la réponse est simple : Non. « La femme », on lui a donné tous ses droits de « La femme », mais elles sont trop bêtes pour s’en servir. Alors que « La femme », c’est simple, c’est beau, c’est rond : plaisir d’offrir, joie de recevoir ! « La femme », un jour, elle empoisonnera le tajine, et n’appellera pas les pompiers.
saison des mariages politique, de Printemps l’homme. Je ressors de la n’y voit rien et me des yeux et du ventre. premier Taxiphone moi, « la dame de fer », pour un film. Comme si la vie était comme un film. Elle me détend en me disant que la solution à mon problème tient en trois lettres. Et la solution, c’est Uma Thurman dans Pulp Fiction. Ma salvation, c’est Mia.

La politique continuée par la littérature
Comment la littérature peut-elle participer à l’effort politique sans se renier comme littérature, sans se subordonner à la cause ? Comment peut-on faire politiquement de la littérature ? Á quoi ressemblerait une politique de la littérature ? Nous ne créons pas les éditions Cause perdue parce que nous avons la réponse mais pour faire vivre ces questions. Car à ces questions il n’est de réponse qu’au cas par cas, livre après livre, dans le vif du texte.
TOLEDO, 6:55 a.m.
Bénédicte Thiébaut
Résumé argumenté
Les éditions Cause perdue sont un collectif constitué de Stéphanie Vincent, Elsa Personnaz, Gaëlle Bantegnie, François Bégaudeau, Gwénaël David, Antoine Derouallière, Bénédicte Thiébaut, Julien Ollivier
contact@editionscauseperdue.fr
Stéphanie Vincent 06 74 33 21 79 - Elsa Personnaz 06 81 98 16 07Lancement en avril 2025 - Inscrivez-vous sur www.editionscauseperdue.fr pour suivre nos actualités.
On pense souvent que les vies marginales sont des vies invisibles, qui passent sous les radars de la représentation. En fait ce n’est pas vrai : la marge est plutôt bien représentée, en cinéma, en littérature. Ce qui passe sous les radars, c’est l’ordinaire, la vie à bas bruit des gens ordinaires. Ceux qu’on pourrait appeler, non pas les sansdents, mais les sans-bruit. Les discrets.
Entre le National Museum of Art où il est gardien et l’usine Chrysler où travaille Léna, Markus ne voit pas de différence fondamentale. Depuis son quotidien rythmé par le travail et les trajets en bus, tenaillé par un sentiment d’incomplétude, il observe les gens qui l’entourent et les laisse parfois conduire le récit. Mais alors qu’il effectue sa première garde de nuit, Léna disparaît. L’enchaînement des jours se dérègle, comme en écho aux dérèglements du monde qui voient mourir les poissons, tomber les oiseaux, se déchaîner les éléments. Il lui faut alors partir, pour tenter de demeurer vivant. Des Grands Lacs à la Stone Mountain, des usines automobiles au siège de Coca-Cola, des hivers neigeux de l’Ohio au soleil écrasant de Georgie, Markus trace une diagonale qui transforme des espaces mythiques en lieux familiers. Toledo, 6:55 a.m. diffuse la lumière tendre des vies qui ne demandent qu’à durer et à faire le moins de mal possible. Son personnage principal ressasse un vide, que la multiplicité des rencontres et des voix du récit, fussent-elles celles de l’eau ou de la roche, participe à combler. L’Amérique du début des 2000, qui résonne des troubles et des crises à venir, annonce les replis, les disparitions, les douleurs et les dégoûts de celle d’aujourd’hui, mais offre aussi de longues lignes de fuites, comme possibilités de l’amour. Le texte ne s’oppose pas mais se pose au côté du mouvement de libération, en courant de ressac, esquivant le viril de la confrontation, l’agitation rhétorique et la surbrillance des discours au profit d’une littérature qui déleste plus qu’elle ne charge. Dans ce pays où tout peut toujours recommencer, il assume la fuite comme puissance vitale, proposant une forme de politique de la douceur par gros temps. Le roman assume aussi d’être français américain, ou américain français, on ne sait plus où tracer les frontières entre réel et littérature, entre ici et ailleurs, on sait seulement qu’il est possible de se sentir là-bas comme chez soi. #vies ordinaires #travail #amérique
………… Bénédicte Thiébaut est née en 1973 dans les Vosges, a fréquenté la scène punk française des années 90, écrit dans des fanzines, participé à plusieurs collectifs et mené des activités naturalistes en Martinique, en Loire-Atlantique ou ailleurs. Autrice au sein d’ouvrages du collectif Othon (À Arles et À Brest chez Divergences), elle est de l’équipe fondatrice des éditions Cause perdue. Toledo s’origine dans son attachement obsessionnel à la littérature américaine, explorée de long en large et quasi exclusivement, des classiques aux contemporains et à la Nature writing. Lors de cinq séjours entre 2011 et 2019, elle éprouve l’étrangeté de se sentir chez soi dans ce pays qui resssemble à ce qu’elle lit et déclenche son écriture. Si elle cite Faulkner, Dos Passos, Franzen, Tartt, De Lillo ou Boyle comme influences majeures, c’est d’abord Russel Banks, et sa constante mise en avant des gens dont on ne parle pas, qui inspire Toledo. On pourrait aussi rapprocher son roman du cinéma de Kelly Richard, par exemple de son film Certaines femmes.

ISBN : 978-2-487871-00-7
Format : 13x19 cm
168 p.
Prix : 17 €
Parution : avril 2025
Extraits choisis
Il n’y a pas trente mille façons de faire le con pour amuser les enfants, il y a le déguisement et le déguisement. C’est ce que je pensais avant le Thanksgiving de l’année dernière. Maintenant je pense qu’il vaut mieux faire un bon vieux jeu de mots qu’ils ne comprendront pas mais on s’en fout. Le père de Nicole a disparu. Ça ne change pas grand-chose à notre quotidien, Nicole n’en parle pas, je ne sais même pas si les enfants sont au courant. Je pourrais leur dire peut-être. Mais ce n’est pas mon père. Mon père s’appelle Will et milite pour la NRA. Nous ne nous sommes pas parlé depuis dix-huit ans et les enfants ne le connaissent qu’en photo, une seule photo, une photo où il paraît à peu près normal, la seule que j’ai gardée. Will Bless ressemble à un acteur de seconde zone, mais il ressemble surtout à un militant de la NRA. Il a une fantastique panoplie de vêtements et accessoires paramilitaires, censés lui servir pour aller à la chasse mais qu’il porte au quotidien, par touches, jamais la tenue complète, tout serait beaucoup trop clair. J’ai échappé à cette fascination malsaine, me suis fait traiter de tapette, de pédale, de fiotasse. J’ai eu ma période tee-shirt coloré au sigle Peace, j’ai eu les cheveux longs, j’ai eu des copines noires, j’ai écouté du rock, de la soul, du jazz, j’ai pissé sur l’arsenal de mon père. Bref je suis entré très vite en conflit surdimensionné avec lui et j’en suis toujours particulièrement fier ou plutôt soulagé maintenant. Mon père croit encore qu’il m’a viré de la maison, il s’en vante auprès de ses amis et grand bien lui fasse. Mel c’est sûr est beaucoup plus sympathique, Nicole m’a dit que l’année dernière, il avait failli mettre sur la gueule de Ray son fils, qui tenait un discours affligeant sur les Noirs et l’argent, la pauvreté bien méritée, ce genre de trucs. Au moment où j’étais à l’hôpital et où on essayait vaguement de me désolidariser d’un costume de dinde. Ah la dinde était bien farcie pour Thanksgiving, ça je peux en témoigner. L’année prochaine, je crois que je vais tenter un truc un peu moins voyant. Étouffant. Un peu moins étouffant. Ma mère est morte lorsque j’avais 14 ans, elle a fait une rupture d’anévrisme, elle était beaucoup trop jeune pour ça mais vivre avec
mon père n’est pas une leurs. J’ai rencontré Nicole de concert ne duraient fille, attachante, pleine toujours en train de faire séduit. Aujourd’hui, je beaucoup moins drôle les tâches dans un couple, con. C’est une grande qualité. blagues ne sont pas toujours
Je me penche en avant raissent entre mes chaussures fil d’Écosse, bien tendues
Je relève la tête quand devant nous en courant.
– Hé ! Jack, qu’est-ce qui – C’est Bearbear, il a un tape sur les visiteurs !
Et Jack court de plus belle autour de lui.
Je regarde Simon, un peu gars ?
– Je croyais aussi. En même de Bearbear ?
– Non jamais.
Bearbear c’est la mascotte, dans les publicités à de sa patte poilue, offre
Tout le monde se fait prendre
con pour amuser les déguisement. C’est ce que je dernière. Maintenant jeu de mots qu’ils ne de Nicole a disparu. quotidien, Nicole n’en parle courant. Je pourrais père. Mon père s’apnous sommes pas parlé connaissent qu’en photo, près normal, la seule acteur de seconde zone, NRA. Il a une fantasparamilitaires, censés porte au quotidien, par beaucoup trop clair. me suis fait traiter de période tee-shirt coloré eu des copines noires, pissé sur l’arsenal de conflit surdimensionné particulièrement fier ou plutôt souqu’il m’a viré de la maigrand bien lui fasse. Mel Nicole m’a dit que l’angueule de Ray son fils, qui l’argent, la pauvreté où j’étais à l’hôpital désolidariser d’un costume Thanksgiving, ça je crois que je vais tenter peu moins étouffant. elle a fait une rupture pour ça mais vivre avec
mon père n’est pas une sinécure. Ce n’est pas une cure non plus d’ailleurs. J’ai rencontré Nicole à un concert de U2. D’habitude, les coups de concert ne duraient qu’un soir. Nicole était vraiment une chic fille, attachante, pleine de vie, hyperactive, elle n’arrêtait pas en fait, toujours en train de faire un truc, de dire un truc, ça m’a amusé, séduit. Aujourd’hui, je suis toujours fou d’elle, elle est forcément beaucoup moins drôle que moi, c’est normal, il faut bien se partager les tâches dans un couple, mais elle rit toujours de mes blagues à la con. C’est une grande qualité. À mon sens, bien sûr. Parce que mes blagues ne sont pas toujours drôles et que je le sais très bien
Je me penche en avant et regarde mes chaussettes qui apparaissent entre mes chaussures et le bas de mon pantalon. Noires, fil d’Écosse, bien tendues sur les mollets.
Je relève la tête quand Jack, un gars de la maintenance, passe devant nous en courant. Simon l’interpelle :
– Hé ! Jack, qu’est-ce qui se passe ?
– C’est Bearbear, il a un gros problème, un court-circuit ou pire, il tape sur les visiteurs !
Et Jack court de plus belle avec ses outils à la ceinture qui s’agitent autour de lui.
Je regarde Simon, un peu interloqué : Mais Bearbear, c’est pas un gars ?
– Je croyais aussi. En même temps, tu as déjà vu quelqu’un sortir de Bearbear ?
– Non jamais.
Bearbear c’est la mascotte, l’image qu’on nous sert tous les ans dans les publicités à Noël. Il est là, au WoCC, il serre les mains de sa patte poilue, offre du Coca, danse et fait même des câlins. Tout le monde se fait prendre en photo avec Bearbear, il enserre
fièrement de sa grosse paluche les épaules des visiteurs jeunes et plus tout à fait, il frotte sa truffe noire contre leurs joues roses de plaisir. Les trentenaires adorent ça beaucoup plus encore que les petits, retour à l’enfance, goût de sucre et peluche géante. Il y a à ces moments-là une lueur dans leurs yeux qui n’a rien de sain, quand ils essayent à tout prix de ressentir ce qu’ils ont ressenti enfants au contact de la barbe à papa. Peine perdue, mais ils s’accrochent comme des forcenés en s’extasiant d’être aussi heureux dans ces fils roses et gluants qu’il y a vingt ans. Alors qu’ils le sont bien davantage. Et à côté d’eux leurs enfants de 3 ans les regardent, ébahis face à une telle paresse intellectuelle. Je grince des dents à chaque fois que quelqu’un use de l’expression « rêve de gosse ». « Alors Bernard Madoff, baiser des milliers d’actionnaires c’était un rêve de gosse ? » « Alors George W. Bush, laisser crever des milliers de Noirs après le passage de Katrina c’était un rêve de gosse ? »
Les enfants n’ont pas de rêve, ils ont des envies.
Et moi mon envie tout de suite maintenant c’est d’aller vérifier si Bearbear est vraiment une machine et pas un être humain.
On s’est tus tous les deux un moment en regardant droit devant nous.
– Il est bien fait quand même.
– Il est super bien fait.
À mon sens, Léna et moi ne travaillons pas dans des endroits fondamentalement opposés. Je n’ai jamais été aussi vivant que ces sept dernières années, dans ce musée de vieilleries, plein de couleurs et de produits chimiques. Léna aussi travaille dans un lieu plein de couleurs et de produits chimiques, un lieu en déclin qui fera lui aussi bientôt partie de l’histoire. Nous finirons par ne plus fabriquer nos propres voitures, nous finirons par laisser tomber en
ruines ces grosses usines j’aime mon musée, pour Toledo n’est pas une belle trielle. Il y fait froid comme tôle et de pétrochimie, et malsain à la fois, avec mélangé. Je n’y ai pas toujours
Aujourd’hui je suis un week-end, aires de jeux, nique. Ça ne mange pas fries. J’ai un téléphérique, 732 cloches dans mon ne font plus guère de mal. ne suis rien de tout cela, ment raciste. J’ai cultivé fait, Helianthus porteri, aussi nommée Confederate verture, je serais une montagne Je suis née de la rencontre Sainte-Marie et je ne suis foi, aucun miracle. 209 chlorés, microcystine, phosphore, sortes. Mes jolis méandres dentiels et votre agriculture les tumeurs, mes petites puis de nouveau une vague me soignent. Pourtant, vous ne pouvez même plus
des visiteurs jeunes et leurs joues roses de beaucoup plus encore que les peluche géante. Il y a qui n’a rien de sain, ce qu’ils ont ressenti perdue, mais ils s’acd’être aussi heureux vingt ans. Alors qu’ils le enfants de 3 ans les intellectuelle. quelqu’un use de l’expresMadoff, baiser des milliers « Alors George W. Bush, passage de Katrina envies. c’est d’aller vérifier si un être humain. regardant droit devant dans des endroits fonaussi vivant que ces vieilleries, plein de coutravaille dans un lieu un lieu en déclin qui Nous finirons par ne plus par laisser tomber en
ruines ces grosses usines bruyantes et polluantes. J’aime son usine, j’aime mon musée, pour moi il n’y a aucun paradoxe. Toledo n’est pas une belle ville mais c’est une belle ville industrielle. Il y fait froid comme dans une ville industrielle, un froid de tôle et de pétrochimie, un froid de lac et de rivière, un froid sain et malsain à la fois, avec de la fumée et du brouillard, tout cela mélangé. Je n’y ai pas toujours vécu, mais j’aurais pu.
Aujourd’hui je suis un parc, on fait de moi le but de sortie du week-end, aires de jeux, village traditionnel, petit train et piquenique. Ça ne mange pas de pain. Plutôt des hot-dogs et des french fries. J’ai un téléphérique, un golf, un pont couvert et même 732 cloches dans mon carillon. Plein de choses idiotes mais qui ne font plus guère de mal. En définitive peu ont compris, mais je ne suis rien de tout cela, ni un nouveau Disneyland, ni un monument raciste. J’ai cultivé une fleur, je suis presque la seule à l’avoir fait, Helianthus porteri, une magnifique petite marguerite jaune, aussi nommée Confederate Daisy, j’essaye de m’en faire une couverture, je serais une montagne de fleurs, visible depuis la Lune.
Je suis née de la rencontre entre la rivière Saint-Joseph et la rivière Sainte-Marie et je ne suis même pas la rivière Saint-Jésus. Aucune foi, aucun miracle. 209 km à traîner vos saletés, biphényles polychlorés, microcystine, phosphore, métaux lourds, algues de toutes sortes. Mes jolis méandres salopés par vos usines, vos quartiers résidentiels et votre agriculture intensive, mes poissons déformés par les tumeurs, mes petites îles massacrées par vos villas coloniales. Et puis de nouveau une vague résilience, des gens qui me cajolent et me soignent. Pourtant, vous savez comme moi que c’est bien tard, vous ne pouvez même plus boire mon eau ni pêcher mes poissons.
Oui je voudrais, je pourrais maintenant, vivre tout seul au fond des bois, au fin fond du Montana, avec Rick Bass et ses voisins de la vallée du Yaak, avec les cerfs en surnombre et les ours en raréfaction, avec les sangsues et les exploitants forestiers. Je serais peut-être heureux, je serais sans doute plus vivant, j’aurais sûrement davantage la sensation d’exister. Mais cela n’arrivera pas car je ne saurais pas, je serais incapable de me débrouiller, je serais handicapé par tout ce que je sais et par tout ce que je ne sais pas, j’aurais peur souvent, glacé d’effroi par un cri de coyote et toujours inquiet et effrayé à l’idée de rencontrer une des rares femelles grizzlis parcourant la montagne. J’aurais peur des tempêtes de neige, des orages violents déclencheurs d’incendies, du froid glacial, de tout ce qui est vivant en somme. Je suis devenu ce genre de mutant incapable de vivre dans la nature et de moins en moins capable de vivre en milieu urbain. Voilà ce que je suis.

CÉLINE MASSON Zone disputée
De la natation à la performance
artistique, l’autobiographie d’un corps qui souffre, résiste et se dépasse.
1982. Une jeune fille est en train de courir. Elle court et dans sa tête il y a du bruit. Les injonctions de son entraîneur, la chanson du film Fame, des mantras étranges sur la torsion de ses phalanges et la longueur de ses cheveux. Avant la course il y a eu la natation puis la gymnastique. Et pendant ce temps, à la télévision, les corps de Nadia Comăneci, de Super Jaimie, de Véronique et Davina indiquent des possibilités de mouvement, de pouvoir et d’extase. Mais il y a aussi les larmes de Candy et cet insupportable échec de la médecine triomphante qui transforme une tache de naissance sur la cuisse en un massacre chirurgical. Un traumatisme face auquel il faut faire bonne figure pour rester dans son club, avec les autres. « Effort, volonté, ténacité, dépassement de soi. » Avec Zone disputée, Céline Masson compose une autobiographie avec des fragments de souvenirs, de documents et une bouleversante correspondance avec sa mère. C’est le récit de la reconquête de son corps tel qu’il a survécu et a trouvé son équilibre à travers les gestes, les images, le sport, la médecine et la mode que lui a imposés un coin de campagne vaudoise dans les années 1970 et 1980.
collection ShushLarry format 11 x 17,5 cm, 144 p., broché isbn 928-2-88964-098-0 prix CHF 16.50 / € 13
« J’aurais aimé me dire que ce n’était finalement pas si grave.
J’aurais aimé ne pas leur en vouloir. »

Le corps est le principal outil de recherche de Céline Masson (*1973), artiste suisse formée à Manchester, Sion et Sierre (Master « Art in Public Sphere »). À travers ses vidéos et performances, elle manipule son visage et son corps pour faire apparaître des faiblesses, des monstruosités et des absurdités. Passant du burlesque à l’inquiétant, elle offre un miroir grossissant à cette incongruité qui fonde notre identité : le corps n’est pas le même vu de l’intérieur ou de l’extérieur. Ce travail se poursuit dans un récit, Zone disputée (art&fiction 2025), véritable autobiographie de son corps.
mot-clés biographie, sport, performance, corps, médecine, années 1980 livres connexes Journal d’un corps, Daniel Pennac, Gallimard, 2012 ; Fabriquer une femme, Marie
Darrieussecq, POL 2024 ; Femmes & sport. Regards sur les athlètes, les supportrices et les autres, Collectif, Hélium, 2024
Mon frère dit de moi que je suis une écorchée vive. Je me sens comme un terrain en friche, une zone urbaine de non-lieu. J’aime ces espaces sauvages, ouverts aux possibles, où j’ai la sensation de voir mon corps se projeter devant moi.
Céline
Céline
No Man’s Land
No Woman’s Land
La zone disputée.
CÉLINE MASSON
ZONE DISPUTÉE 11
J’ai toujours l’impression de venir du dessous de la terre, comme si j’arrivais de très loin, si loin qu’il faut que je rattrape quelque chose, sans cesse. Je bouge pour habiter l’espace et me sentir en vie. C’est un tempérament, c’est un rythme dans mon corps qui est là. Comme si je voulais me débarrasser de quelque chose et que le mouvement m’y aidait. Je prends conscience de mon espace. Et puis il y a ce qui se passe autour : l’environnement, les interactions qui définissent une série de chorégraphies que je répète comme un langage.

Durant l’exercice, je m’entends respirer, je cherche le rythme, j’essaie de trouver la fluidité des gestes. Je m’efforce de coordonner efficacement mon corps pour traverser ce moment. Dans ma tête, il y a une voix qui me guide, celle du but à atteindre, celle de la concentration – une voix volontaire.
Je sais que je peux y arriver. Le sol est dur.
Je sens tous mes pas qui résonnent dans mes jambes.
Mon corps est de plus en plus lourd. Il faut continuer à soulever, continuer à respirer.
L’effort remonte jusque dans mes doigts que je presse entre eux pour rester concentrée, pour ne plus penser à mes jambes.
Je sens le va-et-vient de mes cheveux sur mes épaules, j’ai chaud. Je transpire de partout. Mon legging n’est pas adapté à cette course. Mon tee-shirt est trop long, mais assez ample pour laisser passer l’air. Je sens les épingles à nourrice de mon dossard sur ma peau.
J’entends les paroles en moi.
12 CÉLINE MASSON
Polaroïd
J’ai deux frères aînés. Mes parents sont des « self-made » entrepreneurs qui ont créé chacun·e leur propre entreprise dans le domaine de la vente. Issu·e·s de couches populaires, il et elle désirent nous offrir ce qui leur a manqué durant leur enfance. Nous habitons une grande maison avec jardin et piscine, nous jouissons de loisirs sportifs et mon père, fou de voitures, en possède quatre – dont une Ferrari. Mes parents ont un cercle d’ami·e·s qui leur ressemblent, issu·e·s de la même classe sociale, avec le même désir d’élever leur niveau de vie. Il et elle ne sont pas arrogant·e·s face aux autres, mais ne se privent de rien et le montrent. Tous les deux travaillent à plein temps. Ces années folles durent environ douze ans : entre 1973 (l’année de ma naissance) et 1985. Puis mon père fait faillite. Ma mère assume ensuite les revenus de la maison pendant quelques années avec ses commerces.
ZONE DISPUTÉE 13 À toutes jambes
Je cours, je nage, je fais la roue sur une poutre, j’inspire et expire vite, je retiens mon souffle. Mon corps est très entraîné. Je dois me dépasser, toujours et encore, tirer sur mes muscles pour être plus souple, pour aller plus vite. La limite s’éloigne sans cesse et il y a cette boule qui arrive dans ma gorge, celle qui fait que j’ai toujours envie de pleurer à un moment ou à un autre.
J’ai cette formidable volonté pour accepter l’effort, comme si au bout j’allais être libérée de quelque chose.
Dans la performance sportive, il y a un début, un milieu et une fin. L’histoire est très simple, mais doit être pensée avec précision.
Le rythme y est important, il faut trouver sa cadence en lien avec sa force.
L’effort physique n’est pas silencieux, il résonne bruyamment dans notre corps.
16 CÉLINE MASSON
Fame
I’m gonna live forever
I’m gonna learn how to fly (high)
I feel it coming together
People will see me and cry
…Remember my name
Il y a cette évidence de ce qu’il faut faire et la répétition devient pénible. Je ferme les yeux, je n’en peux plus. Je suis dans mon souffle, tout se resserre dans ma poitrine. Arriver au bout pour en finir.
La boule dans la gorge est là.
Je n’ai pas besoin de gagner, juste d’arriver.
Le rituel de la douleur m’épuise, mais je le connais.
Il y a une revanche à prendre, à ne pas laisser passer.
Fame
I’m gonna live forever
I’m gonna learn how to fly (high)
I feel it coming together
People will see me and cry
I wanna live forever mhhhmmmh !
ZONE DISPUTÉE 17
J’ai 14 ans et je cours
Mon entraîneur est suisse allemand et sa voix directive nous guide.
Il faut soulever les genoux dans la neige.
Il faut faire de petits pas pour descendre les chemins dans les vignes.
Il faut faire attention à sa respiration, ne pas être que dans la gorge, mais aussi dans le ventre.
Il faut comprendre son rythme.
Inspiration
Inspiration
Expiration
Inspiration
Inspiration
Expiration
Il faut s’entraîner deux à trois fois par semaine. Nous allons aux différentes courses de la région, même au championnat suisse. Nous nous entraînons sous la pluie, dans la neige, sur toute sorte de terrains accidentés et sur goudron bien sûr. Nous n’avons qu’une paire de chaussures.
Course des 20 km de Lausanne, 1987.
CÉLINE MASSON
18
Pour moi, cette paire unique a été la première Nike Air. Elle est de couleur blanche. Le vendeur nous explique qu’il y a de l’air dans la semelle de la basket, ce qui permet d’amoindrir les chocs liés aux différents types de terrains. C’est surtout la légèreté de ces chaussures qui est impressionnante. Je ne peux les utiliser que pour les entraînements et les courses – de toute façon on ne porte pas de baskets au quotidien, en tout cas pas chez moi.
Dans la course, je laisse dans mes pas les voix des autres, les situations difficiles, la complexité. Dans l’action, tout est plus simple. J’arrive à gérer ce corps, à comprendre où je suis. Je me sens ici et maintenant. Je me connais à travers l’effort, il y a un vocabulaire du geste que je sais lire. Et puis il y a ce moment libérateur, celui où l’effort n’en est plus un et où les jambes se déploient sans le cerveau, où le rythme parfait s’installe. C’est alors que la sensation de l’effort devient plaisir, sans que j’y sois pour quelque chose. Cela vient, c’est tout.
Les paysages que je parcours sont intérieurs plutôt qu’extérieurs. Le dehors se
ZONE DISPUTÉE 19
réduit aux obstacles du sol auxquels il faut faire attention. C’est une traversée dans un espace-temps totalement fluide où les pensées viennent, sans structure, s’associer à d’autres et s’évanouir.
22 CÉLINE MASSON
sais qu’il faut se méfier du mur où il y a des plantes qui attirent les abeilles. Je reconnais l’odeur de la neige qui a fondu et qui est devenue de la boue, celle de la pluie sur la terre après un jour sec – j’adore cette odeur. Je reconnais aussi l’odeur du fumier frais et celle des bouses de vache. J’ai l’habitude de voir des souris, vivantes ou mortes, des taupes aussi. Nous savons quoi faire si un renard enragé nous menace, car nous apprenons ça à l’école. Je n’ai pas peur de me salir, car nos habits ne sont pas « dommages ».
ZONE DISPUTÉE 23
Organique
Dans cette campagne, nous vivons au quotidien avec les animaux. Je dialogue naturellement avec les chats, les chiens, les vaches et chevaux. Leurs odeurs, leurs poils me rassurent et m’accompagnent. Près de la maison, il y a une petite écurie dans laquelle vivent en pension quelques chevaux. Deux femmes s’occupent de ce manège de campagne. On me dit qu’elles sont en couple. C’est la première fois que je vois des femmes vivre ensemble. En fait, cela ne change rien pour moi, je ne suis pas particulièrement gênée par cette forme de couple. Elles ont toutes les deux les cheveux courts. Je distingue tout de même qu’une d’entre elle a une apparence plus masculine à travers ses choix de vêtements, ce qui m’interroge car je ne comprends pas pourquoi elle devrait ressembler à un homme.
Je vais au manège dès que j’ai un moment libre. Ces deux femmes m’apprennent les rudiments pour m’occuper des écuries et monter à cheval. J’ai un rapport privilégié avec ces animaux qui m’apaisent et me consolent. Je découvre leur chaleur, leur
20 CÉLINE MASSON
[Carnet de Jacqueline]
Épalinges, le 23 avril 2020
Voilà, ma petite Céline, un résumé de tes ennuis de santé depuis ta naissance le 1er janvier 1973 jusqu’à tes huit ans environ. À ton arrivée dans ce monde, on te découvre un angiome important allant quasiment de l’entrejambe au genou, sur la jambe droite. Il s’agit d’une tache large d’environ 6 cm, couleur brun foncé, parsemée de quelques points encore plus foncés. Aucune explication ne nous est donnée sur la provenance de cet angiome, mais il faut en surveiller l’évolution.
ZONE DISPUTÉE 21
Terroir 1982
Nous vivons à la campagne, dans un village au-dessus du lac Léman, une vie privilégiée. Ici, les corps des enfants sont autonomes et peu surveillés par les adultes. Nous sommes libres de bouger, d’expérimenter, de nous faire mal aussi. Nous n’osons pas toujours dire pourquoi nous avons une écorchure ou des bleus, nous n’osons pas toujours dire ce qui s’est passé de peur d’être aussi réprimandés. Nous savons désinfecter nos plaies nousmêmes avec du Mercurochrome rouge et poser des sparadraps. L’école du village est située tout près de la route principale. Quand je rentre, je dois suivre « la ligne jaune » sur le bascôté et les voitures passent tout près. Sur ce trajet, je sais qu’il faut faire attention au chien qui est toujours attaché et qui aboie agressivement quand on passe. Je sais que la clôture des vaches est électrique et je reconnais le petit tac tac tac du boîtier qui diffuse l’électricité. Je sais traverser une clôture en barbelés, je sais où trouver de la terre glaise, je reconnais les orties, le sureau, les pissenlits, la dent-de-lion. Je
24 CÉLINE MASSON puissance qui me fascine et avec laquelle je joue. D’un coup de tête, ils peuvent me faire mal, me jeter, me pincer. Je connais le nom et le caractère de chaque pensionnaire de cette petite écurie qui doit compter dix têtes. Je sais les approcher, les nettoyer, les seller, etc. Souvent, il faut être ferme dans ses paroles pour que l’animal s’exécute – je sais le faire. C’est ainsi que le propriétaire de Belle-denuit vient un soir sonner à notre porte. Il n’arrive pas à rentrer sa jument dans son box après la promenade qu’il vient de faire. Comme les deux gérantes sont absentes, il s’adresse à ma mère pour que je vienne lui donner un coup de main. Ma mère est venue me réveiller et je suis sortie en « chemise de nuit » pour aller l’aider. Arrivée à l’écurie, j’approche la jument, la regarde, lui saisit la bride et lui ordonne fermement de me suivre en l’accompagnant dans son box. L’animal s’exécute sans broncher. Ma mère reste médusée par cette scène et par mon aplomb. J’ai neuf ans, et c’est vrai que j’ai développé une forme d’autorité pour me faire entendre – que cela soit en famille ou avec les animaux.
ZONE DISPUTÉE 25
[Carnet de Jacqueline]
Épalinges, le 23 avril 2020 (suite)
À six mois, je te présente au professeur D***, dermatologue en chef du CHUV. Il me déclare que lui ne fait pas de chirurgie, mais qu’il me communiquera l’adresse d’un chirurgien en dermatologie, lequel pour le moment poursuit un stage de perfectionnement aux États-Unis. Donc à son retour ce dernier me contacte sur les recommandations du professeur D***. On convient d’un essai de chirurgie qui consiste à faire une incision en long. Tu restes une nuit à l’hôpital et quelques semaines plus tard on s’aperçoit que la couture présente des chéloïdes, c’est-à-dire des boursouflures à la cicatrice.
Cela n’est pas encourageant à poursuivre, mais on découvre que le mélanome est relativement épais et qu’il faut absolument l’enlever, car il pourrait par la suite se développer en un cancer dangereux de la peau.
Nicolas Boldych

Genre : promenade
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 128, avec 8 dessins de l’auteur Prix : 14 €
ISBN : 978-2-487-558-08-3

Né dans les Alpes du Sud, en Dauphiné, Nicolas Boldych a étudié l’histoire l’art et les langues, slaves et romanes, avant de partir travailler comme professeur de français en Europe orientale : Slovaquie, Macédoine, Russie, Estonie, République tchèque. Puis il y eut la Belgique où il a vécu six ans, et le retour aux montagnes. Depuis lors l’écriture commence pour lui avec une mise en mouvement du corps et une sortie vers un ailleurs, qu’il soit forêt, montagne, ou un autre pays. Il dessine également les arbres, les massifs alpins, ainsi que les villes traversées.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com
Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre


Très rares sont les écrivains français qui réussissent à traduire la singularité de la Belgique, qui en perçoivent l’extravagance dont les ondes imprègnent aussi bien la Wallonie que la Flandre et, à fortiori, Bruxelles. Nicolas Boldych est de ceux-là. Son merveilleux petit livre avec ses cartes topographiques improbables en témoigne.
Il peut se passer beaucoup de choses lors d’une simple promenade, surtout si cette dernière a lieu entre Bruxelles et Tervuren, au travers d’une forêt qui est le double, ou le reflet, de cette grande ville baroque, emmêlée et végétale, qu’est Bruxelles. Surtout si cette promenade se répète une, deux, trois fois. Pas à pas le monde s’élargit et le passé s’invite au coin d’une rue, dans une clairière au cœur de la forêt de Soignes, ou sur la banquette d’un tramway sans lequel plus rien ne tournerait rond. Le promeneur est aussi un chasseur d’idée et d’images, et ses trophées sont des phrases qui racontent Bruxelles, la Belgique, l’Europe selon des cercles concentriques s’élargissant semaine après semaine. Une vision baroque des choses pleinement revendiquée.
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Téléphone : 06 62 68 55 13
Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde
75006 Paris c/o Galerie Exils
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip
Couverture : Adrien Aymard.
Suivi de fabrication : Alice Rousseau.
© Éditions du Canoë, Bourg-sur-Gironde, 2025.
Nicolas Boldych Voyage à Tervuren
Extrait
En librairie le 2 mai 2025

Éditions du Canoë
En ces temps de crise, grâce aux soviets des transports bruxellois et à la configuration de la capitale nervienne qui à l’Orient est à l’orée des bois, il est encore possible de s’offrir – à prix très modique – de lentes escapades dans la brume.
Une fois, deux, trois fois, même plus au besoin. Un dimanche de préférence, et au petit matin.
Partir lentement, banalement, pour aller loin, vers la flamboyante, la ténébreuse, la bien assise Flandres.
Aujourd’hui le froid est modéré, il a replié élégamment ses ailes en signe de trêve et la lumière promet d’être remise à l’endroit ; elle est un lait ne demandant qu’à surgir de la paresseuse brume hivernale. Par vagues.
Bien heureusement la ville réserve des sentiers sur rails, des échappées motorisées sans but véritable hormis celui d’aller hors. C’est bruyant et silencieux tout
à la fois, car la machine qui nous emporte, tram cossu sorti vivant du vingtième siècle avec ses ampoules criardes et ses inusables essieux, a tout le silence de la ville pour elle, et ses grincements arthritiques meurent rapidement dans ce grand silence blanc et vaguement insalubre, cette incurie dominicale où mêmes les autos prennent racine.
Ce lent déplacement vers Tervuren, même s’il ne fait pas battre le coeur, a au moins l’avantage de l’apaiser, de par les ombres tutélaires, les ébauches de tableaux anciens, les images pieuses qu’il suscite. Je m’offre ainsi un petit film historique et naturaliste entre monde moderne et préhistoire, l’arc de triomphe et les longs arceaux des hêtraies, les moteurs et les coléoptères, Léopold et les Ducs de Brabant.
Électricité et chandelles.
Comment dire… Aller dans l’avenue des bois, dans ces champs élyséens où l’œil se fait géomètre, empereur, en vis-à-vis de grandes vitres couvertes d’une buée légère inondée de promesses solaires ; observer encore somnolent les vastes maisons blanchâtres, couleur saumon, jaune citron où parfois logent des ambassadeurs d’Afrique ou d’Arabie, les terrasses, allées de buis,
gazons grassouillets des jardins, et puis apercevoir les premiers arbres aux grands fûts argentés, avant de recevoir ce coup de pied imperceptible qui nous fait basculer vers la paix des bois ; il y a tout ça dans ce simple déplacement.
Que c’est bien fait ces allées de fayards, piliers répétés d’un grand temple païen au toit bleu qui se confond avec le ciel, cette hêtraie cathédrale honorée par les bergers malinois, joggers, ramasseurs de champignon clandestins, ou encore par ce géomètre ukrainien que je rencontrerai par la suite, carte en main, et dont l’égarement semblait être non au dimension du bois qu’il arpentait mais du monde.
Il n’y a pas un seul un bruit de travers dans tout cela, aucune erreur humaine.
Mais le silence est ce beau cristal fait pour être brisé.
Le compartiment pourtant spacieux et moitié vide au départ de Montgomery, est bientôt chamboulé par l’arrivée d’une douzaine de scouts pétulants, filles et garçons de bonne famille. Entrés à l’improviste depuis cet arrêt étrangement sis à un carrefour perdu au coeur de la forêt de Soignes (Tir aux pigeons), ils commencent vite à m’énerver à force de simagrées, contorsions juvéniles,
et surtout de cette avalanche de cris hystériques qui ont dégommé en un éclair mon beau silence.
Prenant goût à cette école buissonnière qui les ensauvage, accablés par la voix nasillarde de leur chef – un long adolescent en habit de gendarme –, ils se déquillent mutuellement à coups de sacs à dos bourrés de timbales, bouteilles, cordes et sandwichs. L’informité tapageuse de la Ville prend l’aspect de cet intranquille troupeau, de cette logorrhée d’onomatopées formant un langage erratique mais apparemment très efficace, car la troupe a conquis, par dérapages successifs, l’entièreté de l’espace du wagon et s’apprête même à empiéter sur le suivant, vers l’avant. À moins qu’ils ne soient sur le départ.
Oui, les voilà qui achèvent leur expédition par une sortie bruyante à l’avant dernier arrêt, Brusselsteenweg, et disparaissent bientôt dans la nature sauvage pour leur croisade champêtre. Parmi les barbelés ligneux des sous-bois qui firent tant souffrir les légions de Jules César. Et c’est le terminus, le point final de la ligne.
La brume s’est levée découvrant la trame moyenâgeuse, l’agencement tortueux des maisons de
Tervuren ; muraille bourgeoise aux créneaux de cheminées et de paraboles, mosaïques de portes noires, rouges Bordeaux, larges baies ouvertes aux regards des passants ennuyés, comme dans la transparente Hollande, toitures pointues scalpées par les rayons d’un soleil qui ce matin sera blanc, plein de réminiscences hubertiennes (saint Hubert fut le maître des lieux dans les temps anciens).
Tervuren est encastré dans le forêt de Soignes dont elle prolonge les piliers avec ses successions rigoureuses de bâtisses encollées les unes au autres par la glue des siècles. Elle sort et rentre dans le bois tout à la fois, elle dort sur un délicat tapis vert qui forme une tapisserie d’un seul tenant malgré quelques raccrocs de bétons ou de gravier.
Et je me dis qu’il doit y avoir par là-bas un manoir dormant au pied d’un étang, un manoir semblable à ceux du Limbourg, entraperçus depuis un train à la lenteur parfaite.
Allons vers cette lumière posée comme sur des écailles de tortues. Traversons la route à double voie s’achevant par un ce cul de sac triomphal qui marque l’entrée du Versailles léopoldien. Montons vers le grand village blanc qui dort, qui se tait, qui prie, où rien ne
8 9
bouge, où les feuilles jaunies des érables soulèvent le coeur, où les passant chenus sont tirés par des petits chiens de race, haletant.
J’avais envie de surprendre la ville dans son sommeil mais c’est moi qui commence à dormir debout, à aller dans un rêve froid, net, propre, aux couleurs d’une vieille guimauve ou d’une pelure jaunie d’un melon cantaloup.
Et du monde ne reste que la frustre géométrie de la de la ville banquière.
Me voilà pour tourner un bon moment parmi les banques franco-belges, les vitrines des magasins de fanfreluches coûteuses et les statues impertinentes de garçonnets frondeurs.
Tourner, c’est bien le mot. La rue belge est courbe et je pense qu’il y a là-dessous comme une ruse baroque destinée à perdre les piétons bêtement euclidiens, à cajoler, endormir, par un mouvement imperceptible de spirale les chalands qui se perdront peu à peu dans le dédale des banques vampirisantes et des inutiles commerces, dans le cloaque aux milles lumières électriques où on en veut à leurs piécettes douloureusement acquises. Bien qu’il soit en ce jour difficile de dépenser ce que l’on n’a plus.
Heureusement à Tervuren il n’y a pas un tel dédale, car on n’y trouve que deux véritables courbes marchandes. Tout le reste est façade privée, méditation, joie secrète, comptages des gains, ou peut-être jérémiades à propos des pertes. On s’y promène en vain, et c’est ce que j’aime.
Courbe elle l’est ici d’une manière très légère mais suffisamment pour qu’on ne puisse plus apercevoir une fois en bout de rue, quand on se retourne nostalgiquement vers le passé, son début désormais occulté par un renflement de briques percé de grandes fenêtres sans rideaux. On a glissé vers autre part. Et l’on serait perdu si tout cela ne devait mener à la place.
Elle est blanche et laiteuse la place, c’est un fantôme de place où les habitants brillent par leur absence, un désert couleur de cendre et de repentir qui encadre sévèrement les aspirations des badauds aux pas alanguis. Une sainte place de l’hiver de nos jours, et autrefois une clairière de grès et granit où les chasseurs et les peintres devaient se côtoyer dans une promiscuité tapageuse, plongés tous ensemble dans des nuages de tabac amstellodamois. Ainsi, dans la chaleur des estaminets comme le De Vos, le peintre Boulenger devait-il laisser reposer ses pupilles encore imprégnées des papillonnements
ténébreux des forêts alentour, écoutant distraitement les récits de chasseurs de daims, perdrix, blaireaux...
Un seul café, au coin de la place, me semble faire l’affaire, me rappeler à ce glorieux temps passé. L’autre est en fait une dégoûtante pâtisserie savoisienne où se pressent des matrones aux moumoutes lilas.
C’est un café marin où les passants accostent après la traversée de la première artère, poussés dans le dos par un noroît tenace qui après avoir pénétré en larges rafales dans la rue courbe commence ensuite, aux abords de la place, par se tordre et ramper misérablement. Ce café est bien éclairé par de larges baies vitrées qui nous laissent voir une grande précision ce qui se passe à l’intérieur, des baies aussi attirantes que la patine éclatante d’une peinture flamande du xvie siècle ; dans des miroirs ronds accrochés au mur, à gauche en entrant, je vois s’immobiliser l’arrière des crânes, se refléter le sourire pensif d’une femme aux yeux cerclés de montures à double foyer. Les clients parlent à voix basse, font chavirer la bière dans leur gosier asséché par une conversation qui doit s’étirer depuis des heures à en juger par le nombre de choppes vidées. En face, derrière le comptoir de zinc flamboyant, la tenancière flamande tout ouïe attend calmement la commande.
Lumière blanche, iridescente du matin, qui donne aux objets, cadres, fauteuils, verres, une précision chaude et métallique, qui souligne un ordre évident. Il y a dans cette lumière flamande, en particulier en hiver, un métal, une coulée d’étain qui la distingue définitivement de la brillance légère, aérienne, dorée du pays latin, au sud, vers Namur ou Dinant, le long de la Meuse aux eaux vert-de-grisées.
Cette entrée dans le café est aussi un moment de suspense où il faut, avant de pouvoir entrer définitivement dans le tableau, passer l’inévitable épreuve du shibolet : Kaffe, kofie, kofe chaque fois la langue a fourché, trahissant mon désir un peu paranoïde de passer inaperçu. Par trois fois la tenancière m’a corrigé, par trois fois avec un léger sourire en coin. Puis vient à nouveau le silence, redoublé, le repos des objets et des corps. Tout le monde est pris dans le même barzakh paisible. La paix de la Flandres qui agrège aussi bien drosophiles, rosiers sans roses, blanches oies de l’étang en contrebas, que les voyageurs venus de la Babel bruxelloise à la recherche d’un tasse de café flamande, est universellement compréhensible. Tableau du dimanche.
Un homme phoque boit sa bière ambrée en lisant les titres bruyants du Nieuwsblad , chuchotis d’écolières du troisième âge, moustaches lissées devant les
miroirs sorcière en vue d’une photo qui ne sera jamais prise ; je les observe ma tasse de café à la main, tandis que le regard obliquement poli de la tenancière me suit jusqu’à ce que je trouve ma place près de la grande baie vitrée.


En librairie avril 2025
Format : 14 x 21 cm
Pages: 144 p.
Reliure : broché, collé rayon : Littérature
ISBN : 978-2-8290-0701-9
Me taire
Sandro Marcacci
PRÉSENTATION
Nous inventions des jeux avec ce qui nous tombait sous la main, des bâtons que nous avions écorcés, une vieille bâche et nous disparaissions. Sinon un jeu de dominos, des puces. Des puces qui s'échappaient dans les interstices du plancher. Un jeu de l'oie aussi.
1926 - 1953. Le roman d'une femme enceinte à 19 ans et dès lors obligée de se marier, bientôt mère, atteinte de tuberculose et envoyée en sanatorium pour deux années de cure où elle sera séparée de sa fille, retranchée dans son monologue silencieux avec une jumelle trop vite partie - au-delà de son destin de femme, comme un hymne à la vie.
AUTEUR
Né en 1963 à Neuchâtel. Écrivain et professeur de français et de philosophie à La Chaux-de-Fonds. Auteur d' œuvres poétiques et théâtrales, de romans, de proses diverses, ainsi que de livrets d'opéras et de mélodies contemporaines.
Également photographe, initiateur des fonds naturalistes Aqualogue et Araneicon. Son travail fait régulièrement l'objet d'expositions.
DIFFUSIONETDISTRIBUTIONSUISSE
Éditionsd’enbas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr

éditions JOU
Et ce monde étrange
continue de tourner
P.N.A. Handschin
192 pages
15 euros
ISBN : 978-2-492628-11-5
Diffusion-Distribution SERENDIP-LIVRES à paraître le 4 avril 2025
Depuis que son galeriste a fermé boutique, Pierre Kléber, artiste peintre au succès aussi modeste qu’éphémère, tourne en rond. Il tourne en rond dans sa ville anonyme, dans son appartement où il vit en famille, il tourne en rond dans sa tête. Quel souvenir laissent les morts ? Les enfants ont grandi si vite. Chagall jouait-il du violon ? En cinquante-sept chapitres, le monologue intérieur de Pierre Kléber dessine le portrait foisonnant d’un humain parmi d’autres.
Pierre Kléber était déjà le personnage principal du Nouveau Piano, paru en 2024 aux éditions JOU.
Et ce monde étrange continue de tourner, est par ailleurs le seizième tome d’un cycle intitulé « Tout l’Univers ».
P.N.A. Handschin. Né en 1971, auteur de 16 livres (P.O.L., Argol, Jou)
éditions JOU / 60 rue Édouard Vaillant, 94140 Alfortville – France mail : contact@editionsjou.net http://www.editionsjou.net
Extrait :
Est-ce que ça fait de moi quelqu’un d’horrible ? Parce que Sarah-Lee me disait que c’est bien de faire la connaissance de nouveaux gens. Et je lui ai objecté que personnellement, ça me fatigue plutôt. Qu’il faut toujours tout reprendre au début. « Et à part ça, tu fais quoi dans la vie ? » La question qui fâche. Sinon, c’était quand même bien sûr très sympa de la part de notre voisine de nous inviter à sa fête d’anniversaire. Sarah-Lee et elle étaient dans le même lycée, dans une autre ville pas très loin d’ici, et plus petite qu’ici. Il y avait beaucoup de monde à cette fête d’anniversaire. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de rester ni vu ni connu dans mon coin. Ni connu, ça on peut le dire ! Mais il faut croire qu’il y a toujours un zozo pour venir vous parler, s’imaginant peut-être bien faire et surtout pour ne pas lui-même rester seul. J’étais assez bien pourtant, le vin rouge était bon. Le brouhaha des conversations m’aurait presque donné l’impression d’être au bord de la mer. J’apercevais au loin Sarah-Lee discuter. Comme toujours, souriante. Surtout par rapport à moi avec ma physionomie peu avenante. Un visage carré aux traits marqués, et affublé de grosses lunettes ; des cheveux mi-longs grisonnants tirés en arrière. Ce qui n’a donc pourtant pas empêché qu’on vienne me parler. Il me semble que je devrais définitivement dire que je suis père au foyer, quand on me pose la question. Sans doute serait-ce assez rebutant pour que l’importun n’insiste pas et se débine rapidement. « Et sinon, toi, tu fais quoi de beau dans la vie ? – Père au foyer.
– Ah oui ? C’est intéressant, ça. Tiens, désolé, je crois qu’on m’appelle. »

Le Nouveau piano
P.N.A. Handschin
240 pages 16 euros
ISBN : 978-2-492628-08-5
Diffusion-Distribution SERENDIP-LIVRES à paraître le 5 mai 2024
Pierre Kléber, cinquante ans, une compagne ravissante, de charmants enfants, est un artiste peintre qui ne peint plus. Manque-t-il d’inspiration ? N’a-t-il plus envie ?
Le flux de ses pensées quotidiennes forme Le Nouveau Piano, entre incertitudes, souvenirs, mises au point ou encore déchirements. Quand le temps qui passe nous passe dessus et nous écrase.
Le Nouveau Piano est par ailleurs le quinzième tome d’un cycle intitulé « Tout l’Univers », commencé avec Déserts en 2003 chez P.O.L.
P.N.A. Handschin
Né en 1971, auteur de 15 livres (P.O.L., Argol, Jou)
Biographie complète sur Wikipedia.
éditions JOU / 60 rue Édouard Vaillant, 94140 Alfortville – France mail : contact@editionsjou.net http://www.editionsjou.net
Extrait :
En rentrant après avoir accompagné Lucas au collège avec Sarah-Lee puis Sarah-Lee à la station de tramway, il a sauvé d’une mort presque certaine quelques lombrics égarés dans les allées gravillonnées du parc. C’est qu’il sait bien combien les lombrics ont un rôle important à jouer. Cela étant, il se dit que même si les lombrics n’avaient pas un rôle si important, même s’ils n’avaient aucun rôle à jouer dans la nature, ça ne l’empêcherait sans doute pas d’en sauver cependant quelques-uns. Il se dit qu’il ne faut pas se vanter d’une bonne action ; sinon, bien sûr, c’est en perdre le mérite. Est-ce que les lombrics méritent de griller au soleil comme baigneurs à la plage ? Absolument pas. Nenni. Il se dit que cette année, Lucas est entré au collège et Abbie au lycée. C’est quand même une année un peu spéciale pour ça. Ils se sont arrangés pour que l’un entre au collège la même année où l’autre entre au lycée. Ou plutôt, bien sûr, c’est leur âge respectif qui veut ça. Ni l’un ni l’autre n’a jamais redoublé. Il se dit que tous les deux, Abbie et Lucas, ont de très bons résultats jusqu’à présent. Ce qui est un motif de fierté pour Sarah-Lee et lui, c’est normal et compréhensible. Il se dit que Sarah-Lee et lui, depuis un petit moment déjà, c’est pour la vie. Et il en tire sans doute plus de force qu’il n’en conçoit d’ennui. Et avec les enfants aussi évidemment pour toute la vie. Et c’est bête, mais sa vie justement n’est peut-être pas si loin que ça d’être finie, qui sait ? Aussi, tant qu’il est encore temps, pourquoi se contenter de sauver seulement quelques-uns des gentils lombrics échoués dans le gravillon piégeux des allées du parc ? Tant qu’il lui reste un souffle de vie, ne devrait-il pas chaque matin les sauver tous, arpenter beaucoup plus consciencieusement les allées du parc ? Il se dit qu’après tout, les lombrics sont des enfants comme les autres. Et qu’ils méritent tous d’être sauvés, bien sûr. Il se demande après quoi les joggeurs courent dans les allées du parc. Pas après les lombrics, quand même ? Il regrette que les joggeurs mettent la vie des lombrics en danger. Comme si la situation des lombrics n’était pas déjà assez compliquée. Et jamais il n’en a surpris c’est vrai, mais peut-être certains joggeurs sauvent-ils les lombrics. Peut-être s’en trouve-t-il qui sont suffisamment éveillés et attentifs à la situation des lombrics dans les larges allées du parc. Il se souvient que cet été, un jeune Afghan accompagné d’un autre jeune Afghan s’est noyé en voulant traverser la rivière qui borde le parc. Il imagine ce jeune homme parcourir à pied des milliers de kilomètres pour fuir les détestables talibans, et venir se noyer, ivre de joie retrouvée, dans une jolie rivière de la patrie des Lumières et des droits de l’Homme où il se peut même que des joggeurs sauvent les lombrics. Il se souvient que lui-même a déjà failli se noyer à deux reprises dans sa vie. Jamais deux sans trois, comme on dit ? Quand il était enfant d’abord, et qu’il est tombé à l’eau après qu’un sol instable s’est dérobé sous ses pieds. Puis adolescent, en voulant traverser la même rivière que le malheureux jeune Afghan mais à plusieurs kilomètres en amont. La panique ressentie, le souffle précipité. Trouver quelque chose à quoi se raccrocher. Il espère qu’Abbie et Lucas ne seront jamais imprudents. Il se dit
que dans sa collection de disques, il y a celui d’Alain Bashung intitulé L’Imprudence. Il a toujours peur qu’Abbie ou Lucas se fassent écraser par un chauffard. Il se demande si le broyage des poussins mâles a finalement été interdit par la loi ou pas encore, comme il en avait entendu parler. Il s’étonne que des gens sur Terre aient pour métier de concevoir des broyeuses à poussins. Dans la nature, les poules mangent les lombrics. Mais il sait que ce n’est pas pour cette raison qu’on broie vivants les poussins dans des broyeuses à poussins. Il suppose qu’il n’y a d’ailleurs plus tant de poules que ça dans la nature. Il se dit qu’au déjeuner du mercredi, il a l’habitude de faire des œufs au plat pour Abbie et Lucas. Bio les œufs, achetés en vrac au bout de la rue. Enduire préalablement d’une mince couche d’huile d’olive la poêle. Casser les œufs dans la poêle plutôt qu’à côté. Puis un peu de sel et de poivre et d’herbes de Provence. La cuisson juste comme il faut, il se dit, ni trop ni pas assez. Il se dit que c’est un jeu entre eux et qu’il demande toujours à Abbie et Lucas s’ils sont bons les œufs qu’a préparés leur papa. Il note qu’il est vraiment un papa poule. Il se souvient que quand lui-même était enfant, il y avait une série télé intitulée Papa poule. Il se dit qu’Abbie et Lucas ont beau dire, n’empêche que la télé existait déjà quand il était enfant. Cela étant, est-ce que ça lui aurait déplu de grandir à l’époque des dinosaures ? Il se dit qu’il y a environ 65 millions d’années, la cinquième extinction de masse a notamment vu disparaître les dinosaures, et que selon des experts du monde entier, la sixième extinction a commencé. Et il a cru comprendre que les responsables ne sont pas les lombrics. Auquel cas il aurait bien sûr aussitôt arrêté de vouloir les sauver. Il lui semble que s’il n’a jamais été un grand fan de l’humanité en général, il préférerait pourtant qu’elle soit sauvée. Parce qu’il y a certes pas mal de déchets, mais aussi des Abbies, des Lucas, des Sarah-Lees, des Nelson Mandelas, des Einsteins et des Mozarts. Il se dit qu’en ce moment, Lucas joue le rondo de la Sonatine viennoise n° 2 de Mozart, et Abbie, la Bagatelle n° 1, opus 33, de Beethoven. Il se dit : dites trente-trois. Il n’oublie bien sûr pas que dans sa collection de disques, il y a l’intégrale des Sonates pour piano de Mozart interprétée par Christian Zacharias. Dix-huit sonates en tout. Il remarque que depuis qu’il ne va plus voir son docteur, il n’est plus malade. Il pense à son amie Isabeau qu’il connaît depuis longtemps, depuis le lycée exactement, et qui vit dans une autre ville avec son docteur de mari et leurs deux fils. Il se dit qu’elle est entourée de garçons. Il regrette qu’à Noël dernier, ils se soient loupés. Il se dit que Noël dernier, pour le père de Sarah-Lee, ça a été son dernier Noël. Il se dit qu’à partir d’un certain âge, on peut s’attendre à ce que Noël soit son dernier Noël. Ce qui vous ferait presque aimer Noël. Il se dit qu’il n’aime pas Noël sauf que c’est l’une des rares occasions de voir Isabeau. Il sait que le père d’Isabeau s’est suicidé quand elle était enfant. Il ne sait pas comment il s’est suicidé et peu importe, bien sûr. Il se demande tout à coup s’il n’a pas entendu Isabeau, il y a des décennies de cela, parler de revolver. Il constate que la seule personne de sa connaissance qui se soit suicidée était un voisin. Père de quatre enfants, dont la plus âgée devait alors avoir vingt ans. On l’a retrouvé pendu à une branche face à
l’océan, un endroit magnifique semble-t-il, non loin de la maison de vacances. Il se dit que le voisin a dû se dire : bel endroit pour mourir. Sarah-Lee trouve le suicide égoïste. Il se dit qu’il ne sait pas au juste s’il trouve que le suicide est un acte égoïste. Il se dit qu’il n’a pas très envie de penser à ça. Il se dit qu’une chose est sûre, c’est que ni le père de Sarah-Lee, ni ses parents à lui, ne se sont suicidés. Il note que ses deux parents à lui sont morts dans le même hôpital. Il note qu’il s’agit même de l’hôpital où Sarah-Lee travaille. Et papa poule, est-ce que ça peut éventuellement être considéré comme un travail ? Il se demande si ce n’est pas plutôt le mot pistolet qu’Isabeau aurait prononcé. Papa poule. Papaye. Papageno. Tiens, il se dit, ça, c’est encore Mozart. C’est l’oiseleur de La Flûte enchantée. Même qu’à un moment, Papageno est tellement désespéré d’avoir perdu sa Papagena à peine entrevue, qu’il veut se pendre à un arbre. Le nombre d’oiseaux a chuté d’un tiers en Europe en trente ans, il se dit. Il se dit qu’il n’y a peut-être pas de rapport, mais les oiseaux ravissants auxquels il laisse des graines de tournesol devant la fenêtre de la petite pièce qui lui sert d’atelier ne viennent plus que de loin en loin. Il se demande s’il ne faudrait pas plutôt dire : qui lui servait d’atelier. Il se demande depuis combien de temps il n’a pas touché une toile. Il se demande depuis combien de temps il n’a pas touché un chèque pour avoir peint une toile. Il se dit que de toute façon, il vendait peu. Son galeriste le vendait peu. Il se dit que pour être franc, il a tout de même une petite idée du nombre d’années depuis lequel il n’a pas touché une toile. Il se dit que sans l’héritage de son père. Il se dit que sa mère est morte quinze ans avant son père. Il note que quinze ans, c’est l’âge qu’aura Abbie dans quelques jours. Sa petite Abbie adorée, si vite grandie. Il se dit que le père de Sarah-Lee leur avait donné un gros sac de graines pour les oiseaux. Mais maintenant, ils n’utiliseront jamais toutes ces graines. Il se dit que s’il pense au fait qu’Abbie et Lucas grandissent si vite, il n’y peut rien, les larmes lui montent aux yeux. Il se dit qu’après que Charlélie a mis la clé sous la porte, il a cherché quelque temps, mais n’a pas retrouvé de galerie. Il se dit : qui veut d’un artiste qui vend si peu. Il convoque une image d’Abbie toute petite, cheveux plus blonds et plus bouclés, visage poupon, mais recule aussitôt. Il se dit : mes yeux se remplissent de larmes. Il se souvient du titre d’un film de Fassbinder, Les Larmes amères de Petra von Kant, mais il pense ne pas avoir vu ce film. Il se souvient être allé récupérer deux ou trois toiles pour ainsi dire à l’abandon dans l’arrière-boutique de la galerie. Il se souvient du sourire triste et du haussement d’épaules de Charlélie. Il se dit qu’il ne faut pas exagérer, avec Abbie et Lucas et leur maman bien sûr, ils ont encore des années à être ensemble à la maison. Il pense au bonheur qu’il y a à être ensemble. Au bonheur que c’est. Il se dit que la planète Terre est notre seule maison. Mais nous semblons décidé à tout gâcher ; nous n’en avons jamais fini de tout salir. Il se dit qu’il ne doit pas oublier de passer l’aspirateur.
VIDYA GASTALDON

Bleu Extase
1994, une rave. Une jeune femme se retrouve prise dans une expérience initiatique. Elle se découvre au cœur d’un océan de perceptions.
Fleur est née à Florac, ne porte jamais de robe et reste en sécurité dans son petit théâtre. Bleu Extase est le récit de sa vraie naissance.
Une naissance faite de peur et de fusion tout autant que de déchirement avant la grande respiration océanique. Les années 1970 ont déjà ouvert la voie vers de nouvelles perceptions, la découverte de Soi, les communautés hippies. Mais les « on the road » aboutissent parfois dans des culs-desac. Pour Fleur, enfant indigne de cette utopie, il faudra bientôt en quitter les tendres effluves. C’est un autre temps qui s’annonce à l’aube de ses 20 ans : celui des années 1990, de la techno et des raves. Se laissera-t-elle caresser par ce frémissement sonore et révolutionnaire ? À travers ce récit d’une époque où quêtes d’expériences fortes et fêtes viennent faire exploser les limites sociales et culturelles, Bleu Extase questionne aussi les identités apprises et construites. Le texte revient sur ce moment déterminant de la fin du siècle dernier qu’on a tour à tour pensé, oublié, récupéré ou essoré par la marchandisation mais qui garde encore une incroyable survivance. Techno is not dead et tout reste à faire.
collection ShushLarry
format 11 x 17,5 cm, 300 p., broché isbn 928-2-88964-084-3 prix CHF 19.50 / € 15
On inspire, on rentre dans le récit en retenant son souffle et on expire dans la tranquillité.
Tout va bien.

Vidya Gastaldon (1974*) naît dans un ashram. Dans les années 1990, elle obtient successivement son diplôme aux Beaux-Arts de Grenoble, découvre les raves et la techno et reçoit un enseignement de techniques de méditation. Dans sa pratique artistique, tous ces éléments se lient. Son esthétique déploie des représentations des états de conscience. L’écriture lui permet de rendre compte de sa compréhension mystique du monde.
mot-clés techno is not dead, rave party, voyage intérieur, psychédélisme, années 1990, sensations livres connexes Bleuets, Maggie Nelson, éditions
du Sous-Sol, 2019 ; Machine Soul, Jon Savage, Allia, 2011 ; Les Portes de la perception, Aldous Huxley, Chatto & Windus, 1954
Chapitre 1: Les moutons
C'est une maison bleue
Accrochée à ma mémoire
On y vient à pied
On ne frappe pas
Ceux qui vivent là
Ont jeté la clé
Peuplée de cheveux longs
De grands lits et de musique
Peuplée de lumière
Et peuplée de fous
Elle sera dernière
À rester debout
Si San Francisco s’effondre
Si San Francisco s’effondre
San Francisco
Où êtes-vous?
Lizzard et Luc
Psylvia, attendez-moi
Maxime le Forestier, San Francisco, 1972
Fleur commence sa vie dans un panier d’osier capitonné d’une peau de mouton dont l’odeur âcre, des années plus tard, lui semblera tout naturellement se confondre avec celle du lait maternel régurgité. Dans son imaginaire, la texture de la laine s’associe très vite à un océan chaud et moelleux, kaléidoscope de sensations remontant comme du lait blanc et moussu à chaque contact avec la peau. C’est doux mais irritant à force. Le
panier est placé dans une grande chambre tapissée d’extraordinaires motifs floraux bleus d’inspiration Belle Époque. L’ancienne maison du début du siècle achetée par ses parents est à l’image d’une coquille de noix ouvragée dont le contenu ressemble au contenant. Elle s’appelle justement et humblement « la Bicoque ». Son apparence navigue entre la petite maison de maître et la fermette. Elle est compliquée, attachante et organique jusqu’à l’écœurement, aidée en cela par les multitudes de chats et toujours au moins un chien qui se succèdent. Un peu délabrée et située au cœur d’un jardin généreux et entretenu quoique incompréhensible, elle n’a jamais pu bénéficier de rénovations à la hauteur de ses besoins faute de financement et de réel courage. Les tapisseries ont été posées là bien avant l’achat de la maison et témoignent encore olfactivement des multiples vies et substances qui l’ont occupée. Fleur pense que les motifs de sa tapisserie sont les plus beaux de la maison. Plus élégants en tout cas que ceux de prunes et de ronces violines sur fond vert de gris qui ornent le couloir long et sombre. Tapissée de roses entrelacées sur un marbré de chair brunie, la salle à manger paraît encore relativement fraîche. En revanche, déjà très assombrie par la fumée de la cheminée, une tapisserie jaune de Naples représentant des feuilles d’acanthe est en train de sérieusement s’abîmer dans le salon, à la limite de la moisissure.
Reste une tapisserie marron caramel à fins motifs géométriques pointillés rehaussés de bordeaux dans un bureau et deux autres dans des chambres jumelles avec des motifs de trèfles, simplement déclinés en versions différentes, un vert mousse pâle et un vert sapin foncé augmenté de vieux bronze. Chaque pièce est assortie de meubles contrastés, tour à tour finement assemblés par des ébénistes de diverses époques ou faits industriellement de contreplaqués économiques et glacés.
Fleur s’identifie intensément à sa tapisserie. Elle s’appelle Fleur, elle aime le bleu, elle est née là et il n’y a aucune raison valable pour que cette tapisserie soit changée un jour. Début 1991, les parents ont changé laborieusement celle
de la cuisine du rez-de-chaussée pour une peinture à l’éponge abricot. Passé la première sensation de propre, les regrets étaient vite apparus.
«Finalement c’est un peu comme si un papillon s’était inversement métamorphosé en chrysalide», avait affirmé le père.
Enfant, Fleur aime beaucoup les robes et dans une forme de soumission naïve à son prénom elle les choisit souvent avec des motifs fleuris, heureusement beaucoup plus petits et discrets que les gigantesques pivoines hybridées de fraisiers de sa chambre. Elle aime qu’elles soient courtes et flottantes pour créer de beaux ballons ronds comme des montgolfières quand elle tourbillonne, ce qu’elle ne fait pas très souvent. Elle joue avec des cubes en bois, dont certains sont fabriqués par son père, mais tout naturellement le plastique rose commence à envahir sa chambre avec disgrâce et persistance. Comme beaucoup d’autres petites filles de sa génération, de fascinantes poupées aux jambes interminables et à la poitrine atomique finissent par remplacer quasiment tout le reste. Pour Fleur, au-delà d’un modèle potentiel de projection, elles représentent, tour à tour et selon les périodes, de spectrales fées-sirènes ou d’invincibles femmes cyborgs améliorées survivant aux environnements extraterrestres du futur et colonisant d’autres planètes. Elle promène les poupées fées devant sa tapisserie qui prend l’aspect d’un jardin luxuriant, mais cette même nature géante peut à loisir se transformer en une cartographie d’astres célestes accessibles en un battement de jambes glossy. Les poupées volent, nagent ou planent sans toucher le sol, puis fatiguées de leurs aventures atterrissent sur le tapis persan hors d’âge, offert à Fleur comme un trésor. Autres fleurs, autres motifs, le tapis se présente comme un dédale antique peuplé de Pac- mans et de fantômes dont les rôles sont tenus par des jouets de catégories inférieures.
Fleur maîtrise tout ce beau monde avec diligence et sérieux, ne demandant que rarement d’être épaulée dans sa tâche par d’autres enfants. Si toutefois l’occasion se présente, elle les accueille avec bienveillance mais indique
précisément le scénario et exécute elle-même la mise en scène. Le jeu terminé, elle gratifie chacun et chacune de prix spéciaux. Untel imite bien les bruits des Pac-mans tandis qu’une autre fait super bien bouger les jambes des sirènes.
Fleur traite les autres enfants comme des enfants.
Elle n’appelle jamais son père et sa mère autrement que par leurs prénoms:
Marie et Luc. Un peu comme des copains étranges, plus grands en taille mais pas très drôles et à qui, par malchance, aurait échoué une forme de responsabilité inouïe et beaucoup trop tardive.
Marie a trente-six ans et Luc quarante et un au moment de sa naissance.
Elle n’est pourtant pas née à une époque où l’on prend forcément le temps d’envisager d’être parents. Le monde en 1973 est un terrain de jeu rendu encore vivable par l’émergence, ou la subsistance, d’utopies douces ; le retour à la terre, le SMIC, la démocratie… Plus précisément, la France, même farcie de déchetteries sauvages dans ses moindres recoins de campagne semble encore ouverte à une forme d’avenir. C’est ce qui est écrit en grand au-dessus des panneaux publicitaires : Avenir.
Fleur n’est pas non plus un bébé de la dernière chance, elle a juste été conçue par hasard après les quelques années de divagations et de routes de ses parents. Des routes modestes de province en province. Pas la route de «On the Road». Pas de celles qui ont mené des milliers d’aventuriers et d’amazones splendides et vaporisés d’Istanbul à Katmandou, en passant par San Francisco.
Marie et Luc étaient déjà légèrement trop vieux pour cela aussi et, s’ils avaient mollement essayé d’embrasser une certaine idée des années 1960, c’était bien plus pour s’extraire de leur classe sociale un peu honteuse à force d’être moyenne que pour faire la révolution. Ils n’avaient manqué de rien, mais avaient souffert de ce manque de rien.
Ne manquer de rien était presque une insulte à la vraie vie. Une existence qu’ils s’étaient imaginés possible autrement et surtout dans un ailleurs
Louis-Ferdinand Despreez

Genre : roman picaresque
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 380
Prix : 24 €
ISBN : 978-2-487-558-06-9

Romancier sud-africain, engagé aux côtés de l’ANC de Nelson Mandela, Louis-Ferdinand Despreez a été conseiller de plusieurs chefs d’État africains. Depuis sa résidence de Pretoria, il a parcouru pendant trois décennies le continent africain du Cap au Caire et de Zanzibar à Sao Tomé dans le cadre de ses missions. Après avoir vécu sur un bateau dans l’océan Indien et le Pacifique, il est revenu à Luang Prabang et ne se consacre plus qu’à l’écriture. Il a publié La Mémoire courte en 2006, Le Noir qui marche à pied en 2008 chez Phébus La Toubabesse à la Différence en 2016. Bamboo Song est paru en 2021 au Canoë ainsi que son dernier roman, Le Taureau de La Havane en 2023.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com


2 mai
Avec La Rose du Mékong, Louis-Ferdinand Despreez nous plonge à nouveau dans l’Indochine des années 30. On retrouve les colons français de la cité royale de Luang Prabang présents dans son précédent roman Bamboo Song, mais associés aux nouveaux personnages d’une enquête et d’une coursepoursuite dans la jungle, dans les ruelles de Cholon et dans les pagodes du royaume lao. Fondé sur des faits divers qui ont défrayé la chronique de l’époque, il redonne vie à une société de colons, de marchands d’esclaves cruels comme cet Hubert Garlaban, dragon démobilisé de la guerre 14-18, arrivé à Saigon en 1919 pour faire fortune, de policiers de la Sûreté fédérale, de receleurs milliardaires, de barons chinois et de mandarins assassins. Depuis les mines de rubis de Mogok en Birmanie jusqu’au Laos – le pays du Million d’éléphants et du Parasol blanc –, dans un univers d’apsaras langoureuses et de dragons gardiens du royaume, il nous entraîne avec son bonze détective en robe safran, Phra Somsak qui erre sur la Route Coloniale 13 de la Chine au Cambodge, ne prend jamais de notes mais résout les énigmes en rêvant… sur les traces de ce rubis couleur de sang qu’on appelle « La Rose du Mékong ». Dans une langue rappelant celle des romans naturalistes, il mêle ici une enquête policière à des portraits insolites de l’histoire du monde sur fond de colonialisme, de traite des « Jaunes » et des mystères de l’Orient. Un vrai roman populaire qui nous restitue une époque et le Mékong, majestueux et sauvage.
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre
33710 Bourg-sur-Gironde
Téléphone : 06 62 68 55 13
Local parisien : 2, rue du Regard
75006 Paris c/o Galerie Exils
Couverture : Adrien Aymard.
Suivi de fabrication : Alice Rousseau.
© Éditions du Canoë, Bourg-sur-Gironde, 2025.
Louis-Ferdinand Despreez
La Rose du Mékong
Extrait
En librairie le 2 mai 2025

Éditions du Canoë
LA FORTUNE
OÙ UN JEUNE DRAGON DÉMOBILISÉ
REFUSE DE DEVENIR COIFFEUR ET S’EMBARQUE POUR LES
RICHES COLONIES D’INDOCHINE
Ville de Castres, département du Tarn, France
Novembre 1919
Depuis un an, la guerre qui avait saigné la France bien plus que celle de cent ans et fait courber l’échine à l’Allemagne dans le wagon de Rethondes était terminée. C’était la seule chose que l’on pouvait porter au crédit de cette guerre, la paix qui l’avait suivie ! Le 14 octobre 1919, presque six ans après le décret de mobilisation générale du 1er août 1914, et après des semaines de rumeurs qui avaient nourri le front d’un espoir insensé, le décret de démobilisation avait été signé par le président du Conseil Clemenceau. Cette démobilisation étalée sur plus d’une année n’avait que trop tardé, surtout pour
ceux qui avaient eu le malheur d’être enrôlés en 1914. D’aucuns pensaient même à déserter, ne redoutant plus les conseils de guerre spéciaux.
Cette annonce de Clemenceau fut une bénédiction pour la dernière vague de conscrits libérés de l’enfer des tranchées, trois millions de jeunes hommes envoyés au casse-pipe et encore consignés dans des camps de l’arrière où la machinerie bureaucratique de l’armée éclusait à son rythme pesant les livrets militaires des libérables alors qu’une partie de leurs aînés étaient rentrés à la maison depuis des mois. « Allez comprendre… » se répétaient les poilus coincés dans les tranchées qui se languissaient de leur famille.
En compagnie de quelques centaines d’autres troufions, un capitaine débordé expédia un matin le dragon Hubert Garlaban dans un wagon en route pour Compiègne, Paris et la caserne de son corps à Castres. Et un matin gris de novembre 1919, le soldat Garlaban, garçon coiffeur de son état, survivant de la classe 1899, qui s’était réveillé frais comme un gardon dans sa chambrée à l’idée de retrouver une existence normale, restitua au sergent fourrier du 4e régiment de Dragons tout son fourniment. Il souriait à l’avenir. Il ne voulut pas conserver les brodequins, son pantalon garance souillé de boue et sa vareuse à
peine portée dont l’armée était disposée à lui faire cadeau alors que, quelques mois plus tôt, on ôtait sans scrupules leurs vêtements aux cadavres encore chauds pour les ajouter, gorgés de sang, au paquetage des nouvelles recrues envoyées au feu. Il préféra empocher les quelques dizaines de francs offerts par la Grande Muette en échange de son barda usagé. Pour le biffin rendu à la vie civile, le guêpier de la guerre était déjà rangé au rayon des mauvais souvenirs. Pas question de conserver une fourragère, ni un écusson frappé de l’aigle du régiment, et encore moins un caleçon douteux et des chaussettes raidies par la crasse.
Le jeune Hubert Garlaban quitta la caserne d’un pas assuré et pour ainsi dire arrogant en franchissant le poste de garde. Il sifflotait et ne se retourna pas, comme s’il cherchait à narguer le malheureux planton qui attendait encore la quille dans sa guérite. Redevenu un péquin ordinaire, Hubert Garlaban était résolu à prendre dans les semaines à venir un éblouissant départ dans la vie en laissant derrière lui sa ville natale de Castres et les austères monts granitiques du Sidobre. Loin du logis familial qui lui sortait par les yeux, il ne devrait plus endurer les écœurants effluves de brillantine et de lotion capillaire Pétrole Hahn du salon de coiffure du père Eugène.
Il avait lu dans les colonnes de La Dépêche, le quotidien populaire qui traînait sur la table de la salle à manger, au-dessus de l’échoppe paternelle, que l’Indochine était le nouvel eldorado de l’empire et qu’on y marchait sur les lingots d’or qui poussaient comme du chiendent. Il faut dire que, dans ces années-là, la France, celle d’en haut tout autant que celle d’en bas, abreuvée par la propagande du ministère des Colonies qui ne faisait pas dans la dentelle, pensait la même chose. Et le jeune Garlaban était de ces naïfs convaincus que la fortune ne souriait qu’aux audacieux et aux petits malins, au nombre desquels il prétendait se compter. À la lecture des articles de La Dépêche, le journal « qui renseigne vite et bien », comme l’affirmait la réclame de ses manchettes et le clamaient les crieurs de rue, le dragon démobilisable n’avait pas daigné renouveler son engagement en dépit des tentatives de séduction de son chef d’escadron qui lui avait laissé miroiter des galons de maréchal des logis, et une solde plus attrayante que celle de chair à canon enrôlée de force pour sauver la patrie. Il avait tout autant résisté à l’adjudant de sa compagnie, un Lyonnais revêche, qui avait déployé une offensive de charme vantant la sécurité de l’emploi et le prestige de l’uniforme. Mais, en vain. Après quatre années de batailles assassines, de tranchées boueuses, de nuages
asphyxiants d’Ypérite et de massacres au champ d’honneur, la carrière militaire n’avait pas le vent en poupe pour les poilus qui étaient revenus entiers. Garlaban, ainsi que d’autres de sa classe, avait eu son indigestion de cornefesseries bellicistes et mortifères, même s’il n’avait enduré sous les drapeaux que la dernière année de la guerre. Au regard de la saignée subie par la France et de sa légion de gueules cassées, de mutilés et de gazés condamnés au sanatorium, s’être sorti de ce carnage avait valeur d’heureux présage à ne pas négliger…
D’ailleurs, qu’aurait-il pu faire d’autre que de tourner ses regards vers les colonies ? L’Allemagne dont on espérait qu’elle paierait les réparations imposées par le traité de Versailles n’avait pas encore commencé à verser un mark ! On vivait d’expédients, de petits boulots de journaliers. Et encore, pour être homme-sandwich et traîner sa pancarte toute une journée sur les trottoirs fallait-il deux jambes, et pour tirer une charrette à bras fallait-il qu’il n’en manque pas un ! Les démobilisés, sans lesquels le pays s’était habitué à vivre, étaient encore plus touchés que tous les autres. Pour les civils accommodés à la vie déjà si précaire de l’arrière, les poilus de retour étaient surnuméraires, ils avaient quitté le monde des vivants bien qu’ils aient survécu à la déflagration. On comptait sans eux. Ces revenants redevenus civils,
plus ou moins amochés, s’étaient résignés à vivre dans des appentis, des arrière-cours, des chambres de bonne sans eau et mangeaient un seul repas les jours fastes. L’argent ne valait rien et il n’y avait pas de travail. La France était à genoux. Depuis son retour à la maison, le père Garlaban avait rabâché à son fils, qui le savait aussi bien que lui, qu’aucun de ses anciens camarades de régiment ne s’en sortait.
Le climat était confus, le peuple français baignait dans la satisfaction d’avoir battu le Generalfeldmarschall Hindeburg, mais crevait de faim. Ce qui n’empêchait personne d’être naïvement persuadé qu’après l’apocalypse, les dirigeants du monde retiendraient la leçon et ne seraient pas assez bêtes pour se jeter à nouveau dans un bain de sang ! L’orgueilleuse Allemagne était assujettie au traité de Versailles qui devait l’humilier, lui faire passer l’envie de lorgner l’autre rive du Rhin, mais hélas aussi, la rendre insolvable, ce que personne n’avait prévu ! De l’avis de tous, la sanction était juste ; le Teuton, le fridolin, le schleu, bref le salopard d’Allemand, devait payer et souffrir à son tour mille morts pendant mille ans. On croyait dur comme fer qu’il n’y aurait pas d’autre conflit avant au moins trois siècles tant les brûlures de ce brasier avaient défiguré la France, d’autant que le souvenir de la guerre précédente contre
la Prusse en 1870 et de Paris assiégé par le Kaiser était encore vivace.
Un sursaut nationaliste et le chaos avaient alors ravivé les ambitions coloniales. Le métier des armes en temps de paix, même avec l’espoir de devenir un jour adjudant à l’usure, ne paraissant donc pas de nature à faire de Garlaban le dandy millionnaire qu’il rêvait d’être, lui qui avait si peu d’inclinations pour le patriotisme et la discipline. Dans ce monde sans lendemain qui suait la misère, la terre promise d’Indochine tendait les bras aux apprentis aventuriers. Les colonies semblaient être la seule issue.
Pour garder son garçon dans le giron familial, le père Eugène qui avait la bosse du commerce et une belle cassette de Napoléons vingt francs-or fleur de coin économisés depuis un quart de siècle et enfouis sous une dalle de la cheminée avait vanté les bénéfices qu’il y aurait à reprendre le salon de coiffure pour hommes de la place Soult, proche de la caserne Villegoudou du 4e Dragons. Eugène se voyait déjà ouvrir des établissements à son enseigne dans tout le département, et pourquoi pas audelà jusque dans la capitale ; il n’était écrit nulle part qu’un figaro provincial ne saurait devenir riche et célèbre ! La boutique assurerait à son rejeton une clientèle captive de service dit « complet-brillantine » à quarante
centimes, de boules à zéro et de favoris en côtelettes à rafraîchir. D’autant que l’actuel propriétaire – dont la rumeur affirmait qu’il avait un temps taillé la barbe d’un certain Jean Jaurès, l’étoile montante du socialisme français – avait laissé entendre qu’il adjoindrait à l’affaire la main de sa fille Élodie. La demoiselle, ni très intelligente ni plus très jeune, mais vertueuse et soumise, restait assez séduisante bien que de moins en moins courtisée en dépit de ses quelque cinquante mille francs de dot qui pouvaient faire oublier son chapeau de Catherinette. Le père Eugène se voyait déjà grand-père et se disait prêt à casser sa tirelire pour financer l’entreprise de son héritier, un rejeton qu’il jugeait être un animal teigneux et ingrat. Mais c’était son fils, il s’était résigné.
Pourtant, Hubert n’avait cure des efforts de sa famille pour lui mettre le pied à l’étrier. C’était un gros garçon mou, égoïste, fainéant et peu cultivé qui n’avait su tirer aucun parti de l’instruction publique de monsieur Jules Ferry ; il y avait mérité plus de torgnoles, de séjours au piquet et de bonnets d’âne que de Bon Point. Fils unique, il avait été couvé par sa mère, ce qui en avait fait un morveux exigeant et colérique qui persécutait les chats de la maison, martyrisait les mouches et mentait comme un arracheur de dents. Devenu un jeune adulte,
toujours aussi borné et vicieux, il ne s’était guère amélioré et restait une tête à claques doublée d’un bon à rien auquel sa génitrice trouvait pour vertu principale d’être d’une plus grande prévenance à l’égard de sa maman que de son papa… Madame Garlaban avait fait le vœu de rendre désormais grâce, tous les quinze août et à coup de cierges, à la Vierge Marie qui lui avait restitué son fils vivant et entier à la fin de la guerre.
Hubert se foutait de toute cette sollicitude. Il n’avait pas envoyé dire à son père sur le ton le plus méprisant que l’on puisse imaginer, qu’il ne se voyait pas « merlan chez les péquenauds de père en fils », condamné à passer le balai sur le carrelage pour ramasser des cheveux gras et des poils de barbe. Quant au mariage offert en prime du salon de Villegoudou, même pour cinquante mille francs de dot, un joli pactole, l’idée ne l’avait pas effleuré. En réalité, il avait des ambitions. Une folie des grandeurs qu’il exprimait avec morgue dans les cafés qu’il fréquentait le soir en sirotant des bocks et des absinthes.
Dans son arrogance de gommeux médiocrement éclairé, il ne méritait pas mieux qu’un destin miteux, mais il aimait raconter à qui voulait bien l’entendre qu’il ne pouvait plus voir en peinture cette bonne ville de Castres, qui n’était à ses yeux la « Petite Venise du
Tarn » que pour une clique de paysans troubadours à l’accent grasseyant. Non, rien de tout cela, la famille, les péquenauds, la tondeuse, la noce et les sous de l’Élodie, n’était assez bien pour lui. Hubert Garlaban exigeait de son destin de l’aventure virile avec des tigres, des éléphants, des casques coloniaux, des fusils Remington à canon rayé, des lits Picot et des bivouacs dressés dans la jungle au milieu de pahouins cul nul corvéables à merci, comme dans les récits de L’Illustration qu’il dévorait. Son destin l’attendait au pays de cocagne. Il avait étudié l’état de l’Empire, dans les gros titres du journal et au Café du Commerce en écoutant les carabistouilles des savants de comptoir. Il en avait conclu qu’il n’avait pas d’inclination pour les Nègres et les Arabes ; les sousofficiers de son régiment qui avaient « fait l’Afrique » l’en avaient dégoûté. Tous, à la caserne, disaient pis que pendre de ces Bantous fainéants. Et dans les gazettes, les illustrations de négresses du Soudan aux seins tombants en train de piler du mil ou de moukhères algériennes voilées des pieds à la tête n’avaient pas suscité d’émoi voluptueux chez lui. Il s’était bâti en rêve un monde de nabab tropical dans le delta du Mékong. Il avait entendu parler du roman Madame Chrysanthème de Pierre Loti – il ne l’avait pas lu puisqu’il ne feuilletait rien d’autre que des illustrés, ce qui lui était déjà un
gros effort – mais il avait retenu de cette histoire qu’en Extrême-Orient, on pouvait épouser à la coutume des filles à peine pubères en payant aux familles une poignée de piastres, la monnaie de singe locale. Et rien n’était plus simple que de les répudier après usage ! Rien n’interdisait de les revendre au même prix lorsqu’on s’en était lassé. Voilà des mœurs de conquérant qui allaient comme un gant à ce puceau, laid et fat que les femmes ignoraient.
Ses proches eux-mêmes n’osaient désavouer ce garçon hautain et poseur tant il pouvait se montrer rébarbatif et capable de s’enrager si on le contrariait. Il ne se gênait pas pour railler en public l’existence besogneuse de ses parents qu’il traitait de boutiquiers sans ambition. Il n’avait pourtant pas été si mal élevé que ça, « dans la religion chrétienne et les valeurs républicaines », se répétait sa famille désemparée. Comment toutes ces façons prétentieuses étaient-elles ainsi devenues sa seconde nature ? Qu’avait-on fait au Bon Dieu pour mériter ça ? Son père ne comprenait pas comment son fils s’était mué en ce détestable personnage dont il espérait que la vie rabattrait le caquet, ce que lui-même ne se risquait pas à faire. Chaque fois que l’on ramenait sur la toile cirée de la cuisine le salon de la place Soult, le prétentieux Hubert crucifiait les siens de son mépris.
Le frère d’Eugène, un brave gratte-papier employé chez un notaire de Mazamet, ne portait pas son neveu mal embouché dans son cœur et ne s’en cachait pas : « Ce morveux vous en fera voir de toutes les couleurs, à moins qu’il ne tourne mal et finisse sur l’échafaud ! » Pour en être déplaisant à entendre, le constat n’en était pas moins vrai.
Pas plus qu’il n’était charmant dans la vie civile, le dragon Hubert Garlaban n’avait pas non plus été remarqué par ses chefs pour sa hardiesse sous les drapeaux. Il avait confortablement et lâchement traversé la fin de la guerre dans une ambulance de l’arrière grâce à une opportune blessure au cours de sa première et unique sortie à Rosières-en-Santerre le 22 novembre
1917 durant la bataille de Cambrai, quelques jours à peine après sa mobilisation. À défaut de faire de lui un médaillé pour bravoure au front, un éclat d’obus dans le genou avait transformé le deuxième classe Garlaban en rescapé de la boucherie, un bidasse de plus meurtri au champ d’honneur des autres alors qu’il essayait de se planquer derrière un cheval troué de part en part par une rafale de mitrailleuse Maxim. Si cet éclat de métal ne lui était pas opportunément tombé dessus, Garlaban n’avait pas exclu de se tirer une balle dans le pied en nettoyant son fusil pour échapper aux tranchées. Se
faire sauter le pouce d’un coup de pistolet, un cas de réforme assuré, lui était apparu bien trop douloureux et lourd de conséquences.
Le survivant claudiquait désormais avec une canne en ébène à pommeau d’argent de gandin, on pouvait le soupçonner d’en rajouter pour la galerie et pour se donner un genre romanesque, celui de ces usurpateurs et héros de sous-préfecture qui finissent un jour, quand leur couardise a été oubliée de tous, par se pavaner, tels des demi-dieux de la vingt-cinquième heure, devant le monument aux morts de leur village en un garde-àvous impeccable aux accents de la Marseillaise. Hubert Garlaban tenait toujours debout, bien gaillard sur ses deux jambes, mais grâce à ce shrapnel, aucun lieutenant n’avait pu continuer à faire de lui de la chair à canon lancée à l’équarrissage au coup de sifflet. Tout au plus l’état-major aurait-il pu tirer de lui un cuisinier de mauvaise volonté ou un fourrier tire-au-cul si la guerre s’était prolongée. Planqué, il serait resté, quoi qu’il arrivât… I l aurait tout tenté pour ménager sa carcasse. Rendu à la vie civile, il n’avait pas changé ; sa recherche d’un travail serait guidée par la loi du moindre effort et la haute idée qu’il avait de lui-même.
À tout prendre, et avec le recul, Garlaban préférait son destin de lâche confiné à l’arrière des tranchées
16 17
de la Somme à celui de ce pauvre invalide d’Augustin Ricard décoré de la croix. Augustin et lui avaient dans le temps joué à chat perché et grimpé aux arbres dans la même cour de récréation. Son copain d’enfance ne risquait pas de recommencer à escalader les tilleuls, sa mère le poussait maintenant dans sa charrette pour l’aérer dans le jardin de l’évêché depuis que son éclat d’obus à lui, beaucoup plus vicieux, s’était planté dans sa colonne vertébrale et l’avait cloué à son pantalon. Pour faire bonne mesure, une balle de fusil Mauser lui avait aussi enlevé la moitié de la mâchoire, le condamnant à manger de la bouillie avec un entonnoir et à vomir des borborygmes que seule sa mère comprenait. Augustin avait été brave. Garlaban s’était illustré par son absence de courage, il n’avait pas ramené de médaille de la Somme, mais il s’était ménagé…
Pour ce garçon qui n’avait pas vingt ans et n’avait pas fait d’étincelles à l’école, l’Indochine des aventuriers brillait de mille feux de Bengale. La colonisation des sauvages noirs ou jaunes, mahométans ou païens, représentait pour lui, comme pour nombre de ses contemporains, l’avenir des peuples supérieurs, blancs, chrétiens et évolués dont il se voyait en représentant exemplaire. On répétait d’ailleurs de tous côtés, du Café du Commerce jusqu’à la Chambre des députés, et tout autant en
Angleterre, en Belgique, au Portugal, partout chez les races supérieures, que : « sans possessions outre-mer, un pays ne pèse rien et qu’il est condamné à végéter… ».
Des parlementaires l’avaient affirmé sans vergogne à l’Assemblée en ces termes, avec en première ligne Jules Ferry, le célèbre père de l’instruction gratuite, grand colonisateur devant l’éternel au point qu’on le surnomma « Le Tonkinois » et qui avait déclaré quelques années plus tôt : « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Avec ce credo, tout était permis…
Adhémar Lantier, un vieux de la vieille garde ultramarine arrivé en 1870 à la Manufacture d’Opium de Saïgon et revenu de Cochinchine pour attendre une mort cirrhotique sur les berges de l’Agout et qui avait été contremaître à la bouillerie officielle de chandoo, la pâte d’opium, lui avait mille fois fait l’article. Et bien mieux qu’un sergent recruteur de la Colo. Au point qu’Hubert se demandait pourquoi l’ancêtre en bout de course était rentré pour se faire enterrer dans le Tarn au lieu de calancher paisiblement dans sa chère Indochine
18 19
où l’herbe poussait si verte et où les jeunes Annamites se louaient pour rien ! À entendre ses souvenirs de plus en plus féériques et confus, le delta du Mékong et les arroyos, ces petites rivières autour de Mỹ Tho ou les rues de Phnom Penh et Saïgon étaient les antichambres du paradis. Les piastres y tombaient du ciel à gogo et des caisses de vermouth Noilly Prat, de Saint-Raphaël et d’absinthe étaient livrées par des mercantis jusque dans les plus lointaines plantations d’Annam ou du Laos.
Adhémar Lantier lui avait même montré en douce, pour que son épouse ne les lui brûle pas dans le poêle de la cuisine, des photos jaunies de la jeune congaï aux seins nus qui lui avait servi de domestique et de bête à plaisir. Elle lui avait rendu la solitude supportable pendant les douze années passées à cuire les boules de cet opium noir de Bénarès ou de pavot blanc du Yunnan qui étaient ensuite acheminées vers le nord de l’Indochine par chaloupe fluviale. La « fumée bleue » était escortée par une canonnière tricolore pour être distribuée dans la Colonie par l’État français dans des boîtes de laiton serties. Le vieil Adhémar lui avait confié que c’était un métier de chien que fabriquer cette saleté puante. La transformation exigeait trois journées de labeur pour les ouvriers, torse nu et asphyxiés par les exhalaisons toxiques, lui au moins pouvait aller de temps à autre
s’aérer les bronches dans la cour, pas les indigènes…
Les coolies étaient outillés d’une spatule en bois pour malaxer la mélasse noire et visqueuse dans les cuves de cuivre d’une vaste halle du boulevard de Canton saturée d’une humidité à l’odeur entêtante. Mais ce négoce de stupéfiant pourtant licite contribuait à plus du quart du budget de l’Indochine ! La France encaissait des millions de piastres chaque année et n’avait aucune intention de renoncer à cette manne alors que l’opium était interdit en France par les pères la vertu de la Chambre et par la maréchaussée. La camelote s’écoulait librement partout en Indochine avec un congé républicain collé sur la boîte estampillée R.O, pour « Régie de l’Opium »… Les distillateurs des campagnes françaises avec leur eau-de-vie de prune étaient moins bien traités que les bouilleurs de chandoo des colonies !
Quant à la congaï de la photo avec ses tétons en boutons de sonnette, une Annamite que Garlaban trouvait bien peu affriolante, tout en espérant qu’on pouvait dégotter mieux que ce vilain remède à l’amour, le distillateur de pavot l’avait revendue en partant, et encore à profit, à un collègue, un « bleu-bite » venu de la Métropole ! Rien ne se perdait en Indochine, surtout pas une concubine bien dressée à s’occuper sous toutes les coutures d’un « Monsieur Blanc tout neuf ».
Adhémar Lantier avait tout compris aux colonies, même ce dont il aurait fallu ne pas se glorifier, mais qu’il aimait partager…
« Et pour l’opium, j’te dirai qu’on s’en foutait royalement que c’était du poison, c’te merde ! Les autres culs de plomb des bureaux le savaient très bien eux aussi, mais cette saloperie de merde, elle était vendue qu’à des crevards de chinetoques fins gaspillés… On avait le droit, on s’en battait l’œil, nous autres… Les clients, c’était qu’une méchante bande de citrons bons à rien qu’à se ramollir la cervelle, vautrés sur des nattes avec des cinquante touffianes par jour qui les tournaient légume !
Et même pas de la bonne came, c’était du dross… Pas fichus qui z’étaient de tirer leur coup, avec des bras et des canes comme des fifres… Ils devaient avoir la queue desséchée pire que le reste… Y’avait bien des Blancs qui tiraient sur le bambou, et pas qu’un peu, mais ils finissaient toujours par tourner indigènes avant de crever…
T’as raison, c’est pas un truc de chrétien, Adhémar ! qu’il approuvait Hubert, un peu excité quand même par l’interdit.
Ah ça non, tu l’as dit ! Tu les aurais vus, c’était qu’des fantômes crevards, transparents façon tubards dans un sanatorium… Ç’aurait passé derrière une affiche sans la décoller, c’t’engeance. Moi, j’y ai jamais
touché à c’te pourriture d’opium de mes fesses. Ça schlinguait le vieux champignon avarié et j’te dis pas le pot-bouille pour s’envoyer c’te saloperie dans la goule !
Pire qu’une messe noire de sorcière, et j’te roule la boulette, et que j’te la fais cuire au bout d’une aiguille, et que ça grésille, et que boy te la met dans le fourneau et là, paf !, faut pomper d’un coup sec à s’arracher le poumon… Et après, les gars y z’étaient rétamés pendant des heures comme des loques ! À côté de ce cirque de merde, un p’tit godet de calva c’était plié en trois secondes et ça t’requinquait la santé ! »
C’était le sermon que lui faisait à chaque fois en ricanant le père Adhémar dont le nez en pomme de terre et le foie protubérant devenu un musée des spiritueux ultramarins témoignaient d’autres addictions aussi ravageuses que celle à la fumée bleue. En conclusion, Garlaban, que par nature n’étouffaient pas les principes, avait retenu de cette diabolique homélie coloniale que s’il devait finir par tremper ses doigts dans la confiture brune du pavot pour faire sa pelote, il n’aurait aucune raison de se montrer plus regardant que l’État français qui était maître trafiquant, receleur et vendeur de came. À lui le pactole !

7 mai
Louis-Ferdinand Despreez

Genre : roman
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 320
Prix : 21 €
ISBN 978-2-490251-43-8
Romancier sud-africain, engagé aux côtés de l’ANC de Nelson Mandela, Louis-Ferdinand Despreez a été conseiller de plusieurs chefs d’État africains. Depuis sa résidence de Pretoria, il a parcouru pendant trois décennies le continent africain du Cap au Caire et de Zanzibar à Sao Tomé dans le cadre de ses missions. À soixante-six ans, il vit désormais sur un bateau dans l’océan Indien et le Pacifique et ne se consacre plus qu’à l’écriture. Il a publié La mémoire courte en 2006, Le Noir qui marche à pied en 2008 chez Phébus et La Toubabesse à la Différence en 2016. Bamboo Song est son quatrième roman.
Éditions du Canoë 2021

C’est à une étrange croisière dans le temps que nous convie LouisFerdinand Despreez dans ce Bamboo Song. A-t-il rêvé le périple improbable de cet ambassadeur de l’Empereur Hailé Sélassié, Ras Makonnen, envoyé en mission auprès du roi du Laos à Luang Prabang en Indochine sous domination française pour obtenir protection devant les menaces de guerre de Mussolini sur son pays ? A-t-il rêvé aussi cet Extrême-Orient d’avant la Deuxième Guerre mondiale – Laos, Siam, Cochinchine, Cambodge où régnaient encore des cours munificentes ? A-t-il rêvé enfin une descendance imaginaire à Rimbaud dont un des pseudonymes était Jean Baudry ? Il nous emmène un siècle en arrière dans les odeurs enivrantes des frangipaniers, parmi l’or et les pierres précieuses, dans des contrées alors lointaines et inexplorées où la colonisation française n’avait pas encore partout établi ses mœurs et sa domination.


AMORMINA B
Frédéric Roussel

Léo Bakst est seul sur la lointaine planète Amormina B, en charge de l’explorer. Il procède par « rondes ». D’une base scientifique austère, il part dans une direction et revient, prudemment, avant que sa réserve d’oxygène ne s’épuise. Homme solitaire et effacé, ses missions sont l’occasion de digressions sur le sens de la vie, mais aussi sur son origine. À l’horizon, Léo repère HCZ-408, une montagne dont tout laisse présager qu’il s’agit d’un volcan éteint. Intrigué, il prépare une expédition allant à l’encontre de toutes ses règles de sécurité. Dans ce cratère se cache peut-être l’histoire de la planète, voire sa mémoire la plus intime.
Après Grand Nord (2021), qui contait les errances et l’impossible mission d’un cartographe au Pôle Nord, Frédéric Roussel réalise un nouveau récit illustré. On y retrouve une écriture fluide, un rythme qui fait écho au silence de l’espace infini, une profonde intelligence, une grande sensibilité. Une fresque qui fait penser à Solaris de Stanislaw Lem, ou alors digne d’un film de Terrence Malick.
Biographie de l’auteur
Hélice Hélas Editeur
Rue des Marronniers 20 CH-1800 Vevey
Tél.: ++41 21 922 90 20 litterature@helicehelas.org www.helicehelas.org > litterature@helicehelas.org
Distribution Suisse :
Servidis
Chemin des Chalets 7 CH-1279 Chavannes-deBogis
Tél.: ++41 22 960 95 10 www.servidis.ch > commande@servidis.ch
Distribution FranceBelgique :
Serendip-Livres
21bis, rue Arnold Géraux FR - 93450 L’Île-St-Denis
Tél.: ++33 14 038 18 14 www.serendip-livres.fr
Issu de l’ESA St-Luc à Bruxelles dans les années 1990 où il a étudié les Beaux-Arts, Frédéric Roussel a ensuite travaillé dans la publicité, où il s’est familiarisé avec la typographie et le design graphique. Il est par la suite devenu enseignant. Depuis 2017, il conduit des workshops de modèle vivant à la Faculté des Arts et du Design de l’Université de Laponie, à Rovaniemi en Finlande. Son activité artistique est centrée sur le récit, et, plus précisément, le récit dessiné, qu’il pratique de manière indépendante. Sa pratique artistique le mène partout où le dessin ou le texte seul — ou mieux encore les deux ensemble —, le conduisent. Il a publié Grand Nord chez Hélice Hélas (2021) et Deux contes d’aride et de moisi sous le pseudonyme de Sol Ferrères chez Boson2X (2023).
Collection : Mycélium mi-raisin
Genre : Aventure et exploration
Sujets abordés : Planet opera ; Astrophysique ; Biologie ; Origine de la Vie
Format 14.5 x 18.5 cm, 336 pages
ISBN 978-2-940700-69-1
CHF 28 / EUR 24
Parution 7 mai 2025 (CHF / FR / BE)
1
Le bruit s’est tu, et alors j’ai vu, quand Alberto a déclenché l’ouverture du sas, un paysage à la lumière inouïe, sans couleurs étrangement, et où dominaient les gris.
Zephyria, le soleil nain d’Amormina B, était à son zénith.
Cependant la température n’excédait pas 120 degrés sous zéro. Léo Bakst continua à marcher.
La combinaison qu’il portait le protégeait aussi bien du froid extérieur, que des poussées de chaleur dues à l’effort. Il se sentait bien. Enfin, tant qu’il marchait. Car marcher, l’exercice même de la marche, lui procurait une satisfaction immédiate. L’impression d’aller quelque part, d’exister en somme.
Il aimait aussi lever la tête, et exposer sa peau à la chaude caresse de Zephyria. Ce n’était qu’un petit rien, mais qui lui rappelait la Terre.
Et de nouveau, il se sentait exister. Exister.
Voilà bien le problème, depuis que Bakst était arrivé sur Amormina B. La plupart du temps, il se demandait ce qu’il faisait là.
Et ce n’est pas le milieu rassurant, sécurisant, de la station Princesse Inès, qui pouvait le détourner de ce doute existentiel.
Au contraire, dès qu’il était de retour à la station, ce mal le reprenait. Mais il fallait bien revenir à la station.
Lorsqu’il avait franchi la porte du sas et retiré son scaphandre, la première chose qu’il faisait, c’était regarder à travers les hublots pressurisés. Comme si la réponse à ses questions ne se trouvait pas à l’intérieur, mais là-bas, dans les étendues désertes
Le silence était complet. Bakst vit alors, parce qu’il se donnait le temps de voir, le paysage qui l’entourait comme il ne l’avait jamais vu.
Ce qu’il voyait, c’était le calme et le silence absolus.
Le site alentour était montagneux, et le sommet supposé formait un cône tronqué qui se détachait des crêtes environnantes. Bakst pointa sur son nom. Il obtint aussitôt une fiche informative,
HCZ-408
d’autant que, plus le temps passerait, plus le voisinage de la station lui deviendrait familier, et plus il devrait songer à élargir le périmètre de ses investigations. Bakst gratta quelques poussières, et fit demi-tour.
Lorsqu’il arriva au spatiodrome, il fut soulagé.
Le rover, intact, était là.
Grand Nord
Frédéric Roussel

Avril 2021
224 pages
14.5 x 18.5 cm
ISBN : 978−2−940522−97−2 24 CHF / 18 €
Grand Nord a été commencé en 2018 à bord du voilier Knut, au large du Groenland, où l’auteur participait à une résidence d’artiste. Pour s’adapter à l’exiguïté du bord, il a écrit/dessiné dans un carnet qu’il pouvait tenir sur ses genoux.
Fasciné par la géographie si singulière du Groenland et nourri des expériences racontées dans Les Derniers Rois de Thulé de Jean Malaurie, Frédéric Roussel a eu envie de raconter une histoire géographique, une histoire de cartes, l’histoire d’une carte en train de se faire, et d’un géographe-explorateur condamné à endurer la solitude de ces espaces désolés et confronté à la folie qui menace lorsqu’on est exposé à l’isolement complet.
Grand Nord n’est ni une bande dessinée ni un roman graphique, ni du texte illustré, c’est un hybride qui se situe au milieu de tout cela. Les dessins en noir blanc trahissent une influence lointaine, celle du clair-obscur des auteurs de bd américaine des années 1930 à 1950 tels que Noel Sickles, Milton Caniff ou Alex Toth.
Frédéric Roussel
Issu de l’ESA St-Luc à Bruxelles, Belgique, dans les années 1990, où il a étudié les Beaux-Arts, FREDERIC ROUSSEL a d’abord travaillé dans la publicité, où il s’est familiarisé avec la typographie et le design graphique. Il est par la suite devenu enseignant. Depuis 2017, il conduit des workshops de modèle vivant à la Faculté des Arts et du Design de l’Université de Laponie, à Rovaniemi en Finlande. Son activité artistique est centrée sur le récit, et, plus précisément, le récit dessiné, qu’il pratique de manière indépendante. Sa pratique artistique le mène partout où le dessin seul, le texte seul, ou mieux encore, les deux ensemble, le conduisent.
André Bouny

Genre : nouvelles
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 224
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-487-558-07-6

Né dans une famille paysanne du Sud de la France, après des études à Paris, André Bouny s’engage activement contre la guerre du Viêt Nam. Il devient père adoptif d’enfants vietnamiens et consacre une grande partie de sa vie à faire connaître et dénoncer les horreurs commises durant cette effroyable guerre dont les effets se perpétuent encore aujourd’hui. Son essai Agent Orange : apocalypse Viêt Nam publié en 2010 aux éditions Demi Lune agit sur les consciences et permet l’instruction d’un procès en 2014 au nom d’une victime française d’origine vietnamienne, Mme Tran To Nga, défendue par le Cabinet William Bourdon § Associés contre les 24 multinationales états-uniennes ayant fabriqué l’Agent Orange pour dédommager la plaignante dans l’espoir d’ouvrir un précédent pour toutes les victimes.
Les Editions du Canoë ont publié parmi leurs premiers livres, en 2018 : Viêt Nam, voyages d’après-guerres avec 40 dessins de André Bouny qui est aussi un merveilleux dessinateur.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com
Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre
33710 Bourg-sur-Gironde


Paru initialement aux Éditions Sulliver sous le titre Cent ans au Viêt Nam en 2014, complètement épuisé depuis plusieurs années, revu par l’auteur, ce livre de nouvelles nous raconte comment depuis la colonisation française jusqu’à la guerre avec les États-Unis et plus récemment dans la confrontation avec les Chinois qui colonisent une partie de leur territoire de pêche, ce peuple lutte contre les envahisseurs successifs. Chaque nouvelle illustre un épisode tragique de ce drame qui continue alors qu’une force de vie extraordinaire résiste tant dans la population humaine et animale que dans les puissances végétales criminellement attaquées par la guerre chimique qui s’est déployée sur ce territoire. On ne sort pas indemne de la lecture de ces textes. Nous faire vivre ce que nous n’osons même pas imaginer est une des missions de la littérature. Elle est ici implacablement remplie.
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Téléphone : 06 62 68 55 13
Local parisien : 2, rue du Regard
75006 Paris c/o Galerie Exils
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip
Couverture : Adrien Aymard.
Suivi de fabrication : Alice Rousseau.
© Éditions du Canoë, Bourg-sur-Gironde, 2025.
André Bouny
Les Neuf fils de Madame Thu Extrait
En librairie le 6 juin 2025

Éditions du Canoë
LE GRAND MARCHÉ AUX COOLIES (1930)
À l’aplomb du vaste archipel d’Ha Long, la lune obèse de mi-automne était au plus près. Sa grosse lanterne éclairait de sa fidèle lumière dorée l’île en cuvette où se tenait le grand marché annuel aux coolies. Son reflet occupait toute la surface du lac central et l’on eût cru l’œil géant d’un tigre démesuré, ou bien une planète double : suspendue au ciel et nichée sous le lac, dans le cratère silencieux de l’ancien volcan rallumé.
En quelques années, les autorisations minières étaient passées de cinq cents à dix mille, notamment celles de charbon, d’étain et de plomb, les surfaces de plantations d’hévéas multipliées par dix. Quant aux exploitations de thé, de coton, de café, de soie, de riz et de bois, elles demandaient toujours davantage de bras. Dans le même temps, la crise économique réduisait le salaire de l’ouvrier, ne suffisant pas à payer sa nourriture.
Le travail du paysan ne nourrissait plus sa famille. La famine sévissait partout. Les femmes, par dizaines, vieilles comme jeunes, tiraient l’araire de bois dans la boue des rizières car dix jours de salaire humain, de surcroît féminin, coûtaient moins cher que la location d’un buffle pour quelques heures. Aussi l’administration coloniale soutenait activement ce grand marché aux coolies, événement économique majeur. Le Gouverneur général, résidant à Hanoi, dépêcha les trois piliers locaux représentant l’État colonial : Commissaire principal de la ville, directeur de la Prison centrale et responsable au Trésor. Ils y tiendraient des discours solennels aux côtés du directeur de l’Office du recrutement de la maind’œuvre indigène, organisme privé.
En début de semaine, les bateaux affrétés par les sociétés de recrutement accostaient à mer basse, débarquant les recrues par centaines. Le déroulement des opérations et cette concentration ne correspondaient pas aux promesses et engagements oraux avancés par les enrôleurs. Désorientés, les milliers de coolies annamites, cochinchinois, parfois tonkinois – très recherchés –, étaient nerveux et songeaient à s’enfuir. Mais, sous la lune complice, les grandes marées d’équinoxe montaient la garde.
De temps à autre, un bateau attardé débarquait par mer montante. Un vieux coolie se noya : « Ciel ! laissa échapper un associé bouleversé. Même à prix sacrifié, il aurait encore fait un bon domestique d’intérieur…
… une aubaine pour anciens planteurs », ajouta avec regret son affilié, repoussant à l’aide d’une perche le corps vers le large.
Sur l’île, le marché s’organisait le long du sentier faisant le tour du lac. Les coolies rudoyés construisaient les stands sous lesquels ils seraient exposés à leurs preneurs et futurs maîtres ; les cuisiniers ambulants puisaient l’eau à l’aide de balanciers munis de seilles de bois aux extrémités ; par deux, des hommes charriaient des tonneaux marqués au feu Bière Larue, suspendus à une poutre creusée aux deux bouts pour recevoir l’épaule des porteurs ; des lettrés indigents proposaient leur service d’écrivain public ; de petits commerçants portaient un maigre éventaire rangé dans d’étroits meubles à tiroirs fixés aux encoches d’une palanche ; les pousse-pousse allaient sur le profil pierreux du chemin défoncé.
À l’abri de cette grande arène, on s’activait jour et nuit. Fumées de feux et odeurs de cuisine s’élevaient lentement puis se dissipaient brusquement à hauteur du vent marin qui, tour à tour, apportait et emmenait le grondement sourd de la mer et son vacarme irrégulier.
La trique des caïs tournoyait sur cette foule de serfs chétifs luisant sous la lune, les rangeant comme les mailles d’un tricot sur les versants du vaste cirque.
Les marchands ambulants colportaient les nouvelles. Un peu partout, du Tonkin à la Cochinchine, des colonnes pacifiques de milliers de paysans affamés, soumis à l’injustice des impôts et à la corruption des mandarins au service des colons français, marchaient vers la résidence du plus proche administrateur. Commissaires et inspecteurs ordonnaient à la garde indigène d’ouvrir le feu. La répression sanglante engendrait mécaniquement assassinats et attentats. Sur l’île en cuvette, l’atmosphère était étouffante, d’une tension extrême. Quand tout fut en place, le service de Sûreté la boucla par deux nids de mitrailleuses Hotchkiss de chaque côté du défilé qui menait à la seule crique permettant d’atteindre et de quitter l’île.
Les acquéreurs ne tardèrent pas, arrivant par embarcations rapides dès le lever du jour pour ne pas risquer de manquer la bonne affaire. Leurs voix retentissantes se reconnaissaient de loin. En tenue de ville, patrons et gérants circulaient entourés de leurs ayants droit, directeurs et intendants, économes et autres régisseurs.
Suites qui, aux premières heures, ne marquaient aucun intérêt pour un stand d’Annamites, ralentissaient à peine devant les Cochinchinois et, l’œil aguerri, s’arrêtaient d’elles-mêmes là où aucun recruteur n’avait besoin de bonimenter : « Quelles sont vos conditions pour ces Tonkinois ?… demanda un régisseur tendant une carte de visite, évaluant le nombre de coolies accroupis sur le versant en surplomb du chemin.
Cela dépend de l’âge, du nombre et du lieu de livraison… mais notre société est très bien placée, argumenta l’associé recruteur, remettant sa fiche de conditions.
Ils sont vaccinés… ? s’assura le gestionnaire.
Tous ! affirma le recruteur.
Bon, nous repasserons plus tard… coupa le régisseur qui remercia, pressant le pas derrière le patron qui avait poursuivi sa marche comme si de rien n’était.
Ce sera peut-être trop tard ! » prévint de l’arrière le recruteur, remerciant à son tour, carte de visite dans sa main levée.
Exploitants de mines du Tonkin et planteurs de Cochinchine, venus s’approvisionner en main-d’œuvre auprès de ces sociétés de recrutement, s’interpelaient, se saluaient dans une ambiance de foire, évoquant à voix haute les difficultés économiques et l’instabilité qui régnait du nord au sud : « Ils en ont bien raccourci
quelques-uns, mais je ne sais pas si ce sera suffisant !… craignait un gaillard au sujet de l’hydre du parti nationaliste annamite guillotinée à Yen Bai.
— Il y avait une fournée de quatre-vingts condamnés à mort, pourquoi n’en avoir exécuté que treize ?… alors qu’il faudrait trois têtes à certains pour payer leur dette ! » surenchérit son homologue.
Les particuliers n’étaient pas en reste. Il s’agissait le plus souvent de vieux couples de colons en quête de domestiques d’intérieur et de jardiniers. Ils les cherchaient activement et, d’ordinaire, les trouvaient parmi les coolies finissants ou silicosés : « Le choix est malaisé, on les dit doux et fragiles, alors qu’ils peuvent se révéler féroces et résistants, dit une vieille femme de pionnier.
Nationalistes et communistes… ajouta son mari atteint par l’âge.
Que voulez-vous, ici, la contradiction est partout, et permanente ! répondit à deux pas de là le mari d’un duo de même génération.
Mais ne viendrait-elle pas de nous ?… demanda le premier.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire… répondit son interlocuteur.
Et si au contraire vous perceviez très bien ce que je dis ?… ajouta le premier, l’œil taquin.
N’auriez-vous pas été contaminé, par hasard… ? soupçonna le second. Si c’est le cas, les fréquenter aurait dû vous immuniser !
Non, Monsieur, j’essaie de réfléchir en toute simplicité… Pourquoi nos avions ont-ils bombardé le village d’un indépendantiste pour le punir, tuant femmes et enfants ? demanda le sceptique.
À trop creuser, le pieu vous sautera au front ! » conclut le convaincu de son bon droit, tournant le dos, quittant la conversation.
Les entreprises de défrichement, elles, recherchaient des portefaix endurcis ne rechignant pas à marcher sur les bambous épineux où s’enroulait le bongare1. Elles s’achalandaient à moindre frais, engageant en priorité les bagnards en solde que le pénitencier de Poulo Condor2 libérait à cause d’un manque cruel de
« cages à tigre » au fil des ans malgré un taux de mortalité atteignant soixante-dix pour cent. Ceux-là étaient reconnaissables à leur peau brûlée : aux heures les plus chaudes, tandis qu’ils ruisselaient au fond de l’étouffant cachot de ciment, les gardiens – debout sur les barreaux
1. Serpent annelé, jaune et noir, très vénéneux.
2. Con Son, en vietnamien. Île de l’archipel de Con Dao situé au sud-est du pays. Poulo Condor signifie : « Île aux courges », terrible pénitencier de l’époque de la colonisation française, et au-delà.
du plafond à ciel ouvert – jetaient en contrebas des nuages de chaux vive. Elle crépitait au contact de la sueur, corrodant les chairs, arrachant des cris et libérant une fumée âcre : « Ça sent la volaille flambée ! » raillaient les geôliers. Ces bannis, cherchant à se réinsérer, étaient transportés à leurs frais sur ce marché par le service de la Sûreté qui gardait ainsi la trace des opposants à l’« œuvre civilisatrice ».
Les discours avaient été prononcés, dithyrambiques, énumérant les rizières sorties des marais ; les plantations arrachées à la jungle impénétrable ; la douceur de la route reliant Saigon et Hanoi séparées comme Paris de Naples ; la voie ferrée et le train ; l’éducation et l’école, l’hygiène et les hôpitaux tandis que la variole prélevait trois nouveau-nés sur dix : « Œuvre qui profite uniquement aux Français, mandarins et autres collaborateurs, bien que réalisée par les seuls bras annamites sous la cadouille3. Dix-sept millions d’Annamites sur leur terre sous la férule de vingt mille Français exige une collaboration scélérate… » disaient les tracts nationalistes. Et voici qu’aux dernières nouvelles la garde indigène loyaliste pouvait faire défection, se retourner. Les marchés avaient été conclus, les engagements signés.
3. Bâton rigide ou flexible servant à battre les coolies.
Âpres, disputés sapèque à sapèque, les frais d’acheminement furent avancés à coups de grandes coupures de cent piastres, liasses sorties des larges poches intérieures des vestons. Le soir même, à marée basse, entrepreneurs et particuliers quittèrent l’île, tandis que les sociétés de recrutement, plus lourdes à manœuvrer, durent attendre le jour suivant pour lever le camp. Une période de quelques heures autorisait le gigantesque embarquement, phase délicate et redoutée par les associés recruteurs épaulés par la garde indigène, renforcée de Français. En tête de la première vague s’engageant dans la passe qui menait à la crique d’embarquement, les rangs se resserrèrent et un caï frappa quelques coolies mal alignés qui, excédés, lui sautèrent dessus. Les surveillants latéraux volèrent à son secours mais les pierres anguleuses à portée de main l’avaient déjà tué. Les triques s’abattirent au hasard, provoquant un large remous humain. Les recruteurs fébriles palpaient la crosse de leur révolver officieux et les gardes tirèrent des salves en l’air pour rétablir le calme. Ceci déclencha la poussée des milliers de coolies , masse d’une profondeur interminable cherchant à atteindre le défilé et à s’enfuir. Des caïs
furent lapidés, ceux qui le purent encore abandonnèrent la trique et la tenue blanche pour se fondre à la multitude des coolies . Les mêmes raisons déclenchèrent des coups de feu à l’arrière. Alors que le premier rang apercevait en contrebas les bateaux blottis les uns contre les autres pareils à une botte de carottes défaite sur les eaux à marée basse, les sous-officiers français, dépassés, menacèrent de leurs revolvers la tête des mitrailleurs indigènes, ordonnant d’ouvrir le feu. Aussitôt les deux nids de dragons métalliques sur trépied crachèrent les flammes, avalèrent goulûment les rouleaux de bandes articulées posés dans les caisses de bois. La première rangée tomba telle une guirlande de papier. Le cliquetis haletant des mitrailleuses, désormais recouvert par le grondement d’océan de la multitude prise dans un tourbillon dense, était celui d’une mécanique bien réglée, précise et infatigable, qui rougeoyait, chauffait à blanc, déroulant les couches de chair de la foule annamite comme celle d’un litchi. Le soir, les renforts débarquèrent. Jamais requins ne firent pareil festin.
Les mains bandées, brûlées par la chaleur des poignées des vieilles Hotchkiss, les mitrailleurs hébétés, yeux hagards, reçurent sur-le-champ la médaille de la garde indigène.
Un linceul de silence, entrecoupé par les détonations des coups de boutoir de la marée montante se déchirant sur les rochers extérieurs de la cuvette, recouvrit l’île. À espaces réguliers, sur les portées ondulantes de la houle, la musique du vent semblait contenir en son tréfonds les appels plaintifs et lointains des cohortes de coolies ensevelis en mer. Au matin du deuxième jour, tandis que les renforts à leur sinistre corvée jetaient encore des corps lestés, ils aperçurent au loin une forme indistincte, immobile. Ils s’en approchèrent. Les recruteurs l’avaient laissée là, accroupie sur le versant aride de l’île. Et nul ne sut jamais qu’elle fut à l’origine de l’émeute. Elle avait supplié les enrôleurs de l’amener. « Si tu ne trouves pas preneur, nous ne te ramènerons pas », avaient-ils averti. Or, personne n’avait voulu de cette servante hors d’âge. Les yeux caves comme des mouches incrustées dans sa face de cuivre ravinée, le trou écarlate de sa bouche édentée encore pleine de bétel, ajoutaient à son apparence ordinaire et insignifiante. De longs ongles courbes ressemblant à des sarments desséchés prolongeaient les doigts de ses mains flétries. Ces griffes d’iguane posées sur ses genoux s’étaient brusquement levées quand l’asphyxie l’avait submergée, soulevant un siècle de servitude, avant de
retomber. Les Annamites d’avant-hier qui mirent le feu aux poudres, témoins de son trépas, y puisèrent le signal de leur rébellion, annonçant clameurs et vacarmes des combats à venir. Les liquidateurs aussi la laissèrent là. Succulence offerte aux oiseaux marins qui se repurent, ne parvenant plus à s’envoler.
3 avril remise en vente avec le supplément gratuit « En attendant le verdict … »
André Bouny

Genre : Récit
Format : 12 x 18,5
Pages : 272
Prix : 20 €
ISBN : 978-2-490251-01-8
Né dans une famille paysanne du sud de la France, André Bouny étudie à Paris, proteste contre la Guerre du Viêt Nam, expose ses peintures au Grand Palais. Pacifiste et affranchi, il devient père adoptif d’enfants vietnamiens. Auteur de l’essai Agent Orange, Apocalypse Viêt Nam (livre du mois de la revue S!lence), et du recueil de nouvelles Cent ans au Viêt Nam (finaliste du prix-Boccace 2015, finaliste du prix Littér’Halles 2016), il signe avec Viêt Nam, Voyages d’après guerres,son troisième ouvrage sur ce pays.
Éditions du Canoë 2020

André Bouny s’inscrit dans une longue lignée d’écrivains-voyageurs. Sa plume marque avec précision ce que tous les sens perçoivent du Viêt Nam traversé. Elle le fait doublement en accompagnant son texte de ses prodigieux dessins à la mine de plomb qui emmènent le lecteur de Hanoi à l’ancienne Saigon, l’actuelle Ho-Chi-Minh-Ville, du passé au présent, des paysages immémoriaux aux lieux ravagés par les millions de litres de l’Agent Orange que les Américains déversèrent sur le pays durant l’interminable guerre. Du nord au sud, en train, en autobus, en bateau, les villes au nom mystérieux défilent, Lao Cai, Sapa, Hoa Lu, Tam Coc, Hai phong, Ha Long, Phu Ly, Nin Binh, Thanh Hoa, Vinh, Ha Tinh, Dong Ha, Hué… font rêver, laissent deviner l’effervescence, l’énergie intense qui se déploient dans cette Asie qui demeure pour les Européens une énigme.


En avril 2020 va se tenir à Paris une nouvelle étape du procès initié en 2014 par André Bouny, au nom d’une victime française d’origine vietnamienne, Madame Tran To Nga, contre 24 multinationales états-uniennes, dont une des plus connues est Monsanto, ayant fabriqué et vendu des produits hautement toxiques résumés sous le nom de « Agent Orange » qui furent déversés sur le Viêt Nam pendant la guerre éponyme. L’affaire est plaidée par le Cabinet William Bourdon § Associés. De son issue dépend l’indemnisation de la plaignante et la possibilité pour d’autres victimes d’engager des recours. Une guerre chimique de grande ampleur a bien eu lieu, en contravention avec toutes les lois internationales. Les dégâts humains et environnementaux qu’elle a engendrés sont si terrifiants qu’ils ne peuvent rester impunis.


































































C’EST LES VACANCES, n O 3
La sélection des auteurices est en cours (dir. Eugénie Zély)
▶ Format (mm) 120*180
▶ Nombre de pages ............... 144
▶ Prix (€) 14
▶ Tirage 500
▶ Parution juin 2025
▶ ISBN ................................................. 978-2-493534-20-0
C’est les vacances est une revue estivale à emporter à la plage. Elle est plus politique que romantique, plus littérale que métaphorique et donne un aperçu d’une scène de création littéraire émargée, mais puissante. Elle est dirigée par Eugénie Zély, autrice de Thune amertume fortune et lauréate du prix Pierre Giquel de la critique d’art 2023.
C’est les vacances regroupe des auteurices de plusieurs générations, des littératures narratives, poétiques, théoriques, autofictionnelles. La revue propose une multiplicité de voix, des anecdotes qui n’ayant l’air de rien dessinent des mondes, des relations et des façons de les dire désirables.
Après un premier numéro articulé autour de la colère, un second autour de la résignation émancipatrice guidée par la voix de Dorothy Allison, ce troisième numéro prend comme point de départ, la question suivante : Qui a le droit à l’auto-défense et quels sont les moyens de cette auto-défense ?
Voici l’appel à textes que nous avons fait circuler : « Édifier un autel pour la vengeance. Ce qu’il aura fallu de douleur pour devenir aussi dure, quoi nous ramollirait ? Contre la guerre à outrance, la grève générale avec occupation générale, le format de cette occupation, est un poeme, est une litanie, est une chanson, est un cri, bien organisé, qui sonne, fan fiction violente, qui prolonge, amende, déforme les produits médiatiques. Racontons nous (essayons) comment les littératures ont une place dans l’acte révolutionnaire. »
Revues similaires :
Sabir (revuesabir.com), Post (revueppost.com), Nioques (revuenioqques.ffr)


Thèmes abordés : féminisme, amour, transformation, colère, identités queer, luttes politiques, amitié, sentiments

Graphisme : Aurélie Massa

C’est les vacances #3


À propos de l’éditrice : Eugénie Zély est artiste et autrice. Elle a publié Thune amertume fortune (Burn~Août, 2022). Elle écrit régulièrement des textes critiques pour des artistes et des expositions ce qui lui a valu de remporter le prix
Pierre Giquel de la critique d’art 2023. Son travail plastique a fait l’objet de plusieurs expositions et elle écrit actuellement son deuxième roman : La même en pire. Elle est née en 1993 et vit toujours dans la zone rurale dans laquelle elle a grandi.
Crédit photographique : Norman Delauné


































































C’EST LES VACANCES, nO 2
avec les textes de alex~tamécylia, Anouk Nier-Nantes, Badis Djouhri, Bobby chalard, Claire Finch, Elise Legal, Elsa Michaud, etaïnn zwer, Ines Dobelle, Mante Maria Camila, Mimine, Mulov Ugo Ballara, Vinciane Mandrin et Virgu (dir. Eugénie Zély)
▶ Format (mm) ........................... 120*180
▶ Nombre de pages ................ 144
▶ Prix (€) 14
▶ Tirage 800
▶ Parution ....................................... juin 2024
▶ ISBN ................................................. 9782493534064
C’est les vacances est une revue estivale à emporter à la plage. Elle est plus politique que romantique, plus littérale que métaphorique et donne un aperçu d’une scène de création littéraire émargée, mais puissante. Elle est dirigée par Eugénie Zély, autrice de Thune amertume fortune et lauréate du prix Pierre Giquel de la critique d’art 2023.
C’est les vacances regroupe des auteurices de plusieurs générations, des littératures narratives, poétiques, théoriques, autofictionnelles. Le second numéro s’articule autour de descriptions spécifiques ou générales de la vie quotidienne. Une vie qui ne cesse de lutter contre sa nécrose. Ce numéro propose une multiplicité de voix, des anecdotes qui n’ayant l’air de rien dessinent des mondes, des relations et des façons de les dire désirables.
Après un premier numéro articulé autour de la colère, ce nouveau numéro est celui d’une résignation émancipatrice guidée par la voix intense et profonde de Dorothy Allison « Nos vies ne sont pas petites. Nos vies sont tout ce que nous avons, et la mort change tout. L’histoire se termine, une autre commence. Le long travail de la vie c’est d’apprendre à aimer l’histoire, les romans que nous vivons, les personnages que nous devenons. » à laquelle amiexs et inconnuexs ont répondu.
Revues similaires :
▶ Revue Sabir (revuesabir.com)
▶ Revue Post (revuep post.com)
▶ Revue Nioques (revuenioques.ffr)


Thèmes abordés : féminisme, amour, transformation, colère, identités queer, luttes politiques, amitié, sentiments

Graphisme : Aurélie Massa


À propos de l’éditrice : Eugénie Zély est artiste et autrice. Elle a publié Thune amertume fortune aux éditions Burn~Août en 2022. Elle écrit régulièrement des textes critiques pour des artistes et des expositions ce qui lui a valu de remporter le prix Pierre Giquel de la critique d’art 2023. Elle
développe un travail plastique multimédia en relation directe avec son travail littéraire. Son travail plastique a fait l’objet de plusieurs expositions et elle écrit actuellement son deuxième roman : La même en pire. Elle est née en 1993 et vit toujours dans la zone rurale dans laquelle elle a grandi.

































































alex~tamécylia boit des tisanes et anime les ateliers d’écriture Langue de lutte. C’est la caution queer féministe de tes nuits calmes.

Anouk Nier-Nantes vit à Grenoble, elle travaille en tant qu’autrice, intervenante et membre de l’association la vie gagnée. Elle a grandi dans les Alpes dans une famille de classe moyenne et a passé son diplôme à la Haute École des Arts du Rhin en 2020. Au travers de films et de livres, elle s’intéresse aux contextes (de création, de vie) et aux liens que l’on entretient avec son milieu.
REVUE LITTÉRAIRES





Badis Djouhri est bavard et blagueur. Écrire, c’est mettre un peu de soi dans beaucoup de l’autre. En fait, écrire, c’est s’écrire. Souvent cyniques, presque comiques sans tout à fait l’être, ses textes laissent là, l’âme vidée, le cœur las, mais le sourire large.
burnaout@@riseupp.net
Bobby Chalard est écrivain. Il a été diplômé d’un DNA (2019) et d’un DNSEP (2021) aux Beaux-Arts de Nantes. Il a repris ses études au Master de Création Littéraire du Havre en 2022. Il a publié dans des revues (Tendre 02, Censored 07) et a exposé son travail à Nantes, Marseille et Lyon. Il a auto-édité des fanzines (Je suis, Marseille, Sauver les images). Il est en train d’écrire un roman d’amour.




































































Claire Finch écrit des textes expérimentaux pornoweirdo. Ses projets récents incluent I Lie on the Floor (After8 Books, 2021), Kathy Acker 1971‑1975 (Ismael, 2019) et AsshOle, une collection de poésie concrète (Snack, 2023).

REVUE LITTÉRAIRES
Elsa Michaud est musicienne, chorégraphe et conductrice automobile. Son premier album Driving Drama est paru sous le label Bruxellois Midi Fish de TG Gondard (Lazza Gio, Radio Hito...). Elle y chante des femmes au volant d’engins motorisés en quête de paysages presque américains dans des ambiances crépusculaires. Ses pièces chorégraphiques et ses concerts ont notamment été vus à la Fondation Fiminco, Ideal Trouble, au Centre Wallonie Bruxelles, au Centre National de la Danse, au Palais de Tokyo, à la Ménagerie de Verre, aux Laboratoires d’Aubervilliers ou à la Brasserie Atlas. Diplômée des BeauxArts de Paris en 2020, elle poursuit aujourd’hui ses recherches au Fresnoy, Studio National des Arts contemporains, pour y réaliser deux films-opéras de science-fiction.
Éditions

Élise Legal est artiste et autrice, actuellement résidente aux ateliers de la Ville de Nantes. À travers une approche pluridisciplinaire (qui mêle images trouvées, dessin, poésie) elle porte une attention particulière à la manière dont le langage et les corps coexistent. Elle poursuit également une thèse de recherche-création à Paris 8 qui porte sur l’agir politique de la poésie.

etaïnn zwer (∞) croit à l’écriture comme sueur politique et poursuit une pratique discrète, obsédée par le pouvoir de métamorphose du poème — technologie radicalement tendre pour faire advenir des mondes baisables enfin décolonisés. etaïnn performe, solo et avec la collextive RER Q : Whitechapel Gallery (Londres), TN (Bruxelles), La Bâtie (Genève), Air de Paris (Romainville), Ausland (Berlin), à la radio, en sex-parties. Et publie : TISSUE, Phylactère, Realitäten (etece buch, 2022), Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche, 2021).

































































Née en 1990 en Jordanie, Ines Dobelle est diplômée de l’ENSBA. Elle se définit comme une polycultrice qui décloisonne les genres et emploie différents modes d’expression, dont l’écriture. Ses recherches portent sur l’exposition de l’intime, la porosité entre espace privé et public et les formes d’autosurveillance. Parallèlement, Ines est membre de La Collective et est co-fondatrice de La Guerrière, chimère indépendante, féministe et solidaire qui soutient la création contemporaine.

Ancien aspirant romancier converti aux principes de l’écriture sans écriture (uncreative writing) par la lecture de Kenneth Goldsmith, Valentin « Valdo » Savoye-Gavarini partage son temps entre la poésie expérimentale de montage (la postpoésie), la boxe (anglaise) et le bar (embauche/débauche) De Paris (le travail) au Havre (la vie), il est également membre du groupe MANTE (texte et image) avec sa partenaire Solène Langlais.
REVUE LITTÉRAIRES



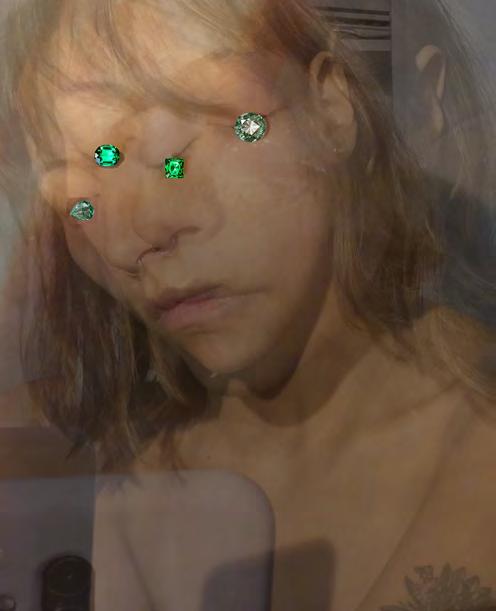
Maria Camila est née à 2 650 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer, là où elle n’habite plus. Migrante depuis cinq ans, elle occupe un territoire fantôme entre Bogota et Nantes depuis lequel elle tente de comprendre ce qui peut être un sens d’appartenance, en mixant des vidéos, des sons et des langues.
Éditions

Mimine rêve de devenir audionaturaliste et chercheuse en ethnomusicologie, de construire un poulailler, de fonder une maison d’édition et d’un corset Vivienne Westwood. Aujourd’hui, elle se consacre à son master d’histoire de la musique au CNSMDP, à sa psychothérapie, à l’écriture et à Touta. Par le passé, elle a étudié le piano, la littérature moderne et les techniques du son, notamment au cinéma.
burnaout@@riseupp.net
Crédit photographique : Ines Dobelle © Laurent-PoleoGarnier

































































est
REVUE LITTÉRAIRES




elle
De ça, elle ne s’en remet toujours pas, donc elle fuit les discussions identitaires et les bio comme son père a fui les fascistes. Ce truc donne un côté dramatique à son histoire qui n’est pas pour la déplaire. Elle est diplômée des Beaux-Arts, où elle fait des performances. Elle en fait encore, mais maintenant elle dit « stand-up » et ainsi, il y a beaucoup plus de gens dans le public. Elle essaie d’écrire un livre, elle pense à faire un spectacle, elle envie de produire un album.

Vinciane Mandrin est artiste, autrice et performeuse. Elle s’intéresse à la pratique du récit corporel et de l’autofiction comme stratégie de résistance face aux régimes de captation et de fétichisation du corps queer et racisé. Sa pratique est mobile et polymorphe, dans un aller-retour entre travail individuel et collectif, interventions dans des espaces artistiques, microédition, et création d’ateliers de co-création autour de l’édition et de la performance.
Né en 1995 à côté de Tours, Ugo Ballara vit et travaille à Paris. Il fabrique des textes et des formes qui parlent souvent d’architecture et de sexualité. Diplômé de la Sorbonne en Histoire et en Histoire de l’art, puis des Beaux-arts de Cergy (ENSAPC), sa pratique s’intéresse aux espaces, objets et activités parasites, au sentiment d’être à la fois à l’intérieur et en dehors, aux trous, aux tunnels et à celleux qui les empruntent. Membre de Glassbox depuis 2019, il y en charge d’une partie des expositions et des suivis de projets. Il fait également partie de Kim Petras Paintings, collectif réunissant des artistes autour des enjeux du fan art. Il écrit parfois des textes pour des expositions et compose aussi de la musique pour des artistes.

Virju a 36 ans et habite à Rennes. Elle a étudié le design en école d’art. Elle est artiste/collagiste/performeuse et d’autres choses. Elle collectionne des images et des objets. Elle écrit dans les notes de son téléphone. Elle considère que la société lui doit quelque chose. Fight back Free Britney
Mulov
née en Turquie et
a grandi en France.



































































EXTRAIT DE J’AI TOUJOURS VÉCU EN MEUTE
PAR BOBBY CHALARD (texte non corrigé)
L’été dernier j’ai quitté ma ville. J’ai fait mes cartons, en slip et en tee-shirt parce que mes seins sont encore là. J’ai regardé Pose, l’épisode où il faut chaud. Elles sont en culotte, les cheveux attachés tout en haut de leurs têtes, dégoulinantes et maquillées. Elles sont collées au ventilateur. Elles mangent des glaces qui fondent sur leurs cuisses et c’est pas sexuel, c’est dégueulasse ça coule et ça colle, elles ont chaud. Alors elles prennent la caisse et elles s’en vont, elles quittent la ville.
Cet été je quitte mon mec et c’est pas très grave (je l’ai beaucoup aimé). On se quitte sans cartons, on a rien à se rendre. Je garde ses trois lettres chacune dans leur enveloppe et il garde toutes les miennes. Je le quitte sans pleurer, mais j’y pense tous les jours. J’y pense sous la douche et en allant à mon job de merde et le soir ou la nuit quand je rentre bourré. On m’offre des shots dans mon bar préféré et souvent je leur dis à demain. Mes amix s’inquiètent. Pas pour l’alcool, iels boivent avec moi, iels s’inquiètent pour les larmes. D’habitude je pleure, je suis cancer, j’écris des livres d’amour, j’aime les céréales au dîner et les alexandrins. J’appelle souvent ma mère. Je suis son petit garçon pédé. Je suis ascendant vierge, je fais des listes, j’ai un bullet journal depuis quatre ans, je range mes chaussettes par couleur. J’installe Tinder et OkCupid. J’ai toujours pas pleuré. Je veux baiser avec des mecs (je veux qu’on me tienne la main). Cet été mes seins sont encore là, c’est dégueulasse et ça colle, j’ai chaud. Je suis cancer ascendant vierge, je fais des listes de sentiments. J’ai : soulagé / déçu / énervé. Je l’ai beaucoup aimé. Je rassure mes amix, je leur dis c’est à cause de la T. Ça fait 18 mois que je pleure pas, c’est l’âge d’un bébé qui marche. J’apprends à compter. On se voit tous les jours. J’ai appris à aimer ma meute par entassement. Je viens d’une grande famille et d’une petite maison. J’ai jamais dormi seul. Je me suis serré dans les lits, j’ai partagé les serviettes à la plage, j’ai grandi empilé. Je suis petit, j’avais pas trop de place, je rentre bien dans les petits espaces. J’aime mes amix en chien de garde. Je perdrais contre n’importe qui à la bagarre, mais je leur dis quand même je protège mon troupeau. On se voit tous les jours. On recopie les enfances qu’on a détestées. On prend la caisse et on va traîner nos culs dans la zone commerciale. On écoute Lana Del Rey sans enceinte, téléphone sur le tableau de bord. Je n’ai que des amix pédés. On regarde les poissons à l’animalerie, on mange à Burger King pour le goûter. Gabriel me vole de la crème pour le corps à la grande pharmacie. Il achète des strass et des paillettes chez Action, je n’ai que des amix pédés. On a toustes quelque chose qui cloche, des allergies aux acariens un traitement à vie ou des parents perdus. Des parents morts oui, mais moi mon père je l’ai vraiment perdu. Je sais pas où il est (parti acheter des clopes etc). C’est un peu grave et je l’aimais pas beaucoup. Alors cet été-là on répare, on prend chaque petit couteau dans les peines et on tire un coup sec. On s’entasse. On déjeune ensemble et on se coupe les cheveux. On vérifie le niveau d’eau
sous les oreillers, on remplit les frigos, on se fait boire pour pouvoir pleurer. C’est pas la meilleure solution, mais j’ai l’alcool mélodrame, je pleure une heure après trois pintes et ça rassure tout le monde. J’écoute mes amix me dire les formules magiques c’est un con / tu mérites mieux. Je suis pas d’accord, mais je hoche la tête. On s’est beaucoup aimés. J’ai jamais détesté mes ex. Gabriel me force à regarder Les demoiselles de Rochefort, en échange il me prépare des fraises à la crème. On se surveille. Dans sa vie il a préparé des fraises à la crème uniquement pour son ex-mari. Il a été marié, maintenant il baise avec les trois quarts de la ville (il veut qu’on lui tienne la main). On tient une boutique de vêtements pendant mes jours off. On est payés comme des connards, mais on adore jouer à la marchande et les bourgeoises adorent acheter des robes vintage aux deux pédés qui les complimentent plus que leurs maris. Vous savez ce qui vous va. Elles pensent sûrement qu’on s’encule dans la réserve. On est très amis. Il m’emmène acheter des pantalons neufs et trop chers, je lui offre Déloger l’animal et on se fait des clins d’oeil. Cet été il m’apprend à être pédé, mais il me dit non pour Grindr. Comme j’en branle pas une au taf, mes amix viennent boire des cafés. Manger des Kinder gratter des astro voler du PQ draguer mes collègues. On scrolle le sien de Grindr à Gabriel, en cachette devant les client-es bonjour oui c’est par là / lui il est chiant, mais il baise bien. Il m’apprend ce que veut dire TBM. Et puis il me dicte des messages à envoyer à mon crush, il me paye des iced coffee double espresso au lait d’avoine, il me dit c’est à 25 ans qu’on commence le rétinol. Il me prend rendez-vous chez la coiffeuse, en privé en pirate c’est son amie qui coupe, parce que faut dire que quand on se coupe les cheveux nous-mêmes c’est pas terrible terrible. Il me force à regarder Les demoiselles de Rochefort, il me fait visiter la maison. Derrière une des infinies portes il y a une boîte pédé. On rentre dans le noir et Gabriel reconnaît quelqu’un, il me regarde, je lui dis oui oui vas-y dans nos clins d’oeil. Il disparaît accompagné, de lui ou d’un autre, au bar ou au sous-sol (on lui tiendra pas la main). Je rentre dans le noir et ça sent la fumée, ça sent le poppers, ça sent les pompiers après les incendies. Il fait plus chaud qu’en pleine ville il fait poisseux collant dégueu, il fait, la goutte qui coule dans la nuque il fait, teeshirt trempé et doigts qui gonflent. J’ai mes seins qui m’espionnent, j’ai chaud. Il y a, des garçons qui se frottent, des shots à sept balles, de la pisse sur le sol, des filles qui nous adorent, des garçons qui s’en foutent. Un garçon qui se frotte, celui que j’essaye de draguer, qui remue son cul contre toutes les bites qui passent sauf la mienne, la mienne celle en plastique la rose la transparente, la mienne à la maison dans le tiroir à slips. Ce soir je le regarde danser dégoulinant dans la sueur des autres, je l’imagine baiser dégoulinant dans la cuvette des chiottes, il est drogué, un peu salope, si je voulais mon tour j’aurais qu’à faire la queue. Mais moi je suis cancer, je veux qu’on me courtise alors j’attends, je danse tout seul, je mens à mes amix je leur dis ça fait rien.
burnaout@@riseupp.net httpp:///editionsburnaout.ffr/



































































EXTRAIT 1 :
« Ouigo vie et autres poèmes » par Élise Legal (texte non corrigé)
On nage Je me baigne mes dents sous l’eau côtoient les foies leurs ventres elles s’en sortent
Dans mon rêve j’ai évité son visage esquivé sa peau très attentivement l’inconscient se débrouille sur tout ce qui passe 10 centimes une dent qui tombe tes aveux à cran
EXTRAIT 2 : « sans remix » par Mulov (texte non corrigé)
Sur le marché de la terreur Je n’ai pas pris de grenade, car JE SUIS Non belligérante Irréniste pacifiste blanche occidentale, avec une conscience POLITIQUE plûtot à gauche.
Mes ennemies POLITIQUES sont d’abord : les connards de l’extreme droite, vraiment ! cons bêtes et méchants les capitalistes qui refusent de me payer pour être, juste être.
JE VEUX
JUSTE ETRE. les carnivores qui ne comprennent rien à la souffrance animal les nihilistes, dont j’attend les attentats terroristes. Puisque dieu est mort, suicidez-nous : on n’en peut plus.
EXTRAIT 3 : « Dramaholic » par Ugo Ballara (texte non corrigé)
Le ouigo, la gare, moi et ma valise à roulette dans le centre pavé. Mes mains qui palpent le plastique pour se persuader qu’elle tiendra. Bus 6 direction plus loin, je traverse de larges avenues dix-neuvièmes flanquées de marronniers, derrières lesquelles s’étalent des maisons de maîtres : compète de moulures et de portails à fioritures. J’imagine que je suis jury d’un concours et j’établis mentalement le classement du plus beau zizi du boulevard des grosses teubs. Terminus, les constructions sont plus modestes. Je longe des petits pavillons sixties cernés de géraniums dans lesquels s’égosillent des oiseaux en plâtre.
Éditions
Les à-coups poussifs du portail automatique. Ma valise que je traine à l’étage sans rien déballer puis le lit sur lequel je me jette.
19h10, soupe d’endive, roulés au jambon, tarte aux quetsches. Le JT régional parle des mirabelles, particulièrement grosses cette année en raison des litres de flotte qui se sont déversés sur la France. On me demande d’en cueillir dans le jardin quand j’aurais un peu de temps, il y en a tellement que les branches caressent la pelouse. On en fera des gelées qui s’entasseront dans la cave en prévision d’une pénurie mondiale. Le goût des fruits survivra sans doute aux arbres qui les ont engendrés. Un renard pétrifié dans sa course monte la garde au-dessus du meuble télé. Des images de canicule défilent. Je constate l’impossibilité d’illustrer la chaleur sans poncifs. Un homme s’arrose la nuque avec une bouteille d’Evian. Un groupe s’abrite sous l’arbre d’une place déserte. Des gouttes perlent sur un front derrière les va-et-vient anxieux d’un éventail ajouré. Les vraies catastrophes manquent cruellement de télégénie. Elles s’étalent mollement dans le temps et ne s’offrent que rarement en spectacle. Un tsunami, ce n’est pas une grande vague pleine d’écumes qui s’abattrait sur les côtes comme la foudre. C’est juste une mélasse brune qui monte et qui embrasse tout. C’est implacable, mais c’est mou.
Mes doigts qui glissent sur l’écran fissuré du téléphone. J’ouvre machinalement Grindr en sachant que je ne ferai rien. Ego trip ou thérapie, chaque notif pénètre joyeusement mes oreilles, comme des promesses. Sans grande conviction, je prends connaissance des salut aimes tu plan daddy BM ? et autres Actif bonne teub ch lope fun cool sympa, évidemment sans aucune photo pour illustrer l’assertion.
Crrrrruui, crrrrruuii, je me demande d’où vient ce son qui agit sur mon corps comme un réflexe de pavlov, une version chiptune d’un arpège de xylophone désaccordé. Je tombe sur l’origine du logo, un masque jaune sur fond noir qui rappelle vaguement une cagoule SM. Joel Simkhai, le fondateur de l’application voulait une image de marque « virile et résistante » au design « agressif et puissant ». On ne peut pas nier la réussite du branding masc for masc. Je découvre que Simkhai est un fils de diamantaire qui a débuté sa carrière dans les fusion-acquisition et je me demande quelles pourraient être ses Tribes
Je bifurque sur insta pour rester dans le thème. J’inspecte des abdos bien secs qui s’agitent sur des chorées débiles. Je vois des corps tendus sur les bords accidentés d’une mer luisante, des fesses bombées dans des slips trop étroits sur des pourtours de piscine. Tout ça dans des intrigues téléphonées qui ne sont évidemment qu’un prétexte. Je me mets à diguer des profils d’artistes mannequins, des bellâtres qui se fabriquent post après post une persona de génies créateurs. La peintoche dégouline sur des plastiques rutilantes et Lady gaga est sous stéroïdes. J’ai l’impression de me faire aspirer dans le siphon de l’algorithme. [...]
burnaout@@riseupp.net httpp:///editionsburnaout.ffr/




































































REVUE LITTÉRAIRES




Le 1er juin 2023 a eu lieu à Glassbox (4, rue Moret, 75011 Paris) le lancement de la revue. À cette occasion, lisait PJ horny, Elise Mandelbaum, Rosanna Puyol Béatrice Lussol, Liza Maignan et Aurélie Massa. DJ Fatale a clôturé la soirée avec un set explosif.
Eugénie
Crédit photographique

L’éclat
des fracas


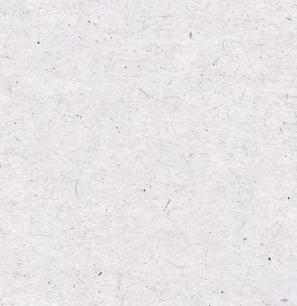
Existe-t-il un lieu où vivent et meurent les fracassés de la vie ?
Et si écrire cette ville, ce quartier, cette ruelle était le moyen de donner au chœur désordonné des vivants l’éclat de leur démesure ?
« Seuls le soleil et le vent pouvaient exister sans renoncer chaque lundi un peu plus à eux même. »
En moins de cent pages les massacrés de la société (chômeurs, intérimaires, précaires, etc.) sortent rincés par les éléments. Jérémy Beschon construit d’une phrase trouée d’éclats et de lumière le récit d’un quotidien en morceau sans rien cacher de l’odeur de sueur et de merde qui suit et précède l’humanité.
l’éclat des fracas
Jérémy Beschon

Quiero
Parution : juin 2025
EAN : 9782914363419
Prix public : 15 €
Publié avec le soutien de la Région Sud
Son livre s’achève sur un putain de chantier : La mission était simple : une tranchée de quarante centimètres de fond sur les trente mètres de terre rapportée qui bordait la nationale. Devant la boulangerie-restaurant, l’unique construction à vue d’œil, au pied de la Sainte-Victoire, de sa face la plus raide, la plus sombre.
Un premier roman vue d’en bas qui laisse couler un filet d’encre, de bave et d’éternité.

L’auteur
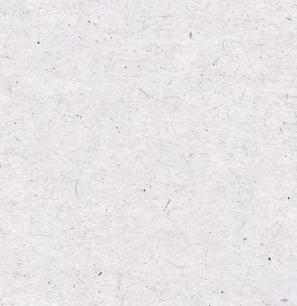



Le bus n’arrivait pas.
Jérémy Beschon né en 1978 à Marseille est écrivain, poète et metteur en scène. Il vit à Marseille. Autodidacte, il arrête l’école à 18 ans et publie à 19 un premier récit dans la revue Agone. Ils créent avec Virginie Aimone le collectif « Manifeste Rien » qui joue dans les bars puis se met à la mise en scène pour monter ses textes et adapter au théâtre ceux des autres : Stig Dagerman, Pierre Bourdieu, Benjamin Stora, Tassadit Yacine, Gérard Noiriel, Alèssi Dell’Umbria, Saïd Bouamama. Vingt ans plus tard le collectif « Manifeste Rien » continue de jouer ce répertoire alliant recherche esthétique et éducation populaire.
Publication : Baraque de Foire, théâtre, L’Atinoir (préface de Alèssi Dell’Umbria et textes à l’appui), 2012.
un autre portrait de l’auteur par Olivier Boudrand…

Elle alluma déjà la cigarette qu’elle grillait après son travail. Fuma en essayant de jouir d’être vivante. Se concentra sur le va et vient de la fumée, sur les rayons du soleil qui chauffaient son visage giflé par le mistral. Cela échoua. Le bus s’arrêta, elle monta, poinçonna son ticket et s’assit. Au démarrage tous ses organes cognèrent contre ses os. Il ne manquait qu’une brèche pour que tout parte, se répande aux pieds des autres voyageurs.


La pointe rouge et ses feux de circulation et
Elle surplombait l’immensité de la mer. Le mistral nettoyait le ciel. Tout était entièrement bleu. Un jogger la dépassa, l’odeur de transpiration gicla à ses narines. Elle se souvint du médecin qui lui avait conseillé le jogging contre les varices. Elle avait choisi les varices.
Elle se rendait chez Madame Piquemale, l’appartement jamais ouvert car, comme disait la vieille, « après faut tout fermer ». Madame Piquemale en était arrivée au point – et depuis longtemps – où elle ne faisait plus que ses besoins vitaux. Et attendre dans le fauteuil du salon, face aux volets clos, la femme de ménage.
Elle gravit l’escalier de roche blanche, reprit son souffle devant la porte, ouvrit. La vision de l’appartement l’attrista, l’attristait toujours. Les tapisseries partaient en lambeaux, la moquette en pelure. Son appartement finirait dans le même état le jour où elle abandonnerait
les travaux d’entretien, comme elle avait abandonné l’idée d’entretenir son corps, de combattre les varices ; le jogger devait avoir abandonné quelque chose de lui pour courir en moule bite, un lundi matin sur la corniche, jusqu’à puer de la sorte. Seuls le soleil et le vent pouvaient exister sans renoncer chaque lundi un peu plus à eux même. Elle posa son sac sur la commode en plastique, noua ses cheveux, prit l’aspirateur dans le placard. La voix chevrotante de Madame Piquemale ne se fit pas entendre. Elle lâcha l’aspirateur, sa crainte se confirma au bout du couloir, Madame Piquemale n’était pas dans le fauteuil du salon. Un post-it signé du médecin, posé sur la télé, lui apprit qu’elle était morte.
Elle revint sur ses pas, rangea l’aspirateur, dénoua ses cheveux.
Elle retourna vers le fauteuil où l’attendait d’habitude Madame Piquemale.
Elle observa son absence. Elle sentit un vide, son vide, l’étrangeté de celui-ci. Sans compassion pour la vieille ou pour elle-même, elle dévidait les années qui avaient défilées tous les lundis dans cet appartement. Elle ouvrit les volets. Le soleil et le vent s’engouffrèrent pour la première fois depuis la mort du mari. Elle eut vite honte de cette initiative et consciente de son absurde culpabilité s’empressa de les fermer.
Elle parcourut le couloir en sens inverse, prit son sac, sortit, tourna la clef dans la serrure emprisonnant l’absence de Madame Piquemale. Elle rejoignit la rue.
S’arrêta au feu rouge, appuya sur le bouton, attendit que le bonhomme clignote devant le flux de voitures.
Elle était de nouveau devant l’azur infini. D’habitude de retour à treize heures, elle imagina l’errance morbide qui l’assaillirait dans son appartement, avant qu’elle ne s’installe à la table de la cuisine devant le journal télévisé. La mer était toujours de toute beauté, cette indifférence de la nature l’inquiétait. Elle s’assit, jamais encore elle ne s’était arrêtée sur le banc du chemin qui la menait depuis dix ans, tous les lundis matins, à l’arrêt de bus. Elle contempla le ciel. Des mouettes, les ailes déployées, restaient en suspens, puis plongeaient dans le vide entre deux rafales de vent.
Le jogger rose fluo passa en sens inverse. Les effluves de sueur ne lui parvinrent pas. Elle n’aurait jamais revu cet homme si Madame Piquemale n’était pas morte durant le week-end. Elle songea à cette succession : le jogger, la disparition de Madame Piquemale, l’impossibilité de faire ses courses cet après midi sans la paye du ménage. Elle se leva, se dirigea vers l’arrêt de bus, poussée par les rafales. Elle ne viendrait plus ici. Il lui fallait trouver un autre ménage ou ses fonds se verraient amoindris. Le week-end perdrait de son sens si le dimanche ne précédait plus le travail du lundi. Sans week-end la semaine perdrait son rythme. L’échelonnement du temps brisé, la solitude serait encore plus vive dans ce dimanche disloqué.
Le bus n’arrivait pas.
Elle alluma déjà la cigarette qu’elle grillait après son travail. Fuma en essayant de jouir d’être vivante. Se
concentra sur le va et vient de la fumée, sur les rayons du soleil qui chauffaient son visage giflé par le mistral. Cela échoua. Le bus s’arrêta, elle monta, poinçonna son ticket et s’assit. Au démarrage tous ses organes cognèrent contre ses os. Il ne manquait qu’une brèche pour que tout parte, se répande aux pieds des autres voyageurs. Elle se dit qu’il ne fallait pas penser à ça, sans savoir ce qu’était ce ça qui s’infiltrait en elle à chaque autre secousse. La vie n’avait plus de vivant qu’une absence de lucidité impossible à atteindre derrière les vitres d’un bus. La lumière à laquelle avait renoncé Madame Piquemale baignait la ville ; la mort de son mari l’avait fait rompre avec le soleil. Elle, qui n’avait pas de mari, n’aurait pas le luxe d’une rupture. Sa vie était terne malgré l’éclat du soleil qu’elle accueillait tous les matins dans son salon. Madame Piquemale avait dû emmagasiner suffisamment de bonheur pour ne plus le côtoyer ces dix dernières années. Elle songea que sa régression à elle, n’ayant eu de début précis, avait débuté. Un déclin sans déclic, une tristesse originelle et sans origine. Elle calcula qu’il lui lui restait, au mieux, une vingtaine d’années à vivre. Elle n’arrivait pas à savoir si cette approximation était longue ou courte, si cette période éventuelle était à craindre. Et que craindre : le soleil, les appartements aux volets clos, la seule dégradation biologique ; elle pensa s’être toujours trompée, la ville irradiée défilait sous le ciel bleu.
Elle atteignit son quartier, se leva, appuya sur le bouton d’arrêt.
Elle montait les escaliers qui menaient à la place, reprit son souffle au premier palier, puis son souffle au second. Elle arriva sur la place ensoleillée, les serveurs préparaient les tables. Elle éprouvait d’habitude de la quiétude à la vue de ces lieux, mais ce matin les rayons du soleil l’injuriaient, creusant encore une faille en elle. Elle s’enfonça dans l’ombre de la rue principale. Salua les commerçants, ainsi que les voisins qu’elle ne croisait pas les lundis matin. Tous lui parurent morts. Elle tourna dans la ruelle de son appartement, s’immobilisa devant son immeuble, sortit les clefs, poussa la porte et grimpa les trois étages d’un rythme lent et régulier. Elle reprit son souffle, ouvrit la porte, posa son sac, s’assit à la table de la cuisine, attendit le journal télévisé de treize heures.
Elle aperçut une nouvelle fissure dans le mur. Se rappela le conseil de son beau frère : doubler les murs de placo. Ces paroles lui remémoraient son père, qui avait été maçon et détestait ces nouveaux matériaux, ces ersatz de la société moderne. Elle se leva pour inspecter la fissure, pensa à lui comme une erreur de l’ancienne société. Il n’y avait rien de nouveau. Son père avait vitupéré en vain pour le maintien de l’ordre, la vertu de ses filles, la place de sa femme. Elle pensa que cette génération avait eu l’illusion d’appartenir à un autre temps. Ici un sentiment de stagnation et de déclin, de stagnation du déclin, semblait irrémédiablement installé. Elle pensa qu’il n’y avait pas de génération, que rien, pas même le temps ne
nous distinguait les uns des autres. Les êtres vivaient leur temps et disparaissaient à tour de rôle. Elle n’avait pas eu d’enfant, elle disparaîtrait plus seule que son père. Elle était une femme de ménage à temps partiel. Se demanda s’il n’était pas injuste qu’une femme ne puisse plus faire ses courses une fois le loyer payé. À cause d’un décès, d’une femme qui attendait la mort depuis dix ans (depuis qu’elle avait commencé à travailler dans cette maison avec vue sur la mer et jamais ouverte). La justice n’avait pas d’interaction avec le monde. La justesse du monde était dans sa réalité, dans la cuisine. C’était tout. Rien de plus qu’une fissure dans le mur repeint. Le triste constat qu’elle avait dressé d’elle même dans le bus était irréel. Les pensées qui l’habitaient en ce moment, devaient l’être aussi. Au bout du compte, le compte y était, tout avait une place – même cette nouvelle fissure – et la sienne n’était pas à plaindre. Combien de malheureux, qui ne la rendaient pas moins malheureuse, souffraient davantage dans cette ville, ce quartier, cet immeuble. Chacun avec son taux d’injustice et son manque de justesse. Elle n’était pas morte comme son père et Madame Piquemale mais elle n’était rien à temps partiel. Une séquence de la mort venait ainsi la cueillir dans sa cuisine. Elle alluma le téléviseur, une cigarette, zappa en attendant le journal de treize heures.

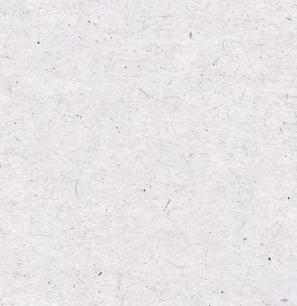
Dans une langue qui tangue au bord du gouffre, Sidonie fuit le pays réel qui l’oppresse. Au centre, le récit d’une scène de violence obsédante revient en ritournelle, à la manière d’un fantasme.
« J’ai des cheveux, des mains, un corps, j’ai mis au monde un enfant, mon sexe écartelé, je suis comme vous, ou presque. »

presque comme vous
Alice Carol

Quiero
Parution : juin 2025
EAN : 9782914363402
Prix public : 15 €

L’auteur

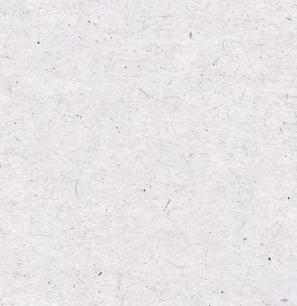



Publié avec le soutien de la Région Sud
C’est une scène vierge de toute interprétation.
Les questions sont suspendues et les frontières se brouillent entre récit, fuite, rêve halluciné, quête d’identité, ce monologue féministe fait vaciller le lecteur dans un autre pays. Les prénoms se perdent, Mina, Gladys, Erika, des hommes sans adresse, missiles projetés dans le vide, des colères aigües tournoient dans un ciel las. La scène du musée revient en ritournelle, imprimer un sceau, elle devient exaltation, sublimation, je peux y entraîner toute la cohorte de mes visions et l’emporter loin d’ici dans une pièce sans écho.
Le texte est montée au théâtre en 2025 mis en scène par Bernadette Résimont.
Alice Carol est née le 7 juillet 1977 à Sète dans l’Hérault. Elle est psychanalyste et vit dans les collines de l’arrière-pays marseillais. Après des études aux Beaux-art à Montpellier puis à Marseille, elle joue pour le théâtre pendant une quinzaine d’années tout en suivant une analyse avant de devenir à son tour psychanalyste. Presque comme vous est son premier roman.

J’ai aimé cette femme comme j’ai pu et c’était dur de trouver une porte pour entrer chez elle, c’était dur de savoir ce qu’elle voulait, ce qu’elle cherchait, ce qu’elle avait fait pour être là dans cette situation étrange et étrangère à ne rien faire, à lire, à dormir, à écouter les oiseaux, à regarder les toutes petites choses du monde, et s’emparer des détails comme d’une couronne.


Détail d’une photographie et encres d’après modèle par Samuel Autexier…
Première partie
J’ai des jambes, des bras, un cou, une tête, comme vous. Je suis comme vous, comme nous, j’ai besoin des autres, je suis comme le fleuve, comme la rivière, j’ai besoin de m’écouler, et sur le temps, et sur la virginité du monde.
J’ai grandi chez mes grands-parents, dans une campagne épaisse, pleine de l’humidité de l’hiver en été, et ils disaient « Sidonie qu’est ce que tu fais ? » Ils ne savaient pas ce que je faisais, personne ne savait, pas même ma mère, qui pourtant en savait des choses.
Il paraît que j’ai été séparée d’elle à la naissance, il paraît que j’étais un bébé fragile, et ma mère, une jeune femme occupée, et mon père, on n’en parlait pas.
Ma mère venait me voir, souvent, surtout en cas de crise, comme ils disaient, je ne me souviens pas vraiment des crises, je sais juste le sang, l’eau froide, le vide, la panique, je sais juste que ma mère venait, parce qu’il n’y avait qu’elle pour me calmer, du reste je ne me souviens pas.
J’ai grandi à la campagne, au milieu de l’herbe grasse, entre d’immenses châtaigniers balayés par la pluie et le vent. J’ai grandi sur un sol acide, couvert de limaces, d’humus, près des sources gelées en hiver, dans un grand manteau de solitude.
Aujourd’hui j’ai tout arrêté, j’ai mis un stop à ma vie, j’ai tout arrêté, pour elle.
Sans elle, j’aurais tout arrêté aussi, mais différemment.
Ne vous méprenez pas sur mes propos, ils ont la corne épaisse de ma vie, ils sont taillés dans l’écorce de la campagne, dans le rouge des crises, ils sont libres, mes propos, ils ne sont pas convenables.
À dix ans, j’ai quitté la campagne et mes grands-parents, le monde enfoui de l’enfance, mais quand s’arrête l’enfance, je ne saurais le dire. Je suis partie rejoindre ma mère, je me suis coulée dans sa force, dans sa voix, je me suis faite à son image.
Les autres, le monde, les hommes, drôles de poches vides dans mes yeux clairs, j’étais ta fille et je grandissais.
J’ai des cheveux, des mains, un corps, j’ai mis au monde un enfant, mon sexe écartelé, je suis comme vous, ou presque.
Si j’ai décidé de tout arrêter c’est parce que tout est allé trop vite, et que je ne savais plus discerner le vrai du faux. Je veux dire en moi-même, dans l’obscur où déambulent ce que je sens et ce que je montre, dans les miroirs déformants des yeux des autres, dans les réponses tronquées aux
questions que je n’ai pas encore osé me poser, dans la fuite, oui j’ai fui, je suis partie, c’était tout ce que je pouvais faire, je suis partie dans un endroit où on ne me reconnaîtrait pas, où on ne me jugerait pas, où on ne me parlerait pas.
J’en avais assez des longs discours, les miens comme les vôtres, tous les discours.
Je m’appelle Sidonie, je ne suis plus une jeune fille, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus biaiser en inventant des histoires, je ne peux plus me faire excuser aussi facilement qu’avant, ni pleurer sur mon enfance, on a tous une enfance, vous aussi, et certainement bien d’autres histoires à raconter qui couvriraient la mienne de honte.
La buée sur ma fenêtre, la trace du soleil qui serpente, le long canevas du cycle menstruel.
C’est ça, aussi, les crises.
Je n’ai pas peur de vous, je sais ce que je veux, je l’ai toujours su, quand j’ai compris qu’il n’y aurait plus de place pour moi, j’ai décidé d’être moi-même, sans le poids de la nécessité de vous plaire, je serai moi-même quoi qu’il m’en coûte, je suis partie pour ça, pour vivre ça.
La décision s’est faite lentement, il y a d’abord eu les crises, la fatigue, et elle. Il y a eu ce retournement, des indices, des histoires, et des histoires sur des histoires, comme des couches successives sur une peinture très ancienne.
J’ai tenu deux ans avant de partir, je ne sais pas comment, et puis un matin, j’ai fait mes valises, j’ai pris ma fille, l’avion, et je suis partie.
Je sentais en même temps le creux et le désir, la culpabilité et le soulagement, tous les doubles ne faisant plus qu’un, je savais qu’on me rechercherait, que je serais certainement condamnée pour une raison ou une autre, parce qu’on n’ a pas le droit de tout plaquer avec un enfant dans les bras, de tout larguer comme ça, du jour au lendemain, parce qu’on doit rester et se justifier, pour qui, pour quoi, pour se faire accepter de cette putain de société les jambes écartées ?
Je m’appelle Sidonie, je ne suis plus un bébé, je ne peux plus jouer à la marelle ou sauter à la corde, mais je peux partir, et c’est ce que j’ai fait.
J’ai grandi dans un isolement qui m’a construite, mais les autres sont toujours là, quelque part, avec leurs raisons d’être, leurs souvenirs, leurs différences, et il faut faire avec tout ça, et vivre en société, et baisser la tête, et se compromettre, c’est ce que je ne savais pas faire, et vous le savez bien, ça ne pardonne pas.
Tout a commencé quand je suis tombée enceinte.
Est-ce-que vous savez ce que c’est que d’avoir quarante ans et d’attendre un enfant, est-ce-que vous pouvez imaginer ce que c’est qu’être une femme, une femme qui attend un enfant, seule, qui attend, est-ce qu’un jour les femmes feront autre chose de leur vie que d’attendre, ou est-ce-que c’est inscrit dans les gênes, dans leurs cellules, cette attente, cette longue marche vers la mort, avec ce corps, toujours
en mouvement, ce corps qui saigne, qui pleure, qui déborde, ce corps qui bouge sur une attente figée, l’amour débordé de l’attente malgré son imminente fracture, et la peur en pâture.
Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà imaginé une seule seconde ce que l’attente organise, ce qu’elle anime, ce qu’elle nourrit. L’attente d’un enfant est la plus belle attente qui soit, parce qu’elle annule d’emblée la possibilité du vide.
J’ai endossé le rôle de victime comme une armure, comme un cri, comme une cape, j’étais de plus en plus silencieuse, rien ne changeait, les jours passaient pour me démonter, je me cachais, je ne voyais plus rien, n’entendais plus rien, j’étais tout au fond sans être folle, ce qui est pire encore. Non, la folie ne venait pas, rien à faire, elle ne voulait pas entrer en moi. J’étais obstinément raisonnée, et ce carcan de dogmes me quadrillait la route.
Et puis, l’arrivée de cette enfant a tout changé, le regard des autres, et moi aussi, c’était l’occasion de remettre sur pied quarante ans d’égarement. J’ai commencé à refuser, à choisir, j’ai commencé à dire stop, et plus je disais, plus je m’apercevais de tout ce qu’il y avait à dire, je ne pouvais plus me taire, c’était incroyable. Une force étrange, très animale, me soutenait jusqu’à l’insoutenable. C’était comme une nouvelle naissance, je me reconstruisais. J’étais claire et obstinée, je ne pouvais
plus faire marche arrière, c’était trop tentant, comme un horizon qui se dégage, une fontaine intérieure, qui coule, abondante, sur un sol asséché.
Mon corps commençait à trouver les mouvements dans la justesse de l’énergie accumulée, et tout se plaçait, j’étais libre, je crois. La liberté personne ne la possède, c’est un combat. Je commençais à voir son ombre me sourire, dans la légèreté de sa substance, dans l’inconséquence qu’elle éclaire. La magie soudaine de l’inconséquence du monde.
Je n’étais plus obligée de rien, tous les cadres s’effondraient sous mes yeux ébahis, toutes les distances se confondaient. La liberté est une histoire intime, c’est un secret.
La vie redoublait en moi, la vie chassait les peurs, la vie était forte, je ne pouvais pas l’ignorer, cette force vive en mouvement, et qui se régénère sans cesse.
Regardez-moi maintenant, je ne suis pas un monstre, je suis une femme, j’ai des yeux, je peux voir, j’ai des mains, je peux toucher, regardez-moi, ne faites pas l’économie de ce regard, je ne peux plus me taire, je suis belle, je suis laide, je suis fine, je suis épaisse, je suis vivante, maculée de vie.
art | littérature

Éric Pessan
144 pages
Format : 12,5 x 19 cm
Poids théorique : 154 gr
Prix : 18 €
Genre :
Littérature générale, récit, essai CLIL : 3641-3643
Mots-clés : Culture, territoire, actualité
Collection Théodolite
La collection Théodolite se consacre au paysage et au sentiment de la nature, avec des incursions en poésie.
Couverture : Nadia Diz Grana
www.lacleamolette.fr
Contact : Alain Poncet 06 70 31 36 50 lcam@orange.fr
Diffusion - Distribution : Serendip livres commandes@serendip-livres.fr www.serendip-livres.fr
21 bis rue Arnold Géraux
93450 L’ILE-SAINT-DENIS
Tél. 01 40 38 18 14
gencod dilicom : 3019000119404 Parution décembre 2024
ISBN : 979-10-91189-35-4
Théorie du coyote
« Je viens pour visiter, pour voir, pour arpenter le territoire, pour me laisser surprendre, pour rendre possible les rencontres imprévues, pour écrire aussi : pour que mon écriture soit bousculée.
En prenant la route pour Montbéliard, j’ai compris que j’avais depuis longtemps envie d’écrire sur la culture et que c’était enfin l’occasion rêvée.
Alors, allons-y.
C’est quoi la culture ? C’est pour qui ? Ça sert à quoi ? C’est élitiste ? C’est pour tous ? C’est réservé à un petit groupe ? On fait quoi pour la partager, la culture ? Pour la transmettre ? »
Invité en résidence par Pays de Montbéliard agglomération, Capitale française de la culture en 2024, Éric Pessan développe ici une réflexion passionnante sur la culture et sa perception. À lire d’urgence.
ISBN : 979-10-91189-35-4

L’auteur
Ne pas savoir ce que l’on vient chercher Éric Pessan, auteur protéiforme fuyant les étiquettes, a répondu « présent » :
Cela fait plus de 20 ans que je publie des livres, passant d’un genre à un autre, du public adulte au public adolescent ; tout ce que j’écris se passe ici et maintenant, dans le monde dont j’éprouve chaque jour à la fois la complexité, la rudesse et la joie. Livre après livre, projet après projet, j’explore ce qui me questionne, m’effraie, me scandalise ou – au contraire – me donne la force d’avancer. Notre monde est si souvent invivable, alors je cherche au travers la littérature ce qui offre des raisons de vivre : que cela soit des combats à mener, des injustices à surmonter, des peurs à affronter ou des beautés à partager.
D’un livre à l’autre, je passe de l’intime au social, parce que l’un et l’autre nous constituent, l’intime est politique, c’est une évidence de le noter. Et je bâtis mes fictions sur le terreau de ma propre expérience : me rendant dans les lieux que je décris, me documentant, m’appuyant également sur la bibliothèque que je transporte en moi. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé invité en des lieux/villes/territoires que je ne connaissais pas, ou peu, ou mal. Ce que m’offrent ces lieux est une chose précieuse : la disponibilité. Je viens pour écrire, pour visiter, pour voir, pour arpenter le territoire, pour me laisser surprendre, pour rendre possible les rencontres imprévues, pour écrire aussi : pour que mon écriture soit bousculée par l’environnement. L’exotisme n’est pas seulement se rendre à l’autre bout du monde ; je me refuse de plus en plus de voyager pour voyager, je cherche la lenteur, je cherche à observer ce qui se tient là, sous mes yeux, le fameux infraordinaire cher à l’écrivain Georges Perec, ce qui se joue au coin de la rue est parfois capital. Ce que je me propose de faire lors de mes séjours dans la communauté d’agglomération de Montbéliard c’est : regarder, ressentir, sentir et laisser cet exotisme-là infuser pour que naisse un texte dont j’ignore au moment où j’écris cette note de quoi il parlera et à quel genre littéraire il s’apparentera.
Éric Pessan – septembre 2022.
ISBN : 979-10-91189-35-4
Extraits
On n’arrive pas vierge dans un lieu. Je débarque à Montbéliard encombré d’une histoire. J’étais à Paris, il y a quelques jours, des amis — des vrais amis de la vraie vie, pas simplement des connaissances — participaient à une soirée en librairie où il était question de présenter une nouvelle collection d’une maison d’édition théâtrale. J’avais du temps, je m’y suis rendu. La soirée était agréable, j’ai retrouvé là-bas quelques visages connus, et au moment des questions du public, une dame (de nombreuses personnes semblaient la connaître, j’ignore de qui il s’agissait) a pris la parole pour dire « Le texte est le coyote ». Des gens ont ri, les auteurs invités ont acquiescé et la soirée a continué, feutrée, chaleureuse, cossue, parfaite.
Si certaines personnes présentes n’ont pas compris ce que venait faire là ce coyote, nul n’a osé poser la question de peur de passer pour un abruti puisqu’à l’évidence, tout le monde avait la référence.
Et c’est encombré de cette histoire que j’arrive. Je n’ai cessé de penser au coyote en prenant le métro ce soir-là. La réf, je l’avais moi aussi. Le texte est le coyote
ISBN : 979-10-91189-35-4
Extraits
est une citation du poète et auteur dramatique Allemand de l’Est Heiner Müller. Il prononce cette phrase dans un entretien autour de son travail pour expliquer à quel point aborder un texte lorsque l’on est un acteur (ou un metteur en scène) c’est se confronter à une bête inconnue qui peut éventuellement vous mettre en danger. Comparant le texte dramatique à un coyote, il fait référence à une performance réalisée à SoHo, New York, par un autre Allemand, l’artiste Joseph Beuys. Pour protester contre la guerre du Vietnam, Beuys s’est rendu aux États-Unis dont il a refusé de fouler le sol, s’est fait transporter allongé en ambulance dans une galerie d’art contemporain où il a passé trois jours (et trois nuits) enfermé dans une pièce avec un coyote symbolisant — entre autres — la puissance des peuples autochtones amérindiens. La performance est archiconnue dans le minuscule milieu de l’art contemporain, elle s’est déroulée du 21 au 25 mai 1974. J’avais la réf, donc, et je me demande combien dans la salle l’avaient?
Et justement, j’ai ressenti immédiatement un plaisir au fait de la posséder cette référence, de connaître Beuys, Müller, de faire partie d’un monde auquel le fils d’employés-ouvriers que je suis n’était pas prédestiné. J’avais la réf bien que je n’aie pas vraiment prolongé mes études. Une réf d’autodidacte qui ressent simultanément fierté et honte en repensant au coyote.
Combien de personnes présentes ce soir-là à la librairie n’ont pas osé poser une question? Combien de personnes ont reçu un message clair: vous êtes trop
art | littérature
ISBN : 979-10-91189-35-4
Extraits
cons pour comprendre. Vous n’êtes pas de notre monde.
Est-ce donc à cela que sert la culture? À créer un entre-soi qui permet de faire le tri, qui isole, qui rassure?
Je ne remets en question ni Beuys ni Müller bien entendu. Mais je me dis que si le coyote avait mordu une bonne fois pour toutes l’artiste en emportant un morceau, personne ne se pâmerait devant la profondeur de cette performance. Je me dis aussi que comparer le travail d’un comédien sur un texte de théâtre au danger éprouvé lorsque l’on se trouve seul face à un animal sauvage est une exagération bourgeoise un tantinet honteuse. Faire du théâtre n’est pas facile, mais personne n’y risque sa vie (du moins dans une démocratie occidentale: monter clandestinement un texte dissident et interdit dans une dictature politique ou religieuse est une autre paire de manches).
Je suis venu à Montbéliard pour écrire et je peine à me désencombrer d’un coyote. Je suis invité par l’agglomération (nommée Pays de Montbéliard agglomération — PMA) qui est — pour l’année 2024 — Capitale française de la culture. Après Villeurbanne en 2022, c’est la seconde fois que ce nouveau label est décerné, il concerne des territoires peuplés de 20000 à 200000 habitants. Les villes ou communautés de communes désirant postuler doivent respecter certains critères: l’innovation, la transmission artistique et
ISBN : 979-10-91189-35-4
Extraits
culturelle, la participation des habitants, l’accessibilité, la solidarité territoriale, la faisabilité et l’inscription dans la durée. Je viens ici pour animer des ateliers d’écriture et pour écrire un livre — qui restera. Lorsque l’on m’a proposé de rédiger une note d’intention sur ma présence (c’était en 2022), mon projet était flou, j’avais indiqué ne pas savoir ce que je viendrai chercher. Puis, j’avais ajouté: je viens pour visiter, pour voir, pour arpenter le territoire, pour me laisser surprendre, pour rendre possible les rencontres imprévues, pour écrire aussi: pour que mon écriture soit bousculée.
Deux années se sont écoulées depuis. En prenant la route pour Montbéliard, j’ai compris que j’avais depuis longtemps envie d’écrire sur la culture et que c’était enfin l’occasion rêvée.
Alors, allons-y.
C’est quoi la culture? C’est pour qui? Ça sert à quoi? C’est élitiste? C’est pour tous? C’est réservé à un petit groupe? On fait quoi pour la partager, la culture? Pour la transmettre?
Je suis écrivain, j’ai axé ma vie sur la culture, je vais au théâtre, j’écoute de la musique, je lis beaucoup, j’aime le cinéma d’auteur, l’art contemporain, la danse, l’architecture, l’art en règle générale et j’ai envie de regarder autour de moi à quoi concrètement tout cela rime. La culture est-elle un espace moelleux pour gens qui se comprennent à mi-mots? Un combat à mener? Une nécessité? Une lubie? Je garde un coyote en tête pour m’emparer de toutes ces questions.
Cyclonopédie ? C’est comme si Deleuze était né en Iran et avait écrit une version philosophique de Dune – entendu en librairie, à l’annonce de la parution prochaine de l’ouvrage –
Arguments de vente
Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi)
bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré l’ouvrage fondateur de la « théorie-fiction » contemporaine. Une édition française très attendue . Dans le monde francophone, plusieurs éditeurs France, au Québec, en Belgique) ont cherché à acheter les droits de traduction de Cyclonopédie tandis que plusieurs traducteurs en ont publié des fragments (en ligne au Québec, dans revues Zone Critique et Multitudes en France). Negarestani apparaît aussi dans l’ouvrage
Accélération (PUF, « Perspectives critiques »).
Une référence en devenir . Depuis quelques années, des éditeurs de plus en plus nombreux publient les œuvres de membres de l’« école » negarestanienne, ainsi que des ouvrages y explicitement référence. Ainsi en français chez Kodwo Eshun, Mark Fisher, Ray Brassier, Frédéric Neyrat, Grégory Chatonsky, Érik Bordeleau, Yves Citton, Jacques Fradin, Guillaume Boissinot, Yuk Hui, entre autres.
Auteur : Reza Negarestani
Traducteur : Emile Lavesque-Jalbert
Préface : Frédéric Neyrat
La métaphysique est une branche de la littérature fantastique, disait Borges. ouvrage en est la preuve ultime.
cible
Format : Broché, 13 x 20 cm, environ 350 pages hkp 01. ISBN : 978-2-487378-03-2
Prix : 24€ TTC
Parution : 4 avril 2025
Résumé

Passionnés de littérature expérimentale, de philosophie spéculative, de fictions d’horreur.
Lecteurs de théorie critique contemporaine (CCRU, Mark Fisher, Andrew Culp, Benjamin Bratton, Donna Haraway, etc).
Amateurs de Lovecraft, Bataille, Borges, Deleuze et fanbase du matérialisme spéculatif.
Ecologistes curieux de lire un livre où un étrange pipeline sabote l’univers humain. Bilingues / anglophiles l isant jusqu’alors les écrits de Reza en ligne et qui passeraient commande.
Œuvre culte de théorie- fiction contemporaine, Cyclonopédie (sous-titre : Complicité avec des matériaux anonymes ) est un livre hybride mêlant philosophie, géopolitique et horreur cosmique. Dans une prose labyrinthique d’où émergent d’étranges artefacts , le philosophe iranien Reza Negarestani, figure légendaire du réalisme spéculatif ( Intelligence and Spirit , Chronosis ) explore l’histoire secrète du pétrole comme entité vivante et maléfique, incarnant des forces obscures qui façonnent les guerres, les mythologies et les civilisations. À travers un dialogue entre spéculation philosophique et fiction paranoïaque, l’auteur nous plonge dans une perspective vertigineuse où les forces telluriques et les conjonctures humaines ne font qu’un. Negarestani explore les chemins souterrains d’une narration où le pétrole, figure tellurique invisible, mènerait secrètement les destinées humaines en se répandant depuis les profondeurs du désert vers la surface entière du globe.
Cyclonopédie ? C’est comme si Deleuze était né en Iran et avait écrit une version philosophique de Dune – entendu en librairie, à l’annonce de la parution prochaine de l’ouvrage –Arguments de vente
• Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi) et bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré comme
Arguments de vente
• Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi) et bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré comme l’ouvrage fondateur de la « théorie-fiction » contemporaine.
• Une édition française très attendue . Dans le monde francophone, plusieurs éditeurs (en France, au Québec, en Belgique) ont cherché à acheter les droits de traduction de Cyclonopédie , tandis que plusieurs traducteurs en ont publié des fragments (en ligne au Québec, dans les revues Zone Critique et Multitudes en France). Negarestani apparaît aussi dans l’ouvrage Accélération (PUF, « Perspectives critiques »).
• Une référence en devenir . Depuis quelques années, des éditeurs de plus en plus nombreux publient les œuvres de membres de l’« école » negarestanienne, ainsi que des ouvrages y faisant explicitement référence. Ainsi en français chez Kodwo Eshun, Mark Fisher, Ray Brassier, Frédéric Neyrat, Grégory Chatonsky, Érik Bordeleau, Yves Citton, Jacques Fradin, Guillaume Boissinot, Yuk Hui, entre autres.
• La métaphysique est une branche de la littérature fantastique, disait Borges. Cet ouvrage en est la preuve ultime.
Public cible
• Passionnés de littérature expérimentale, de philosophie spéculative, de fictions d’horreur.
• Lecteurs de théorie critique contemporaine (CCRU, Mark Fisher, Andrew Culp, Benjamin Bratton, Donna Haraway, etc).
• Amateurs de Lovecraft, Bataille, Borges, Deleuze et fanbase du matérialisme spéculatif.
• Ecologistes curieux de lire un livre où un étrange pipeline sabote l’univers humain.
• Bilingues / anglophiles lisant jusqu’alors les écrits de Reza en ligne et qui passeraient commande.
ils en parlent
« Lire Negarestani, c'est comme être converti à l'islam par Salvador Dali »
Graham Harman
« Les lecteurs occidentaux peuvent s'attendre à ce que leur condition schizoïde particulière soit "charcutée" par cet ouvrage. Considérons une thèse grotesquement réductrice, violente, comique mais néanmoins suggestive : L'islam est à Negarestani ce que le marxisme est à Bataille »
Nick Land
« Le manuscrit de Cyclonopédie reste l'un des rares livres à poser rigoureusement et honnêtement la question de savoir ce que signifie s'ouvrir à une vie radicalement non-humaine […] Cyclonopédie fait également partie d'une nouvelle génération d'écrits qui refusent d'être qualifiés de "théorie" ou de "fiction" […] Pour trouver un ouvrage comparable, il faudrait remonter aux Unaussprechlichen Kulten de Von Junzt, aux poèmes en prose d'Olanus Wormius ou aux récents commentaires "néophagistes" sur le Livre d'Eibon.
Eugene Thacker
« Incomparable. L'horreur post-genre, la théologie de l'apocalypse et la philosophie du pétrole se croisent en un codex nouveau et nécessaire » China Miéville
« Cyclonopédie est un traité extraordinaire, un hybride inclassable de fiction philosophique, de théologie hérétique, de démonologie aberrante et d'archéologie renégate. Il allie la rigueur conceptuelle à un
« Incomparable. L'horreur post-genre, la théologie de l'apocalypse et la philosophie du pétrole se croisent en un codex nouveau et nécessaire »
China Miéville
« Cyclonopédie est un traité extraordinaire, un hybride inclassable de fiction philosophique, de théologie hérétique, de démonologie aberrante et d'archéologie renégate. Il allie la rigueur conceptuelle à un ésotérisme exigeant et, à travers ses formules sacrilèges, l'épilepsie géopolitique est scrutée comme dans un miroir d'obsidienne »
Ray
Brassier
« Monumental […]. Un chef-d’œuvre de théorie-fiction. […] Negarestani pense une forme d’insurrection de la terre contre le soleil »
Érik
Bordeleau
« Une fiction climatique […] Un dédale d’intrigues troublées et inauthentiques »
Fabien Richert
« Un cauchemar spéculatif peuplé d'archéologues, de djihadistes, de trafiquants de pétrole, de soldats américains, de chefs religieux hérétiques, de cadavres d'anciens dieux, de la terre et du soleil, et de chasseurs extraterrestres »
Yun
Won-hwa
« Des mystères chtoniens du pétrole aux fictions macabres de H. P. Lovecraft, de l'ancienne sagesse islamique (et pré-islamique) aux terrifiantes réalités de la guerre asymétrique postmoderne, Negarestani fouille la préhistoire cachée de la culture mondiale au XXIe siècle »
Steven Shaviro
l’auteur en parle
Reza Negarestani, interviewé par Fabio Gironi (sur le site de Nero Editions ), annexe à l’édition coréenne
« L'idée initiale de Cyclonopédie était déjà là avant de découvrir ces nouvelles connexions : un mélange de contes de fées persans tordus, de folklore sociopolitique et de troubles géopolitiques persistants. Mon but était de ne pas aborder ces idées comme un écrivain qui se soucie excessivement du raffinement de l'art littéraire ou des valeurs de la littérature, mais plutôt comme un ingénieur. C'est ainsi que j'ai mis ma formation formelle en ingénierie des systèmes au service de l'écriture d'un livre. Dès le départ, je l'ai traité non pas exactement comme un roman ou un ouvrage de philosophie, mais comme un système doté de tendances abstraites, de trajectoires qui évoluent dans le temps, de comportements imprévisibles, de multiples échelles de contenu d'information, etc. En tant qu'écrivain, je n'ai fait que déclencher - pour reprendre l'expression d'un ingénieur système - l'état initial du système et le laisser vivre sa propre vie. Le désordre auquel vous faites référence à juste titre est le résultat de deux problèmes différents. Ma sous-performance en tant qu'écrivain au niveau de l'exécution, et mon intention en tant que personne qui essaie d'imiter le mieux possible le climat du Moyen-Orient, qui était ma zone d'expérience immédiate. J'ai écrit Cyclonopédie avec une seule priorité : construire un sentiment de syncrétisme et de paranoïa, deux caractéristiques du Moyen-Orient contemporain . Une bonne fiction peut simuler ces caractéristiques, mais pour les imiter et les reproduire, il faut trouver et inventer des mécanismes similaires capables de générer le type de paranoïa, d'horreur chronique et de syncrétisme fertile propre au Moyen-Orient, plutôt que de les décrire ou de les réitérer par le biais du média littéraire ».
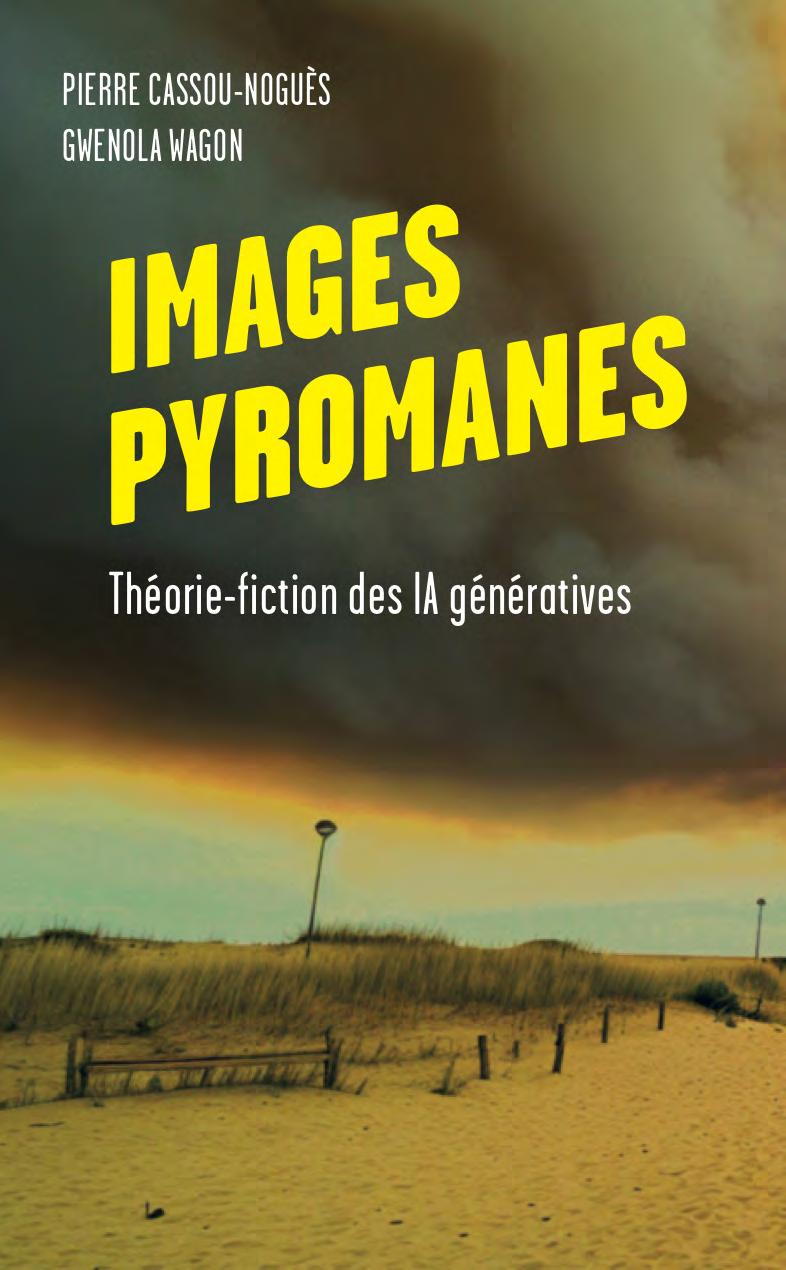
Images Pyromanes
Théorie-fiction des IA génératives
Mêlant théorie et fiction, les auteurs — un philosophe et une artiste — interrogent les implications esthétiques et politiques des IA génératives. Dans un temps fragmenté, sur fond de catastrophe climatique, un duo d’agents immobiliers manipule et imagine la réalité à l’aide de la plateforme, une IA générative d’images.
À travers une série de contes spéculatifs, ce livre se penche sur les multiples facettes de cette révolution : comment les réseaux sociaux, devenus filtres et métafiltres, réorganisent nos réalités ; comment l’anarchive, cette accumulation chaotique d’images possibles, recompose le passé, le futur et l’imaginaire dans un jeu infini de déformations et de réinventions ; la pyropictomanie ou le plaisir pris dans le formidable spectacle d’une dépense d’énergie ; le vol de la lumière qui plonge brusquement l’histoire de l’art dans l’obscurité
La plateforme cache une bête qu’il faut nourrir d’énergie électrique et de temps de cerveau disponible.
Pierre Cassou-Noguès est philosophe et écrivain. Il est professeur au département de philosophie de l’université Paris 8 et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Son travail est fondé sur un usage théorique de la fiction. La fiction est pour lui un moyen d’explorer le possible et ses limites. Dans ses travaux les plus récents, il applique cette théorie-fiction aux problèmes posés par les nouvelles technologies.Il a notamment publié Les Démons de Gödel. Logique et folie (Seuil, 2007), Les Rêves cybernétiques de Norbert Wiener (Seuil, 2014), La Bienveillance des machines (Seuil, 2022). Il a co-réalisé les films Bienvenue à Erewhon, (Irrévérence Films, 2019) et Virusland (Irrévérence Films, 2022).
Gwenola Wagon est artiste et chercheuse. Elle enseigne à l’École des Arts de la Sorbonne à l’Université Paris 1. À travers des installations, des films et des livres, elle imagine des récits alternatifs et paradoxaux pour penser le monde numérique contemporain. Elle arpente le globe virtuel avec ses premiers films Globodrome, enquête dans l’espace de l’hyperinformation et des infrastructures d’Internet en collaboration avec l’artiste Stéphane Degoutin avec qui elle co-réalise World Brain, le livre Psychanalyse de l’aéroport international. Après Bienvenue à Erewhon, Virusland et Chroniques du soleil noir fables post-cybernétique avec Pierre Cassou-Noguès, elle publie le livre Planète B un essai qui mêle enquête et fiction afin d’appréhender un monstre en pleine expansion.
SOMMAIRE IMAGES PYROMANES
Théorie-fiction des IA génératives
Avant-propos
1 - Immobilière Agence
Max et Norma
Posture et post-réalité
Machines à habiter
Filtres et métafiltre
Les vrais artistes sont-ils des agents immobiliers
Reconversion
Psy-non-chimique
La troupe intérieure
Les fantasmeurs
Qu’est-ce que l’IA
Manipulation
Villa de rêve
2 - Anarchives
Les dunes
Une station balnéaire
Le niveau de la mer
3 - Pyropictomanes
Le spectacle de l’énergie dissipée
Hyper-objet et synhaptique
La valeur, temps humain et non humain
Les machines et les plantes
Les images ne sont pas des marchandises
L’économie pyropictomane
TCD (temps de cervau disponible)
Transfert de valeur
Les images rares
Néoromantisme
Le langage et le sublime
Addictions pyropictomanes
4 - Confessions d’une blendeuse - Le carnet de Norma
Bêtes-mains
Des méduses et des escargots
Couples bêtes-actrices
5 - Les grands espaces
Photo de famille
Les archives de Janssen
Les archives du futur
Anarchives
Aberrations, obturations
Un autre temps postmoderne
Différances
L’effet Orlando
Le réel
Architraces
L’espace latent
Comme un enfant
Nommer
Esthétique transcendantale
6 - Portrait del’artiste en Rückenfigur et autres rêveries néoromantiques super-kitsch
L’atelier
La grande réserve
Le Wanderer
Le vol de la lumière
Klepophanes
Nuages
Le Boli
Le plastique
Le paysage-catastrophe
Interlude - Le chant des fibres perdues
Un cœur de plastique
Le super-kitsch
Postscriptum. L’image splash
7 - Épilogue - L’évasion
Remerciements
Index des notions
Biographies
Le livre «Images pyromanes : Théorie-fiction des IA génératives» est une réflexion croisée entre une artiste et un philosophe sur les impacts des IA génératives dans nos vies. Il s’agit d’un mélange de théorie et de fiction qui explore comment ces technologies transforment notre perception du monde, nos habitudes et les formes de coexistence humaine.
Résumé des idées principales :
1. Les IA génératives comme révolution des représentations :
- Le livre ne cherche pas à expliquer techniquement les IA ni leur histoire, mais à comprendre comment elles redéfinissent nos représentations de nous-mêmes, des sociétés, et de l’environnement.
- Les IA génératives, par la production automatisée de textes et d’images, influencent nos gestes, nos récits et les concepts qui structurent notre expérience de la réalité.
2. L’interaction entre artistes, philosophes et IA :
- L’artiste et le philosophe explorent comment ces technologies génèrent de nouvelles «formes de vie». Ils imaginent des scénarios spéculatifs sur les usages, les gestes et les récits que ces IA appellent.
- Les images dans le livre sont majoritairement issues d’IA, combinées avec des photographies et des images trouvées, jouant sur leur authenticité et leur mode de production.
3. Théorie-fiction et critique de la réalité :
- Le livre utilise la théorie-fiction pour explorer des mondes possibles où l’IA joue un rôle central. Ces récits mêlent spéculation et critique sociale.
- Par exemple, un chapitre met en scène une agence immobilière fictive qui vend des logements dans des mondes générés par IA, illustrant la transformation de la perception et de la consommation immobilière.
4. Les images pyromanes :
- Une métaphore centrale est la pyropictomanie, soit le plaisir que procurent les images d’énergie dissipée (incendies, catastrophes, etc.). Cela renvoie à notre fascination pour les images produites par des IA, considérées comme le résultat d’une grande dépense énergétique.
5. Les filtres et la post-réalité :
- Les filtres sur les réseaux sociaux et les images générées par IA sont vus comme des outils de transformation de la réalité en «post-réalité», où les images deviennent des objets de consommation émotionnelle et esthétique.
- Cette dynamique crée des déformations cohérentes qui influencent nos relations à l’environnement et aux autres.
6. La crise environnementale et les IA :
- Le livre aborde les paradoxes de la crise climatique en lien avec les technologies : les IA permettent de représenter les catastrophes tout en
contribuant elles-mêmes à la crise à travers leur coût énergétique. - Il critique notre tendance à utiliser les technologies pour masquer ou «camoufler» les problèmes réels.
7. L’économie des images dans une société post-humaine : - Les auteurs spéculent sur une économie où les images, facilement reproduites, prennent une valeur différente des objets matériels, redéfinissant les concepts de production et de consommation.
Conclusion :
«Images pyromanes» est une exploration imaginative et critique des impacts des IA génératives, intégrant analyses philosophiques, récits fictifs et réflexions sur l’art. Le livre invite à repenser notre rapport aux images, à la réalité et à la technologie, dans un contexte marqué par la crise environnementale et les transformations sociales.

Littérature étrangère

































































SARAHLAND
Sam Cohen (trad. Sarah Netter)
▶ Préface ......................................... Sam Cohen
▶ Postface ...................................... Laura Boulic-Lellouche
▶ Format (mm) 130*200
▶ Nombre de pages 140
▶ Prix (€) ......................................... 14
▶ ISBN 978-2-493534-19-4
▶ Parution avril 2025
Q QUEERS, FÉMINISME, JUDAÏTÉS, RÉALISME FANTASTIQUE
ÉTUDES



Au fil de dix nouvelles brillantes et souvent hilarantes, l’autrice explore la manière dont les narratifs qui nous sont assignés sont dépassables. Elle construit avec ses personnages — presque toutes prénommées Sarah — de nouvelles histoires pour leurs passés, leurs futurs, de nouvelles possibilités de vie en soi. Dans le refus pour chaque Sarah d’adhérer à un récit unique et uniformisant, l’autrice propose un lieu potentiellement meilleur pour nous toustes, un espace narratif qui n’exige aucune fixation de soi, aucune injonction consumériste, aucun compromis corporel : un lieu appelé Sarahland.
Sarahland est un ouvrage de fiction américain contemporain qui se découpe en dix nouvelles, toutes reliées par les personnages de Sarahs et leurs parcours initiatiques à la fin de l’adolescence. Sam Cohen, autrice queer et juive, déploie un univers drôle et piquant autour des notions d’identité, de transition, de transformation, d’émancipation et d’apprentissage.
Au fil d’histoires inventives, l’autrice explore la manière dont les narratifs qui nous sont assignés, les récits traditionnels, les identités qui nous pré-existent, sont dépassables. Elle construit alors avec ses personnages — presque toutes prénommées Sarah — de nouvelles histoires pour leurs passés ou leurs futurs, de nouvelles façon d’aimer la terre et ceux qui la peuplent, de nouvelles possibilités de vie en soi. Dans le refus pour chaque Sarah d’adhérer à un récit unique et uniformisant, l’autrice propose un lieu potentiellement meilleur pour nous toustes, un espace narratif qui n’exige aucune fixation de soi, aucune injonction consumériste, aucun compromis corporel : un lieu appelé Sarahland.
À propos de l’autrice : Née à Detroit aux Étatsunis, Sam Cohen vit et travaille actuellement à Los Angeles. Elle est une autrice de fiction dont les romans explorent des thèmes à l’intersection du féminisme, des études queers, et des pensées juives. Après avoir publié dans différentes anthologies et revues littéraires (Queer Flora, Fauna, and Funga, Weird Sister Collection, etc.), elle publie en 2021 Sarahland, un recueil de nouvelles. Elle enseigne l’écriture à l’université en tant que professeur d’écriture créative. Elle a été nommée et à gagné à de nombreux prix littéraires, notamment le ALMA Award (Best Jewish Story Collection of 2021), le Jewish Women’s Archive Book List, le Golden Poppy Award in Fiction (finaliste) ou encore le Chautauqua Janus Prize. Elle est en cours d’écriture de son prochain livre.


Thèmes abordés : Luttes queers, identités juives, antiracisme, adolescences, enfances, pop culture, réalisme fantastique

Actualités autour du livre : Certains exemplaires du tirage (entre 100 et 200) seront custo misés à la main par le graphiste Flo*Souad Benaddi et deviendront ainsi collector. Des dessins sur les tranches, des stickers ou encore des petits goodies cachés feront partie de ces interventions spéciales !
Œuvres associées :
▶ Les septs Nuits de Miriam, Melissa Broder, Christian Bourgeois, 2023
▶ Soif de sang, Rivers Solomon, Aux forges de Vulcain, 2023
▶ Brûlées, Ariadna Castellarnau, L’Ogre, 2018
▶ Les Dangers de fumer au lit, Mariana Enriquez, Poche, 2024



































































Le récit s’inspire de la littérature adolescente en en reprenant certains codes : le contexte de l’internat, les rapports de séduction, l’attention portée aux vêtements, l’intégration d’éléments de la pop culture, non pas pour reproduire classiquement ce schéma littéraire, mais au contraire pour le déplacer, le transformer d’un regard critique et en faire ressortir les rapports de force et de domination qui se jouent à cet âge. En tant que lecteur, nous nous identifions aux personnages inoubliables que Sam Cohen développe depuis notre position d’adulte qui portons en nous le souvenir ambiguë et complexe de nos adolescences.
Chaque nouvelle a son autonomie : on passe d’une Sarah biblique à une Sarah en lesbienne vieillissante qui prend littéralement racine comme une arbre majestueux, ou encore à une Sarah amoureuse de Buffy qui utilise la fanfiction pour dépasser son obsession romantique. Mais elles peuvent être aussi lues comme un ensemble cohérent qui tisse une vision ambitieuse de l’indépendance, qui propose des façons de se ré-imaginer. Les nouvelles de Sam Cohen sont accessibles, excitantes et profondes. Elles mettent en avant l’amitié, la sororité et examinent les alliances porteuses qui en découlent. Une contextualisation francophone est pensée avec une préface de l’autrice pour l’édition française. Laura Boulic-Lellouche, chercheuse et éditrice, a écrit la postface de l’ouvrage.
À propos du traducteurice : Sarah Netter est traducteurice, auteurice et chercheureuse. Iel vit et travaille entre Marseille et Clermont-Ferrand où iel est artiste-chercheur·euse à la Coopérative de recherche de l’ÉSACM. Iel y donne des ateliers de traduction collective depuis 2020 à partir de textes décoloniaux et sur les questions de blanchité. Iel organise des clubs de lecture autour de la traduction militante, avec des textes qu’iel a traduit. Iel a traduit avec son collectif Trans* de Jack Halberstam, première traduction française de l’auteur, paru chez Libertalia en 2023. Récemment, iel a aussi publié la traduction d’un texte de Sayak Valencia sur les transféminismes et le binarisme de genre dans le livre Ants Walk Two Ways, paru aux Presses du Réel. Iel a écrit la préface du livre de Marl Brun, sorti chez Burn~Août en 2023.
EXTRAIT 1 (traduction provisoire) :
On dormait dans une résidence privée en dehors du campus où quatre-vingts-dix pour cent des filles s’appelaient Sarah, ou bien Rachel, Alyssa, Jamie, Becca, Carrie, Elana et Jen. Les dix autres pour cent s’appelaient Bari, Shira et Arielle. Toute la résidence était juive. Je n’ai jamais compris comment de telles choses arrivaient. Nulle part, sur aucun des supports publicitaires concernant la résidence — qui avaient réussi à tellement m’exciter quant au fait de vivre sans parents dans un immeuble de gens studieux de dix-huit ans avec une machine à yaourt glacé — n’était mentionné le mot « Juif », pourtant, semblait-il, où que j’aille, tout le monde était juif. J’avais beau penser faire des choix indépendants et me déplacer librement
dans le monde, c’était comme si un sillon secret avait été creusé, et que des pare-chocs invisibles me repoussaient doucement dans ce sillon, le sillon juif, Sarahland, et Sarahland me piégerait encore et toujours en me faisant croire que c’était le monde entier. Quand j’ai appris que les juifs ne représentaient que trois pour cent du pays, j’étais déconcertée, où sont les autres ?
EXTRAIT 2 (traduction provisoire) : Maintenant tu es Sarah. C’est parti, roulant sur l’autoroute, short court remonté, cuisses épaisses étalées et suantes sur le cuir du siège conducteur·ice. C’est le désert, mais pas le genre rocailleux magnifique. C’est plutôt le genre tout brûlé, exception faite de quelques buissons insignifiants. Tu es couverte d’une couche de graisse, de quand tu as forcé l’ouverture de ton pot de baume à lèvres fondu qui t’a éclaboussé. Maintenant tu te sens comme un oiseau dodu et juteux, comme si ta peau pouvait buller de croustillant. Ta clim est cassée, et tu te verses de l’eau dessus toutes les deux minutes. Ton rouge à lèvres est rose chewing-gum et tu portes des lunettes de soleil. Ton CD n’arrête pas de sauter et tu n’arrives pas à avoir de réseau dans le désert, ni radio ni téléphone. Tu fuis, sans attaches, une fille et une voiture et mille dollars que t’as mis de côté avec les pourboires. Tu veux recommencer tu te dis, et pourquoi pas de cette manière. Occasionnellement, tu passes devant des panneaux pour des feux d’artifices, des pistolets, du porno, et ensuite des heures de vide, un seul cactus, un paquet de sable.
EXTRAIT 3 (traduction provisoire) : Le monde ordinaire est une banlieue du Midwest construite dans les années 80, faite d’exactement trois styles architecturaux de maisons presque identiques. Tout le monde a de la moquette beige et des coussins bleu sarcelle et un meuble mural avec des vases en verre soufflé et des figurines miniatures de femmes avec des corps en pouf et des têtes en céramiques. Sarah vit dans le monde ordinaire. Sarah est à vélo dans le cul-de-sac. Sarah est dans le cellier, et mange des Cheez-Its directement à la boîte. Sarah lit de très longues séries de livres qui parlent de filles qui ont plus d’ami·es qu’elle. Le monde ordinaire est okay. Il est quelconque.

Sarahland dans sa version originale, publiée par Grand Central Publishing en 2021.
Crédit photographique :
José É milio Pacheco

Genre : nouvelles
Traduction de l’espagnol (Mexique) et présentation de Bruno Lecat
Préface de Vilma Fuentes
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 296
Prix : 24 €
ISBN : 978-2-487558-05-2

Ce grand écrivain mexicain (1939-2014) n’a pas la place en France que son œuvre devrait avoir. Poète, romancier, traducteur, professeur, scénariste et journaliste, contemporain de Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Sergio Pitol ou Mario Vargas Llosa, seules les Éditions de la Différence ont publié quelquesunes de ses œuvres, Batailles dans le désert (1987, 2 e ed. 1998, 3e ed. 2009), Tu mourras ailleurs (1988, 2e éd., 1991, 3e éd. 2009), La Lune décapitée (1991), Le Passé est un aquarium (1991). Son œuvre a été récompensée par de nombreux prix, le prix Octavio Paz en 2003, Pablo Neruda et Alfonso Reyes en 2004, Cervantes et Reina Sofia en 2009.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com
Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr


Le Sang de Méduse réunit des textes publiés au Mexique de 1956 à 1984. Les thèmes qui irriguent ces contes ou nouvelles puisent leur source pour partie dans les mythes de la culture européenne (Persée, Méduse, Pygmalion), pour partie dans les guerres (de celles d’Alexandre au deuxième conflit mondial) comme dans les grandes figures de sa littérature : Shakespeare, Dante, l’ingénieux Hidalgo et Sancho Panza, Poirot, Maigret, Swift. L’histoire du continent américain est aussi très présente (cf. « L’Assassinat de Lincoln »), la menace nucléaire, la guerre froide comme la ville de Mexico. Le récit historique est étroitement tissé avec la fiction et est traversé par l’idée borgésienne qu’un lieu, un personnage ou un instant est à la fois tous les lieux, toutes les personnes et tous les instants. Il opère un montage des récits qui rapproche des espaces-temps éloignés pour écrire une autre histoire de la cruauté, qui s’incarne dans des personnages, historiques ou inconnus, et rend présente l’ubiquité du mal ou les boucles de l’Histoire. Le couple éternel du bourreau et de la victime mis en scène prend des formes diverses : bourreau de l’Inquisition, tortionnaire d’un régime autoritaire que la victime rencontre par hasard, bourreau ordinaire qu’est l’épouse acariâtre, avatar de la Gorgone.
Les contes sont concis, oscillent entre réalisme et fantastique et enchantent le lecteur en le déstabilisant.
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Téléphone : 06 62 68 55 13
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip
© Fernando Aceves, 2009
Couverture : Adrien Aymard.
Suivi de fabrication : Alice Rousseau.
© Éditions du Canoë, Bourg-sur-Gironde, 2025.
José Emilio Pacheco Le Sang de Méduse
Traduction de l’espagnol (Mexique) par Bruno Lecat
Extrait En librairie le 4 avril

Éditions du Canoë
TRIPTYQUE DU CHAT
1. Biographie du chat
La Genèse passe cela sous silence, mais le chat a dû être le premier animal sur terre, le noyau à l’origine de toutes les espèces. Durant l’un de ses passages sur la planète fumante, le chat inventa les êtres humains. Il avait l’intention de nous créer à son image et à sa ressemblance. Une erreur inconnue le poussa à créer des chats imparfaits. Si l’on pouvait prouver que nous descendons du chat, il serait indispensable de réorganiser les sciences. Cela est trop inconfortable pour les savants ; c’est pourquoi ils préfèrent ne pas faire de recherches sur nos origines.
Au cours des siècles, pour compenser tant d’inconvénients, nous avons appris à parler. Le chat, en revanche, demeura enfermé dans la prison de ses sens. Néanmoins, il polit son intelligence et sa sagesse. Quelques religions primitives le divinisèrent. Au Moyen Âge, on lui attribua des pouvoirs maléfiques et
des pactes surnaturels. On le poursuivit au prétexte qu’il participait à des sabbats, en compagnie de démons et de sorcières. De nos jours, c’est un animal domestique qui s’est répandu dans le monde entier. Il fait partie de la famille. On lui témoigne le respect et la méfiance qu’inspire tout être supérieur.
Ceux qui l’aiment et ceux qui le détestent s’accordent à le doter d’attributs extraordinaires : posséder sept vies, annoncer des malheurs s’il est noir, et un nombre infini de choses, qui ne l’affectent pas : sa personnalité est hermétique à l’opinion des autres. Il reste le même chat, adoré des Égyptiens, ou victime de l’ignorance et de la sauvagerie en des époques noires comme la nôtre. Hier comme aujourd’hui, il résiste aux regards de séduction ou de défi : il ne cille devant personne.
Supposer qu’il est membre d’une famille couronnée par le tigre, c’est le calomnier. Le tigre est un chat abêti par la férocité, un agrandissement inutile, inférieur à la synthèse et à l’harmonie de son modèle. On croit l’avoir asservi parce qu’il est à nos pieds. Néanmoins, comme ce monde est un miroir où nous voyons tout inversé, le chat se situe bien au-dessus de nous dans la dimension de la vérité. Nous partageons quelques ressemblances. Ainsi, le courtisan copie les stratagèmes du chat et nous imitons tous son ingratitude. Nous ne remercions
jamais et nous cessons tous de ronronner dès que nous avons obtenu gain de cause.
Qu’il chasse les oiseaux à l’Alameda1 de Mexico ou qu’il pullule en nombre infini dans les ruines romaines, le chat est paresseux le jour et bourreau implacable la nuit. À la différence des autres animaux, pour le chat la vie est un songe. Il passe les deux tiers de son existence à dormir et, à en juger par ses mouvements, il rêve, tout comme nous, d’intrigues fantastiques et réalistes. Il aime être caressé mais en pleine idylle a l’habitude de planter ses griffes dans la personne qui le dorlote. Il vit en se léchant, pour s’adorer lui-même, garder une apparence soignée et se protéger des changements de climat. Il déteste ses excréments et fait l’impossible pour les cacher. Il vénère le lieu où il est né, où il a grandi. En revanche les personnes de son entourage ne parviennent à lui inspirer dans le meilleur des cas qu’une tolérance méprisante.
Seigneur tyrannique du monde qu’il parvient à percevoir par ses yeux phosphorescents et ses moustaches sensibles, on est terrifié de le voir torturer une souris. Cette volupté à faire le mal, ce désir de se sentir
1. Jardin public créé au xvie siècle par les Espagnols, dans le centre historique de la ville de Mexico. (N.B. : toutes les notes sont du traducteur).
supérieur, constituent la part sombre et abominable du chat, et le trait le plus humain qu’on puisse retrouver en lui.
Solitaire, introverti, généralement hypocondriaque, rien d’autre que lui-même ne l’intéresse. Il hait les autres chats et les quelques animaux qui l’entourent, particulièrement le chien, son bourreau. (Le chien est tout le contraire du chat et nourrit contre lui une rancœur inextinguible). Il ne réfrène pas ses désirs, mais n’en est pas prisonnier. Il laisse aux hommes l’esclavage de l’obsession.
Mâle, c’est le père absent par excellence. Femelle, elle prend toujours l’initiative et choisit parmi les rivaux celui qui sera le plus digne de la féconder. Son plaisir dure quelques secondes et s’entoure de férocité et de douleur. Sa discrétion la conduit à se cacher pour mettre bas. Elle se soucie de sa mise bas comme si elle avait étudié la médecine. Dans la semaine qui suit la naissance, elle se comporte en mère exemplaire. Elle entraîne les chatons aveugles et sourds à toutes les manières de survivre, puis elle leur apprend à chasser.
Dès que les petits peuvent se débrouiller tout seuls, elle ne s’occupe plus d’eux. Le chat a inventé l’existentialisme : pour lui, tout moment représente un choix. À force de méditer vingt-quatre heures sur vingt-quatre
sur l’absurdité et la vacuité de tout, il ne s’attache qu’à l’instant vécu. Nous ne saurons jamais ce que pense le chat de ce monde si mal fait et des êtres avec qui il passe du temps bien malgré lui. Vaine tâche que celle d’étudier le mystère du chat, énigme insoluble, masque à travers lequel il nous considère et nous juge, chose que nous ne soupçonnons même pas.
2. Le chat dans la nuit
La nuit se répand sur la terrasse : couche nuptiale et champ de bataille. Les chats se hérissent sous l’effet de ce qu’ils pensent être la passion, mais en réalité seul l’accomplissement du devoir les a menés ici : se préserver au-delà de l’éphémère individu, se multiplier en nouveaux êtres. La femelle en chaleur convoque les mâles. Chacun d’eux urine pour marquer son territoire. Au milieu de ces seigneuries provisoires, la chatte choisit un espace particulier. Les chats l’entourent et luttent pour le privilège de la posséder.
Quand les ennemis admettent leur défaite et s’éloignent, le vainqueur s’approche de la reine. Elle gronde, sort les griffes, roule au sol, se lève, frotte la tête contre le mur ou un pot de fleur. Elle se laisse à nouveau tomber par terre, ronronne, lève et baisse les pattes.
Enfin, elle accepte la consommation. Le chat la tient, la mord, la pénètre. Quelques secondes après, la femelle miaule et expulse le sexe blessant qui lui fait mal en se retirant. Alors elle se roule par terre, lèche son pelage et repousse d’un coup de patte le chat qui veut répéter l’opération. Un autre, puis un autre, un autre encore prennent sa place. Enfin, la reine est satisfaite. Les chats n’embellissent pas de jolis mots le fait que l’existence n’a d’autre sens que de perpétuer l’espèce. Ils nous humilient en ramenant tout aux questions essentielles : le coït et la guerre. Le reste de la vie n’est constitué que d’intermédiaires entre ces activités fondamentales. Personne ne veut l’accepter. C’est là l’origine de la haine que suscitent les chats.
Un chat se hérisse, se cambre, mastique la solitude, la polit de sa langue râpeuse et la recrache. Ses miaulements implorent la pitié dans le désert de ce monde. Mais la lumière éteint l’éclat de tant d’yeux nocturnes. La société secrète se débande. Le jour emporte la lune et l’amour. Si elle les retrouve en vie, la nuit prochaine contemplera à nouveau la cérémonie érotique.
De futurs chats sont en germe dans leur ventre. Pour le moment, les uns et les autres veulent juste dormir sur des couches de soie, dans des boîtes en carton, ou sur une serpillière ; être caressés, avoir du lait, des
morceaux de viande ; être un objet de curiosité, de vénération, de crainte. Ils seront des chats quelques heures durant et se transformeront à nouveau en bêtes comme nous. Quand le dernier chat s’en va, l’étoile du matin s’évanouit.
3. Les trois pattes du chat
L’enfance d’Angelito2 s’écoulait sans privations. Être le fils de don Santiago Bonilla assurait son avenir. Il était sur le point de fêter ses huit ans, attristé parce qu’en les fêtant, il entrerait à l’école et perdrait ses privilèges d’enfant gâté. Le monde d’Angelito était réglé par sa mère, une jeune femme riche qui n’avait pas eu l’opportunité de s’instruire. Par commodité, la famille la maria avec Bonilla, un homme très âgé. La naissance d’Angelito lui interdit d’avoir d’autres enfants. Son amour maternel s’épancha dans l’excès et l’asphyxie.
Un après-midi, sur le trottoir en face de la maison, Angelito jouait aux billes avec ses amis.
« Je t’échange deux billes contre ton calot, proposa l’un d’eux.
Je ne peux pas : mon papa me l’a rapporté de Mexico.
2. « Petit ange ».
Alors, tu me laisses voir ton cheval en bois ?
Non, je l’ai rangé. »
On lui offrait toutes sortes de jouets. Ils le divertissaient un moment, puis on les montait vite au grenier.
« Angelito, je peux avoir un verre d’eau ?
— Ma maman ne veut pas que tu rentres chez moi. »
Fatigué de l’égoïsme d’Angelito, Artemio, qui avait déjà douze ans, lui dit : « Ce que tu peux être égoïste, juste parce que t’es riche. Mais ne cherche pas trois pattes au chat3, sinon tu vas voir. »
Angelito courut informer sa mère qu’Artemio venait de l’insulter. José, le domestique, alla punir l’impertinent.
L’enfant se leva et s’approcha du chevet de sa mère.
« Maman…
Qu’est-ce que tu veux, mon petit ? Pourquoi estu réveillé ? Si tu ne dors pas, tu vas tomber malade.
Maman, je veux un chat à trois pattes.
Mais, mon chéri, c’est impossible : tous les chats ont quatre pattes.
3. Proverbe espagnol du xviie siècle, qui signifie « chercher les difficultés, rendre les choses compliquées ». L’équivalent français était : « chercher cinq pieds en un mouton ». On a gardé ici « le chat » pour respecter la logique narrative.
Moi j’en veux un à trois pattes.
— Bon, il faudrait juste couper une patte à Cléo », répondit la mère sans y penser.
Angelito retourna dans son lit et ne tarda pas à s’endormir. Le lendemain, le caprice semblait oublié jusqu’à ce que, vers onze heures du matin, quand l’enfant jouait dans le salon, la chatte blanche, cadeau de sa grandmère, fasse son entrée d’un pas timide. Angelito sortit en courant dès qu’il l’aperçut. « Elle est là. Coupe-lui la patte.
Mon amour, tu ne vois pas que si on lui coupe la patte elle ne pourra plus marcher ?
Je m’en fiche. Je veux un chat à trois pattes. Si tu ne me fais pas plaisir, j’en mourrai. »
Angelito monta l’escalier à toute vitesse et se jeta sur son lit. La mère, angoissée, le suivit. « Qu’est-ce qui t’arrive, mon cœur ? Vite, Susana, apporte-moi l’eau de Floride, le petit se sent mal. »
Il leva un visage déformé par les pleurs : « Tu ne m’aimes pas, n’est-ce pas ?
Mon trésor, comment peux-tu dire ça ?
Parce que tu ne fais pas ce que je te demande.
D’accord, mais attendons ton petit papa pour qu’on lui demande l’autorisation et qu’il ne se mette pas en colère. »
12 13
Comme l’horloge du salon sonnait trois heures, monsieur Bonilla rentra chez lui. Pendant quelques minutes, ils déjeunèrent en silence. Enfin le père demanda : « Qu’est-ce qu’il a, ce petit ? Pourquoi boude-t-il ?
Tu ne vas pas me croire : c’est que… Non, il vaut mieux que je ne te dise rien.
Dis-moi de quoi il s’agit, je trouverai une solution si c’est possible.
Angelito a pleuré toute la journée, car il voudrait un chat à trois pattes. Tu crois qu’on peut lui faire plaisir ? »
Monsieur Bonilla frappa sur la table : « Tu es folle ? C’est ce que tu apprends à ton fils ? Tu es un monstre de cruauté. Ça ne te suffit pas, le mal que tu as fait à ce pauvre animal en noyant ses petits ? Elle ne sentirait rien parce que c’est une chatte ? Et toi, file. À partir de maintenant, tu vas voir ce que c’est d’avoir un père. »
Angelito monta au premier étage en larmes. Sa mère, cachée dans la cuisine, vit monsieur Bonilla se lever et sortir. Une demi-heure se passa dans le calme. Soudain on entendit les hurlements d’Angelito. La mère, la servante et le domestique accoururent pour voir ce qui se passait. Ils trouvèrent l’enfant qui étouffait dans ses larmes, le visage en sang : « La chat… te… m’… m’a griffé…
Maintenant, il va voir, ce maudit animal », dit la mère en colère. Elle se dirigea vers la boîte à couture où dormait Cléopâtre. La chatte sentit le danger : elle fit le gros dos et ses poils se hérissèrent. Angelito sourit quand il vit sa mère prendre Cléopâtre par le ventre. Mais il fut vite horrifié de voir le coup de griffe que donna la chatte pour se défendre, atteignant la mère à la paupière, avant de sauter et se perdre dans le couloir.
« Cette sale bête m’a arraché un œil.
Ce n’est rien, madame. Juste une égratignure, dit Susana.
Apportez-moi de l’iode et un linge propre. José, occupe-toi de cette bête féroce. Angelito, tu vas l’avoir, ton chat à trois pattes.
Madame, par la Vierge du Carmen, vous savez que pour moi vos désirs sont des ordres, mais ne me demandez pas de tuer un chat, car cela apporte sept ans de malheurs. Mon amie en a étranglé un et peu après tous ses enfants sont morts.
Il ne s’agit pas de la tuer : contente-toi de l’attraper et je te récompenserai. »
Cléopâtre s’était réfugiée sur la corniche qui donnait sur le patio. Le domestique s’arma d’un balai et monta à la terrasse, disposé à capturer la chatte. Tandis qu’il s’approchait d’elle en silence, Cléopâtre s’avança
14 15
un peu plus sur la corniche. José voulut la suivre. Les vieilles pierres s’écroulèrent, et l’homme alla s’écraser sur le sol en ciment.
« Madame ! cria Susana, il est tombé, il saigne beaucoup. » La mère et Angelito se penchèrent vers le patio et rentrèrent aussitôt dans la maison. Choqué d’avoir vu la mort pour la première fois, Angelito criait encore plus fort. Sa mère s’inquiétait à la pensée que la blessure pût s’infecter. Tandis que José agonisait avec la seule Susana à ses côtés, Cléopâtre se mettait à l’abri, et dans ses yeux brillaient le triomphe et la satisfaction de voir tracées dans la poussière les quatre empreintes de ses pattes.
Julio Le Parc

Genre : conte
Version bilingue
Traduit de l’espagnol (Argentine) par C. L. avec une préface de Olivier Salon et le texte original au verso
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 120
Prix : 14 €
ISBN : 978 - 2-490251-95-7

Julio Le Parc est l’auteur d’une œuvre immense dans le domaine des arts plastiques. Les É ditions du Canoë ont publié en collaboration avec Exils la grande monographie sur son parcours plastique avec quantité d’illustrations de ses mobiles, de ses peintures et du long travail de recherche qu’il a mené durant toute sa vie, en Argentine d’abord, et ensuite en France où il réside depuis 1958.On ne compte plus les prix et les récompenses qui ont salué son immense talent partout dans le monde. On le connaît moins comme écrivain en dépit de la publication du livre Sois artiste et tais-toi publié chez Exils en co-édition avec Le Canoë où sont rassemblés ses contributions critiques, ses textes de ré exion et quelques-uns de ses poèmes.
La publication de El Viscacha en espagnol d’un côté et en français de l’autre – Le Viscache – est un événement car elle dévoile un autre aspect du talent multiforme du grand artiste qu’est Julio Le Parc, celui de conteur.
Julio Le Parc a aussi dessiné le logo du Canoë.


Deux gamins, Juan et Pedro, veulent participer à un concours d’écriture d’un conte. Qui peut leur expliquer les règles de composition, ce qu’il convient de faire et surtout d’éviter ? C’est alors que leur vient l’idée d’aller voir celui qu’on nomme du sobriquet « le Viscache ». Qu’est-ce qu’un viscache ? Un rongeur de taille moyenne de plusieurs espèces di érentes. Le mot vient du peuple Quechua qui habite dans cinq pays d’Amérique du Sud (la Colombie, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie et l’Argentine). Celui qui est a ublé de ce nom s’appelait autrefois Juan Monteagudo mais personne ne se souvient de son nom. On sait qu’il a été marionnettiste, qu’il a joué dans un cirque, qu’il a été forain mais aujourd’hui il vit isolé dans une cabane et, généralement, les enfants se moquent de lui… Dans la grande tradition de Jorge Luis Borges ou de Juan Rulfo, ce conte entre rêve et cauchemar est une merveille.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre
Téléphone : 06 62 68 55 13
Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde
75006 Paris c/o Galerie Exils
Couverture : Adrien Aymard.
Suivi de fabrication : Alice Rousseau.
© Éditions du Canoë, Bourg-sur-Gironde, 2025.
Julio Le Parc Le Viscache
Extrait
En librairie le 4 avril 2025

Éditions du Canoë
Je ne me rappelle plus comment j’ai découvert qu’on organisait un concours de contes. C’était peut-être par mon très cher ami d’enfance, Pedrito, qui a une sœur, qui a elle-même une amie et cette amie a une copine cubaine dont le nom est Ana Iris. Je crois que c’est de là que l’information m’est venue car dans le petit cercle de mes camarades on savait que j’avais un goût pour l’écriture. En vérité, je ne m’étais livré, si l’on peut dire, qu’à quelques gribouillis avec l’alphabet. Mais le fait qu’ils avaient pensé que cette annonce pouvait m’intéresser me stimulait. De là à avoir la capacité d’écrire un conte, il y avait de la marge.
D’abord, tirer au clair ce qui était demandé : les feuillets. Deux lignes de blanc. La structure du conte. Devait-elle être linéaire : début, développement, fin ? Fallait-il qu’il maintienne le suspense pour que le lecteur aille jusqu’au bout ? Devait-il être comme ceux que racontent les grand-mères ou une chose hermétique ?
Avec beaucoup ou peu de personnages ? Avec des morts pour le rendre plus captivant ? Champêtre ou citadin ? Raconté à la première personne ou par la voix d’un narrateur ?
Tous ces doutes et beaucoup d’autres n’ont pas diminué mon enthousiasme. J’ai fait de Pedrito mon confident et mon complice. Après d’innombrables élucubrations, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y aurait du bon à consulter le Viscache.
Le Viscache est un homme mûr ayant l’aspect d’un vieillard qui vit très isolé dans une cabane qu’il a luimême construite. Le Viscache n’est pas un illettré. Il avait en d’autres temps des prétentions d’écrivain. À une époque, il était marchand ambulant et, à l’occasion, il écrivait des lettres, surtout des lettres d’amour, sur les marchés du dimanche. Il s’appropriait trois cageots sur le marché, il en utilisait un pour s’asseoir et les deux autres comme bureau, avec un carton sur le dessus sur lequel étaient posés un encrier avec une plume, du papier blanc et une petite pancarte qui disait : « J’écris des lettres. » Lettres qui, pour la plupart, étaient le produit de son imagination. C’est de là que remonte sa réputation d’« écrivain ».
En réalité, le Viscache s’appelle Juan Monteagudo. Le surnom de Viscache est venu d’un comique
globe-trotteur argentin arrivé un jour par hasard au village qui s’était exclamé en le voyant : « Pardi, camarades, voici le vieux Viscache ! » Et c’est ainsi que le surnom lui est resté.
De ce jour-là, plus personne ne l’appellerait Juan. Ce surnom s’était imposé à l’Argentin en souvenir du très curieux personnage du célèbre poème Martin Fierro, parce que le Viscache était un peu déjeté – il avait laissé pousser ses cheveux et sa barbe – et toute sa personne était d’un gris de cendre. Les gens ont commencé à l’appeler simplement : le Viscache.
On y va, on y va, nous sommes-nous dit, et on y est allés.
Le Viscache nous a regardés avec étonnement quand nous sommes arrivés à sa cabane parce qu’en général les enfants et les jeunes se moquaient tout le temps de lui. En un rien de temps, il nous a instruits sur les feuillets, les lignes de blanc, les espaces. Ce qui est curieux, c’est que nous avons vu sur des étagères de vieux bois des cahiers jaunis. Mon regard a croisé celui de Pedrito et j’ai immédiatement distrait le Viscache pour que Pedro puisse soustraire trois cahiers. Pendant que mon ami volait, le Viscache me disait qu’il était étonné que nous ne soyons pas venus le voir pour nous moquer de lui et que notre visite avait donné une
couleur différente à cette journée. Il était habitué à un train-train mortifère et pensait que, dans l’au-delà, parmi l’infini des jours, ses jours passeraient divers et variés, en imaginant surtout, qu’il pourrait choisir et changer de personnalité.
Nous avons vu deux couteaux et une petite table dont il se servait pour cuisiner et manger. L’un de ces couteaux était assez grand. Nous avons vu aussi sur le sol, dans un coin juste en dessous de l’unique poutre de sa cabane, une longue corde. Il nous était impossible de prendre le grand couteau et la corde longue et épaisse. Nous avons pensé qu’à une autre occasion nous pourrions peut être enlever de sa cabane ces objets de mauvais augure.
Nous avons donné au Viscache un Maté nouveau et un kilo d’herbe que nous avions apporté pour le remercier de son éventuelle collaboration. Nous sommes alors partis avec notre petit larcin, bien décidés à en profiter.
Comme nous nous dirigions vers le centre, nous avons été surpris de voir un groupe de gens qui, derrière de grandes fenêtres ouvertes, écoutait quelqu’un avec une très grande attention. Nous sommes entrés dans une vaste cour et, sans aucune difficulté, dans la salle de conférence. Nous nous sommes rendu compte
que ce bâtiment abritait l’Orchestre symphonique des jeunes de la ville. Nous étions surpris par les gestes du conférencier.
Le conférencier était, en réalité, un jeune chef d’orchestre qui avait la particularité d’avoir abandonné sa baguette de chef. Il expliquait comment on pouvait diriger un orchestre sans baguette. « Il n’est pas obligatoire, disait-il, de diriger un orchestre avec une baguette. La musique peut être dirigée de façon plus expressive, avec son propre corps, en mouvant le torse, en mouvant les bras, en mouvant les jambes, en mouvant la tête, avec les expressions du visage, en laissant parler les doigts de toutes les manières, sauf une qui consiste à lever l’index, surtout celui de la main droite et prétendre diriger ainsi. » Il expliquait que l’index dressé remplaçait inconsciemment la baguette. Pour lui, c’était comme une trahison à la modernité.
Nous nous sommes regardés, Pedro et moi, et nous nous sommes dit en écoutant ce qu’il disait que cela pourrait faire partie d’un conte dans le monde de la musique. Nous avons gardé l’idée en réserve, sachant que nous ne savions même pas gratter une guitare.
Rentrés tard à la maison, nous avons convenu, Pedrito et moi, de nous revoir le lendemain pour
déchiffrer les trois cahiers du Viscache. Puis, je suis allé dormir en me disant que peut-être les rêves m’apporteraient le début d’un conte.
Le lendemain, j’ai inscrit sur une feuille de papier une série de mots provenant de mon rêve : crocodile vieille femme baguette magique poussiéreuse homme avec moustache et chapeau noir une fille au loin fumée de train
la corde du Viscache
une nuit qui ne se termine jamais
une source sans eau le bois qui s’éloigne du village la monotonie quotidienne faux desserts aux fruits le mouchoir de Margarita (personne que nous rencontrerons peut-être un jour) chaussure de boiteux filou au visage d’ange lapin toujours en vie
fenêtre sans lumière miroir sans reflet
image de mariée perdue affaires poussiéreuses
verdict du juge ombre révélatrice chemin sans retour
collection mémoires n°3

18 € / 128 p. / 14 x 20,5 cm tirage : 1500 ex. parution : juin 2025 isbn : 978-2-493324-12-2
• une ode à la mémoire, la transmission, et l’identité, à travers le récit de plusieurs générations
• une prose poétique ciselée, illustrée par des photographies d’époque
• une traduction magistrale et inédite en français par la poétesse patricia houéfa grange

une biographie familiale intense à travers l’histoire des états-unis, de la traite des esclaves jusqu’aux années soixante dix : une mémoire des femmes du peuple dahomey à travers les récits entremêlés d’un père et de sa fille.
« Je regarde mon mari et mes enfants, et je sens les femmes du Dahomey se rassembler dans mes os. »
Ce récit hautement poétique retrace l’histoire d’une famille africaine-américaine, la famille Sayles : Caroline, « née parmi les Dahoméens en 1822 », quitte la NouvelleOrléans pour la Virginie en 1830, à l’âge de huit ans ; Lucy, la première femme noire à être pendue en Virginie ; et Gene, né avec un bras atrophié, fils de la grand-mère de l’autrice... Entremêlant la voix du père à la sienne, la narration chorale, richement documentée par des photographies d’époque, nous entraîne dans une histoire familiale marquée par les luttes et la résilience.
Lucille Clifton (1936-2010)
Lucille Clifton, née Thelma Lucille Sayles dans l’État de New York, est une poétesse, écrivaine et enseignante. Respectée et prolifique, son œuvre traite de l’expérience (féminine) africaine-américaine et de la vie de famille ; elle aborde particulièrement les thèmes de la persévérance et de la force face à l’adversité et à la violence, ainsi que de l’héritage de l’esclavage. Finaliste à deux reprises du Prix Pullitzer de poésie, son recueil Blessing the Boats est lauréat du National Book Award (2000).
À ce jour, ses écrits ne sont pas traduits en français.

À propos de Générations de Lucille Clifton (1976)
« Impressionnant - honnête, clairvoyant avec une forme naturelle aux poètes... Outre la facilité et l’intimité de la poésie de Clifton, Generations parle à, pour et à partir de vies fictives et posthumes - Moses, Medgar, Evers, Amazons, Bob Marley, la Belle au Bois Dormant, etc. Elle est à l’aise et connaît les morts... Lucille est un autre symbole de la lumière, qui est l’âme de l’illumination. Et elle le savait. »
-Toni Morrison
« Quel est notre rapport à l’histoire ? Nous appartient-elle ou bien est-ce nous qui lui appartenons ? Sommes-nous en elle ? Nous traverse-t-elle, se déverse-t-elle comme de l’eau ou du sang ? »
-Tracy K. Smith (poétesse américaine et préfacière de Generations)

«Qui se souvient des noms des esclaves ? Seulement les enfants des esclaves. Ils s’appellent Caroline, Lucy et Samuel. Des noms d’esclaves.

CAROLINE AND SON
She said

I saw your notice in the Bedford newspaper and I thought isn’t this interesting, so I figured I would call you and tell you that I am a Sale and I have compiled and privately printed a history of the Sale/Sayle family of Bedford County Virginia and I would be glad to send it to you. But why are you interested in the Sayles?
Her voice is sweet and white over the wires. What shall I say to this white lady? What does it matter now that Daddy is dead and I am a Clifton?
Have you ever heard of a man named John F. Sale? I ask.
Why yes, he was a great-uncle of mine, I believe. She is happy and excited. Well, my maiden name was Sayles, I say.
What was your father’s name? she asks. She is jumping through the wires. Samuel, I say.
She is puzzled. I don’t remember that name, she says.
Who remembers the names of the slaves? Only the children of slaves. The names are Caroline and Lucy and Samuel, I say. Slave names. Ooooh, she cries. Oh that’s just awful. And there is silence. Then she tells me that the slave cabins are still there at the Sale home where she lives, and the graves of the slaves are there, unmarked. The graves of my family. She remembers the name Caroline, she says, her parents were delivered by the midwife, Mammy Caroline. The midwife Mammy Caroline. Is the Nichols house still there? I ask.
Still with the family in it, she says. I hear the trouble in her voice. And I rush to reassure her. Why? Is it in my blood to reassure this thin-voiced white lady? I am a Clifton now, I say. I only wanted to find out about these things. I am only curious, I say. It’s a long time after, and I just wanted to know. I can help you, she sighs. I can help you. But I never hear her voice again. [...] Extrait de Générations de Lucille Clifton (1976)

Le mot de la traductrice, Patricia Houéfa Grange « J'ai été happée par Generations, A memoir (1976) que j'ai lu d'une traite.
C'est un livre d'une centaine de pages dont l'écriture a été déclenchée par l'annonce du décès du père de Lucille Clifton, mais qu'elle commence en évoquant un appel téléphonique avec une héritière de ce qui fut la plantation où son arrière-grand-mère a été esclave... À partir de là, la voix de Lucille alterne avec celle du père : les souvenirs s’ entremêlent partant de l’histoire de l'arrièregrand-mère de Lucille, l’ ancêtre magnifique : "Mammy Ca'line". Cette dernière répétait régulièrement qu'elle était une femme du Dahomey, et ce "You are from Dahomey women" revient régulièrement dans la bouche du père quand il s'adresse à sa fille Lucille.
À travers l'histoire de la famille, on traverse aussi l' histoire des Etats-Unis évidemment.
On ne peut pas rester indifférent·e face à ce texte court, intense, et qui réclame d’ être lu et relu, en le laissant infuser/décanter lentement.
Chair de poule et frissons ! »

• le roman inédit en france d’une écrivaine pluridisciplinaire
• un « chant-roman » poignant
• récompensé par le prix noma en 2005
• préface de la romancière hemley Boum
• illustration de couverture de magali attiogBé
La Mémoire amputée

un « chant-roman » sur une lignée de femmes Bassa, au cameroun une histoire Âpre etfascinante, céléBrantlapuissance créatrice des femmes
Ce « chant-roman », terme inventé par Werewere Liking, est l’histoire de l’autrice : une histoire âpre, violente, fascinante, célébrant la puissance créatrice des femmes.
C’est un récit initiatique poignant, l’histoire d’Halla Njoké, chanteuse-artiste camerounaise, et à travers elle, l’histoire de ses mères et de ses tantes : une féminité plurielle aux contours vastes comme l’Afrique, détentrice d’une mémoire « amputée ».
Le livre commence alors qu’Halla est déjà vieille. Elle a pour projet d’écrire la vie de Tante Roz, femme admirable et généreuse : résistante au moment des guerres d’indépendance, ayant eu mille enfants dont aucun n’est pourtant sorti de son ventre. Tante Roz se refuse cependant à lui livrer ses souvenirs. Ainsi commence l’incursion d’Halla dans sa propre mémoire, afin de livrer, en miroir de sa vie chaotique, celles de toutes les femmes de sa lignée...
Werewere Liking
une écrivaine et une artiste multidimensionnelle (1950 -)
Née en 1950 à Bondè, au Cameroun, Werewere Liking est une écrivaine prolixe en plus d’être une artiste pluridisciplinaire : peintre, chanteuse, chorégraphe et dramaturge. Installée en Côte d’Ivoire, elle fonde le village Ki-Yi M’bock en 1985, un centre dont la vocation est de former des jeunes aux métiers artistiques. Elle réside encore actuellement à Abidjan. Son œuvre tout entière s’inscrit dans un mouvement en faveur de la renaissance des arts en Afrique et d’une reconnaissance des cultures du monde noir.
prix : 24 €
tirage : 1000 ex.
parution : 04/06/2022
format : 14 x 20,5 cm
pagination : 420 p.
ISBN : 978-2-493324-01-6


Au sujet de La Mémoire amputée...
« Finalement, le seul résumé de ce texte pour moi est dans son titre. Ce sont des miettes d’une « mémoire amputée », des bouts recollés à l’envers et à l’endroit dans la pure logique de « l’Absurde » que vit l’Afrique dans son histoire tronquée, muselée. La mémoire d’une fillette devenue femme sans savoir quand, pourquoi ni comment. L’histoire d’une femme devenue un symbole, par la force du destin, au-delà des choix. L’histoire d’une Afrique à qui l’on a volé la virginité et la maturité. » Michelle Mielly, préfacière de l’édition originale
« La Mémoire amputée est « un chant pour toutes les femmes qui se sont tues », un chant qui entend arracher au passé « quelques bribes de notre Histoire sans archive » comme le dit [l’une des protagonistes]. « Nous avions dû choisir l’oubli comme un système de survie, un secret de vie, un art de vivre, ajoute-t-elle, mais le temps du silence est révolu. Le moment est venu de rendre à l’Afrique son Histoire et d’y inscrire la contribution des Mères Naja et des Tantes Roz dont la mémoire du continent a été amputée. Hélas, poursuit la narratrice, j’entends un requiem lourd et traînant sur les pas des hommes déshumanisés, qui s’entredéchirent... et je crains un plus grand écrasement des femmes, mes filles, si toutes les Tantes Roz venaient complètement à disparaître, avec nos mémoires amputées, trouées. »
Un grand livre vivement recommandé. » Jean-Marie Volet, universitaire
WEREWERE LIKING, « ARTISTE ET ÉVEILLEUSE D’ÉTOILES »
Le Point, 25/06/2010
« Dramaturge, chorégraphe, la flamboyante Werewere Liking se veut d’abord « éveilleuse d’étoiles » : fondatrice il y a 25 ans du village Ki-Yi, à Abidjan, l’artiste aux airs de grande prêtresse voue sa vie à découvrir et guider de jeunes talents. Avec ses parures faites de cauris et de perles, ses longs dreadlocks et son éternelle canne sculptée, Werewere Liking ne passe pas inaperçue.
En 25 ans, le Ki-Yi - « ultime savoir » dans sa langue natale bassa - a formé gratuitement plus de 500 jeunes démunis à la scène, danse, théâtre ou encore musique. »

Un livre au cœur d’un écosystème créatif
hemley Boum, la préfacière

Romancière née en 1973 à Douala, Hemley Boum a publié de nombreux romans : Le clan des femmes (L’Harmattan, 2010), Si d’aimer... (La Cheminante, 2012), Les Maquisards (La Cheminante, 2015) et Les jours viennent et passent (Gallimard, 2019), récompensé du prix Ahmadou-Kourouma en 2020.
magali attiogBé, l’illustratrice (couverture)

Magali Attiogbé est née au Togo et a grandi en France, « les fesses entre deux chaises » comme elle aime le dire. Elle est diplômée de l’école Estienne. Ses assemblages noir et blanc / couleur et de récupérations variées forment une sorte de motif africain à l’européenne. En incrustant motifs dans motifs, elle fait apparaître plusieurs plans de lecture.
adjaratou yerima, la comédienne

Adjaratou Yerima est une comédienne et metteuse en scène togolaise. Elle dirige « Fiôhomé », un centre culturel basé à Lomé qu’elle a fondé avec sa sœur, l’artiste Yasmine Yerima et Michaël G. Todego, régisseur technique. Le centre accueille des spectacles, des compagnies en résidence et organise des ateliers de théâtre dans des villages aux alentours de la capitale.

parution : 3 nov 2023
17 € / 128 p. / 14 x 20,5 cm tirage : 1500 ex.
ISBN : 978-2-493324-04-7

Combien de cœurs
Mémoires d'une femme docteure
le premier roman-mémoires d’une figure de proue de l’émancipation des femmes dans le monde arabe.
Publié en 1957 dans la presse égyptienne, ce premier roman inaugure les convictions qui traversent tous les livres de Nawal El Saadawi, alors âgée de vingt-six ans. Il est considéré comme une oeuvre pionnière dans le féminisme arabe moderne.
Une jeune Égyptienne se heurte aux traditions et à sa famille lorsqu’elle choisit de faire carrière dans la médecine. Refusant de se soumettre à un mari et à tout ce que la société attend d’une femme, elle se coupe les cheveux et travaille avec acharnement dans un dispensaire. Les soins prodigués aux corps et aux âmes de ses patient·es l’amènent à construire les fondements d’une pensée rebelle et libre.
• un roman sur le corps des femmes, le soin, la médecine
• un récit initiatique aux accents autobiographiques
• le premier livre d’une pionnière de l’émancipation des femmes arabes
• traduction : fayza el qasem, universitaire (vit à paris)
• postface : rim battal, poétesse (vit entre paris et marrakech)
• illustratrice : kubra khademi, artiste féministe afghane (vit à paris)
Souvent décrite comme la « Simone de Beauvoir du monde arabe », Nawal El Saadawi était une voix pionnière sur l’identité et le rôle des femmes dans la société, l’égalité des sexes et la place des femmes dans l’islam.
« Nawal El Saadawi, autrice, militante et médecin égyptienne (était) devenue l’emblème de la lutte pour les droits des femmes dans le monde arabe patriarcal et faisait campagne contre les mutilations génitales féminines, qu’elle avait subies à l’âge de 6 ans. » alan cowel
Hommage dans le New York Times
Nawal El Saadawi (1931-2021)

Psychiatre de formation, militante féministe emprisonnée et contrainte à l’exil, écrivaine prolifique plusieurs fois censurée, Nawal El Saadawi est une figure égyptienne majeure de l’émancipation des femmes du monde arabe. D’elle, qui a osé parler la première des corps féminins et de sexualité, qui a dénoncé l’excision, le port forcé du voile et la violence de la société patriarcale, Margaret
Atwood a dit :
« À une époque où personne n’en parlait, [Nawal El Saadawi] a exprimé l’indicible. »
L’illustratrice : Kubra Khademi

Kubra Khademi, née en 1989 à Kaboul, est une artiste féministe afghane, peintre, plasticienne et performeuse, réfugiée à Paris.
Kubra Khademi étudie les beauxarts à l’université de Kaboul avant de fréquenter l’université nationale Beaconhouse à Lahore, au Pakistan.
Ses performances publiques répondent activement à une société dominée par une politique patriarcale extrême.
Après avoir présenté sa pièce Armor en 2015, Khademi est contrainte de fuir l’Afghanistan en raison d’une fatwa et de menaces de mort.
Aujourd’hui réfugiée à Paris, Kubra Khademi est décorée du grade de chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture français.
La traduction : Fayza el Qasem

Fayza El Qasem a été directrice de l’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT).
Professeure émérite de la Sorbonne Nouvelle, en charge de l’enseignement de la traduction générale et de la traduction économique et financière vers l’arabe, elle dirige plusieurs thèses de doctorat en traductologie.
La préfacière : Rim Battal

Rim Battal, née en 1987 à Casablanca, au Maroc, est une artiste, poétesse et journaliste marocaine francophone. Elle vit actuellement entre Paris et Marrakech.
Ses performances associent poésie, écriture et arts visuels. Elle est notamment l’autrice de L’Eau du bain (SuperNova) et Les quatrains de l’all inclusive (Le Castor Astral).
Elle codirige Le Bordel de la Poésie et a initié La Biennale Intime de Poésies.
« Elle était notre aînée. Celle qui avait montré la voie à des générations de femmes arabes engagées dans la lutte pour l’émancipation.
[...] Toute sa vie, elle la consacrera à s’opposer aux discours de violence physique contre les femmes, leur infériorisation, leur condition de secondes. »
Fawzia Zouari, écrivaine, hommage dans Libération
« Nawal El Saadawi a défié toutes les manifestations patriarcales. Elle n’en a redouté aucune, empruntant des voies scabreuses dans ses écrits, affrontant des combats féroces avec ses mots, brisant de cette manière toutes les chaînes. Ni la peur ni le désespoir ne sont parvenus à la décourager. »
Ranem AL Afifi, journaliste

« Ils m’ont dit : "Vous êtes une femme sauvage et dangereuse." Je dis la vérité.
Et la vérité est sauvage et dangereuse. »
Nawal El Saadawi
Charlotte Bienaimé
Un podcast à soi
Collection Mémoires
L'Oiseau rouge
Mémoires d'une femme dakota





Zitkála-Šá, tour à tour écrivaine, musicienne et activiste pour les droits autochtones, fait le récit personnel d’une vie de femme «sioux» dakotada.

18 € / 128 p. / 14 x 20,5 cm tirage : 1500 ex. parution : 07/06/ 2024
• un texte fondateur du matrimoine littéraire, enfin traduit.
• une écriture de soi au féminin, sensible et combative, au service d’un peuple.
• une écriture poétique, d’une liberté sauvage. itkála-Šá
Écrit entre et 1900-1902, ce livre retrace les mémoires d’une femme autochtone, acculturée par une scolarité chez les missionnaires et son parcours d’émancipation et de lutte. Ce texte intime et politique défend avec force les droits de son peuple et la richesse de sa culture.
«J’étais une petite fille de sept ans particulièrement sauvage. Habillée lâchement d’une tunique de peau de daim, des mocassins souples à mes pieds légers, j’étais libre comme la brise qui jouait avec mes cheveux et aussi vive qu’un cerf bondissant. C’étaient là deux choses qui remplissaient ma mère de fierté : mon tempérament fougueux et ma liberté indomptable. Et ce fut elle qui m’apprit à n’avoir peur de rien [...]»
l’oiseau rouge : un recueil de récits formant la première autobiographie d’une femme sioux, qui résonne comme un cri de fierté et de révolte.
Ce livre rassemble quatre récits publiés dans la revue The Atlantic Monthly en 1900 et 1902. Les articles firent sensation, contrastant avec la propagande colonialiste de l’époque où il s’agissait de « tuer l’Indien et sauver l’homme ». L’autrice y expose également ses croyances spirituelles, bien loin du dogme chrétien imposé dans les réserves.
« ô, mes sœurs, travailleZ à cette fin ; travailleZ ensemble pour que cessent les mauvais traitements infligés à mon peuple dans ce pays »
Zitkála-Šá fait ainsi appel lors du congrès bisannuel de la general fderation of women’s clubs à la notion de sororité, persuadée que les femmes ont un rôle politique à jouer dans les combats des minorités...
Zitkála-Sá (1876-1938)
Zitkála-Šá, dont le nom signifie « Oiseau rouge », naît le 22 février 1876 dans une réserve « Yankton sioux Tribe » du Dakota du Sud. Également connue sous le nom de Gertrude Simmons Bonnin que lui ont donné les missionnaires, elle est une écrivaine, éditrice, musicienne et activiste pour les droits autochtones. Dans ses ouvrages, elle a décrit la difficulté d’être « Amérindienne » dans la société américaine. Elle a également écrit le premier opéra amérindien et elle fut présidente du National Council of American Indians, association militant pour les droits civiques.
Zitkála-Šá a entrepris un grand travail de collecte des contes et légendes de son peuple. Mais elle a également publié des écrits beaucoup plus politiques, sur le traitement des «Amérindiens», sur sa propre expérience et ses combats de jeunesse entre sa culture et la culture blanche dominante qui lui était imposée.
Ses écrits, entre la littérature et l’essai politique, sont très marqués par cette tension entre la tradition et l’assimilation forcée.

L’illustratrice : Hinook-Mahiwi-Kalinaka

Les illustrations et les lettrines qui figurent sur la couverture et la page de titre, sont tirées du travail graphique et typographique de Hinook-Mahiwi-Kalinaka, également connue sous le nom chrétien de Angel De Cora.
Née en 1871, elle était une peintre, graphiste, enseignante et militante pour la cause des Autochtones. Contemporaine de Zitkála-Šá, elle est née dans la réserve de Winnebago, dans le Nebraska, et faisait partie du groupe HoChunk. Comme Zitkála-Šá, elle fut enlevée par des missionnaires pour recevoir une éducation chrétienne, dans le cadre de la politique assimilationniste de l’époque. Elle fit preuve d’un talent exceptionnel pour la peinture et les arts graphiques. À travers son art, elle n’eût de cesse de mettre en valeur les spécificités et les imaginaires foisonnants des Nations autochtones.
La préfacière : Céline Planchou
Céline Planchou est maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à l’université Sorbonne Paris Nord. Son travail porte sur le triangle État fédéral, nations autochtones et États, notamment à travers les politiques de protection de l’enfance, et sur les résurgences autochtones dans les petites villes de l’Ouest américain comme Rapid City. Elle est aussi membre du CSIA-Nitassinan, une assocation française qui soutient les luttes des peuples autochtones dans les Amériques depuis 1978.
La traduction : Marie Chuvin
Marie Chuvin est traductrice littéraire et membre du comité editorial Les Prouesses. Elle a traduit de nombreux romans et articles de presse et a co-fondé la revue «L’Esprit Européen».

Les incontournables à ne pas rater, les réimpressions etc.



































































ROSE2RAGE
par Théophylle Dcx
· Direction éditoriale ..... Emma Fanget et Fanny Lallart
· Graphisme Fanny Lallart
· Collection 39°5
· Format (mm) 140*205
· Nombre de pages.......... 206
· Prix (€) ................................... 14
· ISBN ........................................... 9782493534118
ROSE2RAGE est le deuxième ouvrage de la collection 39°5 des éditions Burn~Août, consacrée à des travaux littéraires queers, féministes, et issus des paroles dites minoritaires.
AVRIL 2023
ÉDITIONS BURN~AOÛT /// ROSE2RAGE

Résumé : Théophylle Dcx dresse sa chronologie personnelle à travers les différents endroits qu’il a habité : son adolescence dans la campagne stéphanoise puis son arrivée à Nice à l’école des Beaux-Arts, où un horizon de découvertes s’ouvre à lui. Nous le suivons au fil de ses fantasmes, accompagnés, tout au long du récit, de ses musiques préférées et de ses danses de survie. Des négociations dans sa maison d’enfance pour écouter Cascada à fond, à l’écoute collective et festive de remix nightcore de la chanson — “Cascada s’écoute à fond ou ne s’écoute pas” — il revendique tout ce qui le constitue aujourd’hui : sa vie à la campagne en tant qu’homosexuel, sa séropositivité, le travail du sexe, ses amours, ses désirs et ses affects. Son livre rend un puissant hommage à son amitié avec Alexandre, son compagnon de vie et de danse, décédé une année plus tôt.
Le premier ouvrage publié était un recueil de poésies de Marl Brun s’intitulant Hot wings and tenders. Tout comme Marl Brun, Théophylle Dcx écrit à la première personne un récit situé et politique. Il adopte un ton direct pour se raconter et laisser apparaître ses affects. Sa narration est ponctuée par des éclats, des expressions percutantes, des slogans intimes qu’il revendique. Il compose le rythme de son texte en utilisant frénétiquement le retour à la ligne, se passant parfois de majuscules ou de ponctuation. Son écriture évoque un besoin urgent de retracer les sentiments, les sensations ; l’auteur fait l’expérience de mettre en mots des histoires d’habitude privées de paroles. Il raconte vite, bien, fort, ce que peut être la vie d’un jeune queer séropo et travailleur du sexe aujourd’hui, les violences qui la traverse tout comme les moments de jouissance qui la rendent si éclatante, faisant de ce texte un précieux geste de partage et d’empowerment. L’écriture dynamique de Théophylle Dcx évoque le langage parlé, d’ailleurs ses textes
Auteurices et ouvrages associés : David Wojnarowicz (artiste homosexuel de la scène underground new-yorkaise), Guillaume Dustan (écrivain et éditeur), Elodie Petit (poétesse et performeuse)
Los putos, Ioshua, éditions Terasses Théophylle Dcx a grandi dans la banlieue rurale de Saint- Étienne et vit aujourd’hui à Marseille. Sa recherche artistique se développe autour d’une pratique d’écriture, de performance et de vidéo. La musique prend une place importante dans son travail, elle raconte des moments partagés qui lui ont permis de se lier aux autres et de se construire à leur contact. Ses textes et ses performances sont un entrelacement de ressentis et d’analyses sociales. Il évoque les intersections entre ses identités et souligne leurs réalités politiques.

Thèmes abordés : Sexualité, homophobie, sérophobie, identités queer, amitié, solidarités, discriminations, amour, art, deuil, drogue, famille, luttes politiques et sociales, rapports d’oppression de classe, survie économique, fêtes, musiques, travail du sexe, séropositivité
ACTUALITÉS ARTISTIQUES : Festival Parallèle, exposition Larelève (5 château de service, Marseille, janvier à mars 2023) / Exposition Lessillons (CAC de la Ferme du Buisson, mars à juillet 2023) / Exposition 100% (La Villette, Paris, avril 2023) / Performance au Palais de Tokyo (3 mai 2023) / Performance au CAC de la Ferme du Buisson (24 juin 2023) / Show room à Art oRama (Marseille, septembre 2023) / Salon de Montrouge (octobre 2023.

































































sont souvent d’abord écrits pour être lus à l’oral. On pourrait inscrire son travail dans le mouvement du spoken word où l’écrit se pense à travers la prise de parole publique, une écriture active, faite pour être incarnée. Dans la lecture, les mots de Théophylle Dcx engagent son corps et celui des personnes qui découvrent son histoire.
Le livre contient une diversité de contenus : les paroles de ses musiques préférées, des QR codes qui mènent aux vidéos des chansons performées, des images et des photos qu’il a prises. En combinant ces contenus, Théophylle Dcx construit une représentation de son intimité multimédiums et multisensorielle. Cette diversité de contenus offre plusieurs repères aux lecteurices et ouvre diverses possibilités de lecture : l’auteur encourage ses lecteurices à écouter les musiques qui constituent son récit, invitant les corps, le sien que l’on image danser et celui des lecteurices qui s’emparent du texte.
\\\ AVRIL 2023
ÉDITIONS BURN~AOÛT /// ROSE2RAGE

Endroits d’identification pour les lecteurices, les références populaires (musicales et cinématographiques) qu’il utilise font corps avec le récit : elles accompagnent son adolescence, son émancipation, sa sexualité et le processus de deuil de son ami Alexandre, décédé peu de temps avant que Théophylle Dcx se mette à commencer ce texte. Par exemple, la chanson de Juliette Armanet “Alexandre” prend un autre sens quand il décrit l’importance qu’elle a pour se remémorer son ami et fantasmer sa présence. Théophylle Dcx nous décrit son adolescence à la campagne, sa sexualité, le travail (du sexe notamment), la famille et les discriminations vécues à ces endroits sur un ton direct. Il allie une écriture sensible à un style offensif et intense, ce qui fait de ROSE2RAGE un récit net, vif et déterminé.
À propos de la collection 39°5 : 39°5 est une température, celle d’une fièvre qui monte ou d’une journée caniculaire, c’est aussi le nom de notre collection. Dans la collection 39°5, nous choisissons de partager des textes écrits à la première personne qui mêlent l’intime au politique dans une perspective fondamentalement queer et féministe. La collection accompagne des auteurices qui n’ont encore jamais été publiéxes et dont le travail questionne, déplace, ébranle nos rapports aux normes sociales et littéraires. Les textes de 39°5 sont brûlants, humides de sueur, ils portent des voix ardentes. Ils tentent d’inscrire dans le paysage littéraire d’autres références, proches de nos réalités et des affects qui les habitent. Thèmes abordés : sexualité, homosexualité, homophobie, identités queer, amitié, solidarités, amour, deuil, drogue, dépression, famille, luttes politiques et sociales, rapports d’oppression de classe, survie économique.
Genres littéraires : Souvent hybrides et protéiformes, les genres littéraires des textes relèvent de la poésie, du récit à la première personne, du témoignage et de l’autofiction .

Théophylle Dcx lisant un texte
Déjà publié dans la collection 39°5 : – Hot wings and tanders par Marl Brun Hot wings and tenders est un recueil de poèmes écrits en anglais à la première personne. Ils déclinent l’exploration d’une jeune femme queer de son propre corps, de sa sexualité, et de ses modalités d’existence matérielles. Alternativement tendres, crus, drôles et vifs, les poèmes de Marl Brun utilisent des protocoles d’écriture en apparence mathématiques pour tenter de capturer l’absurde logique du monde. Ils sont les énoncés analytiques d’une intimité qui demeure sensible et échappe à toute tentative de rationalisation. Profondément ancrée dans son quotidien, l’écriture de Marl Brun nous rappelle que chaque infime partie de nos rapports est politique et contient en elle un potentiel de résistance. Ainsi, son obsession coupable pour le poulet frit, ou son amour inconditionnel des chiens deviennent les supports poétiques d’une réflexion sur la survie, l’émancipation et la résilience. Cette édition est bilingue, en anglais et français. L’autrice fait ce qu’elle appelle des “traductions affinitaires” en faisant traduire ses poèmes par des proches. N’étant pas des traducteurices professionnel.les, le passage au français est marqué par des inexactitudes. Cela rend visible le processus de traduction comme un exercice de réécriture poétique à part entière.



































































Extrait 1 dans ma chambre, depuis l’apparition de ce poste radio, puis de mon premier Mp4, aujourd’hui encore à 25 ans je continue de danser seul, à fond
ça m’a sauvé – pas mal d’années, d’avoir ce moment, d’être ce moment dans ma chambre, le noir, je danse, et je me connecte, à des espaces, des lieux, des ambiances loin 2 moi, fantasmés & safe
Extrait 2 la veille de ma rentrée de troisième, j’angoissais tellement de me retrouver dans la même classe que certaines couilles pipi au lit à 14ans, au milieu 2 la nuit, tout trempé, c’est la veille, je me pisse dessus
j’ai changé les draps rapidement pour être sûr que personne ne soit témoin, no one no shame
Extrait 3
4 mois plus tard, en septembre, 2h du matin je pense je rentre de soirée complètement bourré et excité comme une chienne, j’écris à Jean Michel, il ne dort pas, je lui dis de venir me baiser chez moi cette fois, il arrive très rapidement, je descends lui ouvrir, trop bourré et excité j’en oublie l’existence de l’interphone, dans l’ascenseur je bande déjà on rentre chez moi
ÉDITIONS BURN~AOÛT
Jean Michel, me baise, il me prend sans capote, je me souviens de ma tête contre la moquette du mur sa bite au fond fond de mon trou je sens ses boules qui frappent mon périnée et caressent mon cul à chaque fois qu’il s’enfonce Putain elles sont énormes énormes énormes


En librairie avril 2024
Format : 14 x 21 cm
Pages : 152 p.
Reliure : broché, collé rayon : Témoignage
Prix : € / CHF
ISBN 978-2-8290-0683-8

DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
Au cœur de la bête
Lorrain Voisard
PRÉSENTATION
Voie étroite, en écrivant, entre la réhabilitation d’un mode de vie considéré comme inférieur, et la dénonciation de l’aliénation qui l’accompagne.
Annie Ernaux, La place
Dans l’usine de la campagne voisine, il y a des gens et des bêtes qui vivent et qui meurent les uns contre les autres. Par moments leurs poils ou leurs yeux s’emmêlent plus que prévu et traversent les frontières établies entre les lieux, les individus, les espèces. Se forment des moments de vie plus ou moins souterrains où se mélangent l’horreur quotidienne et la poésie, le rêve, et le réel, le plus palpable. Et peut-être qu’au bout de ce mélange se trouvent des pistes de renouement possible, par le fond de la terre et les entrailles… Dans l’usine de la campagne voisine, il y a tout une classe de la population, une classe hybride, intello-artisanale, bricoleuse et débrouillarde, qui n’a jamais cessé de penser avec les mains et de façonner du lien avec son “environnement”.
AUTEUR
Né à Saint-Imier en 1987, Lorrain Voisard grandit entre la campagne et la ville. Il prolonge des études de lettres en travaillant à l’école et au MacDo, aux champs et à l’usine. Il s’éloigne d’un doctorat sur le green-washing artistique pour retourner fouiller du côté du travail pénible et de l’injustice sociale. Il vit en Suisse et en Catalogne, travaille dans les jardins et dans les livres.
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom3019000119404
Tél : 01.43.58.74.11 | Fax : 01.72.71.84.51 | commande@pollen-diffusion.com | Dilicom : 3012410370014

A la fin des porcs, le chef me lance.
–T’as déjà fait du boudin ?
Je pensais que je pourrais aller fumer dans le soleil, boire un café, respirer, mais il m’explique qu’il faut que je prenne un seau et une baguette de plastique et que je fouette du sang. Normalement il y a un pétrin électrique, mais c’est la fin de la saison et il paraît que la demande en sang caillé diminue.
–On ne fait que quinze litres aujourd’hui alors ça sert à rien de salir la machine. Bon, tu bats et surtout tu t’arrêtes pas ! Compris !
Alors je fouette.
–C’est pas fort, mais rapide, précise le chef. Tsac ! Faut pas qu’il prenne.
Je fouette. Peut-être deux coups par seconde. Mais il faut le brasser, ce seau de sang. Ça résiste peu, mais plus que de l’eau ou du lait, et je sens vite la tendance à tralentir le rythme. J’essaie de reprendre. En passant, Greg demande.
–Tu t’es déjà fait violer ? Il paraît que c’est la mode, maintenant, tout le monde se fait violer. Dylan, tu t’es déjà fait violer, non ? Tiens, moi je me suis fait violer, j’ai pas de honte à le dire.
Je me demande où est le sérieux de ce qui pour lui semble être une plaisanterie, s’il se sert de l’humour pour laisser échapper des demi-confidences. Je brasse le sang. En huit comme la fondue, et j’ai les bras qui peinent. Je me demande combien un porc a de sang… Et moi ? Quelques litres, cinq peut-être ? Ça en fait beaucoup quand on le voit sortir. Je me disais que c’était l’électrocution qui tuait les porcs, mais Charles a dit que ça les plonge dans le coma, irréversible, mais comme s’ils vivaient encore. Donc ça serait la saignée les achève, ou plutôt qui les tue. Tout à coup je suis plus que complice. Je crois bien que j’ai tué ces porcs. Je peux toujours m’en sortir en pensant que l’électrocution est plus importante, comme dans un peloton d’exécution, me dire que moi j’avais la balle à blanc – c’est arrangeant de diviser la mise à mort. Mais légalement je crois que c’est moi qui les ai tués. Cette fois c’est Charles le complice et moi le tueur : tu parles d’un statut. Tout ce qu’il reste à savoir, c’est si on s’en défait. Délai de prescription, circonstances atténuantes éventuellement. Je pourrais plaider l’intérêt scientifique, tenter encore une fois de me distancier… l’intérêt commun avec les animalistes, ou les carnivores… Je me demande jusqu’à quand on va me laisser là à remuer le sang. Peut-être qu’on m’aura oublié, que je resterai ici à battre jusqu’à la fin des temps, moi tout sec mais le sang frais dans le seau. On dirait qu’une petite mousse apparaît à la surface.
–Alors, ça fatigue ?
J’ai des crampes dans les épaules, mais je dis seulement « un peu », comme un bon petit mec qui a pris l’habitude de minimiser sa peine jusqu’à ce que ça lâche.
–Fais voir.
Le chef tâte le flanc du bidon pour prendre la température, puis plonge la main dedans. Ouais, il estime. Et il retire l’écume, à main nue. Il a un gant de sang qui s’arrête au poignet. Il se rince la main.
–Tu vois, si tu le bats pas, ça coagule, et les molécules qui font que ça coagule, c’est elles qui font cette mousse. La rose, ça s’appelle.
–La rose ? Ça serait presque poétique.
–Alors voilà, tu l’enlèves, et quand ça aura fini de mousser ça sera bon.
–O.K. Vous savez pour combien de temps il y en a ?
–Oh, encore un quart d’heure.
Alors je continue à battre le sang. Je tourne et je retourne, dans un sens et dans l’autre, je fouette le sang de porc. Quand de la mousse se forme à nouveau, je me demande si je vais l’écarter. Je contemple la possibilité pendant cinq minutes en faisant des ronds, dix minutes peut-être, en même temps que celle de reposer mes bras. Je tiens encore un moment. Je voudrais être sûr de ne pas gâcher ces quinze litres de sang. Enfin, je lâche la baguette et je m’accroupis. Je plonge une main dans le seau et j’enlève la mousse rouge. C’est mon tour d’avoir un gant de sang. Je la retourne sous mes yeux. Les poils sont plaqués au poignet, je les sens qui commencent à coller. C’est peut-être la molécule de la rose.

Fabienne Radi
Notre besoin de culotte est impossible à rassasier
ESSAIS, FICTIONS, POÈMES + 1 LETTRE D’AVEU
Objet bâtard comme le fruit des amours d’un teckel et d’un lévrier afghan, ce livre concentre des formes et des sujets variés : essais convoquant des personnalités de la pop culture (Burt Lancaster, Dirk York), de l’art et de la littérature (Flannery O’Connor, Marina Abramović, Allen Ginsberg, Paul Thek, Dean Martin, Paul Newman), fictions fabriquées à partir d’œuvres d’artistes contemporains (Nina Childress, JeanLuc Manz, Joëlle Flumet), poèmes bricolés se servant de matériaux trouvés (manuels de développement personnel, injonctions contemporaines au bonheur), ainsi qu’une lettre d’aveux de l’auteure à ses filles à propos d’une paire de cochons d’Inde.
On s’intéresse tour à tour à l’histoire des crooners et à des problèmes de radiateurs, on apprend des choses sur la fréquentation des morgues, on découvre la formation des Alpes expliquée avec une couverture militaire, on s’interroge sur la place des femmes conjuguant chant et batterie dans la pop music.
Chez Fabienne Radi le trivial s’immisce dans le drame, le dérisoire dérape vers l’incongru, l’idiotie flirte avec la mélancolie.
Ce livre reprend les textes de Oh là mon Dieu et de Holy, etc. (art&fiction, 2015 et 2018), auxquels ont été ajoutés cinq textes inédits. Cette nouvelle mouture présente en sus des reproductions des œuvres d’art évoquées dans les textes, ainsi que des images trouvées par l’auteure.



format 11 x 17.5 cm, env. 230 pages isbn 978-2-88964-041-6
chf 17.80 / euro 14
genre littérature suisse, textes courts sujet abordé pop culture
Lauréate d’un Prix suisse de littérature en 2022, Fabienne Radi continue de travailler la matière texte sous toutes ses formes....
LA FÊTE EST FINIE, RIO NE RÉPOND PLUS, SAUVE QUI PEUT LA VIE.

———Fabienne Radi écrit (essais, récits, poèmes), fait des éditions d’artiste (livres, affiches, disque) et enseigne à la Haute école d’art et de design (HEAD) à Genève. Elle travaille la matière texte sous toutes ses formes et en usant de différents procédés : contraintes, appropriations, détournements d’objets trouvés, invention de protocoles etc. Elle admire David Foster Wallace pour ses essais ébouriffants, Lydia Davis pour ses micro-fictions chirurgicales. Elle relit régulièrement les nouvelles de Flannery O’Connor qui l’épatent à chaque fois, a scotché au-dessus de son bureau la phrase de l’artiste John Baldessari : I never say edifice when building would do. Sa première formation en géologie lui a apporté l’amour des couches, sa brève incursion dans la bibliothéconomie a suscité un engouement pour les classements, ses études en art sur le tard ont transformé son regard sur son appartement. Les titres, les plis, les malentendus, les coupes de cheveux, les dentistes et Paul Newman sont des motifs récurrents dans son travail. Elle a publié Une autobiographie de Nina Childress (Beaux-Arts de Paris, 2021), Émail diamant (art&fiction, 2020), Le déclin du professeur de tennis (Sombres torrents, 2020), Peindre des colonnes vertébrales (Sombres torrents, 2018), Holy, etc. (art&fiction, 2018), C’est quelque chose (d’autre part, 2017), Oh là mon Dieu (art&fiction, 2015), Cent titres sans Sans titre (boabooks, 2014), Ça prend : art contemporain, cinéma et pop culture (Mamco, 2013).
Fabienne Radi est née à Fribourg, vit et travaille à Genève, se repose en Gruyère.———
© Nina Childress

KAREN & KAREN
Dans la famille des interprètes-instrumentistes de genre féminin du siècle dernier, on a connu les chanteuses-pianistes blondes et tourmentées (Véronique Sanson, Diana Krall), les chanteuses-guitaristes brunes et plaintives (Joan Baez, Claudine Longet dans The Party), les chanteuses-violonistes vibrantes ou avant-gardistes (Catherine Lara, Laurie Anderson), ou encore les chanteuses-bassistes frondeuses et boudeuses (Rhonda Smith, Kim Gordon). On a vu beaucoup de chanteuses à qui l’on donnait un tambourin, des clochettes, un triangle ou des maracas, ceci pour occuper leurs mains sur un plateau TV, mais ça ne compte pas. Enfin il y a eu, durant les années septante /quatre-vingt, deux chanteuses-batteuses qui ont squatté le petit écran de leur pays respectif en portant le même prénom, robuste et taillé comme un fjord norvégien : Karen Carpenter aux USA et Karen Cheryl en France.
Sur le principe de la moissonneuse-batteuse, la Karen américaine a cumulé les deux fonctions (chanter et battre) tout au long de sa carrière, alors que la Karen française a rapidement abandonné son instrument pour faire des moulinets dans l’air, sans baguettes, juste avec ses bras. Qu’importe.
Pour les deux Karen, l’expérience de la batterie a été déterminante. Produire des sons en frappant un ensemble disparate d’objets massifs en bois, en métal et recouverts de peau, nécessite des capacités de coordination motrice, d’équilibre spatial et d’endurance physique hors du commun. Rien à voir avec l’action d’insuffler de l’air dans une flûte douce par exemple.
Jouer de la batterie est une expérience sismique intense, qui a longtemps été réservée à la gent masculine. Car dans cet exercice on secoue autant qu’on est secoué, en plus d’être forcé au manspreading pour garder l’équilibre sur son tabouret. Le batteur mâle rock est la plupart du temps musclé, souvent tatoué, sa virilité a l’occasion de s’exprimer lors de solos acrobatiques qui font gicler sa sueur. Seule concession au féminin : la chevelure, si possible longue et épaisse, pour redoubler avec
emphase les mouvements de la tête. Pas très élégant a priori. C’est sans doute ce qu’a dû se dire Andy Warhol lorsqu’il a imposé la chanteuse Nico au Velvet Underground, ceci afin d’ajouter une touche de glamour féminin que Moe Tucker, la batteuse du groupe, avait selon lui du mal à incarner. En quoi les deux Karen, quelques années plus tard et dans un autre registre (la variété), allaient lui donner tort.
Il suffit de regarder Karen Carpenter déchaînée à la batterie en 1976 pour s’en convaincre. Sweat moulant vert pomme, pantalons pattes d’éléphant assortis, elle frappe tout ce qui se présente en ondulant telle une liane tropicale, sans que son brushing ni sa frange ne se défassent, ses deux grandes dents d’écureuil faisant un écho chromatique aux pointes blanches de son col pelle à tarte. Une créature fantasque qui évoque autant Peter Pan (les dents) que Morticia Addams (les sourcils inquiétants). Au-delà du formatage TV de l’époque, il faut avouer qu’il y a de la grâce chez le tomboy Carpenter. Un peu moins chez Cheryl qui impressionne surtout par un stakhanovisme à tout crin, et s’inscrit davantage dans une esthétique majorettes (qui, elles aussi, ont jeté le tambour pour ne garder que les baguettes).
Comme les lapins Duracell programmés pour ne jamais s’arrêter, Karen & Karen ont été construites avec des piles encastrées sous les omoplates. Pourtant, chacune à leur manière, elles ont œuvré à leur propre disparition. À force de ne rien avaler, l’anorexique Karen Carpenter s’est définitivement évaporée dans l’atmosphère en 1983, laissant en plan le duo qu’elle formait avec son frère Richard. Karen Cheryl, elle, poursuit depuis 40 ans un processus de dissolution beaucoup plus complexe, où les changements de noms, les transformations corporelles, les métamorphoses capillaires et les bifurcations professionnelles donnent le tournis. Toute cette énergie qui au départ se déversait sur des caisses et des cymbales a fini par un bizarre phénomène d’implosion chez l’une, de diffraction chez l’autre.

CILS POILS CHEVEUX
Flirter avec les cuisses, est-ce une bonne idée ?
Une paire de bottes rouges, un jean slim et un poncho
Attention fashion faux plat
On dit non aux modèles en vinyle
Peignez vos avant-bras avant d’enfiler un pullover
Sous le charme indéfectible de maniérismes vocaux acrobatiques
Ma coupe de cheveux est un positionnement politique
À nous les belles heures d’Au Théâtre ce soir
Tu peux bien pleurer des rivières, ça ne ressuscitera pas Georges Descrières
Fermeture générale de la chasse au poil
Les aisselles chauves ont du souci à se faire
Les épines nous parlent
A rose is a rose is a rose is a rose
J’aime j’aime j’aime j’aime j’aime tes genoux
Différence et répétition
Comment évitez que mon blond vire au vert après la piscine ?
Fräulein Hedy, que vous avez de grands cils
Sous cette masse capillaire se cache un QI phénoménal
Il faut libérer la mèche avant que le fer ne soit trop chaud
Combien de montres voyez-vous dans ces peintures ?
Je ne suis pas un robot
Tu ne seras jamais Sylvie Vartan
Nous ne sommes pas deux sœurs jumelles nées sous le signe des gémeaux
Vous n’êtes en aucun cas quatre garçonnes assises au-dessous d’un volcan
Suivons le sens des écailles
Guillaume Viry

Genre : roman
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 128
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-490251-98-8

Guillaume Viry passe son enfance au milieu des champs en Bourgogne. D’abord comédien au théâtre ainsi que dans une cinquantaine de films et séries, il joue notamment chez Philippe Genty et Alain Guiraudie. Il réalise ensuite plusieurs films à la lisière de la fiction et du documentaire. Lauréat de la Fondation Jan Michalski, il écrit L’Appelé, son premier roman, dans une cabane face au lac Léman.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com


6 septembre
Jean est appelé en Algérie en 1962. De retour en France, c’est à l’âge de trente ans qu’il meurt lors d’un dernier séjour à l’asile. Soixante ans plus tard, il suffit de presque rien, d’une confusion de prénom, pour que le passé surgisse comme une déflagration.
Guillaume Viry narre le temps fracassé, et la folle histoire de la guerre d’Algérie et ses échos contemporains. Dans ce premier roman, l’auteur bouleverse et cristallise l’ampleur d’une tragédie. Tout de blancs, de non-dits et de silences, L’Appelé révèle un écrivain.
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Téléphone : 06 62 68 55 13
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard
33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils


PERRINE LE QUERREC
Les pistes
Trois personnages dans 42 univers parallèles et toujours la mort, le sang, l’amour, les rêves.
Il y a Eva, il y a Piotr, il y a Tom. Une femme, un homme, un enfant. Trois personnages jetés dans 42 univers parallèles. La vie s’y manifeste, happée par la mort, l’amour tangue, la violence guette, menace, jaillit. Il y a la force du désir et celle des rêves. Ici Eva se saisit d’un verre, Piotr boutonne sa chemise, le petit Tom appuie sur les pédales de son vélo. Des gestes se font, se défont. Des sentiments naissent, meurent écrasés, survivent, s’effondrent, se métamorphosent. C’est la nuit, c’est le jour. L’avenir se joue avant le passé et le passé se vit encore au présent. Le temps se distribue dans l’univers. Fusion. Tout se répète, rien n’est identique. Une piste vaut un monde, un monde vaut ce que valent ces trois destins et les mots pour les dire. C’est la guerre, ses décombres, ses cadavres mutilés qui crient. C’est l’été, l’or en lumière et les corps qui s’aiment derrière les persiennes. Il y a du sang, des gorges tranchées. Les pistes ainsi se déclinent, les fonctions changent, l’action se diffracte. Reste l’écriture, les signes qui dansent sur la page tremblante et un écho intrigant qui s’élève.
collection ShushLarry
format 11 x 17,5 cm, broché isbn 9 78-2-88964-059-1
prix CHF 16.50 / € 13
Perrine
Le Querrec
De la même autrice:



Éditions

« L’œuvre singulière de Perrine Le Querrec se donne les moyens d’une grande inventivité formelle afin de donner voix à ceux qu’on enferme. »
VERONIQUE BERGEN, ARTPRESS, FÉV. 2019

Perrine Le Querrec est née à Paris et c'est dans cette ville qu'elle a écrit ses vingt premiers livres. Livres de poésie et de prose, livres graphiques aussi faits d'archives et de silences, de trous et de pliures. Où le travail sur la langue et les signes ouvre des perspectives politiques, des champs d’expérimentation. Perrine Le Querrec a notamment publié La Construction (art&fiction, 2018) qui présente les plans d'un hôpital psychiatrique mais dont le véritable architecte est le lecteur. Elle a depuis quitté la ville pour le Berry et c'est là qu'elle écrira ses vingt prochains livres. Les pistes ont été menées à la charnière de ces deux vies.
si vous aimez les intr igues, les jeux de piste, le sang, l’amour, les rêves. Smoking / no smoking d’Alain Resnais, Godard, et l’écriture.
Xavier
Loira
d’en bas, 2022
La Contre Allée, 2020 art&fiction, 2018
La Contre Allée, 2022
Souvent ils commencent de haut les films, d’en haut EN PANORAMIQUE le survol d’une forêt un désert filant le brouet des cascades, alors commencer l’écriture comme ça de haut en survol, pas même un horizon mais la page bouchée par le grand pays le grand paysage et puis descendre, fendre l’air jusqu’au trottoir, gros plan sur une petite tennis blanche sur la pédale d’un vélo, des mains d’homme qui boutonnent une chemise, une femme tenant un verre, nuque dévoilée par ses cheveux relevés, l’enfant et son vélo, la femme qui boit, l’homme devant le miroir.
Une histoire qui n’a plus rien d’une histoire, mais une masse compacte de paysages, de terres immergées – une géographie mutante.
La première piste
Sur un trottoir très noir la petite tennis blanche et le revers d’un pantalon trop grand, l’enfant pédale sur son vélo en chrome, il est très sérieux ne quitte pas le trottoir très noir des yeux il ne sourit pas ne chantonne pas, il roule aussi vite qu’il le peut, il appuie régulièrement un pied
après l’autre de toutes les forces de ses cinq ans il quitte le périmètre de sa maison du quartier de la ville si possible, sans rien d’autre que sa volonté et son absolue incompréhension des deux adultes laissés dans la maison sous un tumulte de cris, sa mère encore ivre le verre qu’elle ne quitte plus, toujours entre elle et son fils, elle et son mari, elle et sa vie, elle et les autres, elle et elle il y a le verre plein puis vide puis plein puis les rires les larmes les mots toujours les mêmes, les violences les excuses les saletés les assiettes vides de Tom l’enfant à la bicyclette, le ventre vide de Tom le cœur vidé de Tom le ventre tordu de Tom, les yeux secs Tom roule en direction du soleil, mètre après mètre s’éloigne de cette maison où elle est tombée entre l’évier et la table le verre au-dessus de sa tête comme un trophée elle ne l’a pas renversé, et alors s’approche papa il sort de la chambre où il vient de s’habiller boutonner les mille boutons de sa chemise devant le miroir il tente d’être sourd aveugle totalement sourd totalement aveugle, ni femme ni enfant, le petit Tom devant lequel il passe à présent sans mot dire, enjambant sa femme pour se servir un café qu’il boit très rapidement devant la fenêtre, ce qui se passe dans son dos ne le concerne pas, le petit Tom espérant qu’il se retourne qu’il aide
maman à se relever qu’il aide Tom à lacer ses tennis qu’il termine son café enjambe sa femme dans l’autre sens, décroche son manteau l’enfile et sort tandis que Tom que sa mère appelle pour qu’il vienne l’aider, lace ses tennis par des pensées magiques et sort à son tour, enfourche son vélo et quitte à jamais cette maison cette mère ce père ces inconnus qui n’ont pas lacé les deux brins blancs de ses tennis, quel dommage le lacet s’est défait et le lacet coincé et l’enfant est tombé et une voiture est arrivée.
Il faut vite prendre du recul un très large recul ne pas regarder la tennis souillée le visage de Tom son œil étonné grand ouvert sur l’azur qu’il emporte dans sa rétine, il nous faut nous échapper de la place du meurtrier vite remonter au ciel traverser les nuages s’approcher du soleil la ligne noire du trottoir n’existe plus la petite ville non plus l’écriture survole une immensité végétale, l’écriture-aigle.
La seconde piste
Envol vol survol, sous le ventre de l’aigleécriture la fourmilière ; fondre sur la page réseau serré de la ville à coups de bec déchiqueter les nœuds de l’espace, voici la ville aux millions de lumière, de fourmis, de fenêtres
brisées par l’écriture en mille éclats elle percute les mains tremblantes de Piotr assis au bord de la table de consultation reboutonne sa chemise pâle froissée. Le médecin range ses outils ses mots ses déclarations, il a énoncé la vérité l’arrêt de mort, énumère les traitements les espoirs les possibles un à un les boutons glissent résistent refusent de plus en plus minuscules les trous possibles pour s’habiller reprendre forme humaine, les deux mains se cognent s’évitent se grimpent dessus la fente le bouton se dérapent s’évitent, Piotr de plus en plus lentement l’espoir que la voix du médecin ralentisse ne perfore plus sa vie, qu’elle s’épuise retienne la guillotine du diagnostic encore un instant avant le dernier bouton étrangleur se redresser dans la chemise froissée se relever sur deux jambes d’aplomb quand tout bascule tout a basculé la vie la mort jusqu’alors il ne les avait jamais vues comme le pile et face de la même imposture il est bien obligé à présent, Piotr enfonce sa chemise boutonnée lundi avec mardi avec mercredi avec jeudi avec vendredi avec samedi avec dimanche, chaque jour devient unique, il lui reste des jours à vivre quelques jours quelques semaines il ne pourra pas apprendre à son fils Tom à faire du vélo courir à ses côtés en tenant

ISBN 978-2-940700-44-8
Inhumaines
Florence Cochet
Hélice Hélas Editeur
Rue des Marronniers 20 CH-1800 Vevey
Tél. : ++41 21 922 90 20 bd@helicehelas.org www.helicehelas.org
Diffusion Suisse :
Servidis
Chemin des Chalets 7 CH-1279 Chavannes-de-Bogis
Tél. : ++41 22 960 95 10 www.servidis.ch
Représentants :
Julien Delaye (BD et livres d’artiste) > jdelaye@servidis.ch Pascal Cottin (littérature) >cottin.pascal1@gmail.com
Diffusion France, Belgique :
Serendip-Livres
21 bis, rue Arnold Géraux F-93450 L’Île-St-Denis
Tél. : ++33 14 038 18 14 www.serendip-livres.fr
Recueil de 14 nouvelles fantastiques, dont les héroïnes se vengent de maris méchants, de vampires ignobles ou triomphent d’aventures extraordinaires. Elles s’inspirent parfois de légendes anciennes ou de romans classiques du genre, de l’Apocalypse au Nautilus. D’une écriture somptueuse, sensuelle, au vocabulaire riche, ces récits sont animés par une panoplie symbolique traditionnelle, crocs, vampires, sirènes, fétichisme, malédiction, créatures bizarres, épreuves, qui font frissonner ou pleurer lectrice ou lecteur, non sans une pointe d’humour, ils fascinent jusqu’à leur chute finale.
Ces contes s’inscrivent dans une longue tradition aux ramifications labyrinthiques et métissages subtils étiquetés, roman gothique, merveilleux scientifique, anticipation, rétrofuturisme, fantastique, science-fiction, steam punk… Ils sont aussi d’hybrides exercices de style qui frappent, terrifient ou surprennent en se glissant dans les problématiques contemporaines, libération de la femme, lesbianisme, suicide assisté, extraterrestres, fin du monde… Récits qui mettent en scène les passions qui animent les héroïnes, amour, rage et courage, vengeance, cruauté, sacrifice, espoir ou désespoir et assurément la lutte contre le mal.
Sur l’auteure : Florence Cochet, née en 1976, enseigne le français à Genève. Elle a publié une dizaine de romans et des nouvelles dans les genres fantastique, science-fiction, new romance. Elle aime aussi mêler ces genres.
Collection : Blanc Lait Ment
Genre : Nouvelles fantastiques
Sujets abordés : vampirisme, lesbianisme, féminisme militant, fantasmé et imaginaire
Format : 14x20 cm
220 pages
ISBN 978-2-940700-44.8
CHF 24/EUR 18
Parution : octobre 2023








Chroniques d’une caissière en chien
WHORE FOODS
Chroniques d’une caissière en chien

LA Warman traduit avec sa langue parlée, franche, obsessive et poétique, les écueils des petits boulots où les tâches répétitives et l’absence de sens deviennent le terreau de dissociations sexuelles libératrices.
Au cœur du capitalisme «vert» et ses méthodes manageuriales tournées en
ridicule, la narratrice évoque les travers de l’univers dans lequel elle passe une grande partie de ses journées et les humainxs qui le peuplent : des clientxs éreintées qui essaient de grapiller quelques centimes, les employéxs pleines d’espoir d’ascension, les boss abusives qui ont peur des procès,...
Il y règne une solitude de tous ces êtres. Celle de la narratrice, avide de sensations corporelles dans ce monde aseptisé imaginé pour la satisfaction client. Elle décline toutes les interactions sexuelles possibles, elle décrit sans pudeur ses pulsions, imagine des scènes gargantuesques où la nourriture se mêle aux corps et les corps n’ont plus de limites.
Elle est crue, elle est drôle.
Elle est honnête et impure.
Parfois cruelle.
Elle est lesbienne.
Elle fait des rayons les dédales de nos cerveaux truffés de fantasmes inavoués.
Ces chroniques sont des pages manquantes à la littérature lesbienne.
mot-clés : sexe, nourriture, capitalisme tardif, lesbienne, fantasme, ennui, travail, supermarché
Le livre comprend une interview avec l’autrice menée par la traductrice Clara Pacotte. LA Warman y aborde le contexte dans lequel elle a écrit le livre, sa temporalité, sa forme première de newletter destinée à ses lecteurices abonnéxs, la nécessité d’écrire dans l’économie capitaliste et la possibilité de le faire.
LA Warman











est basée à Rennes / editions.rag@gmail.com / rageditions.hotglue.me








Whore Foods
Chroniques d’une caissière en chien
LA Warman est née en 1989. Elle vit et travaille dans l’État de New-York aux ÉtatsUnis.
Impression de la couverture sur papier texturé effet peau.
140 pages
10x14 cm
ISBN 978-2-9575104-2-9
13 €
Premier tirage : 500 exemplaires
Parution : décembre 2023
extrait 1 :
que quelqu’unx touche ma peau mais Elle est loin et ne sera pas de retour avant deux semaines. Donc, si Elle n’est pas là, qui est-ce que je peux bien baiser ? Je veux baiser quelqu’unx d’une manière non problématique. Je veux baiser quelqu’unx que personne ne m’aurait imaginée baiser. Je veux baiser quelqu’unx qui n’a pas vraiment de visage. Je veux baiser D. Je veux le baiser tout de suite dans les toilettes mais il ne me croit pas parce que sur ma veste en jean il y a un badge qui dit « GOUINE ». Il ne me croit pas parce qu’il lit tous mes poèmes et tous mes tweets et se considère comme un fan de Moi, il m’apprécie parce que je suis imbaisable. Il peut me poser des questions à propos de certaines femmes et jouer avec moi à « Baiserait Baiserait Pas ». Je le laisserai pas me baiser il pourra juste ensuite rêver qu'il me baise car je suis complètement indisponible. Je me demande s’il a une bite. Je me demande ce qui lui fait envie, ce qu’il trouve sexy. Mon amie dit n’importequiavecunvisage J’ai envie de le baiser mais je ne le ferai pas. Je veux qu’il rêve de me baiser.
extrait 2 :
À chaque fois que je reçois un message, mon écran s’allume et L lit le message à tout le monde. Elle m’en demande beaucoup. Elle n’arrête pas de m’écrire au sujet de Ses besoins. Je ne peux pas répondre à Ses besoins, je suis occupée, je ne suis pas au taquet. Je suis dans mes pensées. L rit de Son désespoir.
Je veux changer de sujet.
« L’une d’entre vous a déjà participé à une orgie ? »
Personne ne dit rien, mais tu ne peux pas mentionner une orgie dans un frigo plein de femmes. Si t'en parles, c'est sûr, ça arrivera. Les mots flottent dans la pièce se cognent au plafond mais ne traversent pas les murs.
extrait 3 :
Elle vient à ma caisse et dit
« t’es homophobe » et je dis
« mais je sors avec toi » et Elle dit
« jamais assez. »
87
extrait 4 :
R prend un grain de raisin et le fait rouler de haut en bas sur son bras. Elle déboutonne vite sa chemise et l’enlève. Elle renverse un bac de raisin sur le comptoir en métal. Elle frotte son torse sur les raisins avec précaution pour ne pas les écraser complètement. G se met derrière elle et se met à contrôler les mouvements de R en lui tenant les tétons entre les doigts. L me dit de la déshabiller, ses mains sont couvertes d’avocat. Je fais de mon mieux mais un peu d’avocat se glisse quand même ici et là. L frictionne mon ventre avec la chair verte puis ma fesse. Petites touches de tendresse. Je mets un doigt ganté de latex dans son vagin et un autre dans son trou du cul. Je fais tourner mon doigt un tout petit peu. Puis deux doigts, puis trois doigts. La bouche de L s’ouvre un peu plus à chaque doigt que je lui mets.











Whore Foods
Chroniques d’une caissière en chien
extrait 5 :
Je pulvérise du liquide de nettoyage sur le tapis roulant de la caisse. Je ne sais pas ce qu’il y a dans ce produit parce qu’il sort d’un tuyau dans le mur qui ressemble à une fontaine à soda. Il a une odeur âcre, pas une odeur de propre. Ça sent le non-savon. Tout le magasin a cette même odeur. J'asperge le tapis roulant avec le spray et j’essaie d’atteindre les clientxs avec des gouttes de liquide. Je veux qu’iels emportent un peu de cette odeur en partant. J'asperge le tapis roulant et les gens ne veulent pas mettre leurs légumes sur le tapis mouillé parce qu’ils sont Certifiés Bio. Elle pose sa salade composée. Elle me regarde. Sa salade pèse genre 900 g et coûte 20 $. Elle me donne 30 $ et me dit de garder la monnaie, ce que je fais. Elle va s’asseoir à la Cafétéria et mange sa salade au poulet grillé. Je voudrais rendre toute cette scène érotique mais je n'y arrive pas. Je veux qu’elle me voie comme je suis vraiment, sans ce tablier, mais elle ne le verra jamais. Sa frange grasse est entrouverte. Elle est plus grande que moi. Elle me donne envie d’être invisible. Elle me baise parce qu’elle me voit
35








nouvelle bouchée de sa salade, déboutonne son pantalon et le fait glisser à mi-cuisse. Maintenant mon orteil est sur sa culotte contre son clit. Je le bouge au hasardsans prendre en compte son rythme et sans la laisser jouir. Elle a peur de me regarder. Sa bouche est pleine. Elle a du mal à respirer. Elle crache des petits bouts de salade romaine, de poulet et de parmesan sur son haut, ses yeux roulent vers les caméras de surveillance. Je me débarrasse de sa culotte avec le pied gauche et continue de la frotter avec le droit. Je lui donne enfin ce qu’elle veut parce que ce n’est plus très marrant de la voir se consumer de plaisir en crachant du poulet. Elle fait trembler toute la table, les gens se retournent et supposent qu’elle est en train de s’étouffer mais elle leur fait signe que tout va bien. Je remets ma chaussette couverte de foutre dans ma Croc et je m’en vais, resserrant mon tablier plus que jamais pour lui montrer qu’avec un peu d’effort je peux arborer une vraie silhouette en sablier. Je m’en vais et ne lui accorde aucun regard mais je lui prends tout.
tous les jours. Elle me cherche, Elle essaie de me voir, mais je suis toujours si visible, si facile à repérer. Elle a envie de moi juste parce que je suis là, mais elle a envie de moi quand même. Elle est assise à une table un peu cachée. Les tables sont alignées le long d’une baie vitrée côté rue mais trois mètres au-dessus des passantxs. J’éteins ma caisse. Ma barre de caisse Fermé tombe sur le tiroir-caisse, ça fait un bruit perçant. Elle lève les yeux depuis sa table. Le plus gros bruit du magasin c’est quand la barre de caisse tombe sur le sol en ciment. Je n’y connais rien en amitié féminine mais j’en connais un rayon sur ce qui est de baiser ses amixs. Elle mâche son poulet plus lentement tandis que je m’approche. Elle mâche lentement, sa bouche entrouverte laisse échapper un peu de chair qui tombe par terre. Je m’assieds en face d’elle à la table et je fais sauter les Crocs de mes pieds. Elle est toujours en train de mâcher et de l’orteil je touche son mollet à travers ma chaussette, puis son genou, puis sa cuisse, puis je retourne à son pied, puis je remonte à sa cuisse. Elle prend une
36
Chaque vibration qu’elle m’a donnée, je l'ai prise, je l'ai gardée.
DEMAIN LES FLAMMES LITTÉRATURE

EAN : 9782492667091
Parution : 3 septembre 2024
Pagination : 240 p.
Format : 11,5 x 17,8 cm
Prix : 14 €
Couverture sérigraphiée
« Les nouvelles de George Tabb sont l’équivalent littéraire des meilleures chansons des Ramones : courtes, rapides, addictives, irrévérencieuses. »
Alex raTcharGe
« George Tabb, t’es un excellent écrivain. »
Henry rollins
« George Tabb écrit comme il respire. »
Spike lee
GeorGe Tabb
Petit joueur
Un juif à Greenwich
Traduit de l’anglais par Stéphane Pena
Préface d’Alex Ratcharge
Au fin fond du Connecticut, c’est dans une banlieue pavillonnaire bien sous tous rapports, que grandissent les frères Tabb. Mal aimés par leur père, détestés par leur belle-mère, haïs par leurs camarades d’école et noyés sous les injures antisémites, leur vie est un enfer. Mais l’été est là et avec lui vient le temps du baseball. George, l’aîné de la fratrie, toujours choisi en dernier et juste bon à chauffer le banc de touche, ne baisse pas les bras : quiconque osera le traiter de petit joueur devra en assumer les conséquences.
Avec un humour cinglant et une autodérision bien à lui, George Tabb rend compte par le menu des petites misères et des grandes vilenies qui sont le lot de l’enfance. Les petites brutes n’ont qu’à bien se tenir : le temps de la revanche a sonné.
GeorGe Tabb est musicien et écrivain. Il est notamment l’auteur de Take My Life, Please (Demain les flammes, 2021).

DEMAIN LES FLAMMES
EAN : 9782492667008
Parution : 2021
Pagination : 176 p.
Format : 11,5 x 17,8 cm
Prix : 10 €
Couverture sérigraphiée
43, rue de Bayard / 31000 Toulouse contact@demainlesflammes.fr / demainlesflammes.fr
PETIT JOUEUR EXTRAITS
Donc, j’étais à l’école primaire, et un matin, à l’arrêt de bus scolaire au croisement de Londonderry Drive et Stanwich Road, ça a commencé.
Il était là, il était prêt. Il m’attendait. Et mes frères après moi.
Il s’appelait Mark.
Mark Healy.
Le prélude aux dix prochaines années de mon existence.
Jamais je n’oublierai les trois premiers mots qu’il m’adressa, sous ses cheveux blonds ondulés et ses yeux d’acier bleu-vert.
«T’es un Juif ! »
Puis vinrent les coups. *
Les frères Tabb ont dû apprendre très tôt à se bagarrer.
Ou à s’enfuir.
Étant né avant Luke et Sam, de mon point de vue, je n’avais pas le choix. Si les petites brutes ne s’en prenaient pas à moi, elles s’en prendraient à eux. J’ai donc appris à me battre.
5 la bataille Du bus
PETIT JOUEUR
Enfin, plutôt à être battu.
Vu ma taille, me tabasser n’était pas exactement un exploit. Mais les merdeux de Greenwich pensaient visiblement le contraire. Comme leurs parents, il faut croire.
Tout particulièrement ceux de Mark Healy.
«T’es rien qu’un sale Juif », me disait Mark chaque matin de la semaine. Le week-end, heureusement, c’était relâche.
« Sale ? » répétais-je, confus.
Je pouvais comprendre la partie « Juif ». À peu près. Mon grand-père m’avait expliqué une fois pourquoi nous devions porter ces petits chapeaux marrants à certaines réunions de famille. Mais la partie « sale » m’échappait complètement. Je prenais beaucoup de douches. Et c’est toujours le cas. La saleté et moi ne faisons pas bon ménage.
« Ouais, ricanait Mark, t’es rien qu’un sale Juif dégoûtant, avec ton nez crochu et tes cheveux crépus. »
Et à chaque fois que j’essayais de lui demander de m’expliquer ce qu’il voulait dire, il était trop tard. Il attrapait ma boîte à déjeuner Batman, avec la Bat-Moto imprimée sur la thermos, et il la flanquait par terre.
«Ta maman t’a fait ton déjeuner, disait-il, et moi je le défais ! »
PETIT JOUEUR
Puis il sortait mon sandwich au salami avec de la moutarde sur un seul côté, ma pomme, mes trois biscuits Oréo, et jetait le tout aussi loin qu’il pouvait dans les bois.
« Qu’est-ce que tu vas faire, Tabb ? » deman dait- il.
Je restais silencieux. Qu’est-ce que j’aurais pu dire ? Il était en sixième, et moi au CE1. Et il faisait au moins vingt centimètres de plus que moi.
«Tu vas pleurer, espèce de chochotte ? » continuait Healy.
Bien sûr j’essayais de me retenir, mais les larmes finissaient toujours par m’échapper.
Finalement je lui criais d’arrêter, et le pilonnage commençait alors. Il serrait le poing et me frappait de toutes ses forces sur le nez. La cible la plus grande et la plus facile. Lorsque je commençais à saigner, il riait, me frappait à l’estomac, et enchaînait avec un crochet au menton. Je mordais généralement à ce moment-là ma lèvre ou ma langue, et le sang coulait encore plus. Le temps que le bus arrive, je n’avais plus de repas, et plus beaucoup de visage.
À point pour le deuxième round. Ma bellesœur, Diane, restait plantée là, choquée, tandis que Mark répandait partout mon Kool-Aid avant de jeter la thermos et la boîte à déjeuner. Je le regardais faire, les larmes aux yeux.
PETIT JOUEUR EXTRAITS
C’est donc comme ça que ça a commencé. La violence, les bagarres, les sandwiches au salami écrabouillés et, bien sûr, les combats de bus.
Mes quatre années réglementaires de bébé s’étaient déroulées à Brooklyn, New York, et je les avais employées à mouiller mes draps et grossir exagérément. Puis ma famille avait déménagé à Muttentown, mais mes parents avaient vite divorcé, ma mère quittant mon père. Suivit une installation rapide à Greenwich, Connecticut, où mon père « obtint » notre garde en soudoyant un juge. C’était comme ça que ça marchait, en cette fin des années 1960, dans l’univers brutal de business et de corruption où vivait mon père. À Greenwich, les choses étaient différentes.
Mais pas totalement différentes.
Il y avait aussi du business, et pas mal de brutalité– la seule chose qui manquait dans la plus riche banlieue des États-Unis, c’était les Juifs. Il y en avait sûrement quelques-uns, mais ils étaient bien cachés parmi les visages empâtés de la masse blonde aux yeux bleus. Greenwich n’aimait pas mon père mais, pour quelque obscure raison, mon père aimait Greenwich. Il devint vite évident que sa préoccupation principale était surtout de nous éloigner le plus possible de notre mère. Moi, Luke et
Ed Lacy

Genre : roman noir
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 304
Traduit de l’américain et préfacé par Roger Martin Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490251-89-6

Ed Lacy est un des nombreux noms de plume sous lesquels Leonard Zinberg (1911-1968) se cacha pour publier les romans policiers tirés et lus à des dizaines de milliers d’exemplaires. Auteur sous son patronyme de 4 romans et de plus de 200 nouvelles, il a joué avec le feu. Juif, non croyant, communiste, marié à une Noire et père adoptif d’une petite fille noire, elle aussi, il a eu l’inconscience de faire de ses personnages principaux des militants communistes et de publier des articles dans la presse noire. Victime de la Chasse aux sorcières, il reprend son ancien métier de postier qu’il avait exercé entre 1935 et 1940 sans s’arrêter d’écrire des nouvelles qu’il signera Ed Lacy ou Steve April. Abandonnant le roman social et politique, il se lance alors dans le roman noir, genre où se sont illustrés des progressistes comme Dashiell Hammett, Horace McCoy ou Robert Finnegan. Resté fidèle aux valeurs progressistes, il stigmatise dans tous les romans qu’il publie au rythme de 2 par an de 1951 à 1968, le racisme, la misogynie institutionnalisée, le culte de la virilité et des armes, la corruption et la violence pour la violence.
Les Éditions du Canoë ont publié en 2022 Traquenoir, qui rencontra un large succès.


Toussaint Marcus Moore accepte une mission à Mexico pour le compte de Ted Bailey et Kay Robbens. Une affaire simple vue de loin qui ne lui prendra qu’une quinzaine de jours et qui est grassement payée. Il débarque donc à Mexico pour tirer au clair la demande d’une jeune veuve qui veut la preuve que son mari a été assassiné par un toréro célèbre surnommé El Indio. L’enquête l’emmène dans les bas-fonds de Mexico et à Acapulco. Il y rencontre différents protagonistes, blancs, noirs, métisses qui lui font comprendre qu’il n’est pas le bienvenu. Le racisme n’est pas aussi exacerbé qu’aux États-Unis, mais néanmoins bien réel. Il est traité de boy et de « nègre » par un privé blanc et remis à sa place par le lieutenant Tortela qui ne supporte pas la morgue des étatsuniens. La Mort du toréro illustre donc parfaitement l’essence du véritable roman noir. Une intrigue à suspense, avec de l’action, des rebondissements mais d’où le social, l’historique et le politique ne sont jamais absents. « Une formidable mine de réflexion » comme l’écrit Roger Martin, non seulement progressiste mais carrément prémonitoire dans ses jugements sur la corrida.
CHAPITRE QUATRE
Je pris un taxi pour rentrer à l’hôtel. La femme de ménage avait déjà fait les chambres, ce n’était donc pas la peine de vérifier la place de mes affaires sur la commode. Après une douche froide, je m’étendis sur le lit pour me livrer à l’occupation dans laquelle j’excellais depuis le début de cette affaire : la sieste.
La façon dont Cuzo m’avait ciblé m’intriguait. Savait-il que je travaillais pour Grace, ou bien léchait-il les bottes de tous les touristes ? Quand je souperai avec Smith, je lui ferai part de mon intention de parler à El Indio, en jouant le nouveau converti ; je lui demanderai de m’indiquer les bars où se rassemblent les amateurs de corridas. Je n’avais pas idée de ce que ça me rapporterait mais, de toute façon, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d’autre pour le moment. Je songeai à mettre Frank dans la confidence, peut-être même rétribuer ses services de quelques centaines de dollars. Il pourrait creuser dans des directions dont j’ignorais tout. Mais je ne savais pas jusqu’à quel point je pouvais faire confiance au vieux vantard, si même je pouvais lui faire confiance du tout.
Quand je me réveillai, il faisait noir et froid dehors. C’était quelques minutes avant vingt et une heures et je crevais de faim, comme d’habitude. Smith ne m’avait pas donné son numéro de chambre et lorsque je descendis pour questionner l’employé à la figure de papier mâché encore plus pâle que l’employé de jour, ce fut pour m’entendre répondre que le señor Smith avait réglé sa note l’après-midi.
Il est parti ? Quand ?
— Au moment où je prenais mon service, un peu avant votre retour de la corrida. Le señor Smith semblait particulièrement pressé.
Il a laissé une adresse où le joindre ? Non, señor.
— Il descend souvent dans votre hôtel ?
Je n’avais jamais vu le señor Smith avant qu’il ne prenne une chambre la veille de votre arrivée. Ce n’est pas un de vos amis, señor Moore ?
J’aimerais bien le savoir, lui dis-je en lui tendant la clef.
J’errai un bon moment jusqu’à ce que deux petits vendeurs de billets de loterie m’assiègent. Après leur en avoir acheté un à chacun, je pris la direction de la vieille ville et l’hôtel de Cuzo. On était dimanche soir, les magasins étaient fermés, les rues désertes. Les deux petits piégeurs de touristes m’avaient inspiré la vague idée d’engager l’un de leurs semblables quelques jours comme guide et interprète. Les rares pistes que j’avais dans mon affaire étaient mortes dans l’œuf avec
la disparition soudaine de Smith. Il était vraiment étrange qu’il ne m’ait pas touché un mot au cours de la corrida.
À mon grand étonnement, je réussis à retrouver la rue, déserte à présent, qui donnait sur l’hôtel miteux des matadors. Contrairement au reste de Mexico, l’hôtel était animé ; un jeune Mexicain, gros et gras, était en train de jeter dehors une blonde tapageuse. Elle jurait à haute voix en anglais et en espagnol, en tentant de rentrer dans le boui-boui. Quelques types lorgnaient derrière les fenêtres, ricanant devant la scène. De sa voix stridente, la blondinette traitait tout le monde de tous les noms sauf de celui d’enfant du bon Dieu.
Quand je me rendis compte que la blonde était celle que Smith m’avait désignée comme la maîtresse de Cuzo, je pressai le pas. Gros-lard jeta sur elle une valise bon marché, puis la frappa sur la bouche, d’où jaillissait toujours un flot d’insultes, l’envoyant s’écrouler sur la valise. Le spectacle fit éclore des sourires éclatants chez les types massés aux fenêtres.
Je me précipitai, doublant la mise, un coup exceptionnel du gauche dans son ventre mou et une droite en plein nez. Un petit bobo comme un saignement de nez suffit à calmer les ardeurs de pas mal de types.
Aidant Mademoiselle Sac d’os Blonde à se relever, je lui demandai : « Je peux faire quelque chose pour vous ? »
Elle était hors d’elle ; il lui fallut un moment pour fixer son attention sur moi. Son visage aux traits grossiers avait un nez en petit bouton comme s’il y avait été
ajouté après coup. S’il n’était pas joli, son visage était si inhabituel qu’il en devenait attirant. Se balançant sur ses pieds, elle me dévisagea, avant de sourire et de dire d’une voix traînarde : « Qu’est-ce qui se passe ? Les fusiliers marins américains à la rescousse ? Peau noire et armoire à glace. »
Malgré le persiflage, je ne relevai pas le « Peau noire », j’avais trop besoin de cette fille et d’ailleurs elle avait prononcé le mot avec un sourire.
Elle ajouta, après m’avoir jaugé de la tête aux pieds : « Vous faites partie des armoires à glace. »
C’est ça. Tirons-nous avant que Gros-lard n’appelle ses amis.
Je ramassai sa méchante valise, cherchai des yeux un taxi.
Tout en époussetant sa robe imprimée miteuse, elle se frotta le visage à l’endroit où Gros-lard l’avait frappée, haussa les épaules et dit : « Grand garçon1, je suis de votre côté. »
Alors, laissez tomber le « garçon », répliquai-je sèchement.
Je pris son bagage dans une main, sa main osseuse dans l’autre, et nous commencions à nous éloigner lorsque Cuzo ouvrit la fenêtre de l’hôtel et laissa échapper un torrent d’espagnol. Blondinette s’arracha à ma
1 Le terme « boy » (garçon), systématiquement adressé aux Noirs, quels que soient leur âge et leur position sociale, était la règle dans les États du Sud, et parfois au-delà, et perdura après la déségrégation.
poigne, chancelant sur ses stupides talons aiguilles et hurla à son tour en espagnol. Sans connaître la langue, j’eus une idée à peu près précise de ce dont elle traitait la mère du matador.
Deux traîneurs de savate dans son ombre disparurent au moment où Cuzo me criait en anglais : « Ainsi, le señor à la peau sombre s’intéresser quand même à la viande, la viande de blonde. Comme on dit, les restes de l’un pouvoir devenir le mets de choix d’un autre ! »
Vous vous amusez avec des taureaux, qu’est-ce que vous savez des femmes ? braillai-je, me demandant jusqu’où je comptais faire monter El Indio, si même c’était bien mon intention.
Comme Blondinette venait de lui décocher une nouvelle salve d’insultes en espagnol, je l’attrapai par le bras.
C ’est bon, maintenant, tirons-nous !
Nous avions remonté la rue de quelques mètres quand j’entendis galoper derrière nous. Les deux types qui s’étaient esquivés arrivaient.
— Ne bougez pas, ordonnai-je à Blondinette, m’avançant vivement vers les deux bons à rien. Je ne vis rien dans leurs mains même si l’un des deux avait enfoui son poing droit au fond de sa poche de hanche. Ils s’attendaient que je m’arrête net, que je balance un coup de poing, en espérant atteindre quelqu’un. Le football m’a enseigné que c’est le coup inattendu qui met un gars hors-jeu. Je me contentai de les prendre de plein fouet,
mes cent kilos les envoyant rouler au sol.
Je leur tournai le dos, enjambai d’un bond un des clowns qui haletait, revins vers Blondinette.
Dites donc, pour un type de votre gabarit, vous sautez rudement bien. Vous les avez balancés comme de…
— O ù y a-t-il des taxis ?
En général, il y en a un garé au coin de la rue. Allons-y.
Attendez, ces saloperies de talons aiguilles, c’est l’enfer.
Elle se débarrassa de ses chaussures, se mit à courir pieds nus, sa longue chevelure blonde lui flottant dans le dos comme un drapeau. On tourna le coin, elle montra du doigt une vieille voiture, criant, hors d’haleine : « Taxi ! »
J’ouvris la portière, me glissai derrière elle dans le véhicule. Le chauffeur, un vieux type à face de lune portant une veste élimée de l’armée des États-Unis, n’avait pas cillé au spectacle d’une femme gringo courant nu-pieds. Nous accordant son meilleur sourire réservé aux touristes, il demanda : « Señor, où ai-je le plaisir de vous conduire ? »
Dans cette direction, et vite !
J’avais indiqué une rue sombre qui faisait l’angle devant nous.
Il sembla surpris. Blondinette haleta quelque chose en espagnol et le chauffeur haussa les épaules et décolla. En traversant la rue que nous avions parcourue en
courant, j’aperçus les deux types toujours vautrés par terre, sinon tout était paisible.
Pendant un bon moment, nous traversâmes à fond de train des rues entières de taudis ; enfin le chauffeur dit quelque chose en espagnol. Blondinette me demanda : « On va où, grand garçon ? C’est une voie sans issue. »
Je vous ai déjà dit de laisser tomber le truc du « garçon » ! Où comptiez-vous aller ?
N’ importe où où vous créchez, grand… compagnon, je n’ai pas un peso.
— Supposons que je vous prenne une chambre à mon hôtel ?
Je suppose que je serais d ’accord, pour ça et pour le reste, grand… type. Elle retroussa ses fines lèvres dans ce qui était supposé être un sourire alléchant.
— Je n’ai pas soupé. Ça vous tente, Mademoiselle… ?
Ne jamais manquer un repas, c’est ma maxime. Je m’appelle Janis Kent. Comment dois-je vous appeler, quand je ne serai plus en pétard?
Toussaint. Touie fera l’affaire.



DÎNER À DOUARNENEZ
SUIVI DE “NIGGER LOVER”
Lorsque j'ai vu Douarnenez, je suis retombé amoureux. La baie était envahie de petits bateaux de pêche et de gros chalutiers peints de couleurs voyantes; les filets bleus suspendus aux mâts ressemblaient à des voilages tombés du ciel; et, comme des mots jaillis de la bouche d'un agitateur pendant un meeting politique, les noms de beaucoup de ces embarcations vous interpelaient violemment: «Lénine», «Jean Jaurès», «Prolétaire», «Drapeau rouge», «L'Internationale», «Révolution», «Moscou». On avait surnommé la ville «Douarnenez la rouge»
RÉSUMÉ
Dîner à Douarnenez regroupe deux nouvelles de Claude McKay, écrivain sans frontières, auteur de Banjo et Romance in Marseille : "Dîner à Douarnenez" (inédit, retrouvé dans les archives personnelles de l'auteur) et "Nigger Lover", dont l'action se situe à Marseille, abordent de front la question des préjugés racistes dans la France des années 1920. Deux nouvelles sur son séjour et sur deux ports essentiels dans la construction d'une identité diasporique. Été 1925, Finistère. Claude McKay, qui voyage de Marseille à Saint-Pierre de Brest pour rendre visite à son ami Lucien, apprend en chemin le décès de ce dernier. Il erre alors sur le littoral breton et découvre le petit port de Douarnenez. De cette expérience, il tire un récit lumineux, ode à l’hospitalité et à une pensée transculturelle. Invité chez un pêcheur du village, le narrateur (qui pourrait bien être McKay lui-même) sera témoin d’un bouleversant récit d’amitié, à son tour fervente critique du racisme ordinaire.
Dans ces nouvelles, on retrouve l’infatigable écrivain-voyageur, qui vient nous murmurer, quelques années avant Banjo, Retour à Harlem ou Romance in Marseille, les germes de sa «pensée du large»
L'AUTEUR
Né en 1889 en Jamaïque, Claude McKay est l’auteur de recueils de poésie et de romans, parmi lesquels Home to Harlem (1928), Banjo (1929) et Romance in Marseille (publié de manière posthume en 2020). Il est considéré comme l'un des écrivains les plus emblématiques mais aussi les plus marginaux de la Renaissance de Harlem, reconnu pour son intense engagement à exprimer les défis et les problématiques auxquels sont confrontés les Noirs aux Etats-Unis et en Europe.



DÎNER À DOUARNENEZ
SUIVI DE NIGGER LOVER
NIGGER LOVER : MARSEILLE ACTE III
Après Banjo et Romance in Marseille, Nigger lover est le troisième récit “marseillais” de Claude McKay, qui a fréquemment séjourné dans la ville de 1924 à 1928. Publiée dans le recueil Gingertown (1933), cette nouvelle est l’histoire d’une rédemption, celle d’une prostituée qui, dépassant ses préjugés raciaux, gagne le surnom de “Nigger Lover” après sa rencontre avec un soutier noir.
Dans cette nouvelle, McKay redécouvre le quartier de la “Fosse” à Marseille en proposant une vision intérieure de ce quartier foisonnant, à travers ses lieux de débauche, et en s’immisçant dans les rapports interpersonnels qui y sont noués.
DOUARNENEZ, NOUVELLE INÉDITE
L’attrait de McKay pour Douarnenez avait déjà été évoqué dans son autobiographie, Un sacré bout de chemin. Conservée dans ses archives personnelles, cette nouvelle qui n'a toujours pas été publiée aux États-Unis, est un témoignage du voyage entrepris par Claude McKay en 1925, et qu’il relate dans sa correspondance. Un aperçu du tapuscrit original est proposé dans ce recueil


DÎNER À DOUARNENEZ / CLAUDE MCKAY
Collection : Harlem Shadows n°4
Parution : juin 2024
ISBN : 979-10-97210-13-7
Format : 115 x 175 mm
Prix : 12€ TTC
Nombre de pages : 100
Préface : Jarrett Brown
Traduction : Jean-Max Guieu
Dessins et graphisme : Carlos Chirivella Lopez

Préface : Valérie Berty
Dessins et graphisme : Carlos Chirivella Lopez
Directeur de collectio : Armando Coxe

LA COLLECTION : HARLEM SHADOWS
« Mecque noire », lieu providentiel et sacralisé, chargé d’un symbolisme fécond mais équivoque, le Harlem des années 1920 a cristallisé le rêve d’une ère nouvelle empreinte de liberté, de fierté raciale et de foisonnement culturel. Si le mouvement culturel qui y vit le jour se heurta rapidement à d’infranchissables dilemmes (volonté de respectabilité, d’élitisme et par conséquent méfiance des arts populaires) et finit par s’essouffler, l’ombre de la Renaissance de Harlem, à travers des voix et des talents comme ceux de Langston Hugues, Zora Neale Hurston, Claude McKay, Ann Petry, Aaron Douglas ou Duke Ellington, finira par s’étendre aux mouvements sociaux, politiques et culturels noirs du monde entier.
Avec cette collection, qui emprunte son nom au recueil de poésie de Claude McKay, Harlem Shadows, nous souhaitons mettre en lumière les voix singulières, les récits perdus ou périphériques qui ont gravité, gravitent et graviteront autour, en marge ou dans l’orbite du New Negro.
HÉLIOTROPISMES
Créée en 2017 à Marseille, Héliotropismes est une maison d’édition qui publie de la littérature des marges et s’intéresse aux mémoires sociales qui gravitent en périphérie. Elle porte une attention particulière aux récits-frontière qui retracent les expériences de l’exil, des marges sociales ou urbaines, sans aucune concession. Qu’ils se situent à l'intersection de plusieurs thématiques sociales, qu’ils soulignent la spécificité de conditions marginales et l’interaction des catégories de différence, les textes que nous défendons ont pour vocation de se situer à la croisée des genres, d’où leur trajectoire éditoriale passée, parfois accidentée. Notre maison d’édition fait le choix, au détriment d’une quelconque « identité » ou « ligne éditoriale » de mettre en avant la porosité, l’hybridité des genres littéraires et des sujets abordés. Notre démarche consiste avant tout à se mettre au service d'auteur.e.s dont nous admirons la seule liberté possible.



DÎNER À DOUARNENEZ / CLAUDE MCKAY
Collection : Harlem Shadows n°4
Parution : juin 2024
ISBN : 979-10-97210-13-7
Format : 115 x 175 mm
Nombre de pages : 100
Préface : Jarrett Brown
Traduction : Jean-Max Guieu
Dessins et graphisme : Carlos Chirivella Lopez




Format : 12,5 X 20,5 cm
En librairie en avril 2024
Pages : 64 p.
Reliure : broché, collé
Format : 12,5 X 20,5 cm
Genre : poésie
Pages : 64 p.
Prix : € 14 / CHF 20
Reliure : broché, collé
Genre : Poésie
ISBN : 978.2.8290-0709-5
Prix : € 14 / CHF 20
ISBN : 9782829007095
CONTACT PRESSE contact@enbas.ch damien.murith@gmail.com
CONTACT PRESSE contact@enbas.ch damien.murith@gmail.com
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne 021 323 39 18 contact@enbas.ch / www.enbas.net
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne
021 323 39 18 contact@enbas.ch / www.enbas.net
La fille de la brume
Damien Murith
Damien Murith Poésie
PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
Damien Murith explore la poésie des émotions rythmée par les saisons, le temps qui passe. La fille de la brume sera aussi celle des tempêtes mais encore la fille de l’encre et du papier.
AUTEUR
Damien Murith explore la poésie des émotions rythmée par les saisons, le temps qui passe. La fille de la brume sera aussi celle des tempêtes mais encore la fille de l'encre et du papier.
Damien Murith est né en 1970. Il vit en Suisse, dans le canton de Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs romans, d’un récit et de nouvelles, dont La Voix du violonelle paru en 2024 aux éditions d’en bas. Ses livres ont reçu de nombreux prix littéraires dont le Prix de la Fondation Claude Blancpain pour l’ensemble de ses ouvrages et le Prix de la Ville de Carouge, Yvette Zgraegen pour son roman Dans l’attente d’un autre ciel.
AUTEUR
Damien Murith est né en 1970. Il vit en Suisse, dans le canton de Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs romans, d’un récit et de nouvelles, dont La Voix du violoncelle paru en 2024 aux éditions d'en bas. Ses livres ont reçu de nombreux prix littéraires dont le Prix de la Fondation Claude Blancpain pour l’ensemble de ses ouvrages et le Prix de la Ville de Carouge, Yvette Zgraegen pour son roman Dans l’attente d’un autre ciel
Poésie
Au bord du terrain vague
Le ballon blanc
Crevé, abandonné
Comme la fin d’une partie de rire
Je suis la fin du rire
Et je crie par-dessus les silences
Convaincu de l’existence d’un écho
Qui me répondra sans fin.
Et si j’entre dans la bataille des arbres
Ce n’est que pour y chercher la clairière
Un chemin voudrait me rejoindre
Je ne peux lui offrir qu’un long tunnel d’ignorance
Mes yeux cherchent quelque chose que je ne connais pas
Un oiseau bleu ?
Un parterre de fleurs ?
Tout en bas du ciel
Là où les souvenirs prennent racine
Un reste de chaleur ?
Aucun baiser ne tombe
Du dos de mes hirondelles
Ivre du sang des ciels
Sommeil aux yeux de fièvres
Je suis ce qui dévore
Quel geste et quelle parole
Pour m’habiter ?
Quelle rosée désormais
Sera bue ?
Matin et soir sont réunis
Dans l’évidence
De l’absence.
Il y a de la nuit à traverser
Je la franchis au hasard
D’une bouteille lancée à la mer
Ma détresse ne se compte pas
En larmes versées
Mais en silences.
Qu’il est dur le réveil
Pour celle qui pensait
Avoir vaincu tous les vents !
Je promets au rêve
D’autres sommeils
D’autres merveilles
Venues de contrées
Sans mystères ni regrets
Ma bouche a-t-elle dit
Ce qui était à dire ?
Se rejoindre dans un peut-être.
Comme des persiennes
Ma vie se dessine
En lignes horizontales
Je suis la rue
Où marchent les invisibles
Vies contre vies
Toute humilité bue
Redessinant chaque soir
À bout de voix
Leurs désirs de grandeur
Je m’oblige à ne jamais être apaisée
C’est dans ce déséquilibre
Que se tisse la tendresse
Que se dénoue la colère.
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Pauline Von Aesch
Mon antérieur visage
« tu apparaîtrais si être était autre chose qu’un mot »
Mon antérieur visage, poème, est constitué de trois chapitres (« Mesure du non-être », « Le cycle noir », « Exister en cercle ») qui associent trajectoire orientée et circularité. Trajectoire orientée, celle qui conduit le lecteur vers une forme de dénuement que marque le minimalisme du troisième chapitre du livre. Circularité si l’on considère la figure omniprésente du cercle (les mots « boucle » ou « anneaux » dans le premier chapitre ; « cycle » et « cercle » dans les titres des deuxième et troisième chapitres), et que sténographie singulièrement la lettre « –e » qui se détache, dans sa solitude, à plusieurs reprises dans Mon antérieur visage – voire la figure d’un lieu où trouver place (le visage/le nom propre dans le premier chapitre ; la parole dans le deuxième ; la maison dans le troisième). Saisi entre ces deux mouvements – trajectoire orientée et circularité – on ne saurait mieux comparer la structure du livre qu’à une « spirale idéale » : une courbe qui irait s’élargissant en partant d’un point. Tout l’enjeu du livre est de manifester cet équilibre : art de la funambule, grâce.
Par son format Mon antérieur visage s’inscrit dans une série de publications qui se donne pour objet d’interroger les enjeux actuels de la métrique et de la prosodie. À cet égard, le nouveau livre de Pauline Von Aesch forme une proposition tout à fait singulière sur la question du vers aujourd’hui : plaçant au cœur de sa pratique le « e muet » dont on connaît l’importance dans la prosodie du français autant que dans les débats actuels sur le genre. Mais cette place centrale faite au « e muet » n’est pas l’objet d’un manifeste fracassant. Fidèle à la discrétion qui la caractérise, l’autrice ne promettra d’existence à ce « e muet » que dans et par la possibilité de son amuïssement. Pour le dire avec René Denizot cité en exergue du livre : « L’effacement n’efface rien. C’est pourquoi il ne laisse pas de trace. »
Pauline Von Aesch est née en 1988 à Créteil et travaille dans l’enseignement. Autrice rare, son œuvre a été repérée par Yves Di Manno et Isabelle Garron au point de conclure leur importante anthologie de poésie contemporaine : Un nouveau monde – poésie française 1960-2010.

(COUVERTURE PROVISOIRE)
Parution : juin 2025
Prix : 18 €
Pages : 96
Format : 17 x 21 cm
EAN : 9782917786987
Collection : brochée
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
même la page cette forme parfaite
(lorsque la parole ose prendre la parole)
elle non plus n’ouvre pas de nouvelle page
nous parlons sans cesser et sans parler nous cessons
parler vide il faut faire avec les creux dans la matière
suspendue —
rien ne se dépasse tout ne fait que s’égaler
montons dans chacune de nos entrées
la zone libre tient en ce millième
enroulée la boucle de la lettre –e
cela va se dire avant même la perspective d’une bouche
par compassion pour l’imprononçable, je devrais ne plus jamais parler
ce qui vient se placer est toujours ce qui trouve sa place
vous parlez : le monde duquel il ne faut pas disparaître
on heurte à proprement parler pas un jour sans le mot est une poche parfaite qui se vide et se reflue de terrible
la langue est-elle celle de son occupant qui s’épuise en en déplaçant les traînes (souffle)
on m’a tant parlé, pourtant si peu de choses parlaient de quelque chose
existe-t-il autre chose derrière le rien dont on ait définitivement rien à dire
nos paroles ont tout pour exprimer la forme et la durée pourtant ce qui essaie de vivre ne nous parle pas ma langue est-elle d’une détermination qui m’a dépassée autre que gisante ou résiduelle (parlé) je l’ai parlé pour en venir à bout
cela – rentre-t-il dans un sac ou est-ce la taille d’un autre univers

Héctor Viel Temperley Hôpital Britannique
Traduit de l’espagnol par Rafael Garido
15 x 20 cm 48 pages 978-2-493242-15-0
13 €
3 avril 2025
Comme l’écrit le poète argentin Héctor Viel Temperley dans l’entretien qui conclut ce livre, Hôpital Britannique est le livre d’un trépané. En 1984, il est opéré d’une tumeur au cerveau, et, à quelques jours d’intervalle, sa mère décède. « Nous avions passé trois mois alités tous les deux. Bon, ils m’opèrent la caboche et deux ou trois jours après je sors au jardin. J’étais au bras de ma femme. On s’est assis devant un pavillon, que j’appelle Pavillon Rosetto. Des papillons volaient et il y avait quelques eucalyptus très beaux, rien d’autre que cela, puis j’ai été entouré et transpercé d’une sensation d’amour si intense qu’elle a ruiné ma vie dans le monde. »
Hôpital britannique est un long poème, celui d’une expérience mystique. Il s’agit d’un livre extraordinaire, autant du fait des conditions dans lesquelles il a été écrit que par ses procédés formels. En effet, Hector Viel Temperley compose ce poème en reprenant des vers de ses précédents livres qu’il décline plusieurs fois. Ces déclinaisons produisent une litanie bouleversante, qui convoquent la figure du Christ et celle de la mère de l’auteur.
Dans La fable mystique, Michel de Certeau écrit : « La mystique, comme littérature, compose des scénarios de corps. » Hector Viel Temperley écrit quant à lui au début de son poème : « J’avance vers ce que j’ai le moins connu dans ma vie : j’avance vers mon corps. » Le corps dont il est question, dans Hôpital Britannique, est celui d’un homme ouvert aux quatre vents, traversé par des sensations si fortes qu’elles abolissent les frontières du temps et de l’espace.
La traduction que nous proposons a été réalisée par Rafael Garido.
Hector Viel Temperley est né en 1933 à Buenos Aires. De sa vie nous savons peu de choses, hormis qu’il a publié sept livres, la plupart à compte d’auteur et qu’il est mort en 1987, à la suite d’une longue maladie. Ses oeuvres complètes ont depuis été publiés en Argentine et Espagne et ses poèmes traduits en anglais.

Long coin d’été
Quelqu’un me haït devant le soleil où ma mère me jeta. J’ai besoin d’être dans le noir, besoin de retourner à l’homme. Je ne veux pas que la jeune fille me touche, ni le rufian, ni l’œil du pouvoir, ni la science du monde. Je ne veux pas être touché par les rêves.
Le nain qui est mon ange gardien monte en chancelant les quelques marches en bois mitraillées par les soleils ; et sur la rambarde en couronnes d’épines, la pierre de son anneau est un croisé qui grimpe en somnolant une colline : bordels vides et petits, boulangeries ouvertes mais très petites, théâtres petits mais fermés — et plus haut, yeux de catacombes, lointains regards de catacombes derrière de sombres cils à fleur de terre.
Un requin pourrit à vingt mètres. Un requin petit — une balle avec des entailles, un accordéon ouvert — pourrit et m’accompagne. Un requin — un criquet en silence sur le sol en terre, à côté d’un tambour d’eau, dans un magasin de pneus à plusieurs mètres de la route — pourrit à vingt mètres du soleil dans ma tête : Le soleil comme les portes, avec deux hommes infiniment blancs, d’une école militaire dans un désert ; une école militaire qui n’est plus qu’un désert dans un lieu à l’intérieur de cette plage que l’avenir fuit. (1984)
Long coin d’été
Ne mourra-t-elle jamais, la sensation que le démon peut se servir des cieux, et des nuages et des oiseaux, pour m’observer les entrailles ?
Des amis morts qui marchent dans les soirs gris vers des frontons de pelote solitaires : Le rufian qui me regarde sourit comme si je pouvais la désirer encore.
Ça se couvre et se découvre. Je m’enfonce dans ma chair ; je m’enfonce dans l’église aux égouts à ciel ouvert en laquelle je crois. J’attends la résurrection — j’attends son explosion contre mes ennemis — dans ce corps, en ce jour, sur cette plage. Rien ne peut empêcher que sur sa Jambe me fouettent telle une cotte de maille — et brûlent sans aucune Histoire en moi — les têtes d’allumettes de tout le Temps.
J’ai la toux des vieux fusils d’un Tir Fédéral dans les yeux. Ma vie est un désert entre deux guerres. J’ai besoin d’être dans le noir. J’ai besoin de dormir, mais le soleil me réveille. Le soleil, à travers mes paupières, comme des ailes de mouettes qui jettent de la chaux sur toute ma vie ; le soleil comme une zone qui m’avait oublié ; le soleil comme des éclats d’écume à mes confins ; le soleil comme deux jeunes vigies dans une tempête de lumière qui a englouti la mer, les voiles et le ciel. (1984)
Long coin d’été
La bouche ouverte au vent qui emporte les mouches, le requin pourrit à vingt mètres. Le requin s’évanouit, il flotte au-dessus du dernier siège de la plage — de l’omnibus qui monte avec les rats nauséeux et dans le froid et commence à se fendre en deux et à se détacher de l’essuie-glace, qui dans les yeux de la mer était sa pluie.
Je me suis habitué à les voir arriver avec les nuages pour changer ma vie. Je me suis habitué à ce qu’elles me manquent sous le ciel : silencieuses, sans bagage, avec une brosse à dents entre leurs mains. Je me suis habitué à leur ventre sans époux, jeunes femmes enceintes qui haïssent le sable qui me couvre. (1984)
Long coin d’été
Tout le sable de cette plage veut-il remplir ma bouche ? Toute faim de Visage ensanglanté veut-elle désormais manger du sable et s’oublier ?
Des oiseaux de mer qui reviennent de la vitesse de Dieu dans ma tête : Je ne me sépare pas des claires parallèles en bois qui tatouaient la peau de mes bras tout près des aisselles ; je ne me sépare pas de la seule demeure — sans murs ni toit — que j’ai eu dans le diamant en feu en tant qu’étranger loin du centre des cours vides de l’été, et je suis faim de sables — et faim de Visage ensanglanté.
Mais, comme assiégé par une éternité, puis-je faire violence pour qu’apparaisse Ton Corps, qui est mon repentir ? Puis-je faire violence avec le pugiliste africain en fer et au ventre matelassé qui est ma pièce sans lumière à treize heures cependant que la mer — dehors — ressemble à une armurerie ? Deux mille ans d’espoir, de sable et de jeune fille morte peuvent-ils faire violence ? Avec l’humidité d’une boutique qui vendait des cigarettes brunes, des révolvers pas chers et des rubans colorés pour les costumes du Carnaval, peut-on encore faire violence ?
Sans Ton Corps sur terre il meurt privé de sang celui qui ne meurt pas en martyr ; sans Ton Corps sur terre je suis l’arrière-boutique d’un commerce où se défont les chaînes, les boussoles, les gouvernails — lentement comme des hosties — sous un ventilateur de plafond terne ; sans Ton Corps sur terre je ne sais pas comment demander pardon à une jeune fille sur la pointe de faux couverte de rosée de l’aile gauche du cimetière allemand (et le bord de mer — écume et eau glacée sur les joues — est parfois un homme qui se rase sans envie jour après jour. (1985)
Long
coin d’été
Suis-je le matelot à la couronne d’épines qui ne voit pas ses ailes hors du navire, qui ne voit pas ton Visage sur l’affiche collée à la coque et déchirée par le vent et qui ne sait pas encore que Ton Visage est plus que toute la mer quand elle lance ses dés contre une digue noire de cuisinière
en fonte qui attend quelques hommes dans le soleil où il neige ? (1985)
Ton visage
Ton visage comme du sang très obscur dans une gamelle de soldat, parmi des cuisinières froides et sous un soleil de neige ; Ton Visage comme une conversation parmi des ruches prises de vertige sur la plaine de l’été ; Ton Visage comme une ombre verte et noire avec des bêlements tout proche de mon haleine et de mon révolver ; Ton Visage comme une ombre verte et noire qui descend au galop, chaque soir, depuis une pampa à deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer ; Ton Visage comme des ruisseaux de violettes tombant lentement depuis des coqs de combat ; Ton Visage comme des ruisseaux de violettes qui arrosent de vitraux un hôpital au-dessus d’un ravin. (1985)
éditions Hourra
genre poésie
thèmes
queer, anxiété, adelphité
fiche technique
64 pages offset noir
Sirio color celeste & clairbook ivoire brochures cousues
format 11×18 cm prix 15 €
parution 05/2025 contact
diffusion Paon diffusion paon.diffusion@gmail.com
distribution
Serendip-livres contact@serendip-livres.fr
édition
Hourra contact@editions-hourra.net
Mise en alerte Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie

Mise en alerte recueille des poèmes queers et désenchantés qui résistent à l’anxiété par la contemplation du monde, la recherche de communauté et une quête profonde de tranquillité.
éditions
Hourra
Mise en alerte
Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie
Mise en alerte est un souffle de résistance de la part d’une génération étouffée par l’angoisse et la normativité. Par son apport à la poésie lesbienne contemporaine et cette proposition expérimentale, Roni Burger-Leenhardt contribue à une culture queer et féministe de la radicalité.
le livre
Comment pourrait-on rester tranquille dans un monde qui ne veut pas qu’on le soit ? Mise en alerte est une observation attentive du monde, des corps et de soi. Dans ce recueil d’environ 40 poèmes, Roni Burger-Leenhardt nous confie un point de vue désenchanté sur un décor gâché par le capitalisme et le patriarcat.
Contre l’autorité, qui dévaste, et pour survivre à l’angoisse, l’autrice nous fait comprendre en sous-texte que, ce qui sauve, c’est la communauté, le rapport aux autres, dans le sexe comme dans l’amitié. Animée par des désirs lesbiens, et naviguant dans des références aux cultures queers, on l’accompagne dans sa poursuite de la tranquillité et dans une géographie des corps qui tantôt donne chaud, tantôt nous interroge sur nos drôles d’enveloppes.
Dans ce texte, tout est queer, rien n’est rose ; la culture lesbienne et urbaine que traverse Roni Burger-Leenhardt est teintée d’angoisses et de dépendances pas toujours bienvenues à l’industrie pharmaceutique. Ces angles critiques, parfois ironiques, permettent des saillies réjouissantes dans sa poésie.
L’anxiété globale qu’elle évoque est commune, elle dépeint une destruction permanente de l’environnement. Lorsque Roni BurgerLeenhardt nomme avec précision les arbres et les plantes, ou qu’elle énumère les noms d’insecte, on ne peut s’empêcher d’avoir en tête Rosa Luxemburg, ses herbiers et surtout sa connaissance des oiseaux : il faut savoir nommer les choses pour les chérir et les protéger. Comme Rosa, nul doute que Roni ne soit frappée d’une fusion presque maladive avec la nature.
éditions Hourra
Mise en alerte
Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie

Poème dont est issu le titre du livre. ↑
Il donne le ton : on ne se laissera plus faire.
éditions Hourra
Mise en alerte
Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie
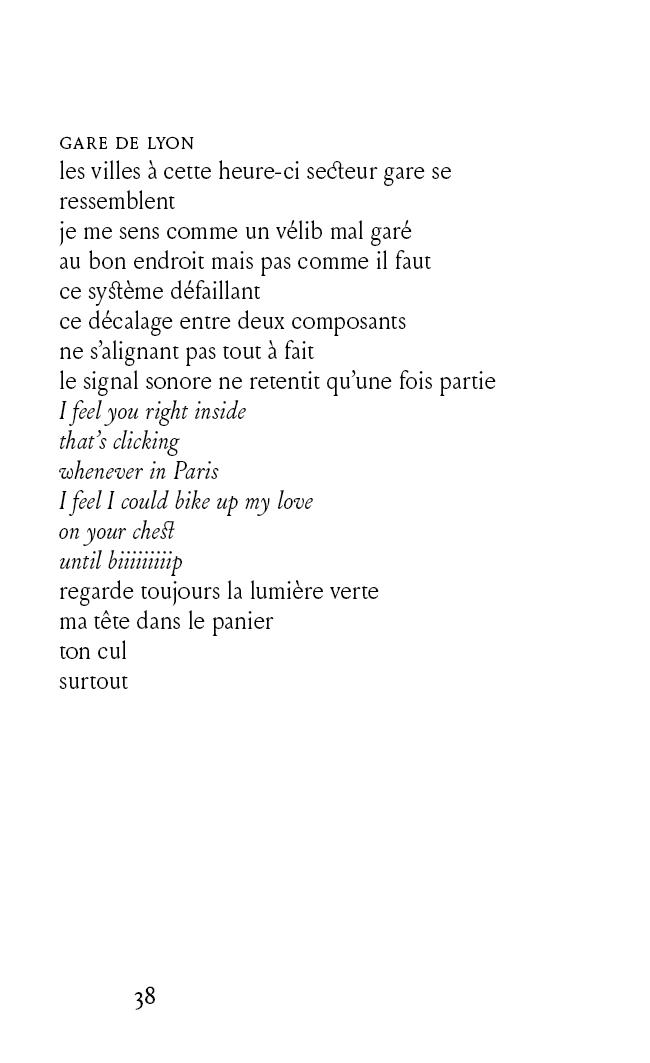
Une écriture familière qui permet de s’identifier à ce sentiment d’inconfort dans le monde.
éditions Hourra
roni burger-leenhard - autrice
Roni Burger-Leenhardt, née en 1996 à Toulouse, est une artiste et autrice installée à Marseille. En tant que personne queer, elle propose un point de vue affranchi du male gaze et son travail artistique se trouve imprégné d’une démarche intime et politique palpable aussi bien dans ses textes que dans les personnes et lieux qu’elle photographie. Dans la vie comme dans son travail, elle appréhende les luttes sociales et la notion d’adelphité par un ralentissement général et une attention particulière au quotidien.
Mise en alerte
Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie

éditions
Hourra
la maison d’édition
— Honneur à celles par qui le scandale arrive !
Hourra : cri de joie, cri de guerre
Les éditions Hourra publient de la poésie et des écrits sur l’art. Créée en 2019 sur la montagne limousine, la maison naît de l’envie de défendre des pratiques d’écritures marginales où se rencontrent le poétique et le politique. Fruit d’amitiés et d’intuitions communes, elle réunit des artistes et des autrices pour qui la révolte fait corps avec la beauté.
Mise en alerte
Roni Burger-Leenhardt
isbn 978-2-491297-10-7 poésie

éditions hourra
36, avenue Porte de la Corrèze 19170 Lacelle
www.editions-hourra.net
ÉDITIONS LURLURE

PARUTION JUIN 2025
FILLES BLEUES
Ivar Ch’Vavar
Genre : Poésie
Collection : Poésie
Prix : 21 euros
Format : 18 x 18 cm
Nombre de pages : 200
ISBN : 979-10-95997-65-8
> Une anthologie de poèmes de l’un des poètes français contemporains les plus importants
> Une traversée de l’œuvre d’Ivar Ch’Vavar autour de plusieurs de ses motifs et thèmes essentiels
> LE LIVRE
Filles bleues est une anthologie de poèmes d’Ivar Ch’Vavar, composée de textes écrits sur plusieurs décennies. Elle propose une traversée de l’œuvre du poète autour de quelques-uns des motifs et thèmes essentiels – et récurrents – chez lui : la mer et la plage (en l’occurrence celle de Berck-sur-Mer, ville de naissance du poète), l’amour, l’amitié, le sexe.
Hommage donc à un lieu (Berck, indissociable de la mer) mais également à de nombreuses femmes, réelles ou fictives – on y croisera plusieurs poétesses, par exemple Évelyne Nourtier (fictive) et Sylvia Plath, dont Ivar Ch’Vavar a traduit en français et en berckois (une forme du picard) le long poème Berck-Plage, reproduit ici).
Si elle est composée de textes formellement très différents les uns des autres (poèmes en vers libres, en vers comptés, proses...), on peut cependant lire cette anthologie comme un seul grand et même poème (par son unité de lieu et de thèmes), porté par un esprit de liberté tout à fait salubre aujourd’hui.

Ivar Ch’Vavar (Pierre Ivart) est né à Berck-sur-Mer en 1951. Il a dirigé plusieurs revues et publié de nombreux livres de poésie dont, aux éditions Lurlure, Cadavre grand m’a raconté (2015, coédition avec Le corridor bleu), La Vache d’entropie (2018), Échafaudages dans les bois (2022, coédition avec Le corridor bleu), Le Tombeau de Jules Renard (2023), ainsi qu’une édition critique des Vers nouveaux d’Arthur Rimbaud (2019, réédition 2021).
En 2008, une réédition de sa revue Le Jardin ouvrier a paru chez Flammarion et, en 2012, une anthologie de ses poèmes, chez le même éditeur, sous le titre Le Marasme chaussé.
En mai 2024, la revue de littérature Le Matricule des Anges lui consacre un important dossier.



“Homme de revue, défricheur de la langue picarde, toujours en quête d’une poésie populaire, Ivar Ch’Vavar déploie une œuvre à la beauté sauvage, rivage à la fois solarisé et crépusculaire où se dépose la mémoire d’une terre et de ses habitants.”
Le Matricule des Anges



suite défaite
sur la plage
Ce poème dit comment la blancheur des nuages s’est construite et déconstruite.
A été là, puis ne l’a plus été. C’est ainsi que, souvent, ça se fait. Alors le ciel bleu, c’est ÉNORME —.
Quelque chose à quoi on ne peut s’ha bituer, c’est plus qu’étrange : stupéfiant.
Ça arrête tout, de voir combien le ciel est bleu, comme il y a du bleu, CE bleu. — Le poème se fait, se défait.
C’est une théorie, comme quoi il ne serait ni fait ni à faire (facile !). Il faut seulement aboutir à l’évidence.
Comme une plage, et l’odeur de la mer aussi. Comme le bleu du ciel qui dépasse, déborde de toutes parts le ciel bleu. Quand on en a plein les yeux, plein le nez —.
Plein les bras. Plein d’être en nous, plein nous — notre être et tout l’être, là, tout bête, tout autour, à attraper facilement (qu’on croit).
chaleur
La nuit est comme un tube quand on est dedans. Ou comme un dôme quand on est dessous. Rien que ça, c’est déjà une émotion, un entraînement sexuel. — Alors quand on est plusieurs garçons et filles !... Oui, la nuit et tout ce qu’il y a dedans. Depuis les quasars, les queues de comètes, les orbites, la matière noire, bourdonnante, la glaire stellaire. Enfin, on sait ça. Mais dans ce poème, pour une raison ou une autre les filles et les garçons ne peuvent se toucher (avec leurs mains ou leurs lèvres). Ils peuvent seulement sentir la vibration qu’il y a entre eux, se concentrer dessus. — Être impudiquement attentifs. Ils ne peuvent pas se rejoindre. Ils doivent apprendre ce que c’est
que la solitude, la finitude, même plutôt.
/
Maintenant c’est dans la journée que nous sommes. Attention ! c’est —
C’est dans la stridence du jour, l’éclaboussement blanc, le resplendissement scandaleux, intolérable de midi. On voit la mer, qui arrive jusqu’ici mais la chaleur, il fait réellement trop chaud. Tout reste brut et vague en même temps.
C’est l’incandescence (indécence) et le chant de la journée qui ne sera bientôt plus qu’un fil qui stridule et cherche visi blement à périr en se recroquevillant — plus vite que le son ! — avec un son qui casse.
EXTRAIT 2 : sirène grise
J’écoute la sirène des pompiers. Je referme la fenêtre C’est une vague. Soleil-méduse dérive dans l’air (je ne l’ai regardé qu’en vitesse). Je mets un disque sur le pick-up : JOHNNY WINTER l’albinos fou ! Il me tire les nerfs un hiver durant.
Ça dure un hiver.
Jusqu’au Noël, nuages gris et pluie. Poches d’électricité sur la mer. Mouettes geignardes découpées dans l’air par un trou de ma mémoire. Je n’entends qu’une minute dans un mois mon cœur qui bat. La mer tourne ses pages sur une plage blanche comme de la cendre. Le bruit de mon cerveau parasite le ciel, le froissement du vent frais à mes tempes. Le visage de Johnny Winter dérive dans le ciel gris tout est gris.
Sylvia Plath, Berck-Plage (second essai de traduction)
(I)
Alors voilà la mer, ce grand vide.
Qu’est-ce que le cataplasme du soleil tire sur mon inflammation !
Les couleurs électrisantes des sorbets, puisés dans la glacière
Par des jeunes filles pâles, traversent l’air dans des mains brûlées.
Pourquoi est-ce si calme, ici, qu’est-ce qu’on nous cache ?
Moi j’ai deux jambes, et j’avance en souriant.
Une sourdine de sable estourbit les vibrations ; Ça s’étire sur des kilomètres — voix amenuisées
Flottant sans support, rapetissées de moitié.
Les rayons de l’œil, blessés par ces surfaces chauves,
Font boomerang, comme des élastiques retenus, frappant leur [possesseur.
Est-ce étonnant, alors, s’il porte des lunettes noires ?
Est-ce étonnant, qu’il se montre ainsi en soutane ? maintenant le voilà au milieu des pêcheurs de maquereaux
Qui font un mur contre lui de leurs dos.
Ils sont en train de manier les losanges vert et noir comme les [morceaux d’un corps.
La mer, qui les a cristallisés,
Se retire en rampant, lacis de serpents, avec un long sifflement de [détresse.
LE TOMBEAU DE JULES RENARD
Ivar Ch’Vavar

ISBN:
979-10-95997-48-1
56 pages
10,5 x 16 cm
9 euros
Parution: 05/05/2023
“Un animal est déjà une métaphore sur pattes : il est une image poétique incarnée, une métamorphose en acte, improbable et néanmoins réalisée là sous nos yeux.”
Laurent Albarracin, préface.
Le Tombeau de Jules Renard : un bestiaire, en mémoire de l’auteur d’Histoires naturelles. Jules Renard mérite qu’on se souvienne de lui.
Des haïkus – mais dont Ivar Ch’Vavar pervertit le genre. Ce qui l’intéresse avant tout, ici, c’est comment se forme, s’articule, se déploie (ou évite de se déployer), comment « fonctionne » une image poétique. Quel est le « mode opératoire » de celle-ci ou de celle-là, voilà la question posée dans ces poèmes. Laurent Albarracin s’est chargé dans sa préface d’identifier et de définir quelques-uns de ceux à l’œuvre dans ce recueil.
Avec un frontispice de Dominique Scaglia.
Ivar Ch’Vavar
CHEF D’ÉQUIPÉES HOMME DE REVUES, DÉFRICHEUR DE LA LANGUE PICARDE, TOUJOURS EN QUÊTE D’UNE POÉSIE POPULAIRE, IVAR CH’VAVAR DÉPLOIE UNE ŒUVRE À LA BEAUTÉ SAUVAGE, RIVAGE À LA FOIS SOLARISÉ ET CRÉPUSCULAIRE OÙ SE DÉPOSE LA MÉMOIRE D’UNE TERRE ET DE SES HABITANTS. Il est grand. Un Haut de France, de Picardie ! Il peut paraître immense à l’instar d’un René Char dont il détourne, iconoclaste, les Feuillets d’Hypnos en Feuillées d’Hypnos. Il s’exprime d’une voix forte, qui incante, d’une écriture hénaurme, inventive, folle, qui cascade d’aval en amont, prosaïque, métabolique, obscène, contrainte… les mots manquent. Souvent, il agite des ailes de géant, pieds et semelles pétris d’argile. Il n’est pas facile de s’extraire de la boue et de voler… de ses propres ailes quand on est (né) crabe… Ivar Ch’Vavar (crabe en picard) naquit le 13 mars 1951.
l’âne il dort dans une forêt de cils alors un long serpent rougeâtre lui sort du ventre humer le monde.
le bélier il court il court le bélier sur la spirale de ses cornes –il vient s’affronter à lui-même.
la cane elle se rend au rivage avec sur la hanche son panier de linge qu’elle bascule dans l’eau.
la corneille elle nage – crawl et brasse –dans le ciel tout gris tout blanc et croasse après sa race.
le hérisson c’est la herse et le pont-levis sa vie. Il fait avec.
la chèvre c’est une femme à barbichette curieuse – une intellectuelle qui lit Heidegger couramment.
la poule 1 (à Rimbaud) comme délire, elle tire les élastiques de sous l’herbe dressés puis a un haut-le-cœur.
la poule 2 pourquoi la poule tout à coup tord son cou et jette un œil au zénith?
la poule 3 picorant, elle montre à tous l’orifice d’où tel œuf a glissé dont elle-même est née.
LA VACHE D’ENTROPIE
Ivar Ch’Vavar

ISBN:
979-10-95997-14-6
136 pages
150 x 210 mm
16 euros
Parution: 04/01/2019
La justification : une contrainte qui bouleverse du tout au tout les conditions et les moyens de la pratique poétique.
Ivar Ch’Vavar a écrit son dernier poème justifié, La vache d’entropie, en 2018 – poème exclamatif où l’humour ne lâche pas un seul instant le coude de la déploration et de la vocifération. Il en a fait le texte éponyme de ce livre où il reprend, à la suite, ses poèmes justifiés les plus anciens, Totems chtis, Au tombeau de Tarkos, La grande tapisserie et bien d’autres, dont certains n’avaient jamais été publiés.
Le regroupement de ces écrits permet, tout en visitant le monde si déroutant d’Ivar Ch’Vavar, de mieux voir à quel point la justification change aujourd’hui le visage de la poésie.
Ivar Ch’Vavar
CHEF D’ÉQUIPÉES HOMME DE REVUES, DÉFRICHEUR DE LA LANGUE PICARDE, TOUJOURS EN QUÊTE D’UNE POÉSIE POPULAIRE, IVAR CH’VAVAR DÉPLOIE UNE ŒUVRE À LA BEAUTÉ SAUVAGE, RIVAGE À LA FOIS SOLARISÉ ET CRÉPUSCULAIRE OÙ SE DÉPOSE LA MÉMOIRE D’UNE TERRE ET DE SES HABITANTS. Il est grand. Un Haut de France, de Picardie ! Il peut paraître immense à l’instar d’un René Char dont il détourne, iconoclaste, les Feuillets d’Hypnos en Feuillées d’Hypnos. Il s’exprime d’une voix forte, qui incante, d’une écriture hénaurme, inventive, folle, qui cascade d’aval en amont, prosaïque, métabolique, obscène, contrainte… les mots manquent. Souvent, il agite des ailes de géant, pieds et semelles pétris d’argile. Il n’est pas facile de s’extraire de la boue et de voler… de ses propres ailes quand on est (né) crabe… Ivar Ch’Vavar (crabe en picard) naquit le 13 mars 1951.
La vache d’entropie ! Je regarde les choses et le monde depuis Le cul des vaches, je prends la vache en long depuis son posté Ri.eur, son derrière : jusqu’à ce qu’il y a devant son devant, et Déjà, dans ce long — « vache en long » — je vois une pente qui N’est pas pour me remonter le moral. Enfin... je ne pense pas. Encore que... «la vache d’entropie », c’est d’abord une excla Mation. Et admirative, même ironiquement! Qui salue quand Même une manière d’exploit! Parce que dégringoler comme On le voit, et s’enfoncer toujours plus bas... il faut le faire, ça Mérite un coup de chapeau, avec quelle grimace, en tournant La tête, d’accord, en se détournant, oui, mais... quand même ! Bravo l’artiste ! Bravo, le pitre sinistre. Bravo le capitalisme — Saloperie !
Parce qu’on nous rit sous le nez, quand même, on Se touche ostensiblement du coude devant nous. Quelquefois, L’hilarité pousse son aboi, montre ses gencives, et ses canines. Peut-être ça arrive qu’ils se pissent dessus. Si je dis «sinistre » — Lui, il se marre bien, ce pitre. Non, c’est plutôt nous autres Qui trouvons ça... genre clown de funérarium. Sur des pentes Aussi déclives — admettons qu’il y a du mérite. Peut-être ; ou Peut-être sans doute pas. Nous, on a la gueule qui s’allonge : On ne trouve pas ça fendard. Leur plaisir ne nous amuse pas. Non. C’est la situation qui nous fait un peu rigoler, au fond, de Voir comment ils ont conduit ça de main de maître — valets!
Qu’ils sont, politiciens, journalistes, communicants, et même «Intellectuels», philosophes déclarés, psychanalystes pour le Prime time des télés! Et premiers cherront, le nez dans l’étron.
Alors on reprend un peu de causticité, on trouve à s’amuser, Nous aussi. On se pousse du coude, chacun son tour. Et on se Passe l’index sous le nez. Et on leur dit, chuintants de feinte
Admiration : La vache d’entropie, les amis! Trop cons sont-ils Sans doute, pour percevoir l’ironie. On peut bien se marrer.
Francesco Giusti

Genre : poésie
Traduction de l’italien et du vénitien par Mauro Bianchi
Préface de Giorgio Agamben Édition bilingue
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 144
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-487-558-09-0

Francesco (dit « Chicco ») Giusti naît à Venise en 1952. Résolument poète, il refuse toute sa vie le travail au sens commun du terme, se consacrant à l’écriture et au dessin. Venise, sa ville, constitue une source d’inspiration majeure, que ce soit par sa langue ou par les gens qu’il y rencontre, lors des nombreux festivals auxquels il participe.
Membre de la « tribu des poètes » aux côtés de Franco Beltrametti, John Gian, Rita Degli Esposti, Jim Koller, Tom Raworth, Julien Blaine et d’autres, il meurt à Venise en 2024, juste avant que ne soit signé le contrat pour cette publication, rendant pour la première fois accessible en français la poésie sublime de Francesco Giusti.
Attachée de presse : Sabine Norroy : snorroy@hotmail.com
Contact : colette.lambrichs@gmail.com


En 2019 paraissait en Italie, dans la belle maison d’édition Quodlibet, l’un des livres les plus importants de Francesco Giusti, Quando le ombre si staccano del muro (Quand les ombres se détachent du mur). Six ans plus tard, juste après la disparition brutale du poète, c’est le premier livre de Francesco Giusti à paraître en France, un livre singulier puisqu’il avait déjà été édité en Italie en édition bilingue : les poèmes écrits en dialecte vénitien furent traduits par Giusti en italien, et vice-versa, interrogeant ce qui fonde depuis Dante un questionnement poétique propre à l’Italie, sur lequel se penche Giorgio Agamben dans une dense et éclairante préface. L’édition française sera elle aussi bilingue, donnant en page de gauche le poème dans sa version originale (tantôt vénitienne, tantôt italienne), en page de droite la traduction française. Un dialogue entre les langues, donc, de même qu’entre le poète et le philosophe, comme en témoigne le poème « Un philosophe à Venise ».
Téléphone : 06 35 54 05 85
Téléphone : 06 60 40 19 16
Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr
Téléphone : 06 62 68 55 13
Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils
© Héloïse Faure


En librairie Juin 2025
format : 21 x 29,8 cm
pages : 102 p.
reliure : broché, collé
rayon : Poésie
collection : À plus d’un titre
prix : 15€
ISBN 978-2-8290-0710-1
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 301003
Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain –93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux
93450 L'Île-St-Denis
+33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
Ce pays d’où tu viens
Les galets de l'oubli
Salah Oudahar
PRÉSENTATION
« Ce pays d’où tu viens
Ses rêves
Ses brûlures
Ses lèvres
Sa bouche nue »
C’est une géographie personnelle de son pays natal l’Algérie que Salah Oudahar trace dans ses poèmes au lyrisme concentré, aux paroles sobres et puissantes pour évoquer les paysages, les vestiges de l’Histoire et les balafres des guerres. Au-delà de ces histoires intimes aux parfums de jasmin, de basilic, de figuiers et de grenadiers, se forgent les récits de l’exil, la force des amitiés, des compagnonnages littéraires.
On y croise des figures aimées, des fantômes et des absents, la tête lourde et le cœur serré. Les poèmes où les mots seuls s’enchaînent sur la page, sont autant de voix qui résonnent et convoquent les lumières de juillet, les nuits pleines d’étoiles et les eaux glacées de décembre. Les pierres, galets et rochers sont les témoins sur les chemins de ces vies multiples.
Les textes et les photographies qui les accompagnent se placent dans ce creuset qui fait se croiser et se fracasser des histoires simples, le quotidien paisible et le surgissement du fracas du monde et son cortège de violences. Ces figures complexes sont évoquées avec simplicité et ce qui frappe dans la poésie de Salah Oudahar c’est la puissance évocatrice des textes, leur rythme paisible, joyeux et soudain vibrant et empli de souffles brûlants.
AUTEUR
Salah Oudahar est poète, metteur en scène, comédien. Diplômé de sciences politiques, il enseigne à l’Université de Tizi-Ouzou jusqu’en 1992, date à laquelle il quitte l’Algérie pour s’établir à Strasbourg où il développe un travail au croisement de la recherche, de la création artistique, de l’action culturelle, sur les questions d’histoire et de mémoire. Il est membre fondateur, ancien Directeur artistique du Festival Strasbourg-Méditerranée, ancien Président de la Cie Mémoires vives.
Main blessée
Tendue
Matin incertain
En tes traversées nocturnes
Port témoin
D’incessants départs
Cette guerre ses morts
Ses violences ses béances
Tu errais sur les quais
Dans le fracas des vagues contre la jetée
Les cris des torturés montaient des ruines
Ils te poursuivent encore ils hantent tes nuits
Tes blancs tes gouffres
Ton besoin de paix de justice inassouvi
Lueur au loin
Dans cette nuit ta demeure
Faible
Vacillante
Des bruits de pas
Le retour de l’absent ?
Un mince filet d’eau en suspens
Dans la roche calcinée du temps
Port transi déserté
Ses quais battus par les vents
Que sont les bateaux les marins
Les désirs de voyage devenus ?
Les amours
Les ivresses
La fille qui courait sur la plage
Derrière les promesses de l’ailleurs
Ses parfums
Ses rires
Ses noces
Ses bijoux
Le sel de sa main
Ses rêves d’enfant
Nuit
Je chemine
Lanterne en émoi
Je t’entraperçois
Eclair vif
Entre deux songes
Entre deux tombes
Signe
Présence
Trace
Témoin
De tes pas en ces lieux
Des tracés du temps
Des sillons toujours recommencés
Ton père ses meules à grains ses pierres
Ta mère son pain chaud
Son métier à tisser ses chants ses rires ses youyous
Le retour des champs au soleil couchant
Les derniers parfums de l’été
Le jasmin
Le basilic
Les figuiers
Les grenadiers
Qui bordaient le chemin de la maison
Les témoins du temps et autres traces


66 chemin de Bande La Curiaz 73360 LA BAUCHE aplusduntitre69@orange.fr www.aplusduntitre.org
Les témoins du temps et autres traces de Salah Oudahar
Collection : Les cahiers de poésie
Format 21 par 29,7 cm Pages 110
Reliure : Dos carré collé cousu
Impression : sur papier couché 135 gr Couv. 2 rabats : sur papier Rives 235 gr
ISBN : 9782917486726
Prix : € 15 / CHF.- 20
Parution :septembre 2021
Rayon : Poésie
Le poète déroule un récit éclaté sur plusieurs dimensions dans une trame serrée autour de la question de l'identité. Celle-ci est déclinée à travers ses différents attributs maintenus sous une oppression et une négation séculaires, valeurs, langue, histoire et territoire semblent subir dans un mouvement de reflux une désertion qui prépare à son anéantissement. Serions-nous devant l'irréversible ? L'inerte et le vivant sont sollicités dans un soliloque évocateur qui sonde la mémoire et interroge le destin. Des mots ruisselants de poésie et de sens brisent le silence de la pierre, de la terre et de la mer pour témoigner du passé, oublié, nié ou perverti par les circonvolutions de l'histoire et l'arbitraire des hommes. Le récital aurait pu aussi s'intituler "De quelles vérités sommes-nous fait ?", car le voyage auquel nous convie l'artiste est une introspection sur nous mêmes, ce que nous fûmes et ce que nous sommes devenus à notre insu. Les pierres antiques parlent, racontent et font méditer ceux qui les observent. Salah Oudahar les côtoie dès son premier éveil à la vie, elles font partie du décor de son enfance, elles captivent sa sensibilité. Il s'empare de leurs murmures et pénètre le mystère du temps qui passe qu'elles portent dans leur silence éternel. Que reste-t-il des temps héroïques plein de gloires et de promesses ? Un vol de mouette au-dessus des plages muettes ? Des pierres figées dépouillées de leur histoire par l'indifférence générale qui les condamne à devenir poussière?des rêves en ruines délaissés par des hommes jadis libres ? Une mer qui n'appelle qu'aux départs ? Tous les combats seraient-ils vains quand la souffrance, l'exil et l'errance pèsent sur les jours présents et menacent ceux à venir ? Que vaut un retour d'exil quand la rupture est déjà consommée ? L'aède déclame son ire et sa douleur, mais ne se résigne ni à l'impuissance ni à l'abandon. La pierre, la terre, la mer, les hommes et les femmes de son pays lui collent au verbe dans un monologue qui rejette toute tentation de renoncement par humanité et amour de la liberté hérités de ses ancêtres.
Mokrane Gacem .
Salah Oudahar
Salah Oudahar est poète, metteur en scène, comédien, diplômé des sciences politiques, originaire des Iflissen/Tigzirt en Kabylie maritime. Il a enseigné à l’Université de Tizi-Ouzou jusqu’au en 1992, date à laquelle il a quitté l’Algérie pour s’établir Strasbourg où il développe depuis un travail au croisement de la recherche, de la création artistique, de l’action culturelle, sur les questions d’histoire et de mémoire.
Il a fondé notamment, avec Mokhtar Benaouda, le collectif de théâtre « Vibra- tions algériennes »(1995 -2000), laboratoire de création, de diffusion, de débat et d’échange- spectacles, mises en espaces, lectures, rencontres...- sur les écritures algériennes.
Il a crée l’atelier de théâtre « Mémoire et citoyenneté » (1997 -2003) sur les thématiques des mémoires coloniales, post coloniales et de l’immigration, collaboré avec le Centre européen de la jeune création/ Théâtre des lisières (1995-2003).
Il a organisé de nombreux évènements culturels, des séminaires et des col- loques, crée et monté des spectacles, dont « Dialogues d’Alsace et d’Algérie »de Joseph Schmittbiel, « Marianne et le Marabout « de Slimane Benaïssa, « Vibrations algériennes 1 et 2 »montage de textes d’auteurs algé riens, « Ecrire dans la guerre/ Kateb Yacine et le 8 mai 1945 » avec Pascale Spengler du collectif de théâtre les Foirades, « Matoub Lounès et les siens »« Par-delà les murs », (performance po étique, chorégraphique, musicale) « Les témoins du temps », exposition photos/textes, récital poétique et musical sur l’enfance dans la guerre, les thèmes de la migration, des traces, des ruines...
Il a dirigé avec Joël Isselé un ouvrage collectif « Tomber la frontière ! »,l’Harmatan 2007 (pour le festival Strasbourg-Méditerranée 2007.
Il est membre fondateur (1999) , Directeur artistique du Festival Strasbourg- Méditerranée et Président de la Cie (de théâtre et de danse) Mémoires vives.
Distribution pour la France : SERENDIP LIVRES : 10, rue Tesson 75010 Paris - contact@serendip-livres.fr Fax : 09 594 934 00 /// tél. : 01 40 38 18 14 - gencod dilicom : 3019000119404
Distribution et diffusion pour la Suisse : Éditions D'en bas - Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne
Tél. +41 21 323 39 18 /// Fax. +41 21 312 32 40 - www.enbas.net
Elguantdeplàsticrosa


En librairie juin 2025
Format : 12,5 x 20,5 cm
Pages: 112 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Poésie
Collection : Collection bilingue
Prix: 26 CHF.- / 20 €
ISBN 978-2-8290-0711-8
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne 021 323 39 18 contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Legantdeplastiquerose
Dolors Miquel
Traduit du catalan par
Lorrain Voisard & Amaranta Fontcuberta
PRÉSENTATION
Suite de poèmes lyriques, aigus et métaphysiques élaborés depuis une quinzaine d'années. Au cœur du recueil de Miquel se trouve une image centrale. Un homme anonyme en état de décomposition constante, en train de pourrir dans l'évier de la cuisine. Pièce par pièce, sa lente décomposition sous-tend une série d'images réalisées dans un langage sensuel, ludique et dynamique. Des vignettes frappantes tirées d'un langage quotidien, imprégnées de l'aura des écrits de la Renaissance catalane et dorées d'une patine de lumière, d'une surabondance d'ombre et d'un flou d'expériences sensorielles.
El guant de plàstic rosa abrite 36 études sur la dynamique de la décomposition. Le ronronnement et le bourdonnement des abeilles, les apartés, les vaches abattues, les montagnes de noyaux d'olives, le ronronnement d'un réfrigérateur vide en permanence et les rêves comestibles jonchés de dahlias et de roses, d'œillets et de chrysanthèmes colorés...
AUTEUR
Dolors Miquel (Lleida, 1960), l’une des voix poétiques les plus reconnues de la scène catalane contemporaine, a publié une quinzaine de recueils, parmi lesquels El vent i la casa tancada (Columna, 1990), Aioç (Edicions 62, 2004), Missa pagesa (Edicions 62, 2006), El guant de plàstic rosa (Edicions 62, 2017) et Ictiosaure (Edicions 62, 2019). L’autrice, à qui l’on a demandé de définir la poésie dans un tweet, écrit : « La poésie est un secret dans un secret dans un secret, etc. »
TRADUCTRICE & TRADUCTEUR
Né à Saint-Imier en 1987, Lorrain Voisard a grandi entre les campagnes et les villes. I l vit en Suisse et en Catalogne, travaille dans les jardins et dans les livres. Il a publié Au cœur de la bête aux éditions d'en bas en 2024.
Amaranta Fontcuberta
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom3019000119404
IL Y A UN HOMME QUI POURRIT DANS L’ÉVIER
Mordant le téton de la mère éternelle, étreignant le pénis du fécondateur, les entrailles sèches à la bouche, le vagin plein de mots blancs, du sperme entre mes seins… Ça fait trois cents jours et trois cents nuits que le souper est dans l’évier : Des montagnes de noyaux et de restes. La chaîne de fourchettes à la poupe, tel un navire qui s’enfonce dans des vagues de microbes. Le poisson mystique glisse entre le savon et le pain moisi Un grain de riz révolutionnaire au fond d’une casserole, à côté de la langouste décapitée. Se chamaillant jour et nuit dans un noyau. Dans le verdet un calice glisse vers la surface transparente. La raison m’engloutit le chaos. Une mouche tombe entre deux silences et entre trois, un spermatozoïde, entre quatre le candélabre de la voix se remplit de sang et la petite flamme du bonheur s’allume. L’épais manteau de brouillard recouvrira le tout. Croix et couteaux à la bouche. Canifs et roses à la voix. Les crânes des animaux se demandent si les yeux leur reviendront aux orbites pendant que leurs osselets s’emballent vers le trou bouché du temps. Mi-instinctivement, j’enfonce la main sous la pile de récipients et d’immondices et je le trouve. Il y a un homme qui pourrit dans l’évier. Lui et son sexe. Je les touche. Trois cents jours sans nettoyer. Trois cents nuits sans nettoyer. Je suis dégueulasse. Je cherche savons ammoniaque javel désincrustants soude déboucheurs, pendant que les vers trouent la télé, que les liquides me salissent les secondes et que l’esprit me plonge dans le barrage des émotions en un poumon libre et irréversible vers Lui.
(Je connais le nom de mon mort Et je le dis la bouche fermée).
LE GANT DE PLASTIQUE ROSE
Arrive un gant de plastique Rose, je lui dis salut gant de plastique Rose, tu es venu. Si tu viens c’est que quelqu’un t’envoie, quelqu’un qui connaît le prix du pain et du lait et des choses utiles. Quelqu’un qui pense à moi et t’envoie. Quelqu’un qui pense : elle est tombée sur un mort dans l’évier, quelqu’un qui sait ce que la vie peut être. Quelqu’un qui sait ce que ma vie est déjà. Un être exceptionnel. Un être qui n’est allé à aucune école. Un être qui pense à moi et qui sait que ce dont j’ai besoin n’est pas une Bible, ni un plan du cadastre ni une liste électorale ni une liste de mariage, mais un gant de plastique rose. Pas un signifiant mais un gant. Pas un signifiant mais un Rose. Le tutu rose sur les jambes sveltes et musclées de la danseuse cygne du ballet de Moscou. Et surtout l’idée de s’introduire dans le gant. La cuirasse du gant. L’âme entrant dans le gant et le corps entrant dans l’âme. Si ce quelqu’un connaît la sortie, qu’il le dise. Qu’il dise par exemple, tu marches tout droit et, à trois cents années-lumière, tu tires à droite et ensuite tu te déplaces vers le pôle nord du premier astre aimanté, et là devant tu traverses la porte de la cuisine, tu attrapes le tablier, la serpillère, le masque de Santa Ana de Teloxtoc où se distinguent encore le nez, des parties de la bouche et la mâchoire. Et tu commences le rituel. Comme faisaient les rois et les prêtres de l’Antiquité, tu commences, avec une vestale qui te regarde, tu commences.
DANSE DE L’ABEILLE
AVEC FLEUR MELLIFÈRE, FAUX BOURDON DISTRAIT ET GUÊPIER CHERCHANT UN NID (PREMIERS PRÉPARATIFS)
Maintenant l’abeille dépose le miel dans la mandibule, sur la langue tuméfiée. et danse devant son crâne : elle fait des cercles avec l’abdomen, battant de ses petites ailes.
En quiétude maximale et à vitesse maximale, la fleur mellifère et ses rhizomes de fécondité séduisent le faux-bourdon qui volait vers la consommation et qui s’arrête pour copuler la fleur, dos à la lumière.
Mon mort me demande : Combien de temps devrai-je supporter ça ?
J’ai des dards d’abeille emmêlés dans les trompes d’Eustache Et un guêpier tente de faire son nid avec mon phallus.
TOUCHER
Elle a touché ma jambe avec le tact de l’herbe mouillée quand tu te promènes dans les champs. Elle s’emmêla à mes cheveux et m’entra dans l’organisme avec l’air des montagnes qui se dirige vers la mer.
Elle n’était pas noire, elle était dorée et avait une couleur rose. Ses mains, anxieuses comme celles d’un nouveau-né, voulaient tout. Elle s’abandonna à mon sein et je lui ai donné mon lait sombre.
Parce que ses paroles étaient le cordon ombilical qui pendait de ma bouche.
Parce que sa non-voix était ma langue future.
Je n’allaiterai aucun fils avec tant de tristesse, avec tant de souci.
Polo Kouman/Polo parle
Henri-Michel Yéré
Préface de Marina Skalova
12,5 x 20,5 cm | 80 p. | broché, collé | ISBN 978-2-8290-0665-4 | 12 €

Henri-Michel Yéré
Mêlant passé, présent et avenir, Polo kouman/Polo parle est le nouveau recueil poétique de Henri Michel Yéré. Écrit en nouchi et en français, sous la forme d’un dialogue poétique entre Polo et l’Avenir, il démontre que la poésie possède, parmi l’éventail de ses pouvoirs, celui d’outrepasser la linéarité du temps et celui de démultiplier nos visions. Puisant dans les deux langues ce qu’elles ont de plus privé pour le révéler par la parole, les poèmes se répondent les uns aux autres et ne se ressemblent pas. Malgré l’abandon de ses ancêtres, Polo résiste, rêve et éprouve les désolations de l’existence et les espoirs qui en découlent. Si les visions sont multiples, une seule certitude émerge de ce recueil : lorsqu’il y a dialogue, toute solitude finit par disparaître.
« À ceux qui prétendent que je ne parle pas français : je veux dire que ma parole démolit les murs. Ceux qui m’ont entendu sont transformés. »
Henri-Michel Yéré est un poète ivoirien et suisse né en 1978 à Abidjan. Il a publié deux volumes de poésie : Mil Neuf Cent Quatre Vingt-Dix (Panafrika) et La nuit était notre seule arme (L’Harmattan), tous les deux parus en 2015. Mil Neuf Cent Quatre Vingt-Dix a fait partie de la sélection du Prix CoPo 2016 (France) et de celle du Prix Ivoire d’Expression Francophone 2016 (Côte d’Ivoire). La nuit était notre seule arme a reçu une Mention spéciale du Jury du Grand Prix National Bernard Dadié du Jeune Écrivain, également en 2016.
Les poèmes de Henri-Michel Yéré ont été traduits en allemand et publiés sur le magazine en ligne Stadtsprachen (stadtsprachen.de/en/author/henri-michel-yere).
Docteur en histoire contemporaine, Henri-Michel Yéré a étudié en France, en Afrique du Sud et en Suisse. Il vit à Bâle, où il est enseignant-chercheur. Marié, il est le père de trois enfants.
Un extrait
Mon tchapali s’est debout le jour le Vieux a parlé que c’est pas lui, alors que je commençais à grouiller dans ventre de la Vieille. Mon premier koumanli est sorti sec ; personne n’a sciencé ça que j’ai parlé. Moi seul je suis devenu mon gars-sûr. Le fanga n’est pas même chose dans mes deux pieds. La Vieille a été mon défenseur devant soleil. Pluie me dabassait on dirait tempête. C’est à cause de malin de pluie et de soleil sur moi que mon tchapali s’est djigui encore.
J’ai commencé à parler le jour où mon père a dit qu’il n’était pas mon père, alors que ma mère sentait la vie poindre en son sein. À ma première parole, aucun écho ; mes mots ne furent pas entendus. La solitude devint très tôt une amie. Mes deux jambes ne m’ont jamais porté avec une force égale. De fait, ma mère fut mon seul bouclier contre le soleil. Chaque pluie s’imposait à moi comme une tempête. Ma parole dût renaître, en tenant en respect une partie du ciel.
Ladro di minuzie / Voleur de détails, Poesie scelte / Poèmes choisis, 1969-2010
Alberto Nessi
2018 | 14 X 21 | BROCHÉ | 128 P.
ISBN 978-2-8290-0549-7
CHF 24.- | € 14.-

Alberto Nessi
Alberto Nessi, est l’un des auteurs actuels les plus reconnus de Suisse italienne. Christian Viredaz, le traducteur, propose dans ce livre une anthologie de tout son parcours poétique ; depuis le premier recueil I giorni feriali (Lugano, Pantarei, 1969), jusqu’à Ladro dei minuzie, « un choix de textes écrits entre 1969 et 2009 ». Cet ouvrage montre au lecteur, et notamment à celui qui ne connaîtrait pas Nessi, une voix qui frappe et étonne par sa cohérence (sur une période de quarante années !), forte d’un style narratif limpide et d’un engagement social constant avec une humanité qui « sans ignorer la lutte des classes, n’est pas vouée à la revanche historique » selon les mots de Mengaldo. La nature y apparaît celle d’aujourd’hui ou celle d’hier : la nature qui résiste au progrès forcené, mais devient toujours plus fragile, faible. Et de nombreux personnages du quotidien y prennent la parole pour parler de la vraie vie à travers la plume d’un auteur qui, étudiant déjà, « reniflait la poésie dans les compartiments de deuxième classe plutôt que dans les séminaires de littérature ».
Alberto Nessi est né en 1940 à Mendrisio. il a publié des romans, des récits, des nouvelles, de la poésie et des essais.
Christian Viredaz - le traducteur
Christian Viredaz est né à Oron-le-Châtel (VD) en 1955. Il a publié cinq recueils de poèmes entre 1976 et 1996, et traduit une vingtaine d’ouvrages, de l’italien surtout, depuis 1981. Il a également travaillé de 1989 à 2000 comme traducteur à la Croix-Rouge suisse et, depuis 2001 à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne. D’Alberto Nessi il a traduit Milò, La Nuit et le Pétale, Le Marteau de Tchékhov, Fleurs d’ombre, La Couleur de la Mauve, Le Train du Soir et Terra matta. Pour les éditions d’en bas, il a traduit, Giovanni Orelli, Le train des italiennes, et, de l’allemand, il a traduit la trilogie de Francesco Micieli, Je sais juste que mon père a de grosses mains, Le rire des moutons, Mon voyage en Italie, et Franz Hohler, Le Déluge de pierres.
Hart am Wind/Tout près du vent
Klaus Merz
2018 | 12.5 X 20.5 | BROCHÉ | 272 P.
ISBN 978-2-8290-0567-1
CHF 32.- | € 20.-

« Tout près du vent » est la traduction de deux recueils de poèmes de Klaus Merz, « Aus dem Staub/De la poussière de la terre » et « Unerwarteter Verlauf/Évolution inattendue » (Haymon, 2015).
« Aus dem Staub/De la poussière de la terre » Klaus Merz est un maître des formes courtes et concentrées. La résistance, titre d’un poème, résume à la fois la teneur du projet de ce recueil et de son écriture. En de courts vers épars, il développe des histoires de vie entière, dessine avec de simples indications des images colorées et lumineuses. Que Klaus Merz évoque de scènes de tous les jours ou qu’il se plonge dans ses souvenirs, qu’il rencontre des lieux ou des personnes étranges, il parvient toujours à se concentrer sur l’essentiel. Sous la surface de sa poésie laconique clignote un esprit espiègle et une ironie subtile.
« Unerwarteter Verlauf/Évolution inattendue »
Unerwarteter Verlauf : ainsi s’intitule le nouveau recueil de poésies de Klaus Merz. Fidèle à lui-même, le poète travaille à son établi comme toujours avec densité et concentration. Ce qui reste, ce sont des questions, car Klaus Merz est également passé maître dans l’art de se refuser aux réponses toutes faites.
Klaus Merz
Klaus Merz est né à Aarau en 1945 et il a grandi à Menziken (AG). Tout d’abord enseignant dans le secondaire, puis chargé de cours en « langue et culture » dans une haute école spécialisée, il est aujourd’hui auteur indépendant et vit à Unterkulm (AG). Ses oeuvres lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le Prix de Poésie de Bâle en 2012 et le Prix Hölderlin de la ville de Bad Homburg.
Marion Fraf - la traductrice
Marion Graf est née à Neuchâtel en 1954. Elle a étudié les lettres (russe, espagnol, français) à Bâle, Lausanne et Voronej. Elle est traductrice littéraire du russe et de l’allemand, ainsi que critique littéraire pour différents médias et collabore à des revues et ouvrages spécialisés. Elle dirige aujourd’hui la « Revue de Belles-Lettres » et est également membre du jury pour les Prix suisses de littérature. Elle a reçu de nombreux prix pour ses traductions.
Këngë nga rruga e farkëtarëve / Chants de la rue des forgerons
Ademaj Ndriçim
MAI 2022 |
14 X 21 CM | 152 P. | BROCHÉ, COLLÉ
ISBN 978-2-8290-0647-0 | 18 € / 26 CHF

Ademaj Ndriçim
Il s’agit d’un recueil de poèmes de longueurs variables (allant de trois vers à plusieurs pages) qui parcourent différents pays : le Kosovo, la Suisse, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la France. Publiée, en 2015, aux éditions renommées de Pegi en Albanie, l’édition originale de 94 pages compte 50 poèmes. Le recueil n’a encore jamais fait l’objet de publication en langue étrangère.
Les « chants » – këngë – poétiques que nous livre Ndriçim Ademaj, crient sur papier toutes sortes de sentiments nés de l’amour dans ses multiples facettes. C’est avec ironie que l’auteur dépeint sous forme de dialogue sentimental une réalité pleine de souffrance suite à la séparation, à l’abandon ou la fuite, à la frustration, à la nostalgie du temps passé et l’évanouissement incessant du temps présent, à la colère et au scepticisme face à une société qu’il critique durement, à la jalousie dont il ne se cache point, au désir intense, à la guerre qu’il rappelle courageusement, à l’oubli et à l’absence d’un « tu » sans cesse invoqué.
Ndriçim Ademaj est un jeune écrivain (1991) de poésie et de prose qui a déjà publié trois oeuvres, dont deux recueils de poèmes et un roman. Entre ses études à l’université de Genève puis celles à la Sorbonne, il retourne toujours dans sa terre natale, le Kosovo. De là, il se rend fréquemment à Tirana, en Albanie, où se trouve son éditeur, Botime Pegi. Considéré comme un des représentants de la nouvelle génération d’auteurs du Kosovo, il s’est vu participer à différents festivals et autres événements littéraires, notamment en France (16ème Voix de la Méditerrannée – Le Printemps des Poètes, Les lettres balkaniques – Balkan Transit), en Suisse (Balkan 2013 dansCulturescapes)…, également inséré dans les anthologies et revues littéraires.
Festa Molliqaj - la traductrice
Bilingue albanais-français, Festa Molliqaj a très vite voulu développer les « mécanismes » de passage d’une langue à une autre, raison pour laquelle la traduction est devenue très tôt un outil de pensée pour elle. Ses études en Lettres – italien, philosophie et linguistique avec Master en traduction littéraire et Master professionnel en didactique des langues étrangères – lui ont permis de perfectionner sa maîtrise de l’italien. Elle a effectué un premier séjour à Rome dans le cadre d’un programme d’études Erasmus à la Sapienza où elle a consolidé ses connaissances de la langue et l’ont amenée à effectuer un stage dans la maison d’édition L’Orma à Rome, où elle a exercé la traduction littéraire sous le mentorat de Lorenzo Flabbi, traducteur officiel de Annie Ernaux. Elle a également traduit des textes pour la revue Viceversa Littérature. Elle travaille actuellement sur la traduction du roman de Doris Femminis, Fuori per sempre, qui paraîtra aux Éditions d’en bas en 2023.
Bonusljod / Poèmes de supermarché
Andri Snær Magnason

2016 | 12.5 X 20.5 | 96 P.
ISBN 978-2-8290-0523-7
CHF 24.- | € 14.-
Selon Andri Snær Magnason, la tradition lyrique en Islande est en mesure de transformer toute chose en énoncé poétique. Une ferme tout à fait normale accueille la scène d’une saga islandaise. Dans la montagne et les collines, on retrouve les lutins et les elfes des contes populaires. Le cimetière est recouvert de nécrologies lyriques. Même une grue de charbon au port de Reykjavik peut se transformer en sphinx grâce au lyrisme mythologisant. Mais, en 1996, il se trouve chez lui, et, affamé, il se rend au supermarché Bónus le plus proche. Le magasin, bien achalandé, est parsemé de lettres et de messages, comme des ambassadeurs, mais qui ne composent en rien une histoire, ou un poème. Fermant les yeux et les oreilles, il essaie de supporter ce vide. À ce moment, quelque chose d’étonnant lui est révélé: l’agencement du magasin lui apparaît comme la structure de la Divine comédie de Dante. Au service de fruits, se trouve le paradis, aux produits de boucherie et de charcuterie, I’enfer et aux produits à nettoyer, le purgatoire. Il voit du jus Bónus, du coca Bónus et du jambon Bónus, et il sait que la nation islandaise, qui est accompagnée de tout temps par la poésie, a besoin d’urgence des poèmes Bónus. Si les écrivains ont écrit le récit du réalisme social au temps de la crise économique, ils doivent maintenant écrire le récit du réalisme du capital. Ainsi, a-t-il rédigé un manifeste : des poèmes doivent servir le marché. Ils doivent être compréhensibles pour chacun qui a terminé I’enseignement obligatoire général. Ils doivent être courts. Ils doivent relancer la croissance économique et stimuler à la consommation accrue… avec la bénédiction de Jóhannes Jónsson, le fondateur de Bónus, il signe un contrat avec le fils comme n’importe quel fabricant de jus: si à l’usage le produit provoque des dégâts, seul le producteur en sera tenu responsable…
Andri Snær Magnason
Andri Snær Magnason, né dans une famille de docteurs et d’infirmières, lui aussi marié à une infirmière, étudie la littérature islandaise et effectue ensuite des recherches sur la poésie traditionnelle islandaise. Il crée un véritable événement. Son site ici.
Walter Rosselli - le traducteur
Walter Rosselli est né au Tessin et vit actuellement en Suisse romande. Traducteur et chroniqueur indépendant depuis 20O7, il a étudié les lettres et langues ibériques, rhéto-romanes et scandinaves. Il a traduit Oscar Peer, Leo Tuor, Claudia Cadruvi, Dumenic fudry, Göri Klainguti, Hubert Giger et Rodrigo Hasbún. Il a également traduit I’ensemble de Bónusljóð, en français (à paraître chez d’en bas) et en italien, à ce jour inédit, ainsi qu’en espagnol, en collaboration avec Úa-Hólmfríður Matthíasdóttir, à paraître. Dernière traduction : Leo Tuor, Onna Maria Tumera ou les ancêtres (d’en bas,2O14). À paraître du même auteur, Settembrini (d’en bas). Autres traductions du rhéto-roman: Hubert Giger, La sorcière de Denteruals (Plaisir de Lire, 2014) et Oscar Peer, La vieille maison (Plaisir de Lire, 2013 ; prix Terra Nova de la Fondation Schiller pour la traduction de ce titre).
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Beata Berggren
Planches-contact
« Rien n’a été inventé. »
Planches contact, traduit du suédois par Martin Högström et Luc Bénazet, est le premier livre de Beata Berggren. Il se compose de trois chapitres intitulés « 75 exemples », « Le Photographe/Auteur » et « Tout pourri et […] et pauvre et les ressources ».
Beata Berggren est une poète de notre temps et de notre monde abîmé. Or, écrire dans un tel monde nécessite l’invention de nouvelles poétiques. Par exemple, en déployant une écriture économe, prosaïque, composée de phrases simples ou de courts paragraphes juxtaposés, montés en séries. Mieux encore : en prenant le parti du matériau trouvé, il s’agit de faire fonds sur ce qui existe déjà, notamment des photographies, en en proposant des descriptions aussi littérales que possible. Ou enfin : prendre pour modèle de description la statuaire, vue au musée ou à travers des reproductions. L’homogénéité entre ces matériaux trouvés sera produite par l’immobilité des scènes ou l’inertie des sculptures décrites, autant que par la minéralité : thème prégnant du livre. Il y a du déjà-là qu’il faut exploiter, à la façon dont on recyclerait des ressources. Ce travail de recyclage, qui n’exclut pas les formes vernaculaires, emporte avec lui l’idée d’une collection de singularités. Ainsi de la « planche contact » chez le photographe argentique. L’item est nommé par Beata Berggren « exemple ». La collection d’exemples, un travail de rassemblement, de langage, de fragments, de restes, d'autres, d'associations et de contextures pour inventer l'unité. Toutefois, il y a une contradiction inhérente au montage de la collection. Le mouvement qui lie repousse également ses éléments. Comme un kaléidoscope, il casse, corrompt et disjoint le langage et les images qui sont à l'œuvre, dans une volonté de démontrer la grammaire changeante du monde. « Il n'y a pas de phrases inacceptables, seulement des mondes impossibles » écrit la poète écossaise Veronica Forrest Thomson.
Née en 1976, Beata Berggren vit à Stockholm. Elle est poète, artiste, co-fondatrice et co-directrice de la maison d’édition Chateaux – l’homologue d’Eric Pesty Editeur en Suède.
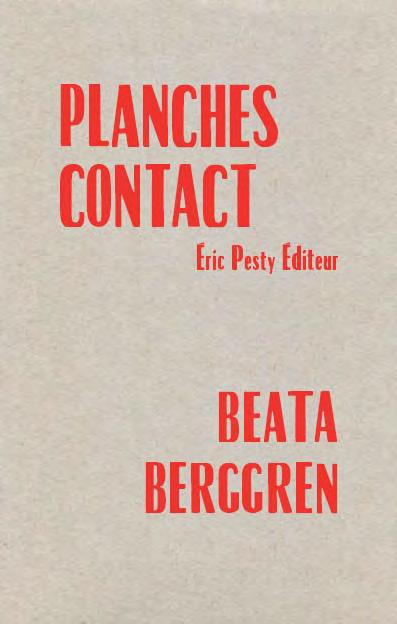
(COUVERTURE PROVISOIRE)
Traduit du suédois par Martin Högström et Luc Bénazet
Parution : juin 2025
Prix : 10 €
Pages : 36
Format : 14 x 22 cm
EAN : 9782917786994
Collection : agrafée
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Elle est un dans la rangée de mots.
Elle est mentionnée plusieurs fois dans les lettres.
Le chemin à l’école est long et traverse une forêt.
Elle hésite chaque jour devant cette image de terre inculte.
Les décisions sont prises dans l’obscurité.
Une conversation s’est tue.
Des parcelles et des lots sont disposés suivant la course du soleil. La largeur du lot correspond à la quote-part du paysan dans le village, qui à son tour se manifeste par la largeur de la parcelle le long de la rue du village.
La fin de la ligne est en italique, puis la lumière sur le sol : un corps tracé.
Elle disparaît et tous ceux qui l’entourent disparaissent, mais la photo d’elle reste.
Il la connaît par ce qu’il a vu sur la photo.
Elle est grande, nez droit, ses cheveux pendent en tresse sur son épaule droite.
Il remarque qu’il ne lit jamais les mots invisibles.
La narration des pétroglyphes a disparu.
Le problème n’est pas le sien.
Il pense plus vite qu’il ne parle.
Après la découverte du double hermès de Socrate et de Sénèque, la sculpture Sénèque mourant a été réévaluée, passant d’une image de Sénèque à celle d’un vieux pêcheur. Mais la sculpture conservera son nom. Après tout, Sénèque mourant a été mentionné au XVIIe siècle dans un poème sur la collection d’art de la famille Borghese. Et Rubens a basé plusieurs de ses peintures sur lui.
Il transforme les troubles romains en exemples. Les problèmes ne disparaissent pas. Il ne constatera que les problèmes ont disparu que lorsqu’ils auront disparu.
La photographie a disparu mais la lettre décrivant la photographie subsiste.
Calcaire peint. Aucun morceau de quartz inséré pour représenter l’iris du globe oculaire gauche n’est présent, comme dans l’autre œil. Plâtre sous les joues et les yeux. Abîme sur les deux oreilles.
Sur la photo, on voit une statue tombée au sol. Mains et pieds dispersés.
Les exemples se propagent.
Il raconte les mêmes événements, encore et encore. Il les désigne comme la preuve de sa propre identité.
Il préfère dire que ce ne sont pas des histoires, ou du moins pas de bonnes.
The Greek Slave a traversé l’Atlantique par bateau jusqu’à William Wilson Corcoran et a été exposée accompagné par des textes soulignant la haute moralité, la beauté intellectuelle et la soumission chrétienne du sujet. L’artiste a déclaré : « Sa nudité n’est pas sa faute, mais plutôt celle de ses ravisseurs turcs qui l’ont déshabillée pour la vendre. »
En 1848, Lucy Stone s’arrête pour admirer The Greek Slave dans un parc de Boston. Elle la voit nue et enchaînée et se met à pleurer. Elle a ensuite inclus la femme dans ses discours.
Il met en scène les événements de différentes manières. Souvent devant des auditoires.
Il dit qu’il a hâte de la rencontrer.
Elle ne le connaît que par ce que d’autres ont dit de lui.
Il est allé voir l’homme dont tous les habitants du village disaient avoir peur. Il est assis à l’intérieur de la cabane de l’homme en question. C’est l’hiver. Il ne savait pas quoi dire. Il avait peur, mais il se sentait défiant. Ils sont restés assis à se fixer l’un l’autre. Ne disaient presque rien. Au bout d’une heure, il a quitté la maison. Est sorti se jeter dans la neige. Il était heureux. Il l’avait fait. Il avait réussi.
Au cours d’une de ses promenades quotidiennes, il s’est soudain effondré, victime d’une crise cardiaque. C’était l’hiver et il y avait beaucoup de neige. Sur l’une des photos, les semelles de ses chaussures sont photographiées de dessous. L’angle de prise de vue est bas. Le photographe devait être accroupi au moment de prendre la photo, ou se tenir sur une pente.
Elle ne peut que dire ce que d’autres lui ont déjà dit.
Elle le dit à son tour.
Le chat est un mammifère.
Il en avait deux. Un jaune et un noir.
Ils se plaignent de ce qu’ils ont entendu, vu, et à quoi ils ont prêté attention, c’est vrai : Il vivait seul et triste, et il parlait peu.
Quand elle lève les yeux, elle a la mer Baltique devant elle.
Elle parle toute seule. Elle ne sait pas ce que ça veut dire.
Il y a des milliers d’années, des images ont été gravées sur des pierres et des rochers. Les images – qui peuvent représenter des chevaux tirant des charrettes, des personnes ramant sur des bateaux, des cerfs et des rennes s’enfuyant, des objets ressemblant à des instruments de musique, des roues, des soleils ou des chapeaux –semblent toutes être placées de manière aléatoire, comme s’il n’y avait pas de haut ou de bas sur la pierre. Peut-être parce que la surface de la pierre est irrégulière et arrondie, avec des bords, des fosses, des pics et des creux. Et que les lignes des images les suivent.
Et ce qui maintient les images en place. Et ce qui lie les événements entre eux. Calcaire et granit.
Nous avons d’abord trouvé trois animaux à quatre pattes qui ressemblent à des chevaux, sans qu’il soit possible d’en identifier l’espèce. Ensuite, nous avons trouvé une image d’un petit être humain qui semble souffler dans un entonnoir, il a une corne qui sort de sa bouche.
Entre autres choses, ils voulaient rassembler les nombreuses histoires, toutes très variées, en un seul récit général.
Nous sommes confrontés à nous-mêmes et à tout, d’où une certaine humilité. Nous avons le problème et la tâche de la vie, même celle du poème. C’est dans l’illimité que ma distinction… C’est seulement qu’il n’y a pas un genre de formes données et des ensembles, et je n’avais pas d’inclination. Et j’ai essayé de donner le contenu.
Il sauve les lettres en copiant ce qui y est écrit.
Tôt le matin, elle se rend chez un homme qu’elle aime beaucoup. Elle frappe à la porte et on la laisse entrer. Rien ne se passe entre eux, si ce n’est qu’elle s’assoit sur ses genoux et qu’ils se parlent, se racontant des choses qu’ils ont vécues dans leur vie. Au bout d’un moment, ils sortent sous le soleil et la chaleur de l’été. Elle est heureuse. Elle ne sait pas où toutes ces discussions vont la mener. La journée n’est pas encore terminée.
Ils parlent la même langue.
Ils parlent seuls. Mais ils parlent cette langue.
Elle parle seule.
Elle fait un calcul dans sa tête.
Les chiffres indiquent l’ordre et le poids dans les phrases, pas dans le monde.
Elle sort dans ce monde.
Elle a une intuition mais n’a pas de concept. Elle ne porte qu’un petit sac.
Elle se promène loin de ce qui est ennuyeux.
Elle passe devant les lupins roses et violets.
Elle affirme la langue qu’elle a apprise.
Elle écrit des tracts.
Elle ne parvient pas à libérer les masses.
Elle évite les raccourcis du développement.
Il leur faut 20 à 30 ans pour se rencontrer.
Ils se rencontrent par une revue.
Il traduit ce qu’elle a écrit.
Le tronçon gris, étroit et usé de quartz concassés et de bitume serpente jusqu’à l’élévation très abrupte du sol, appelée Linderödsåsen, si l’on vient de l’est du pays. Qui constitue un déplacement le long d’une faille, de sorte que la zone définissant la crête a été poussée vers le haut. Ce phénomène géologique est appelé horst. Là-haut, les gens pêchaient. Ils ont planté des sapins dans la forêt de hêtres. Ils ont soulevé pierre après pierre.
La zone située des deux côtés de la crête s’est enfoncée. Dans ces dépressions où le sol est fertile, les habitants de la crête étaient appelés le peuple de la forêt. « Le mystérieux peuple de la forêt descend à l’automne pour aider à la récolte. »
Lorsque les faits réels s’éloignent d’un nom et que l’on ne perçoit plus qu’une immense distance dans la langue – le passé et l’avenir – on peut se rendre compte, dans un bref moment de présence, que l’on se trouve là, sur le sommet de la plaine fertile, et qu’il ne nous reste que le nom d’un village, et que nous nous servons de ce nom presque tous les jours.
Rien n’a été inventé.
(...)
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Stéphane Le Mercier
Puff
« Les caches d’armes / La ronéo / Le papier carbone // Tous trois en représailles / contre l’obsolescence du réel. »
Puff est le deuxième livre de poèmes de l’artiste plasticien Stéphane Le Mercier, après Trisidus (Eric Pesty Editeur, 2020). Comme Trisidus, Puff est un poème composé selon le principe du glissement de terrain visuel – mise en espace du texte dans la page tenant compte de la transparence du papier ; ce que l’on nomme techniquement, mais ici de façon particulièrement pertinente : « l’effet fantôme » – le texte n’étant imprimé que sur le recto des pages.
Contrairement à Trisidus (interpolation possible des mots « tri » et « résidus ») qui nommait son personnage dès le titre, Puff met en scène un passager nommé « Quiconque ». C’est pourtant le même individu, le même clandestin européen, colporteur de souvenirs d'espaces et de paysages ruraux traversés par l'artiste dans les années 1990-2000, voire d’observations récentes en forme d’inventaire parcellaire de notre monde contemporain.
Cet inventaire se compose sur la base de sources textuelles parfois reconnaissables et nommées, d’autres fois savantes et cachées. Ainsi l’on retrouvera des allusions à Arno Schmidt, déjà présent dans Trisidus ; à Freud, avec la citation « la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-àdire régulière de l’ensemble de la personne humaine » qui fait l’objet dans Puff d’un morceau de bravoure ; à la Susan Howe de Deux et, aussi bien qu’à Mallarmé et à Valéry.
A la question de la psychanalyste Christine Anzieu : « Et qu’est-ce que vous faites dans la vie ? » Stéphane Le Mercier répondait : « Je relève des chutes. »
Stéphane Le Mercier est issu de la génération dont les approches néo-conceptuelles se sont affirmées au cours des années 1990-2000, années durant lesquelles il a principalement résidé à l’étranger. Ces séjours lui ont insufflé une réflexion sur l’économie des signes et sur l’usage de la langue écrite dans l’espace public. En mettant en tension des éléments de natures différentes (ready-made textuel et peinture abstraite, sculpture minimale et éléments typographiques), il fait émerger des formes polyglottes, dont le colporteur est, pour ainsi dire, l’intercesseur.

(COUVERTURE PROVISOIRE)
Parution : juin 2025
Prix : 10 €
Pages : 32
Format : 15,2 x 22,8 cm
EAN : 9999999999999
Collection : agrafée
Rayon : poésie contemporaine/art
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Quiconque Budapest
Sa petite pelle Pour se rendre À l’école, Opérer devant elle Un couloir lumineux.
Hasok Tere, Budapest : Soldats stalactites Tombés dans la neige Bûchettes de craie.
La révolution est Un prolongement de l’œil.
Quiconque Vienne
Quand face à lui, Dans l’espace de son musée dûment autrichien, Freud regarde
Les mots circuler à mi-hauteur.
Quand Freud regarde
Les mots circuler à mi-hauteur, pâte de verre, mélasse.
Quiconque Vienne
la maison qui constitue la seule reprÈsentation typique, cíest-‡-dire rÈguliËre de líensemble de la personne humaine
Normal
Normal
Police par défaut Police par défaut a aMMacintosh:Users:stephanelemercier-dauny:Desktop:« la maison qui constitue.docÿ__v
Times New Roman Times New Roman Symbol Symbol
Times-Roman
Times-Roman v« la maison qui constitue la seule représentation typique, c v« la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-à-dire régulière de l’ensemble de la personne humaine la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-à-dire régulière de l’ensemble de la personne humaine
Normal
Microsoft Word 10.0 la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-à-dire régulière de l’ensemble de la personne humaine
Root Entry
1Table 1Table
WordDocument WordDocument SummaryInformation SummaryInformation
DocumentSummaryInformation DocumentSummaryInformation CompObj CompObj
ObjectPool
ObjectPool
Document Microsoft Word Word.Document.8
Trisidus
Stéhane
Le Mercier

2020
15,2 x 22,8 cm, 32 p., 9 € 978−2−917786−64−2
Trisidus est-il un mot-valise ? Il donne en tous les cas son nom à une esquisse de personnage, et son titre au livre de Stéphane Le Mercier.
Ce livre est un composite de souvenirs d’espaces domestiques, de paysages ruraux traversés par l’artiste dans les années 1990 – 2000, principalement la Hongrie, l’Irlande, l’Allemagne et enfin la Bretagne : cette dernière région formant le point où Trisidus revient hanter les lieux de ses ancêtres.
Ainsi, les poèmes composant ce livre n’étant imprimés qu’en belles pages, la transparence du papier (justement nommée effet fantôme) permet de voir s’agencer en seconde lecture un récit parallèle dont la clé est scellée dans une citation de Freud, sous l’aspect de deux lignes surimprimées, issues de L’intérprétation du rêve :
« la maison qui constitue la seule représentation typique, c’est-à-dire régulière de l’ensemble de la personne humaine
A propos de Trisidus, Stéphane Le Mercier écrit : « Je voulais parler d’Europe alors je me suis concentré sur les poutres et les terrains communaux. » *
La publication de Trisidus s’accompagne de l’édition d’une affiche par Incertain sens, composée par Grégoire Sourice et intitulée Semaine ouverte (24 x 35 cm, Arcoprint Edizioni 1.3, avorio 85g – Fedrigoni, Europe 8 pts demi-gras), achevée d’imprimer à 300 exemplaires sur presses typographiques le 1er mai 2020.
L’auteur
Stéphane Le Mercier est né à Saint-Brieuc en 1964. Il vit à Marseille et enseigne à l’École Supérieure d’Art et Design Saint-Étienne.
Artiste, Stéphane Le Mercier est issu de la génération dont les approches néo-conceptuelles se sont affirmées au cours des années 1990 – 2000, années durant lesquelles il a principalement résidé à l’étranger. Ces séjours lui ont insufflé une réflexion sur l’économie des signes et sur l’usage de la langue écrite dans l’espace public. En mettant en tension des éléments de natures différentes (ready-made textuel et peinture abstraite, sculpture minimale et élément typographique), il tente de faire émerger des formes polyglottes, des récits, dont la figure du colporteur est, pour ainsi dire, l’intercesseur.
En janvier 2020, Stéphane Le Mercier a soutenu, sous la direction de Leszek Brogowski à l’Université Rennes 2, une thèse de doctorat : Le Colporteur ou mobilité de diffusion de l’imprimé contemporain.
LAURENT
ALBARRACIN
LECTURES [2]
ÉDITIONS LURLURE
PARUTION JUIN 2025
LECTURES
[2]
Laurent Albarracin
Préface de Pierre Campion
Genre : Essai de critique littéraire
Collection : Critique
Prix : 23 euros
Format : 140 x 210 mm
Nombre de pages : 256 pages
ISBN : 979-10-95997-66-5
> Un panorama subjectif de la création poétique contemporaine
> Le second volume de l’œuvre critique du poète Laurent Albarracin
> LE LIVRE
Ce volume poursuit la publication de l’œuvre critique de Laurent Albarracin, commencée avec Lectures [2004-2015] (Lurlure, 2020). Comme le précédent volume, l’ouvrage se présente sous la forme d’une anthologie d’articles et de courts essais de l’auteur, écrits entre 2016 et 2023, et pour la plupart d’abord parus en revues.

Laurent Albarracin écrit sur les livres de poétesses et poètes aux sensibilités très diverses (citons par exemple Francis Ponge, Bronka Nowicka, Ivar Ch’Vavar, Flora Bonfanti). L’ensemble dessine un aperçu, évidemment partiel et subjectif, de la création poétique contemporaine. Comme le précisait l’auteur en préface du premier volume, “ces recensions n’ont pas été rédigées pour guider le lecteur dans ses choix ni même pour servir les livres, mais très égoïstement pour moi, pour ma méditation personnelle, en vue d’en faire mon miel et d’en tirer jouissance, la lecture s’aiguisant mieux lorsqu’on prend la peine de la coucher sur le papier.”
> L’AUTEUR
Laurent Albarracin est un poète français, né en 1970 à Angers. Il a participé à la revue Le Jardin ouvrier autour d’Ivar Ch’Vavar à la fin des années 1990. Il anime aujourd’hui les éditions Le Cadran ligné et, avec Guillaume Condello et Pierre Vinclair, la revue de poésie Catastrophes. Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie (chez Flammarion, Le Dernier télégramme, Le Corridor bleu, etc.). Il a déjà publié un livre de poésie aux éditions Lurlure, Le Château qui flottait (2002), ainsi qu’un recueil d’articles critiques, Lectures (2020).

EXTRAIT 1 : Pierre Campion, Préface
“Laurent Albarracin n’est pas seulement le poète brillant que nous connaissons. À l’enseigne de son Cadran ligné, il se livre aussi à ce qu’il appelle ses « petites activités éditoriales ». Et puis il y a ses chroniques, postées en divers lieux depuis près de quinze ans, où il se plaît à suivre les publications de la poésie contemporaine. Voilà que, suite au premier volume de ses Lectures, paraît le deuxième, et qu’il est temps d’en esquisser un début de synthèse, une tentative de les lire ensemble, elles. Ce sont des textes plutôt brefs, qui témoignent d’une attention, d’une ouverture et d’une générosité. Albarracin n’a pas l’esprit de coterie. Il lit des recueils très divers et il écrit à leur propos de manière serrée, rigoureuse et immédiatement reconnaissable : il y a un style de la chronique selon Albarracin.
Ce sont des proses elles-mêmes poétiques, rythmées selon les mesures intimes de leur auteur. Elles ne répondent pas à une rhétorique mais à une exigence d’empathie à l’égard des recueils dont il rend compte. Privilégiant la relation à la réalité qu’il aime et qu’il y retrouve – aux éléments, aux choses, aux êtres, à la vie même – il recueille de préférence les images des poètes. Malgré certains aveux (« je les leur vole, leurs images, sans honte excessive, et prends mon envol avec. Qu’ils me pardonnent ce coup d’aile par lequel je m’éloignerais de leurs desseins »), ce ne sont pas des appropriations pures et simples.
Car le moyen de rendre compte des images des autres, ce n’est pas de les paraphraser, ni de les diluer, ni de les confisquer ou de s’y perdre, ni même de les analyser de manière adéquate – cela peut se faire, de dégager leur logique et leur inscription dans des mythes – c’est de leur répondre et de répondre d’elles par des images et par une égale et personnelle prise en compte de la réalité ainsi évoquée. Dans l’empathie, on ne peut pas demeurer à l’extérieur de soi-même.
Albarracin propose donc des résonances, mais dans des images qui respectent les images d’un autre. C’est tout un art, dont le lecteur trouvera mille exemples. [...]”
EXTRAIT 2 : À propos de Malcolm de Chazal, Humour rose
“Malcolm de Chazal aurait mérité de figurer dans l’Anthologie de l’humour noir. « On n’avait rien entendu de si fort depuis Lautréamont » estimait Breton. S’il n’est pas au sommaire de l’anthologie, ce n’est pas parce qu’il y aurait une opposition entre deux conceptions de l’humour. D’ailleurs Breton n’avait sans doute pas eu connaissance de ce titre. Le recueil, composé entre 1940 et 1949, à l’époque de la rédaction de Sensplastique, est resté inédit jusqu’à ce jour et seuls quelques poèmes avaient été extraits et publiés en 1968 par Jean-Jacques Pauvert. L’humour ici n’a rien d’enfantin, d’élégant ou de bon teint et sa charge poétique n’a rien à envier à d’autres cas d’humour noir. Il n’est pas interdit d’entendre dans le titre un humour qui se rapporte directement à l’éros.
N’oublions pas que Sens-plastique avait théorisé la volupté et en avait fait le principe même d’une vision poétique. Humour de l’érotisme, voire humour-fleur, le poème chazalien exalte le corps comme un déploiement de chacune de ses parties jusqu’au tout, jusqu’au grand tout illimité.”
EXTRAIT 3 : À propos de Bronka Nowicka, Nourrir la pierre
“Le point de vue de l’enfant a certes déjà été largement exploré et exploité, en littérature, et souvent avec un bonheur poétique certain. Que l’on songe par exemple aux réussites que furent La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Gaëtan Soucy, ou Ronce-Rose, d’Éric Chevillard. Si le procédé est si fécond, si efficace et si plaisant, c’est qu’il permet un décalage avec les normes et les usages du monde adulte, une fraîcheur dans la perception de la réalité, où l’étrangeté vient côtoyer le naturel, le mystérieux l’innocence, l’insolite l’évident, la peur la drôlerie, sans que cela gêne outre mesure.
Jamais peut-être ce procédé n’aura été poussé aussi loin et si radicalement que dans ce récit d’enfance aux allures d’inventaire. À travers toute une série d’objets et de matières qui sont autant de prismes à la réalité et d’occasions de jeux graves, parfois cruels, un enfant (fille ou garçon, cela est variable d’un chapitre à l’autre) découvre le monde qui l’entoure et le restitue avec une naïveté et une lucidité confondantes (confondues). C’est d’abord l’univers familial qui est passé au crible de cette perspicacité enfantine si particulière. Ici les membres de la famille ne sont nullement figés dans un âge assuré. La hiérarchie familiale évolue au gré des circonstances et plus personne n’a d’âge réel : seulement un âge relatif qui peut très bien s’inverser : la grand-mère materne l’arrière-grand-mère redevenue petitefille. La mère nourrit le père, lequel perd de sa stature en devenant un nourrisson. Les générations se superposent à l’intérieur d’une même personne. En jouant avec eux, l’enfant manipule les membres de sa famille comme des poupées et déshabille leurs rôles dans le vestiaire de son imagination. Il remarque très justement : « Les poupées sont des femmes et les enfants de ces femmes. » Les gens ont plusieurs âges et même les morts continuent de vivre. Les morts ont perdu leur autonomie (ils ne s’habillent pas tout seuls, ils sucrent leur thé quand on le fait pour eux), ce sont des handicapés qui requièrent plus d’attention et qui par conséquent ont presque plus d’existence que les vivants. Leur existence est d’autant plus envahissante qu’elle réclame en permanence nos soins et notre aide : « Il faut cirer leurs chaussures. Lécher des timbres pour eux et envoyer des lettres qui n’arriveront pas. Ils ne penseront pas ce qu’on ne pensera pas pour eux, donc ils pensent à nous avec nos pensées. » [...]”



Le livre en fugue
Françoise Lison-Leroy & Marie Meuleman
6+
ISBN 978-2-930941-77-6
coll. Les baladeurs – 03 couverture souple à rabats ; dos carré cousu-collé 10,5 x 15,5 cm • 44 pages • 11 €
• récit photographique •
Dans ce nouveau titre de la collection Les baladeurs, on suit un livre, qui se balade et nous balade… jusqu'à se retrouver entre nos mains.
Françoise Lison-Leroy débute la promenade ainsi :
Page blanche du jour.
On sonne à la porte.
La lectrice glisse et pirouette. Zou !
Commence alors un long voyage, le livre passant de main en main (dans la camionnette d’un peintre en bâtiment, entre les crocs d’un chien, dans la voiture décapotable d’un ornithologue…).
Un livre drôle qui désacralise l'objet-livre.
Illustration : photographie
Thèmes : livre/lecture • voyage • hasard/sérendipité • transmission curiosité • métalivre/autoréférentialité
Argumentaire :
• coll. Les baladeurs – des livres au petit format dans lesquels les mots côtoient le médium préféré des explorateurices : la photographie.
• Diversité des lecteurices et des occasions de lecture (cycle de 24H).
• Sortir le livre des endroits convenus : il voyage et passe de main en main. Il se prête, il se donne, il s’offre. Il se lit, s’use, se patine.
• Lignes de fuite : le rapport texte-photographies crée des liens et des histoires, fait de subtiles références aux contes et autres lectures.
• Effet de surprise/joie, en fin de lecture, quand on comprend qu'on tient, entre les mains, le livre évoqué par l'ouvrage.

À propos de Françoise Lison-Leroy
Françoise Lison-Leroy est née au Pays des Collines, en Belgique, entre une école rurale et un grand paysage. Elle est l’autrice d’une trentaine de recueils de poésie, dont quelques-uns s’adressent aux jeunes lecteurices. Elle reçoit le prix triennal de poésie de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016. Le prix de poésie François Coppée de l'Académie française recompense en 2020 son recueil Les blancs pains (éd. Esperluète).
Deux livres de Françoise Lison-Leroy sont déjà parus chez CotCotCot, tous deux en 2021 : De la terre plein les poches (ill. Matild Gros) dans la collection Matière vivante et Tous mes cailloux (ill. Raphaël Decoster) dans la collection Les Carnets
La collection Les baladeurs
Dans la collection Les baladeurs, on retrouve des livres qui aiment à se déplacer sans but précis. Leur petit format permet de les emporter partout avec soi, leur côté ludique intrigue. Qu’ils parlent de dyslexie ou des bords de mer, leurs mots côtoient toujours le médium préféré des explorateur·ices : la photographie.
• Baladeur 01 : L’art de ne pas lire, Elisa Sartori (sélection La Petite Fureur 2024-2025)
• Baladeur 02 : Laisse de mer, Marie Saille

• Baladeur 03 : Le livre en fugue, Françoise Lison-Leroy & Marie Meuleman.



Livres de Françoise Lison-Leroy dans notre catalogue


première œuvre

À propos de Marie Meuleman
Bruxelloise de naissance, Marie Meuleman a été un temps libraire avant de retourner dans l'enseignement secondaire. Elle écrit et lit beaucoup, prend des photos (à l’argentique le plus souvent). Impatiente et dissipée, elle arrive toujours à trouver son chemin vers une idée ou une tablée d’ami·es… Marie Meuleman a étudié les langues et lettres françaises et romanes à Bruxelles (ULB) et à Montréal (UdeM), où s’est forgée son envie d’écrire et de créer de manière pluridisciplinaire et collective. En 2021, elle a confondé la collective d’écritures Modesta, qui a publié un « manifeste poétique » : 183 lundis.
Instagram : @marie.meuleman
Photo: Madeleine Salmon
Photo: Chloé Martinache
















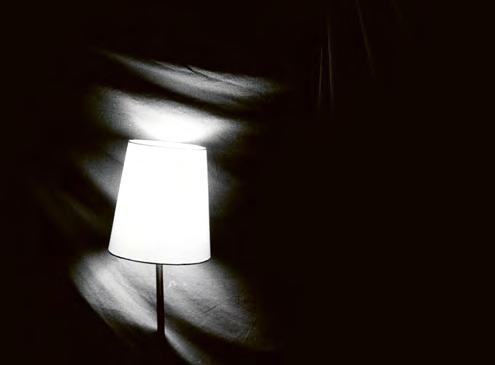


Sciences humaines


Se donner les moyens de refaire une Cité. edi4ons-exces.net edi4ons-exces@protonmail.com

SURGEONS ET AUTRES POUSSES
Livre de Maria Kakogianni, Marie Rouzin
Amalia Ramanankirahina
Réédition
A paraitre le 1er mars 2025
Excés, collection Voix publiques
Livre
14,50 x 22 cm
128 pages
Prix : 16€
ISNB : 78-2-9581188-3-9
Résumé

A mi-chemin entre l’herbier, l’essai sensible, la réflexion philosophique et les surgeons politiques, ce livre présente une collection de textes et d’images des plantes, ainsi que des tentatives, plus ou moins réussies, de faire monde avec elles et non pas en dépit d’elle, en se débarrassant peut-être un peu de la figure de l’homme-jardinier qui maîtrise la nature, faisant d’elle le décor de son action. Ce livre est le fruit de la rencontre de trois femmes. Elles explorent les gestes et les terreaux d’émancipation dans les ravages de l’exploitation intensive du vivant, des corps et des langages
Littérature - Essai - Eco-féminisme - Jardin
« Noues sommes le travail féminisé, précaire, non déclaré. Vies jetables, malformées, épuisées, parasites, noues sommes les restes de leurs indices de performance. Noues sommes les questions à toutes leurs réponses.
Noues sommes le sol glissant d’une grammaire où la police assassine.
Noues sommes les herbes folles dans les pelouses patrimoniales.
Ce qui n’était que pollen devient fruits épineux. Puisse-t-il en être de même de nos créations et de nos pousses
Qu’elles dansent et dérangent, qu’elles sèment le trouble et la colère,
Et se dégustent avec attention sans essuyer les pieds avant de passer à table.
Surgeons-nous »

Biographie des auteures
Maria KAKOGIANNI est travailleuse du texte avec une formation de philosophe. Écrire, traduire, performer, transmettre, faire des montages avec des sons et/ou des images, dans ce travail non hiérarchique avec la chair des mots et leur rythme, elle se sent proche des mots de Toni Morisson :« We do langage ». Parmi ses publications : Printemps précaires des peuples (éditions Divergences, 2017), Ivre décor (Hippocampe éditions, 2020), Iphigénie à Kos (éditions Excès, 2024).
Marie ROUZIN est auteure et enseignante. Elle écrit des textes poétiques et des textes pour la scène dans lesquels elle interroge le collectif, les gestes d’émancipation et la métamorphose des êtres. Elle a notamment publié Circulus (Serge Safran éditeur, 2018) et Treize âges dans la vie d’une femme (Le Castor astral, 2024).
Biographie de l’artiste

Amalia RAMANANKIRAHINA est artiste et restauratrice d’œuvres d’art. Dans ses œuvres, elle tisse des liens entre son expérience personnelle et sa biographie franco-malgache. Ses derniers travaux s’intéressent à la botanique, aux circulations des plantes qui font écho à l’histoire des déplacements humains, aux destructions coloniales mais aussi à des actes de résistances et de transformation.
INDEX DU JARDIN DES PLANTES
Achillée millefeuille…............................................................……. .p. 71
Ailante…...............................................................…….................. .p. 23
Almyriki (Tamarix)… ...................................................................… .p. 19
Amarante…..............................................................................… …p. 53
Amandier…................................................................................... .p. 27
Artemisia annua (青蒿 )…............................................................... .p. 33
Bambou…................................................................….................. .p. 37
Bégonia malculâta…..................................................................... .p. 35
Cardamine hirsute….............................................................. .pp. 54, 80
Catalpa…...................................................................................… .p. 25
Cheveux d’ange (Stipa tenuissima) … ............................................ .p. 30
Chêne…....................................................................................…. .p. 95
Dogue (Rumex)…........................................................................…p. 51
Érable…........................................................................................ .p. 94
Fenouil sauvage….........................................................................p. 74
Figuier…....................................................................................... .p. 91
Fraisier…...................................................................................... .p. 85
Hêtre…......................................................................................... .p. 95
Jasmin…....................................................................................... .p. 90
Maïs….......................................................................................... p. 53
Marronnier…................................................................................. p. 47
Mélisse…......................................................................... .pp. 45, 60, 64
Milleperthuis perforé (Hypericum perforatum) …………… p. 76
Nifinakanga............................................................................. p. 101
Olivier……….…........................................................................pp. 24, 99
Ortie….......................................................................................... ..p. 51
Passiflore…........... . ..........................................................................p. 58
Patate douce….......................................................................... p. 105
Pensée…....................................................................…................ ..p. 57
Peuplier…..................................................................…................ p. 97
Pissenlit…............................................................................. pp. 54, 79
Plantain…..................................................................................... ..p. 53
Renouée….................................................................................... ..p. 43
Rosier…........................................................................................ p. 86
Sauge………………………………………………………………......................p. 66
Thuya…....................................................................................................p. 39
Tomate…..................................................................................................p. 79
Trèfle…..............................................................................................pp.54, 80
Vanille (Tlilxochi)......................................................................................p. 103
Verveine citronnée…................................................................................p. 64

OLIVIER (extrait 1)
Olivier seul, fin d’été, parking de Leroy-Merlin, entrée de magasin, soldes, palette, pot en plastique surélevé, tronc large, trois branches, quelques feuilles argentées, arbre centenaire, trois cent cinquante-neuf euros.
Olivier qui ne peut faire l’objet d’aucune fable, d’aucun récit. Sa solitude elle-même est inénarrable.
Comment a-t-il pu finir ainsi sur un parking ? Qu’est-ce qui l’a mené jusqu’ici, lui, l’arbre-prénom, l’arbre-au-tronc-noueux, l’arbre d’Athéna, de Noé, l’arbre-de-notre-Histoire, Europe et Méditerranée, comment est-il venu jusqu’ici dans la zone commerciale sans terre ?
Olivier seul, déterré, tractopelle dans un sol caillouteux et brûlant, racines coupées, motte perfusée de substances nutritives, plastiquage du tronc et du feuillage, camion, frigo, re-camion, entrepôts, serres surchauffées, eau tiède, engrais, déplastiquage, nettoyage des feuilles, chariot élévateur, palettes, promenade dans les allées, emplacement idéal, fin de vie dans jardin pavillonnaire.
Et nous, sur le parking – nous qui garons notre voiture avec dans nos poches des listes d’outils et de matériaux, quelques idées pour aménager un lieu, et une envie, peut-être, de nous installer quelque part – nous qui prenons un caddie à côté de l’olivier centenaire et avançons vers les portes automatiques –nous qui nous hâtons, poussés par le besoin de construire, de fabriquer, d’utiliser nos mains et notre force de travail, d’œuvrer pour nous-mêmes, de donner une forme habitable à notre présence – nous qui entrons dans l’entrepôt pour acheter de quoi bricoler notre existence, changer le décor de notre vie intérieure, repeindre notre solitude, refaire l’électricité de nos désirs – nous qui nous déplaçons dans les rayons du magasin, hésitant finalement, impressionnés par la matière et l’abondance, la complexité des formes, notre manque de savoir-faire – nous qui ne savons plus ce que nous faisons là – nous qui comme l’arbre sommes coupés du monde, éloignés des terres brûlantes et passées, racines tranchées, corps plastifiés, survitaminés – quel récit inventer, quelle fable pour nos vies ?
FRAISIER (extrait 2)
Hier j’ai passé une grande partie de l’après-midi à travailler au jardin, après pratiquement deux mois d’absence, il en avait besoin et moi aussi. J’ai retrouvé quelques-unes de mes plantes qui avaient souffert. Mais je me suis surprise à rire avec le fraisier. Je le savais envahissant mais pas à ce pointlà. Il était sorti du carré-potager, et passé par-dessus les planches en bois, il avait commencé à avancer tranquillement vers d’autres terrains. Les fraises ont une texture fragile qu’on doit manipuler avec précaution, mais la plante, envahissante et robuste, semble presque à l’opposé de ses fruits. Nous ne créons pas toujours à notre image. Voilà ce qui m’est apparu aujourd’hui en riant avec mon fraisier. Sinon nous ne créons qu’avec nos symptômes.
Qu’est-ce qu’un auteur ? Est-ce que le fraisier est auteur de ses fraises ? Elles ne sont jamais identiques, elles dépendent de la plante-mère mais aussi du sol, de l’arrosage, du climat, des gestes de jardinage ou pas, des puissances d’agir en conflit ou pas. Est-ce ma volonté ? Je suis auteur de ce texte alors que le fraisier ne le sera jamais de ses fraises parce que je veux écrire un texte ? Et si Dieu n’a pas « voulu » créer le monde ?
Fictions spéculatives.
Depuis longtemps, « l’homme » se voit au-dessus du fraisier avec une part divine en lui, à la fois terrestre et extra-terrestre. Il pense que son côté « auteur » correspond précisément à sa part divine, créatrice et capable d’éternité. Un auteur est un petit dieu avec quelques défauts. Que les autres d’ailleurs doivent accepter et comprendre pour protéger son génie. Moi je.
Hypothèse inverse.
Et si être un sujet libre, autonome, rationnel, est une fiction toxique pour ce qui est de « l’auteur » ? Et si la seule véritable fiction d’autonomie était celle qui choisit ses dépendances ? Et si Dieu avait choisi de dépendre d’un monde plutôt que de rien ?
Ce sont des fictions. Le Dieu des romantiques est un tapissier, celui des libéraux nouveaux un comptable.
J’avoue. Sauf quand j’écris un chèque pour régler ma facture d’électricité, payer mon dû, ce que j’écris ne correspond jamais tout à fait à ma volonté. Et quand j’écris, je ne sais jamais d’avance ce que je veux écrire. Je trouve parfois un sens sur le chemin. Parfois non. Ça dépend du climat, des rejets de moi, attendre et voir si ça donne quelque chose. Autre chose que moimême. Ou pas.
Bref, petite pensée jardinière d’hier. POUSSÉES


En librairie 5 avril 2025
Format : 14,8 x 21 cm
Pages : 80 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Essai
Prix : € / CHF
ISBN : 978-2-8290-0702-6
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne 021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
Le jour des mitonneries de Libé Petit déj, la discorde
Demande de traduction en Espagne
Le petit-déjeuner
Un repas inutile ?
Gilles Fumey
PRÉSENTATION
Mis en place dans la haute société d'Ancien régime à la fin du 18e siècle avec l'arrivée des trois boissons tropicales (thé, café, chocolat), le petit déjeuner a été préempté par l'industrie alimentaire. Depuis 1917, avec la parution d’un article dans une revue appartenant à l’industriel Kellogg qui fabrique les corn flakes, elle est parvenue à faire croire que c'était le repas le plus important de la journée. Et si c’était une erreur ? Les biologistes expliquent que notre corps qui sécrète du cortisol (hormone du stress) lorsqu'on se réveille le matin, n'a besoin de rien durant les trois heures qui suivent notre lever.
L'histoire donne raison aux scientifiques. Gilles Fumey documente la manière avec laquelle s'est construit ce repas, comment les humains s'en sont passé et comment l'offensive des majors américaines dans les années 1970 avec, notamment les céréales et les jus de fruit, a été à l'origine du développement du surpoids et de l'obésité de masse.
En faisant l'histoire du petit déjeuner, l'auteur montre comment les mutations actuelles sur les repas peuvent nous aider à reprendre le contrôle de notre alimentation. Un livre étonnant qui nous dévoile les coulisses de notre alimentation mondialisée.
AUTEUR
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Gilles Fumey est géographe (Sorbonne Université/CNRS), il a publié une vingtaine d'ouvrages sur l'alimentation traduits dans une dizaine de langues. Parmi ses derniers titres : Histoire de l'alimentation, coll. Que-sais-je ? et Géopolitique de l'alimentation Éditions Sciences humaines.
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
Cyclonopédie ? C’est comme si Deleuze était né en Iran et avait écrit une version philosophique de Dune – entendu en librairie, à l’annonce de la parution prochaine de l’ouvrage –
Arguments de vente
Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi)
bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré l’ouvrage fondateur de la « théorie-fiction » contemporaine. Une édition française très attendue . Dans le monde francophone, plusieurs éditeurs France, au Québec, en Belgique) ont cherché à acheter les droits de traduction de Cyclonopédie tandis que plusieurs traducteurs en ont publié des fragments (en ligne au Québec, dans revues Zone Critique et Multitudes en France). Negarestani apparaît aussi dans l’ouvrage
Accélération (PUF, « Perspectives critiques »).
Une référence en devenir . Depuis quelques années, des éditeurs de plus en plus nombreux publient les œuvres de membres de l’« école » negarestanienne, ainsi que des ouvrages y explicitement référence. Ainsi en français chez Kodwo Eshun, Mark Fisher, Ray Brassier, Frédéric Neyrat, Grégory Chatonsky, Érik Bordeleau, Yves Citton, Jacques Fradin, Guillaume Boissinot, Yuk Hui, entre autres.
Auteur : Reza Negarestani
Traducteur : Emile Lavesque-Jalbert
Préface : Frédéric Neyrat
La métaphysique est une branche de la littérature fantastique, disait Borges. ouvrage en est la preuve ultime.
cible
Format : Broché, 13 x 20 cm, environ 350 pages hkp 01. ISBN : 978-2-487378-03-2
Prix : 24€ TTC
Parution : 4 avril 2025
Résumé

Passionnés de littérature expérimentale, de philosophie spéculative, de fictions d’horreur.
Lecteurs de théorie critique contemporaine (CCRU, Mark Fisher, Andrew Culp, Benjamin Bratton, Donna Haraway, etc).
Amateurs de Lovecraft, Bataille, Borges, Deleuze et fanbase du matérialisme spéculatif.
Ecologistes curieux de lire un livre où un étrange pipeline sabote l’univers humain. Bilingues / anglophiles l isant jusqu’alors les écrits de Reza en ligne et qui passeraient commande.
Œuvre culte de théorie- fiction contemporaine, Cyclonopédie (sous-titre : Complicité avec des matériaux anonymes ) est un livre hybride mêlant philosophie, géopolitique et horreur cosmique. Dans une prose labyrinthique d’où émergent d’étranges artefacts , le philosophe iranien Reza Negarestani, figure légendaire du réalisme spéculatif ( Intelligence and Spirit , Chronosis ) explore l’histoire secrète du pétrole comme entité vivante et maléfique, incarnant des forces obscures qui façonnent les guerres, les mythologies et les civilisations. À travers un dialogue entre spéculation philosophique et fiction paranoïaque, l’auteur nous plonge dans une perspective vertigineuse où les forces telluriques et les conjonctures humaines ne font qu’un. Negarestani explore les chemins souterrains d’une narration où le pétrole, figure tellurique invisible, mènerait secrètement les destinées humaines en se répandant depuis les profondeurs du désert vers la surface entière du globe.
Cyclonopédie ? C’est comme si Deleuze était né en Iran et avait écrit une version philosophique de Dune – entendu en librairie, à l’annonce de la parution prochaine de l’ouvrage –Arguments de vente
• Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi) et bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré comme
Arguments de vente
• Un livre de théorie spéculative de venu culte. Publié en 2008 par un auteur encore inconnu du grand public, traduit en de nombreuses langues (italien, espagnol, russe, coréen, farsi) et bientôt disponible en allemand, Cyclonopédie est un incontournable et est considéré comme l’ouvrage fondateur de la « théorie-fiction » contemporaine.
• Une édition française très attendue . Dans le monde francophone, plusieurs éditeurs (en France, au Québec, en Belgique) ont cherché à acheter les droits de traduction de Cyclonopédie , tandis que plusieurs traducteurs en ont publié des fragments (en ligne au Québec, dans les revues Zone Critique et Multitudes en France). Negarestani apparaît aussi dans l’ouvrage Accélération (PUF, « Perspectives critiques »).
• Une référence en devenir . Depuis quelques années, des éditeurs de plus en plus nombreux publient les œuvres de membres de l’« école » negarestanienne, ainsi que des ouvrages y faisant explicitement référence. Ainsi en français chez Kodwo Eshun, Mark Fisher, Ray Brassier, Frédéric Neyrat, Grégory Chatonsky, Érik Bordeleau, Yves Citton, Jacques Fradin, Guillaume Boissinot, Yuk Hui, entre autres.
• La métaphysique est une branche de la littérature fantastique, disait Borges. Cet ouvrage en est la preuve ultime.
Public cible
• Passionnés de littérature expérimentale, de philosophie spéculative, de fictions d’horreur.
• Lecteurs de théorie critique contemporaine (CCRU, Mark Fisher, Andrew Culp, Benjamin Bratton, Donna Haraway, etc).
• Amateurs de Lovecraft, Bataille, Borges, Deleuze et fanbase du matérialisme spéculatif.
• Ecologistes curieux de lire un livre où un étrange pipeline sabote l’univers humain.
• Bilingues / anglophiles lisant jusqu’alors les écrits de Reza en ligne et qui passeraient commande.
ils en parlent
« Lire Negarestani, c'est comme être converti à l'islam par Salvador Dali »
Graham Harman
« Les lecteurs occidentaux peuvent s'attendre à ce que leur condition schizoïde particulière soit "charcutée" par cet ouvrage. Considérons une thèse grotesquement réductrice, violente, comique mais néanmoins suggestive : L'islam est à Negarestani ce que le marxisme est à Bataille »
Nick Land
« Le manuscrit de Cyclonopédie reste l'un des rares livres à poser rigoureusement et honnêtement la question de savoir ce que signifie s'ouvrir à une vie radicalement non-humaine […] Cyclonopédie fait également partie d'une nouvelle génération d'écrits qui refusent d'être qualifiés de "théorie" ou de "fiction" […] Pour trouver un ouvrage comparable, il faudrait remonter aux Unaussprechlichen Kulten de Von Junzt, aux poèmes en prose d'Olanus Wormius ou aux récents commentaires "néophagistes" sur le Livre d'Eibon.
Eugene Thacker
« Incomparable. L'horreur post-genre, la théologie de l'apocalypse et la philosophie du pétrole se croisent en un codex nouveau et nécessaire » China Miéville
« Cyclonopédie est un traité extraordinaire, un hybride inclassable de fiction philosophique, de théologie hérétique, de démonologie aberrante et d'archéologie renégate. Il allie la rigueur conceptuelle à un
« Incomparable. L'horreur post-genre, la théologie de l'apocalypse et la philosophie du pétrole se croisent en un codex nouveau et nécessaire »
China Miéville
« Cyclonopédie est un traité extraordinaire, un hybride inclassable de fiction philosophique, de théologie hérétique, de démonologie aberrante et d'archéologie renégate. Il allie la rigueur conceptuelle à un ésotérisme exigeant et, à travers ses formules sacrilèges, l'épilepsie géopolitique est scrutée comme dans un miroir d'obsidienne »
Ray
Brassier
« Monumental […]. Un chef-d’œuvre de théorie-fiction. […] Negarestani pense une forme d’insurrection de la terre contre le soleil »
Érik
Bordeleau
« Une fiction climatique […] Un dédale d’intrigues troublées et inauthentiques »
Fabien Richert
« Un cauchemar spéculatif peuplé d'archéologues, de djihadistes, de trafiquants de pétrole, de soldats américains, de chefs religieux hérétiques, de cadavres d'anciens dieux, de la terre et du soleil, et de chasseurs extraterrestres »
Yun
Won-hwa
« Des mystères chtoniens du pétrole aux fictions macabres de H. P. Lovecraft, de l'ancienne sagesse islamique (et pré-islamique) aux terrifiantes réalités de la guerre asymétrique postmoderne, Negarestani fouille la préhistoire cachée de la culture mondiale au XXIe siècle »
Steven Shaviro
l’auteur en parle
Reza Negarestani, interviewé par Fabio Gironi (sur le site de Nero Editions ), annexe à l’édition coréenne
« L'idée initiale de Cyclonopédie était déjà là avant de découvrir ces nouvelles connexions : un mélange de contes de fées persans tordus, de folklore sociopolitique et de troubles géopolitiques persistants. Mon but était de ne pas aborder ces idées comme un écrivain qui se soucie excessivement du raffinement de l'art littéraire ou des valeurs de la littérature, mais plutôt comme un ingénieur. C'est ainsi que j'ai mis ma formation formelle en ingénierie des systèmes au service de l'écriture d'un livre. Dès le départ, je l'ai traité non pas exactement comme un roman ou un ouvrage de philosophie, mais comme un système doté de tendances abstraites, de trajectoires qui évoluent dans le temps, de comportements imprévisibles, de multiples échelles de contenu d'information, etc. En tant qu'écrivain, je n'ai fait que déclencher - pour reprendre l'expression d'un ingénieur système - l'état initial du système et le laisser vivre sa propre vie. Le désordre auquel vous faites référence à juste titre est le résultat de deux problèmes différents. Ma sous-performance en tant qu'écrivain au niveau de l'exécution, et mon intention en tant que personne qui essaie d'imiter le mieux possible le climat du Moyen-Orient, qui était ma zone d'expérience immédiate. J'ai écrit Cyclonopédie avec une seule priorité : construire un sentiment de syncrétisme et de paranoïa, deux caractéristiques du Moyen-Orient contemporain . Une bonne fiction peut simuler ces caractéristiques, mais pour les imiter et les reproduire, il faut trouver et inventer des mécanismes similaires capables de générer le type de paranoïa, d'horreur chronique et de syncrétisme fertile propre au Moyen-Orient, plutôt que de les décrire ou de les réitérer par le biais du média littéraire ».

L’ÎLE AUX FLEURS
Pourquoi L’île aux fleurs ?
Notre maison emprunte son nom au documentaire de Jorge Furtado de 1989, allégorie en moins de 15 minutes de la vie capitaliste. L’île aux fleurs a pour ambition de mêler éclats de langue, de poésie et de réel, d’inventivité narrative et formelle et de désir de rendre justice à ce qui a lieu, pour que notre époque si singulièrement étouffante et complexe puisse se saisir, dans toute sa densité et son ambivalence, au croisement du personnel et de l’universel.
L’île aux fleurs se peuplera d’essais, de récits, de non-fiction narrative ou savante, d’une littérature sociale afin de dessiner une cartographie intime et politique de notre monde, de donner à lire des peines et des désirs, des échecs flamboyants et des renoncements glorieux, des fragments de ce qui, matériel ou imaginaire, résiste à la marche du monde et reste invisible à nos yeux.
L’île aux fleurs se fera aussi l’écho, autant que possible, de l’intelligence collective en action, du débat permanent auquel participent aussi bien nos auteurs et autrices que nos lectrices et lecteurs. Intelligence et débat qui nourrissent nos espoirs. L’île aux fleurs sèmera des points de vue critiques variés impliquant des subjectivités, c’est-à-dire des doutes et des certitudes, des paroles souvent marginalisées auxquelles nous donnerons le temps de s’épanouir.
Bienvenue sur L’île aux fleurs.
L’arche et le désert
L’avis parfois diffus qu’à propos du changement climatique tout a été dit, que l’on en parle trop ou pas assez dénote un sentiment partagé si ce n’est de désespoir tout du moins de lassitude. La lecture de Mike Davis nous donne un regard neuf et approfondi. De ces lectures qui nous rendent comme un peu plus armés sur les questions de notre temps.
En reprenant les travaux de Kropotkine, penseur anarchiste et géographe émérite, Mike Davis dévoile une historiographie de la conscience écologique et détricote bien des idées reçues. De son expérience d’urbaniste, Mike Davis nous délivre des conclusions inédites, fruit d’une analyse reconnue et d’une capacité à faire le pas de côté parfois nécessaire.
Une nouvelle théorie de la révolution doit se tourner vers les questions majeures de notre époque : le réchauffement planétaire, la pacification du prolétariat et l’éclipse démographique de la campagne pour la ville. La vie humaine ne saura perdurer sans l’émancipation de chacun et chacune.
L’arche et le désert rassemble les derniers écrits non traduits de Mike Davis sur les enjeux climatiques.
Mike Davis a profondément marqué les études urbaines et la critique sociale. Né dans une famille modeste du Midwest, il devient conducteur de camion avant de poursuivre des études universitaires. Professeur à l’université de Californie, il se fait connaître avec City of Quartz (1990), une analyse innovante et radicale de Los Angeles. Ses travaux sur l’urbanisation, les inégalités sociales et l’écologie politique, notamment dans Le Pire des mondes possibles : De l’explosion urbaine au bidonville global (2006), lui valent une reconnaissance internationale. Lauréat du prestigieux MacArthur Fellowship en 1998, Mike Davis a légué une œuvre engagée, mêlant rigueur académique et critique sociale du capitalisme moderne.
Traduit de l’américain par Emilie Lecoulant. Mike Davis

crise climatique écologie urbanisme géographie histoire des sciences critique sociale utopie Giec crise sociale énergie Kropotkine
bibliographie succinte :
City of Quartz : Los Angeles, capitale du futur, Mike Davis, La Découverte (1997).
Génocides tropicaux : Catastrophes naturelles et famines coloniales (1870-1900), Mike Davis, La Découverte (2003).
Au-delà de Blade Runner : Los Angeles et l’imagination du désastre, Mike Davis, Allia (2006).
Le Pire des mondes possibles : De l’explosion urbaine au bidonville global, Mike Davis, La Découverte (2006). Mots clefs
L’arche et le désert
Mike Davis
« Dans cette perspective, seul un retour à une pensée explicitement utopique peut clarifier les conditions minimales de préservation de la solidarité humaine face aux crises planétaires convergentes. […]
Pour élever notre imagination au niveau du défi de l’Anthropocène, nous devons être capables d’envisager des configurations d’action, de pratique et de relation sociale, et cela exige, dès lors, que nous suspendions les hypothèses politicoéconomiques du présent. »
Mike Davis
« Mike Davis est l’auteur d’une œuvre dense et intense, rigoureuse et inventive, largement traduite en français, dont les enjeux n’ont pas fini de venir hanter notre présent et notre futur. », Libération.
« Mike Davis avait le sens de la formule [avec] son écriture puissante, accessible. » Le Monde.
« Toute sa vie, Mike Davis a été un « foot soldier » : un fantassin, un militant de terrain. » Télérama.
« Les textes de Mike Davis, s’ils n’éludent jamais les violences du monde, cherchent constamment à repérer les sources d’énergies qui les produisent, pour en démonter les mécanismes, voire en détourner ou retourner la puissance. » Vacarme.
Préface de Marc Saint Upéry. Marc Saint-Upéry est un journaliste, éditeur et traducteur français. Il a collaboré avec un grand nombre de publications françaises, latino-américaines et italiennes sur des thèmes divers : philosophie politique, géopolitique, mouvements sociaux, Europe de l’Est, États-Unis, Moyen-Orient, Amérique latine, rapports Nord-Sud. Ses articles sont parus entre autres dans Écologie & Politique, Ecuador Debate, Hérodote, Iconos, etc. Il est l’auteur de Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches sud-américaines (La Découverte, 2007). Directeur littéraire aux éditions La Découverte entre 1993 et 1997, il y a été le premier à introduire Mike Davis auprès des lecteurs français avec City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur (1997).

format
130*210
120 pages
Broché [dos carré collé]
Couverture : Carte couchée 250 gr, quadrichromie.
Intérieur : bouffant crème, 80 gr, n&b.
Impression offset ***
Prix : 14 € TTC
Tirage : 2000 ex. ISBN : 978-2-9596273-0-9
l’île aux fleurs

21 rue Kléber
93100 Montreuil.
mail : xavier@ileauxfleurs-editions.fr
Tél. : 06 01 75 77 40
http://ileauxfleurs-editions.fr
SCROLLER
L’art de faire défiler la vie
par
Laurent TESSIER

978-2-493458-16-2
9,90€ € / 11x15 cm / 80 pages
EN LIBRAIRIE AVRIL 2025
« Scroller : faire défiler un contenu sur un écran. »
Que se passe-t-il lorsque ce geste devient l’essence même de notre quotidien, une course effrénée pour remplir chaque instant de contenus ? De réflexions philosophiques en scènes de films cultes, d’analyses incisives en critiques culturelles, Laurent Tessier nous invite à une plongée dans l’obsession moderne de l’accélération et de la distraction.
À la croisée des chemins entre philosophie, sociologie et expérience personnelle, Scroller décortique notre rapport à une culture saturée de stimuli. L’auteur explore l’influence insidieuse des réseaux sociaux, des séries à binge-watcher, et de la surconsommation de contenus, interrogeant ce besoin viscéral de faire passer le temps à tout prix. En empruntant au conte et aux mythes modernes, il nous rappelle le danger de confondre accumulation et enrichissement personnel.
Ce livre propose de faire une courte pause. Dans ce défilement perpétuel, sommes-nous en train de nous perdre ou de nous construire ?
Une lecture captivante pour tous ceux qui, au-delà du scrolling, cherchent à comprendre les mécaniques numériques qui informent notre société.

L’AUTEUR
Laurent TESSIER est sociologue, Professeur à l’ICP où il dirige l’équipe de recherche « médias, images et technologies ». Spécialiste de l’éducation au numérique, il a notamment publié en 2019 chez MkF, Éduquer au numérique ? Un changement de paradigme
LES POINTS FORTS
• Un style narratif inspirant et accessible, fait de nombreux exemples et références de la pop-culture
• Un thème profondément actuel autour de la saturation culturelle et technologique
• Un excellent point d’accroche pour organiser des événements en librairie : discussions sur la gestion du temps, débats sur l’impact de la technologie…
également disponible en version ebook
EXTRAIT
"La matrice contre le réel. Au moins un siècle qu’on invoque les dangers de contenus culturels portés par de nouvelles technologies qui nous coupent de la « vraie vie ». Il n’y a pas si longtemps, les cibles des critiques de la culture de masse, c’était Dallas (Ang, 1982) ou Hélène et les garçons (Pasquier, 1999).
Aujourd’hui ce sont les réseaux sociaux numériques, les plateformes de streaming et autres distributeurs de contenus en ligne qui sont principalement visés. Car si l’on en croit leurs détracteurs, les applications diffusées par les géants de la Silicon Valley seraient plus aliénantes et plus addictives qu’aucun autre médium avant elles. Grâce à une approche scientifique des mécanismes psychologiques de l’attention, Meta, Google et compagnie manipuleraient à l’envi nos dark patterns (Brignull, 2023). Tout cela est largement documenté, discuté et critiqué. Ça n’est pas exactement le sujet de ce texte. La question que je voudrais explorer ici est, plus basiquement :
Pourquoi je fais passer le temps ?
Au lieu de lutter pied à pied contre les fascistes. Au lieu de faire progresser ma carrière, qui stagne. Au lieu de m’engager contre le réchauffement climatique. Au lieu de prendre des nouvelles de mes proches. Au lieu de secourir les migrants qui se noient.
Faire défiler des contenus sur Instagram ou Facebook est une (non-)activité socialement stigmatisée précisément parce que c’est une manière de faire passer le temps particulièrement efficace et pervasive. Une activité qui semble prendre insidieusement la place de toutes les autres activités. Je scrolle sur les réseaux à tout moment de la journée, indifféremment pendant et hors des heures de travail. Dans mon histoire de petit tailleur, c’est bien le travail qui est source d’ennui et d’impatience. C’est le temps du travail que le tailleur veut faire passer plus vite. Mais aujourd’hui, c’est comme si c’était la totalité de mon temps que je voulais faire passer. Temps professionnel, temps personnel. Chaque membre de la famille dans sa chambre, sur son ordinateur ou sa tablette. Mes amis en train de manger au restaurant, à une même table mais chacun penché sur son téléphone. Je me laisse aller à cette annihilation sans peine… Pas tout à fait sans peine en fait. Car subsiste en arrière-fond une forme de culpabilité. Je sais que j’aurais mieux à faire. Que je devrais plutôt mettre à profit ce temps perdu sur les réseaux sociaux pour vivre ma meilleure vie
Éduquer au numérique ?
Laurent Tessier

Coll. Les essais numériques 180 pages – 12 x 20 cm 16 €
Il ne faut pas s’y tromper : l’arrivée des industries numériques dans les écoles et les universités qui se joue actuellement sous nos yeux n’est pas qu’un changement de support (papier Vs. numérique). Il s’agit d’un changement profond dans notre rapport aux technologies et à l’éducation. Educateurs, enseignants, chercheurs et parents doivent donc pouvoir en saisir les enjeux, afin de construire leur propre positionnement et leurs propres stratégies éducatives.
Mais comment alors éduquer à l’ère du numérique ? Quelle place faire au numérique dans les parcours scolaires et universitaires ? En France ou ailleurs, les acteurs du monde éducatif se sont massivement saisis de ces questions. Pour autant, la réponse éducative à la « révolution numérique » est encore aujourd’hui loin d’être univoque. Elle a même suscité durant les dernières années des débats passionnés.
Cet essai ne vise pas à recenser les innombrables pratiques, outils technologiques et théories qui coexistent aujourd’hui dans les mondes éducatifs mais propose au contraire de dégager les grands mouvements de l’éducation au numérique. On verra que s’affrontent deux paradigmes : d’une part le paradigme français avec prééminence de la théorie sur la pratique, construction d’une distance critique avec les technologies. En face, le paradigme anglo-saxon des EdTech prend une place de plus en plus grande jusqu’à devenir le paradigme dominant. Celui-ci met en avant, entre autre, une pratique du code informatique et un rapport décomplexé à des technologies considérées en ellesmêmes comme éducatives.
L’auteur
Laurent TESSIER est enseignant-chercheur à l’Institut Catholique de Paris. Il accompagne depuis plus de dix ans les enseignants en formation à la faculté de sciences de l’éducation de l’ICP dans leurs projets numériques. Ancien vice-recteur de l’Institut, il a également été en charge du campus numérique de cet établissement. A travers ses différents engagements, il veut aider à développer des écosystèmes d’alternatives pédagogiques qui favorisent la réussite de tous.
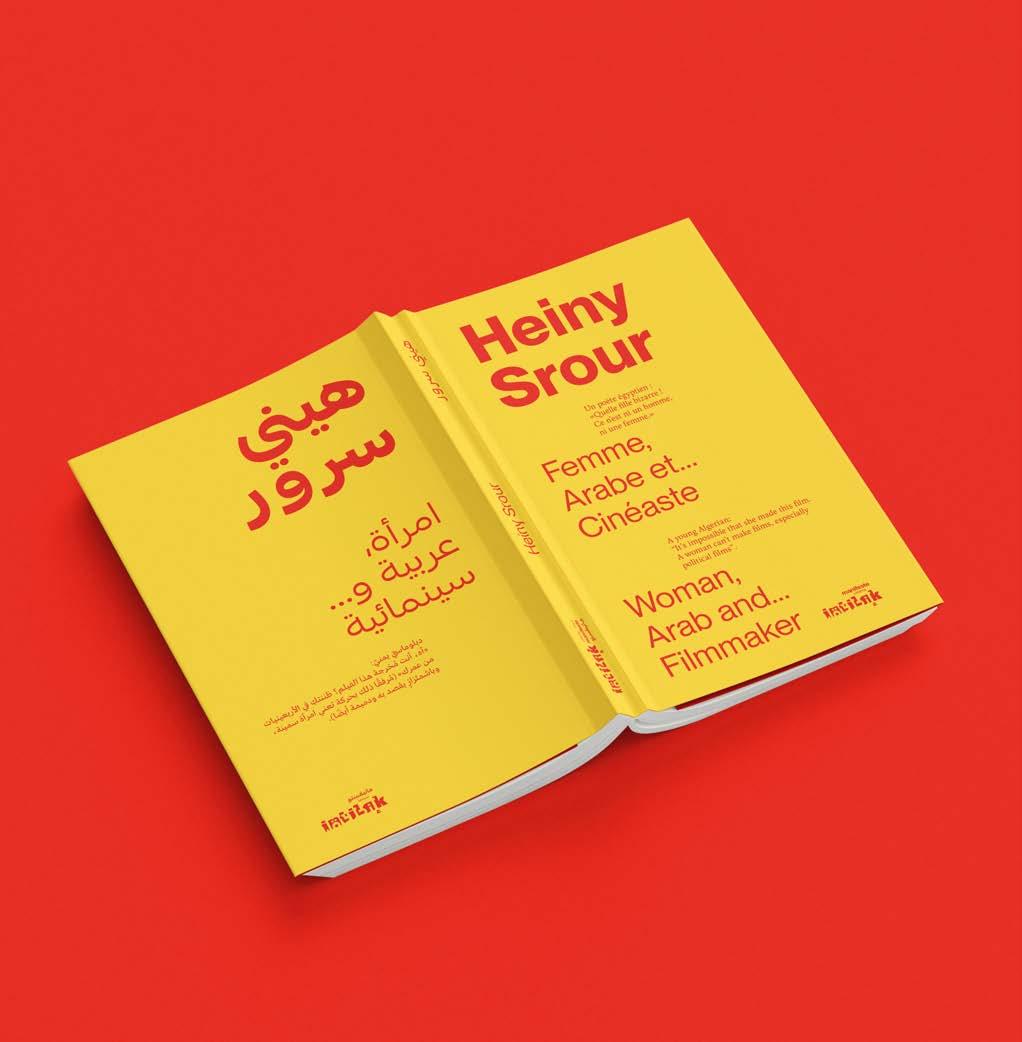
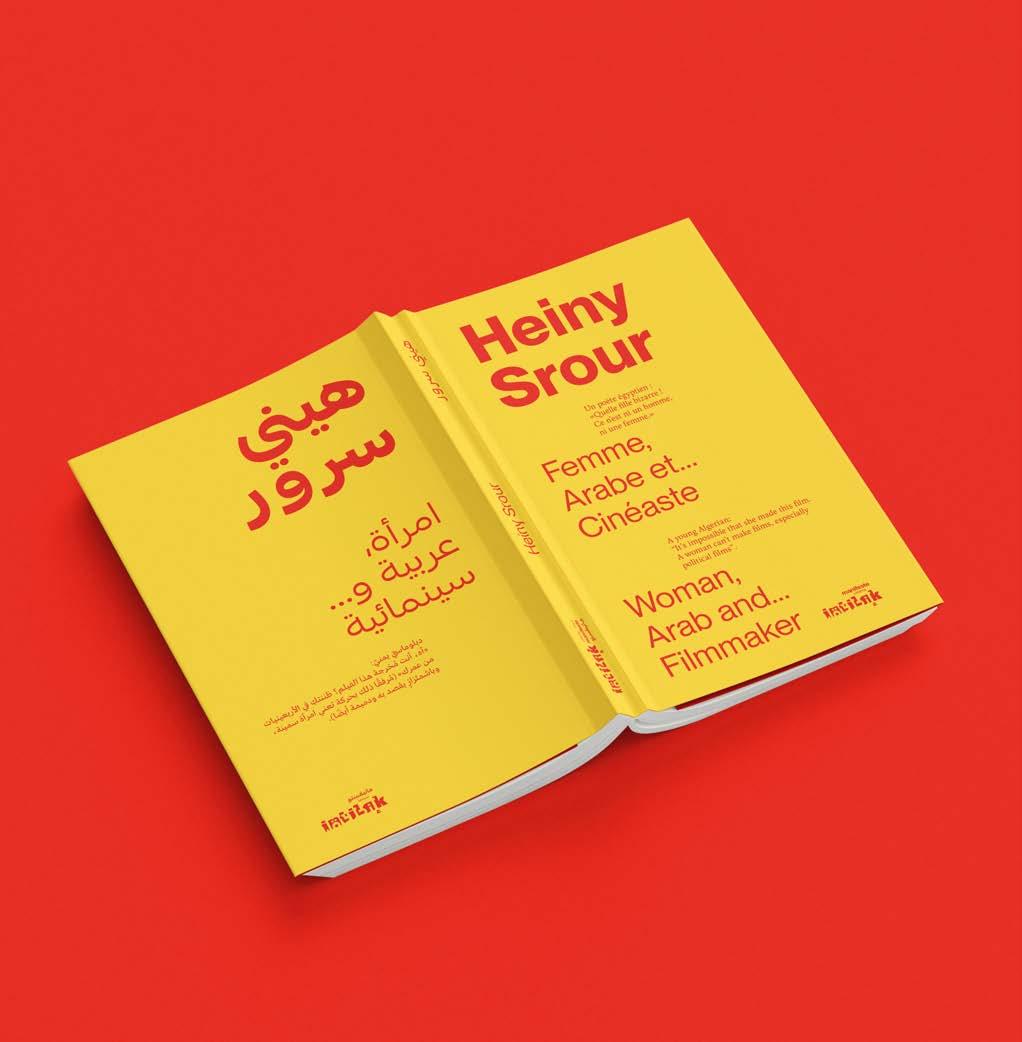
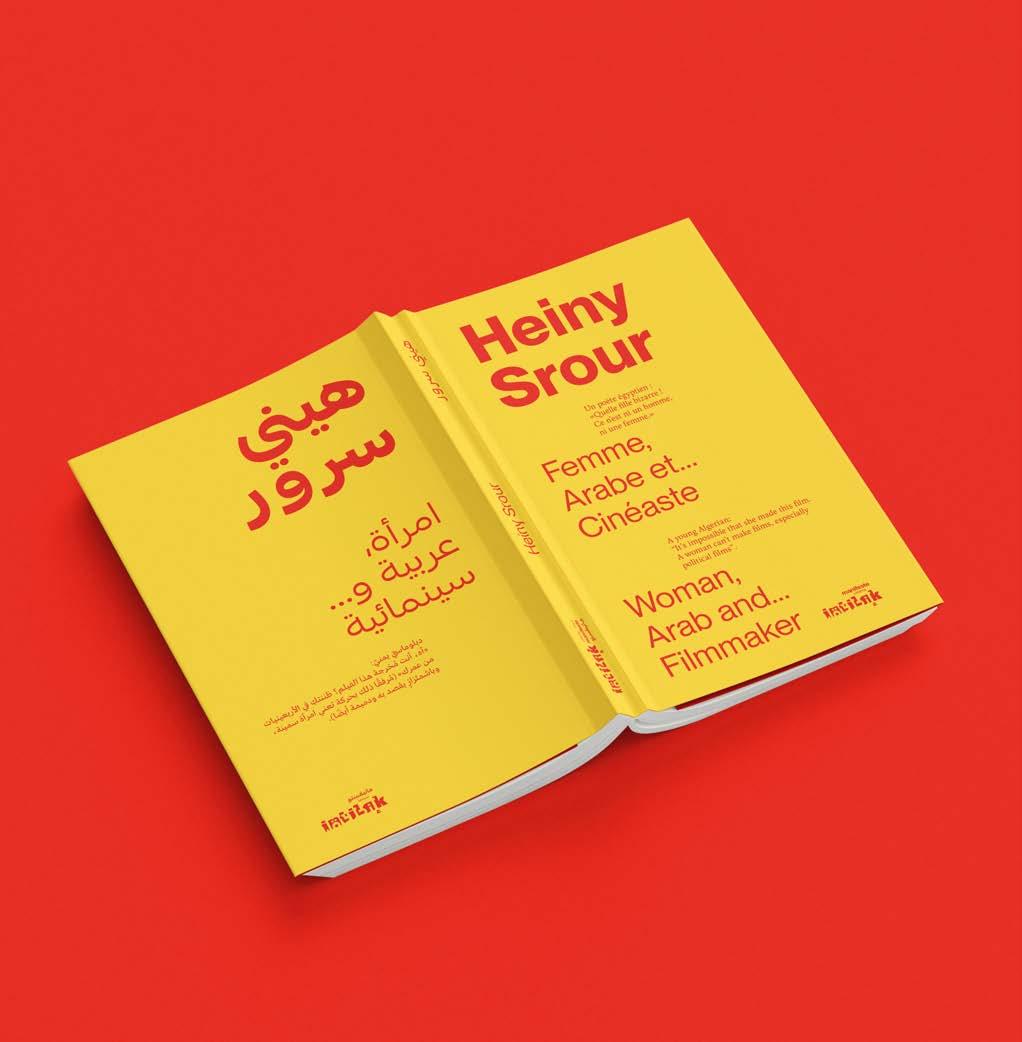
Femme, Arabe et... Cinéaste
Coédition :
Éditions Motifs (Alger), Archives Bouanani (Rabat) et Talitha (Rennes)
Collection INTILAK
120p. 2 illustrations – 12 X 21 cm
Édition trilingue : français, anglais et arabe
Graphisme :
Studio Chimbo
Traduction :
Djamila Haidar, Sis Matthé et Melissa Thackway
Prix de vente :
12€ – 900 DA – 100 dhs
ISBN - 9782958731434
Distribution/Diffusion (France-Belgique-Suisse) : Paon Diffusion / Serendip
Genre :
Essai – féminisme – manifeste
Fabrication :
Dos carré cousu collé


Résumé
1976. Un texte féministe de libération.
De son parcours de militante et son vécu de cinéaste, Heiny Srour révèle les maux, les combats et les doutes qui l’assaillent lors de la réalisation de son premier long métrage sur l’engagement révolutionnaire des femmes, L’heure de la libération a sonné.
Avec humour, révolte et puissance, elle met au jour la violence des réactions provoquées par le film. Ses camarades militants lui reprochent de laisser trop de place au féminisme et pas assez aux luttes. Les féministes françaises lui reprochent d’avoir un regard « trop masculin » car son film montrerait trop d’armes. Et quand un cinéaste latino-américain salue son travail... c’est en lui disant qu’elle a « des couilles ».
En déployant une réflexion accessible et essentielle sur les systèmes de domination que constituent le patriarcat et le colonialisme, la cinéaste libanaise Heiny Srour affirme la nécessité d’articuler les combats.
Ce texte-manifeste bouscule et participe à outiller nos mouvements militants contemporains.
Biographie
Heiny Srour est une réalisatrice libanaise née en 1945 à Beyrouth. Après des études de sciences humaines au Liban et en France, elle s'engage pour la libération des peuples, les décolonisations et l'émancipation des femmes. En tant que cinéaste militante, elle réalise deux longs métrages : L'heure de la libération a sonné (1974), le récit d'une lutte armée au Sultanat d’Oman sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes en 1974, et Leïla et les loups (1984), une fiction qui retrace 80 ans d'histoire silenciée de la Palestine et du Liban, pour en réfuter toute version coloniale et masculine. Elle signe également les documentaires The Singing Sheikh (1991) sur le chanteur contestataire égyptien Cheikh Imam, Les Yeux du coeur (1994), Rising above : women of Vietnam (1996) et La Grève mondiale des femmes 2000 (2000).
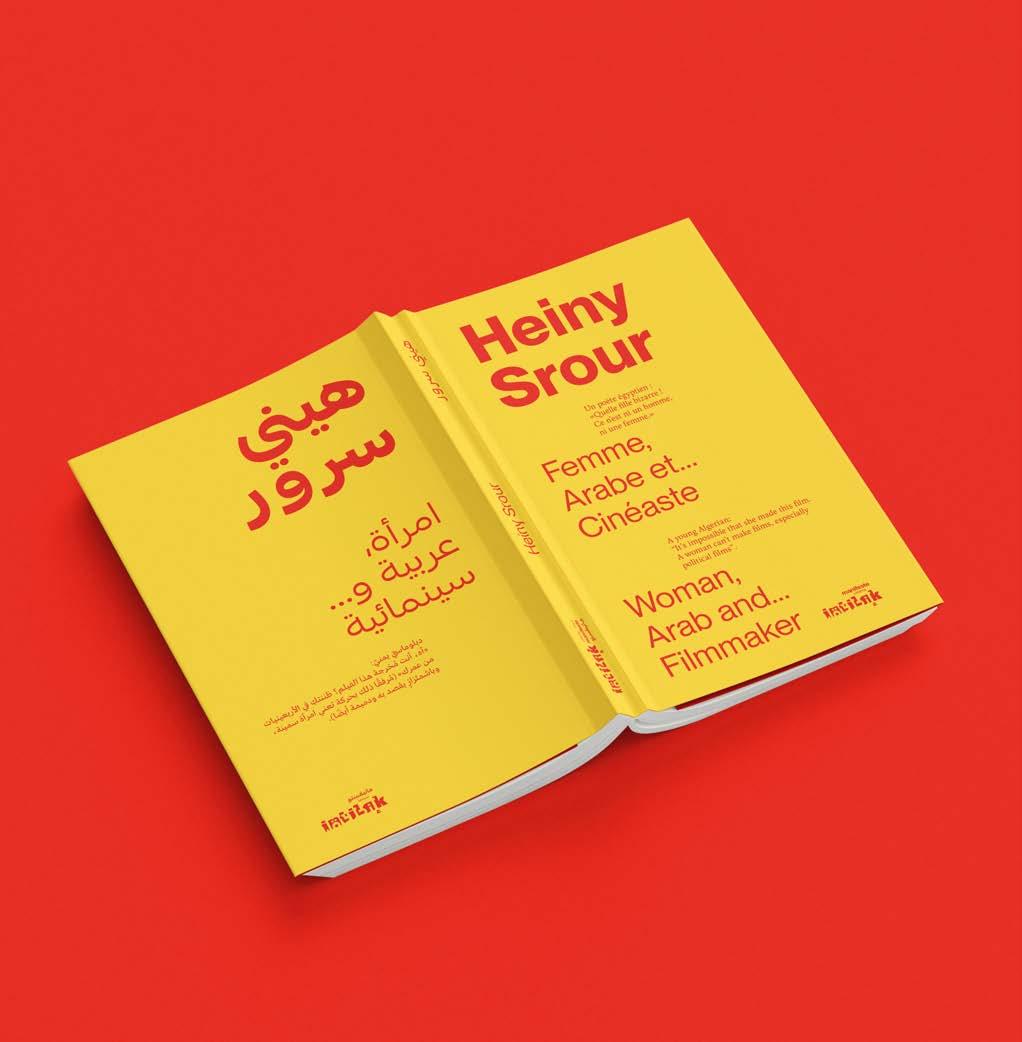

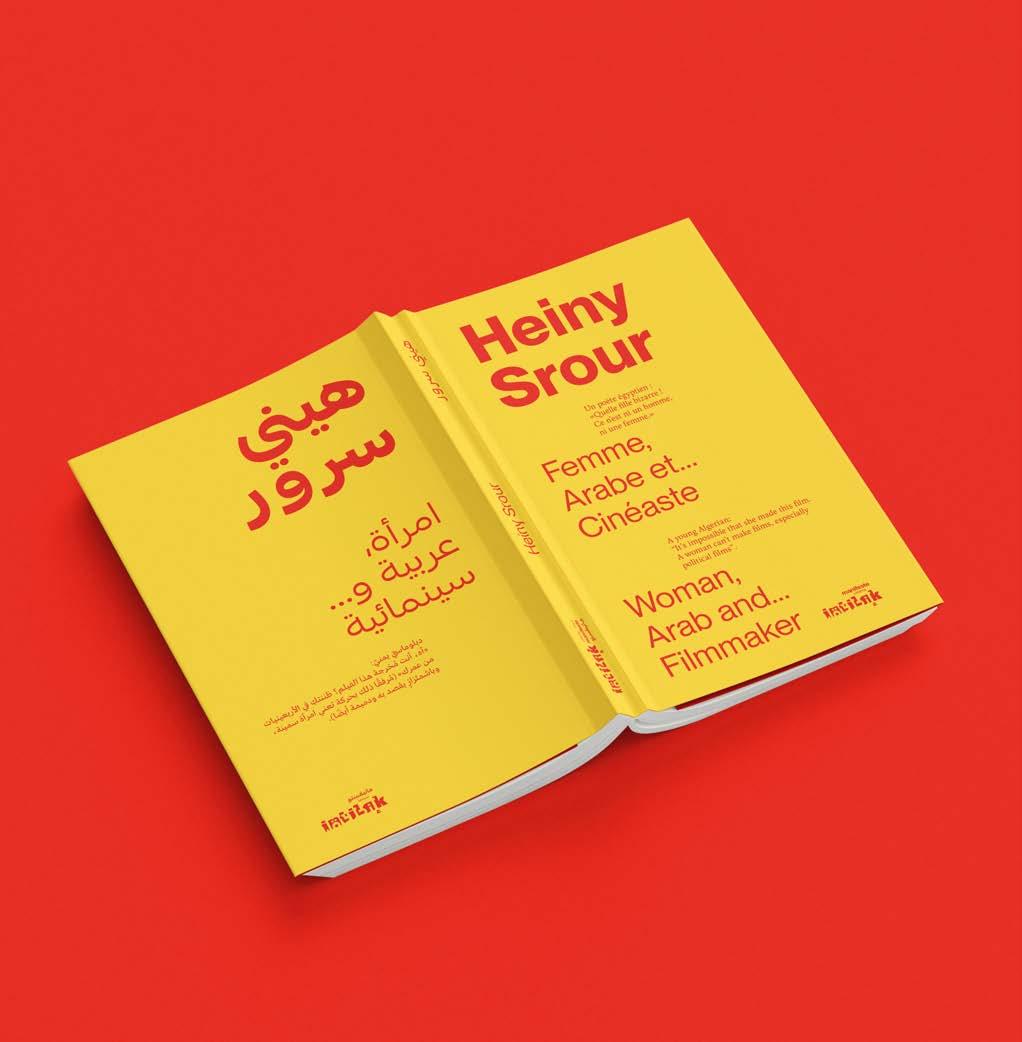
À propos du livre
«Y a-t-il un cinéaste arabe qui ait provoqué une explosion de colère méprisante pour avoir affirmé devant des militants marxistes – ne riez pas – son désir d’être cinéaste un jour ? Y a-t-il un cinéaste arabe qui ait été obligé de cacher à sa famille qu’il voulait réaliser des films ?
Y a-t-il un cinéaste arabe qui se soit vu traiter de fou par X nombre de producteurs pour avoir osé proposer d’aller filmer une guérilla ?»
La force du texte tient au fait que l’autrice arrive à restituer les effets que les attaques répétées ont sur elle. En faisant surgir ce « je », elle ose aller complètement à contre-courant des grands discours de libération de l’époque où triomphent avant tout le « nous ». Évoquant son expérience personnelle, son vécu résonne avec de nombreux destins de femmes empêchées dans leur expression artistique.
Son texte fait écho encore aujourd’hui. Il a été remarqué à travers les ans par un certain nombre de lectrices surtout, pour qui il a représenté une révélation féministe et qui ont eu à cœur de le partager. C’est ainsi qu’il se serait retrouvé aux épreuves de français du bac en Tunisie ; ou que des jeunes féministes arabes en font des lectures, les larmes aux yeux. Signe que les choses n’ont pas tout à fait changé pour les réalisatrices et créatrices, au grand désespoir de Heiny Srour ellemême : elle aurait préféré que les jeunes femmes d’aujourd’hui vivent une réalité différente de la sienne, quitte à faire de son texte une archive datée !
Heiny Srour, écrit et fait des films à partir d’une société colonisée, et lie émancipation de la femme et libération politique. C’est là où résident toute la force et la singularité de son propos.
Extrait
Femme, Arabe et… Cinéaste. Situation viable ? Alors questions :
Y a-t-il un cinéaste arabe qui ait provoqué une explosion de colère méprisante pour avoir affirmé devant des militants marxistes – ne riez pas – son désir d’être cinéaste un jour ?
Y a-t-il un cinéaste arabe qui ait été obligé de cacher à sa famille qu’il voulait réaliser des films ?
Y a-t-il un cinéaste arabe qui se soit vu traiter de fou par X nombre de producteurs pour avoir osé proposer d’aller filmer une guérilla ?
Y a-t-il un cinéaste arabe qui se soit entendu répéter dès le berceau qu’il n’était pas, par essence même, un être « créateur » ? Inspirer les œuvres des autres d’accord ! Écrire des romans traitant de sujets « féminins » est à la limite permis (à contrecœur du reste). Mais prendre la caméra pour parler de dignité humaine (surtout si on insiste sur la libération de la femme), de dignité nationale ? Ah ça non Madame ! C’est l’affaire des hommes.
Voilà quelques échantillons de réactions.
Un poète égyptien « m arxiste » : « Quell e fille bizarre ! Ce n’est ni un homme ni une femme. »
Un jeune algérien : « Ce n’est pas possible qu’elle ait pu faire ce film. Une femme ne peut pas faire des films, surtout pas des films politiques » (ton tranquillement incrédule).
Un diplomate yéménite : « Ah ! C’est vous l’auteur du film ? Je vous croyais âgée de 45 ans » (avec un geste pour dire grosse et une grimace pour dire laide).
Un cinéaste irakien (dégoûté) : « Cette séquence sur les enfants est bien trop longue » (avec un hochement de tête pour dire : quand une femme se mêle de politique voilà ce que ça donne).
Une militante de psyché-po : « C ’est un film d’homme, c’est plein de fusils. » Sa camarade renchérissant : « Ce n’est pas par hasard que nous parlons nous, de «libération», alors que les femmes du tiers-monde parlent elles, d’émancipation. »
Je fais timidement remarquer que nous disons toujours « taharor » (libération) et jamais « intilâq » (émancipation). En vain. Je suis une féministe sousdéveloppée !
Un Mao français : « Sans ce côté M.L.F. (Mouvement de Libération des Femmes) le film était politiquement impeccable ! » Sous-développée encore !
Un cinéaste latino-américain marxiste-léniniste (enthousiaste) : « Voilà un film fait avec des couilles ! »
Et moi : « Non, avec un utérus ! C’est très créateur les utérus, ça engendre la vie. »
Un nombre X de militants arabes : « Tu as trop insisté sur la libération de la femme. L’ennemi c’est l’impérialisme, pas l’homme. »
Un journaliste libanais : « Êt es-vous une vraie femme… Je veux dire une femme normale ? Avez-vous jamais aimé un homme par exemple ? »
Un cinéaste marocain : « C’est politiquement le film le plus «dur» du cinéma arabe. Comment a-t-il pu venir d’une femme et pas d’un homme ? »
Les pires furent parfois ceux dont j’étais politiquement proche dans les milieux du cinéma arabe. Témoin de leur animosité un ami me dit : « Tu as tout fait pour les mettre contre toi : tu as fait un film politique alors que c’est leur chasse gardée, en plus tu es jeune, et tu n’es ni borgne ni bossue. Tu ne leur laisses rien pour se consoler ? »
En somme, c’est bien fait pour la méchante agresseuse.
Assez joué à la victime, me dira-t-on. Ce film a été bien accueilli par la critique européenne et encore mieux par la critique et le public arabes.
J’en conviens mais je note aussi qu’on a voulu y voir surtout le côté anti-impérialiste. Dans le monde arabe en particulier, on a refusé de s’attarder sur les côtés « subversifs » : d écolonisation de la femme et décolonisation de l’enfant.
De toute façon, ce n’est pas la première fois que l’énergie des femmes est acceptée dans des moments où toute la société est en danger. Quand il s’agit de sauver la maison qui brûle, les sociétés les plus conservatrices et les plus misogynes permettront à certaines femmes de dépasser les limites de leur rôle traditionnel. Les femmes deviennent souvent des symboles-compensateurs de la réalité quotidienne des femmes. Elles ne changent pas nécessairement la condition des autres femmes qui sont renvoyées à leurs voiles ou leurs casseroles, une fois le danger passé. Bien souvent, en fait, le plus souvent, le statu quo est rétabli après la violente secousse où pourtant toutes les valeurs de la société auront été remises en question.
Je vous l’avais bien dit, jubileront certains. Elle veut faire de la diversion à la cause anti-impérialiste. Elle veut convaincre les femmes de ne pas participer à la lutte puisque de toute façon elles n’en auront rien !
Ne mélangeons pas tout, et précisons que, si la participation des femmes à la lutte anti-impérialiste est une condition nécessaire, elle n’est cependant pas suffisante, à leur libération.
Extrait 2
Revoyant mon histoire personnelle, je réalise aussi que mes déceptions politiques successives ont joué un rôle fondamental dans mon choix du cinéma comme moyen d’expression. J’aurais pu, en effet, choisir la peinture ou le ballet, mes deux grands amours d’antan. Amours restés sans lendemain, vu le mépris manifesté par mon milieu bourgeois pour ce genre de choses menant à « être une danseuse de cabaret », tout comme le cinéma d’ailleurs, dans l’esprit de mes parents. Certes, le cinéma était le moyen d’expression le plus complet mais je crois surtout le plus politique. Après la répression de mes revendications féministes pendant de longues années de travail politique, le cinéma était le seul moyen à ma disposition pour crier ce que je voulais dire, sans attendre que les états-majors politiques le trouvent opportun ou non. Quel bonheur de décider librement du sujet d’un film – une révolution féministe – sans que quelqu’un vienne vous rappeler « le maillon principal ». Quelle joie de décider toute seule à la table de montage de la longueur de la séquence des femmes sans que quelqu’un vienne vous dire « camarade ce problème n’est pas à l’ordre du jour ». Le censeur en question étant le plus souvent un de ces schizophrènes « marxistes » mais « avec un manque sur le problème de la femme » qui forme la majorité des cadres des différents mouvements de gauche chez nous.
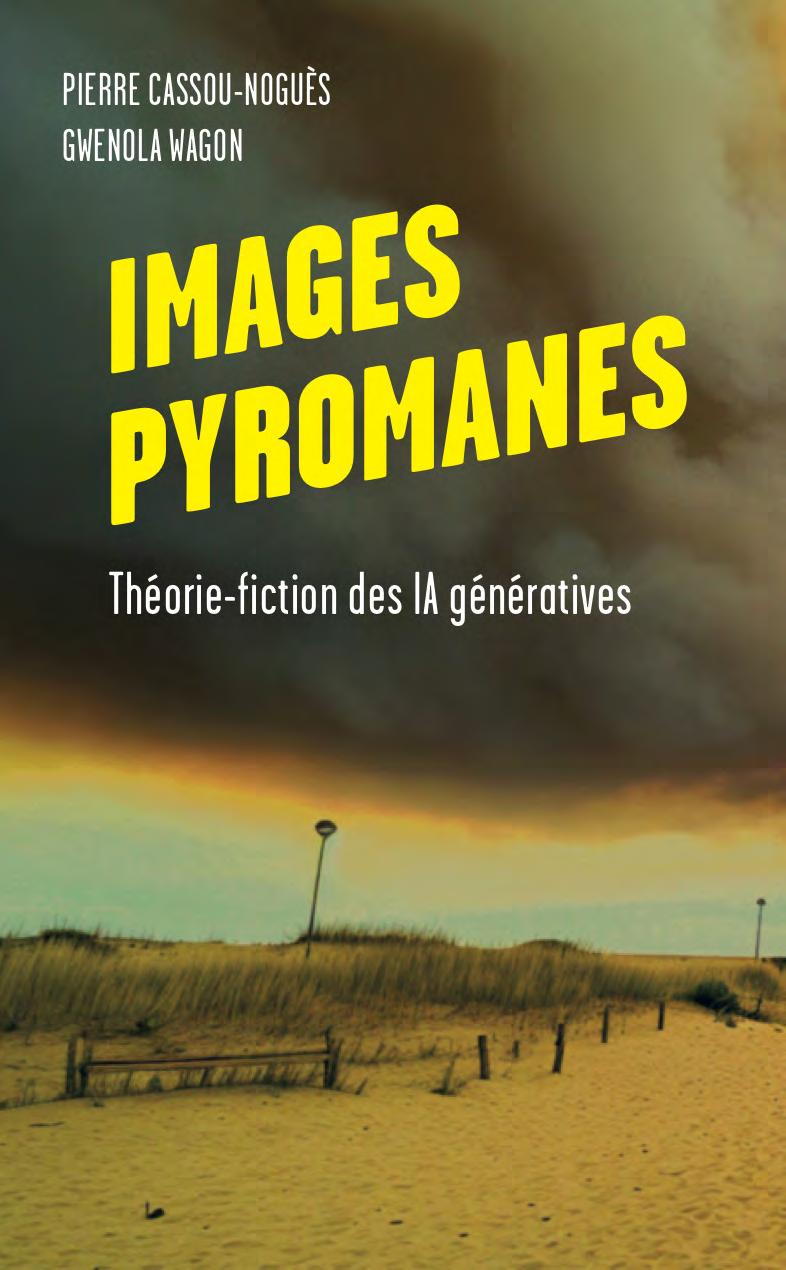
Images Pyromanes
Théorie-fiction des IA génératives
Mêlant théorie et fiction, les auteurs — un philosophe et une artiste — interrogent les implications esthétiques et politiques des IA génératives. Dans un temps fragmenté, sur fond de catastrophe climatique, un duo d’agents immobiliers manipule et imagine la réalité à l’aide de la plateforme, une IA générative d’images.
À travers une série de contes spéculatifs, ce livre se penche sur les multiples facettes de cette révolution : comment les réseaux sociaux, devenus filtres et métafiltres, réorganisent nos réalités ; comment l’anarchive, cette accumulation chaotique d’images possibles, recompose le passé, le futur et l’imaginaire dans un jeu infini de déformations et de réinventions ; la pyropictomanie ou le plaisir pris dans le formidable spectacle d’une dépense d’énergie ; le vol de la lumière qui plonge brusquement l’histoire de l’art dans l’obscurité
La plateforme cache une bête qu’il faut nourrir d’énergie électrique et de temps de cerveau disponible.
Pierre Cassou-Noguès est philosophe et écrivain. Il est professeur au département de philosophie de l’université Paris 8 et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Son travail est fondé sur un usage théorique de la fiction. La fiction est pour lui un moyen d’explorer le possible et ses limites. Dans ses travaux les plus récents, il applique cette théorie-fiction aux problèmes posés par les nouvelles technologies.Il a notamment publié Les Démons de Gödel. Logique et folie (Seuil, 2007), Les Rêves cybernétiques de Norbert Wiener (Seuil, 2014), La Bienveillance des machines (Seuil, 2022). Il a co-réalisé les films Bienvenue à Erewhon, (Irrévérence Films, 2019) et Virusland (Irrévérence Films, 2022).
Gwenola Wagon est artiste et chercheuse. Elle enseigne à l’École des Arts de la Sorbonne à l’Université Paris 1. À travers des installations, des films et des livres, elle imagine des récits alternatifs et paradoxaux pour penser le monde numérique contemporain. Elle arpente le globe virtuel avec ses premiers films Globodrome, enquête dans l’espace de l’hyperinformation et des infrastructures d’Internet en collaboration avec l’artiste Stéphane Degoutin avec qui elle co-réalise World Brain, le livre Psychanalyse de l’aéroport international. Après Bienvenue à Erewhon, Virusland et Chroniques du soleil noir fables post-cybernétique avec Pierre Cassou-Noguès, elle publie le livre Planète B un essai qui mêle enquête et fiction afin d’appréhender un monstre en pleine expansion.
SOMMAIRE IMAGES PYROMANES
Théorie-fiction des IA génératives
Avant-propos
1 - Immobilière Agence
Max et Norma
Posture et post-réalité
Machines à habiter
Filtres et métafiltre
Les vrais artistes sont-ils des agents immobiliers
Reconversion
Psy-non-chimique
La troupe intérieure
Les fantasmeurs
Qu’est-ce que l’IA
Manipulation
Villa de rêve
2 - Anarchives
Les dunes
Une station balnéaire
Le niveau de la mer
3 - Pyropictomanes
Le spectacle de l’énergie dissipée
Hyper-objet et synhaptique
La valeur, temps humain et non humain
Les machines et les plantes
Les images ne sont pas des marchandises
L’économie pyropictomane
TCD (temps de cervau disponible)
Transfert de valeur
Les images rares
Néoromantisme
Le langage et le sublime
Addictions pyropictomanes
4 - Confessions d’une blendeuse - Le carnet de Norma
Bêtes-mains
Des méduses et des escargots
Couples bêtes-actrices
5 - Les grands espaces
Photo de famille
Les archives de Janssen
Les archives du futur
Anarchives
Aberrations, obturations
Un autre temps postmoderne
Différances
L’effet Orlando
Le réel
Architraces
L’espace latent
Comme un enfant
Nommer
Esthétique transcendantale
6 - Portrait del’artiste en Rückenfigur et autres rêveries néoromantiques super-kitsch
L’atelier
La grande réserve
Le Wanderer
Le vol de la lumière
Klepophanes
Nuages
Le Boli
Le plastique
Le paysage-catastrophe
Interlude - Le chant des fibres perdues
Un cœur de plastique
Le super-kitsch
Postscriptum. L’image splash
7 - Épilogue - L’évasion
Remerciements
Index des notions
Biographies
Le livre «Images pyromanes : Théorie-fiction des IA génératives» est une réflexion croisée entre une artiste et un philosophe sur les impacts des IA génératives dans nos vies. Il s’agit d’un mélange de théorie et de fiction qui explore comment ces technologies transforment notre perception du monde, nos habitudes et les formes de coexistence humaine.
Résumé des idées principales :
1. Les IA génératives comme révolution des représentations :
- Le livre ne cherche pas à expliquer techniquement les IA ni leur histoire, mais à comprendre comment elles redéfinissent nos représentations de nous-mêmes, des sociétés, et de l’environnement.
- Les IA génératives, par la production automatisée de textes et d’images, influencent nos gestes, nos récits et les concepts qui structurent notre expérience de la réalité.
2. L’interaction entre artistes, philosophes et IA :
- L’artiste et le philosophe explorent comment ces technologies génèrent de nouvelles «formes de vie». Ils imaginent des scénarios spéculatifs sur les usages, les gestes et les récits que ces IA appellent.
- Les images dans le livre sont majoritairement issues d’IA, combinées avec des photographies et des images trouvées, jouant sur leur authenticité et leur mode de production.
3. Théorie-fiction et critique de la réalité :
- Le livre utilise la théorie-fiction pour explorer des mondes possibles où l’IA joue un rôle central. Ces récits mêlent spéculation et critique sociale.
- Par exemple, un chapitre met en scène une agence immobilière fictive qui vend des logements dans des mondes générés par IA, illustrant la transformation de la perception et de la consommation immobilière.
4. Les images pyromanes :
- Une métaphore centrale est la pyropictomanie, soit le plaisir que procurent les images d’énergie dissipée (incendies, catastrophes, etc.). Cela renvoie à notre fascination pour les images produites par des IA, considérées comme le résultat d’une grande dépense énergétique.
5. Les filtres et la post-réalité :
- Les filtres sur les réseaux sociaux et les images générées par IA sont vus comme des outils de transformation de la réalité en «post-réalité», où les images deviennent des objets de consommation émotionnelle et esthétique.
- Cette dynamique crée des déformations cohérentes qui influencent nos relations à l’environnement et aux autres.
6. La crise environnementale et les IA :
- Le livre aborde les paradoxes de la crise climatique en lien avec les technologies : les IA permettent de représenter les catastrophes tout en
contribuant elles-mêmes à la crise à travers leur coût énergétique. - Il critique notre tendance à utiliser les technologies pour masquer ou «camoufler» les problèmes réels.
7. L’économie des images dans une société post-humaine : - Les auteurs spéculent sur une économie où les images, facilement reproduites, prennent une valeur différente des objets matériels, redéfinissant les concepts de production et de consommation.
Conclusion :
«Images pyromanes» est une exploration imaginative et critique des impacts des IA génératives, intégrant analyses philosophiques, récits fictifs et réflexions sur l’art. Le livre invite à repenser notre rapport aux images, à la réalité et à la technologie, dans un contexte marqué par la crise environnementale et les transformations sociales.


Iman Mersal
Comment réparer :
La maternité et ses fantômes
Traduit de l’arabe (Égypte) par Richard Jacquemond
10 x 15 cm
160 pages 978-2-493242-16-7
15 €
3 avril 2025
Publié en 2018 par Kayfa-ta (Égypte), Comment réparer : sur la maternité et ses fantômes propose une réflexion sur la maternité et ses représentations. Plusieurs fois réimprimé, ce livre jouit d’une très grande réputation dans le monde arabophone, notamment auprès des jeunes générations.
Mobilisant différentes formes d’écriture (essai, récit, poème, journal) et des images photographiques tirées de sources diverses (archives personnelles, presse, portraits vernaculaires, etc.), la trame du livre s’articule autour des relations de l’autrice avec sa mère, sa grand-mère et ses deux fils. Déjouant les clichés et les formes narratives établies, Iman Mersal décèle les complexes réseaux symboliques dans lesquels s’inscrivent la filiation et la maternité, depuis la grossesse jusqu’à l’éducation des enfants, et ce de génération en génération.
À l’écoute des silences de la mémoire, explorant ses labyrinthes, le livre porte un regard critique sur la violence et le sentiment de culpabilité qui traversent le corps maternel, notamment dans ses rapports au langage, au travail ou aux institutions. Iman Mersal élabore ainsi une sorte d’art poétique : la réparation dont parle le titre passe par l’écriture, elle est donc d’ordre créatif ; mais l’écriture s’insère dans un quotidien qui lui fait obstacle, qui met au défi la possibilité même d’écrire dès qu’on devient mère. Comment réparer : sur la maternité et ses fantômes est en ce sens un formidable texte de résistance, un geste d’émancipation.
Née en 1966 en Égypte, Iman Mersal est poète et professeur associé de littérature arabe à l’université d’Alberta, au Canada. Ses récents livres sont des écrits très originaux qui mêlent recherche académique et réflexions intimes sur une grande variété de sujets, dont la plupart ont trait à son identité de femme et d’artiste. Une anthologie de ses poèmes - Des choses m’ont échappé (2018) - et un récit - Sur les traces d’Enayay Zayyat (2021) - ont été traduits en français par Richard Jacquemond pour les éditions Actes Sud.




































































UN JARDIN
Une rencontre imaginée entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli
Yola Le Caïnec, Léa Busnel et Élise Legal
▶ Format (mm) ������������������������� à définir
▶ Nombre de pages à définir
▶ Prix (€) +/- 15
▶ ISBN 978-2-493534-18-7
▶ Parution ��������������������������������������� mai 2025
▶ Graphisme Marine Le Thellec
Un jardin est un livre en trois parties, qui mêle images, textes et documents d’archives autour des pensées des cinéastes et théoriciens Laura Mulvey et Jean-Louis Comolly. La première et la troisième partie sont des textes inédits du collectif Women Remix (Yola Le Caïnec, Léa Busnel, Élise Legal) tandis que la partie centrale réunis des textes de Laura Mulvey inédits en français (trad. Women Remix) et des textes de Jean-Louis Comolli publiés pour la première fois dans un livre. Ce livre est l’endroit d’une rencontre inédite entre des figures majeures de la pensée critique du cinéma.
Toustes les deux artistes et théoriciens de l’image en tant que vecteur des structures politiques et sociales, Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli ont largement contribué à la pensée critique du cinéma
Laura Mulvey, assez peu traduite en français, est la penseuse du concept de « male gaze », tandis que Jean-Louis Comolli a toujours articulé l’existence des images avec leurs expressions sociales
ESSAI, CINÉMA, ÉTUDE DE GENRE
Un jardin découle d’un projet de film qui les aurait fait se rencontrer et dialoguer ensemble dans le jardin de Jean-Louis Les contraintes économiques et temporelles liées à la fabrication du film, mais aussi celles liées la santé fragile de Jean-Louis Comolli, décédé en mai 2022, ont empêché l’aboutissement du projet dans sa forme filmique. Ce livre devient dépositaire de leur rencontre impossible, ébauchée par des échanges épistolaires, et des séquences d’entretiens menés avec l’une et l’autre
Léa Busnel, Yola Le Caïnec et Élise Legal se sont rencontrées en 2013 dans le cadre d’études cinématographiques à Rennes� Depuis lors, elles ont travaillé ensemble en écrits et en images sur la représentation des femmes à l’écran
Le livre se positionne avant tout relativement à la pensée de Laura Mulvey� En évoquant avec Jean-Louis Comolli la théorie de Laura Mulvey, il s’est vite présenté comme étant le plus à même parmi les cinéastes français de donner la réplique à la féministe britannique Il retrouvait notamment dans la pensée de Mulvey ce rapport d’interrogation et d’analyse urgentes des modifications complexes du statut de l’image en lien avec l’accélération des évolutions techniques
Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey — similairement nés en 1941 —, ont des approches théoriques du cinéma et de l’image non pas identiques, mais complémentaires Jean-Louis Comolli aborde l’image du point de vue d’un matérialisme historique, Laura


Thèmes abordés : Cinéma expérimental, documentaire, psychanalyse, féminisme

Œuvres associées :
▶ Fétichisme et curiosité, Laura Mulvey, Brook, 2019
▶ Voir et pouvoir, L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Jean-Louis Comolli, 2004
▶ Bonjour Monsieur Comolli (film documentaire), Dominique Cabrera, 2023
































































Mulvey, dans une perspective freudienne, interroge l’inconscient individuel mais aussi collectif dans l’image, inconscients à l’œuvre notamment dans la mythologie Dans leurs approches respectives, un questionnement persistant les fait se rejoindre : la femme n’est jamais représentée à l’écran sans qu’il y préside une intention spécifiquement liée au fait que ce soit une femme. Un Jardin propose de lier collectivement deux pensées de cinéma qui reposent sur l’affiliation de la lecture et du cinéma� Il s’agit d’imaginer une rencontre traversée par des enjeux de traduction d’une langue à une autre L’espace du livre devient un lieu de montage où s’élabore des mises en commun réelles ou rêvées� Un Jardin ambitionne de mettre en formes et en images ce que recèle un travail de lecture traversé par des enjeux amicaux, féministes et matériels
Léa Busnel : Née à Lorient en 1995, Léa Busnel a fait des études universitaires de lettres et de cinéma avant d’intégrer en 2018 le master « Documentaire de création » à l’école documentaire de Lussas, en Ardèche Après l’obtention de son diplôme, elle s’installe à Marseille en 2019, où elle travaille principalement en tant que réalisatrice dans le champ du cinéma documentaire Elle est aussi membre de l’association La Buissonnière, qui propose des ateliers de réalisation de courts métrages dans une dynamique d’éducation populaire auprès de divers publics à Marseille et ses alentours
ESSAI, CINÉMA, ÉTUDE DE GENRE



Yola Le Caïnec : Née en 1971 à Nantes, Yola Le Caïnec a grandi en Vendée à Fontenay-Le-Comte Elle enseigne dans les classes préparatoires à Rennes, en français philosophie et études cinématographiques Après s’être intéressée aux images de la femme dans la littérature fantastique, elle a complété ses travaux sur l’image en philosophie épistémologique et esthétique autour de Gaston Bachelard (Universités de Nantes, Nanterre, Paris-3) Elle a ensuite étudié l’œuvre d’Arnaud Desplechin (Paris 3), puis, pour sa thèse, Le féminin dans le cinéma de Georges Cukor des années 50 au début des années 80 (Paris-3) Elle a participé à des groupes de recherches (Film pluriel, GRAC), écrit pour des sites (Cinémathèque française), des revues (CinémAction, Atala, Positif) et communiqué dans des colloques (SERCIA) Elle a travaillé pour le festival romain Printemps du nouveau cinéma français autour d’Arnaud Desplechin et de JeanLouis Comolli, a donné des conférences pour les festivals de Entrevues (Belfort), FIFF (Strasbourg), FEMA (La Rochelle), Travelling (Rennes), Lumière (Lyon), ainsi que pour l’ADRC (rétrospectives Ida Lupino, Kinuyo Tanaka, Warner, Jean-Louis Comolli)� Outre ses écrits sur l’acteur de cinéma, le genre, le cinéma américain, l’esthétique amateure, elle a réalisé des entretiens (éditions DVD), a été jurée pour le prix Alice Guy, aux Écrans du réel (Le Mans) et a coréalisé des entretiens et des films.

Élise Legal : Artiste et autrice, Élise Legal est diplômée de l’École Nationale Supérieure des BeauxArts de Lyon et est actuellement résidente aux ateliers de la Ville de Nantes Elle a eu l’occasion de présenter son travail entre autres à la galerie gb agency (Paris), Sabine Knust Gallery (Munich), Graves Gallery Museum (Sheffield). Son premier recueil de poésie Stray Dog est publié chez Ma Bibliothèque en 2021 et son dernier livre Problèmes de localisation est paru chez Même pas l’hiver en 2024 Elle poursuit également une thèse de recherche-création à Paris-8 qui porte sur l’agir politique de la poésie�
Jean-Louis Comolli : Après le ciné-club d’Alger, Jean-Louis Comolli était rédacteur en chef aux Cahiers du Cinéma de 1966 à 1971� Il a enseigné à l’IDHEC, FEMIS, PARIS 8, Belo Horizonte (UFMG), Barcelone (IDEC, Université Pompeu Fabra), Strasbourg (Univ Marc Bloch), Genève (HEAD) Il a écrit pour Trafic, Images documentaires, L’image, le Monde, Jazz Magazine� Il a publié de nombreux livres dont Free Jazz / Black Power (1971, avec Philippe Carles) ; Regards sur la ville (1994, avec Gérard Althabe) ; Arrêt sur Histoire (1997, avec Jacques Rancière) ; Cinéma et politique, 56-70 (2001, avec Gérard Le-blanc et Jean Narboni) ; Daech, le cinéma et la mort (2016) Il fut le lauréat du Prix Scam en 2003 pour l’ensemble de son œuvre � Pendant de nombreuses années, il a participé au blog « cesfilmsapart », sur lequel il a écrit de nombreux textes
Laura Mulvey : Professeure de cinéma au Birkbeck College de l’Université de Londres, Laura Mulvey est l’autrice de : Visual and Other Pleasures (Macmillan, 1989/2009), Fetishism and Curiosity (British Film Institute, 1996/2013), Citizen Kane (série BFI Classics, 1992/2012) et Death Twenty-four Times a Second: L’immobilité et l’image en mouvement (Reaktion Books, 2006). Elle a réalisé six films en collaboration avec Peter Wollen dont Riddles of the Sphinx (British Film Institute, 1977 ; dvd, 2013) et Frida Kahlo et Tina Modotti (Arts Council 1980) Avec l’artiste/cinéaste Mark Lewis, elle a réalisé Disgraced Monuments (Channel 4, 1994) et 23 August 2008 (2013)
Image extraite des repérages filmés de Women Remix dans le jardin de Jean-Louis Comolli



































































EXTRAIT 1, Laura Mulvey, extrait du chapitre « Le spectateur possessif » Il y a quelques années, j’ai remonté numériquement une séquence de 30 secondes de Two Little Girls from Little Rock (« Deux petites filles de Little Rock »), le numéro d’ouverture de Les hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953), pour analyser la précision des pas de danse de Marilyn Monroe, et pour en faire un hommage à la perfection de sa performance. En plus de la persona artificielle et stylisée, évoquant un bel automate, ses gestes sont orchestrés autour de moments au cours desquels elle pose. Sur ce fragment particulier de pellicule, joué pour la caméra, elle remonte la bretelle sur son épaule dans un jeu affecté proche de celui d’une garce en robe débraillée, ce qui rentre en complète contradiction avec la précision mécanique de ce geste et de tous les autres. La pleine conscience du geste est telle qu’il a, pour moi, quelque chose du punctum de Barthes, et je me suis retrouvée à revenir encore et encore sur ces quelques secondes du film. Dans le nouveau montage, j’ai répété le fragment trois fois, en faisant un arrêt sur image aux moments où Marilyn marque une pause entre ses mouvements. En plus de son propre jeu précis et contrôlé, la danse ellemême nécessite un contrôle du corps qui pousse son être naturel à ses limites, alternant aussi entre immobilité et mouvement. Le geste développé se déploie jusqu’à ce qu’il trouve un point de pose, tout comme le cinéma ralenti (delayed cinema) trouve des moments identiques à travers la répétition et le retour. La séquence de 30 secondes finit lorsque que Marilyn s’avance en gros plan, rejetant la tête en arrière, adoptant la pose et l’expression de la photographie type de Marilyn en pin-up. Cette image arrêtée rappelle les Marilyns qu’Andy Warhol a réalisées après sa mort, dans l’hommage sérigraphique au masque mortuaire. La superposition imaginaire de l’image de Warhol sur la trace de la Marilyn vivante contient l’idée d’une signification différée, comme si sa mort était déjà préfigurée dans cette pose. Une conscience aigüe d’elle « alors », avant sa mort, se condense avec l’image comme masque mortuaire et la présence poignante de cet indice (index) comme le « c’était maintenant ».
Le spectateur fétichiste, mu par un désir d’arrêter, de retenir et de répéter ces images iconiques, d’autant plus perfectionnées dans le cinéma hautement stylisé, peut soudainement, de façon inattendue, rencontrer l’indice. Le temps de la caméra, son temps embaumé, vient à la surface, basculant d’un récit du « maintenant » à l’ « alors ». Le temps de la caméra apporte avec lui un « imaginaire » du tournage au sein de l’œil de l’esprit, l’espace hors champ de l’équipe et du matériel, de sorte que le monde fictif se transforme en conscience de l’événement pro-filmique. Alors que la crédibilité fictive décline, que l’incrédulité n’est plus suspendue, la « réalité » envahit la scène, affectant la présence iconique de la star de cinéma. En raison du statut iconique de la star, il ou elle ne peut être greffé.e que tangentiellement sur un
Éditions Burn~Août
Diffusion/distribution : Paon-Serendip
personnage fictif. Si le temps de l’indice déplace le temps de la fiction, l’image de la star bascule non seulement entre ces deux registres mais également pour inclure l’iconographie construite par le studio et toute autre information qui pourrait circuler sur sa vie. De ce genre de fusion et de confusion, les rumeurs et les scandales tirent leur fascination et tendent à s’attacher à l’iconographie extra-diégétique de la star. Même la performance la plus réussie est suivie, parfois dans un éclair inattendu, de cette présence extra-diégétique qui s’invite de l’extérieur de la scène et du hors-champ, donnant une vulnérabilité inattendue à la performance d’une star à l’écran.
EXTRAIT 2, Jean-Louis Comolli
Tous les films, disait Christian Metz, sont des films de fiction. Il n’y a pas que les films. Ou plutôt les fictions sont partout, et tout aussi bien hors des romans et des films narratifs, dans les listes de course ou, autrefois, les annuaires téléphoniques, dans les objets et les rôles usuels, dans l’ordinaire des êtres, des situations, des choses. Je le dis à ma façon : tous les êtres parlants sont des êtres de fiction, la fiction travaille le langage, elle forge l’écoute et l’entendement. Fiction se dit de ce qui est fabriqué, « fait » de tête et de main d’homme. C’est-à-dire à peu près tout ce qui nous entoure, y compris désormais une bonne part de ce que les Anciens appelaient « nature ». Je prétends donc, passant du « cinéma (dit) de fiction » au « cinéma (dit) documentaire », ne pas avoir quitté la fiction, m’y être tout au contraire désespérément adonné. Pourquoi ce « désespérément » ? Il faut une certaine dose de foi, et solide, dans l’humaine condition, pour supposer qu’en chacune ou chacun des passagers du temps que nous sommes puissent naître et se développer de singulières fictions mettant à mal les ordres établis. L’hypothèse que toutes et tous nous sommes porteurs de fiction, et pas seulement acteurs, bien que nous le soyons aussi, dans les fictions des maîtres, est une hypothèse renversante. À tout le moins rebelle.
Et si tout cela est bien tel que je l’écris, la question se pose toujours : pourquoi être passé du cinéma dit de fiction au cinéma dit documentaire, puisque fiction il y a dans les deux catégories ? Autrement dit, qu’est-ce qui définit le cinéma dit documentaire par rapport à l’autre ? C’est bien simple pour moi : le recours à des êtres réels, vivant leur vie de tous les jours, celle que je souhaite filmer, justement. Les comédiens (de métier) peuvent parfaitement faire « comme si » ils étaient employés de bureau ou architectes (après une légère formation). Mais pour les « personnes réelles » comme vous et moi, c’est une performance inédite et le plus souvent non rééditable que de jouer dans un film leur propre rôle. Se produit dans leur vie une sorte de crise, telle qu’elles ou qu’ils investissent dans leur collaboration au film une part, ou des parts d’ellesmêmes ou d’eux-mêmes qui les surprennent, les font se découvrir davantage, se révéler. Cette part de fiction, précisément, que la vie sociale ordinaire masque ou étouffe, peut apparaître dans
burnaout@@riseupp.net



































































cette circonstance extraordinaire. Cette révélation d’elles-mêmes ou d’eux-mêmes au travers d’un film est un bouleversement qui démontre que chaque être parlant est à sa façon créateur. Voilà qui me touche plus que les performances souvent admirables d’une ou d’un comédien. Ce n’est pas de la même eau. Pour le non-comédien, il en va d’une certaine forme de rupture avec le monde ordinaire, d’une liberté nouvelle, d’une désaliénation. C’est ce qui est donné à voir et à entendre aux spectatrices et spectateurs. L’insistance, toujours difficile, souvent contrariée, de cette liberté sur l’écran est ce qui se transmet dans la salle. Les spectatrices, les spectateurs sont eux aussi des amateurs. Elles, ils assistent à une série de passages à l’acte qui ne sont ni feints ni virtuels. Dans notre moment historique où le faux se fait passer pour vrai, il n’est pas vain de se référer à cette sorte d’épreuve du feu. Le passage à l’acte de jouer emporte avec lui — arrache — quelque chose de réel qui peut devenir un fait d’expérience.
C’est bien la question de la croyance du spectateur dans les fictions cinématographiques qui est en jeu : cette nécessaire croyance s’appuie ici sur une évidence, que celle ou celui qui joue son propre rôle n’est pas dans le semblant. Je crois à la fois à ce que raconte d’elle ou de lui celle ou celui qui est filmé, mais je crois absolument qu’elle ou il existe hors du film, dans le monde que nous pensons réel parce qu’il est celui de notre soumission et de nos révoltes. La fiction cinématographique ne se substitue pas au monde, elle en fait valoir, tout au contraire, l’étrangeté, l’autonomie, l’indiscipline, la non-malléabilité. Nous trouvons là, cinéastes, la butée de réel qui nous évite de basculer dans l’illusion des illusions que le monde serait pliable et adaptable à merci.
EXTRAIT 3, Jean-Louis Comolli
Depuis de longues années je prétends défaire l’imperium des effets visuels, sonores, narratifs… dans les films dits documentaires. Les films, par exemple, de la série Marseille contre Marseille : il eut été tentant de forcer le trait dans la représentation des hommes politiques marseillais, et d’abord ceux du Front National. Dans un papier écrit en 1995, Mon ennemi préféré, j’ai proposé de montrer sans raillerie ou ridicule les représentants du F.N. que j’ai filmés, entre autres, pendant trente ans, mais de les montrer tels qu’ils se veulent et se pensent, dans ce qu’ils considèrent comme leur glorieux combat. « Filmer l’ennemi » dans sa force et non dans ses faiblesses. Car il s’agit de le combattre tel qu’il est et non tel qu’on le voudrait. De la même manière, j’ai filmé Philibert dans un acte d’amour pour son cinéma, sans emphase, sans prétentions autres que de filmer pour de bon sa parole, sans lui demander rien d’extraordinaire. Nous parlons, j’écoute, il écoute. J’ai donc présenté ce film comme un manifeste pour un cinéma de paroles Dans ce cinéma dit documentaire, que reste-t-il aux personnes filmées, nos contemporains et souvent nos amis, si la parole leur est enlevée ? Dans la parole, libre, improvisée, se déroule une scène
majeure de la subjectivité. La barrer revient à barrer le sujet filmé, à le restreindre à une figure corporelle sans intériorité. La parole, quand elle est filmée, porte le dedans du sujet à s’aventurer dans un dehors collectif, social, politique. Eh bien, la parole libre, librement associée, est l’invention spécifique du cinéma documentaire, seul en mesure d’enregistrer cette parole vive en même temps que l’image synchrone de celle ou celui qui la profère. Jamais cela n’était arrivé dans l’histoire, puisque le phonographe puis le magnétophone étaient à même d’enregistrer la parole comme suite de sons, mais sans une image synchrone qui lui donne forme et sens dans le visible et pas seulement dans l’audible. Comment comprendre cette oblitération de la parole filmée ? Parce que cette parole dans un monde de distractions exige qu’on la suive, qu’on l’écoute, que l’on s’en laisse pénétrer, toutes attitudes, si je comprends bien, peu propices au déploiement du marché. La parole enregistrée de l’autre filmé demande qu’on lui accorde du temps et de l’attention, qu’on soit à l’écoute, car, dans ce qui se dit, il y a toujours le moment historique, les aléas du présent, la crise des subjectivités, la poussée de l’inconscient. Filmée, la parole du sujet est un compte-rendu fidèle de ses affections et de ses explosions. Tout ce qui affirme la prégnance des subjectivités est devenu l’un des enjeux du contrôle par le marché — avec peu de succès pour l’instant, la fantaisie individuelle étant toujours disposée à l’emporter sur le réglage social.
Rejeter un cinéma de paroles prend le sens, selon moi, d’un soutien au marché spectaculaire, qui a toujours supposé un spectateur paresseux et distrait, un mauvais spectateur. Je plaide pour une transformation de ce spectateur en spectateur actif et non passif, capable de se saisir de l’image et du son, du corps et de la parole filmés.
EXTRAIT 4, Un jardin, scénario de la première partie du projet Women Remix
Les textes de ce dernier chapitre ont été grandement rédigés dans le cadre d’une demande de subvention auprès de la Région Bretagne. Dans ce présent livre, ces écrits deviennent la trace écrite d’un travail préparatoire qui n’a pas pu voir le jour. Ce temps de travail, à la fois dans le milieu du cinéma, de l’édition ou des arts visuels, est considérable et dicte des conditions qui peuvent s’avérer décourageantes pour les auteur·ices qui sont souvent dépendant·es de ce type de financement. Nous avons souhaité visibiliser ce travail sous-terrain dont il n’est pas rare qu’il reste lettre morte. Les dialogues de la séquence 1 et 2 entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli ont été inspirés par notre tournage de repérage en décembre 2019 à Paris. Les rushes de ce tournage où Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli lisent séparément les mémoires de Louise Michel ont été ajoutés au dossier de candidature. Les commentaires d’images de Laura Mulvey dans la séquence 3 sont en partie une retranscription et traduction d’un dialogue entre Laura Mulvey et Élise Legal lors de cette même session de tournage.


En librairie mai 2025
Format : 14,8 x 21 cm
Pages : 160 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Essai, environnement
Prix : 14 € / 16 CHF
ISBN : 978-2-8290-0715-6
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
Le futur collisionneur du CERN au mépris du GIEC
Le plus gros chantier d’Europe sous le feu des questions
Jean-Bernard Billeter
PRÉSENTATION
Le CERN qui exploite déjà le plus grand accélérateur de particules du monde se propose d’en construire un nouveau, long de 91 km, 200 mètres sous le canton de Genève, la Haute-Savoie et l’Ain.
À l’étude depuis plus de dix ans, le projet est développé sans consultation de la population, pratiquement à son insu. Est-il défendable d’imposer à toute une région le plus grand et le plus long chantier du XXIe siècle, de transformer des dizaines et des dizaines d’hectares de zons agricoles, forestières souvent protégées en zones technoindustrielles à coup de dérogations accordées par les pays hôtes, la France et la Suisse, actuellement obnubilés par la renommée du CERN. Alors que le réchauffement climatique déstabilise nos infrastructures et que nous sommes tous appelés à revoir nos habitudes, est-il responsable de la part d’une organisation internationale de demander à ses États membres de lui offrir deux nouvelles machines à plusieurs dizaines de milliards d’euros qui consommeraient autant d’électricité que des villes de 300’000 habitants pour la première, ou 700’000 pour la seconde ?
Tout cela pour des recherches qui n’ont pas la moindre application directe, qui répondent à une curiosité sans doute légitime, mais sans aucun caractère d’urgence ; alors que nos glaciers fondent, nos rivières débordent, nos forêts s’enflamment, et que nos villes dépensent des millions pour tenter de s’adapter aux canicules. Tout cela pour quelques milliers de physiciens des particules qui ont choisi d’ignorer les alertes lancées par leurs collègues du GIEC.
AUTEUR
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Ingénieur indépendant, diplômé de l’École polytechnique fédérale de Zurich, JeanBernard Billeter est membre du Comité de noé21, en charge du dossier FCC. Noé21 (noe21.org) est une ONG genevoise fondée en 2003 par Chaïm Nissim, militant décomplexé et généreux, non résumable en trois mots. Noé21 est bien intégrée au tissu associatif, professionnel et politique local, et entretient des rapports avec de nombreuses organisations nationales et européennes. Architecture climatique, sobriété énergétique, méga-science et aviation civile sont ses principaux sujets d’activité actuels.
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
IMAGES ET DISCOURS DE LA RÉPRESSION
Gilets jaunes et policiers sur les réseaux sociaux par
Édouard BOUTÉ

978-2-493458-14-8
16 ¤ TTC
144 pages, broché, 12x20 cm

Dans cet ouvrage incisif et loin des discours manichéens, Édouard Bouté plonge au cœur des dynamiques sociales, médiatiques et politiques du mouvement des Gilets Jaunes, en explorant la question cruciale de sa répression policière. À travers une analyse du rôle des réseaux sociaux – Facebook, X (ex-Twitter) – il montre comment ces plateformes sont devenues des outils de résistance où les manifestants ont documenté, partagé, raconté et dénoncé les violences subies.
Ce livre éclaire ainsi le lien entre mouvements sociaux et médias numériques, et révèle les nouvelles formes d’organisation politique à l’ère digitale. Une lecture indispensable pour mieux comprendre les tensions sociales qui traversent la France d’aujourd’hui.
L’AUTEUR
Édouard Bouté est docteur en sciences de l’information et de la communication au CERES, Sorbonne Université. Il est également coresponsable du groupe de travail « Participation et citoyenneté numériques » du Centre Internet et Société du CNRS. Ses travaux portent sur la dimension numérique des mouvements sociaux, sur la circulation d’images en ligne dans le cadre de controverses, ainsi que sur les logiques de plateformisation de la société.
LES POINTS FORTS
• Une perspective documentée sur un mouvement qui a marqué l’histoire récente
• Une exploration des nouvelles formes de mobilisation via les réseaux sociaux
• Un thème d’actualité et un atout pour votre rayon politique et société
également disponible en version ebook
IMAGES ET DISCOURS
DE LA RÉPRESSION
par Édouard BOUTÉ
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Chapitre 1 – Manifestations
Naissance d’une conflictualité entre les Gilets jaunes et les forces de l’ordre
L’émeute manifestante et la répression policière
Chapitre 2 - Répression
Une évolution des pratiques de maintien de l’ordre au cours du mouvement des Gilets jaunes
Une judiciarisation du maintien de l’ordre
Les armes du maintien de l’ordre, facteurs de l’escalade de la violence
Chapitre 3 - Mise en récit de la répression policière vécue
Facebook, l’espace numérique des Gilets jaunes
Dire la répression et les violences policières sur Facebook
Chapitre 4 - Une mise en récit en débat
L’enquête et les espaces de commentaires
Du débat d’idées en commentaires
Chapitre 5 Effets de l’entre-soi sur la mise en récit
Faire communauté, être communauté
L’homophilie numérique : un cadre propice pour définir l’expérience vécue comme un problème ?
Dire la répression et les violences policières en s’opposant au vécu d’autrui
Chapitre 6 - Sur X, une répression commentée depuis l’extérieur
Quels acteurs sont mobilisés sur X ?
X, un espace polarisé, mais propice à la critique
Quelle continuité entre Facebook et X ?
CONCLUSION
EXTRAIT
Depuis plus de trois décennies et le tabassage de Rodney King en 1991 par la police de Los Angeles, événement capté par un voisin et son camescope, puis diffusé sur les télévisions du monde entier, la question des violences policières et de leur dénonciation, appuyée sur des images, s’est imposée comme un enjeu majeur pour les démocraties, qui n’a cessé de se renouveler au gré des événements et de l’évolution des dispositifs technologiques et médiatiques.
Les États-Unis sont souvent désignés comme un pays où les violences policières, en particulier à caractère raciste, adviennent trop régulièrement et de plus en plus fréquemment. […] En France aussi, les comportements discriminatoires et violents des forces de l’ordre sont régulièrement pointés du doigts et des images sont mobilisées en appui à la critique. En 2020 par exemple, des extraits de vidéosurveillance du tabassage de Michel Zecler ont été publiées par le média en ligne Loopsider. Parce qu’elles ont permis de contredire la version initiale donnée par la police, l’importance qu’il y a à disposer d’images dans de telles affaires a été largement mis en avant dans le cadre de l’opposition au projet de loi « Sécurité Global » qui était discuté au même moment. Effectivement, la visée de l’un de ses articles était interprétée comme un moyen d’entraver la possibilité de dénoncer les actes illégitimes commis par les forces de l’ordre à partir de contenus audiovisuels. […]
Les événements pris ici en exemples s’inscrivent dans un contexte spécifique, qui détermine les pratiques policières et les pratiques visuelles qui en rendent compte : le maintien de l’ordre social, qui renvoie à l’agir policier en contexte ordinaire – la vie quotidienne – et qui touche principalement les habitant·es des quartiers populaires et les personnes racisé·es. Il est un autre contexte où la conflictualité entre les citoyen·nes et les forces de l’ordre est aussi régulièrement publicisée, celui du maintien de l’ordre public, associé cette fois aux manifestations. Dans ce cadre, où l’on parle bien plus généralement de « répression policière », la captation du déroulé des événements est conséquente, les scènes d’affrontements étant enregistrées sous tous les angles, par des médias centraux ou plus en marges, ou encore par des témoins sur place et par les participant·es aux mobilisations eux·elles-mêmes. La répression policière de la mobilisation des Gilets jaunes, entre 2018 et 2020, constitue à ce titre un cas éloquent et plus que fourni.

Collection PHOTOGRAMMES
MACHINES À DORMIR


Machines à dormir
Dirigé par Montasser Drissi, Wiame Haddad et Léa Morin.
Collection Photogrammes
15X21cm
800 exemplaires
15 e
ISBN : 9782958731441
Collection PHOTOGRAMMES
MACHINES À DORMIR MACHINES À DORMIR
Avec une oeuvre de Wiame Haddad commentée par Victorine Grataloup. Des contributions de Samia Henni, Hajer Ben Boubaker et Philippe Artières . Des textes, photographies et documents de Madeleine Beauséjour, Michèle Acquaviva, Med Hondo, François Maspero, Élie Kagan, Monique Hervo, René Vautier, et du Collectif Mohamed. Et des photogrammes de films (dé/re)montés par Léa Morin
Résumé :
MACHINES À DORMIR est un livre composé en 5 mouvements à partir de traces des luttes du logement de travailleurs déplacés en France et de leur représentation socio-historique (7m2), artistique (61), sonore (Assifa), filmique (Cinéma) et littéraire (Feu).
Il s’écrit à partir de la photographie de l’artiste Wiame Haddad À propos d’une chambre occupée (vision d’une soirée d’octobre 1961) et de photogrammes de chambres - comme espaces de colères et de luttes - tirés de films militants des années 1960 et 1970.
Accompagnés de photographies sur le mal logement de Monique Hervo et Elie Kagan, d’un corpus d’archives et documents des grèves des loyers et luttes anti-racistes des années 1970 (Sonacotra, MTA), des textes, anciens et nouveaux dénoncent le continuum colonial et tracent des lignes possibles entre les luttes et leurs outils (qu’ils soient politiques ou culturels), et réclament justice.

Collection PHOTOGRAMMES
Extrait 1 :
La chambre incendiée, par Philippes Artières
Un homme de 48 ans est mort jeudi 18 septembre 2014 dans l’incendie de sa chambre au deuxième étage du foyer logement Adoma Les Trépillots (ex Sonacotra) qui abrite de nombreux travailleurs étrangers rue des Saint-Martin à Besançon.
Tôt ce mercredi matin, 6 mars 2002, le feu a pris dans une chambre du foyer Sonacotra à Dreux dans l’Eure-et-Loire provoquant la mort deux hommes dont l’âge et l’identité n’ont pas été communiqués.
Une chambre du foyer Adoma situé rue Drogon à Metz a été détruite par les flammes le dimanche 22 avril 2018 au soir. L’incendie n’a fait aucun blessé mais vingt-trois personnes dont dix enfants ont dû être évacuées.
Le 10 juin 1998, un incendie d’origine indéterminée s’est déclaré vers midi dans le foyer Sonacotra de la rue de Villejuif. Le feu est parti d’une chambre du troisième étage, inoccupée à cette heure de la journée. Le sinistre n’a pas fait de blessé, il a en revanche occasionné des dégâts matériels assez importants. Selon le responsable du site, une dizaine de chambres du foyer qui en compte 280 sont inutilisables.
Sept personnes sont mortes et quatre ont été grièvement blessées dans la nuit de samedi 13 novembre 2010 dans un incendie survenu dans un foyer Sonacotra de travailleurs immigrés dans le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. Le feu, qui s’est déclaré peu avant 1h30 dans une poubelle située à l’extérieur avant de se propager très rapidement à ce bâtiment de neuf étages, a également fait cent-trente blessés légers. Aucune piste –accidentelle ou criminelle – n’est écartée.
Sept personnes ont été légèrement blessées dans l’incendie qui s’est déclaré dans la soirée du lundi 23 juillet 2007 dans un foyer Sonacotra du XIIIe arrondissement de Paris.
(…)
Pourquoi les chambres des résidents des foyers Adoma / Sonacotra brûlent-elles aussi fréquemment ?
Pourquoi les chambres des résidents des foyers Adoma / Sonacotra brûlent-elles plus que les chambres des cités universitaires et plus encore que les chambres d’internat des grandes Écoles ?
Pourquoi les chambres des résidents des foyers Adoma / Sonacotra brûlent-elles plus que les chambres des foyers de jeunes travailleurs ?
Pourquoi les chambres des résidents des foyers Adoma / Sonacotra brûlent-elles ?
Quels sont les matériaux utilisés pour construire les chambres des résidents des foyers Adoma / Sonacotra pour qu’elles brûlent si fréquemment ?
Quel est le coût de la construction d’une chambre de résident des foyers Adoma / Sonacotra qui brûle fréquemment ?
Combien coûte la rénovation d’une chambre de résident des foyers Adoma / Sonacotra qui brûle fréquemment ?
Quel est le montant du loyer d’une chambre de résident des foyers Adoma / Sonacotra qui brûlent fréquemment ?
(…)
Photogramme du film Soleil Ô de Med Hondo, 1973
Collection PHOTOGRAMMES
MACHINES À DORMIR MACHINES À DORMIR

Détail. Calendrier du Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève, Atelier de sérigraphie de l’Université de Vincennes, 1977, archives Association Transports

Foyer Sonacotra de Bagnolet en grève, 1976, archives Association Transports
Collection PHOTOGRAMMES
Extrait 2 :
Un Vichyste en Algérie et en France par Samia Henni
En France, ceux qui étaient appelés les « travailleurs immigrés », souvent relégués aux alentours des villes françaises et maintenus à l’écart de la société, ont contribué pleinement à ce qui est connu comme les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975. Ces années qui ont suivi le régime de Vichy et la Seconde Guerre mondiale sont caractérisées par une croissance économique rapide, une productivité élevée, une consommation frénétique, des avantages sociaux, et la planification et le contrôle étatiques sur une économie entrepreneuriale.
(…)
Durant les années de la Révolution algérienne et la création des camps français en Algérie, quand les femmes et les enfants des « travailleurs algériens » arrivaient en France, elles et ils arrivaient dans les bidonvilles destinés aux familles et s’installaient dans des baraques très sommaires et insalubres.
La plupart des abris étaient composés d’une chambre unique sans eau et sans électricité. Fathia qui habite dans l’un des bidonvilles de Nanterre surnommé « La Folie » témoigne : « Hier, j’avais huit bidons. J’ai lavé tout mon linge. Aujourd’hui, j’attends mon voisin pour qu’il aille m’en chercher, j’ai plus une goutte d’eau ; c’est fini, j’ai plus le courage de rien faire. L’eau c’est ça qui manque le plus, l’électricité ça ne fait rien. On met des bougies. Mais l’eau, vous ne pouvez rien faire sans eau. Pour tout, il vous faut de l’eau. »
(…)


Mohamed Zinet à Nanterre, rushes, René Vautier (1970) Rushes muettes filmées par le cinéaste René Vautier, en couleurs, mettant en scène le cinéaste et acteur algérien Mohamed Zinet dans les bidonvilles de Nanterre, probablement en préparation du tournage des Trois Cousins (fiction, avec Mohamed Zinet, 10 min, 1970). Vautier évoque en effet dans son ouvrage Caméra Citoyenne (éditions Apogée, 1998) les repérages menés à Nanterre.


Collection PHOTOGRAMMES
MACHINES À DORMIR
Extrait 3 :
Entre les chiens et des hommes par François Maspero
La manifestation du 17 octobre 1961 aura fait apparaitre dans notre pays d’humanistes l’évidence suivante d’un côté, des hommes qui ont eu le courage de cette présence massive, pacifique et silencieuse, dont l’extraordinaire dignité submerge tout : de l’«autre côté», les policiers en uniformes et les passants, les excités qui crient « bravo, allez-y, tapez fort », ou ces tristes Parisiens qui passent pressés, l’œil perdu, sans être concernés au milieu des coups et des assassinats... De cet autre coté, ce sont les chiens.
Nous savons donc maintenant, clairement où sont les hommes, où sont les chiens. Nous n’avons pas l’intention de nous étendre sur les manifestations du 17 octobre. Nous aurions voulu saluer nos Frères algériens. Mais nous ne nous en sentons pas même le droit : certes nos bien-pensants ont fait, immédiatement après, un effort important pour se désolidariser de leurs compatriotes. « Nous n’avons rien à voir avec le Pouvoir, nous n’avons rien à voir avec ces gens-là », criait M. Depreux à la petite manifestation du PSU le 1er novembre. Certes, on a pu voir les journalistes de « France-Observateur» clamer dans tout Paris : « nous voulons rencontrer un responsable algérien, vite, vite... » (de ces mêmes journalistes qui ne craignent pas d’écrire que l’on ne peut pas les accuser ici d’avoir jamais confondu la cause de la gauche française avec celle du peuple algérien… Certes l’on a assisté à la ruée indécente des reporters - de « Paris-Presse » à « France-Observateur » - sur le bidonville de Nanterre. Mais nous autres Français, nous tous les Français, aussi solidaires entre nous dans notre complicité de fait que les Algériens le sont entre eux dans le racisme qui les englobe, où en sommes-nous?
Le fait que le courage, l’héroïsme même des familles algériennes de la région parisienne ait réussi à faire enfin éclater jusque dans les rues des quartiers bourgeois l’atroce vérité, l’atroce visage de nos chiens en uniforme, ne doit pas permettre à qui que ce soit de se donner le luxe de ces comédies où l’on répète : Nous dénonçons. nous nous désolidarisons, nous ne sommes pas du même monde. IL EST TROP TARD. Les grands sentiments, même quand ils sont dictés par la peur, et surtout quand ils sont fondés sur cette prémonition primaire et avouée : après eux, ça va être nous, ces grands sentiments-là, qui peuvent-ils tromper ? Il n’y a pas de soir où dans Paris depuis sept ans ne retentit le cri des hommes que l’on roue de coups jusqu’au coma dans les paniers à salade de nos braves gens de la circulation ; sur les plus grandes artères de notre capitale l’obscène rituel du « contrôle d’identité » n’attire plus le regard que de quelques touristes allemands étonnés. Voici deux mois, fin septembre 1961, nous avons été avertis qu’un rescapé des noyades en séries de la Seine voulait faire une conférence de presse, donner des détails et des noms. C’était la première indication précise qui nous parvenait, la première fois que l’on citait ces pratiques. Il nous a été impossible de réunir le moindre journaliste stagiaire. Chacun se récusait. Il n’yavait pas matière à article, paraît-il, et puis c’est dangereux et enfin il y avait la saisie… Mieux valait continuer à boire sagement la bonne eau de la Seine polluée de la pourriture de bougnoule.
Il aura fallu cette nouvelle pression héroïque des « damnés de la terre » pour crever ce mur de la prudence confortable.
(...)



Collection PHOTOGRAMMES
MACHINES À DORMIR
À propos des éditions Talitha :
TALITHA est une maison d’édition associative (Rennes). Nos livres tracent des liens et ré-imaginent des circulations à partir de textes et images du passé en dialogue avec des écritures contemporaines : histoires du cinéma, recherches, récits documentaires, enquêtes, archives, textes militants, et écriture poétiques ou hybrides.
Les livres de la collection PHOTOGRAMMES s’écrivent en « gros plan » à partir de photogrammes (images fixes) de corpus de films, et se composent en collectif (artistes, programmateurs cinéma, écrivains, activistes, chercheurs). En associant librement des idées et des formes (textes, documents, photographies, transcription, fragments, notes) par le collage et le re-montage, il s’agit aussi bien d’inventer des généalogies fictives, que de tenter d’écrire des livres par le cinéma.

Photogrammes de M comme Malika par Anne-Marie Lallement, 1980


En librairie juin 2025
Format :12,5 x 20,5 cm
Pages: 112 p.
Reliure:broché,collé
rayon : littérature, santé catégorie: récit
Prix: 18 CHF.- / 16 € ISBN 978-2-8290-0703-3
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne 021 323 39 18 contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Ilfaudraquejem'habitue
Anouk Hutmacher
PRÉSENTATION
Accompagnant mon amie en oncologie, j’ai compris, qu’en dépit des bonnes intentions et d'un discours institutionnel qui se veut rassurant, bien peu de choses avaient changé dans les rapports entre le patient et ses soignants. Tout au long de sa maladie, j’ai vu mon amie souffrir de cette drôle de façon d’envisager la relation. Et j’ai vu aussi des médecins et des soignants en souffrir tout autant. Il était temps pour moi de reprendre mon bâton de pèlerin. Anouk Hutmacher
AUTRICE
Anouk Hutmacher est née en 1967. Polymorphe, elle arpente dans ses différents métiers, les versants les plus vertigineux de l’existence et aime en évoquer les contours sans tabou. Sorte de GéoTrouveTout philosophique, elle cherche à comprendre ce qui ne fonctionne pas et, à sa façon, à réparer dysfonctionnements et injustices qu’elle croise sur son chemin. Sociologue, soignante, libraire, paysanne, cérémoniante en funérailles, elle est la mère de quatre enfants à qui elle souhaite un monde meilleur.
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom3019000119404

APRÈS LA RÉVOLUTION
NUMÉRO 5 – PLANIFICATION





Après la révolution est un journal d’application de la pensée architecturale à d’autres objets que la production de bâti en tant qu’elle est un outil pour la transformation systémique de la réalité.
Ce cinquième numéro thématique annuel traite de la planification. Ce terme, absolument central dans les transformations majeures du XXe siècle a été banni du vocabulaire et de l’action politique avec l’avènement des pratiques dérégulatrices du néolibéralisme. Mais le défi majeur qu’est la question écologique pour nos sociétés a
remis ce terme au centre du débat public, comme de l’action révolutionnaire.
Ce numéro engage un bilan critique des tentatives de planification en présentant les contradictions et potentialités que cette activité recouvre d’un point de vue théorique, mais aussi pratique, en donnant la parole à des acteur·ice·s de ces processus et en proposant d’explorer d’autres significations inattendues. Ce travail est accompagné de la republication de documents historiques peu accessibles et d’hypothèses de mise en œuvre de planification dans un monde en feu.
Ce journal est une des activités de l’association Après la révolution, basée à Saint-Étienne. Ce numéro 5 comprendra le maximum de textes que les deux centimètres d’épaisseur du format lettre peuvent contenir en essayant de couvrir le spectre le plus large, dans le temps et l’espace, des pensées capables de réactiver la planification dans les affaires humaines. ALR est im-
primé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association Après la révolution.
Comité de rédaction du journal : Manuel Bello Marcano, Matthias Brissonnaud, Adrien Durrmeyer, Anaïs Enjalbert, Marianna Kontos, Timothé Lacroix, Léo Pougnet, Claire Thouvenot, Emma Vernet, Xavier Wrona.

Format : 20,8 x 29,5 cm, 350 pages
ISSN : 2678-3991
ISBN : 978-2-493403-15-5
Prix : 23 euros
Rayons : Beaux arts / Essais
Thèmes : Architecture / Philosophie / Sciences sociales
Sortie : juin 2025
SOMMAIRE DU NUMÉRO
Sommaire indicatif sous réserve d’accord des auteur·ice·s et maisons d’édition
ÉDITO
INTRODUCTION GÉNÉRALE — Le comité de rédaction
DOCUMENTS
(republication de documents difficiles d’accès ou peu connus)
INTRO — Le comité de rédaction SÉLECTION DE TEXTES SUR LA « VILLE SOCIALISTE » (SOTSGOROD), PROJET DES ARCHITECTES SOVIÉTIQUES D’AVANT-GARDE — Rassemblés par Claire Thouvenot
LA PLANIFICATION DANS LA PHILOSOPHIE MODERNE OCCIDENTALE : LEIBNIZ, HEGEL ET COMPAGNIE — Léo Pougnet et Xavier Wrona TROISIÈME PLAN SOCIALISTE VENEZUELA 2019-2025 (OU LA PLANIFICATION À L’ÉPREUVE DE LA DICTATURE) — Manuel Bello Marcano
QUELQUES PRISES DE PAROLE DE THOMAS SANKARA SUR LA PLANIFICATION — Xavier Wrona RABELAIS LA MISE EN DÉRISION DES GRANDS PROJETS DU MONDE ET LA PLANIFICATION COLONIALE DE L’EUROPE — Léo Pougnet et Xavier Wrona LE CALENDRIER DANS LA PLANIFICATION AGRICOLE ET L’ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE CHEZ LEROI-GOURHAN — Emma Vernet
LES OUTILS DE LA PLANIFICATION : DIAGRAMMES CALENDRIERS CARTES — Matthias Brissonnaud THÈSES SUR LA VILLE L’URBAIN ET L’URBANISME — Henri Lefebvre UNE THÉORIE MARXISTE DE LA PLANIFICATION EST-ELLE POSSIBLE ?
Guillaume Fondu
LA PLANIFICATION CENTRALE ET SES ALTERNATIVES DANS L’EXPÉRIENCE DES ÉCONOMIES SOCIALISTES — Bernard Chavance URBANISATION DU CAPITAL — David Harvey
LA PLANIFICATION, TECHNIQUES ET PROBLÈMES — Guy Caire PLANIFIER LA DÉBAUCHE/PLANIFIER L’EXCÈS : LES 120 JOURNÉES
DE SODOME (SADE) EXTRAIT : « RÈGLEMENTS » — Marquis de Sade
LA RECONSTRUCTION DE L’HOMME (EXTRAIT DE L’HOMME, CET INCONNU) — Alexis Carrel
EXTRAIT DU POPOL VUH/EXTRAIT DU VOYAGE À IXTLAN : LES LEÇONS DE DON JUAN/L’ART DE RÊVER : LES QUATRE PORTES DE LA PERCEPTION DE L’UNIVERS — Carlos Castaneda
ÉPISTÉMOLOGIE
(contributions à la définition du savoir architectural)
INTRO — Le comité de rédaction
À PROPOS DE LA FASCINATION DE LE CORBUSIER POUR LA PLANIFICATION, EN TEMPS DE GUERRE COMME DE PAIX — Xavier Wrona
CE QUE L’ARCHITECTURE DOIT AU SOL : À PROPOS DU ZÉRO
ARTIFICIALISATION NETTE — Marie Clément PLANIFICATION ET PROBLÈMES MATHÉMATIQUES — Matthias Brissonnaud FRIEDRICH HAYEK, LE NÉOLIBÉRALISME CONTRE LA PLANIFICATION — Xavier Wrona
PLANMÄSSIGKEIT OU « CONFORMITÉ À PLAN » (COORDINATION ?), 11 E LETTRE BIOLOGIQUE — J v. Uexkull PLANIFICATION VS PROJET — Thierry Eyraud L’ARCHITECTURE DE LA NÉCESSITÉ — Ernesto Oroza CONCERNENT LA PLANIFICATION DU DÉRAPAGE… DE LA PLANIFICATION EN URSS — Matthias Brissonnaud
PÉDAGOGIE
(travaux d’exploration d’étudiant·es de l’École d’architecture de Saint-Étienne)
INTRO — Le comité de rédaction LA PLANIFICATION MATRIARCALE DE LA CHINE — Camille Deveautour & Luisa Fernanda Parra Ossa UNE DÉSYNCHRONISATION SYSTÉMIQUE DE L’EUROPE — Emile Goyard & Jacobo Palacio
SOVIÉTISATION DES ÉTATS-UNIS — Joshua Guiffrey & Sara Vanegas PLANIFICATION DÉMOCRATIQUE DÉCENTRALISÉE DE BASSE ÉNERGIE DES MOYENS DE PRODUCTION EN URSS — Alice Blottière & Valeria Villamizar
INTERVENTIONS
(en prise avec des luttes actuelles dans un monde en feu)
INTRO — Le comité de rédaction PLANIFICATION ET PLANNING FAMILIAL — Centre de documentation du Planning familial RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DES JO ET LES DISPOSITIFS
QUI RESTENT… Marianna Kontos LA TRICONTINENTALE ET LA PLANIFICATION — Xavier Wrona PALESTINE ET PLANIFICATION COLONIALE : ENTRETIEN AVEC MONIRA MOON — Anaïs Enjalbert et Claire Thouvenot LES ZAD ET LA QUESTION DE LA PLANIFICATION — Xavier Wrona LA RÉFORME DE L’APPAREIL PRODUCTIF ET LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE : CONVERSATION AVEC ADRIEN CORNET ET PAUL FELTMANN DE LA CGT DE LA RAFFINERIE DE GRANDPUITS — Anaïs Enjalbert, Marianna Kontos, Léo Pougnet et Xavier Wrona FAIRE JUSTICE — Elsa Deck Marsault
KUROKAWA ET L’INSTITUT D’INGÉNIERIE SOCIALE, UNE EXPÉRIENCE DE PLANIFICATION ARCHITECTURALE POUR RECONSTRUIRE LE JAPON -Xavier Wrona
ENFOUISSEMENT DÉCHETS NUCLÉAIRES : « UN PLAN DE MERDE » — Sortir du nucléaire ou Thomas Sebeok
« L’ANTHROPOCÈNE, LE REGARD ET LES RÉFLEXIONS
D’UN GÉOLOGUE » — Pierre Thomas
À PROPOS DE LA PLANIFICATION EUGÉNISTE — Claire Thouvenot et Marianna Kontos
À PROPOS DE LA STÉRILISATION COLONIALE ET PATRIARCALE :
EXTRAIT DE LE VENTRE DES FEMMES. CAPITALISME, RACIALISATION, FÉMINISME — Françoise Vergès CRIMINELS CLIMATIQUES — Mickaël Correia
EXTRAIT DE NÉCROPOLITIQUE — Achille Membe
SCOP MORASSUTI : UNE IMPRIMERIE REPRISE PAR SES SALARIÉS À SAINT-ÉTIENNE — Scop Morassuti
COMMENT BIFURQUER : ENTRETIEN AVEC CEDRIC DURAND
ET RAZMIG KEUCHEYAN — Claire Thouvenot, Timothé Lacroix et Xavier Wrona
« L’UTOPIE AU QUOTIDIEN » : LA VIE ORDINAIRE EN URSS
— Extraits du catalogue de l’exposition
BOUKHARINE ET LA QUESTION DE L’IMPÉRIALISME — Maurice Andreu
MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE : ENTRE COMMUNISME ET CAPITALISME — Emilien Épale
PLAN B POUR LA PLANÈTE, LE NEW DEAL VERT — Naomi Klein
TERRA FORMATION — Benjamin H. Bratton
À PROPOS DE LA MUSIQUE ET DU FUTURISME COMMUNISTE
À TRAVERS UN GROUPE DE T3 — Vincent Chanson
CRITIQUE
(Contributions critiques issues de colloques ou d’ouvrages de recherche)
INTRO — Le comité de rédaction
BRICS, OPEP, ALBA, ALCA – DES ARCHITECTURES INTER-ÉTATIQUES
— Manuel Bello Marcano
À PROPOS DE LA PLANIFICATION DU COMPLOT QANON — Xavier Wrona
LA FONDATION DES VILLES ET LA COLONISATION CHEZ VAUBAN
— Xavier Wrona
JO : PLANIFICATION DES GRANDS ÉVÈNEMENTS : ENTRETIEN
AVEC JULES BOYKOFF — Marianna Kontos
GRILLE, VILLE ET TERRITOIRE AUX ÉTATS-UNIS : UN QUADRILLAGE DE L’ESPACE POUR UNE PENSÉE SPÉCIFIQUE DE LA VILLE ET SON TERRITOIRE — À PROPOS DE LA THÈSE DE DOCTORAT DE CATHERINE MAUMI — Xavier Wrona
À PROPOS D’HÉRITAGE ET FERMETURE DE EMMANUEL BONNET, DIEGO LANDIVAR ET ALEXANDRE MONNIN — Xavier Wrona et Matthias Brissonnaud L’EXPÉRIENCE DE PLANIFICATION CYBERSYNE — Manuel Bello Marcano
PLAN MARSHALL ET CONTRE PLAN MARSHALL DANS L’AGRICULTURE
— Claire Thouvenot
MAGNITOGORSK, EMBLÈME STALINIEN DU PLAN QUINQUENNAL ET DE L’INDUSTRIALISATION — Claire Thouvenot et Xavier Wrona SCÉNARIOS DE PLANIFICATION POST-CAPITALISTE MÉCONNUS (autour du livre Construire l’économie postcapitaliste)
LA PLANIFICATION SPORTIVE EN URSS : L’APPARENCE PHYSIQUE COMME PLAN DE L’ÉTAT ? Une conversation d’ALR avec Sylvain Dufraisse, entretien mené par Claire Thouvenot, Timothé Lacroix et Xavier Wrona
PROPHÉTIES D’ENGELS DANS GÉOGRAPHIE ET CAPITAL — David Harvey
L’ARCHITECTURE CONTRE LE CAPITALISME — Adrien Durrmeyer
LA PLANIFICATION À L’HEURE DE LA GOUVERNANCE — Pierre Caye
DES DIVERS IMAGINAIRES DE LA PLANIFICATION DANS LES PAYS COMMUNISTES DANS LE XX E SIÈCLE — Anna Safronova
LA PLANIFICATION EST-ELLE UNE QUESTION ÉCONOMIQUE OU ARCHITECTURALE ? Xavier Wrona
LA CONSOMMATION, MALADIE INFANTILE DE L’ÉCOLOGISME.
SUR LA PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE — Paul Guillibert
ENTRETIEN AVEC ÉMILIE HACHE À PROPOS DE SON LIVRE DE LA GÉNÉRATION — Emilie Hache, Léo Pougnet et Xavier Wrona
L’AGRICULTURE PAYSANNE EN PAYS BASQUE ET AILLEURS : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE — Iker Elosegi
SEUL LE TEMPS NOUS APPARTIENT — Pierre Caye
PLANNED SOCIETY — Lewis Mumford
MATHEMATICAL METHODS OF ORGANIZING AND PLANNING
PRODUCTION — Kantorovitch
REGIONAL PLANNING AND ECOLOGY — Benton Mackaye
COMPUTERS AND ECONOMIC PLANNING : THE SOVIET EXPERIENCE — Martin Cave
RED PLENTY PLATFORMS — Nick Dyer-Witheford
EXTRAITS
Planches extraites de la partie « pédagogie » du journal




Planches du numéro précédent du journal (N° 4, Production)






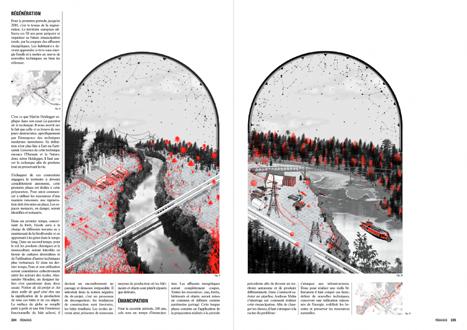


APRÈS LA RÉVOLUTION
NUMÉRO 4 – PRODUCTION





La manière, les outils et les méthodes employés pour produire les objets qui constituent notre culture matérielle contemporaine reposent sur une mobilisation totale des ressources détruisant l’ensemble des mondes vivants. Nous nommons l’ensemble de ces modes de production « l’appareil productif contemporain ». C’est cet appareil productif qu’il s’agit ici de transformer. Le journal après la révolution envisage la discipline architecturale d’une manière différente de celle à laquelle nous sommes historiquement accoutumés. Plus que la discipline en charge de la production de bâti, l’architecture pour ALR est un mode de production des sociétés. En nous appuyant sur les travaux du philosophe
Pierre Caye nous avons décidé d’explorer l’hypothèse selon laquelle l’architecture comme savoir pourrait permette une transformation de l’appareil productif écocidaire contemporain vers des sociétés de basse énergie.
Cet énoncé a été le point de départ d’un projet quinquennal intitulé : Dessiner les sociétés de basse énergie. Après une première année portant sur l’hypothèse d’une école de réforme des moyens de production qui a été le support du numéro 3 « Pédagogie », ce numéro 4, intitulé « Production », vient affiner et approfondir ces premières hypothèses en se posant notamment les trois questions suivantes :
1/ Comment penser d’une part la nécessité d’une production matérielle de la réalité et d’autre part la destruction systémique du monde opérée par les modes de production de cette culture matérielle ?
2/ Quelles politiques d’oppression et d’émancipation des populations sont à l’œuvre dans les processus de production de notre réalité ?
3/ Considérer la pensée architecturale suivant une conception Vitruvienne, c’est-à-dire en considérant que la mécanique et l’ingénierie sont une partie de l’architecture et non des savoirs
autonomes, permettrait-il de maîtriser les effets dévastateurs de la technique contemporaine ?
Comité de rédaction du journal : Manuel Bello Marcano, Adrien Durrmeyer, Anaïs Enjalbert, Émilien Épale, Marianna Kontos, Thimothé Lacroix, Léo Pougnet, Claire Thouvenot, Emma Vernet, Xavier Wrona.
Ce journal est une des activités de l’association Après la révolution, basée à Saint-Étienne. Ce numéro 4 comprend 63 contributions. Il est imprimé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association Après la révolution.

Format : 20,8 x 29,5 cm, 350 pages environ
ISSN : 2678-3991
ISBN : 978-2-493403-08-7
Prix : 23 euros
Rayons : Beaux arts / Essais
Thèmes : Architecture / Philosophie / Sciences sociales
Sortie : mars 2024
SOMMAIRE DU NUMÉRO
DOCUMENTS
Textes à l’étude en vue d’une éventuelle
republication :
Produire la nature, la ressource : LE TOUCHER DU MONDE TECHNIQUES DU NATURER
— David Gé Bartoli
VIVRE AVEC LE TROUBLE – Donna Haraway
MILIEU ET TECHNIQUES – Leroi-Gourhan
L’ÂGE DU PRODUCTIVISME : HÉGÉMONIE PROMÉTHÉENNE
— Serge Audier
LES TROIS ÉCOLOGIES — Felix Guattari
Ne pas produire :
COMMENT SABOTER UN PIPELINE — Andreas Malm
L’HOMME ET LA TECHNIQUE. CONTRIBUTION À UNE
PHILOSOPHIE DE LA VIE — Oswald Spengler
LA PART INCONSTRUCTIBLE DE LA TERRE. CRITIQUE DU GÉO-CONSTRUCTIVISME — Frédéric Neyrat
TEMPS, DISCIPLINE DU TRAVAIL ET CAPITALISME
INDUSTRIEL — Edward P. Thompson
LA NOTION DE DÉ-PROJET — Alessandro Mendini
Produire pour une population fixe :
DU MODE D’EXISTENCE DES OBJETS TECHNIQUES — Gilbert
Simondon
TECHNIQUE ET CIVILISATION — Lewis Mumford
PROGRÈS TECHNIQUES ET CONSÉQUENCES SOCIALES
— Albert Caquot
LA MÉCANISATION AU POUVOIR — Sigrifried Giedion
DATATOWN – MVRDV
PRODUCTION DE LA CULTURE MATÉRIELLE SOVIÉTIQUE :
L’UTOPIE AU QUOTIDIEN — Christina Kiaer
Produire en réseau :
L’ART FÉODAL ET SON ENJEU SOCIAL — André Scobeltzine
LA PART MAUDITE — Georges Bataille
LA MOBILISATION TOTALE — Ernst Junger
HISTOIRE DU SUCRE, HISTOIRE DU MONDE — James Walvin
FROM TRACTORS TO TERRITORY. SOCIALIST
URBANIZATION THROUGH STANDARDIZATION – Christina
Crawford UNDERCOMMONS – Stefano Harney and Fred Morten
EL LIBRO DE LA FAMILIA — Collectif
CON NUESTROS PROPIOS ESFUERZOS - Collectif
Reproduction :
LE CAPITALISME PATRIARCAL — Sylvia Federicci
FÉMINISME POUR LES 99 % — Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser
PAR OÙ ATTAQUER LE « PARTAGE INÉGAL » DU « TRAVAIL
MÉNAGER » ? — Christine Delphy
LA FABRICATION DU CONSENTEMENT — Noam Chomsky & Edward Herman
LA FABRIQUE DE L’HOMME ENDETTÉ — Maurizio Lazzarato
LA REPRODUCTION — Pierre Bourdieu
Instituer la production :
TRAVAIL SALARIÉ ET CAPITAL — Karl Marx
COMMUNS — Pierre Dardot et Christian Laval
ÉMANCIPER LE TRAVAIL — Bernard Friot
PARADIGM OF PRODUCTION : PARADIGM OF WORK
- Agnes Heller
TRAVAIL GRATUIT : LA NOUVELLE EXPLOITATION ? — Maud
Simonet
UN SALAIRE ÉTUDIANT — Aurélien Casta
LE TRAVAIL DU CARE – Pascale Molinier
Détourner la production : L’ANTHROPOCÈNE CONTRE L’HISTOIRE — Andreas Malm
IMPÉRIALISME STADE SUPRÊME DU CAPITALISME
— Lénine
VILLES REBELLES — David Harvey
ART ET PRODUCTION — Boris Arvatov
L’AUTEUR COMME PRODUCTEUR — Walter Benjamin
DANS LE FRONT GAUCHE DE L’ART — Serge Tretiakov
MANIFESTO FOR AN IMPERFECT CINEMA - Julio Garcia
Espinosa
ÉPISTÉMOLOGIE
Aucun texte arrêté à ce jour
PÉDAGOGIE
PRODUIRE EN RÉSEAU — Manon Barnaud & Marie Lamour
DÉTOURNER LA PRODUCTION — Ema Montrobert &…
INSTITUER LA PRODUCTION — Noémie B & Corentin Brissart
PRODUIRE LA NATURE, LA RESSOURCE — Romain Becaud & Laura Duroure
PRODUIRE POUR UNE POPULATION FIXE — Mériem Brin & Uriel
Rollet
NE PAS PRODUIRE — Coutanson Rémi & Drane Julie
INTERVENTIONS
Aucun texte arrêté à ce jour
CRITIQUE
Textes à l’étude en vue d’une éventuelle
publication :
DES LIEUX DE PRODUCTION COMMUNAUX — Adrien Durrmeyer
SUR LE PARADIGME MAGIQUE DE LA PRODUCTION ET DE LA TECHNIQUE CONTEMPORAINES — Thibault Rioult TEMPS, DÉMOCRATIE, JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LA FABRICATION URBAINE
DES JO PARIS 2024 — Marianna Kontos
TRAVAILLER À LA PRODUCTION DES INTERFACES
NUMÉRIQUES — Nicolas Enjalbert
LE TOURNANT DE LA PRATIQUE : PROBLÈMES ET POSSIBLES DANS LES MISES EN ŒUVRE ALTERNATIVES
SUR LE CHANTIER DE LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
— Étienne Lemoine
TRAVAIL DÉMOCRATIQUE ET RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE
— Alexis Cukier
ADOLF LOOS ET L’ÉCONOMIE MASOCHISTE — Can Onaner LA PRODUCTION DU LOGEMENT AU VENEZUELA ET LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA (GMVV)
— Yaneira Wilson
EVERYBODY CAN DESIGN, EVEN DESIGNERS – Ernesto Oroza
UNE LECTURE DE DURER DE PIERRE CAYE — Léo Pougnet
EXPLOITER LES VIVANTS. UNE ÉCOLOGIE POLITIQUE DU TRAVAIL — Paul Guillibert
Planches extraites de la partie « pédagogie » du journal
2021 NE PAS PRODUIRE
Coutanson Rémi & Drane Julie
CONSTAT
À l’heure de la micro-transaction, le monde se trouve régi par des rythmes incompatibles avec la vie. Nous sommes donc en conflit frontal avec le temps biologique. Ces rythmes sont ainsi dictés par un désir de production toujours plus intense. Cette société d’accroissement a poussé à accélérer les temps de production, d’échanges et de consommation. Cette cadence engendre une destruction du vivant et des écosystèmes. Elle implique également des rapports d’oppression sur les peuples. Alors, faut-il ne pas produire ? L’arrêt brutal et total d’une production semble impossible, produire occupe une place importante dans l’histoire évolutive, nous permettant de manger, s’habiller, travailler et se déplacer. En revanche, l’urgence et les dommages témoignent du besoin d’une redéfinition de notre production par un nouveau rapport au temps.
Une force destructrice provoquée par l’énergie et la technique est exercée sur l’environnement. En effet, selon Frédéric Neyrat, dans LapartinconstructibledelaTerre la nature devient de plus en plus
2 DOCUMENTS
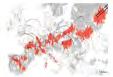
rare et c’est pourquoi certaines personnes cherchent à la recréer par synthèse. Une Terre postnaturelle reconstruite et pilotée par l’ingénierie. Cependant, toute la Terre n’est pas reproductible en laboratoire, d’où le titre du livre. Ainsi c’est par un processus émancipateur que l’humain doit comprendre qu’il n’est ni le propriétaire de la nature ni son régisseur. La politique doit être ainsi repensée en lien avec la nature, afin de mieux appréhender l’utilisation et la préservation des ressources de la Terre qui se trouvent être essentielles aux besoins des humains. C’est dans l’ouvrage L’homme et latechniqueque Oswald Spengler se questionne sur la signification de la technique. Pour lui, elle est la tactique de tout le règne vivant, l’Homme est le créateur de sa technique vitale. Depuis le XIXe siècle on assiste à une accélération de la technique, chaque siècle porte son importance, générant des techniques de plus en plus entrelacées et dépendantes les unes aux autres. Ainsi, selon l’auteur, si celle-ci s’est retrouvée source de destruction c’est par son introduction à l’échelle mondiale. Il est donc nécessaire d’adopter une approche systémique.
de Louis XIV, «La forêt est un trésor qu’il faut soigneusement conserver». C’est par son action que la France a introduit la forêt comme un héritage à préserver et à gérer rigoureusement. Ainsi, cette intention est démultipliée à l’échelle du territoire de l’Europe. Le lien territorial entre les écoles est réalisé majoritairement par les forêts et à plus petite échelle par les fleuves fortement présents. Le réseau d’écoles s’intensifiera et deviendra un moteur permettant d’atteindre d’autres territoires.
PÉRENNISATION
La quatrième et dernière période se portant ainsi à plus 600 ans, signe l’apparition d’un nouvel ordre architectural. L’équilibre atteint précédemment s’est renforcé et a pour but de perdurer, les traces du passé industriel se font rares à l’échelle géologique. Ce nouvel ordre érigé au fur et à mesure mêle les techniques aux formes, loin des procédés destructeurs. Les objets et la vie sont entremêlés et se complètent, en rupture avec les schémas destructeurs passés.


















À la suite des quatre calendriers Tzolkin, chaque école établira ses propres sous-calendriers correspondant à chaque pratique sur un cycle d’un an. Toujours en référence aux Mayas, ces calendriers appelés Haab introduisent le processus de production. Ils seront conçus selon



les conditions environnementales de chaque territoire. Ils auront pour vocation d’être échangés entre les différentes écoles du réseau, ils pourront ainsi partager leurs arts de produire leur alimentation, vêtements ou objets. L’école prospective consiste donc en l’élaboration et la compréhension de ces deux sortes de Calendriers. Deux pôles seront ainsi établis pour guider la pédagogie. Tout d’abord, le pôle théorique avec l’élaboration des calendriers par une étude des écosystèmes,
REFORME DES MOYENS DE REPRODUCTION
Marie Chausse et Zoé Thuillier

La suppression de la publicité et la réforme des médias comme émancipation et générateur d’une nouvelle économie Premièrement, la suppression de la publicité permet de consommer raisonnablement et d’éliminer la transmission de modèles sociaux. D’après Noam Chomsky et Edward Herman dans La fabrique du consentement, la publicité pousse à la surconsommation et devient donc dangereuse pour l’environnement. Elle est aussi dangereuse socialement puisqu’elle influence l’opinion publique aux profits de ses détenteurs, riches et puissants qui souhaitent maintenir le contrôle sur les masses. Actuellement, une entreprise peut dépenser jusqu’à 55 % de son budget dans la publicité, ce coût est payé par le consommateur lors de son achat. Au sein de l’école de réforme des moyens de reproduction, ce coût est donc supprimé, et réinjecté dans le média ainsi que dans le financement de l’école.
Dans ce même ouvrage, Chomsky et Herman expliquent que les médias occidentaux sont l’outil de propagande de la démocratie. Ce modèle s’exerce à travers cinq filtres sa dimension économique, le poids de la publicité, le poids des sources officielles, les pressions exercées et le filtre idéologique de la production capitaliste [Fig. 22].
Afin de produire des individus politiques et conscients, les médias sont repensés et réformés lors d’ateliers au sein de l’institution. Pour déjouer ce modèle, un impôt est mis en place, payé par le citoyen et transféré directement aux médias. Suite à la suppression des coûts liées à la publicité, l’impôt payé par le citoyen est équilibré dans les dépenses. Par ce fonctionnement, les médias sont équitables, les sources transparentes et leur diversité permet d’avoir un regard averti sur le monde. Par cette réforme, les individus s’émancipent des modèles sociaux transmis [Fig. 23] et une nouvelle économie est générée. Les médias ne sont donc plus un outil de propagande reproduisant des sujets, mais un outil de diffusion d’informations favorisant la productibilité d’individu conscient.


de production de basse qualité, d’obsolescence programmée et de surproduction propres aux modes de production capitalistes sont à l’origine de nombreux déchets irrécupérables, polluants, destructeurs des écosystèmes, des eaux et des océans. Produits de basse qualité, faits en matériaux qui ne peuvent être réutilisés, ils finissent généralement en déchet, détruit de manière polluante, jetés, conservés sous terre ou dans des décharges lointaines, polluant ainsi l’environnement qui les entoure [Fig. 1]. D’après l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 354 kilogrammes de déchets seraient produits chaque année par habitant. Eurostat quant à lui calcule le nombre de déchets par habitant et par municipalité en y ajoutant les déchets communaux, les chiffres grimpent alors à 536 kilogrammes de déchets par an et par habitant. Enfin, le centre national d’information indépendante sur les déchets dénombre quant à lui 13.8 tonnes de déchets produits par an et par habitant en comptabilisant les déchets produits par le secteur professionnel.
Qu’est-ce qu’un déchet matériel ? Nous avons donc réparti les déchets en trois catégories pour les définir. Les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets nucléaires. Premièrement les déchets ménagers: il s’agit principalement des emballages de produits, des objets ne fonctionnant plus ou abîmés, des objets à usage unique et des déchets alimentaires. Ces déchets sont détruits par incinération, compostage, recyclés, stockés dans des décharges contrôlées ou encore jetés dans la nature [Fig. 2].
Deuxièmement, les déchets industriels. Il s’agit soit de déchets banals ou de déchets dangereux. Ils sont traités de manière physico-chimique, incinérés ou placés dans des décharges spécialisées [Fig. 3].
Les déchets nucléaires quant à eux ne sont pas détruits, ils sont stockés en surface ou en profondeur en fonction de leur radioactivité. Ils présentent ainsi de grands risques de pollution des sols qui les entourent. En effet, d’après Roland Desbordes, ancien président de la commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité, certains sites français comme celui du Bois Noir seraient contaminés par les déchets émanant des mines d’uranium [Fig. 4].






Une émancipation pour un mode de production inclusif: libéraion collective de l’assigment de rôle et du déterminisme social Dans notre école de réforme des moyens de reproduction, nous nous émancipons de la publicité pas seulement économiquement, mais nous nous libérons aussi collectivement de l’assignation de rôle et du déterminisme social. La réforme des médias et la suppression de la publicité ont un impact sur la productibilité d’individus politiques. Elles questionnent notamment la place de la femme, chargé d’histoire dans les modes de production du capitalisme. Comme l’explique Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcale les femmes étaient tellement abusé dans leur travail ménager, sexuel et de mère reproductrice d’enfants qu’il était plus bénéfique pour elle de se reconvertir dans le travail du
sexe. En effet, leurs tâches étaient similaires, mais en exerçant ce travail, elles devenaient libres et indépendantes financièrement. La suppression de la publicité vise donc à éliminer le modèle social dans lequel la femme a pour devoir de s’occuper des tâches liées à la reproduction et participe de manière générale à réduire les stéréotypes et les inégalités entre individus. Dans notre école de réformes des moyens de reproduction nous luttons contre le système patriarcal et l’assignation de rôle.
Les échanges réalisés au sein de cette nouvelle institution et des différents ateliers proposés permettent l’inclusion de chaque individu qui deviennent pensant et politiques.
Dans les modes de production du capitalisme patriarcal, l’homme est une main-d’œuvre pour la production de capital. Le capitalisme




a assigné à la femme le rôle de s’occuper de l’homme et du foyer, afin que celui-ci soit plus productif dans son travail. Dans notre école de réforme des moyens de reproduction, la place des hommes est également reconsidérée. Ils ne sont plus assimilés à des outils de production, pilier de leur famille, robuste et insensible, mais à des individus pensant et libres dans leurs choix.
Ces réformes permettent de se libérer des diktat de la beauté, du sexisme ordinaire, de supprimer les stéréotypes marketings entre homme et femme et d’éviter la transmission de tout autre type de modèle sociaux dans lesquels s’inscrire. L’ensemble de ces réformes ont pour but de participer à la suppression de stéréotypes et

Fig. 23
Fig. 22
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4 Fig. 3
INSTITUER LA PRODUCTION RÉFORMES DES MOYENS DE PRODUCTION
Noémie Bertrand & Corentin Brissart


CAPITALISATION DES RESSOURCES NATURELLES Aujourd’hui, le fonctionnement de l’appareil productif est contraire au fonctionnement de la nature. Comme l’exprime Georges Bataille dans La Part Maudite “La source et l’essence de notre richesse sont données dans le rayonnement du soleil, qui dispense l’énergie sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais recevoir” [Fig. 27]. La nature, fertile, est dans le don continu et désintéressé. A l’inverse, les modes de production capitalistes fonctionnent par l’extraction des ressources. Nous recevons sans jamais donner en retour et produisons par la destruction.Pierre Dardot et Christian Laval décrivent dans un ouvrage nommé “Commun” l’oligarchie capitaliste dans laquelle un nombre infime de personnes possèdent le pouvoir économique en tirant profit de l’appropriation, l’exploitation et la destruction des ressources naturelles qui devraient être reconnues comme «biens communs» [Fig.1]. C’est une réflexion néolibérale contre les formes d’appropriation commune, contre la capitalisation des ressources naturelles [Fig. 3].




L’aliénation du travail par les modes de production capitalistes Le paradigme du travail est supposé accomplir et libérer l’être humain [Fig.2]. Dans les faits, la mobilisation globale nous aliène et nous domine. Sous le règne de l’hyper productivité, le processus d’accroissement des capitaux est illimité et les inégalités ne cessent de s’accroître. Les classes sociales se creusent et le prolétariat est soumis à la répartition injuste des richesses [Fig.4]. Agnes Heller s’est appuyée sur les propos de Marx afin de théoriser le système de production sous le processus capitaliste comme un moyen d’aliéner et de déshumaniser le travail. Elle partage la même idée que Marx lorsqu’il compare le travail humain à celui des animaux ; instinctif, sans réflexion ni conscience, qui ne sollicite pas la capacité humaine à créer, penser et prévoir l’œuvre.




Fig.1
Fig.2
Fig.4

APRÈS LA RÉVOLUTION
NUMÉRO 3 – PÉDAGOGIE





Après la révolution est un journal d’application de la pensée architecturale à d’autres objets que la production de bâti. Ce troisième numéro thématique annuel traite de la pédagogie comme transformation des êtres. Il engage un bilan critique des modalités programmatiques et organisationnelles de pédagogies issues de processus insurrectionnels et révolutionnaires dans le monde, d’un point de vue théorique, critique mais aussi en donnant la parole à des acteur·ice·s de ces événements. Ce travail est accompagné de la republication de documents historiques peu accessibles et d’hypothèses infrastructurelles. Il explore parallèlement d’autres architectures possibles pour les contes-
tations et d’autres pédagogies à mettre en œuvre après la révolution.
Comité de rédaction du journal : Manuel Bello Marcano, Lynda Devanneaux, Adrien Durrmeyer, Anaïs Enjalbert, Sara El Alaoui, Émilien Épale, Paul Guillibert, Marianna Kontos, Thimothé Lacroix, Léo Pougnet, Claire Thouvenot, Amélie Tripoz, Emma Vernet, Xavier Wrona.
Ce journal est une des activités de l’association Après la révolution, basée à Saint-Étienne. Ce numéro 3 comprend 63 contributions. Il est imprimé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association Après la révolution.

Format : 20,8 x 29,5 cm, 350 pages environ
ISSN : 2678-3991
ISBN : 978-2-493403-08-7
Prix : 20 euros minimum
Rayons : Beaux arts / Essais
Thèmes : Architecture / Philosophie
/ Sciences sociales
Sortie : 3 février 2023
SOMMAIRE DU NUMÉRO
ÉDITO
INTRODUCTION GÉNÉRALE – Le comité de rédaction
DOCUMENTS
INTRO – Le comité de rédaction
LE MAÎTRE IGNORANT – Jacques Rancière (Extraits) PÉDAGOGIE DE L’OPPRIMÉ – Paulo Freire (Extraits)
UNE SOCIÉTÉ SANS ÉCOLE – Ivan Illich (Extraits)
LA MÉTHODE NATURELLE DANS LA PÉDAGOGIE MODERNE » POUR LE TEXTE DE CÉLESTIN ET ÉLISE FREINET
– Célestin & Elise Freinet (Extraits)
LA PÉDAGOGIE ENGAGÉE – Bell Hooks (Extraits) UN HAMSTER À L’ÉCOLE – Nathalie Quintane (Extraits)
L’ÉCOLE EN RÉVOLUTION. L’APPLICATION DES MÉTHODES DEWEYENNES EN RUSSIE SOVIÉTIQUE – Guillaume Garreta
FAMILLE ET ÉCOLE – Nadejda Kroupaskaïa
LA FAMILLE ET L’ÉTAT COMMUNISTE – Alexandra Kollontaï
DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS & LA PENSÉE ÉDUCATIVE DE CONDORCET – Jean-Jacques Rousseau & Bernard Jolibert
YOUNG LORDS. HISTOIRE DES BLACK PANTHERS LATINO – Claire Richard (Extraits)
BLACK MOUNTAIN COLLEGE BULLTIN 2. “CONCERNING ART INSTRUCTION” – Josef Albers
LOUISE MICHEL. MEMOIRES : 1886 – Claude Rétat
UN ARCHITECTE DANS LA « RÉPUBLIQUE DES ARTS » – Aurélien Davrius & Jacques-François Blondel
REFLECTIONS ON LITTLE ROCK – Hanna Arendt
NOUS VOUS ÉCRIVONS DEPUIS LA RÉVOLUTION. RÉCITS DE FEMMES INTERNATIONALISTES
AU ROJAVA – Collectif
L’ARPENTAGE OU LE PARTAGE COLLECTIF DU SAVOIR – Zoé Maus (CIEP-communautaire)
MY PEDAGOGIC CREED – John Dewey
EL SOCIALISME Y EL HOMBRE EN CUBA – Comandante Ernesto Guevara
WHO SHALL SURVIVE ? – Jacob Moreno
ÉPISTÉMOLOGIE
INTRO – Le comité de rédaction
COMMENT PASSER D’UNE PÉDAGOGIE DU CAPITAL À UNE PÉDAGOGIE REVOLUTIONNAIRE ?
INTRODUCTION À LA SECTION « EPISTÉMOLOGIE » – Léo Pougnet pour le comité de rédaction
LE SYSTÈME ÉDUCATIF : POUR L’AUTONOMIE ET L’ÉMANCIPATION – Cybèle David
THÈSES SUR FEUERBACH 3 – Karl Marx
VHUTEMAS. PROGRAMME PÉDAGOGIQUE, RÈGLEMENT ET VISITE DE LÉNINE AUX VHUTEMAS – Documents d’époque traduits du russe PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CRÉATION INDUSTRIELLE
– Patrick Bouchain
18 PRINCIPES POUR DÉVELOPPER UNE PÉDAGOGIE ÉMANCIPATRICE DANS LES ENSA
– Adrien Durrmeyer & le comité de rédaction
PÉDAGOGIE
INTRO – Le comité de rédaction
DÉCOLONISATION DU CAPITALISME – Océane Arbez & Anaïs Ordonneau
DÉFINANCIARISATION, PROGRAMME DE DISSOLUTION DU SYSTÈME DU MARCHÉ
– Claude Lahaye & Marie-Annick Rabefiraisana DES GRAINES LIBRES À LA RÉSISTANCE DES TERRITOIRES – FX. Bodet & Anonyme LE RÉCIT DE LA RENAISSANCE DE L’HOMO GAÏANICUS – Elisa Seguin & Rich
LE RENVERSEMENT ÉNERGÉTIQUE – Damien Gesse & Maine Terrat
UN NOUVEAU PACTE AVEC LA NATURE – Sonia Chaya & Aurélie Vial
REDÉFINITION DES ÉCHANGES – Elisabeth Nampry & Anonyme
SORCIÈRES, LA RÉSISTANCES INVAINCUE AU CAPITALISME – Alexandre Chabanne & Rémy Guggiari
BIBLIOGRAPHIE DES TEXTES ÉTUDIÉS DURANT LE SEMESTRE
INTERVENTIONS
INTRO – Le comité de rédaction
ÉDUCATION POPULAIRE – Gilles Épale. Un entretien avec Xavier Wrona pour le comité de rédaction
L’ÉDUCATION PEUT-ELLE ÊTRE ÉMANCIPATRICE ? LE LYCÉE EXPÉRIMENTAL DE SAINT-NAZAIRE
– Julie Elbois (membre de l’équipe éducative), Louis & Loucia (élèves). Un entretien avec Timothé Lacroix, Claire Thouvenot & Xavier Wrona pour le comité de rédaction
LES MYSTÈRES D’ÉLEUSIS. INITIATION, CONDITIONS D’ADMISSIONS & HYMNES HOMÉRIQUES
33 À DÉMÉTER – Victor Magnien
PÉDAGOGIE ET MARXISME. ÉDUCATION & COERCITION DANS L’ÉDUCATION – Antonio Gramsci
ECOLE ZÉRO, ÉDITION D’ÉTÉ N° 1 : ITINÉRAIRE D’UNE ÉCOLE EN CONSTRUCTION – Collectif
CINÉ CLUB RÉVOLUTIONNAIRE D’APRÈS LA RÉVOLUTION. UN ESSAI VISUEL – Emma Vernet & Xavier Wrona
POINT DE VUE ÉTUDIANT SUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ARCHITECTURE – Collectif étudiant·e·s diplômé·e·s
CRITIQUE
INTRO – Le comité de rédaction BAUHAUS BISSAU. COLONIALISME, DESIGN, MODERNITÉ – Tiphaine Kazi-Tani UN RÉSEAU D’ÉCOLES DE RÉFORME DES MOYENS DE PRODUCTION DANS UNE PARTIE DU MONDE ÉMANCIPÉE DU CAPITALISME VISANT À CONSTRUIRE UNE NOUVELLE RÉALITÉ : LES VHUTEMAS EN URSS DE 1920 À 1930 – Xavier Wrona
OPEN SCHOOL EAST : UN ESPACE D’APPRENTISSAGE, COLLABORATIF, GRATUIT, INCLUSIF, POLYVALENT
– Anna Colin. Un entretien avec Manuel Bello-Marcano, Claire Thouvenot & Xavier Wrona pour le comité de rédaction
LE FEU DU RÉCIT, ENTRE LE POLICIER ET LA VICTIME – Zoé Théval
RÉFLEXIONS ESTHÉTIQUES ET PRODUCTIVES À PARTIR DU BAUHAUS – Pierre Caye
CHILD’S PLAY – Guillaume Désanges (extraits)
RESSOURCES POUR UNE PÉDAGOGIE ANTISEXISTE – Collectif Fédération SUD Éducation
SOIGNER L’ÉCOLE – Marine Éric
VERS UNE ARCHITECTURE NÉOLIBÉRALE – Adrien Durrmeyer
LA PUISSANCE DES MÈRES. POUR UN NOUVEAU SUJET RÉVOLUTIONNAIRE – Fatima Ouassak (Extraits)
LES SANS FACS – Collectif
ISSEP ET ÉCOLES D’EXTRÈME DROITE. « ÉCOLE DE MARION MARÉCHAL : ANATOMIE D’UN FIASCO » & « AVEC LEURS FORMATIONS FINANCÉES PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS, LES AMIS DE MARION MARÉCHAL FONT DES BONNES AFFAIRES » – Robin d’Angelo (JDD) & Lucie delaporte (Mediapart)
DATA PORTRAITS VISUALIZING BLACK AMERICA – William E. B. DU BOIS (Extraits)
CEUX QUI NE SONT RIEN – Taha Bouhafs (Extraits)
À PROPOS DE LA TRANSFORMATION DE L’ARCHITECTURE DU MONDE PAR LA GUERRE : LE CAS DU JAPON
– Xavier Wrona, Est-ce ainsi OCCUPATION DE NANTERRE ET TRANSFORMATION DES ÊTRES – Elsa Lanzalotta, Paul Guilibert & Claire Thouvenot.
Un entretien avec Timothé Lacroix et Xavier Wrona pour le comité de rédaction







PRÉSENTATION DU NUMERO
Le présent numéro d’Après la révolution a pour objectif de travailler la question des projets pédagogiques compris comme un processus de transformation et d’émancipation des êtres en imaginant comment la discipline architecturale pourrait être utile à la construction de pédagogies alternatives à celles du capital. Ce numéro s’est fixé comme objectif de travailler la question des structures et des programmes pédagogiques afin de pallier un manque sur le terme exact de pédagogie et son importance dans la construction des êtres. Il s’agit de mettre un terme à une pédagogie stérile et uni-directionnelle afin de construire une méthode et une infrastructure de la pédagogie au sein d’un projet politique collectif.
La question des pédagogies alternatives est vaste et il ne faut pas la sous-estimer au sein d’une culture progressiste et révolutionnaire. Nos forces se sont dispersées vers de nombreux modèles alternatifs et ont éprouvé de la difficulté à construire une structure pédagogique commune en accord avec les objectifs révolutionnaires qu’elles défendent. C’est une question qui est aussi la nôtre, et nous appelons sur ce point à prendre conscience collectivement qu’il s’agit bien là d’une question d’infrastructure, c’est-àdire d’une question d’architecture. En effet, se poser la question de savoir comment penser les formes structurelles de pédagogie de manière à ce qu’elles soient émancipatrices plutôt qu’oppressives est un énoncé architectural au sens où nous entendons le mot « architecture » dans ce journal.
































































Avec les contributions d’Alexandre Balcaen, éditeur (éd. Adverse) ; Arnaud Frossard, éditeur, libraire et ancien imprimeur (éd. de la Grande Batelière et librairie le Merle moqueur) ; Bakonet Jackonet, auteur et dessinateur (VNPMC, 2018, revue Zitrance) ; Charles Sarraute, sociologue des médias ( Le silence à la radio, penser le média par ses absences, Effeuillage (2014/& n° 3) ; Clara Laspalas, éditrice (éd. Sociales) ; Clara Pacotte, autrice, chercheuse et éditrice (éd. RAG) ; Danièle Kergoat, universitaire et sociologue (membre du centre de recherche RING) ; Jérôme LeGlatin, scénariste, éditeur, traducteur, critique et théoricien dans le champ des bandes dessinées ; Jean-Yves Mollier, historien et spécialiste de l’édition et des médias (Une autre histoire de l’édition française, La Fabrique, 2015) ; Karine Solene Espineira, sociologue des médias ( Transidentités : Ordre et panique de Genre, L’Harmattan, 2015) ; Les Soulèvements de la Terre, collectif ; Pascale Obolo, éditrice, réalisatrice et organisatrice de foires (revue AFRIKADAA, African Art Book Fair et Missread) ; Soazic Courbet, libraire (librairie l’Affranchie et l’Affranchie podcast) ; Thierry Discepolo, éditeur et auteur (éd. Agone et La Trahison des éditeurs, Agone, 2017) ; Tristan Garcia, écrivain et philosophe (Nous, Grasset, 2016) ; Valentine Robert Gilabert, ex-avocate et assistante d’artiste
▶ Format (mm) 148*210
▶ Nombre de pages ................ 144
▶ Prix (€) 10
▶ Parution mai 2025
▶ ISBN 978-2-493534-21-7
SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS



Graphisme : Quentin Juhel, les éditions Burn~Août, Camille de Noray et Rotolux press


Déborder Bolloré est un recueil de textes coédités par une trentaine de structures éditoriales indépendantes qui profitent de la fenêtre médiatique ouverte par la campagne Désarmons Bolloré. Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d’imprimeureuses, d’éditeurices et de libraires qui analysent et/ou subissent les dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché. Chacun·e tente de formuler, depuis leurs positions respectives, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?
Une coédition entre : AFRIKADAA, Association
Presse Offset, Bibliothèque de nuit Fifi Turin, Cosmic Studios, éditions Exces, éditions Burn~Août, Éditions Divergences, Éditions
Les Prouesses, Éditions Winioux, Hématomes Éditions, La dispute, La Lézarde — bouquinistes, Les éditions sociales, Matière Grasse, maison trouble, Même pas l’hiver, RAG Éditions, Rotolux Press, *éditionsMagiCité. Liste non exhaustive, elle est tenue à jour ici : https://www.deborderbollore. fr/signataire
Thèmes abordés : Édition et métiers du livre, libéralisme, médias, organisation, luttes, marché, logistique, monopôle, censure, diversité culturelle, Hachette, pédagogie
Diffusion/distribution : Paon-Serendip
contact@deborderbollore.fr https://www.deborderbollore.fr
Sommaire provisoire :
1/ Une préface depuis nos positions d’éditeurices
2/ La chaîne du livre : co-dépendances et aliénations systémiques, Alexandre Balcaen et Jérôme LeGlatin
3/ L’empire Bolloré s’étend à l’édition, la construction d’un leader mondial de la culture Valentine Robert Gilabert
4/ La concentration éditoriale, Thierry Discepolo
5/ Hachette, un empire vieux de deux siècles, Jean-Yves Mollier
6/ Éditer en féminisme, évolution et la transformation de l’édition féministe et de ses catalogues, Clara Laspalas et Danièle Kergoat
7/ Lesbienne à la page, hybrider les genres dans l’édition indépendante, Clara Pacotte
8/ Depuis une position d’organisatrice de salons et d’éditrice : faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, Pascale Obolo
9/ Le monopole d’Hachette sur le marché des manuels scolaires, Tristan Garcia et Charles Sarraute
10/ Lien entre média/édition et idéologie anti-trans en France, Karine Solene Espineira
11/ Depuis une position de libraire engagée, joies et limites. L’exemple de L’Affranchie librairie à Lille, Soazic Courbet
12/ L’odeur de l’encre. L’imprimerie : mirage des techniques, réalité des concentrations, Arnaud Frossard
13/ Le démantèlement, Les Soulèvements de la Terre
14/ Une bande dessinée, Bakonet Jackonet
15/ Une bibliographie étendue
Œuvres associées :
▶ Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, Jean-Yves Mollier, Libertalia, 2024
▶ On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les Soulèvements de la Terre, Seuil, 2023
▶ La Trahison des éditeurs, Thierry Discepolo, Agone, 2023
Dernière modification 13 janvier 2025 httpps://g/gitlab.com//deborderbollore



































































REF : BOLLO
En juillet 2024, au moment de la dissolution de l’Assemblée Nationale ordonnée par Emmanuel Macron, Vincent Bolloré fut désigné comme promoteur de l’extrême droite par la campagne Désarmons Bolloré, celle-ci appelant en même temps à démanteler son empire par tous les moyens. C’est dans ce contexte et en emboîtant le pas au boycott appelé par les « libraires antifascistes » que nous, éditeurices indépendant·es, coéditons à plusieurs structures ce recueil pour apporter des éléments de réponse depuis nos positions d’éditeurices à la libéralisation de notre secteur.

SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS
de la campagne Désarmons Bolloré sur https://desarmerbollore.net/appel
En tant qu’éditeurices indépendant·es, nous sommes indirectement visé·es par le projet totalisant de Bolloré car nos structures sont des espaces qui permettent la fabrique de contre-récits et la circulation de voix minoritaires. Face à de grands groupes monopolistiques qui filtrent les récits, il nous faut lutter pour préserver ces espaces essentiels de résistance et qui — n’en déplaise aux prophètes du grand remplacement et aux croyants du lobby LGBTQ+ — se font rares.
La forme de ce recueil part du constat suivant : si, à lui seul, Vincent Bolloré se montre capable de mobiliser des moyens logistiques et médiatiques colossaux pour mener sa « guerre civilisationnelle », alors nous devons de notre côté mobiliser l’entièreté de notre réseau d’éditeurices, de diffuseurs, de libraires et de relais médiatiques pour y résister. Face à la concentration par les grands groupes, nous faisons jouer la multiplicité et la singularité caractéristique du monde du livre indépendant. De façon sous-jacente, ce recueil est un prétexte pour réunir, tisser des liens et renforcer le maillage que composent les acteurices de l’édition indépendante.
Bien conscient·es que Bolloré — par l’intermédiaire d’Hachette — est un acteur majeur de la
Diffusion/distribution : Paon- Serendip
concentration capitalistique du milieu éditorial, il n’est pas le seul instigateur de cette dynamique. C’est la structure même du monde du livre qui permet à de grands groupes de s’accaparer 90 % du marché de l’édition. Ainsi avons-nous décidé de « déborder Bolloré », c’est-à-dire, de dépasser la figure, certes exubérante du personnage, pour comprendre dans un premier temps les mécaniques avec lesquelles il opère et comment, dans un second temps, les déjouer depuis nos positions d’éditeurices, mais aussi depuis celle d’acteurices de l’édition indépendante. Pour ce faire, nous avons réuni un ensemble de contributions provenant d’éditeurices, libraires, auteurices, organisateurices de foires, universitaires et militant·es, etc.
Le recueil est composé des contributions de :
▶ Alexandre Balcaen et Jérôme LeGlatin, qui explore l’écosystème de l’édition, dans lequel l’élaboration du livre, sa production et sa distribution s’articulent en une chaîne d’acteurices interdépendant·es.
▶ Valentine Robert Gilabert, qui retrace la chronologie des acquisitions majeures du groupe Bolloré dans l’édition, révélant les étapes de son expansion structurelle et logistique.
▶ Thierry Discepolo, qui met en lumière l’alliance entre grand capital et idéologies d’extrême droite, incarnée par Bolloré, tout en soulignant l’inaction face à la concentration éditoriale qui fragilise la diversité culturelle.
▶Jean-Yves Mollier, retrace les deux siècles d’existence du groupe Hachette, qui est aujourd’hui le leader de l’édition en France, affichant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros et une forte présence internationale.
▶ Clara Laspalas et Danièle Kergoat, sur l’évolution de l’édition féministe et de ses catalogues.
▶ Clara Pacotte, qui aborde la question des voies creusées par les éditeurices indépendant·es afin d’hybrider les genres et rendre compte de la pluralité des cultures qui vivent au sein de celleux qui écrivent.
▶ Pascale Obolo, qui dénonce la censure indirecte par les grands groupes de voix diasporiques en France et en Afrique et défend les foires comme des lieux essentiels de résistance et de diffusion libre.
▶ Tristan Garcia et Charles Sarraute, qui traite de la mainmise d’Hachette sur la production des manuels scolaires et la menace d’une instrumentalisation idéologique par la réécriture des contenus scolaires.
▶ Karine Solene Espineira, qui revient sur le lien entre médias/éditions et idéologie anti-trans en France.
▶ Soazic Courbet, qui se demande comment s’affranchir des dynamiques de dépendances instaurée par les grands groupes.
▶ Les Soulèvement de la Terre, qui détaille comment l’arsenal logistique, éditorial et médiatique de Bolloré alimente la « guerre civilisationnelle » qu’il se targue de mener et y dresse des stratégies concrètes de résistance collective.
contact@deborderbollore.fr
https://www.deborderbollore.fr
Visuel



































































LES CONTRIBUTIONS EN DÉTAIL
La chaîne du livre : co-dépendances et aliénations systémiques
À travers ce texte paru dans Incise, n° 8, (éd. Théâtre de Gennevilliers), Alexandre Balcaen, éditeur chez Adverse, explore l’écosystème de l’édition, dans lequel l’élaboration du livre, sa production et sa distribution s’articulent en une chaîne d’acteurices indépendant·es : auteurices, éditeurices, imprimeureuses, diffuseurs, libraires. Il met en lumière les défis économiques du secteur, entre maintien de la bibliodiversité, accélération des flux et quête de rentabilité. Il souligne aussi le rôle central des librairies indépendantes, protégées par la loi Lang, mais confrontées aux pressions du marché.
L’empire Bolloré s’étend à l’édition, la construction d’un leader mondial de la culture
Dans ce texte, Valentine Robert Gilabert retrace la chronologie des acquisitions majeures du groupe Bolloré, révélant les étapes de son expansion structurelle et logistique. Elle met en lumière le rôle central de Vivendi, présenté comme leader mondial des médias, et explore l’intérêt croissant de Bolloré pour l’édition, secteur clé pour influencer les récits culturels et politiques. Ce parcours éclaire les liens entre ces acquisitions, une stratégie globale d’influence et un usage intensifié des manœuvres judiciaires, notamment les procès-bâillons, pour museler critiques et oppositions, consolidant ainsi son emprise sur la culture, l’information et le débat public.
La concentration éditoriale
SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS
Dans ce texte incisif, Thierry Discepolo, fondateur des éditions Agones, explore la domination du groupe Hachette sur l’édition française, amplifiée par l’arrivée de Vincent Bolloré. Il met en lumière l’alliance entre grand capital et idéologies d’extrême droite, incarnée par Bolloré, tout en soulignant l’inaction face à la concentration éditoriale qui fragilise la diversité culturelle. L’auteur détaille les dynamiques de pouvoir au sein des principaux groupes éditoriaux, dévoilant un paysage marqué par des intérêts politiques, économiques et écologiques inquiétants. Un appel à la vigilance et à l’action pour préserver l’indépendance.
Hachette, un empire vieux de deux siècles
Dans son analyse, Jean-Yves Mollier retrace les deux siècles d’existence du groupe Hachette, qui est aujourd’hui le leader de l’édition en France, affichant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros et une forte présence internationale. L’acquisition du groupe par Vincent Bolloré en 2022 a amplifié les enjeux de concentration dans le secteur de l’édition, Bolloré cherchant à aligner son empire médiatique sur des idéologies conservatrices. À travers cette contribution, Mollier nous alerte que le passage d’ « Hachette sous la houlette de Bolloré représente une rupture avec la diversité et l’ouverture qui caractérisaient autrefois l’édition française. »
Diffusion/distribution : Paon- Serendip
Éditer en féminisme, évolution et la transformation de l’édition féministe et de ses catalogues
Résumé en cours d’écriture

La carte de l’empire Bolloré sur https://desarmerbollore.net/la-carte
Lesbienne à la page, hybrider les genres dans l’édition indépendante
Depuis sa pratique de l’édition (RAG, EAAPES), de l’écriture (Les Aventures de Maboule, 2024 ; Le Parking, étage 63, 2017 ; MNRVWX, Oparo, 2016) et de la traduction, Clara Pacotte aborde la question des voies creusées par les éditeurices indépendant·es afin d’hybrider les genres et rendre compte de la pluralité des cultures qui vivent au sein de celleux qui écrivent ; comment d’un usage particulier de la ponctuation et de l’écriture inclusive, les récits et les émotions se voient multipliées, densifiées, pluralisées. Entre outillage situé et résistance précise à un langage écrit hégémonique d’abord inventé pour le commerce, elle propose un espoir de langage malléable anti-réactionnaire.
Depuis une position d’organisatrice de salons et d’éditrice : faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre
Dans ce texte, Pascale Obolo dénonce la censure indirecte qui entrave la circulation des voix diasporiques en France et en Afrique. Censure toujours plus exacerbée par les dynamiques de concentration éditoriale et le contrôle des réseaux de distribution, notamment par des groupes comme celui de Bolloré. En tant qu’organisatrice de foires indépendantes (African Art Book Fair, Missread), elle défend ces espaces comme des lieux essentiels de résistance et de diffusion libre. Face à de grands groupes monopolistiques qui filtrent les récits, ces foires permettent la fabrique de contre-récits et la circulation de voix minoritaires.
Le monopole d’Hachette sur le marché des manuels scolaires
Dans ce texte, Tristan Garcia alerte sur l’impact
contact@deborderbollore.fr
https://www.deborderbollore.fr



































































REF : BOLLO
croissant des manuels scolaires dans la formation des enseignants, dans un contexte où le recrutement devient de plus en plus difficile et les formations de plus en plus courtes. Il souligne le risque d’une dépendance accrue aux manuels, perçus à tort comme des reflets parfaits des programmes. Avec Bolloré à la tête de la majorité des éditeurs de manuels, Garcia pointe la menace d’une instrumentalisation idéologique : une réécriture des contenus scolaires pour diffuser des récits nationaux, coloniaux et conservateurs en remodelant les enseignements.
Depuis une position de libraire engagée, joies et limites. L’exemple de L’Affranchie librairie, à Lille
Dans ce texte, Soazic Courbet, de L’Affranchie librairie à Lille, s’interroge sur ce que signifie être une librairie engagée au regard des systèmes de dominations dans les milieux du livre. Elle souligne ainsi l’importance d’une réflexion collective sur les dynamiques qui nous lient et invite à penser l’édition en féministes comme une résistance aux idéologies dominantes patriarcales, capitalistes et fascistes : avancer individuellement, c’est bien, mais s’affranchir collectivement, c’est encore mieux.
EXTRAIT 1, LA CONCENTRATION ÉDITORIALE, THIERRY DISCEPOLO
La domination du groupe Hachette sur l’édition française ne date pas d’hier. Ni même d’avant-hier. Mais tout bien considéré, comparé au temps où le regretté Jean-Luc Lagardère regroupait Hachette livres, distribution et médias avec l’armement et l’aviation, l’« empire Bolloré » fait de nos jours un peu prix de consolation. Maintenant, il est vrai que Jean-Luc n’était, à l’égal des autres grands patrons, qu’un militant du profit. Alors que Vincent…
C’est donc l’alliance du grand patronat et de la droite extrême qui est à l’origine de la prise de conscience dont certains médias se font les échos depuis quelques semaines. Il est évidemment remarquable que l’impulsion ne vienne pas de l’édition industrielle, ni des grosses librairies, moins encore des autrices, romanciers, journalistes et universitaires qui font les unes et les prime times – mais de la librairie indépendante, associée à l’édition indépendante.
SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS
L’odeur de l’encre. L’imprimerie : mirage des techniques, réalité des concentrations L’imprimerie de labeur — celle qui concerne l’impression de livres ou de brochure — longtemps associée à l’imaginaire de l’ouvrier typographe et des caractères au plomb, subit de profondes mutations sociales et techniques depuis la fin du XX e L’essor de l’informatique de bureau, le développement des techniques d’impression favorisant les cours tirage et surtout la concentration éditoriale ont fragilisé ce secteur, exacerbé par de grands groupes, dont l’hégémonie accentue le rapport de force entre éditeurs et imprimeurs. Dans ce texte, Arnaud Frossard des éditions de la Grange Batelière et libraire au Merle moqueur, interroge ces mutations et, à travers témoignages et analyses, propose de repenser les solidarités, en écho aux résistances déjà observées entre librairies et éditeurs.
Le démantèlement
En 2024, une coalition de collectifs, syndicats, groupes et partis lance un appel à rejoindre la campagne « Désarmons Bolloré », celui-ci étant perçu par ces militant·es comme l’une des causes de la montée de l’extrême droite en France. Ce texte, rédigé par les initiateurices de la campagne, reviendra sur l’influence déterminante de Vincent Bolloré dans la sphère politique et médiatique, détaillant comment son arsenal logistique, éditorial et médiatique alimente la « guerre civilisationnelle » qu’il se targue de mener. Y seront dressées des stratégies concrètes de résistance collective pour contrer son emprise croissante sur la culture, l’information et le débat public.
Diffusion/distribution : Paon- Serendip
contact@deborderbollore.fr http://www.deborderbollore.fr
C’est pourquoi la formulation des dangers que fait peser l’« empire Bolloré » sur le marché du livre et la réponse à y apporter présentent toutes les qualités de la franchise et de la clarté : un appel à boycotter les livres édités par l’une ou l’autre des quarante et quelques marques du groupe Hachette. Une clarté et une franchise qui répondent à la franchise et la clarté du projet idéologique dont le pieux milliardaire breton porte fièrement les couleurs : restaurer les valeurs millénaires de l’Occident chrétien, version radicalement identitaire et rêve de croisade contre les fantasmes du « grand remplacement ».
Dans l’édition, la première illustration de ce programme fut le soutien apporté au livre d’Éric Zemmour en candidat d’extrême droite à la présidentielle 2017. Cette opération a fait tant de bruit qu’on semble avoir oublié que le groupe Hachette n’a pas attendu d’être sous la coupe de Vincent Bolloré pour éditer Zemmour : trois titres sont parus chez Grasset, maison où débute le journaliste. Mais surtout que c’est un autre groupe éditorial français qui a fait sa gloire et ses plus grands succès : cinq titres (dont Le Suicide français et Destin français) parus chez Albin Michel.
La tribune « Ne laissons pas Bolloré et ses idées prendre le pouvoir sur nos librairies » semble en rajouter sur l’ancrage à l’extrême droite fascisante, raciste, sexiste et nationaliste de l’ascétique sexagénaire. Mais ce n’est peut-être pas exagéré lorsqu’on apprend que l’« ogre de Cornouaille » a engagé un néo-nazi pour entretenir son île et y encadrer les messes auxquelles il assiste en maître des lieux
On ne trouvera jamais pareilles vulgarités chez la famille Gallimard, propriétaire du troisième groupe éditorial français. Mais si on s’inquiète vraiment de la diffusion des idéologies d’extrême droite, côté fonds littéraire et philosophique nazi, fasciste et crypto-fasciste, pétainiste et antisémite, Gallimard dispose d’une avance séculaire qu’on n’est pas près de rattraper chez Hachette. Mais s’inquiète-t-on vraiment dans le monde du livre de la diffusion des idéologies d’extrême droite
Dernière modification 13 janvier 2025
httpps://g/gitlab.com//deborderbollore



































































REF : BOLLO
dès lors qu’elle n’est pas tapageusement poussée par Vincent Bolloré ? Lancé en juillet dernier par Attac et les Soulèvements de la Terre, l’appel à « Désarmer l’empire Bolloré » rappelle qu’avant de fondre sur l’édition et les médias français Vincent Bolloré a fait fortune dans l’exploitation néocoloniale et qu’il continue d’être un acteur majeur du ravage écologique.
Il faut donc aussi rappeler que le patron d’Editis, second groupe éditorial et médiatique français, doit sa fortune au même genre de piraterie — non pas en Afrique, comme Vincent Bolloré, mais en Europe de l’Est. Ce qui fait de Daniel Kretinsky — avec la propriété de centrales électriques au lignite, au gaz et nucléaires, de gazoducs mais aussi d’entreprises de stockage de gaz, de fret, de négoce de matières premières, etc. — un producteur de nuisances écologiques et économiques du même registre, toutefois d’une autre ampleur. Mais s’intéresse-t-on vraiment dans le monde du livre aux nuisances écologiques et économiques d’un grand patron dès lors qu’il ne s’agit pas de « Bolloré » ?
Sur le plan politique, la différence de positionnement entre le Breton et le Tchèque se situe entre Valeurs actuelles, pour le premier, et Franc-Tireur, pour le second. Autrement dit, une offre qui va de l’extrême droite à l’extrême centre — soit l’espèce d’alliance qui gouverne désormais, vaille que vaille, le pays.
Certes, ils sont innombrables celles et ceux à s’être laissé berner par le jeune premier en candidat des médias. Et Françoise Nyssen n’est pas restée bien longtemps ministre. Mais on ne trouve dans son minuscule bilan aucune mesure pour, sinon réduire, au moins réguler la concentration éditoriale. Ce qui n’aurait pas été inutile à la protection de beaucoup de maisons, à commencer par la sienne. Car depuis deux ans, tout observateur avisé ne se pose qu’une seule question sur le destin de la grenouille arlésienne qui a voulu se faire plus grosse que le bœuf parisien. Non pas qui va l’acheter — ce sera Madrigall. Mais quand ? Et le nombre d’années ne se compte que sur les doigts d’une main.
Que l’urgence soit à la bataille culturelle contre l’offensive idéologique menée par un magnat de l’édition et des médias qui a mis tous ses moyens au service d’un parti d’extrême droite ne fait pas de doute. Mais cette urgence ne doit pas occulter la réalité du système qui a permis à une seule personne de disposer de pareil pouvoir : la concentration capitalistique.
Et si on voit bien que la machine Hachette aux mains de Vincent Bolloré concentre les plus grands dangers, politiques et économiques, on voit bien aussi que son boycott, dans un système où les groupes qu’on vient de décrire s’accaparent 90 % de la production, cette action ne va, au mieux, que faire reculer la peste au bénéfice du choléra.
SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS
À la tête de Média-participation, troisième challenger éditorial français du groupe Hachette, la famille Montagne affiche le même genre de pedigree qu’on a vu jusqu’ici à ce poste, mais sur le mode fade. Catholique de droite lui aussi, mais modéré, le fils (Vincent) a pris ses distances avec le père et fondateur (Rémy), qui agrémentait en 1958 les débats à l’Assemblée nationale sur la loi Veil en associant « l’avortement aux génocides du IIIe Reich ». Fondé avec l’argent des pneus Michelin et l’aide de l’assureur Axa, le groupe mélange désormais astucieusement l’industrie de la BD à l’édition religieuse et au livre d’entreprise, à l’« art de vivre » et l’« art du fil », au nautisme et au secourisme — un tas d’où émerge péniblement la bannière du Seuil, qui s’efforce de satisfaire son contrôleur de gestion en exploitant les grandes causes du temps.
On le voit bien, l’urgence que dévoile l’« empire Bolloré » touche autant à l’idéologie qu’à l’organisation de l’édition française, sous le contrôle d’une poignée de grandes fortunes. Pour finir donc ce tour d’horizon (non exhaustif) des principaux groupes à la recherche d’une alliance face à Hachette, voyons du côté d’Actes Sud et de ses patrons, la famille Nyssen. Ici, ni Occident chrétien, ni piraterie néocoloniale, ni calamiteux bilan carbone, et aucun nazi caché dans les placards.
Mais puisqu’il s’agit de « faire barrage au Front national », suivant la formule consacrée, peut-on compter sur celle qui fut la première ministre de la Culture d’un président à qui on peut retirer bien des mérites, mais pas celui d’avoir permis au premier parti d’extrême droite français d’être en mesure de toquer à la porte du pouvoir ?
Diffusion/distribution : Paon- Serendip
contact@deborderbollore.fr http://www.deborderbollore.fr
EXTRAIT 2, La chaîne du livre, une description synthétique et didactique, Alexandre Balcaen
P ar tradition, l’activité éditoriale a longtemps épousé les principes de la règle économique dite du 7-2-1 : pour 10 livres produits, 7 sont déficitaires, 2 atteignent l’équilibre financier, 1 seul génère des bénéfices suffisants pour amortir le déficit cumulé des sept premiers. Selon cette règle tacite, établie empiriquement, un éditeur réalise généralement des bénéfices restreints car il assume seul les déficits de ses publications.
La pérennité de la maison d’édition repose alors sur la gestion de son fonds, c’est-à-dire sur la disponibilité de ses anciens titres, quand bien même cette gestion reste une gageure : les coûts de réimpression d’un titre peuvent parfois annuler les bénéfices d’un premier tirage pourtant épuisé. Maintenir un fonds est de plus un choix souvent onéreux car il immobilise de la trésorerie et génère un coût de stockage. Il en va de même pour une librairie.
Une librairie bénéficie en effet d’une marge commerciale équivalente en moyenne au tiers du prix du livre. Ainsi, pour qu’un livre intègre le fonds d’une librairie en étant considéré comme rentable, il faut qu’il ait été vendu au moins trois fois (deux fois pour amortir le coût d’acquisition de l’ouvrage, une fois supplémentaire pour participer aux charges de la librairie : salaire(s), loyer, amortissement du matériel, abonnements aux bases de données de référencement et de comptabilité/ gestion, électricité, assurance, etc.).
La librairie doit de plus gérer l’encombrement de sa surface de vente, entre rayonnages
Dernière modification 13 janvier 2025
httpps://g/gitlab.com//deborderbollore
page
































































(pour le fonds) et tables de présentation (pour la nouveauté).
L’optimisation commerciale de cette surface de vente peut être envisagée selon un calcul de rentabilité au mètre linéaire d’exposition.
Le bénéfice net d’une librairie ou d’une maison d’édition défendant une politique de fonds s’établit rarement au-delà de 3 % de son chiffre d’affaires. Le moyen communément jugé le plus efficace pour augmenter son bénéfice net est la recherche (pour l’éditeur) ou la mise en avant (pour le libraire) de best-sellers.
Pour les éditeurs portés sur l’accélération et l’augmentation de leurs bénéfices, la règle économique tacite du 7-2-1 a glissé ces trente dernières années vers un ratio plus proche de 15-4-1, selon la doctrine stratégique qui édicte que multiplier les paris multiplie les chances d’obtenir au moins un succès d’autant plus important.
L’efficacité économique du modèle 15-4-1 nécessite un raccourcissement de la durée de représentation d’une nouveauté en librairie, afin qu’un pari jugé perdu puisse laisser rapidement sa place au pari suivant. Il s’agit donc de dynamiser les flux au détriment des publications à rotation plus lente, jugées insuffisamment rentables.
Les rayons des librairies sont ainsi soumis à un engorgement qui dessert lui aussi les politiques de fonds. Le temps nécessaire à la gestion des flux et des stocks de marchandises augmente, tandis que s’amenuise la disponibilité des libraires pour lire (à entendre, dans ce contexte d’urgence commerciale, comme « prendre connaissance des contenus » plutôt que « se cultiver »), sélectionner (évaluer l’intérêt économique, artistique ou intellectuel d’une publication) ou conseiller (produire un discours jugé adapté, dans la perspective d’une vente).
Selon ce double régime de précipitation et d’opportunisme, l’accroissement quantitatif de l’offre va de pair avec une déliquescence de sa moyenne qualitative. Les lecteurs manifestent alors une tendance à se concentrer sur des « valeurs refuges ». L’éditeur doit donc plus que jamais trouver et convaincre des prescripteurs, généralement des journalistes, avec lesquels il entretient souvent un rapport de courtisanerie, afin de favoriser d’éventuelles recensions positives.
SCIENCES SOCIALES, ÉTUDE DES MÉDIAS



Pour permettre l’accélération des flux (condition nécessaire à la politique du remplacement immédiat, qui permet d’augmenter la fréquence des paris éditoriaux), le secteur de la distribution a bouleversé les règles préalablement établies en abolissant le délai de garde qui imposait traditionnellement aux libraires de conserver un livre en magasin pendant au moins trois mois : la durée de représentation d’un livre en librairie peut désormais ne pas dépasser quelques jours, avant qu’il soit retourné. Cette pratique permet aux librairies de bénéficier d’un avoir, crédité par le distributeur sur leurs prochaines factures (mais dû in fine par l’éditeur).
Le secteur de la distribution, pour l’essentiel une poignée de groupes économiques surpuissants et liés aux éditeurs qui dominent le marché, gère la commercialisation de l’immense majorité des catalogues d’éditeurs existants, et bénéficie donc de commissions financières, qu’un livre soit vendu ou non : dès lors qu’un livre est engagé dans un flux aller ou retour entre le distributeur et la librairie, le distributeur facture ses services.
La recherche du plus grand bénéfice possible dans l’intervalle de temps le plus court provoque une augmentation du nombre de livres publiés. Mécaniquement, augmente aussi le taux des retours sur invendus : autant de livres qui rendent l’éditeur débiteur de son distributeur. Par ailleurs, une nouveauté dont la mise en vente se solde par un échec est volontiers détruite, car le pilon est une opération moins onéreuse que le stockage à long terme (à noter que le pilon et une partie du stockage sont généralement gérés, et facturés, par le distributeur). Sans fonds dynamique, un éditeur n’a donc d’autre moyen que de produire de la nouveauté sans discontinuer, afin de compenser mois après mois le montant d’une dette vouée à ne jamais s’évanouir.
Diffusion/distribution : Paon- Serendip
contact@deborderbollore.fr http://www.deborderbollore.fr
Paradoxalement, alors que la perspective industrielle, reposant sur les économies d’échelle, suppose que plus le tirage d’un livre augmente, plus son coût unitaire de production baisse, le système commercial en place induit que de plus en plus de livres sont vendus en quantités de plus en plus faibles, tandis que de moins en moins de livres sont vendus en quantités de plus en plus élevées.
L’activité éditoriale est ainsi prise dans une logique mécaniste et productiviste exacerbant sans discontinuer une tension économique généralisée, sans qu’aucun de ses acteurs ne vienne soulever la possibilité de finalement atteindre un point de rupture.
Tout au contraire, ce sont des métaphores biologiques, relatives à une idéologie d’équilibrage immanent, naturel, qui remportent l’adhésion. Grâce à la seule loi sur le prix unique du livre, la sauvegarde de la librairie indépendante constituerait un rempart garantissant la stabilité d’un écosystème harmonieux, garant de la bibliodiversité, face aux déséquilibres concurrentiels provoqués par la grande distribution.
Il apparaît toutefois que cet écosystème et cette bibliodiversité sont suffisamment malmenés par la réalité du marché pour nécessiter l’intervention financière d’institutions publiques. Auteurs, éditeurs et libraires soumettent ainsi des demandes de subventions auprès du Centre national du livre, des Centres régionaux du livre ou des Directions régionales des affaires culturelles, autant d’instances atténuant parfois les effets les plus délétères de cette mécanique marchande, sans pour autant jamais la remettre en cause. C’est tout cela, la chaîne du livre.
Dernière modification 13 janvier 2025
httpps://g/gitlab.com//deborderbollore


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
« À BAS L'ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS »
Fragments d’une lutte antifasciste
d’après des propos recueillis par Olivier Minot
· Format (mm)
130*205
· Nombre de pages +/- 200
· Prix (€) ............................................ +/- 14
· ISBN .................................................... 9782493534040
· Parution dec. 2023
· Graphisme Service Local
· Tirage ................................................ 1000
Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs s’est formé en 2013 à la suite de la mort de Clément Méric. En 2022, l’État enclenche une procédure de dissolution à l’encontre du groupe. Le portrait et les paroles des militant·e·s de la GALE racontent 15 ans de luttes antifascistes, anarchistes et autonomes à Lyon. Olivier Minot retranscrit ici des entretiens réalisés avec des militant.e.s de la GALE qui racontent 15 ans de luttes antifascistes, anarchistes et autonomes à Lyon. Loin des constructions policières et des fantasmes médiatiques, loin aussi des manifestes qui font paraître les groupes pour des organisations monolithiques, il s’agit dans À bas l’État, les flics et les fachos de rendre compte d’une histoire collective à partir des récits intimes qui la traverse et de la frontière poreuse qui parfois sépare ces deux manières de se raconter. Car c’est cela que recherche Olivier Minot dans les entretiens qu’il réalise : trouver, avec les membres de la GALE, une manière de raconter une histoire à la fois intime et collective avec tout ce que cela comporte de mythification.


À propos d’Olivier Minot. « Mi-homme mi-transistor », ce radioman bricole des émissions sur cassettes au collège puis sur les fréquences associatives (Tropiques FM, Radio Néo, Radio Canut…), il a posé sa voix sur les ondes du privé (Ouï FM, Sun FM), comme du service public (RFI, France Culture). C’est sur Radio Canut à Lyon qu’il mène pendant 10 ans jusqu’en juin 2018 la pétillante Megacombi, prix découverte SCAM 2016.
Reporter pour l’émission Les Pieds sur Terre (France Culture) depuis 2008, Olivier Minot réalise en parallèle pour ARTE RADIO une trilogie autobiographique et sonore qui mêle récit personnel, engagement politique et passion pour la radio : son hommage à l’émission mythique de Daniel Mermet, Là-bas si j’y suis plus remporte le prix Longueur d’ondes en 2014. Deux ans plus tard, il reçoit le prestigieux Prix Italia du meilleur documentaire pour La révolution ne sera pas podcastée, trilogie s’achevant avec le mouvement social de 2016 et ses nuits debouts dans 2017 n’aura pas lieu Il réalise ensuite pendant quatre saisons, la revue de presse déjantée Dépêche ! sur Arte Radio tout en écrivant spectacles mêlant radio et scène ( Radio Bistan avec le chanteur Reno Bistan ou J’étais déjà mort dans les années 80 avec Silvain Gire), et co-produisant l’émission La micro-sieste sur Radio Canut.
Ouvrages associés :
• Et s’ouvre enfin la maison close, l’histoire orale d’un squat au tournant du siècle, Nathan Golshem, Demain les flammes, 2022
• Raccourci vers nulle part, Alex Ratcharge, Tusitala Editions, 2022
• À l’arrache, Portraits & récits de la scène musicale underground de Lyon, 1980 — 2020, Éditions BARBAPOP, décembre 2021
• Une histoire personnelle de l’ultra gauche, Serge Quadruppani, ed. divergences, 2023
• Une vie de lutte plutôt qu’une minute de silence, enquêtes sur les antifas, Sébastien Bourdon, le seuil, 2023


Couverture provisoire


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
Dans cet ouvrage, on peut y suivre le parcours de plusieurs militant.es qui, entre 2010 et 2023, ont croisé le chemin du collectif. Iels y racontent leur désir de révolte, leurs rêves de révolution, les amitiés et les amours qui sont le ferment des bandes affinitaires et de la volonté de continuer à lutter ; iels se confient sur la naissance de leurs engagements, font le récit de trajectoires hétérogènes : issu.es de quartiers populaires la classe moyenne, de familles politisées ou pas ; parlent de la volonté de s’organiser de façon concrète en créant un groupe qui participe à de nombreuses actions : des chasses dans les rues de Lyon, des blocages d’universités ; puis iels se découvrent en parlant de leurs doutes et de leurs peurs. Iels exposent aussi les particularités de la ville de Lyon, de sa tradition religieuse et bourgeoise encore très puissante qui se matérialise dans l’existence de nombreux groupes d’extrême droite, mais aussi, en opposition, des nombreux groupes, bandes et collectifs prônent l’émancipation en ouvrant des squats et en luttant dans la rue.

Moins que le récit d’un groupe en particulier, ce livre a pour ambition de se faire le passeur de l’histoire orale d’une bande de jeunes à l’aube du XXIe siècle. Histoire dont le témoignage est d’autant plus précieux que les événements récents montrent à quel point les voix et les gestes révolutionnaires sont toujours plus empêché.es et réprimé.es. En tant qu’éditeurices, nous avons constaté cette dernière année une offensive répressive contre les personnes et groupes qui portent des gestes conséquents dans l’espace politique français : contre celleux qui, ces derniers mois, on prit part au mouvement contre la réforme du travail et contre le mouvement écolo’ Les Soulèvements De La Terre, lui aussi sous le coup d’une procédure de dissolution. De la même manière, nous prenons acte d’une offensive culturelle toujours plus forte contre tout ce, et tout.es celles et ceux, qui se montrent critiques à l’égard de l’ordre établi. C’est en cela que la diffusion large de ce texte nous semble importante : en se voulant honnête il déjoue le narratif du pouvoir en proposant une autre histoire.
À propos de Service Local Depuis leur atelier lyonnais Service Local déploie des idées, des systèmes, des mots et des images dans le champ du design graphique. Leurs collaborations prennent la forme d’éditions, d’affiches ou d’identités visuelles, et résultent de processus de création mêlant enquête et expérimentation.

Tracts réalisés par Service Local pour diffuser l'appel à financement participatif du livre.
L’affaire des sept antifas à Lyon
Réalisée par Olivier Minot, cette émission publiée le mercredi 15 décembre 2021 sur France Culture a été le point de départ de cet ouvrage.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-affaire-des-sept-antifas-a-lyon-3181220


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
Celui qui écrit — avant-propos par Olivier Minot (mai 2023)
J’ai 41 ans et je ne sais pas me déterminer politiquement. De gauche, c’est sûr, mais c’est large et pas très excitant. Mon engagement, c’est plutôt la radio, que je pratique depuis l’âge de 12 ans, c’est elle qui m’a formé et qui est devenue mon instrument pour jouer, passer des paroles, brasser des idées, et donc faire un peu de politique.
C’est dans ce cadre que j’ai rencontré certains militants de La Gale en 2021 : après avoir assisté au procès de la fameuse « affaire des 7 », je décide de raconter cet imbroglio judiciaire pour l’émission
Les Pieds Sur Terre de France Culture 1 .
Cette affaire était emblématique de l’époque et du traitement policier qu’on réserve aux militant·e·s antifascistes. Elle raisonnait avec la montée en puissance de l’extrême droite que ce soit au niveau international (Orban, Trump, Bolsonaro, Salvini et bientôt Melloni…), au niveau national, des mesures de déchéance de nationalité proposées par le PS jusqu’à la politique répressive et raciste symbolisée par le ministre Darmanin, qui qualifiait Marine Le Pen de trop « trop molle » sur un plateau télé, sans parler de l’arrivée à l’Assemblée Nationale de 88 députés d’un parti fondé par Jean-Marie Le Pen allié à un ancien Waffen SS. Et enfin, au niveau local, ma ville et mon quartier étant constamment confrontés au renforcement des groupuscules ouvertement néonazis, qui semblent avoir pris Lyon pour leur capitale.
À l’heure où j’écris ces lignes, des FAF2 défilent dans les rues de Paris et font des saluts nazis au sein même de l’espace Simone Veil, ils incendient la maison d’un maire qui assume vouloir accueillir des migrants et ils ratonnent régulièrement dans les rues du centre de Lyon. Pendant ce temps-là, les politiques, en place censées dénoncer ces attentats, les renvoient sans cesse aux « violences d’extrême gauche ». Comme si fascistes et antifascistes étaient juste deux faces d’une même pièce. Ce discours devenu dominant me désespère et c’est encore une fois lors du procès de l’affaire des 7, que la plaidoirie des avocats a fait du bien en recadrant les choses et en réaffirmant que nous sommes tous antifascistes.
Cependant, il faut reconnaître que parfois, certains de nos amis ANTIFA collent bien avec la caricature qui est faite d’eux : ils portent les mêmes vêtements que ceux d’en face, peuvent être aussi virilistes, bagarreurs, bêtes et méchants.
Le 1er mai 2022, comme chaque année, ce jour de « fête des travailleur·euse·s », je suis sur une place de mon quartier pour le traditionnel repas de quartier organisé par Radio Canut dont je suis animateur depuis 20 ans. C’est un moment convivial, toute la gauche et tout le quartier se retrouvent autour d’une tarte végétarienne, d’un verre de ponch’ offert par la radio, d’une chorale… Il y a des enfants, des voisins, des gens qu’on croise seulement ce jour-là, c’est comme une réunion de famille choisie à multiplies ramifications. Cette année-là, un
groupe a débarqué, masqué, menaçant, et une bagarre a éclaté. « C’est les fachos » se sont alarmées certaines voix. Non c’était un groupe Antifa qui venait se battre avec un autre groupe Antifa. Et comme après une bagarre dans une cour de récréation, chaque groupe va rejeter la faute sur l’autre, va remonter à des précédentes anecdotes de coup de pression, de tabassage sexiste, de trahison, et chacun trouvera aussi une bonne raison politique d’aller tabasser ses meilleurs ennemis. Mais ces justifications importent peu. Les 90 % des gens présents sur la place ne connaissent pas les guéguerres internes à ce milieu et ont juste vu deux groupes de gauche se foutre sur la gueule. Les fachos, qui des fois rôdent autour de ce repas de quartier ont du bien rigoler ce jour-là.
Alors quand quelques jours plus tard, une maison d’édition proche de La Gale, un des deux groupes en question, est venue me demander de travailler sur ce bouquin, j’étais partagé entre ne pas mettre mon nez dans ce nid de panier de crabes, et essayer de comprendre. Les membres de La Gale ont entendu mes critiques, mes réserves, iels ont accepté que cet ouvrage qui raconte leur histoire ne soit pas à sens unique, qu’il y ait aussi des regards extérieurs qui puissent s’exprimer à commencer par le mien.
Mes doutes sont revenus quand, en cherchant justement les bonnes personnes pour apporter quelques observations, j’ai été confronté à des peurs de réprimandes et surtout à une certaine détestation de La Gale : « pas de temps à perdre avec ces gens-là » ou plus ironique « ils sont déjà dans la merde avec leur dissolution, pas envie de les enfoncer ».
Derrière ces affrontements qui peuvent être violents se cache une fracture politique loin d’être nouvelle dans « la gauche ». Libertaires contre staliniens, insurrectionnalistes contre démocrates, avant garde contre mouvement de masse… déjà en 1970, les autonomes attaquaient le SO de la CGT. Alors assister encore à ce genre d’affrontement 50 ans plus tard confirme un conflit historique, mais relativise les postures de militant.es qui se revendiquent révolutionnaires tout en conservant ces lignes de divisions qui n’ont jamais fait une quelconque révolution. Et puis quand on veut dénoncer le stalinisme et se revendiquer de la diversité des tactiques, et qu’on est prêt à tabasser des « camarades » parce qu’ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne, ça pose question ! C’est aussi ces réponses que j’ai voulu aller chercher, en entamant ce travail. Chaque entretien, réalisé en tête à tête avec chacun·e, a duré plusieurs heures et c’était un privilège de pouvoir écouter ces militant·e·s se raconter au calme.
Dans ce noyau dur de La Gale, il y a une diversité de classes, d’origines, d’identités, mais aussi de cultures politiques : on ne peut pas leur faire le procès d’être un groupe homogène de chasseurs de skins décérébrés ni de former une avant-garde bourgeoise de surdiplômés en sciences sociales, contrairement à que nous renvoie généralement l’imaginaire des groupes antifas ou autonomes.


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
Tou·te·s racontent comment ils sont rentrés en politique, c’est le terme qu’ils et elles emploient. Car pour ces militant.es brillant.es, rentrer en politique, ne signifie pas prendre une carte dans un parti hiérarchisé pour devenir un professionnel qui au fur et à mesure de sa carrière mettra de côté ses idéaux pour être adapté aux postes et aux mandats prestigieux, mais rentrer en, politique, c’est lutter au quotidien, sur le terrain souvent de manière invisible. Et une fois certaines postures prétentieuses sur le reste de la gauche dépassées, on ne peut que saluer ce travail de terrain, qui vient contrecarrer un peu les médias de masse, qui fait vibrer les cœurs restants à gauche comme le mien, qui nous sort de la résignation, qui nous protège encore un peu d’un basculement plus inquiétant. C’est cet activisme qui questionne aussi le mouvement social en le forçant à garder un cap, à modifier ses traditions et trajectoires de cortège parfois planplan… Et cet engagement leur est coûteux, harcelé·e·s par la police dans leur quartier, humilié·e·s par la presse bourgeoise, poursuivi·e·s et enfermé·e·s par l’état, et même dissous… alors ils et elles méritent d’être entendu·e·s.
Enfin et surtout, leur histoire dépasse largement le cadre d’un groupe local antifasciste. À travers ce qu’a fait La Gale (qui n’est évidemment qu’un grain de sable dans la plage qui bouillonne sous les pavés), on revivra 15 ans d’événements communs, de la mort de Clément Méric aux Soulèvements de La Terre en passant par la loi travail, les cortèges de têtes, les gilets jaunes, le confinement, les mesures sécuritaires, les dissolutions, la révolution féministe en cours, les violences policières… Beaucoup de ces lignes ont été écrites pendant le mouvement contre la réforme des retraites de Macron du premier semestre 2023, et il était étrange de retranscrire par exemple comment se sont créés les cortèges de tête en 2016 alors qu’au même moment à Lyon, ils défilaient fournis et déter’comme jamais ! Ou de raconter comment ils se sont battus contre leur dissolution alors même qu’on voulait interdire Les Soulèvements de la Terre.
Bref, voici un fragment des luttes en cours, qui n’a pas fini de raisonner.
(1) A réécouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-affaire-dessept-antifas-a-lyon-3181220
(2) FAF pour « France aux français » appellation générique des militants d’extrême droite, y compris par eux-mêmes.
EXTRAIT 2
ZEDE
Pendant toute une période, on allait très souvent se balader dans le Vieux Lyon le samedi, en espérant tomber sur des bandes de fafs pour leur taper dessus, leur faire comprendre qu’ils sont en sécurité nulle part, parce qu’en fait, c’est des fafs et qu’ils ne devraient pas exister ! C’était comme des sortes de maraude, qu’on appelait des chasses. Souvent on en trouvait en train de manger une glace et en général, des sympathisants à nous un peu cramés commençaient direct à sortir leur matraque en gueulant « y’a des fa, y’a des fa ». Forcément, le truc qu’on voulait discretos se transformait en une énorme esclandre au milieu des touristes où ça se gueulait dessus, ça se donnait des coups, puis on finissait par détaler quand la BAC arrivait. Et on rentrait bien content en se disant « On a chopé machin, on a défoncé machine »
LUCAS
Une fois, après une manif, on apprend qu’il y a une dizaine de fafs à Foch, on était une petite quinzaine alors on décide de foncer : on arrive super vénère sur place, et là, un pote part direct tout seul en trombe avec sa béquille pour leur sauter dessus. On se met à courir derrière lui, mais en approchant, on découvre qu’en fait, ils sont 30, ils sont immenses, ils sont hyper musclés, ils sont tous torse nu, ils ont des chaînes, des machettes, des couteaux, et ils sont tous en ligne. Ils craquent un fumi en hurlant comme des vikings et ils nous foncent dessus. Là, je me retourne et je me rends compte qu’on est plus que six, et qu’on va se faire massacrer. « vaz-y on se barre ! », gueule un pote et on se met à courir le plus vite qu’on peut. J’entendais les chaînes claquer derrière moi pendant que je courrai, ils étaient vraiment à deux doigts de m’attraper, ils nous hurlaient dessus en mode « On va t’égorger ». Il y avait des Italiens avec eux, on l’a vérifié après avec les réseaux de Casa Pound1, ils avaient ramené des chefs de Rome et moi qui parle italien, je comprenais leurs insultes : « va t’en antifa, va t’en, t’es une bête, un animal et je vais prendre un plaisir à te défoncer sale PD ! espèce de pédale, tu fuis ». Au final, on a réussi à se réfugier dans une allée, cachés derrière des portes, on entendait les fafs passer en mode veille. S’ils nous trouvaient, on était morts, on s’est vraiment cru dans un délire de film d’horreur de psychopathes et j’ai jamais eu autant peur de toute ma vie.
GRECOS
Il y a plusieurs années, on avait fait une descente au Dikkenek, un bar de la Croix Rousse, le patron nous avait appelés à l’aide genre « j’ai plein de fafs, ils sont trop nombreux, y a des discours racistes, je sais pas quoi faire ». C’était une époque où les fafs chassaient beaucoup à Croix-Rousse, et ça faisait plusieurs fois


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
qu’on arrivait pas à les choper. Et là on avait une adresse ! On a débarqué à quinze dans le bar, on a allumé tous les fafs dedans, mais il y avait aussi des lambdas qui se sont pris du gaz lacrymogène et des verres qui volaient, ils ont dû avoir super peur. On a blessé pas mal de fafs et on s’est barrés, contents, genre « Ouais on les a éclaté ! » et le bar a du fermer pendant une semaine à cause des dégâts. Mais au fur et à mesure en se refaisant l’histoire, on s’est dit qu’on éviterait de recommencer des trucs comme ça, on a un peu trop abusé, ça aurait pu être très grave, et on en était pas à vouloir tuer un fasciste non plus ! On voulait juste leur dire « vous n’a rien à faire ici, venez pas intimider les gens, venez pas agresser ».
LUCAS
Moi j’ai aucun honneur dans la bagarre, les codes de bagarres, c’est des trucs de virilisme de merde ! Alors franchement défoncer un faf à dix contre un, je le fais sans souci. Mais je ne vais pas faire des écrasements de tête, je vais essayer d’éviter de toucher le visage, j’ai pas envie de les rendre tétraplégiques ni les tuer, quoi !
ZEDE
Je n’ai pas un tempérament à sauter à la tête de quelqu’un, même si je sais que c’est un fasciste, c’est une question de caractère, je ne peux pas attaquer quelqu’un de sang-froid comme ça, il faut que je monte en pression avant, sinon, je n’y arrive pas.
ZOE
Je m’en passerais bien, de me battre moi ! Mais en tant que femme je suis obligé, c’est pas que j’aime bien, c’est un outil que j’utilise, et avec lequel je suis à l’aise. Je fais beaucoup d’arts martiaux. Dans un combat, je suis prête à aller jusqu’à ce que je puisse m’en sortir.
LUCAS
Moi, ce qui m’a toujours fasciné à La Gale, c’est la force des meufs, quoi ! Peut-être que j’ai un truc un peu malsain d’héroïsation des meufs, mais je trouve incroyable la place qu’elles ont sur l’utilisation de la force face à des ennemis, alors que moi, j’ai toujours peur de me battre. Je pense que j’ai aussi été un peu trauma par l’histoire de Clément Méric, j’étais gamin et cette histoire de : il se prend un point — il tombe — il meurt — me revient en tête à chaque fois que je suis confronté à des bagarres.
ZOE
On a tous peur ! Ceux qui disent qu’ils n’ont pas peur, ils mentent. Et puis la violence est proportionnelle à ce qu’on a en face. Dans les années à venir, s’il y a des fafs dans la rue avec des flingues, moi je serai armée et je serai prête aussi ! Mais là, tout de suite, je vais pas te dire que je vais aller buter un faf ou un flic, autant mes potes, ils comprendraient autant l’action ne serait pas acceptée par l’opinion publique et on serait vite catalogué comme des fous extrémistes.
YASMINE
Moi, je suis une nerveuse, une vénère quoi, qui monte vraiment, mais ce qui me sauve, c’est mon côté rationnel. Dans les situations un peu chaudes, je réfléchis aux caméras, à ci, à ça, et je me fais des mégafilms sur la répression à venir, et ça me met des freins, s’il n’y avait pas tant de répression, je serai une folle ! Il y a aussi mes parents derrière, leur histoire, c’est moi qui gère pas mal de trucs pour eux comme la paperasse administrative, et qui aide mon père malade, alors je réfléchis beaucoup à eux et ça me limite pas mal.Mais j’aurais une autre situation, je ferais partie d’une autre classe sociale, je pense que je me permettrais plus de choses.
POUSSIN
Moi je fais de la boxe, des sports de combat, mais je me bats très peu. Je suis jamais dans une confrontation vraiment physique avec les gens, sauf en dernier recours. Après, il y a aussi toute une autre catégorie de violences, qui ne laisse pas de marques, mais qui peut être très humiliante, les insultes et tout ce qui est un peu plus psychologique, c’est ultra violent aussi et ça peut être pire que des coups.
LUCAS
Ça m’est déjà arrivé, quand je suis énervé, de traiter les fafs de sale PD, alors que je suis moi-même PD. J’ai déjà traité un faf de sale pute alors que j’ai envie de respecter les putes. Je dis tout le temps « Bande d’enculés ». Ce sont des trucs de langage, t’as la rage, t’as d’envie de les blesser, de les humilier, et en vrai, les insultes « safes », ça blesse pas les fafs, alors j’utilise le langage qui leur fait peur et qui les humilie. Je sais que c’est pas ouf, mais par exemple, on va défoncer un faf par terre et je vais lui dire « tu vois, tu t’es fait enculer par un PD » !
LAKHDAR
La violence en générale, certains la réduisent à un truc d’ado, à un besoin de sentir de l’adrénaline, moi, je trouve que ça peut aider aussi : briser une vitre, ça peut aussi être catalyseur d’énergie, d’émotion, c’est toute cette colère contre ce monde qui s’introduit dans un geste. C’est sur qu’on ne change pas le monde en cassant une banque, mais à un moment donné, ça fait du bien ! Nos corps subissent la société, ils sont façonnés par la société, il faut qu’on les utilise aussi pour s’en libérer !
(1) CasaPound, mouvement néofasciste italien qui nait en ouvrant des « centres sociaux » d’extrême droite avant de se muer en parti politique. Mouvement qui va inspirer en France « le bastion social »


































































ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS \\\ DEC. 2023
LUCAS
A la fin de la loi travail, je suis parti en dépression. Je n’ai pas été diagnostiqué, mais avec le recul, quand je vois l’état dans lequel j’étais, c’était n’importe quoi : je fumais énormément de shit, j’étais gazé toute la journée, tous les jours, je n’allais plus en cours, j’étais en décrochage scolaire total, c’était horrible.
ZEDE
On était tous un peu fanée par cette défaite cuisante, c’était déprimant pour tout le monde, c’était une gueule de bois importante parce qu’on a tenu trois mois à fond, sans dormir, à tout le temps réfléchir à ce qu’on allait faire comme connerie pour les faire chier, à quel tag débile on allait inscrire. L’été, je suis partie travailler en maison de retraite dans le village de mes grands-parents. Mais après, ça a été compliqué, je me rappelle plus trop comment on avait essayé de relancer la sauce, mais c’est à ce moment-là que je me suis investi sur des squats où il y avait de l’accueil de mineurs isolés. J’ai aussi fait ça parce que ma copine était dans ces trucs-là.
LUCAS
Je venais de connaître les quatre mois de ma vie les plus intenses, les plus fous, la période où je me suis senti le plus vivant, et là, on m’a dit qu’il fallait que je retourne à une vie normale, se lever tous les matins, aller au lycée, et ça, je l’ai pas accepté. Du coup, ça a pété avec mes parents, j’avais 17 ans, je suis parti de chez eux pour vivre en squat parce que j’avais envie de continuer à vivre ce truc. Et aujourd’hui, je cours encore après ce truc, mais je n’ai jamais réussi à le ressentir à nouveau. Même dans les mouvements sociaux d’après, j’avais toujours la nostalgie de la loi travail, je recherchais tout le temps les mêmes sensations, ça a vraiment été les plus belles années de ma vie.
YASMINE
Après la défaite, il y a eu une gueule de bois de ouf. J’avais mis beaucoup du mien : c’était ma première année, je voulais faire plein de choses, j’étais avec les sans papiers, j’étais à la fac, j’étais partout donc l’été après la loi travail, j’étais morte. À partir de ce moment-là, j’ai accepté le fait de ne pas tout faire, de plus m’engager de partout, de ne pas culpabiliser genre « putain t’es une merde t’as pas été à telle réunion, tu t’es pas engagée sur ce truc ! » Ca m’a permis de dire stop, et de prioriser en voulant rentrer dans un groupe antifa, alors je me suis mis à fond sur La Gale !
ZOE
C’est toujours ça de toute façon, tu prends un ascenseur émotionnel, t’es en haut, et après tu descends, il faut gérer ça… Et je pense que c’est à nous aussi de créer des choses pour contrer cette gueule de bois. L’aspirine ça a été par exemple, de s’implanter dans un quartier, faire un festival anti-
fa, créer des conférences, ces petits trucs pour conscientiser les gens et créer des espaces de solidarité, des choses où tu kiffes sur le moment.
LUCAS
Après ce mouvement, je suis devenu un militant et devenir un militant, c’est chiant ! Tu deviens chiant, tu deviens moribond, tu deviens aigri. Alors que pendant la loi travail, j’étais pas encore un militant, j’étais juste à fond : on partait avec nos potes le matin bloquer le Lycée, la journée on faisait des AG et des manifs, et le soir, on finissait par faire la fête à Nuit debout. On ne savait pas ce qu’on allait faire ni le lendemain, ni de nos vies, on était pleinement engagé au présent. Alors que maintenant, je me pose des questions, je réfléchis stratégie tout le temps : « est ce que ça compte, cette manif ? Est-ce que c’est vraiment intéressant ? ». J’ai été matrixé, formaté par le monde militant. Et du coup il faut rechercher tout le temps à détruire, à sortir du militantisme, ce qui ne veut pas dire sortir de la politique, mais sortir de cette posture presque carriériste, qui te fait un carré dans ta tête et où tu vois tout par le même prisme, où tes idées sont très arrêtées, où t’es moins ouvert à la rencontre… bref t’y crois moins donc ça laisse peu de place pour être étonné, pour être touché par des nouvelles choses… C’est un peu la malédiction de la gauche, le militantisme, c’est le truc qui nous poursuit tous et qu’il faut essayer de détruire, mais qui nous rattrape tout le temps.Mouvement qui va inspirer en France « le bastion social »

NICOLAS NOVA & DISNOVATION.ORG
Bestiaire de l’Anthropocène
Atlas de spécimens hybrides, magnifiquement imprimé à l’encre argentée sur du papier noir, pour rendre compte de la confusion entre la technosphère et la biosphère.
Que se passe-t-il lorsque les technologies et leurs conséquences involontaires deviennent si omniprésentes qu’il est difficile de définir ce qui est « naturel » ou non ? Que signifie vivre dans un environnement hybride composé de matières organiques et synthétiques ? Quels sont les nouveaux spécimens qui peuplent notre planète en ce début de XXIe siècle ? Inspiré par les traités médiévaux et les observations de notre planète endommagée, le Bestiaire de l’Anthropocène est une compilation illustrée de créatures hybrides de notre époque. Conçu comme un manuel de terrain, il propose d’observer, de naviguer et de s’orienter dans le tissu de plus en plus artificiel du monde.
Plastiglomérats, chiens robots de surveillance, fordite, gazon artificiel, arbres antennes, SARS-CoV-2, montagnes décapitées, aigles chasseurs de drones, bananes standardisées... chacun de ces spécimens est symptomatique de l’ère « post-naturelle » dans laquelle nous vivons. Souvent à notre insu, ces créatures se répandent de manière exponentielle et coexistent avec nous.

collection CAT. Recherche
format 11,8 x 16,7 cm, 264 p., broché isbn 978-2-88964-080-5 prix CHF 27 / € 19
ENFIN EN FRANÇAIS !
BEST-SELLER EN ANGLAIS, ESPAGNOL, ET ALLEMAND : 10 000 EXEMPLAIRES VENDUS DANS LE MONDE !


TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos Un bestiaire de l’anthropocène
Règne minéral 13 specimens (fiche et description)
Règne animal 24 specimens (fiche et description)
Règne végétal 12 specimens (fiche et description)
Règne des miscellanées 11 specimens (fiche et description)
Bestiaires Re-nommer, rappeler les créatures
Nicolas Nova
Pierre-Olivier Dittmar
Classification Vers une histoire naturelle des monstres de l’Anthropocène ? Matthieu Duperrex
Artificialité Le plan artificiel Benjamin H. Bratton
Communs recombinants Manifeste pour un laboratoire des communs recombinants Aliens in Green Communs négatifs L’ombre sur Centreville (et bien d’autres territoires) Alexandre Monnin
Paysages anthropogéniques Interventions non-intentionnelles Anna Lowenhaupt Tsing
Vie avec les non-vivants La matière première du monde humain Michel Lussault
Indigestion planétaire Entrez dans l’A.G.E.N.C.E. Center for Genomic Gastronomy
Féralité La disqualification du Roomba féral Pauline Briand
Temporalités Vers un interrupteur gestalt
mot-clés anthropocène, post-humanisme, culture numérique, dark ecology, manuel de terrain arguments libraires/représentants Un best-seller mondial enfin en français. Un sujet d’actualité
Geoffrey C. Bowker
présenté de manière accessible et graphiquement innovante. Une centaine d’illustrations. Des essais amples et engagés.

Nicolas Nova est professeur à la HEAD – Genève où il enseigne et mène des recherches anthropologiques sur les cultures contemporaines liées aux mutations tant numériques qu’environnementales. Il est aussi cofondateur de Near Future Laboratory, une agence de prospective impliquée dans des projets de design fiction. Avec un parcours au croisement des sciences naturelles, de l’anthropologie et des pratiques artistiques, il s’intéresse aux démarches d’enquête entre ethnographie et création.
Traducteur·ices David Algranti (description des spécimens), Phœbe Hadjimarkos Clarke, Yves Citton et Aurélien Blanchard.
Contributeur·ices Nicolas Nova, Pierre-Olivier Dittmar, Matthieu Duperrex, Benjamin H. Bratton, Aliens in Green, Alexandre Monnin, Anna Lowenhaupt Tsing, Michel Lussault, Center for Genomic Gastronomy, Pauline Briand, Geoffrey C. Bowker


Fragments d'une montagne. Les Alpes et leur métamorphose, Le Pommier, 2024
Exercices d'observation, Premier Parallèle, 2022
The Manual of Design Fiction, N. Nova & al., The Near Future Laboratory, 2022
Écologies du smartphone, N. Nova & al., Le Bord de l'eau, 2022
Enquête / Création en design, HEAD Publishing, 2021
Smartphones. Une enquête anthropologique, Mētis presses, 2020
Le miracle Wikipedia, PPUR, 2016
La culture internet des mèmes, PPUR, 2016 8-bit Reggae: Collision and Creolization, éd. Volumiques, 2014
Joypads!: Le design des manettes, N. Nova& al., Les Moutons électriques, 2013
Futurs ? La panne des imaginaires technologiques, Les Moutons électriques, 2014
Pouvoirs des jeux vidéo: des pratiques au discours, éd. Infolio, 2014

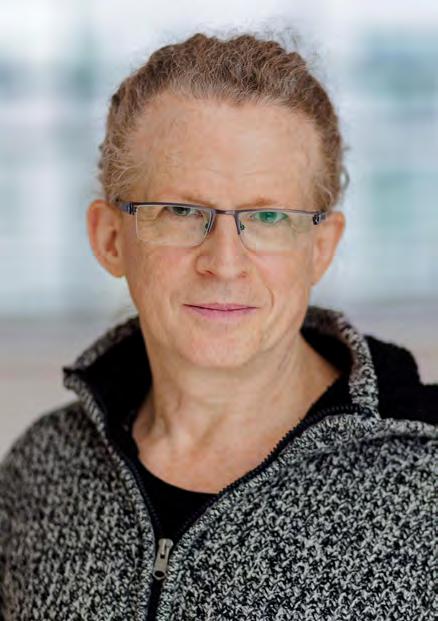
DISNOVATION.ORG est un collectif de recherche créé à Paris en 2012, dont les membres principaux sont Maria Roszkowska (PL/FR), Nicolas Maigret (FR) et Baruch Gottlieb (CA/DE). Leurs actions se situent à l’interface de l’art contemporain, de la recherche et du hacking.
Né à Montréal, Dr. phil. Baruch Gottlieb est un écrivain, conservateur et artiste médiatique basé à Berlin. Formé comme cinéaste à l'Université Concordia, Gottlieb est titulaire d'un doctorat en esthétique numérique de l'Université des Arts de Berlin. Œuvrant dans le domaine de l'art électronique avec une spécialisation professionnelle dans l'art public depuis 1999, Baruch Gottlieb est conservateur à l'institut d'art contemporain néerlandais West Den Haag.
Maria Roszkowska est une graphiste polonaise basée à Paris. Elle a été chercheuse associée à EnsadLab Paris, puis a rejoint le studio de design
graphique Intégral Ruedi Baur. En 2015, elle publie aux côtés de Nicolas Maigret, The Pirate Book, à propos du partage, de la distribution et de l’expérience des contenus culturels hors institution. Nicolas Maigret est un artiste qui travaille dans le domaine des arts numériques et du son depuis 2001. Son travail expose le fonctionnement interne des médias, à travers une réflexion sur leurs erreurs, leurs dysfonctionnements, leurs limites ou leurs seuils d’échec. Après des études en art inter-média, il rejoint le laboratoire LocusSonus en France. Il enseigne à l’École des beaux-arts de Bordeaux et a cofondé le collectif Art of Failure en 2006. Il est également impliqué dans le projet Platforme, un centre d’artistes autogéré à Paris.
Livres récents de Nicolas Nova :