
La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec


La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec















bnc.ca/ingenieur


































Pour souligner le 75e anniversaire du régime d’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada, nous vous offrons, à vous et à votre conjoint ou partenaire, une réduction de taux de 75 % sur toute nouvelle couverture ou couverture additionnelle jusqu’au 31 mars 20241. Les nouveaux proposants peuvent aussi obtenir une couverture additionnelle de 50 000 $ sans frais pendant une période maximale de deux ans2!
L’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada procure une protection financière aux professionnels de l’ingénierie depuis 1948. Obtenez une réduction de taux de 75 % sur les couvertures qui offrent des prestations non imposables pour vous aider, vous et votre famille, à faire face aux imprévus.
Rendez-vous sur le site manuvie.ca/Genium360
Assurance vie temporaire
De plus, demandez une soumission en ligne et courez la chance de gagner une des 12 cartes-cadeaux AppleMD d’une valeur de 750 $3 chacune!
Ou appelez au 1 877 598-2273 pour parler à un conseiller en assurance autorisé Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Assurance Protection accidents graves
Assurance invalidité
supplémentaire d’assurance vie temporaire du participant ou du conjoint. Les taux de prime augmenteront le 1er avril 2024. Pour en savoir plus, visitez le site manuvie.ca/Genium360. La réduction du taux de prime ne s’applique pas à la couverture d’assurance vie temporaire déjà en vigueur.
2 Pour être admissibles à l’offre de couverture d’assurance vie temporaire supplémentaire de 50 000 $ sans frais additionnels pendant une période maximale de deux ans, les membres doivent répondre aux critères d’admissibilité relatifs à l’assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada, soit : avoir entre 18 et 65 ans; demander pour la première fois une assurance vie temporaire parrainée par Ingénieurs Canada; ne pas s’être vu refuser antérieurement par Manuvie une couverture d’assurance vie temporaire; demander et obtenir une couverture d’assurance vie temporaire d’au moins 25 000 $. L’offre s’adresse uniquement aux membres (elle ne concerne pas la couverture du conjoint). Pour obtenir tous les détails, consultez le site manuvie.ca/genium360.
3 Les chances de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus. Un (1) seul bulletin de participation par personne est permis. Un total de douze (12) prix sont offerts. Le ou les gagnants recevront une carte-cadeau AppleMD d’une valeur approximative de 750 $ CA. Il est nécessaire de répondre correctement à la question d’aptitude. Aucun achat n’est requis. Le concours prend fin le 29 février 2024 à 23 h 59 (HE). Consultez le règlement complet du concours au manuvie.ca/reglement75. Apple n’est ni un participant ni un promoteur de cette offre promotionnelle. AppleMD est une marque de commerce déposée d’Apple Inc. Tous droits réservés.
Les régimes d’assurance sont établis par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie).
Manuvie, le M stylisé, et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 2023. Tous droits réservés. Manuvie, P.O. Box 670, Stn Waterloo, Waterloo (Ontario) N2J 4B8.
la communication sont offerts sur demande. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/accessibilite pour obtenir de plus amples renseignements.
1 Les taux de prime ont été réduits de 75 % pour toute nouvelle couverture ou couverture18
L’Humain au cœur des innovations
GÉNIE À LA UNE
Luc Sirois, ing.
L’allumeur d’innovations
L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., met son génie au service de celles et ceux qui créent les nouvelles technologies susceptibles d’améliorer le bien commun.

Voyez comment les innovations technologiques conçues par les ingénieures et ingénieurs du Québec transforment notre quotidien dans des domaines variés tels que le biomédical, le secteur manufacturier ou encore l’émergence des villes intelligentes.

22 28 26
34
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
COIN RH
60 PARCOURS D’ENTREPRISE NUCLEOM
64 66
PROFESSIONNELLE FORMÉE À L’ÉTRANGER
SARAH MOLLIER, ING.
RELÈVE EN GÉNIE
CHLOÉ PILON VAILLANCOURT
Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du Québec a comme mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieures et les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public.
Conseil d’administration
2023-2024
Région 1 • Grande région de Montréal
Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESSG
Sandra Gwozdz, ing., FIC Carole Lamothe, ing.
Béatrice Laporte-Roy, ing.
Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA
Jean-Luc Martel, ing., Ph. D.
Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP
Région 2 • Autres régions
Rédactrice en chef
Sandra Etchenda, réd. a. 514 845-6141, poste 3123 setchenda@oiq.qc.ca
Graphisme
Turcotte design inc.
Photos
Didier Bicep
Chloé Dulude
Israel Valencia
Maquillage
Stéphanie Villemaire
Révision et correction
12 16
68 59
7 71 74 76
COLLOQUE ANNUEL
GÉNIE À L’AFFICHE
ENTREVUE
PATRICK SAVARD, ING.
SAVIEZ-VOUS QUE...
COMITÉS RÉGIONAUX AVIS MOSAÏQUE
NOUVELLE COHORTE D’INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS EN TITRE
Normand Chevalier, ing., M. Ing.
Christine Mayer, ing., M. Sc. A.
Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC
Région 3 • Grande région de Québec
Marco Dubé, ing.
Michel Paradis, ing., M. Sc. 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec
Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA
Alain Larocque, CRHA , ASC
Diane Morin, MBA
Catherine Nadeau
Directeur général
Patrick Savard, ing.
Directrice des communications
Marie Lefebvre
Marie-Andrée L’Allier
Collaboration
Clémence Cireau
Me Martine Gervais
Marie-Julie Gravel, ing.
Pascale Guéricolas
Mélanie Larouche
Valérie Levée
Me Patrick Marcoux
Philippe-André Ménard, ing.
Michel Morin, ing.
PUBLICITÉ
Dominic Desjardins
CPS Média inc.
450 227-8414, poste 309
Plan est publié 6 fois par année par la Direction des communications de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La revue vise à informer les membres sur les conditions de pratique de la profession d’ingénieur et sur les services de l’Ordre. Plan vise aussi à contribuer à l’avancement de la profession et à une protection accrue du public. Les opinions exprimées dans Plan ne sont pas nécessairement celles de l’Ordre. La teneur des textes n’engage que les auteurs.
Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans Plan ne sont en aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. Le statut des personnes dont il est fait mention dans Plan était exact au moment de l’entrevue.
Nous appliquons les principes de la rédaction épicène.
Envoi de Poste-publications • no 40069191
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec • Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0032-0536
Droits de reproduction, totale ou partielle, réservés
® Licencié de la marque Plan, propriété de l’Ordre des ingénieurs du Québec 1801, avenue McGill College, 6e étage
Montréal (Québec) H3A 2N4 514 845-6141 1 800 461-6141 514 845-1833 oiq.qc.ca
Diffusion
63 829
Tirage
16 150 exemplaires
Impression
Imprimeries Transcontinental inc.
Cette revue est imprimée sur du papier carboneutre.
Joignez-vous au réseau LinkedIn de l’Ordre
Échangez sur divers sujets d’ingénierie facebook.com/oiq.qc.ca
Restez branchés sur l’actualité twitter.com/OIQ
Suivez notre actualité en vidéo bit.ly/YoutubeOIQ
Abonnez-vous à notre compte Instagram instagram.com/ordreingenieursqc
Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions plan@oiq.qc.ca
Les contenus de cette édition de la revue Plan ont suscité mon enthousiasme, car au-delà des avancées technologiques spectaculaires, c’est l’élément humain qui resplendit. Les ingénieures et les ingénieurs, passionnés, animés par la quête d’améliorer la vie de chacun, incarnent la puissante énergie motrice de ces révolutions.
L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., véritable catalyseur de progrès, démontre comment l’innovation, loin des cloisonnements, enrichit la vie de tous (son portrait est à découvrir dès la page 18). Ses réalisations passées témoignent de sa vision singulière empreinte d’empathie. Aujourd’hui, son génie continue de se mettre au service de ceux et celles qui innovent, portant le flambeau de l’amélioration collective. Sa fille, également ingénieure en génie électrique, perpétue avec fierté cet héritage exceptionnel.
Luc Sirois sera conférencier le 14 novembre au Colloque annuel de l’Ordre. « Appel à la révolution de l’innovation ! » est le titre de sa conférence, qui promet d’être des plus stimulantes. J’aurai d’ailleurs le bonheur de m’entretenir avec lui sur la scène pour vous parler d’intelligence artificielle.
Autre conférencier au Colloque, l’ingénieur Réjean Bourgault, directeur national du secteur public pour Amazon Web Services Canada. Il abordera la culture de l’innovation chez Amazon, laquelle repose sur des rituels d’équipe et sur l’absolu besoin d’être à l’écoute des clients. L’article à son sujet dans ce numéro donne envie d’en apprendre plus sur la recette originale de ce groupe pour nourrir le potentiel innovant de ses équipes (l’article est à lire à la page 56).
Pour en savoir plus sur la programmation du Colloque annuel 2023, qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal les 13 et 14 novembre, visitez notre site Internet et consultez la programmation dès la page suivante.
Étant adepte du transport collectif, j’ai trouvé extrêmement enrichissante l’entrevue avec Catherine Morency, une ingénieure experte en génie du transport et de la mobilité durable (page 22). La mobilité durable offre de nombreux bénéfices de nature évidement environnementales, mais aussi en matière de santé et de qualité de vie. Dans ce contexte, l’innovation ici repose essentiellement sur notre capacité à repenser nos espaces en plaçant les citoyens et citoyennes au centre de nos préoccupations.

Je souhaite mettre en lumière la détermination de Sarah Mollier (page 64), une jeune ingénieure, ainsi que de Chloé Pilon Vaillancourt (page 66) qui, oui oui, est rappeuse et diplômée en génie physique ! Elles illustrent de manière éloquente l’importance de disposer de figures féminines dans les domaines scientifiques et du génie, afin de stimuler des aspirations d’avenir en tant qu’ingénieure. Je tiens également à saluer leur engagement sans faille envers les enjeux environnementaux.
C’est avec enthousiasme que je souhaite la bienvenue à Patrick Savard, ing., nouvellement nommé directeur général de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ingénieur civil de formation et dirigeant aguerri, son parcours professionnel voué au service public combiné à son style de gestion mobilisateur promettent une direction empreinte d’inclusivité et de progrès (découvrez son parcours ainsi que ses ambitions pour l’Ordre et la profession dès la page 12). Nous sommes ravis d’entamer ce nouveau chapitre guidé par son expertise éclairée et son leadership éprouvé.
De nombreux autres articles captivants méritent votre attention. Je vous encourage à consacrer du temps à parcourir cette édition, qui démontre une fois de plus la dynamique exceptionnelle de notre communauté !
Bonne lecture !
13 14 novembre 2023
Forum 13 novembre
Le génie dans la boucle de l’économie circulaire
L’économie circulaire est essentielle pour un avenir durable. Vous pouvez contribuer à créer un cercle où les produits circulent, en intégrant la durabilité et la réparabilité dès la conception. Venez rencontrer des visionnaires qui présenteront des solutions concrètes à ces défis et des réflexions sur les opportunités qu’offre une transition vers une économie circulaire.


Dîner-conférence 13 novembre
La culture de l’innovation en entreprise, gage de succès

Dîner-conférence 14 novembre

Appel à la révolution de l’innovation !
RABAIS AUX ENTREPRISES
À l’achat d’au moins 5 forfaits de 2 jours obtenez un rabais de 15 % et d’autres avantages.
colloque.oiq.qc.ca
 Animé par Matthieu Dugal
Réjean Bourgault, ing.
Directeur national, Secteur public Amazon Web Services Canada
Luc Sirois, ing., MBA
Innovateur en chef du Québec Conseil de l’innovation du Québec
Animé par Matthieu Dugal
Réjean Bourgault, ing.
Directeur national, Secteur public Amazon Web Services Canada
Luc Sirois, ing., MBA
Innovateur en chef du Québec Conseil de l’innovation du Québec
Lundi 13 novembre 2023
FORUM
8 h 30 à 10 h
Forum : Le génie dans la boucle de l’économie circulaire
Panélistes :
Daniel Normandin, MBA
Jocelyn Doucet, ing., Ph. D., ICD.D Emmanuelle Géhin
CONFÉRENCES 10 h 15 à 11 h 45
Opportunités et défis de la 4e révolution industrielle
Accélérer la transition énergétique sans la faire déraper
Contrer l’espionnage en entreprise : une idée de génie !
L’IA générative bouleversera votre entreprise, mais comment ?
Marc-André Gaudreau, ing., Ph. D.
Pierre-Olivier Pineau, Ph. D.
Francis Coats, ing., PSP, CISSP
Hugues Foltz
Dîner-conférence : La culture de l’innovation en entreprise, gage de succès
Gestionnaires : la clé de la fidélisation
Le jugement, piège ou superpouvoir ?
Gestion stratégique de la santé et sécurité : 20 % d’efforts… 80 % de résultats !
Emilie Pelletier, CRHA Didier Dubois, CRHA
Jorj Helou, CRHA, PCC
Marc-André Ferron
COURS 13 h 45 à 16 h 45
colloque.oiq.qc.ca
Gestion des changements : le rôle de l’ingénieur.e à chaque étape d’un projet de construction afin d’en réduire les coûts
Protocole du CVIIP : savoir évaluer les risques dans un contexte de changements climatiques
L’art de communiquer en situation difficile
Liette Vézina, ing.
Paul Cobb
Isabelle Charron, Ph. D.
Geneviève Dicaire, PCC
Mardi 14 novembre 2023
Comment gérer efficacement son équipe en 2023 ?
Pensée critique : savoir démêler le vrai du faux
Quand votre langage corporel sabote votre crédibilité
Annie Boilard, MBA, CRHA, M. Sc.
Antony Bertrand-Grenier, ing., Ph. D.
Annabelle Boyer, CRHA
COURS 8 h 45 à 11 h 45
La modélisation des données d’infrastructure (MDI-BIM) au service de la gestion des actifs
Attitudes difficiles ou comportements exigeants : apprenez à rester zen !
Leadership transversal : comment exercer son influence sans autorité formelle ?
Dîner-conférence : Appel à la révolution de l’innovation !
Nathalie Oum, ing., Ph. D.
Paule Marchand, MBA
Laurent Vorelli, CRHA, MBA
COURS 13 h 45 à 16 h 45
Habiletés relationnelles et intelligence émotionnelle : des clés pour générer de la confiance et mobiliser les équipes
Professionnelles et professionnels en gestion de l’énergie 101
Relations professionnelles : communiquer efficacement en toutes circonstances
Comment améliorer sa performance au travail ?
Aborder les différences générationnelles de manière inclusive
Gestion de projet : faire un pas de recul pour améliorer sa capacité décisionnelle
Mylène Beauchamp, ACC
Maelys Fillon, ing.
Tania Laurendeau
Dominique Larouche, CRIA
Martine Lafrance, CRHA
Raymond Desbordes, ing.
13 14 novembre 2023
Partenaire principal
Autres partenaires
colloque.oiq.qc.ca

Engagement social Entrepreneuriat
Projet d’ingénierie
Innovation technologique
Présentez-nous des candidatures jusqu’au 1 er décembre 2023
bit.ly/oiq_prix
MAESTR
Vous connaissez des ingénieures ou ingénieurs qui se démarquent ?
Développez votre capacité d’adaptation et mieux communiquer
Adaptabilité et agilité : apprivoiser le changement


formations virtuelles 1h 1h
Au-delà des mots : communiquer avec plus d’impact
oiq.qc.ca/maestro
Depuis le 14 août dernier, Patrick Savard, ing., est le nouveau directeur général de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ce gestionnaire expérimenté, qui a fait carrière dans le domaine municipal, rejoint l’Ordre avec enthousiasme et animé par la volonté de servir sa profession, les membres et le public.
Si l’on devait écrire un livre sur sa vie, « Faire contre mauvaise fortune bon cœur » pourrait être le titre d’un chapitre de l’histoire de Patrick Savard. En effet, rien ne le prédestinait à la remarquable carrière qu’il s’est construite au cours des 30 dernières années.
Issu d’une famille de la classe moyenne de MontréalNord, Patrick Savard n’avait pas d’ingénieurs ou de professionnels dans son entourage. « Dans le quartier de Montréal-Nord où j’ai grandi, les professions telles que celles d’ingénieur, d’avocat, de médecin ou de comptable étaient peu communes. On n’avait pas de modèles à suivre dans ces domaines, se souvient-il. Ma famille et les gens de mon entourage occupaient des emplois dits plus opérationnels. » Malgré ce contexte, celui qui au début de son adolescence travaille comme camelot à La Presse a la ferme volonté de suivre un chemin différent en poursuivant des études supérieures. Mais n’allons pas trop vite !
Durant cette période, Patrick Savard se trouve des emplois d’été dans des usines pour financer ses futures études. « Ces expériences m’ont énormément motivé à persévérer à l’école afin de me forger la carrière que je désirais, raconte-t-il. Ces emplois d’été m’ont permis de comprendre l’importance des études et j’y ai puisé la volonté et les outils nécessaires pour choisir ma future profession. C’est ainsi que j’ai décidé de me tourner vers l’ingénierie, car j’avais toujours eu un intérêt marqué et une facilité pour les sciences pures telles que les mathématiques, la physique et la chimie. »


Alors, à 20 ans, il intègre la très réputée École Polytechnique de Montréal en 1987 pour y étudier le génie civil.
Son diplôme en poche, Patrick Savard occupe pendant deux ans divers postes dans l’arrondissement de Montréal-Nord en tant que contractuel, mais la récession du début des années 1990 rend difficile la recherche d’emploi en génie civil. Alors, contre mauvaise fortune bon cœur, le jeune ingénieur se lance dans des études en gestion à HEC Montréal, où il obtient en 1996 une maîtrise en administration des affaires (MBA) après cinq années d’études menées en parallèle de sa carrière municipale entreprise dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la foulée, il accède à son premier poste de directeur général à tout juste 28 ans. Ainsi commence une carrière prometteuse en tant que gestionnaire et dirigeant.
Pendant 27 ans, l’ingénieur occupera les postes de directeur général dans plusieurs municipalités de la grande région de Montréal… par choix. « Tout au long de ma carrière, chaque fois que j’ai accepté un nouveau poste, j’ai pris soin de ne pas déplacer ma famille, car il était primordial pour moi de maintenir notre stabilité et de ne pas perturber la vie de mes enfants en les faisant changer d’école ou de foyer, dit-il. Ainsi, j’ai toujours décliné les propositions de travail dans des régions plus éloignées telles que Trois-Rivières, Québec ou ailleurs. »
Son parcours de gestionnaire culmine lorsqu’il devient, en 2014, directeur général de la Ville de Longueuil. Ce poste, il l’occupera pendant huit ans, jusqu’en 2022.
Ingénieur-gestionnaire ou gestionnaire-ingénieur ?
Patrick Savard n’en a cure ! Pour lui, il est avant tout un ingénieur. « Bien que j’aie peu d’expérience pratique en
tant qu’ingénieur de terrain parce que j’ai fait le choix d’une carrière de gestionnaire, je reconnais que ma formation en ingénierie a constitué la base de toute ma trajectoire professionnelle. Cette formation m’a permis d’acquérir une approche analytique et pragmatique pour accomplir les tâches de gestionnaire, ainsi que des qualités éthiques et une capacité à résoudre des problèmes complexes, atouts essentiels pour diriger des organisations, notamment dans le domaine municipal qui constitue un des domaines de gestion les plus complexes », affirme l’ingénieur.
« Tout au long de ma carrière, il m’a toujours paru important de conserver mon titre de membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et fierté que je rejoins l’organisation à titre de directeur général afin de relever de nouveaux défis. »
Des défis, Patrick Savard en a eu de nombreux pendant sa fructueuse carrière de gestionnaire dans la fonction publique municipale. Quand on lui demande quelles sont les réalisations dont il est le plus fier, c’est naturellement qu’il parle au « nous » pour décrire le travail accompli avec ses équipes.
« Les réalisations les plus significatives ne sont pas toujours les plus visibles, mais elles ont été essentielles pour mon développement professionnel, admet-il. Dans les villes de Longueuil et de Brossard, nous avons par exemple amélioré le service à la clientèle en mettant en place des centres de services aux citoyens, offrant un point de contact unique pour répondre aux demandes des résidents. Sur le plan stratégique, nous avons élaboré, avec les élus, les employés et la population, des plans qui ont donné naissance à des projets concrets tels que le développement de Solar Uniquartier, le développement de la zone aéroportuaire de Longueuil et l’arrivée de la brasserie Molson sur notre territoire. Enfin, la mise en place de plusieurs
démarches d’amélioration continue au sein de diverses villes a eu des impacts positifs sur les municipalités. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à un travail d’équipe et une mobilisation des employées et employés au profit des citoyennes et citoyens. »
Pour Patrick Savard, les réalisations professionnelles prennent tout leur sens lorsqu’elles s’intègrent harmonieusement à sa vie personnelle. « Je suis quelqu’un
de discret, stable et centré sur l’harmonie entre ma vie personnelle, mes activités professionnelles et mes passions, reconnaît-il. Je suis un grand passionné de golf, je pratique aussi la natation et j’adore la littérature. Ma famille et mes proches sont essentiels à mon équilibre ! Mon parcours professionnel a toujours été guidé par ma quête d’excellence et d’équilibre ; mon arrivée à l’Ordre est une continuation dans cette voie. »
Patrick Savard, ing., est titulaire depuis 1991 d’un baccalauréat en génie civil de l’École Polytechnique de Montréal. Il a obtenu en 1996 une maîtrise en administration des affaires (MBA) de HEC Montréal. Depuis 2021, il est également détenteur d’une certification d’administrateur de sociétés (ASC) de l’Université Laval. En 2019, il a été lauréat du prix Distinction de l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec.

Dates clés de son parcours professionnel
• De 1990 à 1992, il occupe des emplois à la Ville de Montréal-Nord en tant qu’étudiant et contractuel.
• En 1993, il est ingénieur aux services techniques de la municipalité de Saint-Athanase, qui a depuis été fusionnée avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Il en devient directeur général en 1996.
• De 1999 à 2002, il est directeur des services urbains de la Ville de Sainte-Julie.
Pendant 20 ans, de 2002 à 2022, Patrick Savard occupe le poste de directeur général dans plusieurs villes :
• de 2002 à 2004, à Lorraine ;
• de 2004 à 2010, à Mont-Saint-Hilaire ;
• de 2010 à 2014, à Brossard ;
• et de 2014 à 2022, à Longueuil.
Depuis 2022, l’ingénieur est président du Conseil d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
Côté vie personnelle, Patrick Savard et sa conjointe sont les parents de deux jeunes femmes dans la vingtaine, toutes deux avocates.
« Tout au long de ma carrière, il m’a toujours paru important de conserver mon titre d’ingénieur. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme et fierté que je rejoins l'Ordre à titre de directeur général. »
Patrick Savard, ing. Ordre des ingénieurs du Québec
Patrick Savard, ing., revient sur son parcours et les motivations qui l’ont poussé à relever le défi d’occuper la direction générale de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il parle avec sincérité de ses aspirations pour l’organisation et de l’avenir de sa profession.
Plan : En tant qu’ingénieur, quelles étaient vos impressions sur l’Ordre avant d’en devenir le directeur général, et qu’est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste ?
Je suis membre de l’Ordre depuis 1991 et au fil du temps, ma perception de l’organisation a grandement évolué, notamment depuis l’arrivée de Kathy Baig, ing., et de Sophie Larivière-Mantha, ing., à la présidence. Avant cette période, je dois admettre que de l’extérieur on pouvait percevoir une certaine instabilité, mais heureusement, cela s’est considérablement amélioré. C’est cette transformation positive de l’Ordre qui m’a encouragé à accepter le poste de directeur général, un rôle que je connais bien pour avoir dirigé plusieurs organisations municipales.
Pour moi, le type d’organisation pour laquelle je travaille revêt une grande importance, tout comme les valeurs qu’elles soutiennent et les personnes avec qui je collabore au quotidien. J’ai particulièrement apprécié mes interactions avec les membres du Conseil d’administration, l’équipe de direction, les employées et employés ainsi que la présidente, avec qui j’ai eu de nombreux contacts. Je dois dire que notre communication est excellente, sa passion et son énergie sont contagieuses, ce que j’apprécie énormément !
Plan : Quelle est votre vision de votre rôle au sein de l’organisation ?
En tant que directeur général, je veux contribuer positivement au leadership de l’Ordre et à son rayonnement
en collaborant étroitement avec le Conseil d’administration, l’équipe de direction et l’ensemble des employées et employés. Avec mon énergie et mes valeurs, je souhaite pouvoir inspirer les personnes avec qui je travaille et être capable de les aider à participer à la mission de l’Ordre ainsi qu’à la réalisation de sa vision et de ses objectifs. Je veux les soutenir dans l’accomplissement de leur travail afin que toutes et tous se sentent pleinement partie prenante de la réalisation des objectifs organisationnels et du plan stratégique. Cela implique de ma part une écoute active et attentive et la capacité de déceler ce qui n’est pas explicitement exprimé.
Tout au long de ma vie professionnelle, je me suis trouvé dans une grande variété de situations, certaines de l’ordre des relations humaines et d’autres, tout aussi exigeantes, ayant un caractère exceptionnel, comme des événements qui requièrent des mesures d’urgence ou des décisions opérationnelles dans des contextes inconnus. La gestion de la crise du verglas à Iberville–Saint-Jean-sur-Richelieu en 1998 alors que j’étais un jeune directeur général, et les mesures d’urgence mises en place à Longueuil pendant la « crise de l’eau » et la pandémie sont de bons exemples. Dans ces moments, le « courage managérial » s’est avéré essentiel pour prendre des décisions difficiles en fonction du contexte et des situations tendues à plus d’un niveau.
J’ai toujours accordé une grande importance à la communication, que ce soit dans un contexte individuel, en équipe restreinte ou en équipe élargie.
Durant mes premiers mois à l’Ordre, je serai une éponge ! Je m’adapterai à ce nouvel environnement et serai à l’écoute, en m’inspirant beaucoup de l’équipe en place qui est très mobilisée et avec qui les échanges sont intéressants.
Plan : Comment contribuerez-vous à la réalisation des objectifs de l’Ordre ?
Nous sommes à la fin du Plan ING 2020-2025, il faudra très vite amorcer la réflexion pour définir avec le Conseil d’administration la prochaine planification quinquennale. Ayant déjà réalisé cet exercice à plusieurs reprises dans les organisations où j’ai travaillé, je suis convaincu que mon expérience dans le service public peut contribuer positivement à la réalisation de l’actuel plan et à la préparation de la prochaine planification.
De façon générale, j’ai une approche proactive et je m’engage sincèrement dans ce que je fais ; c’est pourquoi, avec l’équipe interne, je m’impliquerai activement dans la réalisation de nos objectifs organisationnels.
Plan : Selon vous, où en seront l’Ordre et la profession dans cinq ans ?
En tant que directeur général, je garde toujours en tête la raison d’être de notre organisation : encadrer la pratique de la profession, soutenir son développement et protéger le public. J’ai la conviction que dans cinq ans,
l’Ordre sera en meilleure position qu’il ne l’est actuellement grâce au dynamisme et au travail accompli ces dernières années par le Conseil d’administration et les employées et employés.
Au cours des prochaines années, je suis persuadé que nous aurons progressé pour relever les défis auxquels la profession et l’Ordre doivent faire face à court et moyen termes à savoir : la lutte contre les changements climatiques, les incidences de l’intelligence artificielle dans la pratique du génie et la promotion de la profession auprès de la relève, afin de faire face à la rareté de la main-d’œuvre. De gros chantiers en perspective pour l’Ordre et la profession !
D’autre part, j’ai été très impressionné par l’engagement exceptionnel des femmes et des hommes qui travaillent avec beaucoup de détermination à l’Ordre. La mobilisation du personnel à 95 % est une situation véritablement exceptionnelle, et je nourris l’espoir qu’elle sera encore aussi forte dans cinq ans et que nous continuerons à maintenir la cohésion des employées et employés.
Les fruits des efforts déployés et notre volonté de toujours progresser me permettent d’espérer qu’à cette échéance, nous aurons consolidé notre rôle au service d’une profession forte, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.»

L’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, ing., met son génie au service de celles et ceux qui créent les nouvelles technologies susceptibles d’améliorer le bien commun.

Par Pascale Guéricolas
Photos : Israel Valencia, Chloé Dulude et Didier Bicep
La lecture du curriculum vitæ de Luc Sirois donne l’impression que cet ingénieur en génie électrique de formation a réussi l’impossible : combiner plusieurs vies professionnelles en une. Il cumule en effet des formations et des expériences de travail variées, aussi bien dans le domaine des télécommunications que dans le secteur de la stratégie de haut vol et dans l’univers de la technologie de la santé.
Dès la fin de son baccalauréat à l’Université McGill en 1991, le diplômé se distingue. Deuxième parmi 391 étudiants, il reçoit notamment la bourse Krashinsky de l’Ordre pour son implication communautaire et sa vision du rôle de l’ingénieur dans la société. Rapidement, le voici directeur marketing multimédia chez Bell, chargé d’un réseau à haute vitesse pour l’industrie des médias. Ce sujet le passionne à un tel point qu’il suit en parallèle des cours de journalisme à l’Université de Montréal, au grand étonnement de ses professeurs.
« Je savais que le monde des médias allait être profondément transformé par les télécommunications, qui s’apprêtaient à vivre un combat de titans entre des chefs de file comme Bell et Vidéotron », se souvient Luc Sirois. Ce désir de parfaire ses connaissances, cette soif intense d’apprendre caractérise d’ailleurs ce curieux de nature qui, enfant, dévorait les manuels d’électronique.
L’envie de mieux comprendre les rouages du monde de la finance internationale le conduit alors à l’Université Harvard. Fils d’une famille modeste, il n’hésite pas à mettre de côté une carrière prometteuse pour apprendre à frayer avec les meilleurs en faisant un MBA dans cet établissement renommé. Là encore, ce travailleur infatigable performe en terminant parmi les 5 % des étudiantes et étudiants de sa promotion qui se démarquent par l’excellence de leurs résultats.
À ce stade de l’histoire, il est facile d’imaginer Luc Sirois propulsé dans les hautes sphères de multinationales comme Apple ou Microsoft, qui courtisent les finissants et finissantes de Harvard. Erreur. Un autre trait de sa personnalité concerne son attachement au Québec et son intention de contribuer à son essor pour les prochaines générations. L’affaire est entendue, la famille rentre à Montréal. Conseiller en commerce électronique, stratège en transformation et innovation pour de grandes entreprises, l’ingénieur se trouve aux premières loges d’une forte croissance pour le cabinet McKinsey nouvellement établi à Montréal.
Fort de sa capacité comme ingénieur à imaginer l’avenir à partir d’une boîte noire tout en maîtrisant sur le bout des doigts le langage des affaires, Luc Sirois possède les meilleurs outils. Il conseille donc des clients au
Québec, mais aussi en France, en Angleterre, en Suisse, sur la façon de s’engager sur l’autoroute de l’information. Arrive l’année 2001. Une grande partie du monde des télécommunications s’effondre. Ces années noires donnent l’idée au diplômé en génie électrique de laisser libre cours à ses aspirations d’entrepreneur et de s’orienter vers la santé. À la différence des télécommunications, les besoins dans ce domaine ne fluctuent pas selon les cycles économiques. Un ami lui présente alors un chercheur de l’Hôpital général de Montréal qui vient de mettre au point une technologie d’imagerie médicale en 3D prometteuse. Son but : mieux cibler les radiations nécessaires pour traiter efficacement les cancers par radiothérapie.
Bénéficiant d’une bonne réputation, le cofondateur de Resonant Medical convainc les investisseurs de se lancer dans cette aventure, sans savoir que le monde médical réserve quelques surprises pas forcément agréables. « Aujourd’hui, je mets en garde les jeunes entrepreneurs que je coache, car il s’agit d’un univers extrêmement complexe, explique Luc Sirois. Par exemple, le personnel médical, donc l’utilisateur, a beau reconnaître la valeur d’un nouvel équipement, il faut qu’une compagnie d’assurances intervienne avant de conclure l’achat, et il faut aussi convaincre la direction de l’hôpital. Ce qui ajoute plusieurs paliers à la vente. »
Détentrice de toutes les autorisations nécessaires, son entreprise a d’ailleurs dû vendre avec succès son équipement à 175 hôpitaux de partout dans le monde avant de persuader un premier établissement médical québécois d’acquérir cet équipement valant près de 500 000 dollars. D’autres se seraient peut-être découragés. Sauf que l’entrepreneur dispose d’une arme secrète, une force de caractère et intellectuelle forgée durant ses difficiles études en génie électrique. « Je compare ces études à l’intensité d’un entraînement militaire, confie l’ingénieur. Les concepts sont très théoriques, et cela développe la discipline et le muscle intellectuel pur. »
Après quelques années de succès, les cofondateurs vendent Resonant Medical à un groupe suédois, qui devient Elekta Canada. L’ingénieur met alors son talent et ses connaissances au service d’autres entreprises comme Telus ou Telesystem pour créer des modèles de technologies novateurs dans le domaine de la santé numérique. Ce travail est exaltant pour un professionnel qui carbure à la passion, mais suscite aussi son lot de frustrations. « L’archaïsme du système de santé s’avère souvent décourageant, reconnaît l’innovateur en chef. Contrairement au reste du marché, les innovations technologiques s’y déploient trop lentement, même si elles seraient extrêmement utiles. »
Luc Sirois, ing., nous parle de son implication auprès des jeunes et de l’intelligence artificielle dans le monde de l’éducation. Pour voir la vidéo : https://bit.ly/Luc_Sirois_ing
C’est en grande partie pour vaincre ces défis et parce qu’il souhaite améliorer la société que l’entrepreneur amorce un nouveau chapitre en 2012, en fondant une organisation sans but lucratif, Hacking Health. Il s’agit de susciter la créativité de citoyennes et citoyens, de professionnelles et professionnels, de communautés capables de faire bouger technologiquement les choses. Un réseau de personnes influentes actives dans une soixantaine de villes à travers le monde portent cette organisation. Un système de messagerie facilitant le référencement entre professionnelles et professionnels de la santé en Alberta, une application québécoise pour obtenir des diagnostics plus précis en orthophonie, et bien d’autres solutions novatrices émergent de ces rencontres.
Cette capacité à faire collaborer des gens évoluant dans des univers très différents, Luc Sirois la compare à l’exercice de l’ingénierie. « Au fond, on peut mettre sur pied des organisations humaines qui sauront déployer les talents de chacun et de chacune, un peu de la même façon qu’on crée une nouvelle technologie, déclare avec enthousiasme l’innovateur en chef du Québec. C’est fou ce que les gens peuvent accomplir en travaillant ensemble. »
C’est justement dans le but de s’impliquer dans la société québécoise que Luc Sirois a accepté les postes de conseiller stratégique à l’innovation auprès du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, puis d’innovateur en chef du Québec, qu’il occupe depuis

2020. Son rôle, et celui du Conseil de l’innovation qu’il a créé avec le ministère, est de développer l’innovation au sein des entreprises et de la société québécoise, dans une province qui dispose d’une grande force de frappe en recherche publique. Avec son équipe, Luc Sirois a d’ailleurs permis de fonder Axelys, une nouvelle société de valorisation pour dénicher et commercialiser les découvertes. Il peut s’appuyer sur une nouvelle stratégie gouvernementale en innovation dotée d’un budget de 7,5 milliards de dollars, une stratégie qu’il a largement contribué à dessiner à partir d’une consultation de centaines d’entreprises et d’organismes de l’écosystème.
Luc Sirois et son équipe ont mis en œuvre, avec des partenaires dans toutes les régions, un réseau de conseillères et conseillers en innovation. Ce réseau permet de rapprocher les entreprises des chercheurs et chercheuses et de les aider à trouver du financement.
Ce grand intérêt pour les inventions n’empêche pas l’innovateur en chef de garder la tête froide devant la révolution que constitue l’intelligence artificielle. La preuve, le groupe d’une quinzaine d’expertes et experts – dont la présidente de l’Ordre – qu’il a mis en place pour orchestrer une réflexion collective sur les enjeux et l’encadrement de l’IA. Le but est d’assurer le développement et l’utilisation responsable en société de cet outil, et de déterminer comment se préparer à son implantation. Une fois encore, Luc Sirois met l’être humain au centre de ses préoccupations en contribuant à susciter la créativité et l’engagement des gens et des organisations qui l’entourent.
« Je compare mes études en génie à l’intensité d’un entraînement militaire. Les concepts sont très théoriques, et cela développe la discipline et le muscle intellectuel pur. »
Luc Sirois, ing. Conseil de l’innovation du Québec
Énergir cherche à identifier et faire émerger de nouvelles solutions, technologies et approches innovantes permettant une utilisation plus efficace du gaz naturel pour ses clients.
Soumettez votre projet pour l’un des thèmes en efficacité énergétique suivants :
1. Solutions intégrant l’intelligence numérique
Solutions qui permettent d’identifier des mesures en efficacité énergétique, déployer un système de gestion avancé de l’énergie ou optimiser le contrôle et la maintenance du bâtiment et des procédés.
2. Technologies efficaces au gaz naturel
Technologies de thermopompes à gaz naturel ou systèmes hybrides à très haute efficacité.
3. Projets novateurs d’énergies renouvelables
Solutions innovantes d’énergies renouvelables en complémentarité avec l’utilisation du gaz naturel traditionnel; mesures de récupération de chaleur des rejets thermiques et conception de boucles énergétiques.
4. Autres types de projets recherchés
• Utilisation plus efficace du gaz naturel comme carburant dans les transports
• L’efficacité énergétique dans la production en serres
• Optimisation d’un procédé industriel
Votre projet pourrait être admissible au programme Innovation s’il présente un haut niveau d’incertitude ou de risques associés à un des aspects suivants :
• la performance énergétique
• la faisabilité technique
• l’acceptabilité ou l’intégration auprès des utilisateurs
Recevez jusqu’à
75 %
des coûts de réalisation de projets Obtenez une subvention allant jusqu’à
250 000 $
Pour connaître les critères d’admissibilité du programme, visitez notre site Internet
Soumettez vos idées ou votre projet à notre équipe efficaciteenergetique@energir.com
























Pierre angulaire de la « ville intelligente », la mobilité durable vise à permettre aux citoyens et citoyennes d’accéder rapidement aux services clés répondant à leurs principaux besoins ainsi qu’à leur lieu de travail. Où en est le Québec dans la mise en place des mesures pour arriver à une mobilité urbaine plus durable ?
Par Mélanie LaroucheJusqu’à présent, le développement urbain a été pensé tout autrement. Pour les futures agglomérations urbaines, il ne s’agit pas d’une « mission impossible », mais pour les villes existantes, le virage comporte maints obstacles. Pour l’heure, si les cibles sont claires et fort louables, les orientations et les stratégies pour les atteindre souffrent d’un manque de cohérence.
Experte en génie du transport et de la mobilité durable, Catherine Morency, ingénieure et professeure à Polytechnique Montréal, souligne d’entrée de jeu que le concept de ville intelligente n’est pas systématiquement lié à la technologie. « Ici, l’intelligence se rapporte aussi à la logique derrière la conception des quartiers et des réseaux de transport. Mais il est vrai que les technologies, notamment tout ce qui tourne autour des données et de l’analyse de données au moyen de différentes approches d’intelligence artificielle et d’instrumentations, sont centrales dans les villes intelligentes. Elles viennent agir en appui et comme accélérateur des transformations sociales et urbaines. »
Cinq axes de développement sont abordés en priorité pour planifier intelligemment ou durablement une ville, explique Catherine Morency. « On tient compte de la densité de population, de la diversité dans les usages du territoire, du design des réseaux de rues en fonction de ces usages, de l’accès rapide aux destinations clés (services de proximité) et des distances d’accès au transport en commun. Forcément, la mobilité des gens est au centre des préoccupations lorsque vient le temps de concevoir une ville intelligente. »
« Certes, le Québec s’est démarqué avec l’implantation précoce de modes de transport écoresponsables, note Catherine Morency. En effet, la province a été une
pionnière en Amérique du Nord en proposant en 1994 un service d’autopartage, avec la compagnie Communauto, et également avec l’offre de vélos en libre-service BIXI. Bien qu’elles soient difficiles à mesurer, les retombées ont été considérables ; on a constaté un enthousiasme notable et la modification des comportements favorisant la durabilité. Aujourd’hui, la multimodalité est en croissance. Certaines villes sont plus innovantes, même si les stratégies provinciales ne sont pas toujours des accélérateurs de transformation. Il faut cependant applaudir plusieurs initiatives locales ; pensons à toutes les infrastructures cyclables mises en place et aux efforts pour mieux partager l’espace dans plusieurs villes du Québec. »
À ce titre, Montréal fait bonne figure, ses parts modales pour le transport en commun sont parmi les plus élevées en Amérique du Nord. La métropole se classe au 16e rang mondial pour son réseau de transport en commun et au 2e rang en Amérique du Nord, après New York. « Bien ancré autour de son métro, ce réseau a contribué à un développement urbain plus judicieux », indique Catherine Morency.
En 2018, le Québec s’est doté de la Politique de mobilité durable – 2030 pour orienter ses décisions, mais, selon Catherine Morency, celle-ci présente un problème d’incohérence dans les cibles. « Les projets présentement mis de l’avant et les cibles à atteindre en matière de développement durable sont en dissonance, soutient-elle. Qui plus est, on ne considère pas la mobilité de tout le monde, on néglige celle des enfants, des personnes aînées et des personnes à mobilité réduite. La marche n’est pas suffisamment prise en compte ; pourtant, elle joue un rôle majeur dans la qualité de vie, la santé des gens, l’autonomie
des enfants. Il importe de favoriser des modes de vie actifs dans les façons d’organiser notre réseau de transport. Actuellement, les stratégies sont centrées presque exclusivement sur les travailleurs et les travailleuses. En outre, les solutions n’impliquent pas la réduction du nombre d’autos alors que c’est la clé de la mobilité durable. »
Catherine Morency est d’avis qu’actuellement, en matière de transport, le Québec s’en va dans la direction opposée des cibles à atteindre. « Le nombre de voitures croît plus rapidement que la population, c’est illogique. On ne voit pas vraiment de stratégie pour réduire la taille du parc de véhicules au Québec. Au contraire, les gens ont accès à divers incitatifs pour acquérir des voitures. Et ce n’est pas qu’une question de nombre, mais aussi de taille des voitures. La popularité des véhicules utilitaires sport a des conséquences importantes sur l’espace nécessaire, les accidents graves, la consommation d’essence, etc. Les messages sont contradictoires : on finance l’achat de véhicules verts, mais il n’y a pas d’incitatifs financiers pour ceux et celles qui font l’effort de restreindre l’utilisation de la voiture et de se déplacer autrement. »

Cette année, le Québec a lancé le plan de mise en œuvre 2023-2027 de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire. « On se rapproche un peu ici de ce qui s’apparente à une ville intelligente, précise la professeure Morency, qui siège au Comité consultatif sur les changements climatiques. Mais il faut savoir que les problèmes de transport découlent souvent de mauvaises décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Dans les nouveaux quartiers, on doit planifier en tenant compte des effets sur les besoins de mobilité et faciliter l’adoption de comportements durables. »
Les impacts des changements climatiques sont réels et doivent être considérés très sérieusement dans l’aménagement des villes. « La réalité des changements climatiques oblige le gouvernement à être plus ferme dans ses stratégies, insiste-t-elle. Les choix d’aménagement du territoire doivent être compatibles avec l’objectif du Québec d’atteindre la carboneutralité et de renforcer sa résilience climatique. La Politique doit marquer un tournant majeur par rapport aux pratiques antérieures et devenir un puissant outil à la fois d’adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Il est nécessaire de renverser les tendances en cours au Québec. »
« Forcément, la mobilité des gens est au centre des préoccupations lorsque vient le temps de concevoir une ville intelligente. »
Catherine Morency, ing. Polytechnique Montréal


Parler d’argent entre amis ou en famille est parfois malaisant. Mais sur le plan professionnel « toute peine mérite salaire », et la question des honoraires est incontournable.
Plusieurs articles du Code de déontologie des ingénieurs (CDI) traitent des honoraires. De plus, à l’intention du public, l’Ordre des ingénieurs du Québec a mis en place une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes d’honoraires pour les clients qui sont en désaccord sur le coût des services professionnels rendus. Comme quoi le sujet n’est pas sans importance.
D’abord, lorsqu’il est question d’argent, il vaut toujours mieux s’entendre avec autrui au début d’une relation contractuelle, au moment où le climat est encore serein. À ce sujet, le CDI prévoit d’ailleurs que « [l]’ingénieur doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement » (article 3.08.03).
Pour ce qui est des modalités de paiement, c’est un aspect non négligeable. Car, rappelons-le, les ingénieurs et les ingénieures ne jouissent pas au préalable d’un droit de rétention comme d’autres prestataires de services1. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué le
Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (CDOIQ) dans une récente décision (CDOIQ 22-22-0677, Ingénieurs c. Rondeau, 19 juin 2023) concernant un ingénieur qui avait exigé le paiement de ses honoraires avant de transmettre son rapport d’expertise2
Une fois le travail accompli, exiger le paiement en tout ou en partie pour les tâches effectuées avant de livrer le résultat partiel ou final peut être une pratique commerciale défendable. Mais une telle façon de faire doit impérativement être convenue à l’avance, de façon explicite, et idéalement par écrit.
Est-ce à dire que l’on peut tout convenir entre les parties dans un contrat ? Comme le paiement d’avance des honoraires, en tout ou en partie, ou encore un escompte en contrepartie d’une avance ? Que non ! Ici, le CDI est explicite et directif : « [L’ingénieur] doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires […] » (article 3.08.03).
Il y a quelques années, le CDOIQ s’est d’ailleurs prononcé catégoriquement contre une telle pratique (CDOIQ 22-20-0636, Ingénieurs c. Ki Hong Kim, 17 novembre 2021) :
« [42] Les manquements déontologiques mettant en cause les devoirs et obligations de l’ingénieur envers le client sont graves puisqu’ils contreviennent à des exigences imposées […] pour éviter que l’aspect mercantile inhérent à l’exercice de la profession l’emporte sur le professionnalisme attendu de l’ingénieur. »

« [46] Ainsi, le fait pour un ingénieur d’exiger du client le paiement par anticipation d’une partie substantielle de ses honoraires sans avoir livré l’information attendue des clients ou sans avoir fourni une prestation de services […] place ce dernier dans une situation de plus grande vulnérabilité et va à l’encontre de la protection du public. »
« [47] Cette conclusion s’explique par le fardeau supplémentaire qu’une telle pratique impose au client alors qu’il existe déjà une disproportion dans le rapport de force entre ce dernier et l’ingénieur […] ».
Il n’y a rien de déshonorant ou de vénal à parler d’argent avec un éventuel client ; c’est pourquoi dans les pourparlers pour convenir d’un mandat, les questions d’argent ne devraient jamais être esquivées ou négligées. Tous les aspects pécuniaires devraient être abordés et convenus dès le départ (contrat à forfait ou à taux horaire, niveau et ampleur prévisible des honoraires, modalités de paiement, fréquence et détail de la facturation, échéances clés et facturations correspondantes, retenus de livrable à défaut de paiement, etc.).
Car si la relation contractuelle s’envenime, non seulement l’ingénieure ou l’ingénieur concerné risque un certain appauvrissement, mais il ou elle pourrait devoir répondre de ses actions ou de ses omissions devant le CDOIQ.
Et comme le mentionne le CDOIQ dans la décision précitée (CDOIQ 22-20-0636, Ingénieurs c. Ki Hong Kim, 17 novembre 2021) :
« [56] […] cela risque aussi de nuire à la crédibilité de la profession en semant un doute dans l’esprit des clients et du public quant à savoir si les ingénieurs en général sont dignes de confiance. »
1. Par exemple, un garagiste a le droit, sauf en certaines circonstances, de retenir le véhicule d’un client jusqu’à ce que ce dernier ait payé le prix total des réparations.
2. Bien que déclaré coupable à l’égard de l’article 3.08.03 du Code de déontologie des ingénieurs, pour des raisons juridiques, l’ingénieur a été sanctionné en fonction de l’article 3.03.02 : « L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. »
à la surveillance de la pratique illégale
Les manuels d'opération et d'entretien jouent un rôle essentiel dans le domaine de l'ingénierie. Ce sont des documents clés qui fournissent des informations indispensables sur le fonctionnement, l’entretien et la sécurité des équipements, des systèmes et des procédés.
Pour les ingénieurs et les ingénieures, la préparation de ces manuels est une tâche cruciale qui garantit une utilisation sûre et efficace des ouvrages qu’ils et elles conçoivent. L’importance de ces documents pour la sécurité du public est reconnue dans la Loi sur les ingénieurs puisque, depuis 2020, ils font nommément partie de la liste des documents d’ingénierie dont la préparation est réservée aux ingénieures et aux ingénieurs.
Mais comment s’applique la Loi dans le cas où un manuel d’entretien doit être modifié pour tenir compte de nouvelles fonctionnalités ? Les manuels fournis avec des équipements conçus et fabriqués hors du Québec peuvent-ils être utilisés tels quels ici ? C’est ce dont nous discuterons dans cette chronique.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la section XXI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail le 27 juillet 2023, il est maintenant requis que toute machine soit accompagnée d’un manuel d’instruction du fabricant dont le contenu doit, au minimum, respecter les exigences de l’article 174.

Cet article prévoit également que si le manuel d’instruction du fabricant est inexistant ou incomplet, les éléments énumérés dans cet article doivent être spécifiés par écrit par un ingénieur ou une ingénieure.
Notez que cette importante révision règlementaire fera l’objet d’une chronique plus détaillée dans la prochaine édition de la revue Plan.
et Me Patrick Marcoux, avocat Par Marie-Julie Gravel, ing. ConseillèreManuel, procédure, carnet, spécification, instruction, petit cahier de note dans le coffre du mécano… Les documents relatifs à l’opération et à l’entretien des ouvrages d’ingénierie peuvent prendre plusieurs formats et plusieurs noms. Ce n’est pas le titre qu’on donne à un document qui fait que sa préparation est une activité réservée ou non, mais bien son contenu. Établissons donc dans un premier temps quelques concepts.

Le manuel d’entretien contient l’ensemble des exigences relatives au maintien en bon état et de la conformité d’un ouvrage. Le contenu du document varie selon le type d’ouvrage, mais doit couvrir les informations critiques pour exécuter l’entretien, notamment ce qui concerne le contrôle des sources d’énergie. Son objectif est de permettre d’entretenir les ouvrages de manière sécuritaire, en conformité
avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable (y compris les normes en matière de santé et sécurité).
Le manuel d’opération contient l’ensemble des exigences relatives à l’opération sécuritaire d’un ouvrage. Le contenu du document peut varier selon le type d’ouvrage, mais doit couvrir les informations critiques pour faire l’installation et pour opérer l’ouvrage de façon sécuritaire (paramètres critiques, plages opératoires, mode opératoire, set-up, démarrage, mise hors service et autres, au besoin). Son objectif est de permettre d’opérer les ouvrages de manière sécuritaire, en conformité avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable (y compris les normes en matière de santé et sécurité).
On comprend que la Loi fait référence aux exigences, aux lignes directrices, aux principes devant guider l’opération et l’entretien d’un ouvrage. D’autres
documents seront requis pour compléter les manuels d’opération et d’entretien, notamment ceux qui détaillent les méthodes et séquences des activités manuelles requises pour opérer et entretenir un ouvrage spécifique (généralement appelées procédures). Ces procédures seront préparées selon les lignes directrices établies dans les manuels.
Voyons maintenant quelques cas de figure fréquemment rencontrés dans la pratique.
Marie-Pier est ingénieure chez un fabricant de défibrillateurs. Elle travaille sur la conception d’un nouveau modèle. Elle doit préparer un manuel d’opération et un manuel d’entretien en conformité avec les paramètres établis lors de la conception et avec la règlementation applicable. Selon la règlementation, un manuel doit être fourni avec chaque produit vendu. Marie-Pier n’aura pas à signer chaque copie, mais doit conserver dans ses dossiers la version en vigueur, qu’elle authentifiera par signature.
Jonathan est ingénieur dans un bureau de génie-conseil. Il est chef de projets pour un mandat de conception d’un procédé de traitement des effluents gazeux d’une usine. L’un des livrables du projet est la préparation des manuels d’entretien et d’opération complets pour chaque étape du procédé. Jonathan devra s’assurer que les manuels sont préparés par un ingénieur ou une ingénieure ou sous leur supervision et qu’on fournira à son client une copie authentifiée de chacun de ces documents.
de faire des inspections visuelles des produits directement sur la ligne de production. Le manuel d’entretien est fourni par le manufacturier suédois. Cependant, certaines informations exigées par la règlementation québécoise sont manquantes.
Yohan peut garder le manuel fourni par le manufacturier, mais devra le réviser pour y ajouter l’information pertinente manquante. Il devra signer la révision, en s’assurant d’indiquer clairement sa contribution.
Camilia est ingénieure en génie mécanique dans une usine de biotechnologie. Le département des opérations veut adapter un équipement existant pour permettre la production d’un nouveau vaccin. Comme les changements proposés impliquent des modifications dans l’opération et l’entretien de l’équipement, Camilia devra s’assurer de faire la révision des manuels d’opération et d’entretien. Elle devra authentifier la nouvelle version des manuels par signature.
Yohan, ingénieur industriel, a acheté en Suède un nouvel équipement permettant
Un inspecteur de la CNESST est venu visiter l’usine où travaille Yassine, ingénieur en génie électrique. Il a émis un avis de non-conformité, puisque la presse industrielle à l’atelier n’est pas adéquatement sécurisée. Des modifications au système de commande de la presse sont nécessaires pour s’assurer que ses dispositifs de protection respectent les règles de l’art. Ces modifications doivent être supervisées par un ingénieur, conformément à la Loi sur les ingénieurs ainsi qu’à la section XXI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Yassine devra donc préparer les plans pour les modifications et s’assurer qu’une ingénieure ou un ingénieur de son équipe supervise la mise à jour des manuels d’opération et d’entretien. Il devra signer et sceller les plans requis pour faire les modifications et s’assurer que les nouvelles
Ouvrez un compte CELIAPP dès maintenant.
En savoir plus ferique.com/celiapp
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le Portail client est la propriété de Gestion FÉRIQUE et est utilisé sous licence exclusive par Services d’investissement FÉRIQUE, son placeur principal.
versions des manuels soient signées par un ingénieur ou une ingénieure.
Peter, ingénieur, est mandaté par un client pour ajouter un équipement à un système CVAC existant dans un hôpital. Le manufacturier fournit les manuels d’opération et d’entretien pour l’équipement qu’il vend, mais Peter et son équipe devront s’assurer que le procédé dans son ensemble est sécuritaire et permet au système dans son ensemble de répondre aux normes rigoureuses de qualité de l’air dans cet environnement critique. Les modifications et les ajouts requis aux manuels d’opération et d’entretien devront

être signés par un ingénieur ou une ingénieure de l’équipe de Peter.
La préparation de manuels d’entretien et d’opération bien conçus est une responsabilité professionnelle de premier plan pour les ingénieurs et ingénieures. En précisant dorénavant que les manuels d’opération et d’entretien sont des documents d’ingénierie dont la préparation est réservée aux ingénieurs et ingénieures, le législateur reconnaît que des manuels clairs, complets et faciles à suivre jouent un rôle majeur pour garantir la sécurité de tous et de toutes, assurer un entretien efficace, réduire les coûts, assurer une fiabilité maximale et soutenir les clients dans le domaine de l’ingénierie.

Par Michel Morin, ing. Coach professionnel en développement intégral

Les ingénieures et ingénieurs peuvent tirer parti d’un coaching individuel en définissant bien leurs objectifs et en s’impliquant dans la mise en pratique d’un programme personnalisé de coaching. Voyons comment on y arrive.
Chloé, ingénieure, est responsable d’une petite équipe. Elle doit rencontrer l’un des membres de son équipe afin d’évoquer avec lui des problèmes liés à son attitude personnelle au travail et à l’atteinte de ses objectifs. Avec son coach, elle soulève les différents points qu’elle doit aborder avec son employé et lui parle du malaise qu’elle éprouve dans de telles situations. Chloé et son coach s’entendent pour viser deux objectifs : développer l’habileté de Chloé à mener une conversation difficile et identifier les émotions et réactions qu’elle éprouve quand se présentent des situations conflictuelles. Le programme de coaching propose en particulier d’utiliser les bases de la CNV (communication non violente ou consciente) en soutien à cette rencontre ainsi qu’un exercice d’auto-observation qui aidera à trouver de quelle façon réagir pour faire face à des relations difficiles.
Le coaching professionnel permet d’aider la personne coachée à gérer une situation
problématique ou une impasse. Il se déroule généralement sur 6 à 12 rencontres réparties sur une période de 3 à 6 mois. Les premières rencontres ont pour but de faire une exploration large des enjeux et du mode de fonctionnement de la personne (penser, ressentir, agir) dans son environnement personnel et professionnel ainsi que de définir les objectifs particuliers qu’elle souhaite atteindre. Voici quelques exemples d’objectifs de coaching : améliorer ses compétences de leadership et de gestion, faciliter la gestion du changement associé à un projet, améliorer la communication avec son équipe et mener des entretiens difficiles, équilibrer le travail et la vie personnelle, acquérir des compétences en collaboration et en travail d’équipe, améliorer sa gestion du temps et des priorités.
Dans l’approche de coaching en développement intégral® (CDI), le ou la coach joue un rôle actif en proposant un programme de développement en réponse aux objectifs qui sont revus dans une perspective plus large par le ou la coach. Il peut s’agir d’exercices d’auto-observation d’un mode de fonctionnement (croyances, réactions, automatismes), de réflexion sur les conséquences de la situation actuelle et souhaitée (formuler le futur souhaité), d’exercices pratiques parfois liés à un domaine connexe
à l’enjeu (faire une activité physique, développer une présence attentive). Ce programme servira de base aux échanges pour guider la personne coachée vers l’atteinte de ses objectifs en lien avec les situations vécues sur le terrain.
Le coaching professionnel est plus efficace lorsque la personne coachée est en mesure de bien nommer ses besoins et de les traduire par des objectifs. Un travail d’équipe entre le ou la coach et la personne accompagnée permet de formuler des objectifs de développement pertinents, réalistes et utiles qui ne s’appliquent pas seulement au court terme, mais qui s’inscrivent dans une perspective de développement global de la personne. Le programme de développement permet à la personne coachée de se mettre en action pour prendre conscience de ses façons de faire et expérimenter des moyens de développer de nouvelles compétences visant à renforcer son leadership et améliorer
ses performances. Plus largement, le coaching aide à développer de nouvelles aptitudes pour naviguer efficacement parmi les écueils et défis qu’offre la vie professionnelle et personnelle.

Saviez-vous que la participation à des séances de coaching fait partie des activités reconnues par le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs1 ?
Vous trouverez des ressources en coaching sur le site d’ICF Québec2
Pour toute question ou pour demander conseil, n’hésitez pas à contacter Michel Morin, ing., coach et auteur de cette chronique, en écrivant à michel.morin@hotmail.com.
1. Voir le Guide d’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, avril 2023, Annexe 2 « Tableau- synthèse des activités de formation continue », p. 24.
Les entreprises naissent et avancent à coups d’innovations et peuvent en cela bénéficier du soutien des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) dans une dynamique distincte de celle qu’offrent les universités.
Par Valérie Levée

Robotique, foresterie, métallurgie, énergie, biotechnologie… Ce ne sont que quelques-unes des spécialités des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) du Réseau des CCTT - Synchronex. Les CCTT sont partout au Québec, et leur mission est d’accompagner l’innovation des entreprises et des organisations.
Affiliés aux cégeps et collèges, les CCTT sont créés à l’initiative de ces établissements d’enseignement, chacun dans un domaine d’expertise particulier. Si 48 de ces CCTT se consacrent à des disciplines technologiques, 11 se spécialisent dans les pratiques sociales novatrices, ouvrant ainsi la porte à l’innovation sociale. Au fil de leur développement, les CCTT recrutent du personnel pour former des équipes de recherche complètes et acquièrent des équipements de pointe. « Nos centres sont propriétaires de parcs d’équipements qui n’ont souvent rien à envier à ceux des laboratoires universitaires », estime
Michel Lesage, président-directeur général par intérim du Réseau des CCTT - Synchronex. Professeur à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, François Michaud, ing., le confirme en donnant l’exemple de Productique Québec, le CCTT affilié au Cégep de Sherbrooke : « L’infrastructure de Productique Québec comporte une mini-usine robotisée dotée d’un convoyeur et de différents robots industriels. Pour le programme de génie robotique, nous n’avions pas d’infrastructure du genre. Au lieu de financer une infrastructure similaire, nous avons décidé de travailler avec Productique Québec pour exploiter cette ligne de production dans la formation des ingénieurs et ingénieures en robotique ».

Au total, une force de 2 400 expertes et experts composée de personnel technique et administratif, de spécialistes, de chercheurs et chercheuses est à l’œuvre dans le Réseau des CCTT - Synchronex pour offrir ses services et répondre aux besoins d’innovation des entreprises, ainsi qu’à ceux des
organisations publiques et parapubliques. « La clientèle type de nos centres est la petite et moyenne entreprise, des entreprises qui n’ont pas à l’interne la capacité de structurer une unité de recherche et développement pour monter des projets de recherche et les réaliser, indique Michel Lesage. La plupart des projets sont réalisés à la demande de besoins exprimés par des organisations. Les CCTT n’accomplissent quasiment jamais de mandat de recherche propre, indépendant et autonome suscité par un chercheur. »
Pour répondre sur mesure aux besoins des clients, les CCTT ont une offre de services flexible qui inclut aide technique, recherche appliquée, diffusion d’information et formation pour assurer chez le client la transmission de la technologie mise au point. Il peut s’agir d’améliorer ou de mettre à l’échelle un procédé de fabrication, d’élaborer une preuve de concept, de concevoir un prototype… Il arrive qu’un client fasse appel à quelques CCTT pour résoudre différents
Michel Lesage CCTT - Synchronex« La clientèle type de nos centres est constituée de PME, des entreprises qui n’ont pas à l’interne la capacité de structurer une unité de R-D pour monter des projets de recherche et les réaliser. »
problèmes techniques d’un même projet, tout comme plusieurs mandats successifs avec un même CCTT sont parfois nécessaires pour mener un projet à maturité. Mais pour assurer le succès d’un projet, prévient Michel Lesage, « il faut un client compétent, et qui dit compétence en recherche et innovation dit souvent personne exerçant l’ingénierie. Ça prend un paratonnerre capable de capter l’éclair de génie et de l’intégrer dans l’entreprise. Il faut un individu qui peut interagir avec le CCTT, bâtir le projet, assurer la participation de l’entreprise, guider le CCTT pour s’assurer qu’on répond adéquatement aux besoins de l’entreprise, et qui soit ensuite capable d’utiliser les résultats de la recherche ».

Au-delà des projets menés sur une base individuelle par les CCTT, Synchronex s’est engagé dans une mission de plus grande envergure dont l’objectif est de répondre aux grands enjeux sociétaux, par exemple la transformation numérique. Pour accompagner
techniquement et soutenir financièrement les entreprises dans leur virage numérique, Synchronex a mis en place le programme Mon succès numérique, soutenu par l’Escouade numérique formée de 14 CCTT. Le programme répond avec agilité aux besoins du client pour l’orienter vers le CCTT idoine et démarrer le projet en moins d’une semaine, en plus de couvrir jusqu’à 75 % des frais.
Cascades et Kemitek
Cascade est connue pour sa vision en économie circulaire, et sa division de recherche Cascade CS+ veut valoriser ses résidus de production. Par traitement avec un solvant inflammable, elle a obtenu un bioproduit qui pourra être réutilisé ultérieurement comme additif. Mais pour cela, il faut passer de l’échelle du laboratoire à l’échelle pilote, puis industrielle. Or Cascade
CS+ n’est pas équipée pour faire une mise à l’échelle d’un procédé chimique impliquant un produit inflammable. Elle a donc fait appel à Kemitek, qui dispose d’installations antidéflagration. « Quand on utilise de petits volumes de solvants inflammables en laboratoire, les risques sont minimes, précise François Marquis, ing., directeur ingénierie chez Kemitek. À grande échelle, les risques augmentent. Chez Kemitek, on a l’équipement, l’expertise et la classification pour manipuler ces produits de façon sécuritaire à ces échelles. »
Dans un premier mandat, Kemitek a étudié et optimisé la réaction chimique. Le résidu est en solution aqueuse et sous l’effet du solvant et de l’agitation, il précipite et forme des particules. Il s’agit ensuite de filtrer les particules. L’objectif était de déterminer les conditions de la réaction pour optimiser la taille des particules, et donc la filtration. Après avoir effectué les opérations requises à l’échelle du laboratoire,
« Quand on utilise de petits volumes de solvants inflammables en laboratoire, les risques sont minimes. Chez Kemitek, on a l’équipement, l’expertise et la classification pour manipuler ces produits de façon sécuritaire à ces échelles. »
François Marquis, ing. Kemitek

le procédé a été validé à l’échelle pilote.
Kemitek a par la suite effectué un deuxième mandat visant à produire une analyse technique et économique de l’implantation du procédé chez Cascades.
Optis Engineering et le CTA
Dans les mines, des ventilateurs aèrent les galeries et chassent les poussières. Leurs pales en aluminium ne résistent que quelques mois à la corrosion, à l’abrasion et à l’érosion dues aux particules qui les frappent de plein fouet. Pour remplacer les produits en métal, Optis Engineering s’est tournée vers l’expertise en matériaux composites du Centre technologique en aérospatiale (CTA). En effet, à travers ses projets sur les aéronefs, les drones, les taxis aériens, la motorisation hybride des avions, le CTA consacre un pan de recherche aux matériaux composites utilisés en aéronautique. « Avec l’expertise de nos chercheurs et notre parc d’équipements, nous pouvons tester
plusieurs combinaisons de matériaux, comparer les procédés de fabrication et tester la résistance », mentionne François LeBel, ing., directeur Technologie et innovation et chef du secteur Composites et matériaux avancés au CTA.
Le CTA a fabriqué des échantillons sous forme de plaques en composites constitués de matrices polymères renforcées de fibres de verre. Ces dernières étaient jointes par des adhésifs. Ces assemblages collés étaient ensuite soumis à des tests en cisaillement avant et après une période de vieillissement préétablie en environnement minier. « L’érosion attaque essentiellement la matrice, et les tests en cisaillement des assemblages sont un bon indicateur de la performance des adhésifs », explique François LeBel. Il fallait obtenir des matériaux plus résistants que l’aluminium et à un coût de fabrication compétitif. Le CTA a finalement fourni à Optis Engineering une sélection de matériaux, et décrit leurs avantages et inconvénients ainsi que les procédés de fabrication.
Optech est spécialisée en optique photonique et dispose d’un parc d’équipement pour prendre toutes sortes de mesures relatives à l’éclairement pour des applications dans les domaines des arts de la scène, des télécommunications, des technologies biomédicales…
C’est pour son expertise en agrophotonique que Pépinière SaintModeste a requis les services d’Optech. Dans le cadre d’un mandat de service technique, Optech a réalisé la cartographie de l’éclairement de la serre et recommandé les options de luminaires répondant aux besoins des pépiniéristes. Dans les serres, de nouvelles lampes au sodium ont été installées, tandis que sur les chariots de croissance, l’éclairage a été optimisé par des lampes DEL. « Les DEL nous offrent des solutions pour trouver la recette lumineuse en fonction du type de plantes, de ses besoins selon son stade de croissance et de ce qu’on veut lui faire produire », souligne

« Avec l’expertise de nos chercheurs et notre parc d’équipements, nous pouvons tester plusieurs combinaisons de matériaux, comparer les procédés de fabrication et tester la résistance. »
François LeBel, ing. Centre technologique en aérospatiale
Depuis peu, les DEL sont aussi offertes dans les longueurs d’ondes des UV-C utilisées dans les processus de désinfection. Leur avantage par rapport aux tubes fluorescents est de permettre des allumages ponctuels. Dans une

étude de concept réalisée pour RP Innovation, Martin Langlois a conçu une chambre de désinfection pour la volaille. En fonction des pathogènes ciblés et du niveau de désinfection souhaité, il a déterminé l’emplacement de l’éclairage et la dose de rayonnement à appliquer pour désinfecter les poulets.
Sur le même principe, mais pour Technologies GRB, il a fait la conception du LIBU, un bouton d’ascenseur autodésinfectant : le bouton pivote sur lui-même et se fait désinfecter en arrière pour que les personnes ne soient pas exposées aux UV-C.

« Les DEL nous offrent des solutions pour trouver la recette lumineuse en fonction du type de plantes, de ses besoins selon son stade de croissance et de ce qu’on veut lui faire produire.
»
Martin Langlois, ing. OptechMartin Langlois, ing., chargé de projet chez Optech.
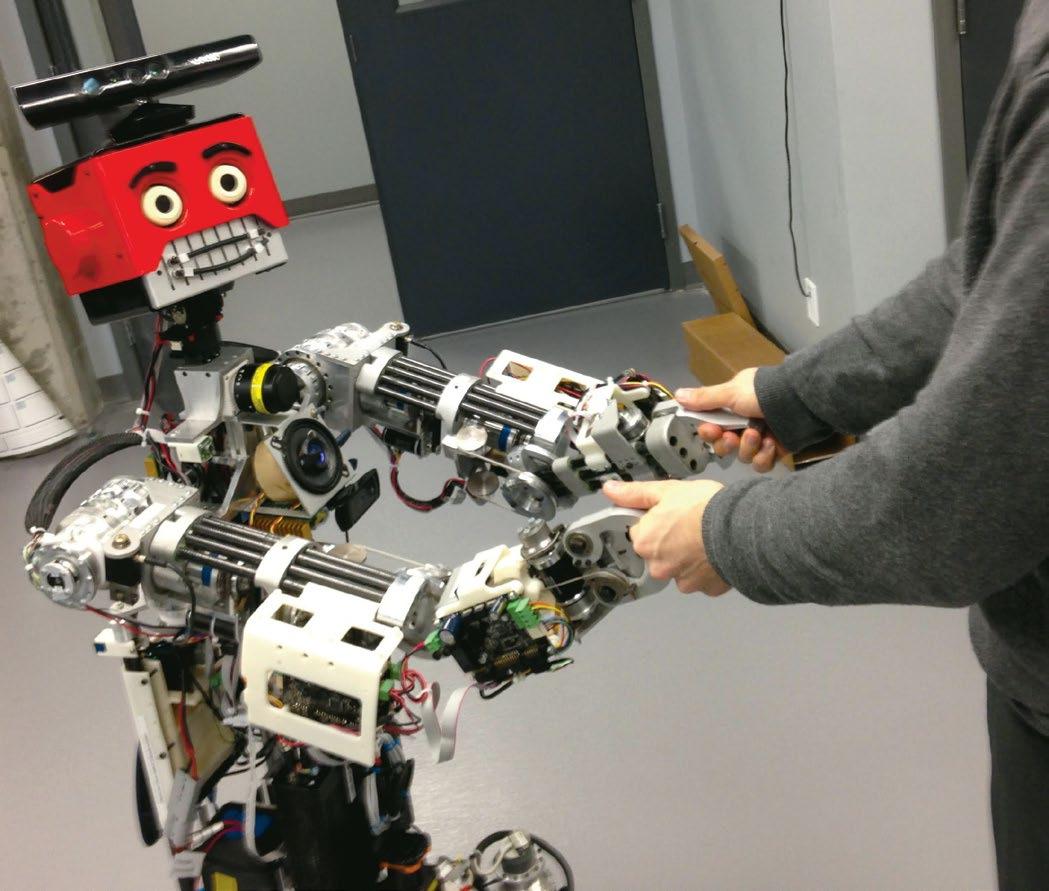
Si la mission d’un centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT) est d’apporter son expertise technique à une entreprise qui met au point un produit ou un procédé, celle de l’université est de former du personnel hautement qualifié et de faire avancer les connaissances. En conséquence, l’innovation prend des voies distinctes. Dans le cas des CCTT, l’idée innovante provient de l’entreprise et transite par le CCTT pour se concrétiser. Dans le cas des universités, elle émane de nouvelles connaissances acquises et sera concrétisée en entreprise. François Michaud, ing., est professeur à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke et il a instauré un partenariat de formation avec Productique Québec, le CCTT affilié au Cégep de Sherbrooke. Ayant un pied dans les deux établissements, il compare les contributions respectives des CCTT et des universités à l’innovation.
À l’université, les étudiants et étudiantes sont formés à répondre à des questions de recherche et à devenir des scientifiques qui feront avancer la science. Ces questions de recherche sont souvent de nature intemporelle et ne ciblent pas nécessairement les besoins d’une entreprise particulière. « Les besoins de l’industrie sont souvent orientés vers des problèmes à résoudre sans mener à de nouvelles connaissances scientifiques. Difficile de savoir si ceci estlié aux connaissances scientifiques et non aux besoins », précise François Michaud. D’autant plus que les projets de recherche s’étirent sur plusieurs années et excèdent les délais de l’industrie. « Les universitaires travaillent sur des programmes de recherche à long terme, poursuit François Michaud. Les CCTT sont plus réactifs pour servir de centres de R-D et répondre à la demande des entreprises, qui ont des échéanciers à plus court terme. Ils sont mieux placés pour élaborer des produits ou des
solutions sur mesure pour des entreprises. La recherche diffère du développement d’un produit, puisqu’un produit ne fait pas nécessairement avancer la science. » Comme le résume Michel Lesage, président-directeur général par intérim du réseau des CCTT, « le but de l’intervention du CCTT, c’est de produire un livrable utilisable par l’entreprise, c’est très rarement une publication scientifique ».

Cela n’empêche pas la recherche universitaire d’être source d’innovations, mais celles-ci sont plutôt un produit dérivé des résultats de recherche. Plusieurs universités offrent des programmes d’accompagnement à l’entreprenariat ou des incubateurs d’entreprises pour que les idées innovantes des scientifiques deviennent réalités. « Les entreprises des incubateurs universitaires sont souvent issues
« Les besoins de l’industrie sont souvent orientés vers des problèmes à résoudre sans mener à de nouvelles connaissances scientifiques. Difficile de savoir si ceci estlié aux connaissances scientifiques et non aux besoins. »
François Michaud, ing. Université de Sherbrooke
de questions de recherche qui ont mené à un élément commercialisable, dit François Michaud. Elles ne découlent pas d’un besoin industriel, mais d’une poussée scientifique qui peut trouver preneur dans le marché. »
Il donne l’exemple d’une recherche qu’il a commencée en 2003 sur le développement d’un robot capable de discriminer les sons pour discuter avec un être humain et qui a abouti en 2015 à un système de détection de drones. Cette application n’était assurément pas prévue en 2003. « Pour un robot équipé d’un seul microphone, tous les sons se mélangent, indique le

professeur Michaud. Notre oreille peut discriminer les sons et percevoir d’où ils viennent, et la question de recherche était de réussir à faire pareil avec un robot. »
Quand un robot comporte plusieurs micros, il arrive à localiser les sons et à distinguer la voix des bruits environnants. « En 2015-2016 est apparu le problème des drones qui font des livraisons en prison. Nous avons pensé que nous pourrions utiliser des matrices de microphones pour distinguer le son d’un drone des bruits environnants et le localiser », ajoute François Michaud. Le développement se poursuit maintenant avec le programme
fédéral de soutien à l’innovation Solutions innovatrices Canada.
« La genougraphie, c’est l’électrocardiogramme du genou », déclare Nicola Hagemeister, professeure à l’École de technologie supérieure. Il s’agit d’un harnais, muni de capteurs de mouvements, qui enserre le genou et permet de mesurer le mouvement tridimensionnel de l’articulation du genou, avec le fémur et
le tibia. « Le mouvement est décomposé en flexion-extension, rotation du tibia et abduction, explique la professeure Hagemeister. On obtient des courbes desquelles on extrait des marqueurs mécaniques de dysfonctionnement de l’arthrose. » À partir de ces marqueurs, il est possible de prescrire des exercices pour renforcer un muscle ou en étirer un autre. La genougraphie vient donc ainsi compléter la radiographie et l’imagerie par résonance magnétique pour personnaliser les traitements.
Une étude clinique a comparé le traitement habituel consistant en exercices génériques et le traitement personnalisé après genougraphie. « Avec la genougraphie, 84 % des personnes faisaient leurs exercices, rapporte Nicola Hagemeister. C’est énorme parce que dans les programmes génériques, les gens ne font pas leurs exercices ». Les douleurs avaient aussi diminué.
Aujourd’hui, KneeKG, l’appellation commerciale du harnais, est distribué par l’entreprise Emovi, et la technologie est utilisée dans de nombreuses cliniques au Québec et ailleurs dans le monde.
KneeKG est le résultat de plus de 20 ans de recherche. Mentionnons que, à l’origine, la recherche ne portait pas sur l’arthrose, mais sur la réparation de genoux ayant des ligaments artificiels. Un étudiant au doctorat avait fabriqué un harnais pour mesurer les mouvements du tibia et du fémur afin de réduire les déformations de ces ligaments. « La genougraphie est issue de là ! Curieusement, le harnais n’a jamais été utilisé pour cette application. C’est seulement des années plus tard que Michelle Laflamme, la fondatrice d’Émovi, s’est dit que ce serait un excellent outil pour améliorer le diagnostic de l’arthrose et déterminer quel traitement donner aux patients », évoque Nicola Hagemeister.

Au Laboratoire de robotique intelligente, interactive, intégrée et interdisciplinaire (IntRoLab), le professeur François Michaud et son équipe travaillent à la conception
d’un robot capable de répondre à des questions, et met au point un prototype qui peut voir, entendre et interagir de façon naturelle avec les personnes. Une tablette mobile est équipée de microphones et de caméras pour distinguer les sons et cartographier l’environnement, et des réseaux de neurones permettent de reconnaître les objets. « Notre robot est capable de voir ce qui se passe dans la réalité, de reconnaître une personne, de la nommer, de voir ce qu’elle porte et ce qu’elle fait, et peut engager la conversation en fonction de ce qu’il voit », décrit François Michaud. Par exemple, le robot peut repérer la présence de M. Tremblay, se tourner vers lui et lui demander comment il va. S’il s’aperçoit que, comparativement aux autres jours, M. Tremblay ne prend pas de café, il peut lui demander pourquoi. L’objectif ultime de cette recherche est d’évaluer si un tel robot interactif favorise l’implication des personnes âgées et contribue à briser leur isolement. Une fois ce but atteint, il reviendra à une entreprise de développer le robot pour en faire un produit commercialisable.
« Avec la genougraphie, 84 % des personnes faisaient leurs exercices. C’est énorme parce que dans les programmes génériques, les gens ne font pas leurs exercices. »
Nicola Hagemeister, ing. ÉTS
La meunerie La Milanaise a contacté l’Institut de valorisation des données (IVADO), qui a ensuite transféré le projet à Bruno Agard et Christophe Danjou, professeurs au Laboratoire en intelligence des données (LID) à Polytechnique Montréal. « La démarche s’apparente à celle des CCTT, mais dans les CCTT, les solutions sont connues et ont déjà fait l’objet de publications scientifiques, précise Bruno Agard. Il faut appliquer la solution. Dans notre cas, ce sont souvent des problèmes qui n’ont jamais été abordés. »

En l’occurrence, il s’agissait de transposer les opérations de meunerie en algorithme. La qualité de la mouture dépend de l’humidité et de la provenance des grains. « La météo et les paramètres des grains jouent sur ce que le meunier appelle la
“recette”, c’est-à-dire le pourcentage de chaque sorte de grains et le réglage du moulin », explique Bruno Agard. L’algorithme a donc besoin de données météo, mais aussi des données relatives au réglage du moulin. Or, quand le meunier tourne les manettes d’un cran à droite parce qu’il fait chaud, c’est l’expérience qui parle, il n’y a pas de formules mathématiques. « On a mis des capteurs sur les machines pour mesurer les angles des manivelles et pouvoir répliquer les gestes du meunier », décrit Bruno Agard. À partir de ces données météo et gestuelles, l’algorithme peut déterminer les réglages à effectuer si des conditions similaires se présentent.
Les chemins de l’innovation sont multiples et parfois imprévisibles… Mais les CCTT et les universités se complètent pour offrir chacun à leur manière un soutien à l’innovation afin de transformer l’idée en produit commercialisable.
CCTT : centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales
Les CCTT mènent chaque année 11 000 projets et font affaire avec 6 000 clients.
Depuis 1983, date de la création des premiers CCTT, le modèle a fait ses preuves au point que le gouvernement du Canada s’en est inspiré pour créer un réseau de 60 centres d’accès à la technologie (CAT), un programme dont bénéficient plusieurs CCTT.
« On a mis des capteurs sur les machines pour mesurer les angles des manivelles et pouvoir répliquer les gestes du meunier. »
Bruno Agard Polytechnique Montréal
Guide de l’employeur pour un milieu de travail plus diversifié, inclusif et équitable
Téléchargez-le sur le site de l’Ordre bit.ly/guide_employeurs_OIQ


Qu’elle soit issue d’une collaboration pour répondre à un réel besoin du milieu ou d’un concept mis de l’avant pour faire face à une problématique de santé complexe, l’innovation est au cœur de l’avancement des soins médicaux et de la transformation des pratiques dans le système de santé.
Par Mélanie LaroucheBien intégrés à la chaîne d’innovation technologique, les ingénieurs et les ingénieures jouent un rôle de premier plan dans cette volonté collective de faire avancer le milieu médical.
Force vive de développement, l’ingénierie apporte en effet une contribution inestimable à la progression des idées et à la réalisation des projets.
Parmi les nombreux projets de recherche liés à la médecine, celui de Jean-François Beaudoin, ingénieur affilié au CRCHUS – le Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) –, a retenu l’attention cette année pour son ingéniosité, sa créativité et ses répercussions sociétales positives. La mise au point d’un automate de production de radioisotopes médicaux pour le compte du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a valu à Jean-François Beaudoin de remporter le prestigieux prix Honoris Genius – Innovation technologique 2023, décerné par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les travaux de développement de l’automate ont été réalisés conjointement avec son collègue Sébastien Tremblay, agent de recherche pour l’Université de Sherbrooke.

Il faut savoir qu’outre la guérison du cancer, la course à sa détection rapide fait l’objet d’efforts soutenus dans les milieux de la recherche. Déjà reconnu mondialement pour le développement d’appareils
d’imagerie médicale par tomographie d’émission par positrons (TEP), le CRCHUS fait figure de précurseur pour ce qui est de l’utilisation du radio-isotope gallium 68 produit par cyclotron pour diagnostiquer et traiter un cancer rare, soit le cancer neuroendocrinien.
Jean-François Beaudoin explique qu’avant la création de l’automate, la production par générateur du gallium 68 occupait la semaine entière d’un radiochimiste. La quantité de gallium 68 produite limitait le nombre de diagnostics par imagerie médicale des usagers de l’hôpital. Qui plus est, les générateurs sont coûteux et doivent être remplacés après quelques mois.
« La production par cyclotron avec un automate améliore grandement la vitesse de production, c’est-àdire la quantité produite de radioisotope, tout en réduisant de manière significative l’exposition du personnel à la radioactivité, précise l’ingénieur-chercheur. L’automate pourra être utilisé dans la production d’autres radio-isotopes médicaux. Depuis deux ans et demi, 1 512 personnes atteintes d’un cancer neuroendocrinien de partout au Canada sont venues à Sherbrooke pour leur examen médical. Au cours de la dernière année, plus de 478 individus ont profité du
radio-isotope pour le diagnostic du cancer de la prostate. Il ne fait aucun doute que l’automate a changé pour le mieux l’environnement de soins des usagers et usagères de notre système de santé. »
Pour ce projet, le CRCHUS a mis en place une équipe composée de radiochimistes à laquelle s’est greffé Jean-François Beaudoin. « Pour répondre à la demande exponentielle, nous avons conçu et déployé cet automate pour faciliter la production à grande échelle et la distribution de gallium 68 à visée diagnostique. D’autres centres hospitaliers du Québec peuvent donc bénéficier de cette avancée technologique. L’automate a fait l’objet d’un brevet international. Il serait possible de déployer cette approche dans d’autres cyclotrons et d’établir un réseau provincial ou national de distribution de radio-isotopes. »
Au dire de Jean-François Beaudoin, le développement technologique au CRCHUS est l’un des secrets les mieux gardés de Sherbrooke. « Peu de centres de recherche font le développement complet en imagerie médicale. Au CRCHUS, en partenariat avec des chercheuses et chercheurs de l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique
« Nous concevons, fabriquons, programmons et faisons fonctionner nos équipements technologiques de recherche préclinique et nous produisons nos radio-isotopes sur place. »
Jean-François Beaudoin, ing. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(le 3IT) de l’Université de Sherbrooke, nous concevons, fabriquons, programmons et faisons fonctionner nos équipements technologiques de recherche préclinique et nous produisons nos radio-isotopes sur place. »
Jean-François Beaudoin ajoute que dans la dernière année, un nouveau tomographe par positron cérébral a également été mis en fonction au CRCHUS. Doté d’une qualité d’image supérieure aux appareils sur le marché, ce tomographe pourra dépister des tumeurs plus petites. Cette résolution inégalée permettra aussi de mieux identifier les régions cérébrales de petite taille impliquées dans les maladies
neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer.

Depuis 17 ans, Jean-François Beaudoin est intégré à l’équipe pour ses compétences à titre d’ingénieur en génie électrique. « Il est très rare qu’un centre de recherche clinique se dote d’un ingénieur permanent directement incorporé dans les équipes de recherche, souligne-t-il. D’année en année, cette collaboration me permet de mettre à profit ma polyvalence et ma créativité
au bénéfice des nombreux projets menés par l’établissement. Je me situe à la jonction de la recherche universitaire, de la recherche clinique et du réseau de la santé. C’est un terreau fertile pour acquérir des connaissances concernant de multiples disciplines. Nos chercheurs et chercheuses sont une riche source d’inspiration de projets d’ingénierie. »
Originaire de Sherbrooke, une région qui lui tient à cœur, JeanFrançois Beaudoin se dit extrêmement reconnaissant de l’occasion qui lui a été donnée de se joindre à une équipe dynamique et performante au sein du CRCHUS. « Être sur le terrain et faire partie de l’architecture du centre de recherche
représente un gage de confiance inestimable. L’établissement me laisse de la latitude dans mon travail pour soutenir différents intervenants dans le centre hospitalier. C’est très valorisant. Pouvoir laisser libre cours à mon imagination et être entouré de collègues talentueux et inspirants me permet tous les jours d’apporter une contribution dans le milieu médical à travers l’ingénierie. »
Le chercheur croit beaucoup à la multiplication des forces ; c’est la clé selon lui pour favoriser l’espace d’innovation. « Au grand bénéfice des usagers et usagères du réseau de la santé, les équipes de recherche utilisent conjointement leurs connaissances et leurs observations pour définir des besoins. On applique alors des algorithmes, des codes informatiques, des techniques de production et du prototypage rapide afin de répondre à ces besoins avec les ressources disponibles. Comme les ressources du milieu ne sont pas infinies, notre créativité dans tous les domaines doit combler l’écart et transformer notre manière de produire, de consommer et de vivre. »
Jean-François Beaudoin poursuit en donnant un exemple : « L’accessibilité des techniques de fabrication additives comme l’impression 3D est d’une aide précieuse pour la réalisation de projets de recherche. Quelqu’un peut me demander au début d’une journée
de me charger d’un mandat ; je dessine une pièce, et une à deux heures plus tard, nous avons un prototype dans nos mains, prêt à être déployé sur le terrain. Le prototypage rapide est un outil vital à notre arsenal pour la réalisation interne de nos projets. »
Pour sa part, Maxime Bolduc, un jeune candidat à la profession d’ingénieur (CPI) à l’esprit visionnaire, a vu sa volonté d’innovation lui être révélée à la suite d’un malencontreux accident arrivé à sa grand-mère. « Ma grand-mère est tombée chez elle et s’est fracturé la hanche, relate-t-il. Elle est restée seule à souffrir pendant cinq heures avant que mon grand-père ne la trouve. Sa fracture a nécessité trois mois d’hospitalisation, puis elle a dû réapprendre à marcher. La famille s’est mobilisée pour l’aider. Mais cet accident m’a poussé à me questionner sur la meilleure façon de prévenir ce genre de blessure, quand on sait qu’elle est malheureusement fréquente chez les personnes âgées. »

Maxime Bolduc s’est donc investi dans la mise au point d’une technologie pour prémunir les personnes aînées contre ce type d’accident. Son étude de marché a montré qu’il n’existait rien sur le marché pour éviter les blessures causées
par une chute. « Il y a beaucoup d’appareils servant à alerter lorsqu’une personne fait une chute, mais peu qui protègent réellement la personne. À cette époque, je finissais mon baccalauréat en génie mécanique à l’École de technologie supérieure et j’avais choisi un cours d’entrepreneuriat en ingénierie. Ça ne pouvait pas mieux tomber ! Pour la première fois dans mon parcours, on me disait de trouver une problématique plutôt qu’une solution, un réflexe de mon éducation en ingénierie. »
« J’ai aussi appris en faisant l’étude de marché qu’on dénombre 400 000 personnes victimes d’une fracture de la hanche chaque année en Amérique du Nord. Le taux de morbidité à la suite de cette blessure oscille entre 25 % et 28 % ; 25 % de ces gens perdent la capacité de marcher de façon permanente, et l’autre moitié passera entre 3 et 12 mois en réhabilitation. La presque totalité de ces fractures (98 %) est due à une chute. »
Pendant son cours d’entrepreneuriat, Maxime Bolduc a présenté son projet d’entreprise, qui consistait à concevoir un vêtement gonflable de protection personnelle pour réduire les risques fracture de la hanche, à un panel d’investisseurs. Il a obtenu une place dans le programme Accélération de l’incubateur Centech, ce qui lui a donné accès à un accompagnement d’une durée de 12 semaines. « Je
« En aidant à diminuer le nombre de blessures, la technologie Azimut contribue à réduire l’achalandage aux urgences et les hospitalisations. »
Maxime Bolduc, CPI Azimut Médical
suis ensuite passé au programme Propulsion, d’une durée de deux ans, en incorporant simultanément mon entreprise en mai 2021. J’ai alors engagé des designers industriels et j’ai fait des entretiens avec une cinquantaine de professionnels du milieu de la santé, de la gériatrie en particulier, ainsi qu’avec des personnes aînées, pour bien comprendre notre marché. »
En janvier 2022, Azimut Médical a démarré la recherche et développement, de laquelle a émergé une première preuve de concept. En parallèle, Azimut a été accepté dans le programme NextAI en partenariat avec HEC Montréal. « Ce programme nous a grandement aidés à raffiner l’utilisation de l’intelligence artificielle dans notre produit. Nous avons par ailleurs eu la chance de rencontrer une panoplie de mentors et d’experts de l’industrie qui ont su nous guider pendant le développement de nos prototypes et la croissance de notre équipe. Nous avons terminé l’année en créant un partenariat avec une résidence pour personnes âgées (RPA) ; 14 personnes ont porté le vêtement pendant un mois pour tester notre technologie en milieu réel, explique Maxime Bolduc. Début 2023, nous avons apporté plusieurs modifications en tenant compte des rétroactions reçues, et un autre projet pilote débutera dans les prochains mois avec la deuxième version du vêtement. Présentement, on termine le développement, on poursuit les tests et on commence la fabrication. L’an prochain, ce sera le début de la production à plus grande échelle. On établit déjà des partenariats avec des ateliers de couture pour accroître notre capacité de production. »
Le vêtement Azimut de protection personnelle est un produit intelligent. Grâce à une fusion de capteurs et de microcontrôleurs uniques à Azimut, il est possible de détecter qu’une personne est sur le point de tomber. Une membrane qui entoure les hanches de l’utilisateur ou de l’utilisatrice se gonfle alors pour absorber l’impact au sol et ultimement réduire le risque de blessure. « Notre algorithme est très sophistiqué, il permet de distinguer le mouvement de chute et d’autres mouvements du quotidien, souligne le jeune homme. Le système peut également générer une alerte qui est envoyée aux contacts de la personne lors du déploiement du vêtement et si la personne reste un certain temps au sol après l’impact. »
Un premier brevet provisoire déposé en octobre 2023 protégera les aspects clés de la technologie d’Azimut. « Les sousvêtements rembourrés qui existent sur le marché ne conviennent pas aux personnes âgées, qu’il s’agisse du confort, de l’esthétisme ou du niveau de protection, note Maxime Bolduc. Le vêtement gonflable Azimut est très discret et confortable, il est conçu pour répondre aux besoins des usagers. En plus, il absorbe présentement 80 % de l’énergie générée par l’impact. Notre but est d’atteindre plus de 90 %, ce qui éclipse tout produit similaire. »
À l’heure actuelle, les RPA privées et les individus à risque de fracture de la hanche forment la clientèle cible d’Azimut Médical. « Notre dernière étude pilote a aussi démontré que l’intégration fonctionne, indique Maxime Bolduc. Notre but est de démocratiser l’accès à une protection individuelle, et d’offrir notre
produit dans tous les établissements, publics et privés. Nous voulons aussi contrer la peur de tomber, parce qu’il a été prouvé qu’un cercle vicieux s’installe après une chute. La peur empêche les gens de rester actifs, ils perdent ainsi leurs réflexes et, avec le temps, ils perdent leur mobilité, petit à petit. »
Les données relatives à la satisfaction recueillies jusqu’ici sont très favorables. « Le taux d’adoption de la technologie Azimut est de 64 % pour la première version du vêtement, ce qui est presque deux fois plus élevé que pour les autres sous-vêtements rembourrés sur le marché. Notre deuxième pilote vise un taux plus élevé. En général, les personnes âgées sont réceptives à l’idée de porter cette protection. La prévention qu’elle représente est un aspect plus tangible que l’alerte, qui est réactive. »
Du côté de l’administration des RPA, le produit suscite un grand intérêt puisqu’il concerne une préoccupation importante, celle d’améliorer la gestion des risques et la qualité de vie des résidentes et des résidents. « Financièrement, notre technologie est attrayante parce qu’elle permet de garder plus longtemps les résidentes et les résidents en santé et indépendants, ce qui réduit le taux de roulement dans les RPA et les frais inhérents qui en découlent », mentionne Maxime Bolduc.
Le secteur public est aussi très réceptif. « En aidant à diminuer le nombre de blessures, la technologie Azimut contribue à réduire l’achalandage aux urgences et les hospitalisations, fait valoir le candidat à la profession d’ingénieur. Le traitement d’une fracture de la hanche et la réhabilitation résultante sont extrêmement coûteux pour le système de santé. »
L'Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) vous invite à la soirée de remise des Grands Prix du génie-conseil québécois 2023, le mardi 26 septembre prochain à compter de 17 heures au Centre Mont-Royal, à Montréal.
Sous le thème Au premier plan de l’innovation, l’événement animé par Stéphane Bellavance réunira plus de 350 dirigeants et professionnels du génie-conseil québécois, donneurs d’ouvrage et partenaires afin de récompenser les meilleurs projets réalisés partout au Québec et ailleurs dans le monde!
17 h 00 Arrivée des invités et cocktail de bienvenue
18 h 00
18 h 15
18 h 20
Ouverture de l’auditorium Remise des prix
Allocution d’ouverture présentée par présentée par
20 h 45 Cocktail festif
NOUVEAU : billets gratuits disponibles pour assister à la remise des prix en direct par webdi usion!
présentée par
Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC

Directrice générale
Polytechnique Montréal

Le 13 novembre 2023, l’ingénieur Réjean Bourgault, directeur national du secteur public pour Amazon Web Services Canada, animera un dîner-conférence traitant de la culture de l’innovation chez Amazon.
Par Clémence Cireau Photos : Amazon Canada
Amazon, multinationale fondée par Jeff Bezos en juillet 1994 à Seattle autour d’une librairie en ligne, domine désormais toutes les sphères commerciales et s’étend à la pointe des services technologiques. Ce modèle de réussite repose sur une culture de l’innovation entretenue à tous les échelons de l’entreprise.
C’est en 2017 que Réjean Bourgault, ing., rejoint Amazon Web Services (AWS) Canada, quelques mois après que l’entreprise décide de lancer à Montréal une grande région infonuagique regroupant plusieurs centres de données. En tant que directeur national pour le secteur public, Réjean Bourgault détient la confiance des clients d’AWS dans divers secteurs comme la santé, l’éducation et la défense. « Mes équipes accompagnent les provinces, les ministères, les ONG pour effectuer leur transformation numérique en adoptant l’infonuagique, indique-t-il. Nous n’avons de cesse de leur démontrer les avantages de cette transition en termes d’efficacité, de productivité, de sécurité et de capacité d’innovation. Aujourd’hui, nos clients
peuvent choisir parmi plus de 240 services allant du stockage de données à la sécurité, en passant par l’Internet des objets, l’apprentissage automatique, et bien plus encore pour mieux accomplir leurs missions. » Il affirme d’ailleurs que « les entreprises canadiennes utilisant l’infonuagique sont deux fois plus innovantes que les autres ».
Persuadé que la technologie d’aujourd’hui façonne un avenir prometteur pour le Canada et le monde, Réjean Bourgault est régulièrement invité à donner des conférences.
« La conférence que je donnerai le 13 novembre est la plus demandée parmi la centaine de présentations proposées par Amazon. Mon objectif est d’offrir aux ingénieurs présents des astuces concrètes qu’ils pourront utiliser pour renforcer leurs projets et leur entreprise. » Selon lui, les ingénieures et les ingénieurs disposent d’un « goût de l’innovation intrinsèque au domaine ».

Les entreprises ne mettent pas pour autant forcément en place une
méthodologie suffisamment axée sur l’innovation, précise-t-il. « Chez Amazon, c’est toute une culture : nous utilisons l’approche des bâtisseurs. Dès le processus de recrutement, les questions sont tournées en ce sens pour déceler en chacun le potentiel innovant. » Afin que ce potentiel puisse être mis en action à des échelles très différentes, le concept de « deux pizzas » est appliqué. « La taille d’une équipe ne doit pas dépasser un groupe pouvant être nourri par deux pizzas. Ça permet une plus grande autonomie et une meilleure réactivité. Nous insistons également sur l’absolu besoin d’être à l’écoute des clients, puisque de 90 à 95 % des innovations d’Amazon proviennent d’un besoin signalé par un client. »
L’une des autres particularités de cette culture de l’innovation est de toujours travailler à rebours. Lorsqu’une équipe propose une idée de nouveau service, elle commence par rédiger un communiqué de presse fictif à propos du lancement du service pour le présenter en interne. Après avoir pris connaissance des réactions à ce communiqué de presse, l’équipe rédige un texte de présentation de six pages
« Nous insistons également sur l’absolu besoin d’être à l’écoute des clients, puisque de 90 à 95 % des innovations d’Amazon proviennent d’un besoin signalé par un client. »
Bourgault, ing.
qui sera la base de ce nouveau service. C’est un processus récurrent qui alimente la prise de décision et qui est parfois entamé deux ou trois ans avant le lancement d’un nouveau service. « Il est essentiel de prendre le temps de penser, de poser ses idées et de bien les rédiger, déclare Réjean Bourgault. Nous réservons d’ailleurs un temps de lecture, de réflexion et d’apprentissage pour l’ensemble de mon équipe tous les mercredis matin. Avec cette méthode, on ne perd jamais de vue l’objectif final d’une innovation. »
Cette méthodologie est appliquée à tous les échelons de l’entreprise afin que tous et toutes soient sur un pied d’égalité. « C’est dans ces conditions que l’innovation peut vraiment devenir une culture. Les clients qui ont assisté à cette

conférence nous le disent ensuite : ils ont commencé à appliquer nos méthodes, et ça fonctionne ! »
Lorsqu’on parle d’innovation aujourd’hui, les questionnements se concentrent rapidement autour des enjeux de l’intelligence artificielle. « Nous développons l’IA depuis plus de 25 ans chez Amazon, c’est un domaine que l’on maîtrise désormais très bien, signale l’ingénieur. Internet a démocratisé l’information ; je crois que l’IA générative va démocratiser la technologie ! »
Au cours du dîner-conférence « La culture de l’innovation en entreprise, gage de succès », dans le cadre du Colloque annuel de l’Ordre, Réjean Bourgault expliquera comment
l’IA aidera les ingénieures et les ingénieurs et jouera un rôle dans leur carrière. « Sans trop révéler la teneur de ma présentation, je peux vous dire que l’IA va accélérer l’innovation dans tous les domaines. En design industriel par exemple, elle permettra de réaliser des prototypes en simulation beaucoup plus rapidement. »
Le dîner-conférence du 13 novembre 2023 promet ainsi d’être riche en idées concrètes pour les ingénieures et les ingénieurs qui s’intéressent à la culture de l’innovation. Réjean Bourgault conclut avec une maxime : « Mon père disait toujours : si tu vas dans un séminaire et que tu ressors avec au moins une idée nouvelle, tu as bien fait de t’y rendre ! J’espère que les personnes présentes à la conférence repartiront avec ce sentiment ! »
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en 1988, Réjean Bourgault est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1989. Lorsqu’on l’interroge sur sa trajectoire en génie, il avoue qu’il a toujours su vouloir être ingénieur : « Je jouais encore avec des Lego à 17 ans !»
Le génie est une histoire de famille ; dès l’âge de six ans, il accompagnait son père – propriétaire de boutiques d’électronique – à ses rendez-vous. À l’université, Réjean Bourgault participe à un concours avec son frère et conçoit sa propre antenne satellite. Une fois diplômé, son ambition se tournera vers l’entreprise Nortel, ancienne entreprise canadienne du secteur des activités sans fil et des entreprises, où il déploiera ses compétences pendant 21 ans.
« J’ai participé à la construction de l’infrastructure téléphonique du Canada, au développement d’Internet et j’ai ensuite rejoint les équipes du sans-fil, 2G et 3G », retrace-t-il. Tous ces postes l’ont amené à travailler à Paris et à Hong Kong.
Conseil d’administration
Son mandat : prendre les décisions à la suite des recommandations du Comité d’assurance responsabilité professionnelle afin d’assurer une gouvernance saine, transparente et équitable des régimes collectifs de l’Ordre.
2
Comité d’assurance responsabilité professionnelle (CARP)
Son mandat : surveiller les régimes collectifs de l’Ordre et émettre des recommandations au Conseil d’administration.
Composition : 2 membres du Conseil d’administration de l’Ordre + 4 ingénieur.e.s exerçant en pratique privée dans des petites et moyennes entreprises.
Étude de marché* : Le CARP recommande au Conseil d’administration de lancer un appel de propositions pour la sélection de l’assureur des régimes collectifs de l’Ordre.
Le Conseil d’administration, après étude et analyse des avantages et des inconvénients des recommandations, autorise le lancement de l’appel de propositions en conséquence. C’est ce qui a été fait à la suite d’une étude de marché débutée en août 2022.
* L’étude de marché permet de dégager une lecture optimale sur l’état du marché d’assurance et sur le moment opportun pour la sélection d’un assureur. Elle est entreprise par BFL CANADA, le courtier exclusif de l’Ordre, et revue par un actuaire indépendant avant d’être présentée au CARP.
Janvier 2023 : Décision du Conseil d’administration du retour au marché.
Juin 2023 : Lancement de l’appel de propositions.
Septembre 2023 : Recommandation du CARP au Conseil d’administration sur le choix de l'assureur ou du gestionnaire d'assurance.
Septembre 2023 : Confirmation du choix de l’assureur ou du gestionnaire d'assurance par le Conseil d’administration.
1er avril 2024 : Souscription des polices d'assurance auprès du nouvel assureur ou du nouveau gestionnaire d’assurance.
Pour tout savoir sur l’assurance responsabilité professionnelle en 4 vidéos de 1 minute.
La sélection de l’assureur est une décision commune et réfléchie ! 1
Olivier Marcotte, ing., fondateur de Nucleom, a saisi l’occasion de créer une entreprise dans le très niché créneau des essais non destructifs.

Il s’agit d’un domaine en pleine expansion, puisque les fournisseurs d’hydroélectricité ou les opérateurs de centrales hydroélectriques et nucléaires ont besoin plus que jamais de faire inspecter leurs installations.
Par Pascale Guéricolas
Photos : Chantal Carbonneau, Photographie f8
Olivier Marcotte déteste les regrets. S’appesantir sur la carrière qu’il aurait dû faire s’il avait pris telle ou telle décision à tel moment ou tel autre de sa vie, très peu pour lui. Alors il fonce, et crée sa chance. Comme en 2004, lors d’un séjour en Allemagne pour y faire un stage lié au baccalauréat en génie physique qu’il finalise à l’Université Laval. En une soirée, au cours d’une discussion informelle, il décroche un stage à l’Université technique de Munich comme assistant d’enseignement. Il réussit de surcroît à trouver une chambre, certes modeste, pour se loger. « Le salaire du stage payait mon logement, c’était parfait », mentionne le PDG de Nucleom, un sourire dans la voix.
Autre occasion saisie quelques mois plus tard quand une rencontre fortuite avec une inconnue dans le métro lui ouvre les portes de l’Institut Max-Planck de physique extraterrestre. Ce fut une expérience marquante pour ce garçon « un peu nerd », selon ses propres termes, amoureux de l’exploration spatiale. Dès son plus jeune âge, il s’enthousiasme pour les innovations technologiques présentées à l’émission Découverte, pendant que les copains et copines de la garderie suivent les aventures de Passe-Partout
Avec le recul, le lauréat du prix Honoris Genius –Entrepreneuriat 2023 de l’Ordre des ingénieurs du Québec constate que ces expériences à l’étranger lui ont donné un solide savoir-être, autrement dit de la débrouillardise, et de bons réflexes sociaux, des outils très utiles quand il fonde Nucleom, en 2010, d’abord seul, puis avec un associé deux ans plus tard. Mais n’anticipons pas.
À son retour au Québec en 2006, la déprime du retour se fait sentir. Son baccalauréat terminé, Olivier Marcotte se cherche un peu. Un de ses camarades d’études, Mathieu Beauchesne, l’introduit chez Métaltec, une entreprise spécialisée dans les essais non destructifs. Pendant deux ans, il découvre ce secteur consacré à l’inspection de haut niveau, dans l’industrie nucléaire, les pâtes et papiers, la pétrochimie. Cette technologie a pour but de sauver des vies avant qu’elles ne soient en danger, comme le résume son collègue de longue date Jean-François Martel.

Passionné par cet univers, le jeune diplômé choisit de voler de ses propres ailes en 2010. La centrale Gentilly-2 lui alloue des contrats pour préparer sa campagne de prévention sur le circuit primaire du réacteur, en mettant au point la documentation, les équipements, le type de formation. Puis, les responsables de certaines centrales nucléaires ontariennes, qui l’avaient connu par réputation et avaient apprécié sa rigueur, le sollicitent.
« C’est un travail de haute précision où l’on utilise des robots pour détecter d’éventuelles fissures dans les réacteurs nucléaires, les tuyaux d’alimentation en eau, les soudures, explique l’ingénieur. Plusieurs des réacteurs CANDU, fabriqués au Canada, sont en fin de vie et il faut surveiller les effets de la corrosion. Nous utilisons différentes technologies pour procéder à ces inspections comme les ultrasons, la radiographie, les courants de Foucault. » Rapidement, les offres de
« Plusieurs des réacteurs CANDU sont en fin de vie et il faut surveiller les effets de la corrosion. Nous utilisons différentes technologies pour procéder à ces inspections. »
Olivier Marcotte, ing. Nucleom
service s’accumulent et la fibre entrepreneuriale d’Olivier Marcotte l’incite à se lancer en affaires en fondant sa propre entreprise, puis à s’associer avec Mathieu Beauchesne.
Prudent, le duo se verse de modestes salaires au début. Il faut garder le maximum de liquidités afin d’investir les centaines de milliers de dollars nécessaires pour acheter les technologies haut de gamme qui servent à procéder aux inspections. L’industrie pétrochimique, éolienne, les mines, les fabricants de poutres pour les ponts ne tardent pas à faire appel à la jeune entreprise Nucleom, installée à Québec au cœur d’un écosystème tourné vers les essais non destructifs.

Lorsqu’on demande à Olivier Marcotte comment on passe en une décennie de 0 dollar à un chiffre d’affaires tournant autour de 40 millions de dollars et à 200 employées et employés – ce qui lui a valu le premier rang pour la croissance d’une entreprise en 2017 à Québec –, il répond : « Je suis entouré d’un personnel
dévoué ; tous les membres de l’équipe travaillent dans l’entreprise comme si c’était la leur. Je dirige beaucoup à l’instinct, de façon organique, en m’entourant de gens différents. Nous prenons plaisir à nous lancer des défis entre nous. J’essaie de laisser leur créativité s’exprimer. »
Après Québec, l’ingénieur en physique a ouvert des bureaux à Montréal, Edmonton et surtout en Ontario, où l’industrie nucléaire connaît un véritable renouveau comme dans de nombreux pays partout sur la planète. Le domaine de l’énergie constitue d’ailleurs le cœur de Nucleom. Récemment, Hydro-Québec a signé une entente avec Nucleom pour la commercialisation de sondes d’inspection de lignes électriques. Le marché du nucléaire américain, tout comme celui de l’Europe, ou de la Corée – qui utilise des réacteurs CANDU – intéresse aussi Olivier Marcotte. Sans parler de l’Afrique, où se déroulent déjà plusieurs projets miniers au Congo et au Burkina Faso. Non, vraiment, le PDG de Nucleom n’a aucun regret !
Parcours d’entreprise
Consultez l’étude en ligne : bit.ly/genie-entrepreneuriat

Selon Sarah Mollier, pour résoudre les problèmes liés aux changements climatiques, il faut miser sur les énergies renouvelables et sur la mixité dans les équipes de travail.
Par Valérie LevéeEn sortant du lycée, Sarah Mollier avait déjà trouvé sa voie : le génie énergétique, et plus précisément les énergies renouvelables. En France, pour intégrer une école d’ingénierie, il faut faire deux ans de classe préparatoire et passer un concours. Bonne élève, Sarah Mollier réussit le concours, mais elle n’est pas acceptée dans l’école de son choix. « Cette école était trop spécialisée en gestion de l’eau ; je voulais un programme plus ciblé sur l’énergie et l’environnement », précise-t-elle. Fidèle à ses aspirations, elle préfère redoubler pour retenter sa chance dans une école qui corresponde mieux à ses champs d’intérêt. La deuxième fois sera la bonne, et elle intègre l’École des mines d’Alès, dans le sud de la France. Comme le programme de cette école inclut une expérience

internationale, elle vise le Québec. « Étant donné que près de 99 % de l’énergie électrique produite au Québec est renouvelable, ça semblait un bon choix de faire des études au Québec », indique Sarah Mollier. Elle s’inscrit alors à Polytechnique Montréal pour faire une maîtrise en génie énergétique. « Polytechnique Montréal offre un programme de maîtrise option Énergies renouvelables, c’était donc dans la continuité de ma spécialisation, poursuit-elle. C’était parfait pour moi ! »

Sa maîtrise la conduit à faire un stage dans les laboratoires de CanmetÉNERGIE, à Varennes, où elle évalue le potentiel des thermopompes pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la flexibilité du réseau électrique. En 2020, elle termine ses études, doublement diplômée : une maîtrise de Polytechnique Montréal et le diplôme d’ingénieure de l’École des mines d’Alès.
Si Sarah Mollier a choisi de venir à Montréal, c’est aussi pour la qualité de vie qui y règne. « Le Québec et la ville de Montréal ont une très bonne réputation à l’étranger pour la qualité de vie et la sécurité. J’avais le choix d’aller dans d’autres villes, mais quand je me demandais où je voulais rester après mes études, c’était le Québec et Montréal qui gagnaient », déclare-t-elle. De fait, sa stratégie d’être diplômée en France et au Québec avait aussi pour but de lui ouvrir plus de portes sur le marché de l’emploi. Cette stratégie s’est avérée fort utile quand la COVID-19 s’est pointée au printemps 2020 alors que la jeune femme faisait son stage à CanmetÉNERGIE. Au lieu de risquer un retour en France, dans un contexte pandémique et un marché de l’emploi hasardeux, elle a préféré rester au Québec et travailler à CanmetÉNERGIE.
Le moment était venu pour elle d’entreprendre les démarches afin d’obtenir le titre d’ingénieure au Québec.
En vertu de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, son diplôme en génie était reconnu par l’Ordre, mais elle devait faire valider trois années d’expérience de travail et réussir l’examen professionnel pour obtenir le titre d’ingénieure de l’Ordre. Comme elle avait à son actif plusieurs stages en entreprise réalisés durant sa formation à Alès en plus de son passage à CanmetÉNERGIE, elle n’a eu aucune difficulté à totaliser trois années d’expérience. C’est maintenant en tant qu’ingénieure qu’elle poursuit son travail à CanmetÉNERGIE. « Finalement, j’aime mon travail, j’aime beaucoup vivre à Montréal ; c’est une ville dynamique et j’ai décidé d’y rester », assure Sarah Mollier. Elle s’implique dans son quartier, elle est bénévole à la Remise, une bibliothèque d’outils qui propose des ateliers de travail du bois, de couture et de réparation de vélo. Sportive, elle se déplace d’ailleurs en vélo.
Au secondaire, Sarah Mollier avait un profil plus scientifique que littéraire. « Ce qui a beaucoup joué, ce sont mes profs, femmes et hommes, qui m’ont donné le goût des sciences. Sûrement que des professeures m’ont influencée, reconnaît-elle. Avoir des modèles féminins dans les matières scientifiques, ça peut aider, on se dit qu’on peut faire comme elles plus tard. » C’est pourquoi elle a participé à la Journée internationale des femmes et des filles de science en février dernier. « C’est important de montrer aux filles que c’est possible d’étudier et de faire carrière en sciences et qu’il y a une place pour elles », affirme-t-elle. La mixité et, plus largement, la diversité sont essentielles pour trouver des solutions aux grands enjeux comme les changements climatiques et, comme Sarah Mollier le dit, « il faut avoir le point de vue des femmes pour résoudre l’équation ».
« Avoir des modèles féminins dans les matières scientifiques, ça peut aider, on se dit qu’on peut faire comme elles plus tard. C’est pourquoi j’ai participé à la Journée internationale des femmes et des filles de science. »
Sarah Mollier, ing. CanmetÉNERGIE
Un pied dans la musique, un autre dans le génie physique, Chloé Pilon Vaillancourt cultive ses deux passions sans fausse honte. Pour cette curieuse inlassable, c’est une façon de garder l’équilibre et de nourrir sa créativité.
Par Pascale Guéricolas Photos : Israel Valencia, Chloé Dulude et Didier Bicep
Pendant que d’autres brident leurs rêves pour se consacrer à un seul objectif, cette diplômée au baccalauréat en génie physique les vit plutôt de front. Autrement dit, Chloé Pilon Vaillancourt s’investit autant dans la physique quantique et la thermodynamique que dans la musique. Un choix fructueux pour cette rappeuse, connue sous le nom de Marie-Gold, qui a déjà produit deux albums et deux microalbums.

En 2018, le Gala alternatif de la musique indépendante salue sa contribution en accordant pour la première fois de son histoire un prix à une femme pour le meilleur « EP rap » ; MarieGold sera de nouveau récompensée en 2021. Et cela n’empêche pas l’étudiante d’obtenir son diplôme de Polytechnique Montréal en génie physique en 2022.
Heureuse aujourd’hui de jongler avec deux passions qui nourrissent sa curiosité insatiable, la jeune femme reconnaît qu’il lui a fallu du temps pour s’afficher au grand jour comme artiste. « J’avais l’impression que, pour le milieu scientifique universitaire, ça avait l’air vulgaire de faire du rap, raconte la chanteuse. En fait, je me suis aperçue que les dirigeants de l’École connaissaient mes chansons, et valorisaient mon côté créatif. »
Pour mieux comprendre comment Chloé Pilon Vaillancourt parvient à faire rentrer deux carrières dans une même vie, il faut remonter à son enfance hyperactive. Quand, à l’âge de
sept ans, elle combinait la lecture, le dessin, les concours d’art oratoire, les dictées, les activités parascolaires. Puis suivent les triathlons, les périples en vélo de plusieurs milliers de kilomètres, jusqu’à cet inoubliable voyage à vélo en Inde, en 2013.
Méditation, yoga, séjours dans des fermes agroécologiques, la jeune femme se laisse porter par la vie et s’abreuve sans retenue à différentes sources de connaissances. C’est justement en jouant dans la terre qu’elle prend conscience de sa fascination pour le monde de la chimie. Cette expérience déterminante dans son cheminement intellectuel l’amène à s’inscrire à un certificat en écologie à l’Université du Québec à Montréal, à son retour à Montréal.
Au moment où elle suit un cours d’initiation en physique nucléaire, elle assiste, émerveillée, à un court-métrage sur la matière noire diffusé au Planétarium de Montréal. Elle entame aussi des discussions avec des étudiantes et des étudiants en physique qui nourrissent son intérêt pour la façon dont les particules évoluent dans l’univers.
En 2016, l’horizon se précise. Après des cours préalables en biologie et en maths, Chloé Pilon Vaillancourt plonge dans le génie pour mettre son amour de la physique au service de son désir d’agir dans une société en pleine tourmente climatique. Oui, mais la musique dans tout ça ? La réponse courte serait de relier Chloé à son père, Gaétan Pilon, propriétaire du fameux Studio Victor à Montréal où ont défilé Jean Leloup, Daniel Bélanger, Mara Tremblay, Catherine Durand. Pourtant, l’arrivée du rap dans sa vie a plutôt coïncidé avec l’envie de mieux connaître un milieu fréquenté par ses amis, et surtout avec le besoin d’exprimer ses sentiments et sa créativité, alors que ses études sollicitaient son côté cérébral.
Sa chanson « Beach Club » sur l’album Bienvenue à Baveuse City, sorti en février 2022, résume bien la propension des humains à conjuguer leurs divergences. Sur un rythme très dansant, la jeune rappeuse envoie
quelques piques aux jeunes de sa génération. En proie à l’écoanxiété face à des changements climatiques qui les dépassent, plusieurs choisissent de se laisser aller à la surconsommation. « Mal à la tête comme à ma terre, jeter serviettes, bouteille à la mer sous le soleil, Bien j’y vois clair, si y’a plus rien à faire autant faire la fête », chante et danse Marie-Gold en concert sur les scènes des quatre coins du Québec.
« La musique m’a aidée à exprimer mon côté émotif durant des études qui sollicitaient beaucoup mon côté rationnel, souligne la jeune femme. J’arrive à la fin de ce cycle-là, et je souhaite désormais faire des sciences jusqu’à la fin de ma vie. » Agir pour l’environnement avec des outils scientifiques apaise un peu son écoanxiété. En 2020, par exemple, la jeune stagiaire a contribué à dresser une carte des zones inondables pour le centre de recherche Takata au Mexique, là où la pollution s’en prend aux barrières de corail. On espère ainsi mieux protéger ce milieu fragile. En plus de son intérêt pour les changements climatiques, la jeune diplômée est également fascinée par la physique des particules et l’intelligence artificielle.
Très attirée par les énergies propres, Chloé Pilon Vaillancourt croit que les innovations responsables vont pouvoir répondre aux besoins de la société. À condition cependant que des règlementations adéquates encadrent l’activité humaine générant des gaz à effet de serre.

Celle qui, pour mieux mener ses recherches, dispose d’un certificat en analyse des données avancées de Google ne voue pas pour autant un culte à la technologie. « Je trouve merveilleux qu’on puisse avoir recours à des innovations comme celles qui sont liées à la séquestration de carbone. Il faut cependant s’assurer dans le même temps qu’un consommateur ne puisse pas commander 15 paquets par jour livrables par Amazon. Sinon, à quoi ça sert ? »

« La musique m’a aidée à exprimer mon côté émotif durant des études qui sollicitaient beaucoup mon côté rationnel. J’arrive à la fin de ce cycle-là, et je souhaite désormais faire des sciences jusqu’à la fin de ma vie. »
Chloé Pilon Vaillancourt
L’Ordre des ingénieurs du Québec réorganise le mode d’engagement des bénévoles en région pour mieux soutenir et amplifier les actions de promotion de la profession. Au cours des prochains mois, les comités régionaux cesseront d’exister sous leur forme actuelle et seront redynamisés pour mettre l’accent sur l’Expérience ambassadeurs/ambassadrices et optimiser le rayonnement de la profession auprès de la relève.
Par Clémence CireauLes comités régionaux existent sous leur forme actuelle depuis 2013. Pendant dix ans, les activités sur le terrain d’information, de formation et de promotion de la profession ont permis un rayonnement du génie et de l’Ordre des ingénieurs dans 11 régions du Québec. En 2021, l’Ordre a créé le Programme de promotion de la
profession (PPP), qui vise à joindre les jeunes de 12 à 18 ans dans les moments stratégiques de leur parcours scolaire afin de susciter leur intérêt pour la profession d’ingénieur et d’assurer la relève de demain. Une attention particulière dans l’approche est portée aux jeunes filles afin d’atteindre l’objectif de l’initiative 30 en 30 d’Ingénieurs Canada.
Dans la continuité de ce programme, la structure des activités bénévoles en région doit évoluer pour fédérer les efforts. « Les actions actuelles des bénévoles des comités régionaux vont se développer différemment, explique Luc Vagneux, directeur du développement de la profession à l’Ordre. Nous souhaitons concentrer nos forces afin d’assurer un axe promotion de la profession encore plus fort. Étant donné que la formation sur le terrain et dans les organisations a pris un virage virtuel depuis la pandémie et que l’Ordre avait déployé la plateforme de formations Maestro en 2018, la diminution du nombre d’activités offertes et de la participation sont des éléments qui ont pesé dans la balance. Par contre, les visites formatives en entreprises demeureront dans les régions ; la formule sera toutefois renouvelée et placée sous la gouverne du Pôle de prévention et de relations avec les contacts auprès des employeurs. »
Les ingénieurs et les ingénieures bénévoles pourront désormais concentrer leurs efforts autour de l’Expérience ambassadeurs/ambassadrices et des activités de promotion de la profession dans leur région. « C’était de fait déjà souvent le cas, les bénévoles des comités régionaux sont aussi généralement des ambassadeurs et ambassadrices, précise Luc Vagneux. Ainsi, ceux et
celles qui souhaitent le rester ou même prendre plus de responsabilités pourront également devenir des ambassadeurs experts et des ambassadrices expertes de la profession au sein de quatre pôles d’actions : la gestion et le développement du PPP, le volet de l’Expérience ambassadeurs/ambassadrices, la gestion des évènements et la coordination des activités sur le terrain. » Les activités se poursuivront sous les mêmes formules : présentations en classe, ateliers scientifiques, kiosques, journées carrière, compétitions scientifiques, etc. « Seulement, on décharge les bénévoles de la gestion et de l’organisation pour qu’ils et elles puissent se concentrer sur la rencontre avec les jeunes. C’est quand même la partie la plus valorisante ! »
Les bénévoles des pôles d’actions de tout le Québec seront en contact les uns avec les autres au cours de rencontres virtuelles afin d’échanger sur les meilleures pratiques. Une fois par an, ils et elles pourront aussi se retrouver à l’occasion d’une journée de rencontres en présentiel. « L’implication bénévole des ingénieurs et des ingénieures reste au cœur du succès du Programme de promotion de la profession, indique le directeur du développement de la profession. Ce sont ces bénévoles qui soutiennent et représentent la profession dans les établissements et activités scolaires. » Grâce à l’engagement des bénévoles dans l’ensemble du territoire, l’Ordre a rencontré plus de 17 000 jeunes en 2022-2023, et a certainement réussi à créer l’étincelle pour que plusieurs décident de faire carrière en génie !

« Les bénévoles des comités régionaux sont aussi généralement des ambassadeurs et ambassadrices. Ainsi, ceux et celles qui souhaitent prendre plus de responsabilités pourront également le faire au sein des quatre pôles d’actions.
»
Luc Vagneux, CRIA Ordre des ingénieurs du Québec
> animer des ateliers scientifiques et présentations dans les établissements scolaires

> faire des parallèles entre le génie et les activités en classe ou le quotidien des jeunes
> faire découvrir une profession inspirante à la prochaine génération

> des ingénieur.e.s et des CPI
> des passioné.e.s par la profession
> des membres de tous les horizons, de toutes les disciplines

Devenez ambassadeur

Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 15 juin 2023, Pierre Morin, ing., (membre no 37198) dont le domicile professionnel est situé à Chicoutimi, province de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir : Protection incendie
« DE PRONONCER la limitation volontaire du droit d’exercice de Pierre Morin, ing. (membre no 37198), en lui interdisant d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elle se rapporte au domaine de la protection incendie. Toutefois, Pierre Morin, ing., pourra exercer dans ce domaine sous la supervision d’un.e ingénieur.e. »
Cette limitation du droit d’exercice de Pierre Morin, ing., est en vigueur depuis le 15 juin 2023.
Montréal, le 17 juillet 2023
Me Élie Sawaya, avocat Secrétaire adjoint et chef des affaires juridiques
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 15 juin 2023, Dominik Dicaire, ing., (membre no 131344) dont le domicile professionnel est situé à Trois-Rivières, province de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir : Protection incendie « DE PRONONCER la limitation volontaire du droit d’exercice de Dominik Dicaire, ing. (membre no 131344), en lui interdisant d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elle se rapporte au domaine de la protection incendie. Toutefois, Dominik Dicaire, ing., pourra exercer dans ce domaine sous la supervision d’un.e ingénieur.e. »
Cette limitation du droit d’exercice de Dominik Dicaire, ing., est en vigueur depuis le 15 juin 2023.
Montréal, le 17 juillet 2023
Me Élie Sawaya, avocat Secrétaire adjoint et chef des affaires juridiques
L’infolettre en
Outils et contenus exclusifs pour gestionnaires
Abonnez-vous !
bit.ly/infolettre_employeur


Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 15 juin 2023, Jean Belley, ing., (membre no 108998) dont le domicile professionnel est situé à Gatineau, province de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir : Charpentes et fondations
« DE PRONONCER la limitation volontaire du droit d'exercice de Jean Belley, ing., en lui interdisant d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elle se rapporte aux sous-domaines des systèmes actifs de protection contre les chutes et des systèmes d’ancrage (potelets, boulons d’ancrage et plaques de base) du domaine des charpentes et fondations. Toutefois, il pourra exercer dans ces sous-domaines sous la supervision d’un.e ingénieur.e. »
« DE LIMITER le droit d'exercice de Jean Belley, ing., jusqu'à ce que les mesures de perfectionnement soient complétées avec succès, en lui interdisant d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs lorsqu’elle se rapporte au sous-domaine des systèmes d’étaiements temporaires, du domaine des charpentes et fondations. Toutefois, il pourra exercer dans ce sous-domaine sous la supervision d’un.e ingénieur.e. »
La limitation volontaire du droit d’exercice de Jean Belley, ing., relative aux sous-domaines des systèmes actifs de protection contre les chutes et des systèmes d’ancrage (potelets, boulons d’ancrage et plaques de base) est en vigueur depuis le 15 juin 2023.
De plus, la limitation du droit d’exercice concernant le sous-domaine des systèmes d’étaiements temporaires est en vigueur depuis le 26 juin 2023.
Montréal, le 26 juillet 2023
Me Élie Sawaya, avocat Secrétaire adjoint et chef des affaires juridiques
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 13 juillet 2023, Paul Renaud, ing., (membre no 20062) dont le domicile professionnel est situé à Gatineau, province de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir : Charpentes et fondations
« DE LIMITER le droit d'exercice de Paul Renaud, ing. (membre no 20062), jusqu'à ce que les mesures de perfectionnement soient complétées avec succès, en lui interdisant d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs, autrement que sous la supervision d’un.e ingénieur.e., lorsqu’elle se rapporte au domaine des charpentes et fondations, à l’exception des activités professionnelles suivantes :
• Inspection et surveillance des travaux (sans conception, sans vérification de conception, sans modification de la conception, à moins d’exercer sous la supervision d’un.e ingénieur.e).
• Vérification de conformité de dessins d’atelier déjà authentifiés par un.e autre ingénieur.e (apposition d’un tampon de vérification ou délivrance d’un avis de conformité séparé, et ce sans conception, sans vérification de conception, sans modification de la conception, à moins d’exercer sous la supervision d’un.e ingénieur.e).
• Analyse et conception de supports et ancrages parasismiques pour des composants non structuraux et équipements (autres que ceux destinés à la protection incendie et ceux contenant des matières toxiques, explosives ou dangereuses) de bâtiments appartenant aux catégories de risque « faible » ou « normal » décrites à la partie 4 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction du Québec (chapitre B-1.1, r. 2). »
Cette limitation du droit d’exercice de Paul Renaud, ing., est en vigueur depuis le 21 juillet 2023.
Montréal, le 21 août 2023
Me Élie Sawaya, avocat Secrétaire adjoint et chef des affaires juridiques
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 15 juin 2023, le Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec a prononcé la radiation du membre dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut de se conformer aux obligations de la formation continue obligatoire conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
Cette décision est effective depuis le 17 juillet 2023.
Nom Prénom
Domicile professionnel
Abikhzer Michael Joseph MONTRÉAL
Montréal, le 17 juillet 2023
Me Pamela McGovern, avocate
Secrétaire de l’Ordre et directrice des affaires juridiques
Veuillez communiquer avec le Service de l’accès à la profession (514 845-6141 ou 1 800 461-6141, option 1, ou par courriel : sac@oiq.qc.ca) afin de vérifier si les personnes dont le nom n’est pas suivi d’un astérisque ont régularisé leur situation depuis le 17 juillet 2023.
Conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 6 juin 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré John Vathis, dont le domicile professionnel est situé à Montréal, province de Québec, notamment coupable de l’infraction suivante :
« À Montréal, entre le ou vers le 21 août 2020 et le 9 février 2022, en laissant et/ou permettant à un non-ingénieur de conserver une copie de son sceau et en le laissant l’utiliser, l’ingénieur John Vathis a manqué d’intégrité, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs »
Le Conseil de discipline a imposé à John Vathis, au regard de l’infraction, une période de radiation de trente (30) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel. En conséquence, John Vathis est radié du tableau de l’Ordre pour 30 jours à compter du 9 juillet 2023 jusqu’au 7 août 2023 inclusivement.
Montréal, le 6 juillet 2023
Josée Le Tarte Secrétaire du Conseil de discipline
Conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 2 août 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec a déclaré Yann Tremblay, dont le domicile professionnel est situé à Shawinigan, province de Québec, coupable de l’infraction suivante :
« À Trois-Rivières, au cours du mois de novembre 2021, et entre le ou vers le 12 et le 15 novembre 2021, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’ingénieur Yann Tremblay a recouru ou s’est prêté à des procédés malhonnêtes et douteux en dissimulant des processeurs à son employeur, lorsque celui-ci le requérait, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs »
Le Conseil de discipline a imposé à Yann Tremblay, au regard de cette infraction, une période de radiation de cinquante (50) jours à être purgée à l’expiration des délais d’appel. En conséquence, Yann Tremblay est radié du tableau de l’Ordre pour 50 jours à compter du 6 septembre 2023 jusqu’au 25 octobre 2023 inclusivement.
Montréal, le 6 septembre 2023
Josée Le Tarte
Secrétaire du Conseil de discipline
Du 26 mai au 14 août 2023 (période de réception des avis)
L’Ordre des ingénieurs du Québec offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées suivantes :
GÉRALD ROBERT SCOTT BROMONT
YVES FORTIN QUÉBEC
Pour nous informer du décès d’une ou d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : sac@oiq.qc.ca
Conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, voici les renseignements concernant les prochaines séances d’examen :
Pour vous inscrire à une séance, vous devez vous rendre sur la plateforme d’inscription. Vous trouverez le lien vers la plateforme sur le site de l’Ordre à la rubrique Je suis – Candidat à la profession d’ingénieur (CPI). Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle aux numéros suivants : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, option 1. En conformité avec la Loi sur la langue commune et officielle du Québec, le français, cet examen est administré en français. Toutefois, les candidats et candidates qui se qualifient pour un permis temporaire selon l’article 37 de la Charte de la langue française peuvent obtenir un exemplaire bilingue du questionnaire.
VOUS N’AVEZ PAS FOURNI À L’ORDRE UNE ADRESSE COURRIEL ?
Vous devez fournir à l’Ordre une adresse courriel, laquelle doit être établie à votre nom (art. 60 du Code des professions). Cette adresse doit être fonctionnelle et vous permettre de recevoir les communications de l’Ordre.
VOUS DÉMÉNAGEZ OU CHANGEZ D’EMPLOI ?
Vous devez aviser le secrétaire de l’Ordre de tout changement relatif à votre statut, à vos domiciles résidentiel et professionnel, aux autres lieux où vous exercez la profession et à votre adresse courriel, si nécessaire, et ce, dans les 30 jours du changement (art. 60 du Code des professions).
VOUS AVEZ ÉTÉ DÉCLARÉ.E COUPABLE D’UNE INFRACTION CRIMINELLE OU
PÉNALE OU FAITES L’OBJET D’UNE POURSUITE CRIMINELLE ?
Vous devez informer le secrétaire de l’Ordre que vous avez été déclaré.e coupable, au Canada ou à l’étranger, d’une infraction criminelle ou disciplinaire ou que vous faites l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction passible de cinq ans d’emprisonnement ou plus, et ce, dans les 10 jours où vous êtes informé.e de la décision ou, selon le cas, de la poursuite (art. 59.3 du Code des professions).
Pour apporter des modifications à votre profil, rendez-vous sur votre portail membres.oiq.qc.ca
Permis d’ingénieures et ingénieurs délivrés par le Comité d’admission à l’exercice de l’Ordre des ingénieurs du Québec du 22 mai au 30 juillet 2023
Aberbour, Nabil
Abou Arrage, Patrick
Abou Rjeily, Jad
Agachi, Igor
Agozzino, Claudia
Ajmi, Zakaria
Ajouamai, Zakaria
Akaffou, Stella-Malicia
Aksakal, Volkan
Alexandre, Philippe
Allaire, Julianne
Allard, Émilie
Allemand, Bérangère
Amache Salazar, Alexander Antonio
Amouzegar, Ehsan
Angui, Jessica
Aouad, Peter Alexander
Arutyunyan, Lusine
Aseervatham, Jessica
Ashby, Emily
Asjad, Aqeel
Asselin, Olivier
Assiani, Rahma
Auclair, Antoine
Aury, Martin
Ayad, Abdel
Ba, Ndeye Seynabou
Bacon, Cédrik
Badrieh, Chelesty
Bahrami, Maysam
Bakhouche, Mohamed
Balihuta, Alain Miruho
Ballouk, Salim
Barboux, Brian
Bassily, Moheb
Bauret, Nicolas
Bazinet, Alexandre
Bazyar, Hassan
Bea Jaramillo, Alberto
Beauchamp, Étienne
Beauchamp-De Géry, Thomas
Beauchemin, Caroline
Beauchesne, Antony
Beaudet, Alexandre
Beaulé, Edouard
Beaulieu, Jason
Beaulne, Danyk
Beausoleil, Simon
Beiko, Thierry
Bélair, Alec
Belguidoum, Reny
Belhachemi, Fatima Ez-Zahra
Bellalou, Akemdin
Ben Hassine, Ghada
Ben Romdhane, Youssef
Benchakar, Younes
Bennett, Charlotte
Benterkia, Abdelhafid
Bergeron, Nicolas
Bernier, Camille
Bertot, Joël
Bérubé, Samuel
Betrous, Maged
Beya Balufu, Joel
Bigo, Olivier
Bilodeau-Lecomte, Éloïse
Bisaillon, Simon
Bisson, Frédéric
Bisson, Mathieu
Blanchette, Mélina
Boily, Laurence
Boily-Auclair, Emile
Boivin-Rioux, Jean-Charles
Bordeleau, Julien
Boucetta, Jihad
Bouchard, Jésis
Bouchard, Olivier
Bouchard, Pierre-Olivier
Boucher, Luc
Boucher, Samuel
Boudier, Jérôme
Boulanger, Rémi
Boulianne, Étienne
Boulianne, Guillaume
Bourassa, Julien
Bourassa, Renaud
Bouthillette, Francis
Boyé Guité, Emeric
Branchaud, Alex
Breton Vincent, Guillaume
Briand, Jordon
Brière, Dominic
Brouillette, Cameron
Bruel, Charles
Bureau, Arnaud
Camargo Salinas, Alexandra
Carbonaro, Carlo
Cardinal, Thomas
Caron, Chloé
Castel, Privaël
Castello Fatala, Gisele Augusta
Castillo-Buca, Vlad Chabot, Hubert Chabot, Louis Chahine, Charbel Chahine, Ralph Champagne-Fawer, Francis
Chapotard, Vincent Charest, Olivier Chartré-Bérubé, Samuel Chehboub, Samy Cherif-Touil, Amine Chowdhury, Soumya Sundar Cloutier, Côme Collin, Louis-Michel Concha Fernandez, Diego Corne, Raphael Corrigan, Jason Côté, Joey Côté, Olivier Côté, Raphaël Côté, Samuel Cumming, Bryan Cunningham, Nicolas Cusson, Charlotte Dadoun, Kevin Daigle, Alison Dal Mas, Ambre Dandurand, Charles-Olivier
Danita, Ioan Vladimir Daoust, Guillaume Daure-Cagnol, Pierre-Emmanuel David-Poulin, Stéphanie
Delobel, Philippe
Demelo Craveiro, Anthony
Dena, Diby
Deniau, François Deraps, Francis
Des Roches, Mathieu
Desbiens, Jean-Nicolas
Desmarais-Lebel, Sam
Desormeaux, Frédéric
D'esteve De Pradel, Olivier
Dion, Marc-Antoine
Dionne, Jean-Philippe
Disanski, Mihail
Dodier, Vincent
Dorosti Hasan Kiadeh, Sahar
Doskotch, Kenneth
Doucet, Guillaume
Douville, Josy-Anne
Drexler, David
Dubé, Jean-Christophe
Dubé, Michaël
Dufresne, Justine
Dumas, Catherine
Dumont-Grant, Maggie
Dupont, Vincent
Duquette, Marie-Danielle
Duval, Nicolas
El-Chami, Ismail
El-Haddad, Christelle
El-Outari, Karim
Elshebshiry, Moustafa
Ennaifer, Emira
Erfanian Mazin, Hooman
Eshraghian, Sirous
Estimable, Wilfrid
Junior
Ezzahiri, Abdelhalim
Fafard, Frédéric
Favreau, Alexandre
Ferrari Arredondo, Sylvana
Fillion, Maxime
Forsley Levesque, William
Fortin, Eva
Fournier, Jean-Philippe
Fournier, William
Frémont, Charles
Gagné-Lemire, François-Emmanuel
Gagnon, Frédéric
Gagnon, Mathieu
Gagnon, Nathan
Gagnon, Rémi
Gagnon, Rémi
Gagnon, Samuel
Gagnon-Proulx, Anthony
Gallien, Simon
Garneau, Brittany
Garnier, Camille
Gauthier, Jonathan
Gauthier-Thibodeau, Sandrine
Gauthier-Wong, Maxime
Gauvin, Pierre-Olivier
Gérard, Nicolas
Gervais, Marc-Antoine
Ghanem, Jean Mark
Gignac, Frédérick
Gill, Marie-Philippe
Gingras, Bryan
Gingras, Danny
Girard, Alexandre
Girouard, Philippe
Gobeil, Philippe
Godard, Maxime
Gomes Brito, Alexandre
Goudekelian, Anthony
Gratton, Félix
Guay, Francis
Guay, Philippe
Gueye, El Hadj Matar
Guyot, Quentin
Hafdi, Abderrazak
Hamed, Hussein
Hamel, Patricia
Hamilton, Anne-Marie
Hamimi, Mohamed Tahar
Hanfaoui, Essalek
Amine
Harton, David
Harvey, Raphaël
Harvey-Rhéaume, Charles
Hassini, Noureddine
Hénault, Pier-Alexandre
Henley, Anna
Hernandez Diaz, Juan Pablo
Hetmanchuk, Katja
Hogben, Christopher
Hombach, Yoann
Houndjiffo, Tossavi Paul
Hounkponou, Sévérin Eusèbe
Hounmènou, Edouard Calixte
Huot, Emilie
Imhof, Marie-Pier
James, Audrey-Anne
Jayaratnam, Janet
Jdi, Wafaa
Jean, Christian
Jean, Johnny
Jeanty, Koestler
Jetté, Nicomaque
Jodoin, Andréanne
Johnson, Marc
Joly, Jacques-Olivier
Jouault, Erwan
Kabore, Abdoul
Kadi, Amine
Kadiri, Abderrahman
Kapungwe, Greg
Karimi, Mina
Kechad, Mohammed
Nadir
Khorchani, Wissem
Khraibani, Diala
Khushiram, Chaulesh
Chand
Kidon, Dominika
Kiniffo, Guy Francis
Klanjian, Krikor Gregory
Klouch, Lahouari
Kono Tamko, Hartmann Narcisse
Kordane, El Mehdi
Kouané Nana, Marc Alex
La Frenière, Alexandre
Labelle, Benjamin
Labrecque, Alexandre
Lacaze, Jean Henri Xan
Lafond, Frédéric
Lahmani, Fatine
Lajoie-Dansereau, Vincent
Lakebedj, Samir
Lambert, Julien
Lamontagne, Maxime
Langevin, Hubert
Languérand, Audrey
Lapierre, Alexandre
Lapierre, Marc-André
Lapointe, Alexandre
Lapointe, Julien
Larocque, Marc-Olivier
Larouche, Jean-François
Laurin, Mickaël
Lavallée, Mégane
Lavertue, Simon
Lavoie, Eliane
Lavoie, William
Léal, Céleste
Leclerc, Gabriel
Leclerc, Jean-François
Leroy, Louis
Lethuillier, Vincent
Levasseur, Guillaume
Lévesque Thibodeau, Marc-Antoine
Lewis, Gabriel
Limbourg, Raphael
Lok, Christopher James
Louis, Alain
Lynch, Ludovic
Madingu, Njila Kinzumba
Mahrour-Venturelli, Célia-Nour
Maillefort, Lauriane
Mainville, Eve
Mainville, Valérie
Maistre, Fabien
Maltais, Alexandre
Maltais, Louis-Gabriel
Mandor, Ahmed
Mohamed Ahmed
Maniraguha, Benjamin
Marcotte, Renaud
Marcoux, Pier-Luc
Maréchal, Justin
Marinodominguez, Miguel
Mariz-Denis, Simon
Martin, Laurence
Masoumi Verki, Mona
Massé, Léandre
Mbiakop, Steve
Mc Crae, Nicolas
Mcinnes, Philip
Melhado, Silvio
Méndez Aguirre, José Leonel
Mendze Kameni, Jordan Tresor
Miraval, Guillaume
Monfette, Thomas
Montplaisir, Kaèle
Mopi Yonga, Hervé
Morandini, Léonard
Moreau, Félix
Morel-Andrade, Dario
Morin, Arthur
Moundai, Hamza
Mungedi, Mireille
Nsompo
Murphy, Jean-Francois
Murray, Samuel
Myal, Malika
Nadir, Wiam
Nassar, Emad
Nde K Tameghe, Edmond Brice
Nearing, Andrew Neth, Volker Noël, Antoine Noreau, Antoine Nsairia, Amine Obas, Klaus-Fabien
Olarte Navarro, Bertha Maria Ortega, Hector Otmani, Souhila Ouazani, Hafida
Ouédraogo, Franck Julien Damien
Ouellet, Anthony
Ouellet, Jean-Cédric Pagé, Dany Pagé, Nicolas Palmieri, Leandro Pamen Heubo, Gaëtan Joël
Paquin, Olivier Paquin, Samuel
Patel, Pankaj Pelleray, Marjorie
Pépin Sirois, Émile Pereira, Rodrigo
Périgny, Samuel Perreault, Félix Perron, Jean-Michel Perron-Abran, Pascal
Petkova, Nataliya Pigeon, Nicolas
Poirier, Louis Poirier, Maxime
Poissant, Roxanne
Pongo Nyoumea, Guillaume
Pophali, Ameya
Poulin, Maxime
Pourshargh, Farshad
Provencher, Yan
Quintini, Laura
Quirion, Alexis
Racette, Alexandre
Rachedi, Reda
Rainville, Antoine
Rammal, Nasri
Razavet, Aristide
Reuter Schlickmann, Pedro
Rezaeinouri, Mehran
Riopel, Alexandre
Rochais, Sylvain
Rodriguez Cachaya, Edwin
Rojas, Euclides Antonio
Rondeau-Millaire, Samuel
Rouhani, Hassan
Roussin, Laurence
Roy, Alain
Roy, Nicolas
Roy, Vincent
Roy-Blais, Catherine
Roy-Boutet, Jocelyn
Royer, Olivier
Sakr, Etienne
Salem, Wassim Jean
Samlani, Rachid
Sauce Franchi, Jesus
Felipe Heriberto
Schrauwen, Chris
Séguin, Mathieu
Seica, Michael
Serrano-Parent, Benoît
Shanmugalingam, Jalaja
Sharifi, Bita
Sharifzadeh, Alireza
Shelton, Spencer
Simard, Emile
Simard, Allan
Singh, Gurman
Singh, Prabhjot
Sivapatharajah, Thukarasha
Slama, Mourad
Slim, Iheb
Slimani Houti, Yacine
Smith, Jason
Sparling, Colin
St-Jean Beaudin, Tommy
Stock, Antoine
Suassuna De Andrade
Ferreira, Regelii
Sultana, Sormin
Tan, William
Tanoh, Danzo
Tardif, François
Tassé, Simon
Tauffenberger, Nicolas Xavier
Tayeb, Djamal
Tchouanhou Tayo, Steven
Temimi, Mehdi
Tétreault, Marie-Gabrielle
Thamsuwan, Ornwipa
Themens, Alexandre
Thériault, Francis
Thibodeau, Vincent
Tian, Haoyun
Tougas, Edouard
Touyon, Ludovic
Trachy-Cloutier, Justin
Traversy, Guillaume
Tremblay, AnneFrédérique
Tremblay, Benoît
Tremblay, Jean-Simon
Tremblay, Marc-André
Tremblay, Maude
Tremblay, Maxime
Tremblay, Paul
Tremblay, Roxane
Tremblay, Simon
Tremblay, Stéphanie
Tremblay, Vincent
Trépanier-Desjardins, Mathieu
Trudel, Francis
Turki, Abderrahmen
Vachon, Miguel
Valiquette, Joel
Van Den Berg, Neil
Venne, Stéphane
Vinchon, Manuela
Wendmy
Vu, Nicolas
Walker, Jeremy
Williams, Sandra
Yip, May-Yee Wendy*
Younes, Kamal
Younsi, Khaireddine
Zacca, Antoine
Zaoui, Mohamed Aziz
Zerhouni, Ansar
Zouari, Youssef
* Titulaire d’un permis temporaire pour un projet particulier. Pour plus de détail contactez l’Ordre.
d’ingénieures et ingénieurs délivrés par le Comité d’admission à l’exercice de l’Ordre des ingénieurs du Québec du 22 mai au 30 juillet 2023
Ce numéro marquant le 60e anniversaire de votre revue Plan vous réserve quelques surprises !
Vous aurez l’occasion de plonger dans le monde fascinant des ingénieures et ingénieurs ayant de l’expertise dans les travaux subaquatiques et qui conçoivent, inspectent et gèrent des infrastructures immergées. Et bien sûr, ne manquez pas l’occasion de faire la connaissance de plusieurs membres de l’Ordre dans des portraits inspirants.
Tout cela et bien plus encore à lire dans le numéro de novembre-décembre 2023 de votre revue Plan.
Vous êtes ingénieure ou ingénieur ou candidate ou candidat à la profession d’ingénieur (CPI) et vous travaillez dans les domaines :

• de l’intelligence artificielle
• des infrastructures et du transport
• de la gestion des risques
Faites-vous connaître et partagez votre expérience dans votre revue Plan en écrivant à plan@oiq.qc.ca
La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec
60 ans de Plan – Travaux subaquatiques
À découvrir dans le prochain numéro de plan.
... aux ingénieures et aux ingénieurs du Québec pour ces 60 années à lire la revue Plan. Vous informer et vous faire découvrir le génie d’ici est notre engagement !











