DOSSIERS
Formation
Polytechnique
Montréal
150 ans
Maud Cohen, ing.
Polytechnique version féminine

La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec


DOSSIERS
Formation
Polytechnique
Montréal
150 ans
Maud Cohen, ing.
Polytechnique version féminine


X 31 MARS 2023
date limite pour compléter vos 30 heures de formation
X 15 AVRIL 2023
date limite pour déclarer vos formations dans votre portail. Ayez le bon réflexe, déclarez-les dès que vous les avez suivies !
30 JUIN 2023 :
Date limite pour récupérer, si vous le souhaitez, vos anciennes pièces justificatives sauvegardées dans le répertoire « Documents FCO archivés » de votre portail (onglet Reçus et autres documents).
1er JUILLET 2023 : Les pièces justificatives archivées, de fournisseurs autres que l’Ordre, seront détruites. Cette mesure est conforme aux bonnes pratiques en matière de technologies de l’information qui recommandent notamment que les organisations conservent un minimum d’information sur leurs serveurs.
IMPORTANT : Durant la période d’inscription annuelle (du début février à la fin mars 2023), l’accès aux pièces justificatives archivées sera temporairement suspendu.
60 55 11 66 67 69
GÉNIE À L’AFFICHE
SAVIEZ-VOUS QUE...
COMITÉS RÉGIONAUX AVIS AVIS DE RADIATION
(Formation continue obligatoire) NOUVELLE COHORTE D’INGÉNIEURES ET INGÉNIEURS EN TITRE
MOSAÏQUE
Fondé en 1920, l’Ordre des ingénieurs du Québec a comme mission d’assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieures et les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité dans l’intérêt du public.
Conseil d’administration
2022-2023
Région 1 • Grande région de Montréal
Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. ing, DESS
Sandra Gwozdz, ing., FIC Carole Lamothe, ing.
Béatrice Laporte-Roy, ing.
Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA
Nathalie Martel, ing., M. Sc. A., PMP
Région 2 • Autres régions
Maxime Belletête, ing.
Christine Mayer, ing., M. Sc. A.
Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC
Région 3 • Grande région de Québec
Marco Dubé, ing.
Michel Paradis, ing., M. Sc.
4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec
Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA
Alain Larocque, CRHA, ASC
Diane Morin, MBA
Catherine Nadeau
Directeur général
Louis Beauchemin, ing.
Directrice des communications
Marie Lefebvre
Rédactrice en chef
Sandra Etchenda, réd. a. 514 845-6141, poste 3123 setchenda@oiq.qc.ca
Graphisme
Turcotte design
Photos
Denis Bernier
Benedicte Brocard
Israel Valencia
Maquillage
Stéphanie Villemaire
Révision et correction
Marie-Andrée L’Allier
Collaboration
Clémence Cireau
Robert Gagnon
Me Martine Gervais
Marie-Julie Gravel, ing.
Pascale Guéricolas
Mélanie Larouche
Margot Lecat
Valérie Levée
Me Patrick Marcoux
Philippe-André Ménard, ing.
Christian Renault, ing.
PUBLICITÉ
Dominic Desjardins
CPS Média inc.
450 227-8414, poste 309
Plan est publié 6 fois par année par la Direction des communications de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La revue vise à informer les membres sur les conditions de pratique de la profession d’ingénieur et sur les services de l’Ordre. Plan vise aussi à contribuer à l’avancement de la profession et à une protection accrue du public. Les opinions exprimées dans Plan ne sont pas nécessairement celles de l’Ordre. La teneur des textes n’engage que les auteurs.
Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans Plan ne sont en aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. Le statut des personnes dont il est fait mention dans Plan était exact au moment de l’entrevue.
Nous appliquons les principes de la rédaction épicène.
Envoi de Poste-publications • no 40069191
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec • Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0032-0536
Droits de reproduction, totale ou partielle, réservés ® Licencié de la marque Plan, propriété de l’Ordre des ingénieurs du Québec 1801, avenue McGill College, 6e étage Montréal (Québec) H3A 2N4 514 845-6141 1 800 461-6141 514 845-1833 oiq.qc.ca
Diffusion
62 601
Tirage
16 700 exemplaires
Impression
Imprimeries Transcontinental inc.
Cette revue est imprimée sur du papier carboneutre.
Joignez-vous au réseau LinkedIn de l’Ordre bit.ly/LinkedInOIQ
Échangez sur divers sujets d’ingénierie facebook.com/oiq.qc.ca
Restez branchés sur l’actualité twitter.com/OIQ
Suivez notre actualité en vidéo bit.ly/YoutubeOIQ
Abonnez-vous à notre compte Instagram instagram.com/ordreingenieursqc
Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions plan@oiq.qc.ca
Chères consœurs, chers confrères,
Ce numéro principalement consacré à la formation en génie et au 150e anniversaire de la fondation de Polytechnique Montréal est l’occasion pour moi de parler de la contribution des ingénieures et des ingénieurs au développement du Québec. Le génie a été la pierre angulaire de la construction du Québec moderne. Et aujourd’hui plus que jamais, nous avons un rôle significatif à jouer pour trouver des solutions durables et relever les principaux défis technologiques et environnementaux.
L’année 2023 marque le 150e anniversaire de Polytechnique Montréal. C’est le moment opportun pour souligner l’apport de cette institution à la prospérité du Québec. Fondée en 1873, durant la révolution industrielle, l’École Polytechnique de Montréal est devenue une référence en génie au Québec et au Canada, que ce soit pour l’enseignement de haut niveau qu’on y donne ou pour ses activités de recherche reconnues dans le monde entier. Ses diplômés et diplômées ont participé à la réalisation des grands ouvrages et à la plupart des travaux d’envergure du XXe siècle ayant permis le développement économique du Québec.
Polytechnique Montréal exerce aussi une grande influence dans le développement de la profession d’ingénieur. Elle favorise le sens entrepreneurial ainsi que la rigueur, et elle accorde une importance particulière à la diversité et à l’inclusion (atteinte de la cible de 30 % d’étudiantes en génie) ainsi qu’au développement durable.

Étant donné que nous sommes le premier ordre professionnel carboneutre et que nous avons comme objectif de réduire les émissions GES à la source, la question de l’innovation en matière de développement durable me tient particulièrement à cœur.
Dans le cadre de notre mission, nous voulons nous assurer que nos membres sont suffisamment outillés pour répondre aux défis du développement durable. En ce sens, l’Ordre a collaboré avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC) de l’Université Laval, le consortium de recherche Ouranos, l’Ordre des architectes du Québec et l’Ordre des urbanistes du Québec afin de concevoir une formation sur l’adaptation aux changements climatiques. Elle vous sera offerte en ligne sur la plateforme Maestro à compter du printemps 2023 (voir l'article sur le sujet à la page 12).
La formation en génie doit être évolutive pour répondre aux nouveaux besoins de la société, aussi bien sur les plans technologique, environnemental et économique que social. Ce contexte de changements et de transformation est bien détaillé dans l’étude Profil de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain publiée par l’Ordre (bit.ly/etude-profil-ingenieur). En effet, cette étude nous éclaire sur les grandes tendances qui auront des effets sur la profession d’ingénieur au cours des dix prochaines années, des orientations qui laisseront
la place à de nouvelles industries et de nouvelles disciplines, ce qui nécessitera d’acquérir de nouvelles compétences.

Ainsi, 81 % des ingénieures et des ingénieurs sondés considèrent que l’intelligence artificielle aura des répercussions importantes sur l’avenir de la profession, de même que la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Cela dit, de nouvelles disciplines gagnent en intérêt et connaissent une nette croissance. Pensons aux domaines liés aux changements climatiques (génie de l’environnement, génie des eaux) et aux logiciels (génie informatique, intelligence artificielle, cybersécurité).
Parallèlement, de nouvelles habiletés et compétences
membres estiment que trois compétences essentielles non techniques se retrouveront au cœur du travail des ingénieures et des ingénieurs en 2030 : la gestion du changement, l’intelligence émotionnelle et les relations interpersonnelles, ainsi que la programmation informatique.
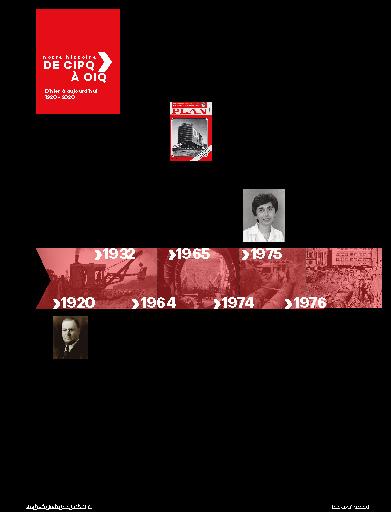
Enfin, c’est avec une grande fierté que l’Ordre célèbre cette année le 60e anniversaire de la revue bimestrielle Plan. La revue de l’Ordre des ingénieurs du Québec représente, depuis 1963, l’écho de l’évolution du génie en mettant en valeur des profils d’in

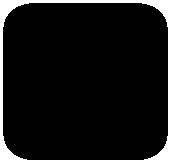

D’abord gestionnaire de projets en lien avec les technologies, l’ingénieure Maud Cohen – qui a été notamment présidente de l’Ordre puis PDG de la Fondation

CHU Sainte-Justine – devient la première directrice générale de Polytechnique Montréal depuis sa fondation il y a 150 ans.
Portrait d’une amoureuse du génie au service des gens.
Par Pascale GuéricolasPhoto : Denis Bernier
Àl’automne 1989, la jeune Maud Cohen s’interroge sur son avenir. Elle avait longtemps rêvé de médecine, mais se sent peu d’affinités avec la biologie après une année au cégep, même si elle apprécie beaucoup les maths et la physique. Survient alors en décembre la tragédie de Polytechnique. Ébranlée par le drame, elle découvre aussi du même coup une profession dont elle avait très peu entendu parler. « À cette époque, les choix pour les filles en sciences se limitaient souvent aux professions de la santé ou à la comptabilité quand on aimait les mathématiques, se souvient-elle. Tout le bruit autour de
Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC Polytechnique Montréal

cette école où des femmes étudiaient en génie m’a donné envie de me lancer dans ces études. » Voilà donc comment cette première de classe, élevée à SaintLouis-de-Terrebonne – une banlieue où la forêt n’avait pas encore disparu –, se retrouve propulsée dans la grande ville.
L’atterrissage ne se fait pas forcément en douceur. Éblouie par sa nouvelle liberté, l’étudiante mord à pleines dents dans la vie sociale, s’implique dans des associations, découvre la fête… et constate que les bonnes notes ne sont plus au rendez-vous. Certaines auraient peut-être abandonné le génie à ce stade. Pas la future directrice de Polytechnique Montréal. Elle y puise plutôt une motivation pour relever ses manches et poursuivre son cheminement scolaire.
Cette leçon de résilience, la jeune Maud Cohen l’a mise en pratique dès l’école secondaire dans les années 1980. Parfois rejetée par ses camarades parce qu’elle est trop studieuse, l’adolescente expérimente l’adversité. Elle dispose cependant d’une alliée de taille, sa cousine, qui vit non loin de chez elle, et elle se fait de nouvelles amies. Bien intégrée dans un clan familial tissé serré, la jeune fille comprend la force que représentent les liens développés avec les autres pour recevoir du réconfort ou tester ses idées.
Elle applique cette philosophie de vie dès ses premières années de génie. Comment ? En prenant sa place au sein d’un groupe, des amis et amies qui l’accompagnent toujours plusieurs décennies plus tard. C’est d’ailleurs sous leur impulsion que l’étudiante s’oriente vers le génie industriel, une discipline qui la séduit parce qu’elle est axée sur la logique et la logistique. En 1996,
Maud obtient un baccalauréat avec une spécialité en robotique ; elle est prête à voyager à l’étranger pour découvrir de nouveaux horizons.
Embauchée par Walsh Automation Inc., puis Walsh Europe Limited principalement en Grande-Bretagne et en France, la gestionnaire de projets participe à l’automatisation manufacturière, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, secoué par une série d’événements marquants (erreurs de production, empoisonnement, etc.). Le suivi des lignes de production et d’information sur les conditions d’exécution deviennent des actions majeures pour assurer la traçabilité des lots.
En 2001, l’activité ralentit du côté de l’Europe ; la jeune ingénieure et son conjoint français s’interrogent sur l’opportunité de revenir au Québec. Maud Cohen considère les postes de décision des organisations de la France, mais estime qu’ils sont encore trop peu ouverts aux femmes pour vouloir y rester. Cap sur l’Amérique du Nord pour le couple ; Maud Cohen revient chez Walsh Automation (devenue Systèmes Invensys Canada) et voyage fréquemment aux États-Unis, puis en Ontario.
C’est alors que Dominique Anglade, son amie de promotion à Polytechnique, entre en action. Elle, qui l’avait orientée vers le génie industriel, lui souffle une nouvelle idée. « Dominique commençait un MBA à HEC Montréal ; cette formation pouvait se faire tout en travaillant, indique la directrice de Polytechnique Montréal. J’ai trouvé très pertinent d’approfondir mes connaissances en gestion, pour raffiner certaines notions comme la stratégie organisationnelle, la gestion financière, les habiletés de gestion. »
« J’ai trouvé très pertinent d’approfondir mes connaissances en gestion, pour raffiner certaines notions comme la stratégie organisationnelle, la gestion financière, les habiletés de gestion. »
Son MBA en poche en 2004, Maud Cohen poursuit son travail de gestionnaire de projets reliés à la technologie, tout en songeant à déployer ses ailes d’administratrice. Un article paru dans Plan l’incite à présenter sa candidature au Conseil d’administration de l’Ordre, et elle devient administratrice en juin 2004. Surprise ! Non, elle est élue présidente en juin 2009, et on lui confiera trois mandats successifs, jusqu’en 2012. Ces années furent marquantes pour une profession alors secouée par les scandales dévoilés au grand jour par la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. L’affaire démarre en octobre 2011 à la suite de la fuite du « rapport Duchesneau ».
« Dès 2009, il nous est rapidement apparu important de demander la tenue d’une commission d’enquête, raconte l’ingénieure. Comme organisme de protection du public, nous visions un idéal de pratique touchant aussi l’éthique de nos membres. Cela me semblait primordial de corriger les problèmes en jeu pour l’ensemble de la société, et d’adopter de saines règles de gouvernance. Il ne faut pas oublier que les contrats concernés étaient payés avec de l’argent public. »
Cette soif d’idéal et ce besoin d’agir dans les affaires publiques, citoyennes, son engagement dans la communauté la poussent ensuite à s’investir en politique.
À l’occasion des élections de 2012, elle brigue le poste de députée de la circonscription de Laval-des-Rapides pour la Coalition avenir Québec (CAQ), alors présidée par Dominique Anglade. Ce nouveau parti l’attire par son discours de promotion du nationalisme québécois, détaché de la souveraineté. La candidate voit dans le programme de cette formation une façon pour le Québec d’aller plus loin dans ses ambitions, et de faire davantage de place à l’éducation.
Arrivée troisième dans cette circonscription remportée par Léo Bureau-Blouin du Parti québécois, Maud Cohen assume ensuite pendant un an la présidence du Conseil national de la CAQ ; ce sera l’occasion pour elle de s’imprégner des rouages des partis politiques et du fonctionnement du Parlement. Puis, elle conjugue divers mandats, notamment ceux d’administratrice à Aéroports de Montréal et chez Gestion FÉRIQUE ;
elle enseigne aussi à titre de chargée de cours à HEC Montréal, sans oublier l’accompagnement de son jeune fils dans son cheminement scolaire au primaire.
En 2014, Maud Cohen entre en fonction comme présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, un poste auréolé d’une forte mission sociale liée aux sciences, dont rêve la gestionnaire soucieuse d’influer sur le cours des choses pour améliorer la vie des mères et des enfants du Québec. « Ma formation en génie m’a beaucoup rapprochée des centres de recherche qui disposent des meilleurs professionnels et d’équipements de pointe, souligne-t-elle avec enthousiasme. Je possédais les outils scientifiques pour bien comprendre les besoins des chercheurs et chercheuses et les rendre accessibles à nos donateurs pour qu’ils se mobilisent. »
Celle qui figure dans la liste des « 100 femmes leaders de l’avenir » de la revue Entreprendre en 2010 et 2018 met tout en place pour appuyer la stratégie de recherche du CHU Sainte-Justine. Elle contribue à financer notamment le recrutement de jeunes chercheurs et chercheuses et leurs travaux en génomique et en thérapie cellulaire, ainsi que des équipements de soins d’avant-garde.
On l’aura compris, la dirigeante de Polytechnique Montréal rêve d’une technologie au service des populations, dont les priorités se discutent par une collaboration renforcée au sein de groupes élargis. C’est d’ailleurs cette vision qu’elle apporte à Polytechnique Montréal. Première femme à la diriger depuis sa création en 1873, Maud Cohen milite pour une grande ouverture à l’autre, que ce soit les femmes ou les personnes les plus diverses possible. Cet engagement se traduit également par sa volonté d’augmenter l’ampleur de l’influence positive de Polytechnique Montréal sur la société.
À l’aube du 150e anniversaire de Polytechnique Montréal, Maud Cohen est bien déterminée à y arriver. Fière que cet établissement d’enseignement ait atteint sa cible de 30 % d’effectif féminin, sa directrice veut faire partie d’une société qui encourage tout un chacun à s’impliquer, pour une plus grande créativité et un avenir durable et inclusif.



En novembre dernier, Kathy Baig, ing., a été nommée vice-présidente, Positionnement et développement, de la firme d’ingénierie Stantec. Celle qui a occupé la présidence de l’Ordre des ingénieurs du Québec de 2016 à 2022 contribue désormais à la croissance et au rayonnement de la firme, où elle dirige les opérations d’un important groupe en transports, qui voit à l’amélioration de la mobilité dans la région.
Au cours de sa carrière, Kathy Baig a siégé à de nombreux conseils d’administration pour des entreprises privées et des organismes à but non lucratif, notamment dans les secteurs des transports, des technologies et des arts
Abonnez-vous à votre InfoGénie régional bit.ly/abonnement_igr


Accédez au portail et dans vos consentements sélectionnez
« Activités informatives et de réseautage »



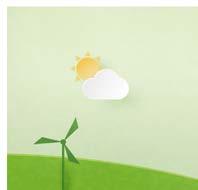


Pour faire face aux défis climatiques, l’Ordre des ingénieurs du Québec souhaite proposer des solutions concrètes à ses membres. Un nouvel outil sera mis à leur disposition dès le printemps : une formation transdisciplinaire sur l’adaptation aux changements climatiques dans l’environnement du bâti.
Par Clémence CireauTout a démarré lorsque l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC), situé à l’Université Laval, et le consortium Ouranos ont obtenu du financement du ministère québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de Ressources naturelles Canada pour élaborer une formation sur les adaptations aux changements climatiques destinée aux ingénieurs et ingénieures, aux architectes et aux urbanistes. L’Ordre des ingénieurs du Québec, l’Ordre des architectes et l’Ordre des urbanistes, les trois pôles concernés par l ’environnement du bâti, apportent leur contribution au projet. « Les impacts négatifs des changements climatiques ne sont plus uniquement de l’ordre de projections pessimistes, leurs conséquences affectent déjà notre quotidien, soutient Luc Vagneux, directeur du développement professionnel à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Étant donné leur rôle dans la société, les ingénieurs et ingénieures doivent adapter leurs pratiques
professionnelles au plus vite. Ils et elles pourront ainsi être au cœur de la solution. »
La formation en ligne d’une quinzaine d’heures sera offerte à partir du printemps sur l’interface Maestro de l’Ordre. Le parcours de formation se présentera en cinq modules, tous pouvant être suivis individuellement. Les trois premiers porteront sur les concepts clés de la lutte contre les changements climatiques, sur l’évolution du climat et sur les concepts liés à l’adaptation aux changements climatiques. « Le langage est la pierre angulaire qu’il faut maîtriser pour comprendre les changements climatiques, affirme Luc Vagneux. Les membres de l’Ordre doivent savoir de quoi il est question, comment en parler, à quelles sources se fier. Sinon, comment défendre et porter des projets novateurs en ce qui concerne les changements climatiques ? D’autant plus que les solutions d’adaptation, bien que
nécessaires, sont parfois plus onéreuses en amont, ce qui peut rebuter les clients. »
Luc Vagneux précise que les trois premiers modules de la formation sont pertinents pour tous les membres ; les deux derniers modules s’adressent plus spécialement aux ingénieures et ingénieurs exerçant dans le domaine du bâti. « Cette formation transversale entre le génie, l’architecture et l’urbanisme permet de souligner la complémentarité des trois expertises et de mettre en évidence les collaborations. »

Cette formation est une première pierre servant à outiller les ingénieurs et ingénieures afin de relever les défis à venir. L’OQACC compte réaliser une étude pour comparer la pratique des ingénieures et des ingénieurs avant et après la formation. « L’objectif est d’offrir de nouveaux horizons pour passer aux étapes suivantes, comme des approches plus spécifiques dans certains domaines. La formation sera bien sûr adaptée au fil de l’évolution des connaissances. »



Des heures de formations déclarées automatiquement dans votre dossier de formation continue

« Cette formation transversale entre le génie, l’architecture et l’urbanisme permet de souligner la complémentarité des trois expertises. »
Luc Vagneux, CRIA — Ordre des ingénieurs du Québec
Les dessins d’atelier d’armature pour fabrication et installation doivent-ils être préparés et authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure ?
Si la réponse à cette question demeurait parfois floue à ce jour pour vous, les précisions contenues dans cet article dissiperont tous vos doutes.
Règle générale, les dessins d’atelier d’armature sont préparés par le fournisseur (fabricant ou entrepreneur) et soumis à un donneur d’ouvrage avant le début des travaux. Mais la préparation des dessins d’atelier d’armature estelle une activité professionnelle réservée aux ingénieures et ingénieurs ? Telle est la question. Simon Rodier, ing., est inspecteur à la surveillance de l’exercice à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Dans le cadre de ses fonctions, il lui arrive de rencontrer des membres et des donneurs d’ouvrage qui hésitent sur la marche à suivre. « Il existe une croyance selon laquelle ces documents ne nécessitent jamais d’être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure. Ce n’est pas exact. Même si dans la grande majorité des cas ils n’ont effectivement pas à être authentifiés par un ou une membre de l’Ordre, il peut arriver que leur authentification par un ingénieur ou une ingénieure soit requise. » Des règles s’appliquent ; elles
s’arriment à la Loi sur les ingénieurs ainsi qu’au Code de déontologie des ingénieurs Conséquemment, la connaissance de ces textes de loi facilite grandement la prise de décision.
Tout d’abord, rappelons que les ingénieurs et ingénieures ont, en vertu de leur code de déontologie, un devoir professionnel de préparer des plans et devis complets et sans ambiguïté. Ils et elles doivent donc s’assurer que toutes les informations nécessaires à la fabrication et à l’installation des barres d’armature sont indiquées aux plans et devis. Dans le cas où les plans et devis du donneur d’ouvrage sont fondés sur des dimensions standards contenues dans des guides pratiques reconnus, comme le Manuel des normes recommandées de
Par Christian Renault, ing.l’Institut d’acier d’armature du Canada (IAAC), la référence doit être précise et ne laisser aucune place à l’interprétation ou à la déduction afin que la dimension à utiliser puisse être directement extraite du document (par exemple d’un tableau).
Dans le cas moins fréquent où le donneur d’ouvrage choisit de confier la conception de certains éléments d’acier d’armature à l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur, le devis doit en faire clairement mention afin d’éviter toute ambiguïté sur la responsabilité de la conception des armatures.
Le plus souvent, les dessins d’atelier d’armature du fournisseur ne comportent aucune conception d’ingénierie, car l’entièreté de la conception et des informations requises pour la fabrication et l’installation des barres d’armature est montrée sur les plans et devis du donneur d’ouvrage. Dans ces conditions, les dessins d’atelier d’armature n’ont pas à être authentifiés par l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur, car ils ne font que représenter sa compréhension de ce que le donneur d’ouvrage demande ou encore la méthode qu’il entend utiliser.

Il se peut que certaines précisions aux plans et devis soient requises pour la bonne compréhension des travaux à réaliser. Par exemple, dans le cas où une référence à un guide pratique n’est pas suffisamment détaillée, porte à interprétation et ne permet pas d’extraire du document des dimensions précises sans l’avis d’un ingénieur ou d’une ingénieure, le fournisseur devrait alors en informer le donneur d’ouvrage ou lui transmettre une ou des propositions (ex. : QRT - question-réponse technique) afin que ce
dernier produise de nouveaux plans (ou révisions de plans) signés et scellés.
Dans tous les cas où le fournisseur exerce une activité de conception, les dessins d’atelier d’armature doivent être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure, car ils complètent la conception indiquée aux plans et devis du donneur d’ouvrage. Dans un tel cas, pour bien circonscrire sa responsabilité, l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur doit identifier clairement les éléments qu’il ou elle a conçus sur les dessins (par exemple à l’aide d’un symbole). Afin de respecter ses obligations déontologiques et d’assurer une compréhension optimale ainsi que la sécurité de l’ouvrage, l’ingénieur ou l’ingénieure du fournisseur qui modifie ou ajoute des informations aux plans et devis du donneur d’ouvrage doit aviser l’ingénieur ou l’ingénieure qui les a préparés. Il ou elle peut, du même coup, discuter avec cette personne des ajouts ou des précisions proposés.
Habituellement, les fournisseurs d’acier d’armature n’exercent pas une activité réservée aux membres de l’Ordre lorsqu’ils préparent les dessins d’atelier d’armature en conformité avec les plans et devis du donneur d’ouvrage. Ainsi, ces dessins n’ont pas à être authentifiés par un ingénieur ou une ingénieure. Cependant, il peut y avoir des situations moins fréquentes – comme nous l’avons expliqué ci-dessus – où la préparation des dessins d’atelier d’armature est réservée aux membres de l’Ordre et où les dessins d’atelier doivent donc être authentifiés par l’ingénieur ou l’ingénieure qui les a préparés
Par
Me MartineGervais, avocate Chef d’équipe de la gestion des demandes d’enquête et conseillère juridique au Bureau du syndic et Philippe-André Ménard, ing. Syndic adjoint
L’indépendance professionnelle est l’une des valeurs au cœur de la confiance du public envers la profession : elle garantit aux clients une prestation de services axée sur leurs besoins et leur intérêt, à l’abri de pressions ou d’influences indues.
Mais qu’en est-il de cette valeur dans un contexte de relations de travail, où les ingénieures et ingénieurs salariés ont un devoir de loyauté et d’honnêteté1 envers leur employeur, et alors qu’ils et elles agissent sous la direction ou le contrôle d’un employeur2 ?
D’abord, il va de soi que les membres de l’Ordre doivent refuser toute demande de leur employeur qui irait notamment à l’encontre des lois et règlements en vigueur. C’est une évidence.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (CDOIQ) dans le cadre d’une plainte opposant un ingénieur cadre de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et un ingénieur salarié quant à la production d’un rapport d’accident. Dans sa décision, le CDOIQ cite le Tribunal des professions3 :
« [128] Un client ou employeur ne peut pas exercer de pression indue
sur un professionnel pour que ce dernier pose un acte qui irait va [sic] à l’encontre de l’intérêt public, viole son code d’éthique ou une loi quelconque, commette un acte criminel, exécute des travaux qui vont à l’encontre des règles de l’art ou de la bonne pratique, etc. Le lien de subordination dans la relation employeur-employé ne peut justifier le professionnel-employé d’agir à l’encontre de son Code de déontologie adopté dans l’intérêt public. […] »
Par ailleurs, en vertu de l’article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur a l’obligation d’« exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, [...] si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions ».
Il doit de plus, en vertu de l’article 3.01.01 du Code de déontologie, « tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer » avant d’accepter et d’exécuter un mandat.
Que faire si une ingénieure ou un ingénieur salarié estime que les paramètres fournis par
son employeur (orientation, délais, budget, intrants, etc.) sont incompatibles avec une prestation de travail professionnelle ?
D’abord, en tant que personne exerçant une profession, il ou elle devra aviser par écrit son employeur qu’il ou elle ne croit pas avoir toutes les informations, les intrants, les connaissances ou encore le soutien nécessaire pour mener à bien le mandat que son employeur veut lui confier.
Mais en tant que personne salariée, il ou elle devra tenter de trouver une solution acceptable, consensuelle, pour répondre malgré tout aux attentes de son employeur. Par exemple, il serait possible de circonscrire la portée de son mandat, ou encore d’exposer les hypothèses qu’il ou elle a dû faire, ou bien formuler les mises en garde qu’il ou elle juge appropriées, etc.

Finalement, l’ingénieure ou l’ingénieur salarié pourrait ultimement aviser son employeur qu’il ou elle considère ne pas être en mesure d’accomplir avec professionnalisme le mandat ou les tâches qu’on veut lui confier4. Il ou elle devrait alors expliciter ses raisons, toujours par écrit, raisons qui pourraient éventuellement être contestées par son employeur. Évidemment, cela ne signifie pas pour autant que l’ingénieure ou l’ingénieur salarié doit quitter son emploi, mais dans un tel contexte de divergence de vues, certaines instances pourraient être appelées à trancher5
Mais l’indépendance professionnelle et l’autonomie qui l’accompagne ne sont pas absolues.
L’ingénieur ou l’ingénieure doit reconnaître que son employeur, tout en limitant son ingérence, n’est pas totalement indifférent : il n’est pas indifférent aux
coûts, aux délais, aux risques, et pour ce qui est du contenu, il peut très bien ne pas être indifférent tant sur le fond que sur la forme.
L’employeur peut aussi demander régulièrement à une ingénieure ou un ingénieur salarié de rendre des comptes, sous une forme ou une autre. L’ingénieur ou l’ingénieure doit donner suite à une telle demande, comme le prescrit explicitement l’article 3.03.03 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert. »
Pour ce qui est du contenu, sur le fond, certes, l’employeur ne doit pas « museler » un ingénieur ou une ingénieure à son emploi, mais il peut très bien chercher et adopter une opinion contraire6
Est-ce que l’employeur doit pour autant justifier son choix auprès d’une ingénieure ou d’un ingénieur salarié, particulièrement lorsque le représentant de l’employeur, le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate, est aussi une personne membre de l’Ordre ? Est-ce que l’ingénieure ou l’ingénieur salarié concerné peut exiger un suivi, des réponses ou encore des analyses supplémentaires ? La réponse est non, il ou elle ne peut pas l’exiger ; et en de telles circonstances, la suite des choses – discussion, rétroaction, réaffectation – est du domaine des relations de travail et n’est plus une question déontologique.
Pour ce qui est de la forme, dans le cadre de son droit de gérance, un employeur pourrait par exemple imposer un vocabulaire normalisé au sein de l’entreprise, exiger plus de concision dans un rapport, limiter la portée d’une enquête aux seules causes techniques, etc.
Encore ici, le CDOIQ cite le Tribunal des professions7 :
« [129] Le droit de [l’employeur] prévu par le contrat de travail doit se comprendre et peut s’exercer “parallèlement” au droit
d’indépendance [du professionnel] dans la mesure où les demandes de l’employeur […] ne vont pas à l’encontre de l’intérêt public, de la loi ou du Code de déontologie. L’indépendance professionnelle n’est ni absolue, ni ne signifie que [le professionnel] employé peut faire ce qu’il veut. »
Et dans le cas précis sur lequel devait se prononcer le CDOIQ, ce dernier conclut8 : « [77] […] En l’espèce, il ne semble pas que la demande de correction de [l’ingénieur-cadre] faite à [l’ingénieur] va à l’encontre de l’intérêt public ou qu’il lui impose de commettre un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou dérogatoire à la discipline ou à son ordre. Le Comité considère que les modifications demandées par [l’ingénieur-cadre] n’étaient nullement contraires à l’intérêt public et que [l’ingénieurcadre], en se faisant, n’a pas limité l’autonomie professionnelle de [l’ingénieur] et rejette en conséquence le premier chef de la plainte. »
L’indépendance professionnelle est une valeur importante, qui est d’ordre public. Mais ce n’est pas un absolu : c’est un continuum dynamique qui oscille continuellement entre autonomie et subordination au gré du contexte et des situations.
Par ailleurs, dans un contexte de relations de travail et de droit de gérance, l’indépendance et l’autonomie professionnelles dont bénéficie une ingénieure ou un ingénieur salarié ne lui donnent pas plus de pouvoirs décisionnels ou opérationnels que son statut d’emploi ne lui confère.
Tout ingénieur salarié, toute ingénieure salariée doit s’attendre, à un moment ou à un autre de sa carrière, à ce que ses avis et opinions soient remis en question par son employeur. Le fait que cet employeur demande des explications et des précisions supplémentaires, consulte d’autres professionnels ou ignore les conclusions d’un rapport ou d’une étude ne constitue pas en soi une atteinte à l’indépendance ou à l’autonomie professionnelles de l’ingénieur ou de l’ingénieure
1. Voir l’article 2088 du Code civil du Québec : « Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. « Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. »
2. Voir l’article 2085 du Code civil du Québec : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. »
3. Dans sa décision (Ingénieurs c. Bélanger, CDOIQ, 22-01-0003, 17 novembre 2008), le CDOIQ cite le Tribunal des professions dans l’affaire Couture c. Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) 2005 QCTP 95, paragraphe 128.
4. C’est ce que précise l’article 3.03.04 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :
a) le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute ;
b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux ;
c) le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur. »
5. Parmi ces instances, il y a par exemple un tribunal d’arbitrage pour les ingénieures et ingénieurs syndiqués ou la CNESST pour les ingénieures et ingénieurs non syndiqués.
6. Voir l’article 3.01.04 du Code de déontologie des ingénieurs : « L’ingénieur doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur et, dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier. »
7. Op. cit.
8. Op. cit.
Du 13 février au 31 mars 2023
Avant le 31 mars
Connectez-vous à votre portail : membres.oiq.qc.ca

Renouvelez votre inscription au tableau de l’Ordre
Payez votre cotisation
Complétez vos heures de formation continue
obligatoire
Par
Le Service de la surveillance de la pratique illégale (SSPI) reçoit régulièrement des signalements quant à l’utilisation de mentions telles « B. Ing. » et « M. Ing. » par des personnes non inscrites au tableau de l’Ordre. Pareilles situations sont aussi fréquemment mises au jour par les enquêteurs du SSPI sur le terrain.
Bien souvent, les personnes qui utilisent ces mentions expliquent aux enquêteurs du SSPI qu’elles ne font que reproduire ce qui est inscrit sur leur diplôme universitaire. Bien que cela puisse être vrai, il n’en demeure pas moins que cette pratique peut contrevenir à la Loi sur les ingénieurs et au Code des professions, et ainsi rendre ces personnes passibles d’une amende d’au moins 2 500 $.

Les textes pertinents se trouvent aux paragraphes 2e et 3e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs et à l’article 32 du Code des professions. Ces dispositions prévoient ceci :
Loi sur les ingénieurs

« Nul ne peut, s’il n’est ingénieur : […]
2º prendre le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs ;
3º utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’ingénieur lui est permis ou s’annoncer comme tel ; […] » (Nous soulignons.)
Code des professions
« Nul ne peut de quelque façon prétendre être […] ingénieur ni utiliser […] un titre
et Me Patrick Marcoux, avocat« B. ING. » ET « M. ING. » !
ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est […] s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre […] » (Nous soulignons.)
La contravention au paragraphe 2e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs est simple à comprendre : les désignations B. Ing. et M. Ing. reprennent l’abréviation du titre d’ingénieur, à laquelle est ajouté le qualificatif « B. » ou « M. », selon le cas.
Quant à la contravention au paragraphe 3e de l’article 22 de la Loi ou à l’article 32 du Code des professions, le contexte de l’utilisation des désignations B. Ing. et M. Ing. revêt une grande importance, car le législateur utilise les termes « susceptible de » ou « pouvant laisser croire ». La question qui occupera alors le ou la juge est de déterminer à qui « laisser croire ».
Dans l’analyse d’un chef d’infraction porté sous le paragraphe 3e de l’article 22 de la Loi ou de l’article 32 du Code des professions, le tribunal devra se demander « à qui » le comportement reproché peut bien « laisser croire » qu’on a affaire à un ingénieur.
La jurisprudence nous enseigne que ce « qui » est la personne raisonnable prenant connaissance des désignations B. Ing. ou M. Ing., en tenant compte du contexte de leur utilisation. Le test juridique que le juge doit appliquer est le suivant : on doit se mettre « dans la position d’une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites, sans qu’elle doive vérifier les lois ou consulter des dictionnaires avant de requérir les services d’un professionnel1 ». (Nous soulignons.)
Ce test a été appliqué dans un dossier d’appel concernant l’Ordre, porté devant la Cour supérieure2 Il était reproché au défendeur d’avoir utilisé des cartes professionnelles portant la mention B. Eng., alors qu’il agissait comme inspecteur préachat d’une résidence. Le juge a conclu3 que même si l’inspection préachat n’est pas réservée aux membres de l’Ordre, elle peut néanmoins être réalisée par un ingénieur ou une ingénieure et donc être raisonnablement considérée comme faisant partie du travail des membres de l’Ordre. Par conséquent, l’utilisation de l’abréviation B. Eng. dans ce contexte laisserait une personne raisonnable conclure qu’elle fait affaire avec un ingénieur ou une ingénieure.
Le juge enchaîne avec un cas hypothétique : la situation ne serait-elle pas inverse s’il s’agissait d’un fleuriste qui utilisait la mention B. Eng. sur sa carte professionnelle ? Il conclut que la situation est différente. En effet, sachant que le commerce des fleurs

n’est généralement pas associé à la profession d’ingénieur, la personne raisonnable ne devrait pas conclure que le fleuriste est ingénieur4
Dans un jugement plus récent concernant des faits similaires5, la Cour supérieure reprend ces propos. Dans cette affaire, il était reproché au défendeur d’avoir utilisé la désignation B. Ing. dans des courriels échangés avec un dessinateur technique pour des projets de conception d’installations septiques. Le défendeur envoyait au dessinateur des directives spécifiques concernant les installations septiques et signait le courriel en ajoutant la mention B. Ing. à la suite de son nom. La juge du procès et le juge de la Cour supérieure ont conclu qu’une personne raisonnable viendrait à comprendre du contexte qu’elle avait affaire à un ingénieur. Le défendeur a porté le jugement en appel. La conclusion de culpabilité a été maintenue.

Dans le Guide de pratique professionnelle, l’Ordre rappelle que le finissant ou la finissante d’un programme universitaire en génie ne devient pas automatiquement membre de l’Ordre. Ainsi, il ou elle ne peut utiliser le titre d’ingénieur. L’Ordre souligne également que les grades universitaires
(B. Ing., M. Ing., B. Eng., M. Eng.) peuvent être utilisés, dans la mesure où le contexte ne laisse pas croire :
• que la personne est membre de l’Ordre ;
• que la personne est autorisée à exercer une activité professionnelle réservée à un ingénieur ou une ingénieure au Québec.
La contravention au paragraphe 2e de l’article 22 de la Loi sur les ingénieurs est généralement manifeste et évidente : une personne utilise le titre d’ingénieur ou son abréviation, sans être membre de l’Ordre. La preuve de ce comportement est aisée pour le poursuivant et ne prête guère à interprétation.
L’utilisation de grades universitaires (B. Ing., par exemple) n’est pas en soi illégale. Cependant, c’est la juxtaposition de cette utilisation à un contexte tel que cela ferait croire à une personne raisonnable qu’elle est en présence d’un ou d’une membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui vient cristalliser l’infraction. Le contexte de l’utilisation du grade universitaire sera donc mis en preuve et apprécié globalement par le tribunal, par la lorgnette de la « personne raisonnable ».
1. Lessard c. Ordre des acupuncteurs du Québec, 2005 QCCA 832, paragraphe 8. 2. Ordre des ingénieurs du Québec c. Bensoussan, 2017 QCCS 2921. 3. Idem, paragraphe 92. 4. Idem, paragraphe 97.Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est l’un des instruments de placement les plus connus. Pour cause, ses caractéristiques en font un accélérateur de croissance idéal pour financer certains projets et sa retraite.
Première caractéristique du REER : les rendements générés par les placements sont libres d’impôt jusqu’à leur retrait. Grâce au rendement composé, cet avantage fiscal est un puissant levier pour atteindre l’autonomie financière.
Les cotisations au REER sont déduites de votre revenu imposable. Sans effort additionnel, vous pourriez augmenter vos épargnes chaque année grâce au remboursement d’impôt.
En réduisant le revenu net imposable, vous pourriez avoir accès à des programmes et des allocations, ou en augmenter les sommes reçues, comme les allocations familiales, les crédits d’impôt remboursables et les subventions au REEE.

Sous certaines conditions, le Régime d’accession à la propriété (RAP) vous permet de retirer jusqu’à 35 000 $ du REER sans payer d’impôt pour votre mise de fonds. Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) permet, quant à lui, de retirer jusqu’à 20 000 $ pour financer un retour aux études.
CONCOURS : 20 000 $ EN PRIX À GAGNER
Cotisez à votre REER ou CELI avant le 1er mars chez Services d’investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE, et courez la chance de gagner l’un de nos 20 prix de 1 000 $.

Selon Renée Houde, professeure retraitée de l’Université du Québec à Montréal et l’une des pionnières du mentorat au Québec, le but du mentorat est de révéler la personne mentorée à elle-même afin qu’elle découvre son propre potentiel d’expansion. Dans le contexte postpandémique actuel, il est essentiel de tisser des liens sociaux tout en s’enrichissant de l’expérience et des connaissances des autres par le mentorat.

Je ne vais rien vous apprendre, l’être humain est un être fondamentalement social. Il a besoin des autres pour vivre, survivre et se développer. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses discussions informelles de qualité ont été malheureusement remplacées par de simples messages par visioconférences ou ont été complètement annulées. Ces moments d’échanges réels qui sortaient du cadre professionnel pouvaient s’avérer indispensables au développement de votre carrière. Le mentorat est une façon intéressante de continuer à vous développer sur les aspects intangibles de votre carrière en génie ou encore en gestion.
Bien qu’il présente de nombreux avantages au quotidien, le télétravail est aussi un fléau pour les relations interpersonnelles. Les recherches récentes montrent une augmentation du sentiment d’isolement depuis le début de la pandémie. À travers des conversations de qualité, la relation de mentorat vient donc créer un lien social
dans notre univers actuel où prévalent la surinformation constante et l’individualisme (Houde, 20031).
La pénurie de main-d’œuvre est un sujet d’actualité, c’est maintenant une évidence ! Dans un tel contexte, le mentorat est un levier sous-estimé pour contrer la guerre des talents. Les programmes de mentorat instaurés dans une entreprise favorisent la transmission de savoirs. Mais au-delà de cet effet positif, ils améliorent également la rétention des employés. En effet, une étude faite par Deloitte2 révèle que 68 % des personnes ayant accès à un mentor ou une mentore dans l’organisation où elles travaillent comptent y rester pendant plus de cinq ans. Cette proportion n’est de que de 32 % pour les personnes qui n’avaient pas de mentor ou de mentore.
Par ailleurs, l’environnement de travail étant de plus en plus virtuel, il est nécessaire de trouver des solutions concrètes pour
permettre à la fois la continuité et le renouvellement du sentiment d’appartenance des employées et employés. Un programme de mentorat peut aider à maintenir et à renouveler la culture gagnante de votre équipe, ainsi que celle de toute l’organisation à long terme.

Il va sans dire que la relation avec votre mentor ou mentore repose sur une certaine compatibilité entre les personnalités, d’où l’importance de faire un choix judicieux. Le but est de créer une fusion avec une personne de confiance qui encourage votre potentiel, vous ouvre des perspectives et vous voit plus loin et par-delà ce que vous êtes. Il est également primordial de choisir
une personne qui possède de bonnes habiletés communicationnelles et relationnelles.
Lorsque vous aurez trouvé la personne qui vous mentorera, vous devez savoir qu’elle n’est pas là pour vous donner les réponses à toutes vos interrogations. Eh oui, ayez des attentes réalistes quant aux « miracles » qu’un mentor ou une mentore peut faire ! En effet, il ou elle n’ouvrira jamais les portes de la réussite à votre place, mais cette personne vous fera profiter de son expérience et de ses connaissances afin de vous permettre de les ouvrir.
En conclusion, la meilleure façon de s’initier au mentorat est de prendre le risque et de ne pas hésiter. Parfois, il faut se lancer pour savoir si on tombe ou si on vole… L’essentiel est d’avoir vécu l’expérience et d’apprendre à travers ça. Bon mentorat!
VISITEZ
 1. Renée Houde, « La vie adulte, un long fleuve non tranquille », Le Devoir, 23-24 août 2003, série « Que sont nos rites devenus ? ».
2. Deloitte, « The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning over theNext Generation of Leaders », 2016, deloitte.com.
1. Renée Houde, « La vie adulte, un long fleuve non tranquille », Le Devoir, 23-24 août 2003, série « Que sont nos rites devenus ? ».
2. Deloitte, « The 2016 Deloitte Millennial Survey: Winning over theNext Generation of Leaders », 2016, deloitte.com.
L’Attestation Stationnement écoresponsable pour vous distinguer auprès de vos clients.

Les responsables de la formation en génie offerte dans les programmes universitaires s’adaptent aux nouvelles réalités de la profession d’ingénieur, au cœur des enjeux de notre société. Petit tour d’horizon des offres en gestation.
Par Pascale Guéricolas
Avant de devenir présidente de l’Ordre, Sophie Larivière-Mantha a participé à la planification de la modernisation de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, à Montréal. Formée en génie de la production automatisée avec une concentration en technologie de la santé, l’ingénieure gérait habituellement des équipements médicaux. Pour ce projet, son rôle diffère. « Comme il s’agit d’équipements de plus en plus connectés,
dont les données doivent être accessibles rapidement aussi bien sur la tablette du médecin que dans le dossier numérisé du patient, il faut gérer beaucoup de données sur différents supports, expliquet-elle. Mon équipe était aussi chargée du volet technologique, ce qui implique la question de l’intelligence des données pour que tout le personnel soignant y ait accès. Je ne suis pas ingénieure informatique, mais, comme cheffe de service, je
devais m’assurer que nos différents spécialistes s’arriment afin de promouvoir un environnement humain, efficace et soutenu par la technologie, un des principes directeurs du projet. »
Cette expérience récente a permis à l’ingénieure Sophie LarivièreMantha de prendre conscience du rôle de chef d’orchestre qui incombe de plus en plus aux ingénieurs et ingénieures. Souvent placés au centre des prises de décision, ils et elles ont en outre à faciliter le dialogue entre des personnes exerçant divers métiers et professions et employant des vocabulaires distincts. Cette nouvelle réalité est bien décrite dans l’étude Profil

de l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain, publiée par l’Ordre en avril 2021. bit.ly/etude-profil-ingenieur
Ce document met l’accent sur trois compétences d’avenir, qui gagneront en importance chez les ingénieures et ingénieurs. La première concerne la gestion du changement et la capacité d’adaptation, compte tenu par exemple de la présence de plus en plus importante de l’intelligence artificielle. La seconde suggère de mieux se former à la gestion de données massives, à la programmation informatique, à la cybersécurité qui ne relève plus seulement des diplômés et diplômées en génie informatique, tandis que la troisième, et non la moindre, porte sur l’intelligence
émotionnelle. Une qualité à cultiver car les problèmes à résoudre se complexifient et mobilisent des équipes de travail toujours plus diverses et variées.
Conscients de l’importance de former des diplômées et diplômés dotés d’une grande rigueur intellectuelle et ayant aussi des connaissances pluridisciplinaires, les établissement d’enseignement du génie prennent les grands moyens pour y parvenir. Plusieurs optent pour un décloisonnement des disciplines. À l’Université Laval,
« Mon équipe était aussi chargée du volet technologique, ce qui implique la question de l’intelligence des données pour que tout le personnel soignant y ait accès. »
Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA Ordre des ingénieurs du Québec
la Faculté des sciences et de génie offre aux étudiants et étudiantes une flexibilité dans leur parcours scolaire. « Nous sommes la seule université francophone au Canada à donner des cours dans ces deux domaines au sein d’une même instance facultaire, ce qui favorise la formation interdisciplinaire, souligne le doyen, André Zaccarin, ing. Chez nous, par exemple, un étudiant en génie minier peut suivre des cours de géologie afin d’en apprendre davantage sur les sondages dans le sous-sol pour trouver des minéraux. Des ponts sont lancés aussi entre les génies logiciel et informatique, entre les génies civil et mécanique. »
Pour l’avenir, le doyen plaide aussi pour une formation ouverte vers les autres facultés du campus. Les étudiants et étudiantes pourraient ainsi s’inscrire à 12 crédits en management, en design ou en arts, histoire de stimuler leur créativité et leur capacité à innover.
On partage aussi cette conception à l’École de technologie supérieure (ÉTS), qui forme un ingénieur sur quatre au Québec. « Aujourd’hui,
la pratique du génie a changé, constate le directeur de l’ÉTS, François Gagnon, ing. Aux connaissances générales indispensables pour exercer cette profession, il faut ajouter l’impact social que produisent certaines technologies ou projets, sans parler des conséquences sur l’environnement. »

François Gagnon cite ainsi l’exemple du cellulaire, qui devient une extension de nos vies en stockant les photos personnelles, sans parler du rôle de cet outil dans la mise en contact sur les réseaux sociaux. Faut-il, par exemple, brider ses capacités pour limiter la dépendance des utilisateurs comme le moteur d’une voiture ? Ou revoir sa forme ? Ce sont des questions auxquelles pourraient répondre des professeurs et professeures venant de domaines comme la philosophie, le design ou l’éthique, qui font maintenant partie de l’équipe pédagogique de cette école. Des artistes pourraient s’y ajouter dans un avenir proche.
Régulièrement, des étudiants et étudiantes de l’École de design de Nantes, en France, participent d’ailleurs aux innovations développées au Centech, un incubateur d’entreprises créé par l’ÉTS. C’est une façon pour les ingénieures et ingénieurs en émergence de se frotter à une autre réalité. Les laboratoires en équipe, une pratique mise en œuvre dans les cours, forment aussi les étudiantes et étudiants à apprendre à travailler ensemble, une compétence aussi développée au sein des clubs et regroupements étudiants qui conçoivent des véhicules solaires, des drones ou des tout-terrain amphibies. En promouvant de façon soutenue la participation à ces activités, la direction de l’établissement constate que plus de 10 % de la collectivité étudiante y participe et vit une expérience étudiante très formatrice.
La Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke poursuit aussi un objectif semblable en regroupant
« Les ingénieurs et ingénieures de demain doivent être en mesure de travailler en équipe interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, mais aussi d’aiguiser leur capacité d’écoute réelle et d’ouverture. »
Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC Polytechnique Montréal
depuis deux ans des étudiantes et étudiants des génies mécanique et électrique autour de projets majeurs de conception, mais aussi celles et ceux qui étudient en génie informatique et en génie robotique. Ensemble, les équipes imaginent et fabriquent des prototypes fonctionnels. « Il s’agit de notre deuxième cohorte, et déjà on voit que les projets issus d’équipes mixtes sont plus avancés qu’avant, indique le doyen, Jean Proulx, ing. De plus, l’évaluation porte non seulement sur le produit, mais également sur la façon dont les membres du groupe ont travaillé ensemble. »
À la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, les étudiants et étudiantes en génie logiciel et génie informatique collaborent
aussi ensemble à des projets de conception, tout comme celles et ceux inscrits en génie électrique et en génie physique. Voilà une manière de développer l’intelligence émotionnelle, de plus en plus recherchée par les employeurs.
« Les donneurs d’ordre, comme les municipalités ou les ministères, ont de nouvelles contraintes quant aux infrastructures, par exemple, mentionne Audrey Langlois, conseillère principale Main-d’œuvre et affaires publiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les ingénieures et les ingénieurs doivent tenir compte aussi bien des besoins des citoyennes et citoyens que des exigences liées au développement durable ; il faut être capable de dialoguer avec différents acteurs. Cette profession se

retrouve désormais au cœur de très nombreuses questions liées à la mobilité, à l’urbanisme, à l’acceptabilité sociale. »
Les stages, partie prenante de la formation dans plusieurs établissements d’enseignement du génie, constituent un moyen privilégié de développer cette capacité à se mettre à l’écoute des autres et de comprendre les besoins du milieu. « Les ingénieures et ingénieurs de demain doivent être en mesure de travailler en équipe interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, mais aussi d’aiguiser leur capacité d’écoute réelle et d’ouverture », remarque Maud Cohen, ing., directrice générale de Polytechnique Montréal. Initiés dès leur première année à ce mode de
« Aux connaissances générales indispensables pour exercer cette profession, il faut ajouter l’impact social que produisent certaines technologies ou projets, sans parler des conséquences sur l’environnement. »
François Gagnon, ing. ÉTS
gpp.oiq.qc.ca
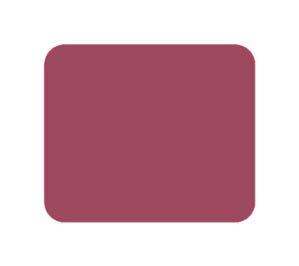



Pour s'informer sur sa pratique et comprendre ses obligations.
Jusqu’à 10 heures d’autoapprentissage*
Pour xer et plani er ses objectifs selon ses aspirations, obligations et impératifs.
Jusqu’à 1 heure pour la préparation du plan*

Pour identi er les zones d'amélioration possibles.
40 heures de formations pour développer vos compétences*.

maestro.oiq.qc.ca
*Activités admissibles à la formation continue obligatoire, dans la mesure où elles sont en lien avec l'exercice de vos activités professionnelles.
travail collaboratif, les étudiants et étudiantes réalisent quatre projets intégrateurs au cours de leur formation. Ce type de réalisation permet de travailler à plusieurs et mobilise aussi bien des connaissances techniques que des habiletés transversales. D’autre part, Polytechnique favorise deux parcours entrepreneuriaux pour celles et ceux qui approfondissent un projet, l’un dans le domaine des technologies propres et l’autre en cybersécurité.
Soucieuses de diversifier les horizons, certaines facultés de génie, comme celle de l’Université de Sherbrooke, diversifient aussi les sources d’enseignement. À cheval entre les sciences de la gestion et le génie, une professeure participe ainsi à la concentration en entrepreneuriat. Elle forme les étudiants
et étudiantes à l’écosystème entrepreneurial, en amont de leur éventuelle participation à un incubateur d’entreprises. Un autre professeur de la Faculté des lettres et sciences humaines devrait bientôt s’ajouter à cette nouvelle initiative, afin de mettre l’accent sur l’impact d’un nouveau produit sur le comportement des consommatrices et consommateurs ou sur sa mise en marché.
La question de la diversité citoyenne préoccupe aussi au plus haut point la Faculté de génie et l’Université de Sherbrooke, qui vient d’ailleurs de lancer un projet pilote. Il vise
l’analyse comparative des sexes sur les technologies, ou les prototypes de robots à reconnaissance faciale ou vocale, par exemple, pour prendre davantage en compte la variété des particularités humaines. Mieux vaut disposer, par ailleurs, de mannequins différents pour prévenir les accidents automobiles ou des tissus fabriqués en laboratoire. Ces informations sont fondamentales pour offrir des équipements et des technologies adaptées à l’ensemble de la population, et pas seulement à un groupe standard.
Autre incontournable dans la formation selon les écoles et facultés de génie, l’enseignement portant sur la gestion des données. Les ingénieurs et ingénieures conçoivent de plus en plus des outils informatiques personnalisés et ont donc

« On voit que les projets issus d’équipes mixtes sont plus avancés qu’avant. De plus, l’évaluation porte non seulement sur le produit, mais également sur la façon dont les membres du groupe ont travaillé ensemble. »
Jean Proulx, ing. Université de Sherbrooke
Avez-vous complété vos heures?
La nouvelle DEP générique pour le béton prêt à l'emploi est maintenant disponible!

Par souci de transparence et d'amélioration continue, l'Association béton Québec présente aux ingénieurs, architectes et autres prescripteurs la déclaration environnementale de produit (DEP) examinant les processus de fabrication du béton prêt à l'emploi


La DEP souligne l’engagement de l'industrie envers l’atteinte des objectifs net zéro d’ici 2050. Cet outil permet de quantifier les impacts environnementaux des projets et d’aider à prendre des décisions entraînant la réduction des émissions de CO eq. 2
Envie d'en savoir plus sur les initiatives de l'ABQ en matière de développement durable?
L’infolettre en génie Employeur
Outils et contenus exclusifs pour gestionnaires

Abonnez-vous !
bit.ly/infolettre_employeur
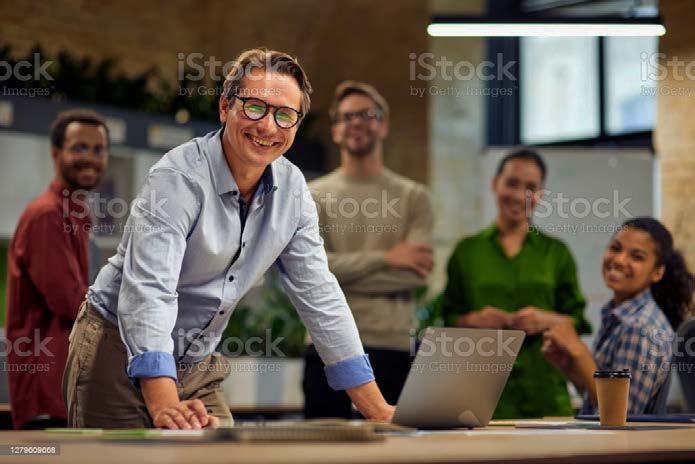
Le site web Formation ABQ offre une série de formations destinées aux praticiens de l'industrie du béton prêt à l'emploi Celles-ci s'adressent tant aux nouveaux arrivants dans le domaine qu'aux ingénieurs chevronnés
WEBINAIRES ET FORMATIONS DIFFÉRÉS

16 formations 100% à distance!
Plus de 20 heures de formation!
Le béton et le développement durable
Le béton architectural
Bonnes pratiques pour les trottoirs
Pathologies du béton
Rendez-vous sur le site web formation.betonabq.org
Et plus encore!
besoin de maîtriser ce langage. La Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval offre déjà un cours d’introduction au langage Python, utilisé largement sur la planète, aux étudiants et étudiantes de différentes disciplines du génie. À l’automne 2024, il sera possible de suivre une concentration en sciences des données.
Du côté de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, un nouveau programme de génie robotique est offert, en collaboration avec les génies électrique, mécanique et informatique, qui s’intéresse aussi bien à l’automatisation industrielle qu’aux interactions avec
les machines en matière de santé et d’éducation. Un autre nouveau programme en génie du bâtiment, orchestré en collaboration avec le génie civil et le génie mécanique, est aussi offert. Il cible la conception intégrée des bâtiments, y compris l’écoconception.
Le développement durable, l’analyse du cycle de vie, la recherche de la carboneutralité font aussi partie des éléments de plus en plus présents dans les programmes de génie.
Polytechnique Montréal offre un projet intégrateur en développement durable qui suscite un grand engouement. Des finissantes et
finissants de diverses spécialités du génie sont jumelés à des étudiants et étudiantes en architecture, pour se prêter à un exercice de conception d’une infrastructure en milieu urbain dans une perspective de développement durable. Ils et elles doivent prendre en compte les effets des solutions proposées sur l’environnement, la société et l’économie (gestion des eaux usées et pluviales, production locale d’énergie, analyse du cycle de vie, mobilité et aménagement, gestion des sols contaminés, etc.).
L’Université Laval réfléchit d’ailleurs à un éventuel baccalauréat en génie de l’environnement qui combinerait

« Chez nous, un étudiant en génie minier peut suivre des cours de géologie afin d’en apprendre davantage sur les sondages dans le sous-sol pour trouver des minéraux. »
André Zaccarin, ing. Université Laval
les enjeux climatiques, la recherche nordique – très présente dans cette université – et la biologie.
La transition énergétique, les changements climatiques, la numérisation des activités, les compétences
non techniques jugées désormais essentielles, tout cela transforme durablement le visage du génie. Les universités et les écoles québécoises s’adaptent à cette réalité en actualisant leur offre de cours. Elles prennent soin aussi de ne pas
surcharger l’horaire, attentives aux défis de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Après tout, les études universitaires consistent surtout à apprendre à apprendre, pour se développer tout au long de son existence.
Maud Cohen, ing., FIC, MBA, ASC, est directrice générale de Polytechnique Montréal depuis août 2022. Elle détient un baccalauréat en génie industriel de Polytechnique Montréal et un MBA de HEC Montréal. Maud Cohen a occupé des postes de gestion au sein de la Fondation CHU Sainte-Justine, du Groupe CGI et de Systèmes Invensys Canada. De 2009 à 2012, elle a été présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

François Gagnon, ing., est directeur général de l’École de technologie supérieure (ÉTS) depuis juin 2019. Titulaire d’un baccalauréat et d’un doctorat en génie électrique de Polytechnique Montréal obtenu en 1991, il a amorcé cette même année sa carrière à l’ÉTS. Il a notamment été directeur du Département de génie électrique et titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Électronique SCT en communication sans fil d’urgence et tactique de haute performance.
Audrey Langlois est conseillère principale Main-d’œuvre et affaires publiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle est titulaire d’un baccalauréat en études politiques de l’Université Bishop’s et d’une maîtrise en relations internationales de l’École supérieure d’études internationales (Université Laval).
Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, est présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 2022. Titulaire d’un baccalauréat en génie de la production automatisée de l’ÉTS et d’une maîtrise en administration des affaires de l’ESG UQAM, elle a fait carrière dans le milieu du génie biomédical et a occupé différents postes de gestion au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
Jean Proulx, ing., est doyen de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke depuis juin 2021. Il a obtenu son baccalauréat à l’Université Laval, et sa maîtrise puis son doctorat à l’Université de Sherbrooke. Professeur de génie civil depuis 1994, il a été directeur du Département de génie civil et de génie du bâtiment de 2012 à 2021. Il a cofondé le programme de génie du bâtiment lancé en 2017 à l’Université de Sherbrooke.
André Zaccarin, ing., est doyen de la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en génie électrique de l’Université Laval, et un doctorat dans la même discipline de Princeton University. Professeur au Département de génie électrique et de génie informatique, il en a été le directeur de 2008 à 2016.
« La profession d’ingénieur se retrouve désormais au cœur de très nombreuses questions liées à la mobilité, à l’urbanisme, à l’acceptabilité sociale. »des chambres de commerce du Photo : FCCQ
On le sait, il n’y a pas d’âge pour apprendre… C’est sur ce principe que l’Université du troisième âge (UTA) a vu le jour en 1976, à l’initiative de l’Université de Sherbrooke. Retraité depuis une trentaine d’années, Charles Terreault a puisé une grande satisfaction personnelle à agir comme professeur auprès d’étudiantes et étudiants aînés qui se sont inscrits à ses cours avec un enthousiasme contagieux.
 Par Mélanie Larouche
Par Mélanie Larouche
À87 ans, Charles Terreault est un ingénieur à la retraite dynamique. Il est la preuve vivante que l’apprentissage garde jeune et allumé ! Cette formidable occasion de donner accès à des connaissances représente pour lui une belle source d’enrichissement et de valorisation personnelle qu’il souhaite transmettre à ses pairs, ingénieures et ingénieurs à la retraite.

Littérature, géographie, mathématiques et sciences, langues et informatique… les cours offerts par l’UTA sont extrêmement diversifiés. « Il y en a pour tous les goûts, mentionne d’entrée de jeu Charles Terreault. Moi, j’y suis allé de mes propres centres d’intérêt et compétences pour mettre en place des cours qui ont tous été suivis par de nombreuses personnes. J’ai débuté en 2002 par des cours sur la fibre optique, l’internet, les médias sociaux, le téléphone cellulaire et la photographie numérique. Puis, de 2007 à 2010, j’ai donné une série de cours sur les origines : l’univers, la Terre, la vie, l’humain. Ces cours ont roulé plusieurs années et ont connu un beau succès ! »
Lauréat en 2013 d’un prix Hommage reconnaissance de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour son engagement social exceptionnel, Charles Terreault témoigne sans conteste d’un goût du partage et de belles aptitudes relationnelles qu’il a su mettre à profit tout au long de sa carrière et de sa retraite active. Il a travaillé plus d’une trentaine d’années pour Bell Canada à titre de vice-président du développement technologique ; il a également enseigné à Polytechnique Montréal et dirigé la Chaire JVR-Cyr en gestion de la technologie.
« J’ai pris ma première retraite en 1991, souligne le chaleureux octogénaire. J’ai commencé à collaborer avec l’UTA un peu par hasard. Des amis ont tâté le terrain au début des années 2000 pour connaître mon intérêt à préparer un cours sur la fibre optique. Ce fut mon tout premier cours à l’UTA. L’année suivante, mon cours a porté sur l’internet ; c’étaient les débuts, les gens voulaient en savoir plus sur cet univers numérique. Puis les sujets se sont enchaînés d’une année à l’autre. J’ai toujours élaboré des cours en fonction des besoins
des étudiants et de l’UTA. Au début, les commandes venaient de l’UTA, puis je me suis mis à proposer des sujets en lien avec l’actualité sur la base de l’intérêt que les gens manifestaient. »
Les professeurs de l’UTA ne sont pas nécessairement des spécialistes des sujets qu’ils abordent, mais ils doivent s’assurer d’expliquer clairement les différentes notions. « Il est donc primordial de bien comprendre soi-même, note Charles Terreault. Je trouve le processus de préparation de cours vraiment stimulant. Apprendre d’abord par moi-même pour mieux communiquer ensuite. Il faut fouiller l’information, la synthétiser, réfléchir sur les façons de présenter le sujet, structurer l’information. Il y a des règles à respecter, imposées par l’UTA ; on nous donne des indications pour bien travailler. Dans ma carrière, j’ai fait beaucoup de présentations, j’ai ainsi pu faire bénéficier les étudiants de mon expérience. Le contact avec les gens crée une belle dynamique dans la classe, une ambiance chaleureuse
« Il y en a pour tous les goûts. Moi, j’y suis allé de mes propres centres d’intérêt et compétences pour mettre en place des cours qui ont tous été suivis par de nombreuses personnes. »
Charles Terreault, ingénieurà la retraite Université du troisième âge
et participative. J’ai des étudiants qui sont revenus d’année en année, c’est agréable, ça ! Cet échange réciproque de connaissances est très enthousiasmant, c’est merveilleux comme projet de retraite. »

L’origine au sens large est un sujet qui a toujours intéressé Charles Terreault. Il a ainsi conçu une série de présentations qui lui a procuré une grande satisfaction personnelle. « Je ne suis ni astronome ni biologiste, indique-t-il. Je présente le fruit de mon travail de recherche en tant que non spécialiste à d’autres non spécialistes. C’est tellement une belle motivation de pouvoir faire part de connaissances et d’en acquérir beaucoup. L’interaction est vraiment enrichissante ! Mes conférences sont en évolution constante, c’est un beau processus intellectuel. Je fais des mises à jour régulièrement, selon les commentaires des gens. »
À l’UTA, il n’y a ni examen ni diplôme, que le pur plaisir d’apprendre. « Au-delà de la grande richesse d’information que cette formule propose, elle offre la possibilité de socialiser avec des gens qui ont des intérêts communs, soutient Charles Terreault. L’UTA, c’est un milieu d’apprentissage vraiment particulier, accessible à tous, sans préalable sur le plan des études et à coût fort raisonnable. Présente dans plus de 60 villes au Québec, elle permet à toute personne d’enrichir sa culture personnelle après sa carrière. L’UTA s’adresse à un auditoire de gens curieux qui ont envie de parfaire leurs connaissances sur différents sujets. L’Université de Sherbrooke a été un chef de file en mettant en place un tel système il y a plus de 45 ans. »
Charles Terreault a pris sa retraite de l’UTA en 2022 ; sa dernière conférence portait sur l’image numérique. Cependant, il a donné depuis une série de six conférences virtuelles sur l’histoire du numérique au Club informatique Mont-Bruno. Des personnes ayant assisté à ces conférences lui ont suggéré d’écrire un livre, ce à quoi il a répondu : « C’est un trop gros projet pour un homme de 87 ans, mais c’est très flatteur ! »
La déontologie de l’ingénieur : rappels et explications
2.5h | 54,95 $
L’éthique : pourquoi est-ce si important?

Les fondations de votre pratique professionnelle
Évitez les tracas de la fin de période de formation continue, profitez des formations virtuelles de l’Ordre

Parcourir toutes les formations virtuelles
de l’ingénieur : pour éviter les pièges
Le professionnalisme : valeurs et devoirs
Indépendance et désintéressement : les clés de l’autonomie

ANNUEL 2023-2024
Du 13 février au 31 mars 2023
Connectez-vous à votre portail : accesprofession.oiq.qc.ca

Renouvelez votre inscription au registre des CPI de l’Ordre
Payez vos frais annuels avant le 31 mars
150 ans
À Montréal, au xixe siècle, un nouvel établissement d’enseignement voit le jour en 1873. Cette institution jouera un rôle crucial dans le développement économique du Canada, et plus particulièrement du Québec. Elle formera des cohortes d’ingénieurs et ingénieures francophones qui contribueront à l’essor économique du pays.

Aujourd’hui, à l’aube de ses 150 ans, Polytechnique Montréal se trouve à l’avant-garde des grands projets-cadres internationaux de recherche. Voyons le long chemin qu’elle a parcouru.
Par Robert Gagnon
Dans les années 1850, l’avènement des chemins de fer et le début de l’industrialisation suscitent de nouveaux besoins dans un Québec qui bouge. Politiciens, hommes d’affaires, journalistes et éducateurs évoquent alors la nécessité d’adapter son système d’éducation aux nouvelles réalités économiques. Selon eux, il devient urgent de former dans les établissements d’enseignement supérieur non seulement des médecins, des avocats ou des prêtres, mais aussi des géologues, des chimistes et, surtout, des ingénieurs. En 1867, la Confédération, qui octroie la juridiction exclusive de l’éducation aux provinces, va permettre de créer les deux premiers établissements
voués à la formation des ingénieurs. En 1871, l’Université McGill inaugure le Department of Practical and Applied Sciences, embryon de ce qui allait devenir sa faculté de génie. Deux ans plus tard, les efforts du premier ministre Gédéon Ouimet et du directeur de l’Académie commerciale catholique de Montréal, Urgel-Eugène Archambault, mènent à la création de l’École des sciences appliquées aux arts et à l’industrie, au sein de l’Académie, pour la dispense d’un cours scientifique et industriel en français. L’École sera rebaptisée École Polytechnique de Montréal en 1876 par le gouvernement du Québec.
Les débuts de l’École Polytechnique de Montréal s’avèrent difficiles. L’absence d’une grande bourgeoisie
canadienne-française et son isolement dans un système d’enseignement dominé par le clergé entravent son épanouissement. Il faut attendre le début du xxe siècle pour que les premiers signes annonciateurs de jours meilleurs se manifestent. En 1901, l’École obtient 25 000 $ grâce à un legs de l’industriel Joseph-Octave Villeneuve. Elle pourra ainsi lancer la construction d’un immeuble digne de ce nom, inauguré en 1905. Ce sont surtout les dirigeants et diplômés de Polytechnique qui vont mener un combat de tous les instants pour valoriser le statut de l’École et celui des ingénieurs ; ils vont en effet jouer un rôle prépondérant dans la construction de l’identité sociale de l’ingénieur. En 1908, la création de la section de Québec de la
▲Société canadienne des ingénieurs civils et les efforts de l’Association des anciens élèves de l’École Polytechnique vont permettre la reconnaissance sociale de la profession d’ingénieur. En 1918, le Québec devient ainsi la première province canadienne à se doter d’une loi protégeant le titre d’ingénieur et la pratique de la profession.
Bien qu’absents des grandes industries, les ingénieurs formés à Polytechnique ne chôment pas. Ils réussissent à conquérir des postes dans les administrations publiques et à jouer un rôle non négligeable dans la modernisation du Québec. Les ministères de la Voirie, des Travaux publics, des Mines, la Commission des eaux courantes sont des lieux d’exercice importants pour les diplômés de l’École. Il en va de même pour les services municipaux des grands centres urbains, souvent dirigés par des personnes diplômées de l’École Polytechnique. La conquête des postes de commande dans ces lieux avantage certains ingénieurs qui se sont faits entrepreneurs de
construction ou qui se sont lancés dans la pratique du génie-conseil. La réalisation de grands travaux municipaux (usines de filtration, systèmes d’aqueduc, tunnels routiers, édifices publics...) ou de travaux publics commandés par le gouvernement provincial (barrages hydroélectriques, grandes routes, écoles, etc.) permet notamment à des bureaux francophones de génie-conseil de s’imposer dans ce secteur de l’économie. Marius Dufresne, Arthur Surveyer, Séraphin Ouimet, Stanislas-Albert Beaulne, tous diplômés de Polytechnique entre 1900 et 1915, ont fondé des entreprises dont la réussite ne passe pas inaperçue.
Au début des années 1950, de nombreux ingénieurs francophones, pour la plupart formés à l’École Polytechnique, éprouvent toujours des difficultés à franchir les portes de la grande industrie. Rappelons qu’en 1953, 108 des 119 ingénieurs du complexe Alcan à Arvida sont des anglophones. Or, le vent s’apprête à tourner. D’ailleurs, l’année 1959 laisse entrevoir que les temps

changent : Gabrielle Bodis devient la première femme diplômée de Polytechnique.
Au moment de l’arrivée au pouvoir de libéraux de Jean Lesage en 1960, une nouvelle vague d’investissements dans l’industrie manufacturière, la nationalisation de l’ensemble des compagnies productrices d’hydroélectricité et la création de plusieurs sociétés d’État dans le secteur des richesses naturelles ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes diplômées de Polytechnique. Par ailleurs, les gouvernements québécois et canadien ainsi que la Ville de Montréal injectent des sommes substantielles dans des projets d’envergure (métro de Montréal, Expo 67, modernisation du système routier, entre autres). Plus important encore, la construction des grands barrages à Manicouagan et à la Baie-James permet à des firmes d’ingénierie québécoises, créées par des diplômés de Polytechnique, de participer à ces chantiers et d’acquérir une expertise propice à la conquête de marchés internationaux. C’est le cas, notamment, de SNC et de Lavalin (aujourd’hui SNC-Lavalin). D’autres firmes au rayonnement international comme Cogeco, fondée par un ancien de Polytechnique, ou Bombardier,
qui regroupe un large bassin de polytechniciens, témoignent de l’apport de l’institution montréalaise. Dorénavant plus nombreux au Québec que leurs compatriotes anglophones, les ingénieurs francophones accèdent massivement aux postes supérieurs au sein des grandes entreprises privées.
À la fin du premier quart du xxie siècle, Polytechnique trône parmi les grandes institutions de génie dans le monde. Elle pilote nombre de projets de recherche qui totalisent annuellement plus de 100 millions de dollars. Elle entretient des collaborations avec pas moins de 300 partenaires du secteur
industriel qui viennent aussi bien du Canada que du monde entier. Parmi ces partenaires se trouvent de grandes sociétés actives dans des domaines de pointe, tels l’aérospatial, le biomédical, l’énergie, l’intelligence artificielle et les télécommunications. Enfin, Polytechnique accueille aujourd’hui 10 000 étudiants et étudiantes ; la proportion des femmes qui y étudient est de 30 %.
Polytechnique Montréal a fait du chemin depuis la première promotion du printemps 1877, qui comptait cinq diplômés. Son fondateur, Urgel-Eugène Archambault, avait rêvé que son école de génie puisse survivre aux nombreuses difficultés rencontrées au cours de ses premières années. S’il revenait sur terre aujourd’hui, gageons qu’il n’en croirait pas ses yeux !
Robert Gagnon est professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST). Il a écrit plusieurs livres, dont Histoire de l’École Polytechnique de Montréal, La montée des ingénieurs francophones (Boréal, 1991), Urgel-Eugène Archambault, Une vie au service de l’instruction publique (Boréal, 2013) et Augustin Frigon, Sciences, techniques et radiodiffusion (Boréal, 2019).

Dossier Polytechnique
Montréal
150 ans
Depuis cinq générations, plusieurs membres de la famille Laberge-Dagenais fréquentent Polytechnique Montréal, une institution qui fait partie de leur ADN. Petit guide généalogique de passionnés du génie.
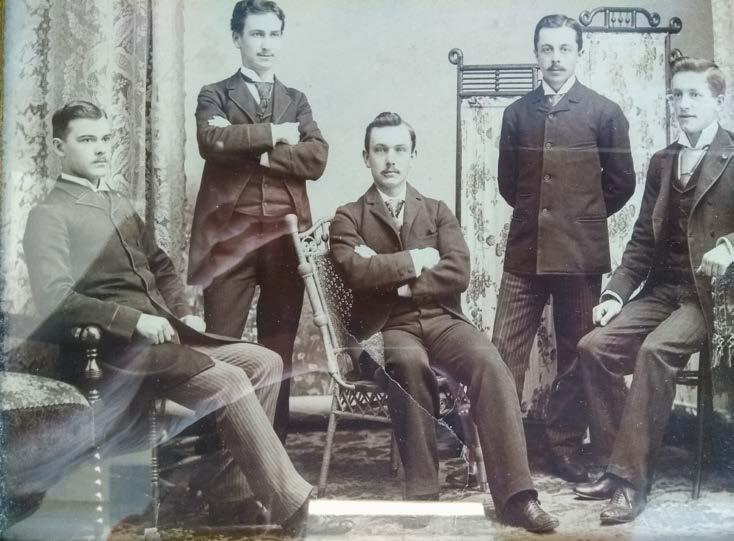 Par Pascale Guéricolas
Par Pascale Guéricolas
Formé à Polytechnique Montréal
Il y a quelques années, la conjointe de Michel Dagenais, ing., professeur de génie informatique à Polytechnique Montréal, lance une idée plutôt inusitée à ses proches. Cette médecin de famille, très investie dans son métier et mère de trois futurs diplômés de ce même établissement, leur indique un peu à la blague qu’elle songe à s’inscrire à des cours d’ingénierie. Pourquoi ? Tout simplement pour se rapprocher de ses enfants qui discutent avec tant d’enthousiasme de leurs études pendant les soupers familiaux !
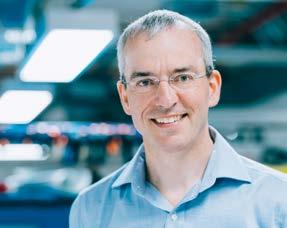
Il faut dire que les liens entre cette famille et Polytechnique Montréal n’ont rien d’ordinaire : lorsqu’on remonte le fil généalogique de ce clan d’ingénieurs, on découvre que ces liens datent du xixe siècle. Le nom de l’arrière-grand-père maternel de Michel Dagenais, FrançoisCharles Laberge, se trouve ainsi parmi une des cohortes de 1892. Ingénieur civil et arpenteurgéomètre, il a travaillé à la construction de routes et de lotissements
pour le bureau de génie-conseil de Ville Saint-Laurent.
Le fils de l’ancêtre François-Charles, Charles-René, diplômé en 1931 en génie civil, devient, lui, ingénieur en chef adjoint, puis sous-ministre au ministère des Travaux publics, où il surveille la construction de ponts, avant de prendre sa retraite en 1960 et de construire des maisons.
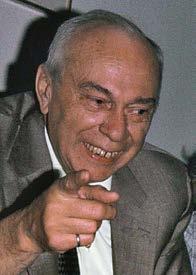
Côté paternel, Émilien Dagenais, le grand-père de Michel, termine sa scolarité en génie chimique dans les années 1930. Ingénieur en chef pour la raffinerie Esso dans
Montréal-Est, il s’y retrouve conscrit pendant la Seconde Guerre mondiale car le carburant est considéré alors comme un bien stratégique. À la fin de sa carrière, il met ses compétences au service des municipalités qui étendent leurs routes et ont besoin d’un expert en matière d’asphalte.
Très tôt, le petit-fils Michel Dagenais a conscience de l’omniprésence de tant d’ingénieurs dans sa lignée. Ses oncles et ses grands-pères parlent souvent lors de rencontres des problèmes courants des résidences familiales (infiltration d’eau, fentes dans les murs…), et le jeune Michel s’interroge dès l’enfance sur les causes physiques derrière ces phénomènes. « À cinq ans, j’ai reçu de mon grand-père Laberge un marteau garanti à vie dont je me sers encore, se souvient ce diplômé en génie électrique de 1983. Plus tard, mon oncle Guy Laberge m’a acheté une perceuse quand j’ai eu 12 ans. Je l’utilisais pour construire des petits meubles à ses enfants que je gardais. »
« À cinq ans, j’ai reçu de mon grand-père Laberge un marteau garanti à vie dont je me sers encore. Plus tard, mon oncle Guy Laberge m’a acheté une perceuse quand j’ai eu 12 ans. »
Michel Dagenais, ing.
Cet oncle maternel figure bien sûr parmi les diplômés de Polytechnique. Il termine un baccalauréat en génie civil en 1961, avant d’entreprendre une maîtrise aux États-Unis pour en apprendre davantage sur la mécanique des sols et le génie des fondations, un domaine encore peu étudié au Québec et pourtant d’une importance cruciale alors que routes, autoroutes, ponts sortent de terre aux quatre coins de la province. Sans parler de toutes les infrastructures autour d’Expo 67.
Expert en contrôle des matériaux et des fondations aujourd’hui âgé de 84 ans, Guy Laberge garde un souvenir encore vif de sa scolarité à l’École Polytechnique, au moment où les cours se donnaient rue

Saint-Denis, au centre-ville. C’était une période effervescente ; déjà, les étudiants réclamaient la gratuité scolaire. Le jeune homme représentait d’ailleurs l’association étudiante auprès de celle de l’Université de Montréal. « J’assistais aux réunions du conseil, relate le retraité. Je participais à des activités sociales et politiques comme président du Conseil consultatif. »
Avec le recul, Guy Laberge considère que sa formation l’a bien préparé à sa carrière, longtemps associée à celle de son frère René, lui aussi diplômé en génie civil de l’École Polytechnique et viceprésident de l’association des étudiants de Polytechnique. Ce dernier avait fondé un cabinet de génie-conseil, où les deux hommes ont travaillé ensemble avant de le vendre en 1974 à Lavalin. Un peu plus tard, dans les années 1980, Guy Laberge participe en tant que diplômé au Conseil consultatif de
l’École Polytechnique qui a pour mandat de donner des avis concernant les besoins de l’industrie en génie. « Je me souviens qu’on avait suggéré à la direction de donner un cours sur l’environnement à tous les étudiants, et pas seulement aux personnes inscrites en génie chimique ou civil. »
Après avoir terminé son cégep, le jeune Michel Dagenais s’inscrit à son tour à Polytechnique Montréal. Il hésite entre le génie mécanique et le génie électrique, jusqu’à ce qu’il constate que son professeur de dessin technique refuse qu’il fasse ses travaux sur ordinateur, un outil qui favorise pourtant une plus grande précision.
Guy Laberge, ingénieur à la retraite Formé à
150 ans (suite)
« J’assistais aux réunions du conseil. Je participais à des activités sociales et politiques, notamment à la rédaction du journal Le Quartier latin. »
Polytechnique Montréal
Lui qui se passionne pour l’informatique, un domaine alors en pleine explosion, choisit donc le génie électrique, parce qu’il peut ainsi en apprendre davantage sur les circuits d’ordinateurs. « À la fin des années 1980, le milieu de la recherche dans ce secteur était très dynamique, et j’ai fait plusieurs stages dans des laboratoires où l’on travaillait sur des projets appliqués dans les domaines du transport, du génie électrique ou biomédical », raconte le sexagénaire. Son diplôme en poche en 1983, il se perfectionne à l’Université McGill ; il y fait un doctorat sur les circuits intégrés à grande échelle.
Rapidement, le jeune diplômé se rend cependant compte que les entreprises de l’époque n’offrent pas des possibilités de recherche aussi stimulantes et ouvertes sur les découvertes de partout dans le monde que ce qu’il a connu à l’université. Tout naturellement, il répond ainsi favorablement à l’offre de Polytechnique Montréal qui ouvre un programme de génie informatique et qui cherche des professeurs.
Michel Dagenais revient donc dans l’établissement qui l’a d’abord formé, que ses grands-pères et ses oncles ont aussi fréquenté, et où ses trois enfants feront leurs études deux décennies plus tard. « J’étais directeur du Département de génie informatique lorsque ma fille s’y est inscrite en 2008, et je craignais que cela lui nuise, mentionne Michel Dagenais. En fait, au bout d’un mois, on m’appelait “le père d’Amélie”, car très rapidement elle a fait sa marque en s’impliquant dans le comité étudiant. Il faut dire aussi que l’effectif féminin ne représentait que 10 % des cohortes à ce moment-là. » Amélie Dagenais travaille maintenant pour différentes compagnies informatiques en haute technologie sur la côte Ouest américaine.
Grâce aux discussions sous le toit familial, situé à seulement 20 minutes en vélo de Polytechnique Montréal, le professeur bénéficie d’un accès privilégié pour comprendre les doléances des étudiants et étudiantes au sujet de leur formation. Il se rapproche encore davantage des jeunes en cofondant Polyfab, qui met à leur disposition des imprimantes 3D,
des outils de découpe laser, vinyle ou de soudure, tout en assurant une formation adaptée.
« L’avantage de Poly, c’est que c’est assez grand pour disposer d’équipes sportives, d’une troupe de théâtre, de groupes de musique, mais assez petit pour partager des intérêts communs », fait-il remarquer. À ses yeux, les ateliers comme Polyfab ou les sociétés techniques où des équipes étudiantes fabriquent un canot en béton, un sous-marin à propulsion humaine, une fusée ou une voiture de course ultra-performante sont un enrichissement à la formation donnée dans cet établissement.
Ce n’est pas son fils, Laurent Dagenais, ingénieur de 32 ans, qui le contredira. « Je pense que notre implication étudiante a poussé notre père à faire valoir à la direction de Poly l’intérêt de ce genre d’apprentissage », soutient-il. Directeur de la Société technique de formule électrique, ce diplômé en génie mécanique de 2014 a profité à plein de son passage à Polytechnique Montréal pour assouvir sa passion de toujours, à savoir construire des véhicules.

« Je pense que notre implication étudiante a poussé notre père à faire valoir à la direction de Poly l’intérêt de ce genre d’apprentissage. »
Laurent Dagenais, ing. Formé à Polytechnique Montréal
« Plus jeune, j’adorais fabriquer des petites voitures en bois, et démonter tout ce qui me tombait sous la main », confie le deuxième de la famille, qui a reçu un casque blanc de construction de son grandoncle Guy dans son enfance. Très à l’aise en mettant au point des solutions techniques pour améliorer les moteurs électriques ou en discutant avec les fournisseurs, Laurent Dagenais constate qu’il reste encore quelque chose des liens noués durant ses études. Il croise souvent d’ex-collègues de
la formule SAE Montréal dans les entreprises avec lesquelles il fait affaire en travaillant depuis huit ans dans le domaine ferroviaire, des camions et des autobus électriques. De deux ans sa cadette, Sophie, qui se définit comme une étudiante autodidacte, a elle aussi apprécié les multiples comités étudiants auxquels elle a participé dans cet établissement qu’elle fréquente depuis son enfance. « Les amitiés qu’on se forge dans des concours comme les Jeux de génie ou en collaborant à des travaux d’équipe intensifs, ça n’a pas de prix », raconte celle qui a reçu son jonc de son père en 2016.

La jeune femme a choisi le génie civil, comme son ancêtre
François-Charles Laberge et son grand-oncle Guy, et son secteur de prédilection est la géotechnique des sols, des routes, des mines et des ponts. La jeune ingénieure se sent fière d’appartenir à une telle lignée. « Enfant, j’aimais beaucoup aller aux Portes ouvertes de Poly, fréquenter le camp de jour, découvrir les différentes machines et équipements », se rappelle-t-elle. Épanouie dans son emploi chez WSP, un des plus grands cabinets de génie-conseil en environnement de la planète, Sophie Dagenais est très satisfaite d’avoir étudié dans un domaine qui offre tant de possibilités de carrière. La lignée d’ingénieures et ingénieurs LabergeDagenais a assurément encore de beaux jours devant elle...
Sophie Dagenais, ing. Formée à Polytechnique Montréal
« Enfant, j’aimais beaucoup aller aux Portes ouvertes de Poly, fréquenter le camp de jour, découvrir les différentes machines et équipements. »
CONCOURS REER-CELI
20 000 en prix à gagner1
Cotiser maintenant3 ferique.com/plan
1Des conditions s’appliquent. Voir le règlement du concours. 2Lorsque comparés à leur univers de référence au Canada, selon Fundata Canada inc. 3Via Services d’investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Offert aux professionnels en génie, à leurs familles et à leurs entreprises.
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d’investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d’investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d’investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le Portail client est la propriété de Gestion FÉRIQUE et est utilisé sous licence exclusive par Services d’investissement FÉRIQUE, son placeur principal.
FÉRIQUE : gérés par un OBNL carboneutre ratios de frais de gestion parmi les plus bas2
Avec des arguments solides, c’est logique d’investir dans les Fonds FÉRIQUE.
En septembre 2022, l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) a décerné le prix Visionnaire 2022 à BBA et à ses partenaires Polytechnique Montréal et Consortium SAF+. Plus haute reconnaissance de l’industrie, ce prix vient récompenser le projet d’usine pilote destinée à convertir des émissions de carbone en un nouveau carburant d’aviation durable dont l’impact en GES est 80 % moindre que celui du kérosène habituellement utilisé.
 Par Clémence Cireau
Par Clémence Cireau
►
Usine pilote de carburant d’aviation durable
Retour sur ce projet qui fait figure de précurseur en Amérique du Nord avec Lyne Ricard, ing., directrice du groupe Carburants et produits chimiques avancés et coordinatrice du projet chez BBA.
Comment est né ce projet de production de carburant d’aviation durable ?
Lyne Ricard : Je m’intéresse au biocarburant et à ses usages depuis plus d’une décennie. Alors que ce secteur occupait un créneau très pointu à l’époque, on assiste aujourd’hui à un véritable engouement pour l’utilisation du biocarburant. Lorsque j’ai rencontré mes collègues chez BBA en 2013, je leur ai rapidement parlé de ma volonté à pousser la recherche dans ce domaine. Ils ont tout de suite été intéressés et m’ont encouragée dans cette voie.
Que faire du CO2 une fois qu’il est capturé ? Il est possible de le séquestrer sous terre dans des puits de carbone. Cette solution, bien qu’elle soit utilisée à différents endroits, est différente de celle que nous avons choisie pour ce projet. L’objectif était de réutiliser le CO2 et de le transformer en un carburant utilisable pour le domaine de l’aviation, qui propose une solution de remplacement verte aux combustibles fossiles.
Polytechnique Montréal a mis sur pied une plateforme de chimie verte et d’ingénierie durable afin de soutenir des projets favorables à la transition vers une économie carboneutre. Polytechnique a donc construit une usine de capture et de purification du CO2 qui permet le développement et la propulsion de différentes technologies de décarbonation en collaboration avec des partenaires industriels. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’usine pilote de SAF+.
Notre mandat a consisté à réaliser l’ingénierie, à gérer le projet et la construction pour l’installation de l’usine pilote, ainsi qu’à exploiter l’usine de capture de CO2 de Polytechnique Montréal et l’usine de conversion de SAF+. Grâce au travail des ingénieures et ingénieurs qui se sont relayés jour et nuit pour procéder à l’ensemble des phases de conception des interconnexions, de construction et de mise en service du projet, il a été

possible de produire quelques litres d’un carburant propre en moins de huit mois.
L.R. : Les technologies utilisées reposent sur l’économie circulaire ; elles capturent et convertissent le CO2 en carburant d’aviation à l’aide d’hydrogène vert. Premièrement, le CO2 est recueilli à la source, directement des cheminées industrielles. Il n’est donc pas émis dans l’atmosphère. Il est ensuite purifié et modifié en enlevant ses deux atomes d’oxygène, puis en ajoutant l’hydrogène vert, qui est produit à partir de l’électricité renouvelable. On obtient ensuite un carburant synthétique qui, une fois purifié, se conformerait à la norme ASTM D4054, qui définit les exigences des carburéacteurs et assure la sécurité et l’efficacité des opérations aériennes. Polytechnique Montréal et Consortium SAF+ croient fermement que le biocarburant fait partie des solutions qui garantiront un avenir durable et écoresponsable au domaine de l’aviation. BBA le croit aussi.
Quels sont les défis à venir pour produire ce biocarburant d’aviation à l’échelle industrielle et le commercialiser ?
L.R. : Nous venons d’établir la preuve qu’il est possible d’exploiter ce concept et que les deux usines peuvent être fonctionnelles, c’est-à-dire que nous savons que le processus pour produire le biocarburant fonctionne. Il faut maintenant reproduire les conditions mécaniques et chimiques nécessaires à la réussite du projet à l’échelle industrielle. Cela requiert beaucoup d’expérience opérationnelle afin que ce soit sécuritaire et rentable.
Le principal défi technique concerne l’approvisionnement de l’usine en énergie. Les procédés de conversion du CO2 en biocarburant nécessitent de chauffer puis de refroidir les molécules afin qu’elles
réagissent entre elles. Traditionnellement, le gaz naturel est utilisé pour répondre à ce type de besoin, mais lorsqu’on utilise de l’hydroélectricité, cela se complique. En effet, ce qui est facilement réalisable à petite échelle ne l’est pas toujours lorsqu’on passe à une exploitation commerciale ayant des besoins en énergie beaucoup plus importants. À titre d’exemple, le réacteur dans l’usine pilote est haut de deux étages. Dans une usine commerciale, il sera beaucoup plus volumineux. Plusieurs questions se posent donc, par
exemple comment stabiliserons-nous une température au milieu du réacteur avec de l’hydroélectricité ?
Nous en sommes encore aux balbutiements de notre démarche pour produire un carburant réalisé à partir de nos déchets et utiliser efficacement de l’énergie, mais c’est un pas historique qui vient d’être franchi. C’est ce que récompense le prix Visionnaire de l’AFG, et nous en sommes très fiers. La mise en service de l’usine commerciale est prévue à l’horizon 2026.
Lyne Ricard occupe le poste de directrice du groupe Carburants et produits chimiques avancés chez BBA depuis 2013.

Ingénieure en génie chimique, Lyne Ricard contribue au développement des activités de la firme de génie-conseil sur ces marchés, tout en étant responsable de l’exécution des projets.
Après une carrière d’une vingtaine d’années chez PétroCanada à améliorer les procédés et les opérations, puis chez SNC-Lavalin où elle s’est impliquée à l’international en conception de mégaprojets, Lyne Ricard s’est jointe à BBA. À son arrivée chez BBA, Lyne Ricard a mis sur pied une équipe qui tire sa richesse de sa diversité culturelle, de genre et d’âge, une équipe diversifiée, motivée et dynamique, qui poursuit l’objectif commun de travailler à la transition climatique.
Fondée il y a plus de 40 ans, BBA est l’une des plus importantes firmes privées de génie-conseil du Canada. Elle est reconnue pour son savoir-faire dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles.
Avec 16 bureaux au Canada et à l’international, BBA offre aux clients un soutien local et une présence sur le terrain, et fournit des solutions d’ingénierie et des services-conseils stratégiques parmi les plus novateurs, durables et fiables de l’industrie.
▲ Lyne Ricard, ing.1
PRATIQUE GÉNÉRALE : Vous exercez en pratique générale si vous fournissez des services professionnels directement à votre employeur, et non à la clientèle de votre employeur.
(Assurance Responsabilité Professionnelle)
Votre pratique définit votre obligation en termes d’assurance responsabilité professionnelle
2
PRATIQUE PRIVÉE
OCCASIONNELLE : Vous exercez en pratique privée occasionnelle si vous fournissez seul .e et à votre compte1 des services professionnels et que vos honoraires sont égaux ou inférieurs à 15 000 $ annuellement2.
La pratique générale est couverte par le régime collectif de base.
La pratique privée occasionnelle est couverte par le régime collectif de base.
Vous exercez en pratique privée occasionnelle si vous respectez ces deux conditions :
X Fournir seul.e et à votre compte1 des services professionnels


X Percevoir des honoraires égaux ou inférieurs à 15 000 $ annuellement2
Si vous ne respectez pas ces 2 conditions, vous exercez en pratique privée. Dans ce cas, vous devez adhérer au régime collectif complémentaire auprès du fournisseur exclusif de l’Ordre en plus d’adhérer automatiquement au régime collectif de base lors de l’inscription annuelle.
3
PRATIQUE PRIVÉE : Vous exercez en pratique privée lorsque vous fournissez des services professionnels à un client autre que votre employeur ou votre société.
Vous adhérez automatiquement au régime collectif de base lors de l’inscription annuelle, + vous devez adhérer au régime collectif complémentaire auprès du fournisseur exclusif de l’Ordre3
1. La notion « seul.e et à son compte » vise la travailleuse ou le travailleur autonome ou encore l’ingénieure ou l’ingénieur qui travaille seul pour une entreprise individuelle.
2. 1 an à partir du 1er avril de chaque année.
3. À l’exception des membres qui peuvent obtenir une dispense.

MERCI DE MAINTENIR VOTRE COTISATION DE 25 $ LORS DE VOTRE RENOUVELLEMENT À L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC.
LES INGÉNIEUR.E.S EN DEVENIR VOUS REMERCIENT.

Si vous êtes ingénieur salarié ou ingénieure salariée dans une firme de génie-conseil, vous exercez probablement en pratique privée.
L’exercice en pratique privée ne signifie pas seulement exercer à son propre compte ou sous le nom de sa société. En effet, vous exercez aussi en pratique privée si vous fournissez des services professionnels à des clients externes, et ce, peu importe que ces services soient offerts directement par vous ou par l’entremise de votre employeur ou d’une société où vous exercez. La finalité du contrat avec votre client externe ne doit pas être la vente d’un produit ou la réalisation d’un ouvrage. Elle doit inclure uniquement vos services.
OUI NON
• Vous êtes ingénieur travailleur autonome et un entrepreneur vous demande de préparer des plans pour la construction d’un immeuble.
• Vous êtes ingénieure et employée salariée au sein d’une firme de génie-conseil. Votre employeur vous demande de fournir un service professionnel pour son client.
• Vous êtes ingénieure et à l’emploi d’un entrepreneur. Ce dernier reçoit un mandat pour construire un immeuble. Les plans que vous préparez pour votre employeur ne constituent pas de la pratique privée. La finalité du mandat sur lequel vous travaillez est la réalisation d’un ouvrage par votre employeur. Vous êtes considérée comme exerçant en pratique générale.
• Vous êtes ingénieur et à l’emploi d’une compagnie spécialisée en réfrigération et climatisation. Vos mandats consistent à concevoir, construire et fournir des systèmes. La finalité de vos mandats est la réalisation d’un ouvrage par votre employeur. Vous êtes considéré comme exerçant en pratique générale.
PRATIQUE PRIVÉE = RÉGIME D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
Si vous exercez en pratique privée, vous devez également adhérer au régime d’assurance complémentaire, à moins d’être dans une situation qui vous permet d’obtenir une dispense. Cette adhésion peut être faite par vous ou par votre employeur.
IMPORTANT : Il est possible que pour le même emploi, vous exerciez en pratique privée pour certains mandats et en pratique générale pour d’autres. Si c’est le cas, vous devez déclarer que vous exercez en pratique privée.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’Ordre (bit.ly/oiq_assurance_pro) ou communiquez avec nous : arp@oiq.qc.ca.
NGC Aérospatiale, c’est une histoire de succès, d’acquisition d’une expertise de pointe et d’innovation technologique. Aujourd’hui, grâce à ses systèmes de navigation autonome et d’évitement d’obstacles, la PME québécoise prendra part à la conception de la première astromobile lunaire canadienne, en collaboration avec l’équipe de Canadensys Aerospace, pour le compte de l’Agence spatiale canadienne.
 Par Mélanie Larouche Photo : NGC Aérospatiale
Par Mélanie Larouche Photo : NGC Aérospatiale
Depuis un premier projet aérospatial entrepris à Sherbrooke en 2001, la notoriété de NGC Aérospatiale n’a cessé de croître et de faire des petits, jusqu’à permettre à son équipe de se positionner parmi les acteurs majeurs dans le domaine de l’exploration aérospatiale. Le projet d’astromobile lunaire représente pour l’entreprise une autre occasion de déployer ses technologies dans l’environnement lunaire. Sa contribution au programme est significative : c’est NGC Aérospatiale qui fournira au véhicule lunaire l’autonomie nécessaire à l’atteinte des objectifs de la mission, dont le lancement est prévu pour 2026. « En plus d’un système de guidage et d’évitement d’obstacles, l’astromobile sera dotée de l’odométrie visuelle à l’aide d’une caméra qui permettra de regarder défiler les objets
sous le véhicule comme des repères au sol pour ainsi déterminer la trajectoire parcourue, explique Jean de Lafontaine, ing., PDG de NGC. Le véhicule pourra aussi revenir à son point de départ. On a démontré que cette technologie est performante et précise avec une marge d’erreur de 1 % de la distance parcourue. »
Bien que l’entreprise soit aujourd’hui reconnue à l’international, NGC (pour navigation, guidage, commande) est en quelque sorte née par accident… « La fondation de l’entreprise en 2001 ne vient pas vraiment d’une intention délibérée, souligne en riant le PDG de NGC. C’est
Jean de Lafontaine, ing. NGC Aérospatiale
après avoir acquis 10 ans d’expérience à l’Agence spatiale européenne que j’ai créé NGC. Le succès remporté par le projet de sonde spatiale Rosetta auquel j’ai pris part m’a valu une solide réputation pour mon expertise dans la conception de véhicules autonomes. Lorsque je suis revenu au Canada pour enseigner à l’Université de Sherbrooke, l’Agence spatiale européenne m’a de nouveau contacté pour que je fasse la démonstration que cette technologie d’autonomie spatiale peut aussi s’intégrer aux satellites d’observation de la Terre. Ainsi est né le projet européen de microsatellite PROBA-1. Puis ont suivi les projets PROBA-2, PROBA-Végétation et deux autres satellites, Sentinel-3A et Sentinel-3B, ces satellites étant destinés à l’observation de la Terre ou du Soleil. Le succès de toutes ces missions spatiales, rendues possibles grâce à la participation de l’Agence spatiale canadienne aux programmes de l’Agence spatiale européenne, nous a assurément servi de carte de visite pour le développement de l’entreprise et son rayonnement international. »
Entre 2001 et 2008, NGC Aérospatiale a travaillé presque exclusivement pour des projets de l’Agence spatiale européenne et quelques sociétés privées. « Tous nos projets élaborés pour l’Agence spatiale européenne ont cumulé plus de 55 années d’activité en orbite sans faille », déclare fièrement Jean de Lafontaine. NGC applique actuellement sa technologie dans le développement du logiciel de navigation, guidage et commande pour plus d’une trentaine de satellites pour le compte de sociétés aérospatiales européennes et américaines.
Par ailleurs, la rencontre fortuite de l’ingénieur Jean de Lafontaine avec un chef d’entreprise qui lui a présenté la technologie LiDAR lui a ouvert d’autres avenues de développement. « Un lidar permet de réaliser électroniquement la cartographie tridimensionnelle d’un site pour que notre logiciel l’utilise afin d’y reconnaître les obstacles et les éviter, précise-t-il. De cette alliance des
technologies est né le premier système de détection des objets destiné à l’exploration spatiale. D’ici quelques années, il devrait être utilisé pour assurer la sécurité des atterrissages en des endroits plus accidentés de la Lune. Nous avons ensuite exporté cette technologie lunaire pour l’utiliser sur la Terre, pour les drones qui atterrissent dans des endroits inconnus, dévastés par des désastres naturels par exemple. Notre technologie permet d’éviter qu’ils se retrouvent dans des situations fâcheuses. »
Cette technologie novatrice a été adaptée aux véhicules aériens sans pilote pour effectuer des missions de transport de nourriture ou de médicaments en territoire inconnu ou hostile, lorsque surviennent des catastrophes climatiques par exemple. « Aussi, nous avons pris part à un projet américain pour le transport d’organes par véhicules aériens électriques pour des vols longue distance, avec départ et arrivée à la verticale », indique Jean de Lafontaine.
NGC Aérospatiale a par la suite amorcé la mise au point d’une autre technologie, celle-là pour la navigation optique. « Puisque autour de la Lune il n’y a pas de constellation GPS, nous avons eu l’idée d’utiliser les cratères lunaires comme référence topographique pour déterminer la position des orbiteurs ou atterrisseurs, poursuit Jean de Lafontaine. Nous avons donc créé une base de données qui cartographie tous les cratères et, à l’aide de notre logiciel, nous faisons l’appariement des cratères détectés par une caméra embarquée avec les cratères de la base de données pour ainsi déterminer à quelques dizaines de mètres près la position d’un véhicule lunaire. Il est prévu de valider cette technologie en orbite lunaire dès 2023, en collaboration avec la société japonaise ispace, et en 2024 avec la scociété américaine Firely Aerospace. »
Avec le contrat de l’astromobile lunaire canadien et tous ses projets de satellites en cours, NGC Aérospatiale promet de se distinguer une fois de plus dans l’industrie par son haut niveau d’expertise.

« Puisque autour de la Lune il n’y a pas de constellation GPS, nous avons eu l’idée d’utiliser les cratères lunaires comme référence topographique pour déterminer la position des orbiteurs ou atterrisseurs. »
Franjieh El Khoury est passionnée de sécurisation des systèmes informatiques, autrice, éditrice, chargée de cours…, et c’est cette multidisciplinarité qui la comble dans son travail.
 Par Valérie Levée Photos : Denis Bernier
Par Valérie Levée Photos : Denis Bernier
Pour Franjieh El Khoury, le génie informatique joue un rôle clé dans la numérisation des données, l’automation et la sécurisation des systèmes. C’est ce qui l’a conduite, après un début de scolarité au Liban, au CNAM Paris (Conservatoire national des arts et métiers), où elle a obtenu un diplôme d’ingénieur informatique équivalant au baccalauréat en génie informatique et de la construction des ordinateurs.
Son projet de fin d’études portait sur l’organisation des systèmes d’information, et notamment sur un système de gestion de distribution des produits. Sa curiosité et ses lectures personnelles la poussent à explorer la sécurisation des données ; elle en fera le sujet de ses recherches pour l’obtention d’un doctorat en informatique de l’Université Claude Bernard - Lyon I, en France. « Mon doctorat traite de la sécurisation d’accès aux réseaux en utilisant des techniques de cryptographie, de reconnaissance de l’iris et des systèmes multiagents (SMA), précise Franjieh El Khoury. C’est moi qui ai choisi le sujet. »
Tout comme l’empreinte digitale, l’iris est particulier à chaque personne et peut être utilisé pour reconnaître
Franjieh El Khoury,
les individus autorisés à accéder à un système informatique d’une façon sécurisée efficace. Dans le principe, « on extrait l’iris, représenté sous forme d’une couronne, de la forme de l’œil. Après la phase de l’élimination des effets des paupières pour obtenir le motif de l’iris sous forme binaire, on compare ce motif de chaque personne qui essaie d’accéder aux données à ceux des personnes identifiées et autorisées », explique Franjieh El Khoury.
C’est John Daugman, professeur à l’Université de Cambridge, qui a inventé l’algorithme de reconnaissance de l’iris « IrisCode », en tenant compte des effets des paupières qui peuvent masquer une partie de l’iris. Franjieh El Khoury a donc amélioré l’algorithme pour concevoir une méthode innovante d’élimination des effets des paupières plus précise et pour assurer que différentes images d’iris prises d’une personne proviennent bien de la même personne. Elle a publié en 2013 un livre sur ce sujet, Iris Biometric Model for Secured Network Access. Elle est en outre co-autrice de Building a Dedicated GSM GPS Module Tracking System for Fleet Management – Hardware and Software, un ouvrage paru en 2018 et portant cette fois sur l’utilisation du GPS pour assurer le suivi et la sécurité des enfants et des personnes âgées. Franjieh El Khoury a aussi écrit plusieurs articles scientifiques diversifiés.
Franjieh El Khoury est venue au Canada parce qu’elle souhaitait s’épanouir sur le plan professionnel. Après quelques emplois en tant que contractuelle et consultante informatique, elle décroche, en 2018, un poste d’associée de recherche au Laboratoire de recherche en réseautique et informatique mobile (LARIM), dirigé par le professeur Samuel Pierre, ing., à Polytechnique Montréal. Celui-ci, ainsi que le professeur Musandji

Fuamba, ing., l’encouragent d’ailleurs dans ses démarches pour intégrer l’Ordre. « J’ai aussi eu l’appui de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour toute la démarche et pour la préparation de l’examen final, tient-elle à préciser. Chaque fois que j’ai appelé, une personne m’a donné des informations utiles. »
Au LARIM, en tant que coordonnatrice, elle supervise les étudiants et étudiantes, effectue le suivi des projets de recherche en collaboration avec les partenaires universitaires et industriels. Les projets de recherche mettent à profit les technologies de la sécurisation des systèmes, de la chaîne de blocs, de l’apprentissage automatique pour le développement de l’internet des objets, des applications mobiles et de la ville intelligente. À cela s’ajoute une charge de cours sur les bases de données, la conception et la modélisation des systèmes d’information. « Mon travail est multidisciplinaire. Je mets en application des principes d’ingénierie, j’ai des collaborations avec l’industrie, la recherche m’intéresse. Le milieu universitaire est l’environnement qui m’attire le plus », indique Franjieh El Khoury, ajoutant qu’elle n’est pas « du genre à rester les bras croisés ».
La preuve en est ses diverses activités en rédaction et diffusion des connaissances. Au sein du regroupement Collaboration pour l’ingénierie enseignée en ligne (CIEL), une association francophone pour l’enseignement et l’apprentissage du génie, elle participe à la rédaction d’un guide sur l’intégration de systèmes dans l’industrie à l’intention des futurs diplômés et diplômées en génie. Elle est membre volontaire du comité de rédaction du Centre canadien des sciences et de l’éducation, et éditrice associée et réviseure de la revue scientifique internationale Computer and Information Science
Pour caser toutes ses activités, tout est, selon elle, une question de rigueur et d’organisation des 24 heures qui composent une journée.
« Mon travail est multidisciplinaire. Je mets en application des principes d’ingénierie, j’ai des collaborations avec l’industrie, la recherche m’intéresse. »
ing. Polytechnique Montréal
L’ingénieure Najat Kamal et l’ingénieur Alain Gauvin arrivent tous deux au terme de leur mandat respectif. Très satisfaits de leur expérience, ils font un bilan positif et envisagent avec optimisme l’avenir de leurs équipes.
Par Clémence CireauNajat Kamal est ingénieure responsable Environnement et Qualité chez Nexans.

Originaire du Maroc où elle a étudié le génie des procédés industriels, elle est arrivée au Québec en 2002. Elle est devenue membre de la section régionale de Laval-LaurentidesLanaudière puis du comité régional il y a une dizaine d’années. « Au départ j’étais seulement bénévole active en promotion de la profession, puis j’ai pris en charge la gestion des activités de promotion de la profession. »
Najat Kamal se présente ensuite à la présidence de son comité régional et est élue.
« De toutes les responsabilités que j’ai acceptées, c’est celle qui m’a donné le plus grand bonheur », affirme Najat Kamal. Elle raconte avoir autant reçu que donné tout au long des
quatre années de son mandat. « L’équipe du comité est merveilleuse, ce sont des gens engagés qui sont là pour les bonnes raisons. Il n’y a pas d’intérêt financier, c’est simplement l’amour de notre profession, le génie, qui nous porte dans notre engagement. »
L’ingénieure déclare avoir acquis des compétences en guidance, en stratégie et en encadrement d’équipe. « J’ai appris à connaître l’équipe et à distribuer les rôles en fonction des préférences et des forces de chaque personne. Tout bien considéré, les présidentes et présidents des comités ne sont pas des dirigeants, ce sont des facilitateurs. » Najat
Alain Gauvin est natif de Montmagny. Il a étudié le génie électrique à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a par la suite travaillé pour la Compagnie minière Québec Cartier, à Port-Cartier, entreprise rachetée depuis par ArcelorMittal. En mai 2020, Alain Gauvin a pris sa retraite. « Lorsque je travaillais, mon implication dans le comité régional et en particulier mon rôle de président du comité régional de la Côte-Nord m’ont permis de développer des compétences de leadership et d’affiner mon rapport aux responsabilités, dit-il. Les membres du comité détiennent un haut niveau d’éthique professionnelle, c’est très formateur. »

« Maintenant que je suis retraité, je suis heureux de garder le contact avec des ingénieures et des ingénieurs qui ont à cœur la promotion de la profession et de continuer à intervenir auprès des jeunes pour les inciter à choisir de faire carrière en génie. » Le comité de la Côte-Nord a parfois du mal à fidéliser ses bénévoles, car comme l’explique Alain Gauvin, « un certain nombre d’ingénieurs restent à Port-Cartier pendant 14 jours d’affilée et travaillent 12 heures par jour, puis ils retournent dans leur famille pour une période de congé. Cela laisse peu de possibilité de s’ajouter des engagements ». Son souhait pour le comité est donc qu’une équipe solide se constitue autour d’objec-
Kamal termine son mandat avec le sentiment du devoir accompli. Et pour cause, le comité a amplement dépassé ses objectifs en ce qui concerne la promotion de la profession, l’engagement, la mobilisation et la reconnaissance des ambassadrices et ambassadeurs en génie. Au-delà des nombreuses rencontres dans les écoles, les membres ont organisé plusieurs formations, des conférences et des visites d’entreprises. « J’ai grandi en âme et en esprit avec ce comité, assure-t-elle. Je compte bien continuer à en faire partie pour apporter mon soutien à l’équipe, faire la transition et passer le flambeau à la personne qui me succédera à la présidence. Je suis très confiante en l’avenir du comité Laval-Laurentides-Lanaudière et convaincue qu’il va continuer à briller ! »
tifs tels que l’initiative 30 en 30, qui consiste à avoir au moins 30 % de femmes en génie d’ici 2030. « Les bénévoles font un travail impressionnant auprès des jeunes. Même si l’on ne peut offrir beaucoup de temps, ces moments de promotion de la profession sont essentiels. Il suffit d’une étincelle pour allumer le rêve. Et on peut être cette étincelle ! »
Le programme de promotion de la profession a amorcé sa deuxième année en septembre. Dominique Guérette, conseillère séniore au développement de la profession, Valérie Bongain, conseillère au développement de la profession, et Tifany Néron, coordonnatrice au développement de la profession, ne ménagent pas leurs efforts pour que cette deuxième édition soit aussi porteuse que la première.
Les objectifs sont de susciter l’intérêt envers la profession, notamment chez les jeunes filles, en démythifiant la réalité de la profession d’ingénieur, très variée et souvent méconnue. Les 350 ambassadrices et ambassadeurs passionnés ont rencontré l’année dernière plus de 10 000 jeunes du secondaire et du cégep. Afin de consolider ces moments de rencontre, ceux et celles qui travaillent à promouvoir la profession multiplient les interventions avec des personnes qui jouent un rôle clé en ce qui concerne l’orientation des jeunes tels que les professeurs et professeures de sciences et les conseillers et conseillères d’orientation. Comme le rappelle Dominique Guérette, conseillère séniore au développement de la profession, « l’Ordre veut être la principale source d’information scolaire en génie ». Le catalogue de présentation des différents types de génie, destiné aux intervenants et
intervenantes en milieu scolaire, contient 25 fiches. « Cette année, 5 fiches seront ajoutées, ce qui complétera la présentation des 30 types de génie présents dans les programmes de baccalauréat. » Ces fiches résument en quoi consiste le travail des ingénieurs et ingénieures exerçant dans différents domaines, décrivent les tâches qu’ils et elles accomplissent, présentent des innovations résultant de leur travail ; elles s’avèrent un incontournable pour bien accompagner les jeunes dans leurs recherches sur la profession. Les intervenants et intervenantes qui le souhaitent peuvent également recevoir chaque mois une infolettre « Flash génie » qui contient des renseignements sur le domaine, très souvent en lien avec l’actualité, et présente les activités réalisées par les ambassadrices et ambassadeurs dans les établissements scolaires.
 Par Clémence Cireau
Photo : Luis Medina et Didier Bicep
Par Clémence Cireau
Photo : Luis Medina et Didier Bicep

Les orientations de cette deuxième année du programme visent à atteindre encore davantage d’élèves. « Nos ambassadeurs et ambassadrices réalisent un travail formidable et nous les en remercions, déclare Dominique Guérette. Maintenant, nous souhaitons mettre en place des outils pour atteindre plus de 500 000 jeunes fréquentant le secondaire et le cégep, des étudiants que nos ambassadeurs et ambassadrices ne rencontrent pas directement. »
Ainsi, six activités virtuelles seront organisées en janvier et février. Le format s’apparente à celui des ateliers « Du grand génie » : une étudiante inscrite à un programme universitaire posera des questions sur leur profession à un panel constitué de membres de l’Ordre. « Avec cette formule virtuelle, nous pouvons joindre simultanément des centaines de jeunes du cégep de partout au Québec, indique Dominique Guérette. Le moment choisi pour diffuser ces discussions est particulièrement propice, juste avant la période des inscriptions à l’université, qui se termine le 1er mars. »
Dans la même optique, l’équipe de Dominique Guérette souhaite décupler les contenus du compte TikTok de la communauté placepourtoi.ca, le site de vulgarisation du génie destiné aux jeunes. « On y trouvera des vidéos mettant en vedette des ambassadeurs et ambassadrices parlant de leur profession, ainsi que des capsules de devinettes et des défis lancés aux jeunes », explique Dominique Guérette. Le principe des devinettes existe déjà sur les comptes Facebook et Instagram de l’Ordre, « et c’est un beau succès, poursuit Dominique Guérette. Nous avons lancé à plusieurs reprises des défis aux jeunes ; plusieurs ont répondu et partagé le contenu sur leurs réseaux ». Le site internet placepourtoi.ca va également faire peau neuve cette année. « Nous allons dynamiser la facture visuelle afin de le rendre plus pertinent et attrayant pour les générations Z et alpha », précise Dominique Guérette.
Au-delà d’une densification et d’une modernisation de la communication destinée aux jeunes, le programme de promotion de la profession désire s’orienter vers les
enfants des écoles primaires. Une équipe va également participer pour la deuxième année consécutive au Festival Eurêka Montréal. « Lors de la dernière édition, les ambassadeurs et ambassadrices ont rencontré plus de 4 000 jeunes en 3 jours. Des mini-ateliers scientifiques étaient organisés autour du thème de l’eau. Il fallait notamment estimer combien de gouttes pouvaient tenir sur une pièce de monnaie à l’aide d’une pipette en suivant les étapes de la démarche scientifique », raconte la conseillère.
La force du programme de promotion de la profession réside sur son socle fort d’ambassadrices et d’ambassadeurs qui s’impliquent tout au long de l’année. Dominique Guérette, Valérie Bongain et Tifany Néron les accompagnent quotidiennement et veillent à bonifier et à prolonger leurs interventions scolaires à l’aide d’outils complémentaires. « Il y a fort à parier que la deuxième année du programme de promotion de la profession continuera sur la même dynamique positive ! », conclut Dominique Guérette.
Pour retrouver le catalogue et les 30 fiches sur les types de génie : https://www.placepourtoi.ca/ wp-content/uploads/2022/05/PPTOI_catalogue_ fiches_genie_numerique.pdf
placepourtoi.ca, accédez à la communauté TikTok https://www.tiktok.com/@placepourtoi
Pour Charles Maheu, l’ingéniosité n’a pas de limites, et ce n’est certainement pas son fauteuil roulant qui freinera sa créativité ! Finissant au baccalauréat en génie robotique à l’Université de Sherbrooke, le jeune homme s’apprête à démarrer sa carrière dans la firme où il a effectué son dernier stage de formation.
 Par Mélanie Larouche Photo : Charles Maheu
Par Mélanie Larouche Photo : Charles Maheu
Natif de la Beauce, Charles Maheu a arrêté son choix sur le génie robotique à l’université pour les nombreuses avenues professionnelles que présente ce nouveau programme. « J’ai toujours été attiré par les sciences, mais c’est seulement à la fin du cégep que je me suis intéressé davantage à l’ingénierie, raconte-t-il. Le programme de génie robotique de l’Université de Sherbrooke répond à plusieurs de mes centres d’intérêt. En plus de la robotique, il touche au génie mécanique, électrique et informatiques ; ça donne une bonne vue globale de tout ce qu’on sera appelés à faire comme ingénieur. C’est ce que je recherchais : avoir des avenues diversifiées pour m’accomplir professionnellement. C’est un nouveau programme vraiment très intéressant ; je fais partie de la deuxième cohorte à terminer en robotique à Sherbrooke. »
Le programme de génie robotique est assez costaud. D’une durée de quatre ans et demi et comportant cinq stages à réaliser, il a vite permis à Charles Maheu de bien comprendre le rôle de l’ingénierie industrielle dans la résolution concrète de problèmes sur le terrain. « Quand on constate en entreprise que quelque chose ne fonctionne pas ou qu’il serait possible d’améliorer la productivité des installations, notre mandat en tant qu’ingénieur est de trouver des solutions, explique le jeune homme. Le fait d’avoir une réelle influence sur les
gens et sur leur environnement immédiat, ça donne une valeur incroyable à notre travail : nous contribuons à leur faciliter la vie. L’ingénierie pousse sans cesse les limites du possible, je trouve ça extrêmement stimulant et valorisant. »
Charles Maheu a reçu la bourse Avenir de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec en 2018. Quelques semaines avant l’obtention de son diplôme, l’étudiant était très enthousiaste en songeant à la carrière qui l’attend. « Les stages m’ont aidé à explorer mes champs d’intérêt et à réaliser que j’aime vraiment travailler en dynamique de groupe, précise-t-il. Mon dernier stage, pour le Groupe IND, je l’ai adoré ! J’étais vraiment très heureux qu’on m’offre un poste à temps plein dans cette petite compagnie qui a énormément d’impact pour ses clients. Situé dans le quartier industriel à Sherbrooke, Groupe IND réunit plusieurs petites entreprises d’ingénierie. Mon mandat est d’élaborer des solutions intégrées pour que les clients, grâce à nos cellules robotiques, puissent simplifier certaines fonctions de leurs opérations. Nous mettons actuellement au point un palettiseur, c’est-à-dire un bras robot qui met des boîtes sur des palettes. La conception mécanique et l’interface le rendent facile à utiliser. »

Atteint d’ostéogenèse imparfaite, Charles Maheu est en fauteuil roulant depuis toujours. Ses os sont très fragiles et les fractures sont fréquentes. Au cours de son baccalauréat seulement, il en a subi trois. « Ma situation de santé est un énorme défi au quotidien, confie-t-il. Mais j’apprends à me connaître à travers cette épreuve. Je développe ma résilience et je poursuis néanmoins mes objectifs, adaptés à ma condition mais non moins ambitieux. C’est certain que ma situation a des répercussions sur ma carrière et mes projets futurs, de là l’importance pour moi d’avoir plusieurs cordes à mon arc. Dans mon domaine, je penche pour une spécialisation en mécanique et robotique. »
Parmi ses objectifs professionnels, Charles Maheu entend donc pousser ses apprentissages et s’entourer de gens motivés et stimulants. « J’aime sortir de ma zone de confort, il y a tellement de choses à apprendre sur le terrain ! Mon milieu présente de beaux défis, en grande quantité ; c’est de cette façon que je veux continuer à me développer en tant qu’ingénieur. »
Son projet de fin de bac le rend particulièrement fier. « Graspy est une main robotique programmable par imitation de mouvements pour faciliter l’automatisation de tâches avec des bras robotiques, indique l’aspirant ingénieur. Le projet vise à simplifier les robots en milieux changeants pour qu’ils puissent s’adapter rapidement à leur environnement. Par exemple, les entreprises manufacturières qui changent fréquemment de produits doivent sans cesse faire appel à des firmes spécialisées pour automatiser certaines parties de leur production. Avec Graspy, un employé formé peut facilement reprogrammer les mouvements et actions d’un bras robotique. La main intègre des technologies innovantes permettant de saisir des objets de formes variées ainsi qu’un système de vision utilisé pour contrôler les mouvements en temps réel. »
Parmi les autres activités auxquelles il s’adonne, Charles Maheu adore la photographie. « J’ai commencé ce passe-temps il y a cinq ou six ans, mentionne-t-il. J’aime bien faire des portraits et prendre en photo des objets urbains. La photographie est pour moi une façon d’exprimer ma créativité, mais sans pression. La créativité est un aspect important dans ma vie. J’aime aussi voyager pour découvrir de nouveaux paysages et de nouveaux visages, que je me plais à capter avec ma lentille. Malgré les embûches et les défis, la vie a tellement à offrir à qui sait l’apprécier ! »
« C’est certain que ma situation a des répercussions sur ma carrière et mes projets futurs, de là l’importance pour moi d’avoir plusieurs cordes à mon arc. »
Charles Maheu Université de Sherbrooke
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 13 octobre 2022, M. Michel Gosselin, ing. (membre no 120150), dont le domicile professionnel est situé à Lac-Mégantic, province de Québec, a fait l’objet d’une décision du Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec relativement à son droit d’exercice, à savoir :
Assainissement autonome des eaux usées
« DE PRONONCER la limitation volontaire d’exercice de Michel Gosselin, ing. (membre no 120150), dans le domaine de l’assainissement autonome des eaux usées, en lui interdisant, autrement que sous la supervision d’un ingénieur, d’exercer toute activité professionnelle réservée aux ingénieurs par la Loi sur les ingénieurs dans ce domaine. Cette limitation comprend également toute activité non réservée aux ingénieurs se rapportant à un système d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée visée par un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). »
Cette limitation du droit d’exercice de Michel Gosselin, ing., est en vigueur depuis le 13 octobre 2022.
Montréal, ce 24 novembre 2022
Me Pamela McGovern, avocate Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques
Avis est donné par la présente que, le 4 octobre 2022, en vertu du second paragraphe de l’article 85.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), l’Ordre des ingénieurs du Québec a radié du tableau de l’Ordre le membre dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut d’adhérer au régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité professionnelle dans les délais fixés conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs :
Nom Prénom Domicile professionnel
El Gayer Salah Eddine Val-d’Or, Québec
Le présent avis est donné en conformité avec l’article 182.9 du Code des professions
Montréal, ce 20 octobre 2022
Me Pamela McGovern, avocate Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que le 17 novembre 2022, le Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec a prononcé la radiation du membre dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut de se conformer aux obligations de la formation continue obligatoire conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
Cette décision est effective depuis le 19 décembre 2022.
Nom Prénom Domicile professionnel
Zendagui Zoheir GATINEAU
Montréal, le 19 décembre 2022.
Me Pamela McGovern, avocate Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques
AVIS DE RADIATION
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Conformément à l’article 182.9 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), avis est donné par la présente que, le 15 décembre 2022, le Comité des requêtes de l’Ordre des ingénieurs du Québec a prononcé la radiation des membres dont le nom apparaît ci-dessous, pour avoir fait défaut de se conformer aux obligations de la formation continue obligatoire conformément au Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
Cette décision est effective depuis le 16 janvier 2023..
Nom Prénom Domicile professionnel
Christopher Karl Leblanc QUÉBEC
Louis Chouinard QUÉBEC
Montréal, le 16 janvier 2023.
Me Pamela McGovern, avocate Secrétaire de l’Ordre et directrice des Affaires juridiques
Veuillez communiquer avec le Service de l’accès à la profession (514 845-6141 ou 1 800 461-6141, option 1, ou par courriel : sac@oiq.qc.ca) afin de vérifier si la personne dont le nom n’est pas suivi d’un astérisque a régularisé sa situation.
Permis d’ingénieurs et ingénieures délivrés par le Comité d’admission à l’exercice de l’Ordre des ingénieurs du Québec du 17 octobre au 31 décembre 2022
Abib, Narimane
Ait Slimane, Dahais
Akremi, Najeh
Al Harash, Mohamed
Al Saati, Anas
Alrahwan, Mohammad Amer
Alungulesa, Simina
Amelete, Sam Gontran
André, Bruno Alain
Tomasz
Aramboo, Lavatharshan
Asselin, Marie-Hélène
Athans, Cassandra
Aubé, Jean-François
Augustynski, Amanda
Bah, Alpha Oumar
Bakiri, Ali
Ballet, Paul
Baril-Lahaie, Miguel
Baron Hernandez, Maria Fernanda
Basili, Marco
Bastien, Dominick
Bauluck, Adonis
Baumelle, Frédéric
Beaucage-Gauvreau, Francois
Beaudry, Louis-Félix
Beauséjour, Mike
Bedard, Alexandre
Bédard-Martineau, Marie-Ève
Behiguim, Fernand
Bélanger, Anthonin
Bélanger, Pier-Luc
Bélanger, Shawn
Bélanger, Simon-Pierre
Béliveau-Larose, Vincent
Benabbas, Zoheir
Benjrad, Othmane
Benyahia, Haoi
Bergeron, Kevin
Bernatchez Verville, Mathieu
Bertoldi, Marco
Bessette, Julie
Beya Kazambua, Fabrice
Bibeau, Olivier
Bilodeau, Mathieu
Bizouarn, Marion
Blanchard, Nicholas
Blanchette, Carl
Blanchette-Brochu, Maxime
Boileau, Pierre Marc
Boisvert, Nicholas
Bolduc, Joanie
Boloba, Hassane
Boskovic, Srdan
Boucher, Tommy
Boucher Paré, Angelo
Boucher-Allard, Maxime
Boulé, Carolane
Bourbonnais, Simon
Bourdeau-Goulet, Sarah-Claude
Bourdon, Louis-Denis
Bourget-Boulanger, Nicolas
Boyer, Vincent
Brière, Michaël
Brodeur, Maxime
Brzeski, David
Bunieski, Simon
Burns, Luc
Burson, Julien
Burton, Augustus Jai
Bustos, Angela Milena
Carr, Dustin
Castano, Ricardo
Castro Lizcano, Daniela
Cayouette, Olivier
Chabot, Pier-Étienne
Chambolle-Tournon, Nathan
Champagne, Gaël
Charbel, Rouhana
Charbonneau, Lydia
Charron, Christophe
Chase, Matthew
Chassaing, Étienne
Chavand, Vincent
Chebbi, Karim
Chehayeb, Nader
Chéné, Rafaël
Chengli, Samuel
Cherif, Tahar
Chiasson, Christophe
Chouider, Abdallah
Chrétien, Guillaume
Chu Barinotto, Dereck Jesus Ciari, Anna Ciucasel, Ciprian-Aurel Cloutier, Maxime Cloutier, Olivier
Colangelo, Tommy Colney, Antoine
Copti, Paul Choucri Corbeil, Tristan Corbin, Valérie
Cormier, Marc Cornille, Vladimir Corriveau, Xavier Cote, Justine Côté, Antoine Côté-Leclerc, Stéphane
Crombet, Pauline Cusson, Éliot
Cyr, Etienne Dabate, Guillaume
Daf, Merzouk
Dahlab, Fatima
D’amour, Louis
D’angelo, Julian
Daoust, Emile
Darmon, Judith
Darthout, Emilien
Daviault, Antoine
De Albuquerque
Albernaz Crespo, Taisa
Degré, Laurence
Del Real Estevane, Gerardo Antonio
Dellal, Mariem
Dello Sbarba, Hugo
Demers, Pier-Antoine
Denis, Mitchell
Depardon, Diane
Dépault, Emmanuel
Derome, Jean-François
Deschênes, Tommy
Desjardins, Antoine
Destruy, Pierre-Romain
Di Battista, Vanessa
Diomi , Gian Marco
Dion, Marc-Olivier
Dionne, Benjamin
Dissi, Rym-Sabrina
Djasrabe, Noudjalbaye
Djengue, Fred Roland
Dominguez, Francisco
Dontigny, Marc-André
Du Sault-Lapointe, Jérémy
Duclos, Jérémie
Dupuis, Clarence
East, William
El Khazaka, Chris
El Khoury, Franjieh
El Ogeil, Serena
Elagamy, Naglaa
Elsarraf, Mohamed
Espinoza, Samuel
Essouissi, Malika
Everton, Pascal
Faddal, Malak
Fequet, Kristopher
Fernandes Brito Silva, Atylla
Ferreira, Maicon
Roberto
Filali, Saad
Flores-Huynh, William
Foin, Veronique
Fortier, Jean-Michel
Fortin, Marie-Jeanne
Fotié Tchomtchoua, Magloire
Fournier, Joey
Fradette, Sonya
Frechet-Boudreau, Arnaud
Frenette, Maxime
Fung, Adrien
Gagnon, Antoine
Gagnon, Noémie
Gagnon-Lapointe, Gabriel
Gallo, Danika
Galvin, Matthieu
Gamache, Olivier
Gamboa, Philip
Gasulla, Marine
Gaudette-Thibault, Camille
Gaudreau-Miron, Vincent
Gauvin-Verville, Antoine
Georgescu, Georgiana-Adina
Gervais, Guillaume
Ghostine, Richard
Gingras, Mathieu
Girard, Raphaël
Gomez, Sebastian
Goudreau, Sophie
Gourd, André
Gourdon, Yann
Gourga, Pierre-Louis
Guay, Gabriel
Guay, Rosalie
Guélennoc, Quentin
Guérin, Joey
Gueye, Pape Seybatou
Hajjout, Nadia
Hamilton-Hodgson, Kenneth
Hanini, Mohammed Said
Harvey Girard, Marc Olivier
Hazzi, Imad
Hervy, Corentin
Huard, André
Ibarra Gutiérrez, Sebastián Ignacio
Idrissi Ibrahimi, Mohammed
Igouhe Atcha, Jean-Cedric
Inejih, Mohamed
Yahdhih
Iragena, Joy Valentin
Ismail, Dhya
Jack, David
Jacques, Samuel
Jahid, Younes
Jaimes Aldana, Gloria Maria
Jean, Marie-Ève
Joyal, Frédérik
Jutras, Mark
Kabayiza, Pacifique
Nkuriza
Kameni, Sebastien
Kamwa Moghom, Steve Loic Junior
Kana Tadatsin, Raoul Duval
Karkeni, Mohamed Yassine
Kebir, Sara
Keita, Alpha Mamoudoutalibe
Keita, Massiga
Keïta, Tiécoro
Khalifeh, Leïla
Permis d’ingénieurs et ingénieures délivrés par le Comité d’admission à l’exercice de l’Ordre des ingénieurs du Québec du 17 octobre au 31 décembre 2022
Kiala Lutonadio, Vanessa
Kierans, Anjelica
Kim, Kihong
Kondrat’ev, Artur
Koulibaly, Aboubacar-Sidiki
Labelle, Justin
Labonté, CharlesOlivier
Labonté-Dupuis, Thierry
Labrecque, Alexis
Lacasse, Vincent
Laganière, Pascal
Laliberte, Jean-Michel
Laliberté, Jérémy
Lalyre, Augustin
Alphonse
Lamarre, Nicolas
Lambert, Philippe
Lamontagne, Olivier
Lamontagne, Olivier
Lampron, Jean-François
Langlais, Marc-Édouard
Langlois, Julien
Laparé, Francis
Lapointe, Francis
Lapointe-Aubert, Marjorie
Lardjani, Kaddour
Larochelle, Emily
Larose-Guay, Jonathan
Lavallée, Simon
Laverdière, Michael
Lavigne, Karl-Antoine
Laviolette, Alex
Laviolette, Thomas
Law-Kam Cio, Yann Seing
Law-Kam-Cio, Yann-Meing
Lazzaroni, Mathieu
Lazzouzi, Mehdi
Leclerc, Stéphanie
Leclerc, Thierry
Lei, Xin
Lemieux, Dominic
Lévesque, Justin
Lévesque, Laurence
Lévesque, Mathieu
Lirette, Benjamin
Llanos Lopez, Lina Fernanda
Lussier-Tomaszewski, Pénélope
Maali Tafti, Mahdi
Mailloux-Rhéaume, Philippe
Mallet, Mickael
Maltais, Samuel
Mandelzys, Joelle
Maranda, Jean-Christophe
Marchand, Francois
Marois, Laurence
Maroun, Josephe
Masquelier, Nicolas
Mbarki, MohammedAmine
Mcgreal, Inci
Mcisaac, Reagan
Miao, Hongyan
Michaud-Girard, Camille
Milad, Hari
Minville, William
Mole, Jonathan
Morin, Olivier
Morin, Samuel
Mottier, Paul
Moustaid, Amine
Mteirek, Alaa
Nachet, Soufiane
Nadeau, Marc
Najivandzadeh, Behnaz
Nami, Hamaad Haider
Nasirian, Farshad
Ndiaye, Elhadji
Ousmane
Nervet, Guillaume
Ngabu, Elysée
Tshibangu
Nicollet, Quentin
Jean-Pierre
Nkamegue, Estelle
Nkawe, Stanislas Benjamin
Normand, Anne-Louise
Optyker, David
Osman, Rami
Ouali, Hakim
Oubaha, Rachida
Oukbili, Abdessamad
Oulbani, Said Ouro Koura, Baba-Issa Papineau, Vincent Paquet, Jeanne Patino Rodriguez, Edison Gilberto Paulo E Silva, Carlos Eduardo Pellemans, Xavier Pelletier, Guillaume Perrachon, Lou Perreault, Claudia Petit, Yvan Piché, Maxine Pierre, Jean Emmanuel Pigeon, Alexandre Plante, Olivier Pommier, Ludmilla Poullard, Florent Prabhu, Kieran Proulx, Alexandre Proulx, Jonathan Provencher, Marc-André
Qin, Linda Radi, Ashraf
Rainville, Carl Redl, Erin Renaud, Vincent Rey, Gaëtan Rezaei, Masoud
Rivière, Maxime
Roberge, Vincent Robert, Manal Rolland, Valentin Romain, David Roulier, Elizabeth Roullier, Thibaud
Rousseau, Pierre-Alexandre Rousseau, Pierre-Olivier Roux, Guillaume
Roy, Jean-Simon
Roy, Thomas
Roy-Bergeron, Alizée
Roy-Girard, Guillaume
Sabetazad, Shabahang
Salama-Siroishka, Jonathan
Sanchez Osio, Jose Luis Sandu, Marcel
Saucedo Prado, Luis Lenin
Savaria, Maxime
Savoie, Mélissa
Sebbag, Raphael
Senneville, Rose
Senougbe, Sèmassa
Fréjus
Senturk, Sadettin
Serrano Corredor, Maria Del Rosario
Sévigny-Vallières, Claudine
Simard, Antoine
Simard, Christophe
Skwarka, Audrey
Slezak, Amanda
Smith, Joseph*
Soloviev, Alexandre
Sourceaux, Maxime
St-Amour, Antoine
Steneker, Paul
St-Jacques, Léa
St-Laurent, Philippe
Sylvain, Megan Anaïs
Sylvestre, Danny
Tack, Ryan
Taillefer-Reneault, Alexandre
Takou, Brice Archimede
Tanguay, Olivier
Tannoury, Joseph
Tardif, Alexandre
Tawk, Samer
Tchatatntapkam, Bertrand
Thaghri, Mohamed
Amine
Thivierge, Philippe
Thobie, Youen
Tobar, José Alfredo
Tremblay, Gabrielle
Tremblay, Jonathan
Tremblay, Roxanne
Tremblay, Samuel
Tremblay-Harnois, William
Trépanier, Alexis
Tsheke Shele, Johnny
Turbide, Cédric
Turcot, Gabrielle
Turcotte, Simon
Varnier, Pierrick
Vellaine, Vincent
Vendetti, Samuel
Vidalon Aliaga, Percy Angel
Villeneuve, Thierry
Wack, Jules
Walling, Eric
Wang, Xiaodong
Watier, Mathieu
Wong, Fabien
Xing, Chen
Yameogo, Fabrice Aser
Zabramba, Miguel
Zaghib, Imad
Zambito, Gabriele
Zebdji, Neila
Zeghoud, Mohammed
Ala-Eddine
Zerigui, Amel
Zhou, Yaojin
Zhu, Xiaolu
Zimmermann, Yann
* Titulaire d’un permis temporaire pour un projet particulier. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’Ordre.
AVIS
D’INGÉNIEUR ET AUX PERSONNES
DÉTENTRICES D’UN PERMIS RESTRICTIF TEMPORAIRE
Conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, les prochaines séances d’examen auront lieu comme suit :
Pour vous inscrire à une séance, vous devez vous rendre sur la plateforme d’inscription. Vous trouverez le lien vers la plateforme sur le site de l’Ordre à la rubrique Je suis – Candidat à la profession d’ingénieur (CPI). Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle aux numéros suivants : 514 845-6141 ou 1 800 461-6141, option 1. En conformité avec la Loi sur la langue commune et officielle du Québec, le français, cet examen est administré en français. Toutefois, les candidats et candidates qui se qualifient pour un permis temporaire selon l’article 37 de la Charte de la langue française peuvent obtenir un exemplaire bilingue du questionnaire.
VOUS N’AVEZ PAS FOURNI À L’ORDRE UNE ADRESSE COURRIEL ?
Vous devez fournir à l’Ordre une adresse courriel, laquelle doit être établie à votre nom (art. 60 du Code des professions). Cette adresse doit être fonctionnelle et vous permettre de recevoir les communications de l’Ordre.
VOUS DÉMÉNAGEZ OU CHANGEZ D’EMPLOI ?
Vous devez aviser le secrétaire de l’Ordre de tout changement relatif à votre statut, à vos domiciles résidentiel et professionnel, aux autres lieux où vous exercez la profession et à votre adresse courriel, si nécessaire, et ce, dans les 30 jours du changement (art. 60 du Code des professions).
VOUS AVEZ ÉTÉ DÉCLARÉ.E COUPABLE D’UNE INFRACTION CRIMINELLE OU PÉNALE OU FAITES L’OBJET D’UNE POURSUITE CRIMINELLE ?
Vous devez informer le secrétaire de l’Ordre que vous avez été déclaré.e coupable, au Canada ou à l’étranger, d’une infraction criminelle ou disciplinaire ou que vous faites l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction passible de cinq ans d’emprisonnement ou plus, et ce, dans les 10 jours où vous êtes informé.e de la décision ou, selon le cas, de la poursuite (art. 59.3 du Code des professions).
Pour apporter des modifications à votre profil, rendez-vous sur votre portail membres.oiq.qc.ca
Du 19 octobre au 22 décembre 2022 (période de réception des avis)
L’Ordre des ingénieurs du Québec offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées suivantes :
ANDRÉ AUDET
TROIS-RIVIÈRES
NADINE COSSETTE LA TUQUE
LAURENT DUBÉ
ROUYN-NORANDA
LÉANDRE MERCIER QUÉBEC
PHILIPPE REID MONTRÉAL
MICHEL TREMBLAY GATINEAU
La formation des ingénieures et ingénieurs est essentielle pour faire face aux défis industriels et environnementaux présents et futurs du Québec. Depuis 150 ans, la belle province peut compter sur l’apport important de diplomées et diplomés de Polytechnique Montréal pour assurer son développement.
SILVIU CONSTANTIN JIANU LAVAL
DENIS RÉAL LORANGER MONTRÉAL
Pour nous informer du décès d’une ou d’un membre, veuillez écrire à l’adresse suivante : sac@oiq.qc.ca
Plan vous invite également à faire plus ample connaissance avec l’ingénieure Maud Cohen, la première directrice générale de Polytechnique Montréal.
Quels sont les principaux enjeux en matière de production et de distribution d’énergie auxquels le Québec doit faire face ? Quelle place les énergies renouvelables occupent-elles dans le bouquet énergétique de la Belle Province ?
Plan vous invite également à faire plus ample connaissance avec l’ingénieur Michel Chornet, vice-président principal chez Enerkem.
Tout cela et bien plus encore à lire dans le numéro de mars-avril 2023 de votre revue
annuelles avec notre offre bancaire privilégiée pour les ingénieurs et diplômé(e)s en génie

Découvrez vos avantages
et privilèges à bnc.ca/ingenieur

