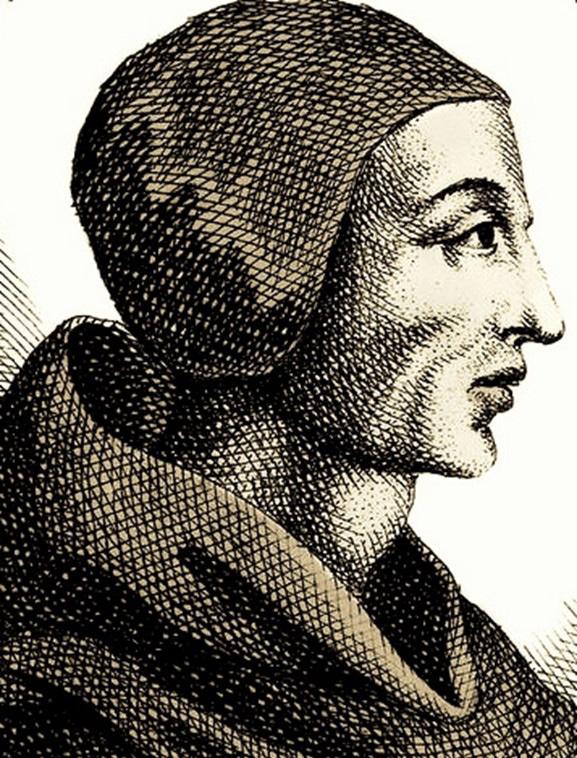CONTENU ÉDITORIAL
Lucinda M. Vardey
CLERGÉ ET LAÏCS DANS UNE ÉGLISE SYNODALE
Valerio Mauro OFM Cap.
L’INTERVIEW DE MAGDALA : SUR L’AMITIÉ SPIRITUELLE
Emily VanBerkum en conversation avec Susan Muto
RÉCIPROCITÉ COSMIQUE ET DÉONTOLOGIE ÉCOLOGIQUE
Dawn M. Nothwehr O.S.F.
LA RÉCIPROCITÉ INTÉRIEURE : UN CHEMIN VERS L’AMOUR SACRÉ
Lucinda M. Vardey
ENSEMBLE, NON SEULS
John Dalla Costa
LA RÉCIPROCITÉ DANS LE LEADERSHIP FÉMININ
Maria Rita Cerimele
COMMUN ACCORD
Volume 4,
1 Hiver 2024
D’UN
Réciprocité
Numéro
www.magdalacolloquy.org 1
Dans les dernières décennies le principe de réciprocité a été pleinement admis par l’Église. Franciscaine américaine, comme seul moyen de respecter l’égalité homme femme dans le discours féministe. Dawn Nothwehr OSF affirme dans son article que la réciprocité est reconnue comme “moralement normative” qu’elle “fonctionne comme un rectificatif à toute forme d’amour et de justice.”
La réciprocité n’est pas la même chose que la complémentarité, mot souvent utilisé pour signifier égalité au sein du peuple de Dieu. La complémentarité, tel que souligné par la théologienne française Anne-Marie Pelletier (voir notre numéro précédent intitulé La Communauté), “ne fait que réitérer l’inégalité hiérarchique traditionnelle.” Elle contribue alors à gommer la plénitude de l’être humain, que ce soit en tant qu’homme ou en tant que femme.
C’est par la compréhension et la pratique de la réciprocité que nous pouvons commencer à faire l’expérience de la grâce de la synodalité. Alors que nous entrons plus profondément dans le processus synodal cette année, avec l’appel du pape François à une plus grande “co-responsabilité” dans la mission évangélisatrice de l’Église, la relation de réciprocité entre Jésus et soi-même ou avec deux personnes ou plus, inclus en son coeur les principes de bienveillance, partage et coopération.
Dans ce numéro, nous abordons quelques questions importantes relatives aux relations qui affectent notre Église et notre monde. Nous proposons des exemples de réciprocité en action. Il s’agit notamment de faire progresser l’amitié spirituelle respectueuse entre le clergé et les laïcs.
L’interview avec Susan Muto propose diverses exemples d’amitiés réciproques avec le Christ qui ont toutes apporté de nombreux dons à l’Église et à la mission du Christ au cours des siècles.

Par le prisme du cosmos et de l’écologie on explore le phénomène de réciprocité entre Dieu et l’humanité ainsi que les plans de Dieu pour développer un partenariat humain visant à vaincre la solitude. Identifiée en 2023 comme la principale maladie de l’Occident par l’Organisation mondiale de la santé, la solitude a été qualifiée par Mère Teresa comme étant la plus grande pauvreté du monde occidental.
La relation de réciprocité est également évidente dans le processus intérieur du cœur, tel que transmis par Béatrice de Nazareth, mystique cistercienne flamande du XIII e siècle ayant inspiré le style et le leadership d’une femme au sein du mouvement des Focolari.
“La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Cependant, chaque note doit contribuer au projet commun. C’est pourquoi l’écoute mutuelle est essentielle: Chaque musicien doit écouter les autres.”
Pape François (Dans le discours du consistoire pour la création de nouveaux cardinaux, 30 septembre 2023).
www.magdalacolloquy.org 2
Éditorial
Lucinda M. Vardey Rédactrice en chef

Valerio Mauro OFM Cap est né à Mazara del Vallo en 1956, mais a grandi à Florence. Il est devenu frère franciscain capucin en 1982 et a été ordonné prêtre en 1988. Après avoir obtenu une licence en théologie dogmatique à l’Université pontificale grégorienne de Rome, il a enseigné la théologie et a été ministre provincial des capucins de Toscane pendant deux mandats. Depuis 1997, il enseigne la théologie sacramentaire à la faculté de théologie de l’Italie centrale et, en tant que membre de l’Association théologique italienne, il a également fait partie de son conseil présidentiel. Entre ses postes d’enseignant, il exerce son ministère en tant que prêtre de paroisse. Il s’intéresse également à l’art et au dialogue œcuménique et interreligieux.
Clergé et laïcs dans une Église synodale
Valerio Mauro OFM Cap
En combinant les différentes interprétations de la synodalité, y compris celles du document de la Commission théologique internationale sur le sujet, il me semble que le processus synodal, sur lequel le pape François a initié le cheminement de l’Église, se déploie dans trois intersections : les événements, les structures et le style. Les événements, tels qu’une celebration inaugurale d’un synode diocésain ou, plus simplement, une assemblée paroissiale, situent les travaux d’une communauté dans un temps et un lieu précis. Les structures synodales ont un large éventail de possibilités et de mises en œuvre, des conseils pastoraux aux conseils économiques en passant par les assemblées au niveau paroissial et diocésain. Dans le contexte actuel, les structures synodales sont de plus en plus transformées afin de les ouvrir à une utilisation plus large dans les différentes composantes des structures ecclésiales. Sous la direction du pape François, les laïcs, hommes et femmes, ont été invités à participer davantage aux divers autres organes du Siège apostolique. Ce qui semble clair, c’est que les éléments fondamentaux à tous les niveaux de l’ensemble du processus sont réalisés dans un style synodal, sans lequel tout événement et changement structurel éventuel perdrait sa fiabilité et son efficacité. Le style synodal, vécu et partagé à tous les niveaux, crée un environnement totalement inspiré par les valeurs évangéliques dans toute leur radicalité.
Si nous regardons l’histoire et si nous considérons les processus qui ont le plus marqué l’évolution concrète de l’Église, les relations entre le peuple de Dieu, en particulier entre les laïcs et le clergé, ont été déterminantes.
En s’appuyant sur le fait que le ministère ordonné est un élément essentiel et constitutif de la réalité ecclésiale, l’appel qui découle de l’expérience d’aujourd’hui est celui du style dialogique qui anime les relations entre les ministres ordonnés et les laïcs. En cela, il y a un besoin de reconnaissance réciproque des charismes et d’une profonde communion d’esprit. En effet, pour que cette idée ait une racine apostolique, il suffit de prendre au sérieux ce qui est écrit dans la lettre aux chrétiens d’Éphèse : “Le Christ a donné aux uns d’être apôtres, aux autres d’être prophètes, aux autres d’être évangélistes, aux autres d’être pasteurs et docteurs, afin de préparer les frères à l’œuvre du ministère (littéralement : diakona) pour l’édification du Corps du Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la
www.magdalacolloquy.org
3
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité, à la mesure de la pleine stature du Christ” (Ep 4,11-13).
L’édification du corps du Christ se fait par la diaconie (l’œuvre du ministère) de tout le peuple de Dieu, au service duquel le Christ a mis en place une variété de ministères, tous liés d’une manière ou d’une autre à la proclamation de la Parole. Cette parole évangélique, une fois de plus, doit être semée dans le champ du monde pour qu’entretenue et protégée, elle puisse porter du fruit en vue de l’accomplissement du Royaume.
RÉCIPROCITÉ DE L’INTIMITÉ
Nous vivons un changement d’époque sans avoir de carte pour nous guider sur le chemin, si ce n’est la Parole de Dieu, qui nous interroge et nous éclaire en passant continuellement de la vie à l’Évangile et de l’Évangile à la vie. Ce mouvement forme un cercle herméneutique aussi nécessaire que délicat. En prenant au sérieux ce que je viens d’écrire, j’ai eu la confirmation, au cours des dix dernières années de ministère pastoral et académique, combien l’interaction entre laïcs et ministres peut être fructueuse.
Je me souviens des nombreuses familles avec lesquelles j’ai partagé un parcours de vie fait d’écoute réciproque. Comme leurs jugements sur le moment présent étaient sages, comme leurs besoins et leurs préoccupations étaient fondés, comme leur témoignage de foi était épuisant et joyeux à la fois ! Ce partage par réciprocité d’estime a façonné mon ministère, le transformant en une manière de servir de moins en moins théorique et de plus en plus vécue. Ma vie de ministre devait entrer en profond “contact” avec la leur.

J’aimerais souligner ici la dimension corporelle présente dans chaque rencontre, un sens singulier et intime qui a engendré la réciprocité : lorsque nous nous touchons, nous sommes touchés. Il se passe quelque chose dans cette proximité intime, à tel point que l’on peut dire : “Il a touché mon cœur.” “Il a touché mon cœur. Jésus lui-même a vécu dans la plénitude du contact avec les femmes, les hommes et les enfants. Il a touché pour guérir, pour redonner la vie, pour entrer en communion, dans cette communion si particulière qu’est l’amitié. Les amis vivent dans l’intimité et le contact réciproques. C’est en entrant dans le cœur d’une personne et en la touchant que l’on comprend que l’amitié est un don du ciel, dont on ne prend conscience que lorsqu’elle s’est enracinée au plus profond de soi. Amis, le Seigneur nous a appelés (cf. Jn 15,15).
LE CŒUR EXISTENTIEL
Pour devenir une Église synodale, pour être vraiment celle d’un hôpital de campagne
www.magdalacolloquy.org
4
évoquée par le pape François, il ne suffit pas de modifier les structures, d’élargir la participation et la coresponsabilité dans la prise de décision—même si tout cela est nécessaire et urgent. Le nouveau style dont nous avons besoin réside dans la capacité à nouer des amitiés profondes, chaleureuses et intimes au sein de chaque communauté ecclésiale.
Je ne me fais pas d’illusions en pensant que toutes les situations sont iréniques (c’est-à-dire qu’elles visent à la paix et à la réconciliation des différences). Toute vie communautaire est imprégnée de conflits, où les différences d’attitudes, d’idées et d’objectifs montrent qu’il s’agit d’un lieu où l’on expérimente et vit la complexité de la vie avec l’Évangile comme levain. Mais c’est là que se trouve l’opportunité d’un témoignage de foi pour le monde, dans le fondement sacramentel commun du baptême et du don de l’Esprit. Ce que l’on appelle le sacerdoce

commun, la participation première et fondamentale au sacerdoce du Christ, je l’ai aussi expérimenté à travers la réflexion théologique. L’expertise des laïcs dans ce domaine est de plus en plus digne d’attention et doit être écoutée. En participant à de nombreuses conférences et congrès de l’Association théologique italienne, j’ai eu la joie de rencontrer de nombreuses sœurs et de nombreux frères par le biais de l’intellect et de l’existentiel. L’admiration pour l’acuité et la profondeur de leur pensée s’est conjuguée à l’estime pour leur vie, surtout lorsqu’ils se consacraient à l’étude de la Parole dans des milieux académiques pas toujours favorables.
Si vous me permettez une dernière réflexion, pour aller au cœur existentiel du parcours synodal proposé à l’Église, je crois que nous sommes confrontés à un appel à construire des liens d’amitié entre les hommes et les femmes, envers la création, au sein de l’Église et avec Dieu.
Aelred de Rievaulx a écrit sur l’amitié spirituelle. Il voyait dans l’amitié dévouée l’accomplissement de l’humanité et un reflet translucide du mystère de Dieu. Pour Deus est amicitia (Dieu est amour), dérivé de 1 Jn 4,16, à la lumière de ce que le Seigneur Jésus a dit : “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis” (Jn 15,13).
L’Eucharistie est la référence centrale de cet appel à célébrer chaque dimanche. Elle est l’acte symbolique d’une Église rassemblée en synodalité. L’Eucharistie nous plonge chaque fois dans ce grand désir de Jésus de manger la Pâque avec ses amis (Lc 22,15).
www.magdalacolloquy.org
5
Susan Muto est directrice générale de l’Epiphany Association et doyenne de l’Academy of Formative Spirituality à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle contribue fréquemment pour des revues savantes et grand public, est auteur et co-auteur de plus de quarante livres. Elle donne des conférences nationales et internationales sur la sagesse précieuse de la foi judéo-chrétienne et sa tradition de formation. Elle y aborde de nombreux aspects fondamentaux sur la vie et ses valeurs, sur les vertus humaines et chrétiennes dans le monde d’aujourd’hui. La Catholic Historical Society of Western Pennsylvania lui a décerné un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2009. Elle a également reçu le prix Aggiornamento 2014 de la Catholic Library Association. Son livre le plus récent s’intitule “Formation for the Spiritual Life : Questions and Reflections for Today’s Christian”, il est publié en 2023 par The Teresian Press. Pour son livre précédent, “A Feast for Hungry Souls : Spiritual Lessons from the Church’s Greatest Masters and Mystics” elle reçoit en 2021 le prix de la spiritualité décerné par la Catholic Media Association.


Emily VanBerkum est rédactrice associée pour notre revue D’Un Commun Accord. Pour plus d’informations, visitez notre site web.
Sur l’amitié spirituelle
Emily VanBerkum en conversation avec Susan Muto
EMILY VANBERKUM L’essor des médias sociaux s’accompagne d’une grande tendance à vouloir élargir nos réseaux et à accumuler des quantités d’amis que nous ne rencontrerons peut-être jamais en personne. Qu’est-ce que la vie spirituelle a à dire à ce sujet et comment définiriez-vous l’amitié spirituelle ?
SUSAN MUTO La différence se situe entre la quantité (par exemple avoir 500 amis sur Facebook) et la qualité (si nous pouvons compter nos amis sur les doigts d’une main, nous sommes vraiment bénis). La distinction entre les amis occasionnels et les amis spirituels est que entre soi et l’autre il y a le Christ. Aelred de Rievaulx, qui a écrit sur l’amitié spirituelle, explique que deux personnes choisies par Jésus pour avancer ensemble le font marchant dans une même direction, ils sont liées par la réciprocité et passent le test du service désintéressé et celui du sacrifice. Nos dons et de nos talents croissent pour l’amour de Jésus d’une manière inhabituellement remarquable afin de servir l’Église. Les amitiés spirituelles ne durent pas seulement toute une vie, mais laissent un héritage dans leur sillage.
EVB L’Église rassemble en son sein un héritage formé de multiples amitiés spirituelles, telles qu’illustrées dans la vie de nombreux saints.
SM Depuis l’Antiquité, en passant par la période médiévale jusqu’aux temps modernes, les saints ont été des exemples illustrant le don de réciprocité. Saint Benoît et sa sœur Sainte Scholastique ont vécu une véritable réciprocité en tant que frère et sœur, montrant comment un frère et sa sœur peuvent devenir de vrais amis spirituels. Un autre couple est
www.magdalacolloquy.org
6
celui formé par saint Augustin et sa mère sainte Monique, qui a prié pour la conversion de son fils et qui ensemble ont construit tout au long de leur vie une relation d’échanges mutuels reciproque. À l’époque médiévale, nous avons l’exemple de Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix (elle avait 56 ans et lui 24). Malgré cette différence d’âge, Sainte Thérèse écrit à propos de Jean : “J’ai trouvé celui qui peut lire dans mon âme.” Tous deux se sont associés pour réformer l’ordre religieux des carmélites. À la même époque, mais un peu plus tôt, sont apparus saint François et sainte Claire, lui apostolique et elle contemplative, qui, grâce à leurs qualités mystiques, ont offert à l’Église un grand cadeau que ni l’un ni l’autre n’était en mesure de réaliser seul. Plus tard, saint François de Sales et sainte Jeanne-Françoise de Chantal, un prêtre et une laïque, ont développé leur relation à travers l’expérience de la direction spirituelle. Dans ces échanges, ils se sont fait confiance et écouté leur cœur. La puissance de l’Esprit Saint les a rapprochés et de nombreuses communautés religieuses se sont ainsi formées.
Le grand saint Vincent de Paul, fondateur des Filles de la Charité, a initié avec Louise de Marillac un ministère auprès des pauvres qui perdure encore aujourd’hui. En déroulant les fils d’or de la réciprocité dans l’Église, nous constatons que, d’une manière ou d’une autre, un mystère que nous ne pourrons jamais comprendre a réuni ces âmes en une cause commune, pour le plus grand bien de l’humanité et le service l’Église.
EVB La véritable amitié spirituelle nous entraîne dans une relation durable, on marche ensemble en regardant dans la même direction, gardant présentes notre humanité et notre dignité communes. Ces exemples d’amitiés chez les saints et saintes sont puissants et démontrent comment se forment les vocations.
SM Oui, les vocations sont essentielles. Ces saints se sont vraiment sentis appelés par Dieu à faire fructifier le meilleur des dons et talents reçus de Jésus. Ils ont senti au plus profond d’eux mêmes l’appel à accomplir un dessein supérieur ou une nouvelle manière de vivre une vie spirituelle qu’il était impossible d’accomplir seul. Cela nous montre que c’est la Providence de Dieu qui rapproche les âmes de cette manière.
EVB Les amitiés spirituelles apparaissent ensuite à différentes étapes de la vie et des vocations, telles que le mariage, la vie religieuse, la vie de famille ou la vie de célibataire, nous relient aux autres d’une manière significative et spécifique. Alors qu’en 2023 l’Organisation Mondiale de la Santé identifie la solitude et l’isolement social comme étant un problème de santé mondial, que nous apprend la réciprocité sur le bonheur dans les relations humaines?
SM La meilleure façon d’expliquer la réciprocité en tant que vocation est de mettre l’accent sur ses vertus. L’une d’entre elles est une affinité inexplicable avec l’autre - comme si, lors de la première rencontre, vous aviez l’impression de connaître cette personne depuis toujours, alors que vous venez à peine de vous rencontrer. C’est ainsi que Dieu rapproche les gens. La réciprocité favorise également la vertu d’empathie, qui n’est pas la même chose que la sympathie, mais qui consiste à entrer dans ce que l’autre personne ressent vraiment et à se sentir profondément compris par elle. Vous comprenez en quoi cela diffère d’un simple moment de plaisir ou de gratification qui passe comme un souffle. Une autre vertu inséparable de la réciprocité est la charité. Elle nous donne le sentiment de nous aimer les
www.magdalacolloquy.org
7
uns les autres comme le Seigneur nous a aimés et de laisser cet amour s’épanouir dans le service aux autres. Même en tant que personne seule, nous sommes un dans le Seigneur et un dans l’Esprit. Mon propre mentor et directeur spirituel, le père Adrian Van Kaam, a été un pionnier dans l’explication de l’empathie. Il disait que c’était le sentiment d’être pleinement compris par une personne.
EVB Compte tenu de ses antécédents et de la relation particulière que vous avez eue avec le père Adrian, quel héritage vous à laisser cette relation ?
SM Pour tous les saints mentionnés ici l’histoire débute par une rencontre. Les gens se sont réunis. Je n’oublierai jamais la première rencontre avec le père Adrian - l’expérience a été si impressionnante pour moi. J’avais beaucoup prié Dieu pour savoir ce qu’il voulait que je fasse, pourquoi j’étais ici et quel était le but de ma vie. Le rencontrer m’a confirmé qu’il y avait un but, qu’il y avait un travail plus profond à accomplir que celui de journaliste ou d’enseignant. Le père Adrian m’a décrit sa vision de l’Église du troisième millénaire, selon laquelle nous devrions nous spécialiser dans une manière complémentaire de vivre notre foi - pas seulement avoir des informations sur la foi, mais comment traduire les croyances du credo dans la vie du monde. Le père Adrian est passé de la tête au cœur et a partagé son histoire. Cette rencontre a débouché sur 40 livres que nous avons co-signés sur la spiritualité formatrice. Nous avons créé une association destinée à aider les croyants et les chercheurs à comprendre ce qui donne le plus de sens à la vie. Nous avons intégré la théologie de l’information et la théologie de la formation. Le père Adrian était également convaincu du rôle important des femmes dans l’Église. Je me suis sentie respectée, comprise et j’ai su que l’amour que Dieu apporterait aux autres à travers nous, était exactement l’amour que Jésus voulait que nous partagions.
EVB C’est une si belle description du mot rencontre. Cela me fait penser aux premiers disciples, avant de croire et de suivre Jésus, il y a eu un moment de rencontre, pas n’importe laquelle, mais celle connue et vécue par Jésus.
SM Oui, l’amitié spirituelle s’enracine souvent dans cette réciprocité, c’est toi et moi avec le Christ entre nous qui regardons dans la direction où le Seigneur veut que nous allions. À la lumière de mon propre parcours et de celui des saints, je comprends parfaitement que Jésus lui-même ait atteint ce point où il a dit qu’il ne pouvait pas appeler ses disciples des serviteurs, mais des amis. On le sent dire : “Je veux que tu vois en toi ce que moi je vois en toi”. Il arrive un moment où l’on sait au fond de soi que l’on donnerait sa vie pour son ami, c’est là la profondeur de l’amitié spirituelle, c’est ce que Jésus a fait. Nous devons célébrer ce don et essayer d’encourager les gens à espérer ces rencontres impossibles à prévoir où vous vous retrouvez en présence d’une âme sœur potentielle, quelqu’un qui peut partager votre cœur et lire dans votre cœur. Encore une fois, la qualité d’une relation dépasse largement la simple quantité.
EVB Vous nous avez donné tant de choses à contempler afin de nous préparer à l’éventualité d’une telle rencontre. Je vous en remercie.
www.magdalacolloquy.org
8

Dawn M. Nothwehr OSF est titulaire de la chaire de déontologie théologique catholique Erica et Harry John Family à la Catholic Theological Union, à Chicago dans l’Illinois. Déontologue catholique de premier plan dans le domaine de l’environnement, elle est consultante pour l’encyclique Laudato Si’ du Bureau de la dignité humaine dans l’archidiocèse de Chicago. Ses recherches et son enseignement portent sur diverses questions de déontologie environnementale, déontologie du pouvoir, la justice raciale, ainsi que sur la théologie morale fondamentale abordée sous l’angle de la théologie franciscaine. Elle s’intéresse également au dialogue religion/science. En tant que chef de projet pour la subvention AAAS-DoSER, elle permet l’intégration du dialogue science/religion dans les cours de théologie et de déontologie à la faculté CTU. Pour l’AAAS-DoSER, elle est en charge actuellement d’évaluer les demandes de subventions, un programme de soutien aux écoles de théologie, permettant d’inclure ce dialogue science/religion dans leur programme. Son dernier livre s’intitule “Franciscan Writings : Hope amid Ecological Sin and Climate Emergency” (Londres, Bloomsbury, 2023).
Réciprocité Cosmique et Déontologie écologique
Dawn M. Nothwehr O.S.F.
L’un des esprits les plus brillants à avoir étudié le cosmos de la Création est le frère franciscain John Duns Scotus, un prêtre écossais (1266-1308). Dans son ouvrage intitulé The Treatise on God as First Principle (Traité sur Dieu en tant que premier principe), il passe en revue l’ensemble de la création et pose la question suivante: quelle est la nature et la cause de tout ce qui est? Scotus remonte ensuite jusqu’à la cause première, la cause déterminée, qu’il appelle Dieu, le Premier Principe.1 Scotus conclut également que Dieu n’a pas eu besoin de créer quoi que ce soit, qu’Il est absolument libre et absolument nécessaire.
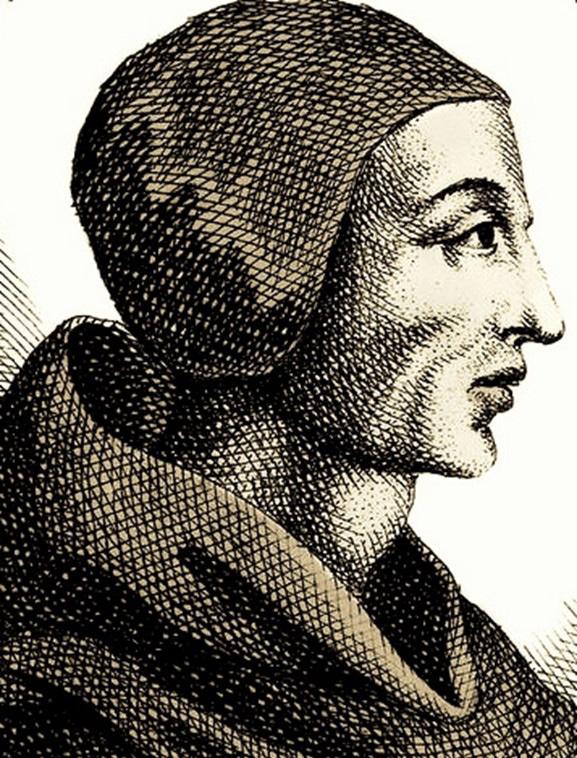
Même si l’on sait que Dieu est la source de la vie, on ne connait qu’un aspect de la relation entre Dieu et l’homme. Le principe de haecceitas (signifiant individuation ou ceciité) de Scotus, définit la réciprocité comme une relation entre des
êtres distincts.2 Scotus attire l’attention sur le caractère sacré de chaque aspect cosmique. Dieu englobe tout et tous, y compris le naturel et l’imparfait.
INCARNATION
Scotus soutient que le Verbe se serait quand même incarné si Adam (les humains) n’avait pas péché.3 L’Incarnation est la décision de Dieu, libre et éternelle (en dehors de lui-même) d’avoir quelqu’un qui puisse l’aimer parfaitement. Ainsi comprise, l’Incarnation est un paradigme permettant aux êtres humains d’être partenaires de Dieu dans la co-création et la co-rédemption du monde.
Mary Elizabeth Ingham C.S.J. écrit que “le principe de réciprocité entre Dieu et l’humanité était prévu de toute éternité, commencé dans l’Incarnation, il sera pleinement réalisé lorsque le Christ sera “tout en tous”. L’apogée de la Création est la communion de tous avec Dieu... C’est dans le Christ que l’humain et le divin parviennent à cet état de réciprocité.” 4
www.magdalacolloquy.org 9
Avec l’Incarnation, les humains sont mis à l’épreuve et habilités à jouer un rôle semblable à celui du Christ dans le cosmos. Habiliter à aimer Dieu et le cosmos dans son ensemble qui est l’expression même de Dieu. Parce que le cosmos ressemble au Christ, “Premier-né de toute la création” (cf. Col 1, 15-19), nous devons chérir la création comme nous vénérons le Christ.
LA RÉCIPROCITÉ COMME NORME CORRECTIVE ET COMPLÉMENTAIRE
“L’urgence climatique” d’aujourd’hui pose la question des relations humaines et de la survie, qui sont en fin de compte des questions de pouvoir. Les féministes ont déjà admis que la parité était moralement normative. Elles font la distinction entre le “pouvoir-sur,” le fait d’être sous emprise, et le “pouvoir-avec,” la relation mutuellement partagée. La théologienne américaine et féministe Carter Heyward écrit qu’utiliser le pouvoir-avec est bon, utiliser le pouvoir-sur est mauvais.”5
Dans la tradition morale catholique romaine (dans le Thomisme), les relations de pouvoir sont comprises dans un cadre déontologique de normes d’amour et de justice. En effet, dans l’ensemble des Écritures, l’amour et la justice sont considérés comme les données d’un même plan. Comme l’explique le théologien et déontologue Daniel C. Maquire, “Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez à proportion de la fidélité” (Osée 10:12). La dichotomie entre l’amour et la justice est fallacieuse. Les deux sont naturellement liés. La justice précède l’amour, en insistant sur les conditions minimales de survie. Elle fait ensuite cause commune avec l’amour en découvrant que survivre sans s’épanouir n’est pas survivre du tout.”6
C’est précisément en examinant la
signification du mot “épanouissement” qu’apparaît la nécessité de faire de la parité la norme formelle. La réciprocité est “le partage du pouvoir- avec, par et avec toutes les parties impliquées, dans une relation intègre et unique qui engage chacun, en vue de l’épanouissement de tous.” En général, la réciprocité fonctionne comme une norme corrective pour l’amour ou la justice, limitant la dynamique au “pouvoir-avec.” Grâce à la réciprocité la “justice” se limite à tout ce qui peut constituer l’épanouissement holistique, et fait passer l’amour au-dessus des petits sacrifices dans un échange mutuel et convenu.
La réciprocité caractérise la vie de la Trinité. Elle définit les relations de Jésus au cours de son ministère terrestre et le règne de Dieu. Elle est profondément enracinée dans la tradition franciscaine, dans l’origine christocentrique de la création et la primauté du Christ. Elle place les humains en continuelle relation avec Dieu et tout le cosmos, mettant en place la dynamique du “pouvoir-avec.”
RÉCIPROCITÉ ET COSMOS
Comme l’amour et la justice, il existe de nombreuses manifestations de réciprocité dans différents domaines, qu’il s’agisse du genre, du social ou du cosmique. La réciprocité cosmique c’est la relation entre Dieu et l’ensemble de sa Création. Pareillement les humains sont liés au cosmos en vertu de leur relation avec Dieu. La réciprocité cosmique c’est le partage du “pouvoir-avec,” par et entre le Créateur, les êtres humains et l’ensemble du cosmos, dans l’interdépendance et le respect de tous.”7 Les sciences, par exemple l’astrophysique, l’écologie et la physique quantique, attestent de l’interdépendance du cosmos et trouve écho dans l’affirmation des féministes “Nos corps, Nous-mêmes”. Elles mettent en avant
www.magdalacolloquy.org
10
la beauté et la valeur de l’être humain, en particulier les femmes, en tant qu’êtres physiques. Le charisme franciscain soutient le panenthéisme orthodoxe. “Dieu dans le monde et le monde en Dieu”. Si nous reconnaissons la parenté de la Création, alors nous devons étendre le commandement de “l’amour du prochain” à toute la Création.
La Création est bonne et s’épanouit en des relations d’échanges mutuels. L’Incarnation est la racine de ces échanges au sein du cosmos tout entier. La notion de haecceitas (individuation ou ceci-ité) de Scotus, ne définit pas seulement l’individualité, elle souligne comment chaque détail de toute chose n’est connu que de Dieu seul. Renforcée par l’Incarnation, l’individuation est le lieu où tous sont unis à Dieu et dans Celui qui accomplit tout selon la décision de sa volonté (cf. Eph. 1,11).
La réciprocité cosmique est vitale pour l’écologie en cette période “d’urgence climatique”. En tant qu’agents moraux, les êtres humains doivent traiter concrètement avec l’ensemble de la Création, non seulement les humains, mais aussi la planète, la vie végétale, la vie animale, la flore et la faune, etc. Cela nécessite d’exercer la dynamique du “pouvoir-avec” avec tous les acteurs impliqués. La réciprocité cosmique nous incite à agir pour l’épanouissement de toute la Création. Il faut tenir compte des conséquences historiques de nos actions. En bref, elle exige de l’honnêteté et de l’intégrité pour le bien de toute la Création de Dieu.
Nous ne pouvons plus nous considérer comme les seuls détenteurs du “pouvoir-sur” les autres. Nous devons plutôt adopter une position de réciprocité cosmique, “le partage du pouvoir, entre le Créateur, les êtres humains et l’ensemble du cosmos, dans l’interdépendance et le respect de tous.”8
Bibliographie
1 Armond A. Mauer, Medieval Philosophy, The Etienne Gilson Series 4, Second Edition, (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1982), 223-24.
2 Mary Elizabeth Ingham, “Integrated Vision,” in The History of Franciscan Theology, ed. Kenan B. Osborn, (St. Bonaventure, NY: The Franciscan Institute, 1994), 210.
3 Robert North, The Scotist Cosmic Christ,” in De Doctrina Ioannis Duns Scoti, vol. III, 194-198.
4 Ingham, “Integrated Vision,” 222.
5 Voir Nothwehr, Mutuality, 33-95.
6 Daniel C. Maguire, “The Primacy of Justice in Moral Theology,” Horizons 10 (1983): 77.
7 Ibid.
8 Ibid.

www.magdalacolloquy.org
11
La Réciprocité Intérieure Un Chemin vers l’Amour Sacré
Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey est rédactrice en chef de la revue D’un Commun Accord. Pour en savoir plus sur son parcours, veuillez consulter notre site Web
“Le désir d’une âme bonne est de servir fidèlement, d’imiter pieusement—et aimer vraiment— Notre Seigneur.”
(Béatrice de Nazareth)
Dans la tradition de l’Église, nous comptons de nombreux exemples au féminin de réciprocité intérieure issus de la vie mystique. Certaines mystiques ont laissé une inestimable documentation relatant leurs expériences de purification, d’illumination et d’union avec le Christ. La plus célèbre étant sans aucun doute Le Château intérieur de Thérèse d’Avila.
Trois cents ans avant Thérèse, la Cistercienne flamande Béatrice de Nazareth (1200-1268) écrit Les sept voies (ou étapes) de l’amour saint, l’une des premières œuvres en prose mystique de l’Église et l’une des premières œuvres enregistrées en langue vernaculaire néerlandaise. Ce que nous savons de Béatrice provient d’une biographie latine, Vita Beatricis, écrite après sa mort par un ecclésiastique Cistercien anonyme. Il y rassemble des informations provenant des propres écrits de Béatrice et ceux d’une de ses sœurs vivant aussi au même monastère.
Béatrice est née à Tirlemont (dans l’actuelle Belgique), la sixième et la plus jeune enfant d’un couple de parents pieux. À la mort de
sa mère, Béatrice qui n’a que sept ans est confiée par son père à des béguines dans une ville voisine, pour qu’elle “progresse dans les vertus.” Au bout d’un an, désireuse d’entrer dans la vie vie monastique, Béatrice devient oblate chez les Cisterciennes voisines, où son père occupe le poste de directeur général. À quinze ans, elle entre en noviciat, puis prononce ses voeux. Son père, deux de ses frères et deux de ses sœurs se joignent à la communauté en tant que membres laïcs.
Béatrice se lie d’amitié avec une religieuse plus âgée, Ida de Nivelles, qui découvre ses dons. Outre son habileté à recopier les manuscrits, Béatrice, bien que physiquement peu robuste, fait preuve d’une grande sagesse spirituelle. Dans une biographie ultérieure, on peut lire qu’Ida recommande à Béatrice de “vider soigneusement son cœur de tout ce qui est superflu, pour le rendre apte à accueillir la grâce divine.” 1
Son cheminement intérieur passe par de nombreux détours, mais elle finit par consigner ses progrès dans le recueil Les sept étapes de l’amour saint, “qui viennent d’en haut et retournent vers Le plus haut.”
LES ÉTAPES DE L’AMOUR SAINT
La première étape, nommée par Béatrice “l’amour organisé,” exige un examen de conscience: “Le cœur n’a de cesse de questionner, implorer, apprendre, attirer à lui et retenir tout ce qui peut aider l’âme à atteindre l’amour. La deuxième étape exige de vivre sans limites ni structures. Béatrice se trouve dans une sorte de disposition organique dépourvue de tout ego, de projets, d’idées préconçues, de plans. Elle se contente
www.magdalacolloquy.org
12
de servir humblement le Seigneur, sans attendre de récompense telle la grâce ou la gloire, juste accepter de faire le “bon plaisir” du Divin. Cela nous mène à la troisième étape, celle où l’amour est mis à l’épreuve, où l’âme manque de consolation intérieure et de paix, la vie devient un combat. Béatrice écrit: “C’est une grande douleur, l’âme désire ce qu’elle ne peut obtenir.” Après cette expérience solitaire, arrive la quatrième étape, celle qui libère de multiples grâces sans qu’elles aient été demandées. Béatrice ressent “une grande proximité avec Dieu,” “une étreinte intense” venant de Dieu. Son cœur se dilate et elle reçoit de nombreuses visions.
De cette expérience de ravissement et d’union, Béatrice est conduite vers la cinquième étape, celle où le désespoir et le ravissement co-existent et agissent ensemble. Ceci cause beaucoup d’agitation et “une profonde insatisfaction.” Elle se rend compte qu’elle est appelée à aimer Dieu de tout son esprit, de tout son cœur et de toute son âme, même si elle n’est pas en mesure de le faire en raison d’une maladie. Elle considère sa faiblesse comme une purgation corporelle qui aide son âme à être purifiée “et lavée intérieurement.”
“Car la chose même qui la torture et lui procure la plus grande des souffrances la rend une et entière, et ce qui la blesse au plus profond est la source même de son plus grand soulagement.”
Transformée par Dieu à travers la souffrance, Béatrice se réfère à la “Divine Sévérité” qui l’a purgée non seulement des afflictions terrestres et des obstacles de la chair, mais aussi de fautes futures. Elle entre maintenant dans la sixième étape de l’amour saint, la “connaissance supérieure,” où elle découvre la puissance divine, un
état de pureté limpide, une douceur spirituelle, une liberté inespérée et la suave égalité avec Dieu.” Béatrice réalise que cet état est “le commencement et le fondement de la vie éternelle.”

Même si la sixième étape semble être la dernière, une septième, “l’état le plus élevé que l’on puisse atteindre,” écrit Béatrice, est celle de l’espoir, sans aucun doute. L’espérance absorbe l’âme dans un amour perpétuel “dans la douce compagnie des esprits les plus élevés.” Tout en désirant “jouir à jamais de la présence de Jésus,” Béatrice se sent comme prisonnière de ne pas encore être parvenue au lieu du repos avec Lui et, en même temps, d’avoir le sentiment de ne pas appartenir au monde. Elle se souvient de ne devoir pas oublier qu’elle vit en exil. Cet exil lui rappelle qu’elle doit vivre dans l’espérance malgré les difficultés de la vie, espérance qui lui permettra d’endurer ce qui doit l’être, afin de rejoindre son refuge et sa maison. Son corps est sur terre, mais tout son esprit est au ciel.
LES DERNIÈRES ANNÉES ET AU-DELÀ
Élue première prieure en 1236 d’un nouveau monastère Cistercien appelé Notre-Dame de Nazareth, à l’initiative de et construit par son père, Béatrice s’y installe avec deux de ses sœurs oblates, Christine et Sybil, quelques religieuses, son frère et son père. Béatrice y vit de nombreuses autres expériences spirituelles, notamment lorsqu’elle est témoin du feu de l’amour divin et le sent brûler dans son cœur. Elle y développe une vie de prière si intense que l’amour pouvait jaillir d’elle. Les visiteurs au
13
www.magdalacolloquy.org
monastère pouvaient être guéris ou consolés, de même que les animaux et les oiseaux à proximité.
Notre-Dame de Nazareth prospèra sous la direction de Béatrice pendant 32 ans. C’est à Noël 1267 qu’elle tombe malade, atteinte de ce qu’elle appelait “la fièvre de l’amour”, qui devait l’emporter vers sa demeure céleste sept mois plus tard. Elle est enterrée dans le déambulatoire du cloître, entre l’église et le chapitre de son monastère.

Le monastère continua à prospérer jusqu’en 1797, date à laquelle il ferma ses portes à la Révolution française. Il resta à l’abandon même après la Révolution belge de 1830 (lorsque la Belgique obtient son indépendance des Pays-Bas). Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’il ressuscite sur un nouveau site à Brecht. L’abbaye de Brecht porte également le nom d’origine de Notre-Dame de Nazareth et a été officiellement inaugurée le 25 juin 1950. C’est à ce jour une abbaye Cistercienne de moniales trappistines.
Bibliographie
1 Extrait de La vie de Béatrice de Nazareth, traduite et annotée par Roger De Ganck (Cistercian Publications, 1991) p. 63.
Citations de “Les sept étapes de l’amour saint” extraites d’une traduction en anglais d’une ancienne langue vernaculaire néerlandaise par Katrien Vander Straeten.
Ensemble, Non Seuls
John Dalla Costa

John Dalla Costa è est un auteur et théologien, spécialiste des questions éthiques et morales, il a rédigé cinq livres. Pour en savoir plus sur son parcours, veuillez consulter notre site web.
La réciprocité fait partie intégrante de la Création de Dieu. Dans la Genèse, les forces cosmiques du jour et de la lumière, la séparation terrestre de la terre et des océans, et la naissance d’une immense diversité de plantes et d’animaux, ont toutes et tous été considérés comme fondamentalement parfaits. Comme dans la vie, la bonté est une vertu relationnelle—quelque chose à voir, à chérir ou à partager, qui profite à la fois aux autres et à soi-même.
Cette réciprocité fondamentale s’explique
d’autant mieux lors de la création d’êtres humains conçus tels Adam et Ève afin de vivre en interdépendance. En effet, dans son infinie bonté, Dieu déclare explicitement qu’il n’est “pas bon” pour l’être humain une fois sur terre de rester seul.
Être privé de réciprocité, c’est amoindrir ou porter atteinte à notre humanité essentielle. De nombreuses études scientifiques démontrent que la solitude réduit l’espérance de vie ; elle vide le quotidien de son sens et du bonheur, elle finit même par emprisonner de nombreux adolescents dans le désespoir. Ces données sont peutêtre utiles, mais une question pressante se pose : pourquoi avons-nous besoin d’études aussi importantes pour nous rappeler que nous avons besoin les uns des autres? Sommes-nous aujourd’hui si éloignés des réalités du cœur pour avoir besoin de
www.magdalacolloquy.org
14
preuves statistiques accablantes, pour ne serait-ce qu’envisager la vérité humaine la plus élémentaire : aucun d’entre nous n’est créé seul et aucun d’entre nous ne peut survivre ou s’épanouir sans l’échange mutuel d’amour et d’attention à l’autre ?
LA CAUSE PROFONDE
La solitude est une maladie, mais sa cause profonde c’est l’égoïsme. Ceux d’entre nous qui travaillent dans le monde des affaires constatent une dégradation de la morale et de la responsabilité individuelle, engendrée par la pression économique à maximiser les profits. “L’intérêt personnel” défendu par le premier économiste, Adam Smith, s’est transformé en “intérêt égoïste,” au point que même la cupidité est considérée comme une vertu. L’incapacité des nations et des entreprises à faire face à la menace existentielle du changement climatique repose sur cette mutation. “L’intérêt personnel,” tel que le concevait Smith, impliquait des “principes moraux” d’obligations envers les autres, tandis que “l’intérêt égoïste,” comme on ne le constate que trop bien aujourd’hui, est indifférent à tout ce qui n’est pas gratifiant pour l’ego.
L’égoïsme extrême de notre économie, dont les statistiques sur les inégalités sont les plus évidentes, a contaminé la politique et la culture. Le populisme furieux qui agite les nations, la haine dangereuse, le racisme et la misogynie qui font irruption dans les médias sociaux, témoignent des blessures infligées par l’égoïsme, ce qui engendre encore plus d’égoïsme agressif. Cette idolâtrie du moi, alors que la technologie met entre nos mains tant de pouvoir, nous conduit à défaire la Genèse, à détruire la bonne terre, à faire disparaître la riche diversité créée par Dieu et à profaner, voire détruire, l’humanité créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. À bien des égards, notre conscience est aujourd’hui déformée par l’égoïsme qui anime notre économie. La plupart des gens
reconnaissent les catastrophes écologiques et sociales en cours, mais la plupart d’entre eux insistent pour que les remèdes ne viennent pas impacter leur confort et le prix des choses.
Malheureusement, l’égoïsme extrême qui sévit dans la société mondiale est également répandu dans l’Église. Bien sûr, à chaque époque, le corps du Christ a été confronté à des désaccords virulents et trop souvent violents. En tant qu’êtres humains limités face au Dieu infini, notre meilleure compréhension restera toujours incomplète et sujette aux différences. Cependant, à l’heure actuelle, trop de chrétiens se sont approprié l’étroitesse de l’intérêt personnel qui domine, pour l’appliquer à l’Église. Au lieu d’offrir et de modeler la réconciliation et l’unité, nous dénigrons et nous nous opposons avec véhémence à ceux qui ne sont pas d’accord avec nous.
D’où la nécessité et l’urgence de retrouver le principe de réciprocité. En Jésus, par la réalité même de son incarnation en tant que vrai Dieu et vrai Homme, nous est transmise la bénédiction salvatrice d’une relation de réciprocité. La croix est une étreinte. En s’offrant à nous, Jésus nous replace dans l’unique échange qui puisse vraiment satisfaire notre désir profond, la seule relation d’échange qui nous ramène à la plénitude. Durant son ministère, Jésus a

paradoxalement tendu la main aux égoïstes, comme le collecteur d’impôts Lévi, et à ceux
15
www.magdalacolloquy.org
que la société égoïste considère comme moins que rien, telle la femme adultère. Il a reconnu la nécessité de la charité au-delà de la distorsion du péché, Il les a appelés à vivre pleinement Sa grâce et vivre le principe de réciprocité. Les aveugles à qui Il a rendu la vue, les boiteux qu’Il a guéris, les lépreux qu’Il a purifiés, tous ont été bénis et guéris physiquement, mais encore plus, ils ont reçu une guérison impliquant un échange potentiel de réciprocité.
RÉCIPROCITÉ ET LA COMMUNAUTÉ
En tant que “corps mystique du Christ,” il nous incombe désormais de lutter contre l’égoïsme, en nous-mêmes, dans nos communautés et dans notre culture, avec la même compassion et le même amour que Jésus. Jésus nous a donné la formule de la réciprocité aimante. Pardonner, pardonner et pardonner sans cesse. Marcher avec les autres au-delà de ce dont ils ont besoin ou de ce qu’ils demandent. Reconnaître la bonté de Dieu digne de notre amour même chez nos ennemis, ceux qui nous haïssent et nous méprisent. Être le Bon Samaritain, panser les plaies des étrangers. Même devenir Simon de Cyrène, en sortant de notre intérêt personnel pour nous transformer en porteurs indispensables de la Croix du Christ.
La réciprocité avec les amis est assez facile, car la base et les avantages sont clairs. Notre défi le plus ardu est d’étendre la réciprocité à des situations où une telle générosité peut être ridiculisée ou considérée comme allant de soi. Heureusement, Jésus nous a légué les sacrements et le Saint-Esprit pour nous redonner le courage de risquer la réciprocité.
Lors de l’Eucharistie, nous ingérons le don de soi du Christ vivant, ne mettant pas simplement en œuvre la réciprocité, mais métabolisant l’habitation de Dieu. De cette réciprocité sacramentelle, chacun de nous devient un tout plus grand que la somme des parties individuelles. Ainsi, notre vie
de relations mutuelles dans l’amour de Dieu fait naître d’autres relations mutuelles d’échanges dans notre communauté.
Les problèmes de notre monde sont tels que nous avons un immense besoin d’échanges relationnels. Nous ne pouvons pas assumer cette tâche sans la grâce de Dieu. Tous travaux pratiques vers le principe de réciprocité doivent donc s’accompagner d’une relation d’échanges par la prière. Pour cela, nous pouvons nous inspirer de la communauté ecclésiale encore en formation dans les Actes des Apôtres : “tous ceux-là, d’un commun accord, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères” (1,14).
Pensez aux différences chez les apôtres : pêcheurs et collecteurs d’impôts, sceptiques et croyants, frères recherchant les meilleures places au royaume de Dieu. Pensez aux différences chez les disciples, ceux qui ont fui Jésus au jardin de Gethsémani, aux femmes qui ont gravi le Calvaire avec Lui puis ont été témoins du Golgotha. Pensez à la peur du groupe tremblant au Cénacle, et aux “cœurs enflammés” de ceux devant le Ressuscité. Malgré leurs faiblesses et leurs différences, malgré leurs préjugés, tous ont choisi avant même la Pentecôte et l’effusion de l’Esprit Saint, de prier ensemble, de prier dans la réciprocité, prier d’un “commun accord” pour confier leur régénération au Christ que tous aimaient et qu’ils ont incarné ensemble.
“Il faut d’abord aimer, ce qui se traduit par des expériences concrètes, et ensuite partager ses expériences. C’est ainsi qu’ont agi les premiers Chrétiens.”
Chiara Lubich (Dans un discours “L’amour mutuel est notre uniforme”).
www.magdalacolloquy.org
16

Maria Rita Cerimele fait partie de l’Œuvre de Marie (mieux connue sous le nom de Mouvement des Focolari, www.focolare.org). Elle a occupé de nombreux postes au niveau national et international au sein des Focolari en Italie. Elle a enseigné le latin et le grec dans les lycées publics. Elle a écrit plusieurs articles en lien avec sa spécialisation en philologie classique,sur son expérience d’enseignante et sur l’actualité ; articles principalement publiés dans Città Nuova online et sur le site web AngeliPress dont elle est rédactrice. Membre du comité international de la Journée mondiale de réflexion et de prière contre la traite des êtres humains, elle collabore à la planification de “I Dialoghi a Spoleto” (Dialogue à Spoleto). Redactrice pour “Futuro Anteriore, alla ricerca di nuovi paradigmi” (Futur Antérieur : à la recherche de nouveaux paradigmes, avril 2021 Francesco D’Amato editore). Son dernier livre s’intitule “Governance=Amore” sur la vie et l’œuvre de la Focolarina Ginetta Trotter (Edizioni Insieme, 2022).
Gouvernance et Amour : La Réciprocité dans le Leadership Féminin
Maria Rita Cerimele
J’ai récemment publié un livre (en italien) sur une femme peu connue, même en Italie. Elle s’appelle Ginetta Trotter. Elle est née à Canal San Bovo (province de Trente) le 17 juin 1924. J’ai choisi d’écrire sur elle, car étant moi-même une focolarina (membre des Focolari), j’ai découvert comment Ginetta a rendu possible “l’extraordinaire” dans le tissu ordinaire de la vie, puis a rendu l’expérience possible pour d’autres. Sa vie, son exemple et sa mémoire méritent certainement d’être mieux connus, aujourd’hui surtout alors que la négativité et les conflits conduisent à la guerre, que la paix et les relations d’amour se fragilisent toujours plus.

Ginetta a 23 ans lorsqu’elle rencontre la jeune Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari. C’était la dernière année de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Trente avait été détruite par les bombardements. Chiara Lubich avec quelques amis se voient contraints de s’occuper des autres et partager avec ceux dans le besoin. Ginetta se souvient de sa rencontre avec Chiara Lubich comme d’une rencontre “inattendue mais révolutionnaire,” une lumière peu commune qui envahit tout son être. Ce que Ginetta va garder en son cœur et en son esprit, c’est l’idée que seul l’amour compte dans la vie. “Les événements que nous vivions,” raconte-t-elle “la tristesse continuelle qui nous étreignait, la présence de la guerre et de la mort, tout ceci nous avait ôté la capacité d’aimer et même le besoin conscient d’accepter d’être aimé.” C’est alors qu’elle prend conscience de cette vérité—l’Amour est le sens de l’existence et l’enseignement de Jésus—Ginetta pleure pour la première fois depuis des années, des larmes de joie sur cette rencontre avec Dieu. Ainsi part-elle sur un nouveau chemin, celui de la fidélité profonde et joyeuse à ce Dieu redécouvert comme étantAmour. Elle s’y consacre donc et tisse avec Lui une relation de plus en plus solide et vitale. Un Dieu qui est Amour ne peut être servi que par l’amour de tous ses enfants, de tous nos frères et sœurs. C’est ce que Ginetta a fait.
www.magdalacolloquy.org
17
Pendant de nombreuses années, Ginetta a occupé des postes à responsabilité au sein du mouvement des Focolari. Timide de caractère et de par son éducation, Ginetta évite d’attirer l’attention. Avec le temps, j’ai fini par reconnaître sa maturité au travers des caractéristiques propres au leadership féminin. Elle n’impose jamais sa propre vision des choses, mais prend le temps et l’espace nécessaires pour partager avec les autres. Ses actions parlent plus que ses mots. Chacun était accueilli et se trouvait aidé selon ses besoins, Ginetta se rendait toujours disponible dans les moments de douleur ou de joie, faisant preuve de tendresse à l’égard des personnes plus vulnérables. Elle était capable de toujours batîr une relations d’amour authentique et amicale, invariablement transformée en réciprocité.
FAIRE CONFIANCE À L’ESPRIT
L’écoute attentive était la composante essentielle dans la manière de diriger de Ginetta. Convaincue que l’Esprit Saint souffle où Il veut et parle à chacun, Ginetta n’hésite pas à réorienter ses programmes, à revenir sur des décisions déjà prises, acceptant de se laisser transformer par cette écoute attentive. Elle écoute tout le monde, même un petit garçon ou une petite fille. Grâce à cette posture attentive, les propos et suggestions de chacun étaient empreints de sérieux et d’honnêteté, ce qui était révélé devait être vrai, exprimé en paroles, en actions ou en silence. Ginetta indiquait la voie, mais pouvait guider l’autre à découvrir lui-même la direction à prendre.
Ginetta entretenait par la prière et par une confiance absolue, cette relation primordiale et irremplaçable nouée avec Jésus et Marie, la source de l’amour du prochain. Elle se référait constamment à l’Évangile, guidée par la demande de Jésus au Père “que tous soient un” (Jean 17, 21). Elle croyait fermement
au charisme d’unité des Focolari, cherchant toujours à le traduire dans sa vie, non seulement au travers de grands événements ou de rencontres, mais aussi dans les faits du quotidien. Elle était proche de toutes personnes d’âge ou de statut différents, de la femme au foyer comme du professeur d’université, de l’évêque orthodoxe à l’athée, en passant par le jeune amoureux ou le jeune en quête. Tous ont été aimés et appréciés pour leur belle personnalité.
Le calme de Ginetta lorsqu’elle proposait une idée contrastant avec celle d’un autre, sa ténacité à ne pas abandonner face à quoi que ce soit, à recommencer, à rester fidèle à la charité, tout ceci était le fruit de son engagement envers les paroles de Jésus: “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix” (Jean 14:27). Ces paroles ont modelé et instruit sa vie: une paix active, une paix devenue contagieuse.
Elle décéde le 19 septembre 2007 et est enterrée à Loppiano (province d’Arezzo).
À une époque où la relation à l’autre est si superficielle et sous l’influence des réseaux sociaux, à une époque où l’Église est blessée par de multiples abus de pouvoir et des défaillances dans le leadership, l’exemple de réciprocité proposé par Ginetta Trotter peut nous donner espoir et nous amener à redécouvrir la sagesse au cœur de l’Évangile, tandis que nous poursuivons notre voyage synodal.
www.magdalacolloquy.org
18

D’Un Commun Accord
O Dieu, notre créateur, Vous, qui nous avez faits et faites à votre image, donnez-nous la grâce de l’inclusion au cœur de Votre Église.
R : D’un commun accord, nous prions.
Jésus, notre Sauveur, Vous, qui avez reçu l’amour des femmes et des hommes, guérissez ce qui nous divise, et bénissez ce qui nous unit.
R : D’un commun accord, nous prions.
Esprit Saint, notre Consolateur, Vous, qui guidez ce travail, veillez sur nous qui espérons faire
Votre volonté pour le bien de tous.
R : D’un commun accord, nous prions.
Marie, mère de Dieu, priez pour nous.
Saint Joseph, restez près de nous.
Sagesse divine, éclairez-nous.
R : D’un commun accord, nous prions.
Amen.
19
www.magdalacolloquy.org
Vos commentaires et réactions sont les bienvenus et nous envisagerons de les partager dans les prochains numéros ou sur notre site web.
Veuillez envoyer vos commentaires à editor@magdalacolloquy.org
Si vous n’êtes pas encore abonné(e), vous pouvez le faire à tout moment et sans frais grâce au généreux soutien des Pères Basiliens de la Congrégation de Saint-Basile. Il suffit de visiter notre site web www.magdalacolloquy.org où vous pouvez également lire les anciens numéros de notre revue et être informé(e) de nos intentions et de nos activités.
La revue D’un commun accord est publiée en italien, en anglais et en français. Pour accéder aux autres versions linguistiques, veuillez visiter notre site web.
Images utilisées dans ce numéro :
Couverture: Détail d’un vitrail conçu par Elena Manganelli O.S.A. et réalisé par les sœurs augustines du monastère Saint-Antoine de Padoue à Pennabilli, en Italie.
Page 4 “Jésus et ses disciples” de Carl Wilhem Friedrich Oesterley (1825-1891).
Page 5 “Un’ostia e due candelabri d’argento in una nicchia di pietra” di Jan van Kessel (1626-1579).
Page 9 “Portrait de John Duns Scot” (école française).
Page 11 “Coucher de soleil en Toscane 2023,” photo de John Dalla Costa.
Page 13 Détail de “La Vierge et l’Enfant avec une religieuse cistercienne” de Joachim Patinir (vers 1480-1523).
Page 15 “La femme adultère” de Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666).
www.magdalacolloquy.org
20
Ce numéro
Copyright © 2024 Paroisse catholique de Saint-Basile, Toronto, Canada . Pour contacter la Rédactrice écrivez editor@magdalacolloquy.org
ISSN 2563-7932
ÉDITEUR
Morgan V. Rice CSB.
RÉDACTRICE EN CHEF
Lucinda M. Vardey
RÉDACTRICE ASSOCIÉE
Emily VanBerkum
ÉDITEUR CONTRIBUTEUR
Greg Rupik
COORDINATEUR DE LA PRODUCTION
Michael Pirri
CONSULTANT
John Dalla Costa
TRADUCTRICES
Véronique Viellerobe (Français)
Elena Buia Rutt (Italien)
ADMINISTRATICE
Margaret D’Elia
www.magdalacolloquy.org
21