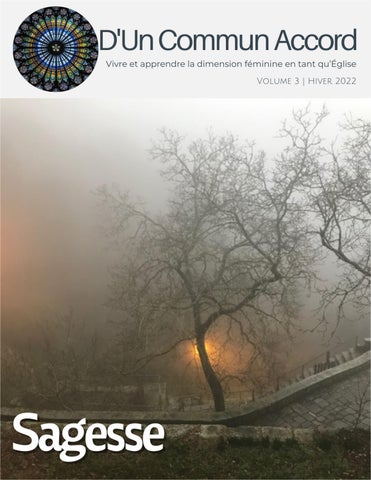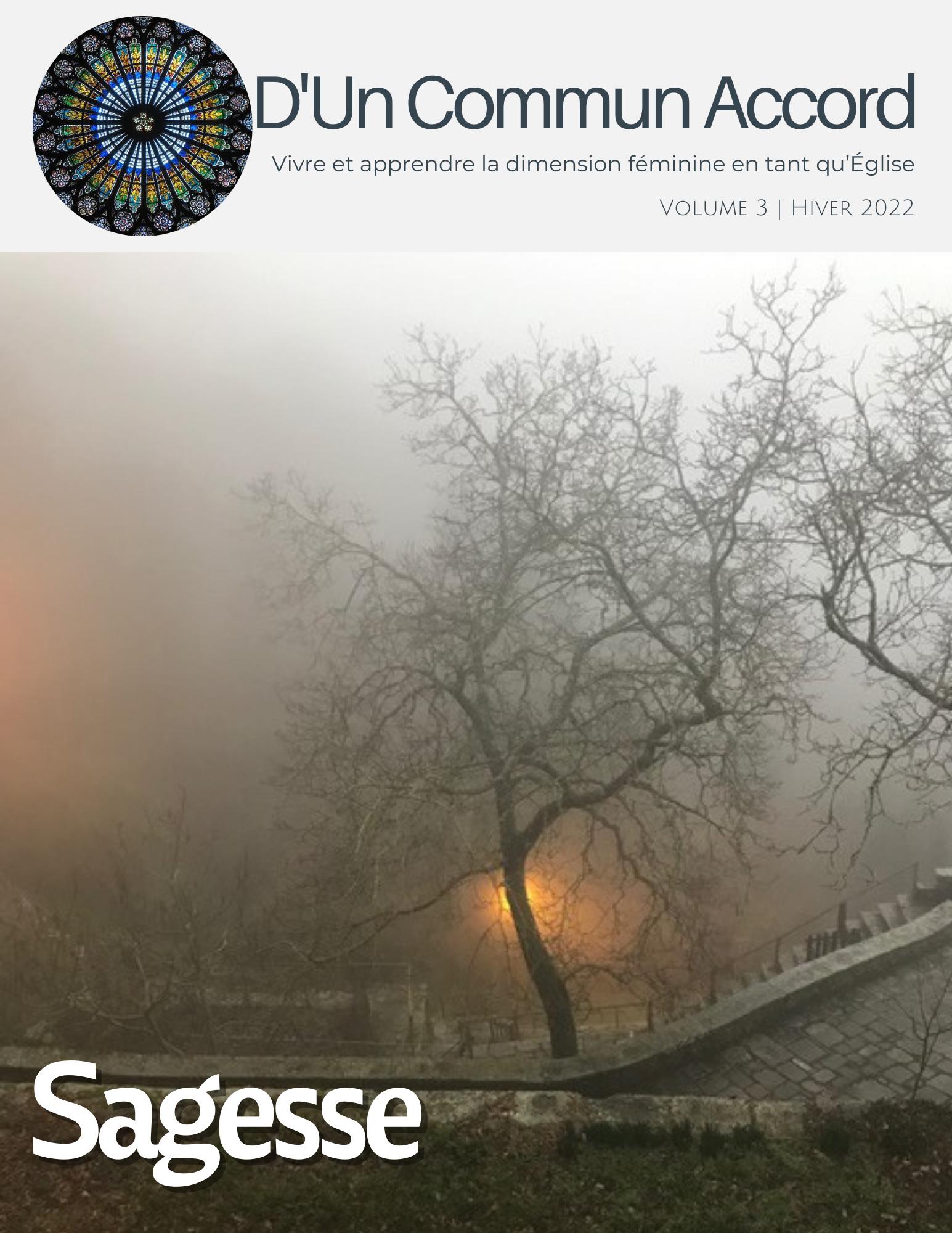
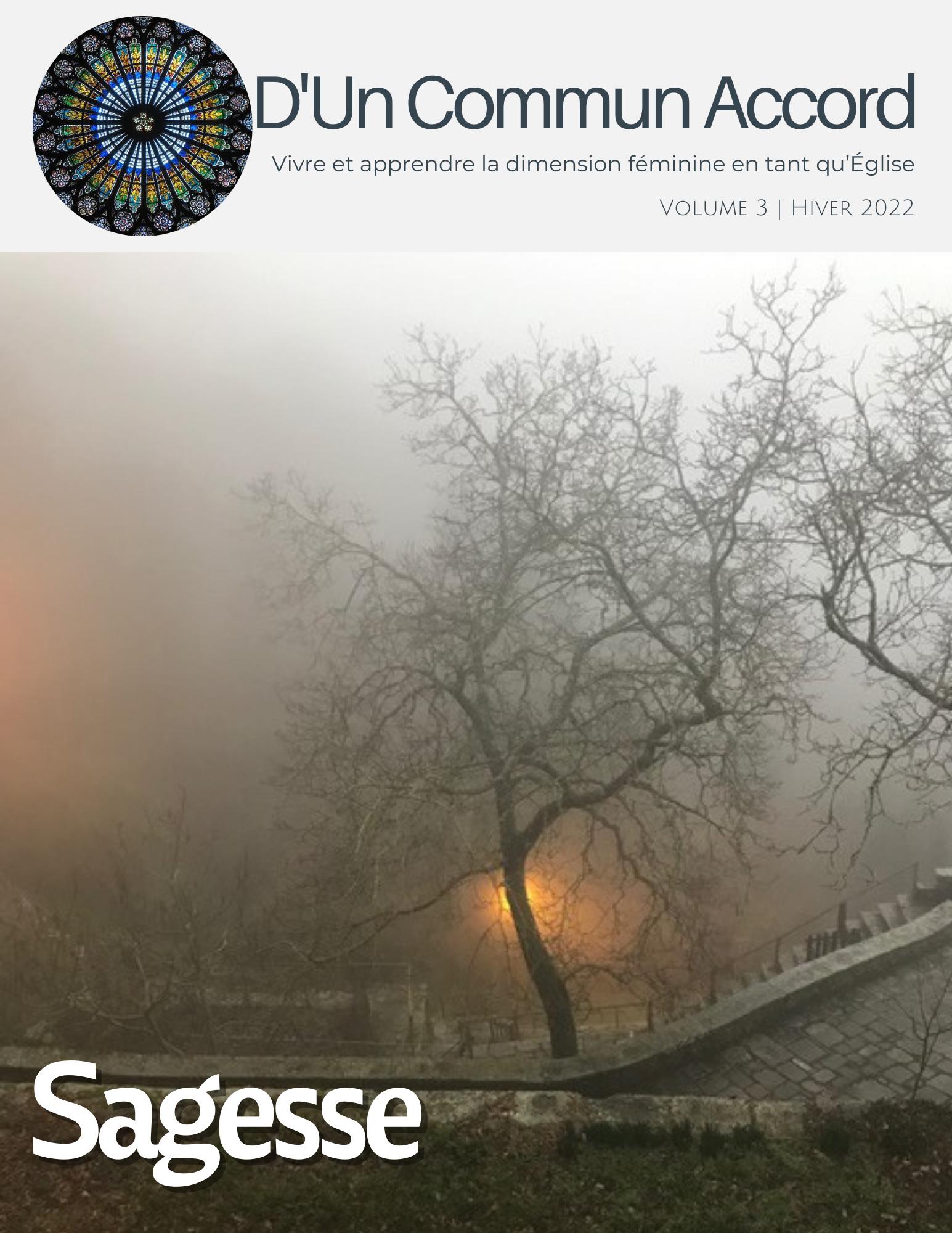
Sagesse
CONTENU
ÉDITORIAL
Lucinda M. Vardey
LA SAGESSE DANS LA BIBLE
William Irwin CSB
JÉSUS-SOPHIA
Elizabeth A. Johnson CSJ
QU’EST-CE QUE LA SOPHIOLOGIE ? Barbara Hallensleben
SOPHIA EN EXIL
L’Interview de Magdala : Greg Rupik et Michael Martin
LA SCIENCE DE SOPHIA : UN REFLET DE LA LUMIÈRE ÉTERNELLE Elinor Dickson
L’ÉVEIL : THOMAS MERTON ET SOPHIA Lucinda M. Vardey
www.magdalacolloquy.org
Éditorial
Les philosophes/théologiens russes Sergej Bulgakov, Pavel Florenskij et Paul Evdokimov ont été les rares à influencer grandement le développement des idées qui allaient composer les caractéristiques de l’étude de la sagesse que nous appelons sophiologie. Dans ce numéro, Barbara Hallensleben illustre comment nous reconnaissons et nous engageons dans la sophiologie aujourd’hui. Comme Michael Martin l’explique dans son livre, Sophia in exil , nous sommes principalement absents de ce qui est réel, que, assumant une vie d’utilité, nous perdons la capacité d’être enchantés par la beauté de la réalité de la sagesse. Notre exploration commence par les livres de la Sagesse de la Bible. William Irwin CSB nous donne un aperçu clair et complet de ces livres et de ce qu’ils révèlent. Elizabeth Johnson établit un lien entre une grande partie des figures de la sagesse bibliques et l’incarnation et la mission de Jésus. Michael Martin, dans l’interview de Magdala, partage comment le travail de la terre participe à une relation de sagesse et comment les arts, en particulier la poésie, sont une forme dans laquelle Sophia prend vie. Elinor Dickson, qui avait collaboré avec la jungienne Marion Woodman sur la présence de Sophia à notre époque, propose la physique comme moyen de comprendre. Durant les dernières années de la vie de Thomas Merton, il s’est aventuré plus avant dans l’étude de Sophia, non seulement à partir de la lecture des Russes, mais aussi à partir de ses propres intuitions contemplatives et de ses expériences ultérieures, qui renforcent l’intuition de Barbara Hallensleben selon laquelle nous pouvons choisir l’amour et les influences de Dieu plutôt que les influences du pouvoir et de la persuasion du monde.”La vérité est une intuition qui est prouvable” a écrit Florenskij.
Sergej Bulgakov a affirmé que Sophia est révélée dans le principe organique. Sans entrer dans le détail de ce qu’il a compris de ce principe, les articles de ce numéro forment des fils conducteurs qui tissent une manière organique de s’engager dans la sagesse. Les Évangiles nous révèlent comment Jésus enseignait l’organique ; ses mouvements et ses actions étaient dictés par l’Esprit, il savait où il devait aller et ce qu’il devait faire. “Viens à ma suite” est une méthode organique du moment, de l’ordre naturel de la volonté de Dieu, dépourvue de plans, de désirs, d’activités sociales ou d’obligations familiales imposées par soi-même. Une fluidité, un flux, une flexibilité en accord avec les éléments naturels, les saisons, le “souffle” même de l’Esprit. Un ralentissement, un retour à la simplicité, une prise de conscience de ce qui nous entoure. Faire une chose à la fois avec cœur, en lui donnant du sens—même les choses dites insignifiantes peuvent devenir précieuses. Être réceptif, ouvert à la grâce de Dieu sans aucun effort de notre part est une leçon du “lys dans le champ.” Une autre est d’être conscient de son état intérieur et de la vérité qui y naît. La diariste néerlandaise Etty Hillesum a senti “un processus organique” à l’œuvre en elle, “quelque www.magdalacolloquy.org

chose en moi grandit et chaque fois que je regarde à l’intérieur, quelque chose de frais est apparu, et tout ce que j’ai à faire est de l’accepter, de le prendre sur moi, de le porter en avant et de le laisser s’épanouir.”
“Pour être pleinement nous-mêmes,” écrit le scientifique jésuite Pierre Theilhard de Chardin dans son livre Sur le bonheur “nous devons donc travailler toute notre vie durant à nous organiser, c’est-à-dire à porter toujours plus d’ordre, plus d’unité dans nos idées, nos sentiments, notre conduite.”
(La réalité submergée)William Irwin CSB est un prêtre Basilien, originaire de Houston, Texas, et résident du Canada. Il a étudié à Rome et à Jérusalem, se spécialisant dans la Loi, les Prophètes et les Écrits, et quelques livres conservés en grec que les chrétiens appellent l’Ancien Testament. Pendant plus de quarante ans, il a enseigné les études bibliques à l’Université de St. Michael’s College et à la Toronto School of Theology.
La sagesse dans la Bible
William Irwin CSB
Le mot sagesse en hébreu (hokmah) et en grec (sophia) est de genre féminin. La Sagesse est une “elle” comme le sont beaucoup d’abstractions dans ces langues. Mais le genre grammatical est une métaphore latente et a produit plusieurs portraits remarquables de la Sagesse, la femme céleste qui est la fille aînée de Dieu.
Bien que la sagesse soit de genre féminin en hébreu, elle est généralement incarnée par des hommes et des femmes. Salomon, par exemple, est le monarque le plus sage qui ait jamais existé. Il restait au livre des Proverbes à dépeindre la Sagesse comme un être céleste. Il est dit que c’est un recueil des sages paroles de Salomon, deux recueils pour être précis, avec d’autres recueils plus petits des sages paroles d’autres sages. Bien qu’il prenne la forme de parents enseignant à leurs enfants, il se concentre sur leur vie d’adultes. Dieu est l’autorité derrière l’enseignement des parents et la sagesse de Dieu. Vous entendez la voix de la Sagesse dès le début :-
La Sagesse crie par les rues, sur les places elle élève la voix. À l’angle des carrefours elle appelle, près des portes, dans la ville, elle prononce son discours : “Jusques à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie ? et les railleurs se plairont-ils à la raillerie? et les sots haïront-ils le savoir?” (Pr 1, 20-22).
www.magdalacolloquy.org
Lucinda M. Vardey Éditrice en chef
“Sophia unit Dieu au monde comme le seul principe commun, le fondement divin de l’existence des créatures.”
Michael Martin
Elle ressemble à un prédicateur de rue ou à une maîtresse d’école de l’Ouest d’antan sonnant la cloche de son école. Elle appelle les niais, les railleurs et les sots et leur demande d’abandonner leurs habitudes et d’apprendre la sagesse. Son discours se poursuit jusqu’à la fin du premier chapitre. Il s’agit principalement d’un avertissement sur ce qui leur arrivera s’ils n’ont pas la sagesse à leurs côtés. Dans les neuf premiers chapitres des Proverbes, il est parfois difficile de dire si la voix du maître que nous entendons est celle des parents ou de la Sagesse elle-même. Ces voix portent cependant le même message.
L’ORIGINE DE LA SAGESSE À LA CRÉATION
Dans le chapitre 3, le livre des Proverbes présente une déclaration traditionnelle : “Yahvé, par la sagesse, a fondé la terre, il a établi les cieux par l’intelligence. Par sa science furent creusés les abîmes, et les nues distillent la rosée” (Prov 3, 19-20).
Mais dans les Proverbes 8, 22-31, cette affirmation traditionnelle prend tout son sens lorsque la Sagesse dit :
“Yahvé m’a créée, prémices de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l’éternité je fus établie, dès le principe, avant l’origine de la terre. Quand les abîmes n’étaient pas, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfantée; avant qu’il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde. Quand il affermit les cieux, j’étais là, quand il traça un cercle à la surface de l’abîme, quand il condensa les nuées d’en haut, quand se gonflèrent les sources de l’abîme quand il assigna son terme à la mer, - et les eaux n’en franchiront pas le bord - quand il traça les fondements de la terre, j’étais à ses côtés comme le maître d’œuvre, je faisais ses délices, jour après jour, m’ébattant tout le temps en sa présence, m’ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes.”
C’est l’accent mis sur le caractère ludique de la Sagesse qui est frappant; cf. Ps 104, 26, “Léviathan que tu formas pour t’en rire”. Elle était le premier-né de Dieu, elle a trouvé le monde que Dieu a fait un délice en tout point mais surtout dans la race humaine. C’était comme si elle regardait ravie, alors que Dieu lui construisait une maison de poupée et que ce qui lui plaisait le plus était de jouer avec la race humaine. Son attitude à leur égard était donc celle d’un enfant pour ses jouets préférés. Nous parlons du jeu de la raison ou du jeu de la pensée et nous l’imaginons comme un concept très grec, mais on le trouve aussi dans les psaumes. Le psaume 19 dit:-
“Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce; le jour au jour en publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix
qu’on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu’aux limites du monde” (Ps 19, 1-4).
La sagesse peut enseigner parce qu’elle a une connaissance de première main de tout ce qui est créé. C’était l’argument de Dieu contre la plainte de Job. “Où étais-tu quand je fondai la terre?” (Jb 38,4).
LA MAISON DE LA SAGESSE ET LA MAISON DE LA FOLIE
Construire une maison était très important dans la Bible—pas seulement comme résidence mais comme famille. Proverbes 14,1 dit : “La Sagesse bâtit sa maison, de sa main, la Folie la renverse.” Proverbes 31 montre en détail comment la “maîtresse femme” construit sa maison. Elle la construit avec sept colonnes selon Proverbes 9.1 Et elle invite les simples et les crédules, c’est-à-dire ceux qui ne la connaissent pas encore mais sont prêts à apprendre, à y dîner. Elle sait que les moqueurs et les insensés rejetteront tout simplement son invitation. Son banquet est un banquet qui mène à la vie. Pour comprendre cette variation sur la métaphore, nous devons réaliser qu’elle n’est qu’une partie d’une métaphore de deux maisons. La Sagesse a une rivale, la Folie. Plus tôt dans les Proverbes, elle n’est pas une abstraction. Il s’agit simplement de la “femme étrangère”, soit la non-Israélite contre laquelle la loi avait mis en garde et qui avait contribué à la chute de Salomon, soit la “femme étrangère”, la femme vivant seule sans famille connue, soit la femme séparée de son mari et le trompant. Les Proverbes 1 à 9 mettent en garde contre deux tentations majeures pour le jeune adulte : une vie de crime et une vie de débauche.
LE SIRACIDE : LA SAGESSE À LA CRÉATION
Le livre du Siracide a été écrit vers 175 avant J.-C., soit environ trois ou quatre siècles après la fin des Proverbes. Le Siracide 24 s’appuiera sur la description que fait le Proverbe 8 du rôle de la femme Sagesse dans la création. “Avant les siècles, dès le commencement il m’a créée, éternellement je subsisterai” (Si 24, 9). Mais le Siracide ajoute quelque chose. Selon les Proverbes, le plaisir de la Sagesse était d’être avec les hommes et selon le Siracide :

“Dans les flots de la mer, sur toute la terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j’ai régné. Parmi eux tous j’ai cherché le repos, j’ai cherché en quel patrimoine m’installer. Alors le créateur de l’univers m’a donné un ordre, celui qui m’a créée m’a fait dresser ma tente. Il m’a dit : “Installe-toi en Jacob, entre dans l’héritage d’Israël” (Si 24, 6-8).
1 La pensée ultérieure, notamment la pensée islamiste, cherche à nommer les sept principes sur lesquels repose la sagesse. La Bible ne l’explique pas. Certains ont pensé que cela faisait référence à la façon dont les Proverbes ou les Proverbes 1-9 sont construits.
www.magdalacolloquy.org

La sagesse a élu domicile en Israël. Le Siracide donne des exemples de ce qu’il veut dire. Le livre de la Loi est une incarnation de la sagesse. Le scribe qui consacre sa vie à l’étude de cette Loi et à la recherche de la sagesse, qui enseigne et loue Dieu, est inspiré par la sagesse. Enfin, c’est tout le peuple saint de l’histoire d’Israël, avec comme point culminant le grand prêtre Simon, qui, d’une manière ou d’une autre, est enfant de la sagesse. En parlant des incarnations de la sagesse, Siracide s’inscrit dans la tradition biblique qui voyait en Salomon l’incarnation du souverain sage. Aux yeux de Siracide, la sagesse devient presque comme une muse grecque.
LA SAGESSE COMME AMANTE
Une autre caractéristique de l’utilisation de la personnification de la Sagesse en tant que femme dans le livre du Siracide est d’introduire une certaine intimité dans la relation des individus à Dieu. L’auteur la décrit comme une femme courtisée par ses prétendants. Cela lui permet aussi d’expliquer les épreuves de la vie d’une manière personnelle comme le développement d’une relation amicale avec Dieu. Dans le Siracide 4:12, il commence de façon assez traditionnelle en disant combien il est important de poursuivre la Sagesse constamment et de lui être toujours fidèle.
LA SAGESSE COMME ESPRIT
Le livre de la Sagesse, ou la Sagesse de Salomon, fait beaucoup plus appel à la philosophie grecque. Il réunit trois concepts bibliques, l’esprit de Dieu, la parole de Dieu et la sagesse, qui est omniprésente et partout. Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 7, Salomon parle :
“En elle est, en effet, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible”, et il poursuit en énumérant toutes les qualités de l’esprit, disant même qu’”elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant; aussi rien de souillé ne s’introduit en elle. Car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l’activité de Dieu, une image de sa bonté” (Sg 7, 22-26).
Elle est aussi la parole par laquelle Dieu a fait l’univers, le λογος. En grec, le λογος ne signifie pas “parole” comme nous l’utilisons. Il signifie la parole et le discours mental, le raisonnement. L’auteur du livre de la Sagesse traduit donc le jeu de la Sagesse dans les Proverbes par le jeu de l’esprit qui se reflète dans les œuvres de la création. La Sagesse est même l’Un de la philosophie grecque. De nombreuses traductions diront : “bien qu’elle ne soit qu’une, elle peut tout faire,” mais cela montre une mauvaise compréhension de la philosophie grecque. Il faudrait dire : “Parce qu’elle est une, elle peut tout faire.”
LA SAGESSE COMME SAUVEUR
La deuxième grande innovation que le livre de la Sagesse introduit dans la personnification de la Sagesse en tant que femme, est de lui donner le rôle majeur dans l’histoire du salut. Comme la déesse Isis, la Sagesse est le Sauveur. C’est l’un des moments les plus remarquables de l’histoire biblique. À la fin de la prière de Salomon pour la sagesse, au cours de laquelle
il chante les louanges de la sagesse, il dit : “Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi les hommes on été instruits de ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.” Je dis remarquable car c’est le moment où l’histoire du salut est devenue un objet de sagesse. Les premiers auteurs de sagesse de la Bible ne parlaient jamais d’Israël ou de son histoire. L’auteur du livre du Siracide a commencé à faire de l’histoire un objet de sagesse mais c’était en termes d’hagiographie : “louons les illustres dans leurs générations.” Mais maintenant, l’histoire d’Israël, avec son Dieu sauveur, est pleinement introduite dans la sagesse et la sagesse de Dieu.
LES INCARNATIONS DE LA SAGESSE
En dehors de Salomon, des scribes et des prêtres proposés dans le livre du Siracide comme modèles d’une vie de sagesse, il y a aussi des incarnations de la sagesse parmi les femmes - par exemple Déborah, la juge et la prophétesse, et Esther et Judith. Judith, dans l’un des derniers livres de l’Ancien Testament, est présentée comme un modèle de sagesse. C’est une enseignante religieuse d’une grande sagesse et d’une grande éloquence qui guide le peuple dans sa réflexion sur ce qu’il faut faire face à sa crise.
Il y a ensuite la femme décrite dans Les Proverbes 31,10-31. Elle n’est pas appelée “sage” mais “une maîtresse femme” et est présentée comme la “bonne épouse.” Sa sagesse n’est mentionnée explicitement que dans Pr 31, 26, “Avec sagesse elle ouvre la bouche, sur sa langue : une doctrine de piété.”
Dans la Bible, la sagesse est donc représentée au féminin comme un être céleste, une enseignante, la chérie du Créateur, l’amie de la race humaine, l’amante, l’esprit et le sauveur, qui invite à une relation incarnée avec elle et ses attributs.
Elizabeth A. Johnson CSJ est professeur émérite de théologie à l’université Fordham de New York. Ancienne présidente de la Catholic Theological Society of America et de l’American Theological Society, elle a reçu quinze doctorats honorifiques. Elle fait partie du comité de rédaction de quatre revues de théologie et ses nombreux livres, traduits en treize langues, comprennent “Celle qui est : le mystère de Dieu dans le discours théologique féministe” (Crossroad l992) ; “Véritablement notre sœur: Une théologie de Marie dans la communion des saints” (Continuum 2003) et “La force de son témoignage : Jésus-Christ dans les voix des femmes du monde entier” (Orbis 2016). Le texte qui suit est un extrait de “Celle qui est.” Il est réimprimé par arrangement avec The Crossroad Publishing Company. Copyright © Elizabeth A. Johnson. www.crossroadpublishing.com

Jésus-Sophia
Elizabeth A. Johnson CSJL e C hrist , sagesse de d ieu (1 Cor 1,24).
L’utilisation de la figure féminine de la Sagesse personnifiée, si influente dans la christologie biblique, pour parler de Jésus-Christ, offre un champ élargi de métaphores permettant d’interpréter sa signification salvatrice et son enracinement en Dieu d’une manière qui soulage le monopole des images masculines du Logos et du Fils. Dans les catégories de la sagesse, nous pouvons dire que la solidarité intime de Sophia avec le Dieu non originel et sa solidarité tout aussi compatissante et vivifiante avec les êtres humains dont elle fait des amis de Dieu sont incarnées dans Jésus-Sophia, dont la personne est constituée par ces deux relations fondamentales. Une telle façon de parler rompt avec l’hypothèse selon laquelle il existe un “lien ontologique nécessaire” entre l’être humain masculin Jésus et un Dieu masculin. Cela conduit à la réalisation qu’en tant que Sophia incarnée, Jésus, même dans sa masculinité humaine, peut être considéré comme un révélateur de la gratuité de Dieu imaginé comme féminin. De même, la divine Sophia incarnée en Jésus s’adresse à toutes les personnes dans son appel à être les amis de Dieu, et peut être réellement représentée par tout être humain appelé dans son Esprit, les femmes comme les hommes. En outre, les stéréotypes typiques du masculin et du féminin sont subvertis, car la Sophia féminine représente la transcendance créatrice, la passion primordiale pour la justice et la connaissance de la vérité, tandis que Jésus incarne ces caractéristiques divines de manière immanente par rapport à la corporéité et à la terre.
Le paradoxe créatif et rédempteur de Jésus-Sophia ouvre la voie à la réconciliation des opposés et à leur transformation d’ennemis en une diversité libératrice et unifiée. En fin de compte, le genre n’est pas constitutif de la doctrine chrétienne de l’incarnation.
En plus d’aider à défaire le nœud de la christologie sexiste, les catégories de sagesse mettent en évidence d’autres avantages :
1. La relation avec le cosmos tout entier est déjà intégrée dans la tradition de sagesse biblique, ce qui oriente la christologie au-delà du monde humain vers l’écologie de la terre et, en fait, vers l’univers, une démarche essentielle en cette ère de crise planétaire. En tant qu’incarnation de Sophia, qui est le créateur de tout ce qui existe, l’attention rédemptrice de Jésus le Christ vise à l’épanouissement de toutes les créatures et de la terre entière. La puissance de l’Esprit du Christ se manifeste partout où les êtres humains partagent cet amour pour la terre, en veillant à sa fécondité, à ses limites et en la préservant de la destruction.
2. Le discours de la sagesse oriente également la croyance vers une perspective globale, œcuménique et respectueuse des autres voies religieuses. L’imagerie de la sagesse fonctionne aujourd’hui de la même manière que la métaphore du logos fonctionnait dans les premiers siècles chrétiens pour signifier le jeu de la bonté et de l’ordre juste de Dieu dans le monde, une fonction aujourd’hui quelque peu réduite pour le logos en raison de
sa longue association avec la théologie androcentrique et l’histoire ecclésiale impérialiste. Sophia, cependant, aime les gens; sa lumière brille partout, et ceux qu’elle fait devenir des amis et amies de Dieu et des prophètes se trouvent dans le monde entier. JésusSophia incarne personnellement son attention bienveillante dans une histoire particulière, pour le bénéfice de tous et de toutes, tandis qu’elle trace une multiplicité de chemins dans diverses cultures par lesquels tous les gens peuvent la chercher et la trouver.

3. En s’unissant à l’humanité dans l’incarnation et la souffrance, Sophia, dont les voies sont la justice et la paix, montre que la passion de Dieu est clairement orientée vers la levée de l’oppression et l’établissement de relations justes. La table est mise pour ceux qui viendront, le pain et le vin sont prêts à nourrir la lutte. Ce qu’il faut, c’est écouter les grands cris de Jésus-Sophia qui résonnent dans les cris des pauvres, des personnes violées et désespérées, et allier nos vies en tant que communauté de sagesse à l’œuvre divine créatrice et rédemptrice dans le monde.
En résumé, la doctrine de l’incarnation confesse qu’en Jésus-Christ, Dieu est véritablement entré dans l’histoire humaine, en vue de notre salut. Ni la divinité ni l’humanité dont il est question dans cette confession n’exigent la masculinité comme condition exclusive et constitutive. D’une part, Dieu n’est pas masculin. Les métaphores du Verbe et du Fils le plus souvent utilisées pour articuler la relation entre Jésus-Christ et le mystère absolu de Dieu ne signifient pas la masculinité en Dieu, mais une certaine relationnalité divine qui peut être superbement représentée dans le symbole de Sophia. D’autre part, l’histoire humaine
signifie l’ensemble du genre humain dans une solidarité de péché et de souffrance, comme l’a toujours affirmé la doctrine classique. Les particularités historiques de la personne de Jésus, notamment son sexe, ses caractéristiques raciales, son héritage linguistique, sa classe sociale, etc. ne signifient pas que Dieu s’incarne de manière plus appropriée dans ces réalités que dans d’autres.
La théologie aura atteint sa maturité lorsque la particularité mise en évidence ne sera pas le sexe historique de Jésus, mais le scandale de son option pour les pauvres et les marginalisés dans l’esprit de son Dieu-Sophia compatissant et libérateur. C’est le scandale de la particularité qui compte vraiment, car il vise à créer un nouvel ordre de plénitude dans la justice. À cette fin, le discours théologique féministe sur Jésus, la Sagesse de Dieu, déplace le centre de la réflexion pour aller de la masculinité vers la signification théologique globale de ce qui se passe dans l’événement du Christ. Jésus, dans sa spécificité humaine et historique, est confessé comme Sophia incarnée, révélatrice de la gratuité libératrice de Dieu imaginé comme femme; les femmes, en tant qu’amies de Jésus-Sophia, participent à égalité avec les hommes à sa mission salvatrice à travers le temps et peuvent représenter pleinement le Christ, étant elles-mêmes, dans l’Esprit, d’autres Christs. Telles sont les étapes sur la voie d’une communauté d’égaux interreliés dans une authentique mutualité, en théorie comme en pratique.
www.magdalacolloquy.org
Barbara Hallensleben occupe, depuis 1994, le poste de professeur ordinaire de théologie dogmatique et de théologie de l’œcuménisme à l’Université de Fribourg en Suisse. Elle est membre de l’Institut d’études œcuméniques et directrice du Centre d’études des Églises orientales, ainsi que de la Commission théologique internationale au Vatican (de 2004 à 2014). En plus de ses nombreuses fonctions dans le dialogue œcuménique, dont celle de consultante auprès du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, elle est membre de la Commission vaticane pour l’étude du diaconat féminin.

Qu’est-ce que la sophiologie ?
Barbara Hallensleben“Qu’est-ce que la sophiologie ?” est une question à poser non pas au début mais plutôt à la fin d’un parcours de pensée et d’expérience. Si nous posons cette question dès le début, la sophiologie pourrait facilement tomber dans une autre “ologie,” qui, comme la plupart des “ologies,” peut être tentée de devenir des idéo-logies. Les idéologies sont des systèmes de pensée qui tentent d’expliquer le monde de la manière la plus complète possible et de le façonner selon des idées préétablies.
La sagesse (grec : sophia ; latin : sapientia) est motivée différemment. Une personne qui en sait beaucoup n’est pas communément qualifiée de sage. Ce qualificatif est plus facilement attribué à une personne modeste, humble, qui sait de manière quasi-intuitive—sans parler ni débattre—ce qui compte vraiment dans la vie. Comme la sagesse a un caractère pratique, les sages savent comment maîtriser la vie, même dans les circonstances les plus difficiles, et sont capables de guider non seulement eux-mêmes mais aussi les autres pour qu’ils agissent de la bonne manière. C’est pourquoi la sagesse est une vertu privilégiée dans le leadership. Aristote a écrit “sapientis est ordinare”—les sages sont capables d’établir un ordre juste.
Le roi Salomon incarnait la sagesse. Il avait demandé à Yahvé un “cœur sage et intelligent” (1 Rois 3, 12). Ses jugements en tant que souverain ont permis aux gens de reconnaître “qu’il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice” (3, 28). La sagesse est ressentie comme appartenant à Dieu non seulement en Israël mais aussi dans d’autres nations et cultures. C’est ainsi que Thomas d’Aquin définira plus tard la sagesse, comme la compréhension de la plus haute des causes et comme le but ultime. Seul Dieu possède ce large horizon, comme la postmodernité le sait trop bien. La sagesse ne s’apprend pas ; elle ne se certifie pas par un diplôme; elle est un don de Dieu et pointe au-delà du monde terrestre.
Augustin a apporté une grande théologie sur la sagesse de Dieu, et a écrit qu’elle se trouve

particulièrement dans la théologie mystique. Dans le “Livre de la sagesse divine” du dominicain Heinrich Seuse (+1366), la dimension féminine de la sagesse réapparaît, probablement en raison des échanges qu’il a eus avec ses filles spirituelles dans les monastères féminins. Dans son livre “Sagesse secrète” le pasteur et hagiographe réformé Walter Nigg (+1988) a compilé des témoignages protestants pour une théologie de la sagesse, et Jakob Böhme (+1624) devait, par une approche sophianique, façonner la philosophie de l’idéalisme allemand.
En tant qu’introduction rudimentaire au développement de la sagesse, il est clair que la sophiologie ne peut pas tomber exclusivement sous les auspices de l’Église orientale. À Constantinople (l’actuelle Istanbul), l’important monument architectural de Sainte-Sophie a été construit dans la capitale de l’Empire romain de l’époque, probablement pour montrer la ressemblance entre l’empereur au pouvoir et le Christ Tout-Puissant. Dans les églises Sophia du monde russe, c’est toutefois l’interprétation mariologique qui prédomine. En Russie, une mystérieuse icône représentant une femme sous le trône du souverain céleste perpétue également le souvenir de la Maison de la Sagesse terrestre. Cette tradition a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de la philosophie religieuse russe et de la théologie du XXe siècle, qui devait unir les traditions orientale et occidentale.
La sagesse divine est devenue le centre de la vision du monde de l’économiste, philosophe religieux, prêtre et théologien russe orthodoxe Sergej Bulgakov (1871-1944). Pour lui, l’expérience précède la réflexion. Il a décrit l’expérience qu’il a vécue lors de sa première visite à Sainte-Sophie : “L’étroitesse et la lourdeur de notre petit moi souffrant ont disparu...” écrit-il, “l’âme en est guérie, elle se fond dans les arches et s’unit à elles. Elle devient le monde : Je suis dans le monde et le monde est en moi—ce sentiment n’est pas seulement du bonheur et de la joie, mais de la béatitude—une sorte d’intuition finale, tout en tout et tout en moi, un tout qui englobe tout, le monde dans son unité. C’est vraiment la Sophia, l’unité actuelle du monde dans le Logos.” La mort de son fils, qui n’avait pas encore quatre ans, a également fait que le ciel s’est ouvert pour lui d’une manière inattendue. Ancien marxiste, Bulgakov est passé du statut de matérialiste convaincu à celui d’“idéaliste,” pour découvrir que “les humains n’ont pas à fuir le monde (matériel), car le Christ y condescend lors des noces de l’Agneau.” Lorsque Dieu ne se contente pas de nous imposer sa volonté, mais qu’il nous communique la sagesse et la bonté comme dimensions de l’être de Dieu, alors le monde est infiniment précieux. Il participe au mystère de Dieu. La terre est confiée à l’humanité, non seulement comme la scène d’une probation éthique, mais comme le matériau pour la préparation d’une nouvelle création.

Sommes-nous maintenant mieux à même de répondre à la question “Qu’est-ce que la sophiologie ?” Pour réviser, nous savons au moins que la sagesse n’est pas un système de pensée qui s’impose à la réalité pour former un parti, et entrer en compétition avec d’autres systèmes de pensée. C’est la capacité de recevoir la réalité dans son caractère comme un cadeau, nous ouvrant à comprendre et à agir d’une manière nouvelle, surprenante, unique.
www.magdalacolloquy.org
L’HISTOIRE D’AMOUR DURABLE
La Sagesse possède toujours une qualité personnelle, comme nous, chrétiens, le confessons. Elle a son origine en Dieu le Père, se révèle dans le Fils et devient accessible à la création dans l’Esprit Saint. Non seulement les êtres humains sont créés à l’image de Dieu, mais toutes les créatures portent des traces de la sagesse divine, “chaque brin d’herbe et chaque rayon de soleil,” comme l’écrivait Dostoïevski.
La sagesse se révèle à chacun de nous de manière très personnelle, et pourtant c’est une sagesse unique qui nous donne la confiance pour l’unité, nous permettant de façonner ensemble ce monde dans la paix et la justice. La sagesse concourt à une compréhension qui accompagne le respect des différences des autres. La sagesse crée l’amitié.
La sagesse a un message particulier pour chaque temps et chaque époque. Dans le monde d’aujourd’hui, marqué par la méfiance, la violence et la propagande, nous sommes tentés d’accorder la priorité à notre propre survie et à notre bien-être, cédant ainsi à la tentation de sacrifier notre liberté et nos propres idées pour des promesses de sécurité politiques, économiques et juridiques. La sagesse fait preuve d’ouverture dans ce théâtre du monde et nous conseille : Ne vous résignez pas à être les innombrables victimes de l’histoire des puissants. N’essayez pas de ne sauver que vous-même. Ne vendez pas votre âme aux idoles fabriquées par vous-même dans ce monde. Dieu, l’unique Créateur et Rédempteur, a construit sa maison parmi nous. La vie finie est précisément la vie que le Dieu éternel, dans sa sagesse, nous a destinée et qu’il partage avec nous.
Il n’existe pas de monde “séculier” qui soit complètement impie. Au contraire, le monde est “séculier” précisément parce que Dieu l’a créé comme une contrepartie libre et aimante, comme “l’Épouse de l’Agneau.” L’apocalypse de ce monde est l’envers d’une histoire d’amour immense et durable à laquelle nous participons tous.
Michael Martin est écrivain, philosophe, poète, musicien, auteurcompositeur, éditeur, directeur du Center for Sophiological Studies et agriculteur biodynamique dans le Michigan. Il a passé seize ans comme enseignant Waldorf et maître enseignant, et a enseigné l’anglais, la philosophie et la théologie au niveau universitaire et collégial pendant plus de dix-sept ans. Il s’est lancé dans l’agriculture en 1990 et élève actuellement des vaches laitières, des abeilles et d’autres animaux tout en gérant un jardin maraîcher avec sa femme et certains de ses neuf enfants. Sa poésie et ses travaux universitaires ont été publiés dans de nombreuses revues. Il est l’éditeur de “Jesus the Imagination : A Journal of Spiritual Revolution” et auteur de nombreux ouvrages dont “The Submerged Reality : Sophiology and the Turn to a Poetic Metaphysics “ (Angelico Press, 2015), “ Transfiguration : Notes Toward a Radical Catholic Reimagination of Everything” (Angelico Press 2018), et “Sophia in Exile” (Angelico Press 2021). Son site web est www.thecenterforsophiologicalstudies.com

Sophia en exil: L’interview de Magdala
Gregory Rupik et Michael MartinGregory Rupik est un collaborateur de la rédaction de la revue D’Un Commun Accord. Pour en savoir plus sur son parcour, visitez notre site web.

Gregory Rupik Le titre de votre dernier livre est Sophia en exil. Comme tremplin pour notre conversation, que pourrait dire l’expression “Sophia en exil” de notre état actuel des choses? Que dit-elle sur la situation actuelle de l’Église et du monde ?
Michael Martin Nous vivons effectivement dans une sorte de pseudo-monde fabriqué qui est éloigné de ce qui est réel. Nous passons une grande partie de notre vie en ligne ou dans des mondes virtuels non réels. Contrairement à la plupart des gens, mes journées ne se déroulent pas seulement en ligne, mais je suis agriculteur et je dois donc faire face à la réalité pour passer à travers la journée. Il y a cette idée d’oubli— que nous oublions qui nous sommes : “Pourquoi sommes-nous ici ?” et “Quel est notre but ?” Ce sont des questions importantes.
GR Comment cet oubli se manifeste-t-il ? Qu’avons-nous oublié ?
MM Nous avons oublié notre relation avec la création et notre relation avec le Divin, et c’est la pièce maîtresse de la sophiologie. La sophiologie nous appelle à nous souvenir de ces deux choses, à entrer dans une manière de vivre qui reconnaît et révère ces deux choses. Parce que nous sommes exilés de la nature et de la création, et aussi de notre propre biologie, nous rejetons extérieurement ce qui est réel dans la création et la biologie lorsque nous cessons d’avoir une relation avec le Divin.
GR Il y a une sorte de révérence qui se perd alors - la capacité d’apprécier certaines des sagesses créées inhérentes à la nature.
MM J’irai plus loin. Cela nie la réalité sacramentelle de tout ce qui est. Voyez-vous, Sophia n’est pas en exil, c’est nous qui le sommes. Dès que nous prêtons attention à la sagesse du monde, elle s’éveille et nous aussi, dans une relation de réciprocité.
GR Que devons-nous faire pour nous réengager?
MM Je me suis spécialisée dans les poètes métaphysiques, tels que le poète anglais du XVIIe siècle, Thomas Traherne, et Eleanor Farjeon, du siècle dernier. Tous deux nous montrent comment voir le monde comme un enfant, tout comme l’Évangile dit “si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux.” Ils nous font découvrir comment un adulte peut redevenir un enfant.
GR Pour vous, le médium de la poésie - et les capacités de ces poètes à voir, à s’engager matériellement avec la beauté de la création - est une façon de voir le monde sous un jour nouveau, et une invitation aux autres à expérimenter le monde sous ce jour nouveau.

MM Oui, notamment dans le célèbre ouvrage d’Evelyn Underhill, Mysticism, publié à l’origine en 1911, elle consacre une section à la poésie. La philosophe française Simone Weil, ainsi que William Blake, essayaient, par le biais de leur poésie et de leurs écrits, d’ouvrir notre perception, de montrer Dieu en toutes choses. Ils étaient poussés par leur propre expérience pour voir comment elle pouvait se mesurer à la tradition dans laquelle ils avaient été élevés.
GR Il existe une opposition traditionnelle entre la techne et la poesis, entre créer pour contrôler (techne) et créer pour révéler quelque chose de vrai, de bon ou de beau (poesis). Cette tension nous éclaire-t-elle sur notre sentiment d’”exil” aujourd’hui, ou sur la manière de réenchanter notre expérience du monde ?
MM Pour moi, cela a été un long processus. Dans notre ferme, nous élevons des vaches laitières et des bovins, des moutons, des abeilles, des poulets et des oies. Notre jardin fait un demi-acre et ma femme et moi faisons tout cela sans outils électriques, sans même utiliser de charrue. Vous réalisez que vous n’êtes pas éloigné de la création avec laquelle vous travaillez—mais tout le monde ne peut pas faire cela. Comment entrons-nous dans la création ? C’est une chose. Les arts y jouent un rôle, la façon d’éduquer les enfants aussi, et de plus en plus la technologie s’en mêle. Un enfant peut lire des articles sur les serpents sur Internet et voir des vidéos, mais c’est une expérience très différente que de voir un serpent dans son environnement naturel. C’est très simple et nous essayons de le rendre compliqué. Il ne s’agit pas d’ésotérisme, mais d’un retour à l’état de perception et de relation de l’enfance, et c’est ainsi que les choses deviennent plus simples. Mon livre Transfiguration : Notes Toward a Radical Catholic Reimagination of Everything explore comment rendre les
choses plus réelles, comment nous pouvons le faire dans la science, l’éducation et l’économie. G. K. Chesterton est un excellent exemple de personne qui a vu ce qui allait arriver, tout comme Hillaire Belloc. Ils faisaient un travail important au début du 20e siècle. Il est regrettable que ces écrivains catholiques soient cloisonnés dans une bulle catholique radicale, car leur message s’adresse vraiment à tout le monde.
L’artisanat traditionnel nous relie également à ce qui est réel. Travailler avec des choses réelles, comme les textiles, la laine, etc.
GR Ce que je trouve intéressant, c’est que le fait de s’engager honnêtement avec les choses réelles de la nature, dans un sens, révèle à quel point elles sont directes et simples, mais cela nous invite également à découvrir leur complexité et la façon dont ces choses peuvent encore nous surprendre et nous enseigner.
MM Être connecté au réel exige de la flexibilité. C’est ce que nous devons faire dans notre ferme : être attentif à ce qui est là et s’adapter aux changements. Nous célébrons les fêtes chrétiennes dans notre ferme, à la manière d’une religion populaire. Par exemple, nous célébrons la fête de la SaintMichel avec une procession. Certains de mes enfants ont fabriqué une tête de dragon en papier mâché et nous avons fait le tour de la ferme jusqu’à ce qu’ils rencontrent Saint Michel sous un noyer qui a transformé le dragon. Puis nous avions une fête, une fête de la moisson. Des choses comme ça, très simples, qui ajoutent tellement de vie à la communauté, précisément en ne reculant pas devant la sagesse de la création.
Elinor Dickson a occupé le poste de directrice des services psychologiques à l’hôpital St. Michael de Toronto pendant 18 ans et a été très impliquée dans les communautés diocésaines et religieuses en tant que consultante, conseillère et leader communautaire. Au fil des ans, elle a animé de nombreux ateliers, donné de nombreuses conférences et collaboré avec l’écrivain jungien Marion Woodman. Cette collaboration inclut la co-écriture de “Dancing in the Flames : The Dark Goddess in the Transformation of Consciousness “(Alfred A. Knopf/Shambhala 1996). Elle est l’auteur de “Dancing at the Still Point : Marion Woodman, Sophia and me : A Friendship Remembered “ (Chiron 2019). Son prochain livre s’intitule “The Wisdom Option : Humanity’s Final Evolutionary Challenge.”
La Science de Sophia : Un reflet de la lumière éternelle
Elinor Dickson

Dans un ancien texte gnostique, on trouve une image captivante de Sophia étendant son doigt pour envoyer de la lumière dans la matière, puis suivant cette lumière dans le chaos. Pour moi, cette image évoque le Big Bang , lorsque quelque chose jaillit du néant. Ou, selon le mystique indien du 20 e siècle, Sri Aurobindo, c’est le moment où le Dieu caché, la force de la conscience indifférenciée, a été révélé pour la première fois. Au 19 e siècle, cette révélation par Sophia (Savitri) a été formulée par la science comme l’évolution. Pour reconnaître l’archétype de Sophia dans l’évolution de notre temps, nous devons nous tourner vers la lumière.
Nous lisons le voyage de Sophia vers la lumière dans le livre de la Sagesse de l’Ancien Testament (7, 24-27) “Car plus que tout mouvement la Sagesse est mobile; elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté… un reflet de la lumière éternelle… demeurant en ellemême, elle renouvelle l’univers.” La science a mis un peu plus de temps à la reconnaître.
POTENTIEL QUANTIQUE
Afin de préserver et de maintenir une position matérialiste, des concepts comme la conscience ou les processus psychologiques ont été éliminés du vocabulaire scientifique. De même, en physique, les vibrations microscopiques dans l’espace entre les choses étaient considérées comme un bruit de fond. Perçues comme une constante, ces vibrations étaient soustraites des calculs jusqu’à ce que l’on découvre, il y a plus de trente ans, que ce bruit était en fait une mer quantique de lumière appelée le champ du point zéro. Pour expliquer cette mer de lumière, l’astrophysicien américain Bernard Haisch écrit : “Nous voyons les choses par contraste. L’œil fonctionne en laissant la lumière tomber sur la rétine, par ailleurs sombre. Mais si l’œil était rempli de lumière, il n’y aurait pas d’obscurité pour créer un contraste. Le champ du point zéro est une telle lumière aveuglante. Puisqu’il est partout, à l’intérieur et à l’extérieur de nous, imprégnant chaque atome de notre corps, nous sommes effectivement aveugles à cette lumière... Elle nous aveugle à sa présence. Le monde de la lumière que nous voyons est tout ce qui se trouve au-dessus du champ du point zéro.” 1 Lorsqu’il s’agit de la réplétion de la lumière éternelle, la science et les Écritures s’accordent sur le fait que Sophia n’est pas “là dehors”. Elle est partout, à l’intérieur et à l’extérieur, imprégnant chaque atome
www.magdalacolloquy.org

dans nos corps et dans toute la création.
En s’appuyant sur la théorie des ondes, on a découvert que le champ du point zéro n’était pas seulement une mer de lumière, mais aussi une mer d’informations sur l’univers entier, transportées par des ondes de torsion du vide en interférence. Entre particule/ onde, matière/esprit, corps/âme, l’élément transformateur est l’information. Ce tiers réconciliateur entre les opposés, le célèbre physicien David Bohm l’a appelé information active. Il ne s’agit pas d’une information “ordinaire”, mais d’une information contenue dans le potentiel quantique qui informe ou donne forme à l’énergie.
En biologie, l’information “active” passe par ce que la neurobiologiste américaine Candace Pert a appelé les molécules de l’émotion - l’ Inforealm . Elle écrit : “Nous ne pouvons plus considérer les émotions comme ayant moins de validité que la substance physique et matérielle, mais nous devons au contraire les voir comme des signaux cellulaires qui participent au processus de traduction de l’information en réalité physique, transformant littéralement l’esprit en matière. Les émotions sont le lien entre la matière et l’esprit, elles vont et viennent entre les deux et les influencent.” 2 Cela me rappelle qu’au 12e siècle, riche en spiritualité, Sophia, ou Sapientia, était considérée à la fois comme l’ordre sous-jacent de l’univers et comme la création matérielle du monde par son grand effet.
L’ACTION DE SOPHIA
En physique, la théorie ondulatoire de la lumière était prédominante, mais avec la découverte de la complémentarité, la science a réalisé que les particules avaient également une fonction d’onde, et que la fonction de lumière de la particule/onde opérait dans notre ADN et au-delà. En travaillant dans son
laboratoire, le biophysicien allemand FritzAlbert Popp a découvert la lumière dans la matière. “Les vibrations du biophoton dans le corps font vibrer les molécules et créent leur propre fréquence de signature qui agit comme sa force motrice unique et aussi comme son moyen de communication.”3 Non seulement cette communication instantanée a lieu à l’intérieur du corps, mais Popp a également découvert que chaque molécule possède une fréquence unique qui s’étend au-delà du corps individuel et influence les autres corps.
La recherche en physique et en biologie est souvent considérée comme analogue à la découverte par Carl Jung de l’inconscient collectif et des schémas énergétiques archétypaux. Ceux-ci englobent à la fois l’instinct et l’image et guident l’interface entre notre codage génétique et culturel. De même, Jung a imaginé la matière et l’esprit comme deux cônes dont les sommets “se touchent mais ne se touchent pas”, ce qui permet la libre circulation constante de l’énergie qui informe et transforme notre position consciente dans le monde. Selon les mots de l’analyste canadienne Marion Woodman, Sophia est le “processus continu au sein de l’éternel,” qui entraîne constamment l’humanité dans l’évolution continue de la conscience de l’humanité.
Une autre façon d’observer l’action de Sophia est dans les messages des rêves. Une de mes clientes a rêvé qu’elle s’approchait d’une scène où des danseurs chinois sautaient tout en faisant exploser des pétards. Une grande femme entre en scène avec un long manteau bleu flottant, se frayant un chemin parmi les danseurs. Le rêve était porteur d’un message personnel pour la rêveuse, mais j’ai été frappée par la connaissance de la psyché de la théorie des particules et des ondes ! Un autre rêveur voit une magnifique femme sombre
chevauchant triomphalement une énorme vague vers le rivage : “J’avais peur, mais soudain mes amis et moi étions tous des molécules dansant dans la vague et notre élan amenait Sophia vers le rivage.”
Nous nous rendons souvent compte que nous avons besoin d’une chose par son absence. Aujourd’hui, dans notre “âge de raison” tant vanté, nous n’avons, dans de nombreux domaines, pas du tout évolué, mais nous avons sombré dans une sorte de cauchemar nihiliste rendu possible par une scission entre la matière et l’esprit, le corps et l’esprit. Si l’esprit se désincarne, ou si le corps est traumatisé, le point qui se rencontre et ne se rencontre pas devient plutôt un gouffre pour la folie qui s’ensuit. Regarder la télévision d’aujourd’hui, pourrait indiquer que l’humanité est en pleine dévolution. Notre espoir ne peut résider que dans le fait que Sa lumière brille dans l’obscurité. Que le traumatisme collectif que nous vivons dans nos corps et dans la nature est, en fait, non seulement reconnu mais en voie d’être libéré.
Pour devenir entier et entière, il faut l’énergie de l’âme qui circule librement, et pas seulement nos meilleurs efforts pour sauver la terre et nous-mêmes. Dans cet effort, plus la science pénètre au cœur de la matière, plus elle peut affirmer la nécessité d’une plus grande compréhension de Sophia, dont le travail évolutif en cours est le nôtre.
1 Haisch, Bernard. The God Theory: Universes, Zero-Point Fields and What’s Behind It All, Red Wheel/Weiser, York Beach, ME., 2006, p. 71.
2 Pert Candace, Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine, Simon & Schuster, New York, 1999, p. 189.
3 McTaggart, Lynne, The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe. HarperCollins, New York, N.Y., 2002, p. 59.
Elizabeth A. Johnson (Celle Qui Est)“La Sainte Sagesse est la mère de l’univers, la source vivante et non originelle de tout ce qui existe.”
L’éveil : Thomas Merton et Sophia
Lucinda M. Vardey est l’éditrice de la revue D’un commun accord. Pour en savoir plus sur son parcours, veuillez consulter notre site Web.

En 1962, le trappiste américain Thomas Merton a écrit un court poème de réflexion et de prière intitulé Hagia Sophia. Comme pour tous ses écrits, Merton avait le don d’exprimer, avec une honnêteté absolue, ce qu’il avait sur le cœur, consignant dans ses journaux intimes, ses lettres, ses poèmes et ses livres, ses chemins vers la vérité. Ses expériences étaient nombreuses et à multiples facettes, car il lisait beaucoup les œuvres de nombreux maîtres du mysticisme et des révélations divines, non seulement au sein du christianisme occidental, mais aussi dans les églises orientales ainsi que dans les religions orientales, en particulier le bouddhisme.
La sophiologie évidente dans le texte de Hagia Sophia a été longuement enregistrée; elle fait écho à une grande partie de ce que d’autres partagent dans ce numéro. C’est un document important car il dépeint l’essence de l’expérience de la présence de Sophia : l’ouverture d’une conscience de ses nombreux aspects, y compris les éléments d’amour, d’union, de paix, de guérison et de miséricorde qui composent son être. Le mystère de sa présence dans la nature, l’invitation à participer et à se transformer en douceur et en “douceur indicible,” en amour, en “éclat diffus de Dieu,” en enfant féminin qui joue “à tout moment devant le Créateur” et dans le monde “visible et invisible.” Elle a une pureté maternelle reflétée dans la figure de Marie, qui consent à recevoir Dieu pour que Dieu puisse entrer dans la création de
Dieu. Marie est alors Sophia, comme l’est Jésus qui vient pour racheter, restaurer, guérir et enseigner les voies du cœur. “Sophia est un don.....Elle est un don de Dieu et Dieu lui-même est un don.”
Au début de Hagia Sophia, Merton se voit en rêve comme un homme endormi dans un hôpital. Aux premières heures du matin, le jour de la fête de la Visitation, il entend la voix douce d’une infirmière qui le réveille de la séparation et de la solitude “dans l’unité de l’amour”, la main fraîche de l’infirmière le touchant avec “toute la vie, le toucher de l’Esprit.” Cette expérience lui arrive dans l’état vulnérable du sommeil, “sans conscience et sans défense....L’amour le prend par la main,” écrit-il, “et lui ouvre les portes d’une autre vie, d’un autre jour.”
Dans une lettre à Proba, Saint Augustin écrit que le désir de Dieu est un élément central d’une vie de prière. Que Dieu, qui sait ce dont nous avons besoin, ne peut nous donner que ce que nous sommes capables de recevoir. Dans le cas de Thomas Merton, quatre ans après avoir écrit Hagia Sophia, le matin du dimanche de Pâques 1966, il a été conduit à faire une expérience incarnée de ce qui pourrait être interprété comme un désir prophétique. Alors qu’il se remettait d’une intervention chirurgicale sur le dos dans un hôpital de Louisville, dans le Kentucky, il allait tomber profondément amoureux de l’étudiante infirmière qui le soignait. Il a consigné les détails de cette relation dans son journal, notant qu’il avait un besoin émotionnel “de compagnie et d’amour féminins.” L’amour qu’il recevait d’elle suscitait en lui “une gratitude irrésistible” qui, même impliqué avec une femme en tant que moine, lui procurait la paix et le bien-fondé de laisser “l’amour s’emparer de moi en dépit de toute
ma peur.” La peur, bien sûr, était l’inconnu, l’inacceptabilité qui pouvait conduire au déshonneur. Mais ce qu’il a enregistré, c’est la beauté d’une rencontre de cœurs, le fait d’être “connu” par l’autre au plus profond de lui-même, et la façon dont il a vu dans son cœur “toute (sa) préciosité devant Dieu, toute sa beauté...”. Il a décrit l’abandon à sa sagesse féminine.... qui cherche instinctivement en moi la blessure qui a le plus besoin de sa douceur et m’y prodigue son amour.”
Merton a aimé ce qui est “le potentiel profond, mystérieux, personnel, unique qui est en elle... essayant de devenir libre dans mon amour.” Même si, par obéissance à son abbé, Merton a cessé de la voir et de correspondre avec elle, il a revendiqué cette expérience comme un “événement profond” dans sa vie. C’est un événement qui a modifié et transformé tout son être, et que leur amour en lui a continué comme une “présence cachée et transfigurée.... elle sera toujours pour moi sa douce voix qui parle des profondeurs de mon propre cœur.” Reconnaissant qu’il avait besoin de cet amour, il a compris qu’il contribuait à guérir ce qui manquait à sa vocation monastique. Et, dans la douleur de la séparation finale, il a ressenti “la proximité et la miséricorde de Marie.”
Le théologien et spécialiste de Merton, Christopher Pramuk, a observé dans son livre Sophia : The Hidden Christ of Thomas Merton (Sophia : Le Christ caché de Thomas Merton) que son interprétation de Sophia dans ses écrits était la découverte de la “douceur dans la réalité”, que, comme pour Marie, siège de la Sagesse, le Christ doit être enfanté dans la vérité de nous-mêmes, et que Sophia éveillait “une union qui existe déjà.”
La relation de Thomas Merton avec son infirmière, bien que perçue comme une digression, aurait pu être, au contraire, une porte d’entrée. Son désir d’être réveillé du sommeil par une douce présence féminine l’a conduit à recevoir cette présence dans la chair, non seulement pour l’aider à réaliser ce qu’il désirait, mais aussi pour trouver les joyaux spirituels intégrés dans l’expérience, ce qu’il a identifié comme la possibilité très réelle de la vie en union avec l’amour. “Tel est le réveil d’un homme,” écrit-il à propos de Hagia Sophia, dans un nouveau monde, une nouvelle réalité, “hors de la langueur et de l’obscurité, hors de l’impuissance, hors du sommeil.”

“Ô Sagesse s’étendant d’un bout du monde à l’autre, établissant et ordonnant tout (Sg 8, 1) et disposant toutes choses avec douceur en rehaussant le sentiment et en le rendant ordonné, guidez ce que nous faisons comme votre vérité éternelle le demande, afin que chacun de nous puisse se glorifier en sécurité en vous et dire “Il a ordonné l’amour en moi” (Ct 2,4).
Saint Bernard de Clairvaux (Sermon 50)
Prière

O Dieu, notre créateur, Vous, qui nous avez faits et faites à votre image, donnez-nous la grâce de l’inclusion au cœur de Votre Église.
R : D’un commun accord, nous prions.
Jésus, notre Sauveur, Vous, qui avez reçu l’amour des femmes et des hommes, guérissez ce qui nous divise, et bénissez ce qui nous unit.
R : D’un commun accord, nous prions.
Esprit Saint, notre Consolateur, Vous, qui guidez ce travail, veillez sur nous qui espérons faire Votre volonté pour le bien de tous.
R : D’un commun accord, nous prions.
Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, restez près de nous. Sagesse divine, éclairez-nous.
R : D’un commun accord, nous prions. Amen.
Vos commentaires et réactions sont les bienvenus et nous envisagerons de les partager dans les prochains numéros ou sur notre site web.
Veuillez envoyer vos commentaires à editor@magdalacolloquy.org
Si vous n’êtes pas encore abonné(e), vous pouvez le faire à tout moment et sans frais grâce au généreux soutien des Pères Basiliens de la Congrégation de Saint-Basile.
Il suffit de visiter notre site web www.magdalacolloquy.org où vous pouvez également lire les anciens numéros de notre revue et être informé(e) de nos intentions et de nos activités.
La revue D’un commun accord est publiée en italien, en anglais et en français. Pour accéder aux autres versions linguistiques, veuillez visiter notre site web.
Musique de signature With One Accord (D’un commun accord) pour l’interview de Magdala, composée par le Dr John Paul Farahat et interprétée par Emily VanBerkum et John Paul Farahat.
Images utilisées dans ce numéro :
Couverture: “Aube à Montecasale” photo John Dalla Costa.
Page 2 “Coucher de soleil à Montecasale” photo John Dalla Costa.
Page 5 Détail de “Sagesse et force” de Paolo Veronese (1565).
Page 5 “Le roi Salomon avec trois de ses épouses” par Giovanni Venanzi di Pesaro (1668).
Page 9 “Sapientia” Manuscrit illustré du 12e siècle, artiste inconnu.
Page 10 “Sainte-Sophie” Istanbul, photo John Dalla Costa.
Page 15 “Détail de “Arc-en-ciel sur Sansepolcro” de John Dalla Costa.
Page 19 “Où chantent les rouges-gorges” par Thomas Hovenden (1890) Woodmere Art Museum, Philadelphie, U.S.A.
www.magdalacolloquy.org
Ce numéro
Copyright © 2023 Paroisse catholique de Saint-Basile, Toronto, Canada .
Pour contacter l’Editrice, écrivez editor@magdalacolloquy.org ISSN 2563-7932
ÉDITEUR
Morgan V. Rice, CSB ÉDITRICE EN CHEF
Lucinda M. Vardey
RÉDACTRICE ASSOCIÉE
Emily VanBerkum
ÉDITEUR CONTRIBUTEUR
Gregory Rupik CONSULTANT
John Dalla Costa
TRADUCTRICES
Patricia O’Grady (Français) Elena Buia Rutt (Italien)
COORDONNATEUR DE LA PRODUCTION
Michael Pirri ADMINISTRATRICE Margaret D’Elia