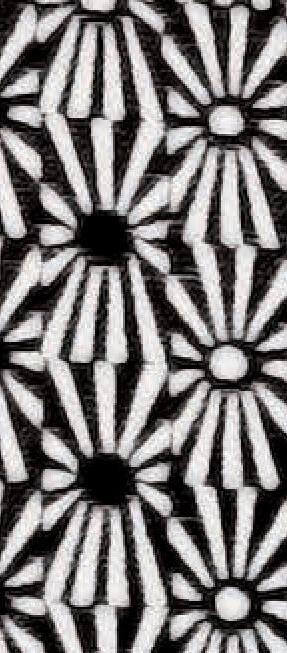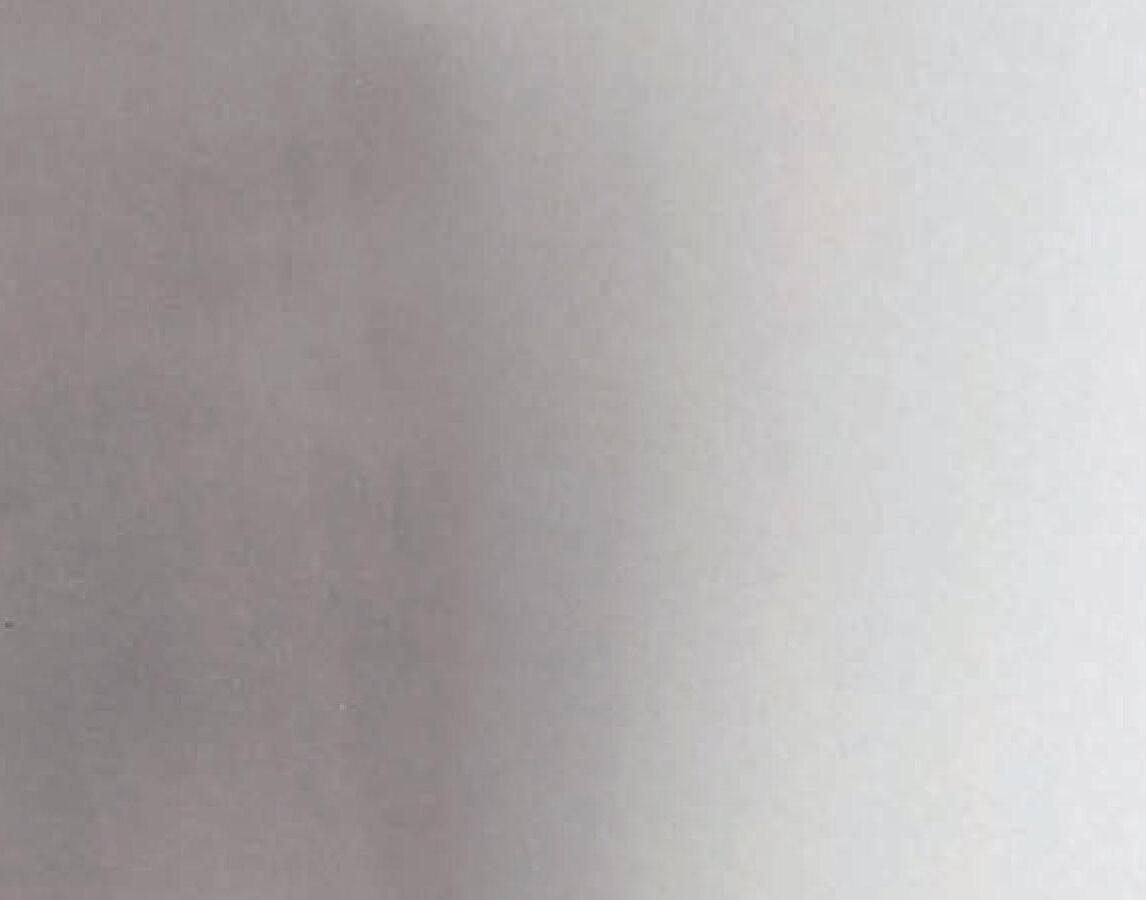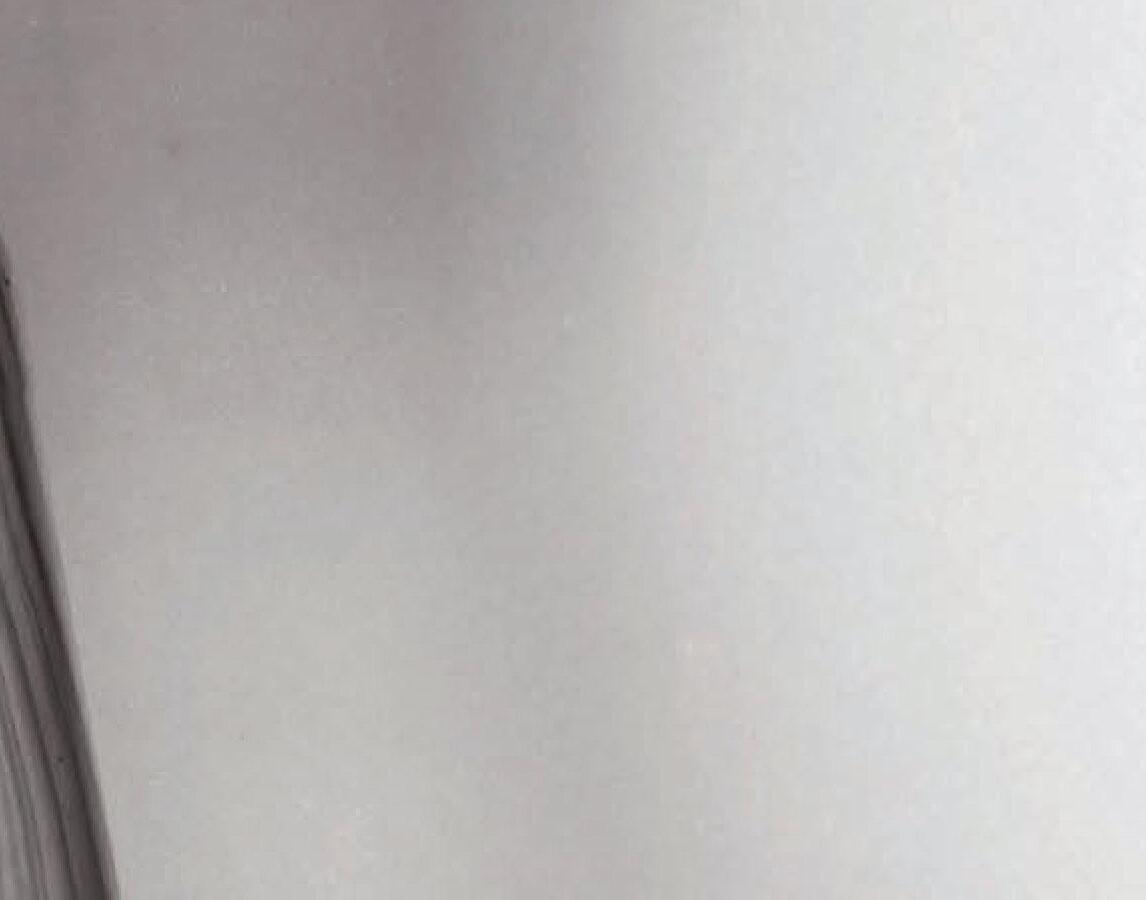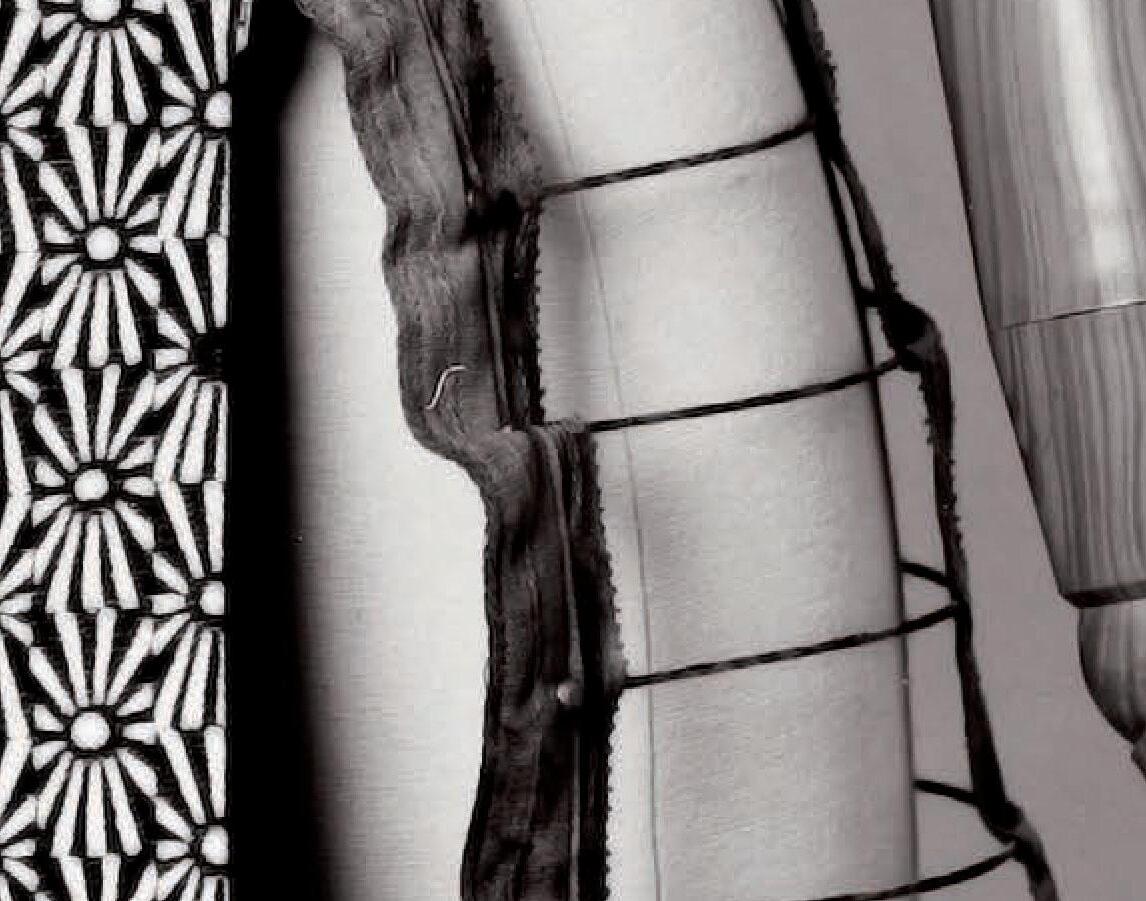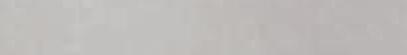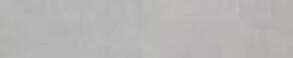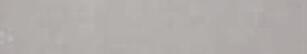Vêtement et identitésentre réalité et souvenir
• Le « saint habit » des Augustines
• « Ravissante, ravissante… WonderBra » - la petite histoire d’une entreprise québecoise
• Steampunkplus qu’un costume
HISTOIRE QUÉBEC est publié quatre fois par année et imprimé à 1 600 exemplaires. Le contenu de cette publication peut être reproduit avec mention de la source à la condition expresse d’avoir obtenu au préalable la permission des Éditions Histoire Québec (ÉHQ). Par ailleurs, toute utilisation non personnelle ou commerciale doit passer par opibec à moins d’une entente spéci que avec les ÉHQ. Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et des illustrations utilisées, et ce, à l’exonération complète de l’éditeur.
Le magazine Histoire Québec est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).
ABONNEMENTS
1 an 4 numéros 35 (toutes taxes incluses)
2 ans numéros 60 (toutes taxes incluses)
• Abonnements institutionnels
1 an 4 numéros 60 À l’étranger 1 an 4 numéros 5 ( N)
HISTOIRE QUÉBEC
7665, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7 élép one 514 252-3031 ans frais 1 866 691-7202 www.histoirequebec.qc.ca
iffusion et distribution au anada francop one
Diffusion Dimedia 539, boulevard Lebeau, Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2 élép one 514-336-3941 www.dimedia.com
No ISSN 1201-4710
Dép t lé al ibliot èque et rc ives nationales du Québec S N
S N papier 9 -2- 95 6-2 1-9
S N numérique 9 -2- 95 6-2 0-2
Éditeur Les Éditions Histoire Québec, en partenariat avec la édération
Histoire Québec • Rédacteur en chef / Jean Rey-Regazzi
Équipe éditoriale / Louise Douville, Roxane Martineau, Jean Rey-Regazzi
• Réviseure Marie-Sop ie érard • Design graphique régory rossat
Couverture ves Lavoie En cavale, Redingote par Muse par Christian Chenail (2010) sur crinoline-cage (vers 1870) (détail), ferrotypie au collodion humide, 2024, collection particulière.
Droits d’auteur et droits de reproduction outes les demandes de reproduction doivent être ac eminées à opibec (reproduction papier) 514 2 -1664 1 00 1 -2022 licences@copibec.qc.ca
4
5
9
12
15
Le mot de la rédaction
Le « saint habit » des Augustines - entre symbole d’appartenance communautaire et témoin historique
Un portrait des créateurs haut de gamme de Montréal en 1898 et en 1927
Les élégantes Montréalaises à l’opéra au temps de l’Albani, 1883-1906
18 « Ravissante, ravissante… WonderBra » : la petite histoire de l’entreprise montréalaise Canadelle Inc.
21
25
28
31
35
Souvenirs : quand des vêtements témoignent de Métis-sur-Mer comme lieu de villégiature
Les anciens Français d’Amérique et la nationalité française de 1763 à nos jours : Histoire et Droit
Le costume steampunk, plus qu’une mode vestimentaire
Un manifeste belge en faveur de l’engagement citoyen en histoire et patrimoine
Marginalisation et émancipation : les luttes des femmes au Québec à travers l’histoire
38 L'histoire de l'autochtonisme kwe
40
Histoire de lire
V N QUAND DES VÊTEMENTS TÉMOIGNENT DE
circonstances il a été porté. Cet article en rend compte. Il des relations entre la population permanente de cette municipalité et la bourgeoisie anglophone montréalaise
le lieu à l’époque. Il pouvait s’agir d’échanges sous
MÉTIS-SUR-MER
COMME LIEU DE VILLÉGIATURE
par Marjelaine Sylvestre, directrice du département muséal, Jardins de Métis, et Philippe Denis, Ph. D., muséologue et chercheur en patrimoine de la mode
À l’Église Saint-Georges de Métis-sur-Mer, vers 1925. Collection Les Amis des Jardins de Métis.
ou encore de commandes passées à des couturières locales qui ont inspiré ces dernières dans la réalisation de l’apparence vestimentaire dans le maintien des
C’est le seigneur John MacNider qui est à l’origine de l’établissement d’une communauté écossaise sur la rive sud du Saint-Laurent, à plus de 600 kilomètres à l’est de Montréal. Ce groupe forme, encore aujourd’hui, le cœur de Métis-sur-Mer. utrefois appelée Petit-Métis ou Metis each, la municipalité est fondée en 1 1 . n moins d’un siècle, elle quitte son statut de bourgade agricole isolée pour devenir un lieu de villégiature prisé par la bourgeoisie anglophone montréalaise. Plusieurs facteurs sont à la source de ce changement. l y a, entre autres, le désir des bourgeois anglophones de fuir la chaleur et les éclosions d’épidémies de choléra et de typhus qui reviennent de manière récurrente avec les beaux jours au e siècle1. D’ailleurs, la santé publique recommande à la population de fréquenter des lieux aérés, loin de l’air corrompu des villes où des miasmes mortels propagent les maladies. L’amélioration de l’accessibilité participe également à l’intérêt pour l’endroit, car, avant l’achèvement du chemin de fer de l’ ntercolonial en 1 6, il n’est possible de se rendre à Métis que par voie maritime.
Dans le dernier quart du e siècle, l’accroissement de la popularité de Métis comme lieu de destination privilégiée est fulgurant. Hôtels et résidences d’été s’implantent par dizaines dans le paysage métissien avec la bourgeoisie anglophone montréalaise qui y apporte ses habitudes. Elle y transpose son mode de vie, ses codes de conduite et ses activités qui ont désormais lieu en plein air.
Dans le respect des conventions sociales, bien que le rythme des journées soit plus lent et laisse du temps pour des moments de détente et de loisir, le thé reste servi inexorablement à 16 h et le souper à 19 h. ussi, la règle exigeant une tenue appropriée pour chaque type d’activité est maintenue. aignade, golf, tennis, promenade en forêt, pêche, pique-nique, thé et soirées les changements vestimentaires rythment la journée.
Un homme se souvient que, lorsqu’il était enfant à Métis, en été, les dames prenaient le thé sur la galerie du Cascade Club « avec ces grands chapeaux qu’elles portaient, avec leurs gants blancs et leurs ombrelles, et mangeaient des sandwichs servis par des serveuses en uniforme2
Les membres de la bourgeoisie af uent donc avec des malles remplies de vêtements qui ne laissent pas indifférente la communauté permanente.
vec la transformation de Métis-sur-Mer en destination touristique, la population locale formée de descendants de colons écossais et des communautés francophones environnantes s’adapte. Quelques-uns de ces membres quittent l’agriculture pour ouvrir des hôtels, parmi lesquels le Seaside House 3 , le oule Rock Hotel4 et le Cascade Hotel 5 , tandis que d’autres entrent au service des familles pour assurer l’entretien des b timents, des jardins et des garde-robes 6
Dans ces malles arrivent des vêtements confectionnés ou achetés ici et à l’étranger. La bourgeoisie anglophone commande ses tenues auprès de couturières montréalaises, notamment lorine Phaneuf, abrielle « aby ernier et da Desmarais, ou elle les fait réaliser par le personnel de maison. Elle s’en procure également lors de déplacements à Londres — les maisons de couture parisiennes y établissent des succursales — et à New York. Par exemple, Elsie Reford, la créatrice des Jardins de Métis, pro te de ce qu’elle accompagne annuellement ses deux ls en ngleterre, où ils étudient, pour faire quelques achats à Londres.
Je suis allée faire des essayages chez Paquin et Martze et j’ai acheté un chapeau. Seule ici pour le déjeuner. Essayages chez Durwards. Je suis allée commander des livres et des chemises, etc. Lady E. Dawson et lady Margaret Douglas sont venues prendre le thé. Lord Charles Hope est venu dîner et nous sommes allés voir Rutherford and Son. Une pièce de caractère très intelligemment jouée qui montre la soumission à une volonté toutepuissante .
De même, elle se rend occasionnellement à New York comme d’autres de ses semblables.
Les tenues achetées après la saison estivale arrivant donc l’année suivante à Métis ne sont plus des nouveautés. Déjà portées et vues, voire décrites dans les rubriques mondaines de journaux comme The Montreal Star, elles viennent y achever la première partie de leurs vies. l est, de ce fait, aisé de s’en départir au pro t d’une employée engagée pour la saison estivale ou d’une résidente permanente. ien conservé, un manteau acheté chez ergdorf oodman, un grand magasin new-yorkais de luxe, témoigne de cette pratique . L’établissement commercial n’étant pas reconnu pour sa vente par catalogue — le marché local est occupé par Eaton (1 4), Morgan (vers 1 91), Simpson (1 93), Paquet (vers 1 9 ) et Dupuis rères (1922)9, notamment —, celui-ci n’a donc pu être acheté que sur la 5e avenue, avant d’être offert à Marieerthe Leblond, l’épouse du cordonnier de Les oules, un secteur de Métis-sur-Mer. C’est d’ailleurs l’un des rares exemples où l’identité de la personne l’ayant re u est connue. Marie- erthe Leblond dirige avec fermeté le commerce fondé par la famille de son époux, un établissement renommé tant pour la vente de chaussures que pour ses services de réparation en tout genre allant de la sellerie aux bicyclettes; qu’aurait-elle pu faire pour que le manteau lui soit offert? La question reste sans réponse.

Manteau acheté che ergdor Goodman ayant appartenu Marie- erthe Leblond, après 1963. Collection privée.
La robe de plage a eu un parcours différent. Vêtement léger et facile à retirer pour se mettre en maillot de bain, la robe, ou tunique de plage, est apparue dans les années 1930 pour permettre à celle qui la porte de se changer à la maison ou à l’hôtel, puis de se rendre jusqu’à la piscine ou à la plage sans heurter les sensibilités. En outre, en marchant sur le littoral, il est encore possible de voir des cabines utilisées par des baigneurs pour en ler leur maillot.
Taillée dans un tissu léger et glacé, la robe de plage parsemée de motifs de eurs roses et de palmes vertes atteste de l’exotisme en vogue à la n des années 1940 et durant la décennie suivante. L’ajustement et la découpe à la taille mettant en valeur sa nesse et la courbe naturelle des épaules sont également en phase avec la féminité promue dès 194 par les couturiers d’ici et d’ailleurs. Le double boutonnage du corsage et la forme et la largeur de l’unique rabat de poche ne sont pas sans évoquer, quoiqu’adaptés, des détails du tailleur Auteuil réalisé par Christian Dior New York en 1949. Cette année correspond aussi à la sortie du lm hollywoodien La lle de eptune, dans lequel l’actrice et nageuse Esther William interprète une dessinatrice de maillots de bain sur fond de musique sud-américaine. Y a-t-il un lien à faire?
Sans étiquette et confectionné avec soin, la première hypothèse émise fut que ce vêtement ait appartenu à une estivante l’ayant offert en gage de remerciement, d’où sa présence à Métis. La possibilité qu’il ait été réalisé par une des couturières locales pour l’une des membres de sa famille a été soulevée ensuite. La propriétaire actuelle de la collection ayant mentionné que sa grand-mère, Eugénie Dubé rochu, et une de ses grands-tantes, lanche rochu uilbault, cousaient tant pour elles et leur famille que pour des femmes en vacances, il est devenu, de ce fait, envisageable que l’une d’elles aient repris ou se soient inspirées des vêtements faits pour ses clientes à des ns personnelles.
Conclusion
ien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, cette étude se penche sur l’importance que les vêtements peuvent avoir dans l’écriture de l’histoire d’un lieu. l est d’autant plus intéressant d’en analyser des pièces pour essayer d’en extraire des informations, même si peu d’échantillons subsistent par comparaison au nombre confectionné.
l n’en reste pas moins qu’il existe des objets vestimentaires à découvrir à Métis — d’autres ont surgi de quelques malles et greniers depuis la mise au jour de cette première collection — et ailleurs, qui permettront de continuer à comprendre la diffusion des goûts dans la région. •
de plage, après 1949. Collection privée.
Notes
1. oulet, Denis. « Les grandes épidémies qui ont frappé le Québec , Québec Science, 2020. Récupéré de https www.quebecscience.qc.ca sante grandesepidemies-quebec/.
2. « man reminisces that when he was a boy in Métis in the summer, the ladies used to have tea on the gallery of the Cascade Club “in those huge hats they used to wear, with their white gloves and parasols, and eat thin sandwiches served by maids in uniforms. traduction libre , dans Westley, Margaret W. Remembrance of Grandeur. The Anglo-Protestant Elite of Montreal 1900-1950, Montréal, Éditions Libre Expression, 1990, p. 10
3. ppartenant à John stle, le Seaside Hotel ouvre en 1 5. D’abord résidence familiale, puis auberge et, en n, hôtel de villégiature recherché, trois générations de cette famille se succèdent à sa direction. l ferme ses portes en 1963 et est détruit en 1966.
4. Construit en 1900 par William stle, le oule Rock Hotel est reconnu pour sa piscine d’eau salée chauffée accessible depuis l’étage des chambres permettant à la clientèle d’y descendre le matin pour une baignade discrète dans les années 1920. l ferme en 19 5.
5. uvert en 1 6, le Cascade Hotel est construit et dirigé par les descendants du seigneur MacNider. l est démoli en 1969.
6. Par exemple, en 1931, la population permanente comprend 210 personnes, mais passe à 3500 personnes durant la saison estivale. Hyde, Cynthia, Zambrano, ustavo et Lemieux, Denis. « Métis-sur-Mer, un lieu unique à découvrir , Revue d’histoire du Bas-Saint-Laurent , 1993, 16 (2), p. 9-1 . Récupéré de https // semaphore.uqar.ca/id/eprint/2512/1/Métis-sur-Mer un 20lieu 20unique 20 à 20découvrir.pdf.
. « Went for ttings to Paquin Martze and bought a hat. lone here for lunch. ittings at Durwards. Went to order books and shirts, etc. Lady E. Dawson Lady Margaret Douglas to tea. Lord Charles Hope came to dine and we went to see Rutherford and Son. very cleverly drawn character plays showing the subservience to an all-powerful will traduction libre . Reford, Elsie. « Monday, pril 1 , Journal personnel , 1912.
. Deux autres étiquettes sont cousues sous celle de ergdorf oodman sur l’une des parementures du manteau. La première indique qu’il a été réalisé par Count Romi Ltd, une société commerciale enregistrée dans l’État de New York en 1963, la deuxième qu’il a été confectionné dans des ateliers af liés à l’ L WU — nternational Ladies arment Workers Union —, un syndicat défendant les intérêts des ouvrières travaillant dans la confection vestimentaire aux États-Unis.
9. Trépanier, Esther et orbo n, Véronique. Mode et apparence dans l’art québécois, 1 0-1945, Québec, Musée national des beaux-arts du Québec / Publications du Québec, 2012, p. 4-
Robe