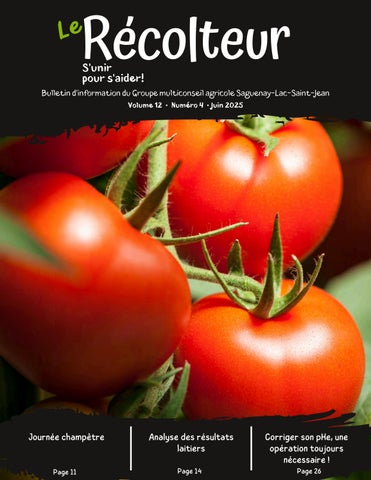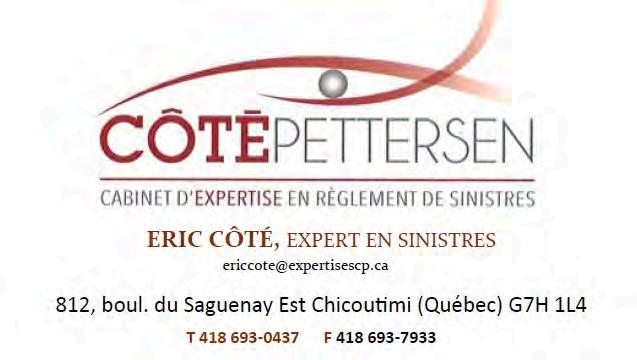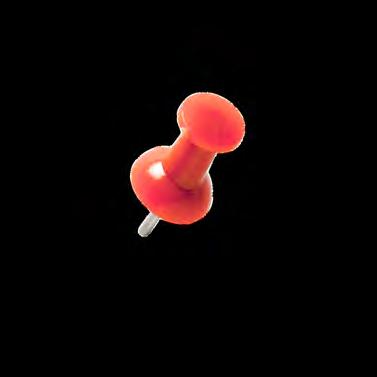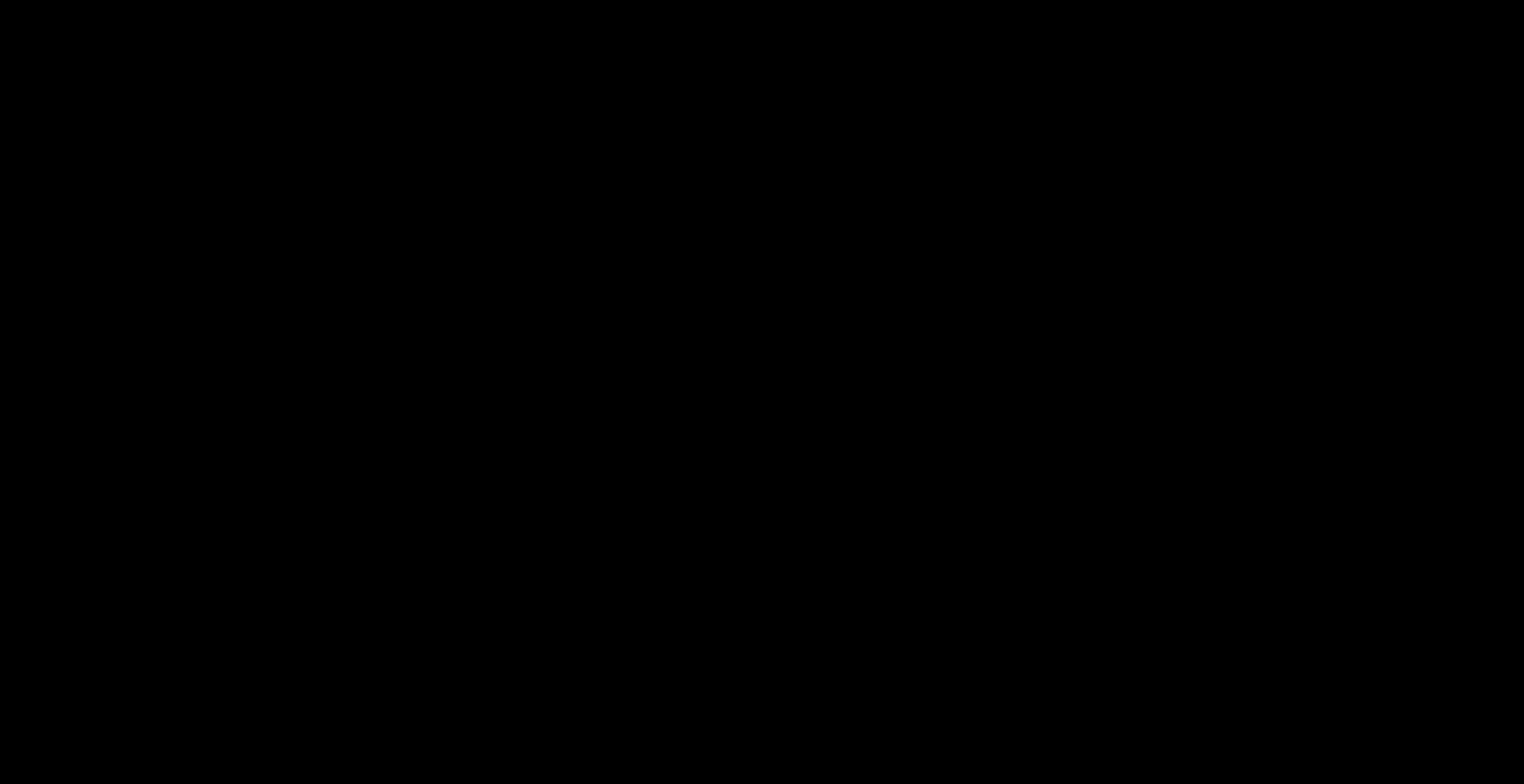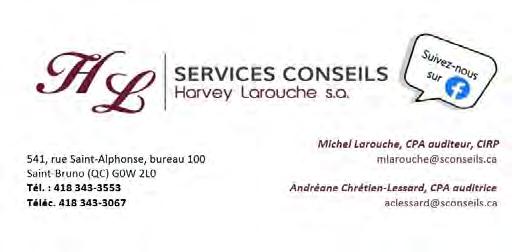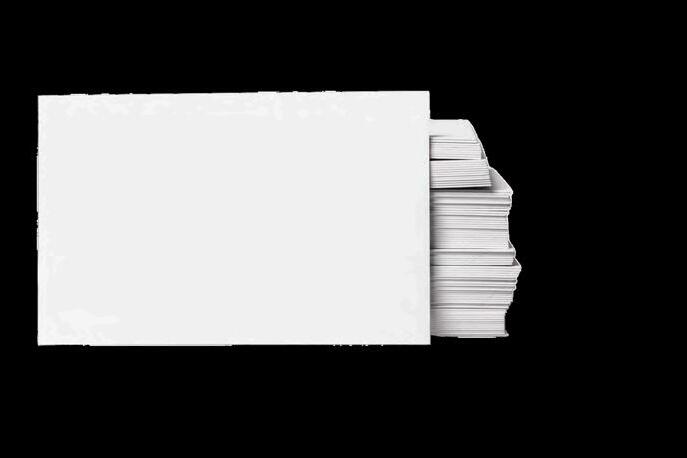Mot du Mot du directeur général directeur général
Sachez que l’accessibilité à notre personnel est une valeur très importante pour laquelle nous ne ménageons aucun effort. Comme la période des vacances commencera bientôt, voici les options qui s’offrent à vous pour adresser vos demandes à l’un des membres du personnel par téléphone :
Demande non urgente : Vous êtes invité à laisser un message sur la messagerie vocale de la personne contactée. Chacun des membres du personnel indique dans son message vocal la période où il sera absent. Ainsi, à son retour il sera averti de votre demande et pourra vous contacter. Notez que, de cette façon, seul le conseiller contacté est avisé de votre demande.
Demande urgente : Si votre conseiller est en vacances, faites le zéro. Votre appel sera alors transféré à un collègue disponible et en mesure de vous servir.
Enfin, n’hésitez pas à consulter le site internet du GMA (www.gmasaglac.com) pour retrouver les coordonnées de la personne que vous souhaitez rejoindre.
Malgré tout, il est possible que, certaines journées, aucun des membres du personnel ne soit disponible pour répondre à votre appel. Vous pourrez rappeler un peu plus tard ou le lendemain !
Ajustements de notre facture pour répondre aux nouvelles exigences du MAPAQ du programme desoutienauréseauAgriconseils
En 2024 et en 2025, la direction du MAPAQ a fait des ajustements au guide des utilisateurs du réseau Agriconseils. À la suite des représentations politiques de VIA (notre regroupement provincial), nous devons apporter quelques modifications à certaines pratiques afin de nous conformer à ces nouvelles règles. Nous comprenons que toutes modifications sur nos contrats et factures occasionnent une nouvelle compréhension et aussi une certaine adaptation pour vous, mais aussi pour notre personnel. D’ailleurs, notre personnel subit autant que vous ces ajustements. N’hésitez pas à entrer en contact avec la direction générale du GMA si vous avez besoin d’explication ou pour nous donner vos commentaires à ce sujet. Aussi, nos administrateurs sont ceux qui vous représentent et ils sont aussi disponibles pour discuter avec vous si cela est nécessaire.
Notez que ces ajustements n’apporteront pas de revenus supplémentaires au GMA, mais plutôt une baisse en bout de ligne, car après consultations des administrateurs, ceux-ci ont décidé que le GMA assumera une partie des impacts occasionnés par ces changements.
Merci de votre compréhension et soyez assuré que nous ne ménageons aucun effort pour maintenir nos services de grande qualité, avec un personnel compétent et avec des coûts représentatifs de la qualité offerte.
Nouveau conseiller au volet Génie M. Thomas Csisztu, candidat à la profession d’ingénieur Thomas s’est joint à l’équipe en mai 2025. Diplômé en 2022 de l'Université McGill, il détient un baccalauréat en génie agricole et rural. Originaire de la province ontarienne, sa venue au Lac-SaintJean a été influencée par les racines régionales de sa conjointe. Xavier et Maude l’impliqueront graduellement dans les dossiers et son embauche répond aux besoins et à notre vision du volet génie d’offrir des services en génie agroenvironnemental répondant à vos attentes. Bonne carrière au GMA !
La sécurité de notre personnel avant tout !
Avec le retour de la saison estivale vient le retour du personnel du GMA dans vos champs ��.
Nous aimerions vous rappeler quelques règles de sécurité à respecter lors d’une visite planifiée d’un membre de notre personnel sur votre entreprise :
La veille : si vous avez épandu des pesticides (insecticides, fongicides ou herbicides) dans vos champs récemment, aviser notre ressource de tous les traitements effectués dans les trois jours précédant la date prévue de sa visite. Ainsi, la visite pourra être remise dans le cas où le délai avant l’entrée au champ ne pourrait pas être respecté.
La journée de la visite : assurez-vous de ne pas épandre de pesticides dans les champs à proximité des champs visités par notre ressource, car le risque de dérive est toujours présent.
Ne soyez pas surpris si notre employé porte des gants, un masque ou un vêtement Tyvex selon les tâches réalisées. Ce n’est pas un extraterrestre, mais une personne responsable avec des protections pour préserver leur santé. �� Notre personnel est en contact régulier avec ce risque et nous ne ménageons aucun effort ou équipement pour les protéger.
Si vous prêtez un moyen de transport à la ressource : assurez-vous qu’il y ait du carburant en quantité suffisante pour la durée de la visite et qu’il est en bon état de fonctionnement SVP !
Si vous n’effectuez pas la visite avec notre ressource, assurez-vous que celle-ci a bien quitté votre entreprise en fin de journée. Si le véhicule de la personne est toujours chez vous au-delà de l'heure prévue de son départ, communiquez immédiatement avec elle pour vous assurer de sa sécurité.
Si elle ne répond pas à votre appel, rendez-vous sur place pour vérifier que tout va bien.
Si nécessaire, appelez M. Denis Larouche, directeur général du GMA, au 418-818-1469 afin qu'il puisse prendre les décisions appropriées pour assurer la sécurité de cette personne.
Enfin, si notre ressource a un doute pour sa sécurité (odeur, risque de dérive, trace importante de pesticide récent, etc.), celle-ci n’effectuera pas le suivi de vos champs et, en cas de non-respect de ces règles, le temps de déplacement vous sera facturé. Vous recevrez également un avis écrit par courriel pour vous informer de la raison de son retrait de vos champs. En cas de récidive, la direction générale du GMA se réserve la possibilité d’interdire ce service auprès de votre entreprise.
La protection et la santé de notre personnel sont au cœur de nos préoccupations et nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur votre professionnalisme pour atteindre ce même but !
Ann-Sophie Lavoie
Administratrice
Bonjour chers membres du GMA,
Je me présente, Ann-Sophie, et je me joins aux membres du Conseil d’Administration du GMA en tant que nouvelle administratrice. Il me fait grand plaisir de pouvoir m’y impliquer.
Je ne suis pas propriétaire d’une entreprise agricole, mais je travaille à temps plein à la Ferme Lavoie à Chicoutimi depuis 2020. Durant mes études, j’ai essayé de toucher un peu à tout, question d’ouvrir mes horizons. J’ai été auxiliaire de recherche au Laboratoire d’agroécologie de l’Université Laval puis j’ai essayé le service-conseil en production maraîchère. Finalement, je suis revenue à la Ferme Lavoie où j’avais fait mon stage de première année d’agronomie en 2017. Rien ne m’avait autant stimulée mentalement et physiquement que cette expérience à la ferme.
Je trouve la diversité des tâches et des compétences très stimulante. Un instant, je peux être en train de faire une évaluation de la levée des semis au champ, l’autre en train de faire de la gestion de médias sociaux, de sarcler de la gourgane, de calculer des coûts de production, de déplacer des vaches au pâturage ou encore être dans un congélateur à -20 °C pour gérer l’inventaire de viande pour la mise en marché à notre kiosque à la ferme.
En occupant le rôle d’administratrice pour les prochaines années, j’espère pouvoir contribuer à notre milieu grâce à mes intérêts et à mes connaissances en agriculture biologique et de mise en marché de proximité.
Au plaisir de vous rencontrer !
Ann-Sophie
Justine Boivin-Côté Présidente
Comité Ressources humaines justine@boulangeriemedard.com
Nicolas Blackburn Vice-président
Comité Ressources humaines nicolas@fromagerieblackburn.com
Étienne Savard Administrateur
Comité Vérifications et Finances e.savard05@outlook.com
Timmy Gauthier Trésorier
Comité Vérifications et Finances
timgau07@gmail.com
Jade Girard Secrétaire
Comité Éthique et Gouvernance jadegirard1026@outlook.com
Ann-Sophie Lavoie Administratrice annsophie30@gmail.com
Thomas Csisztu
Candidat à la profession d’ingénieur
Bonjour à toutes et à tous,
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le GMA comme candidat à la profession d'ingénieur. Originaire de la région d'Ottawa en Ontario, j'ai complété mes études en génie agricole à l'université McGill, à Montréal, en 2022. Après deux ans de travail en ville, suivies d'un an de voyage et de découvertes en Nouvelle-Zélande, j'ai maintenant la chance de m'établir dans la magnifique région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
J'ai très hâte de collaborer avec les producteurs, les professionnels et tous les membres du GMA, d'apprendre avec vous et d'apporter ma contribution au secteur agricole de la région.
En dehors du travail, je suis passionné de plein air et on peut souvent me retrouver en randonnée, en camping, ou simplement en train de courir dans les rues d'Alma !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
MERCIànos MERCIànos généreuxpartenaires!!généreuxpartenaires!!
Rappeldesdates
d’inscription auxPGBAgrisolutionsclimat
Vous n’avez pas encore fait votre inscription aux Pratiques de gestion bénéfique (PGB) avec Agrisolutions ?
C’est le moment de le faire !
PGB 1 – Réduire les apports d’engrais minéraux azotés totaux pour l’ensemble d’une culture.
PGB 2 – Réduire les apports d’engrais minéraux azotés totaux suivant une culture de couverture.
PGB 3 – Remplacer les fertilisants minéraux azotés par une première utilisation d’amendement organique à l’échelle de l’entreprise
PGB 5 – Introduire une nouvelle culture principale dans la rotation qui permet la réduction des besoins d’azote de l’entreprise
PGB 6 – Culture de couverture avec légumineuse - secteur horticole et aux grandes cultures.
PGB 9 – Cultures de couverture – secteur des grandes cultures
Pour plus de détails sur les conditions de participation :
Agrisolutions climat – UPA
��Date d’inscription : 9 juin au 30 septembre 2025
��Contactez votre conseiller dès maintenant si vous avez un intérêt !
L’équipe Agro
Recouriràdestravailleursétrangerstemporaires(TET)
FermEmploi est un programme qui vise à soutenir les producteurs agricoles dans l’accueil et la formation de nouveaux employés par une aide financière. En cette période où vous accueillez de nombreux employés étudiants, on pense particulièrement aux producteurs maraîchers et serricoles, le programme peut être intéressant pour vous.
Il permet notamment :
Aider les nouveaux travailleurs à acquérir des compétences liées au métier;
Offrir des outils pour mieux encadrer et accompagner les employés; Favoriser la stabilité de l’équipe de travail.
Le programme propose :
Une aide financière couvrant 50 % du salaire pendant 24 semaines;
Un carnet pour suivre l’intégration en emploi; Jusqu’à 60 heures d’accompagnement gratuit avec un conseiller en ressources humaines.
Pour que le travailleur soit admissible, il doit :
Avoir 16 ans ou plus;
Avoir peu ou pas de formation ou d’expérience dans le domaine visé.
Pour que l’employeur soit admissible, il doit :
Être prêt à accueillir et former un nouvel employé selon les modalités du programme; Avoir besoin d’un coup de main pour le recrutement, la formation ou l’intégration; Offrir un emploi permanent ou saisonnier récurrent, à temps plein ou à temps partiel (minimum 20 heures par semaine).
Le programme est également accessible à d’autres productions. Informez-vous auprès de l’équipe du Centre d'emploi agricole du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Pour plus d’information :
Centre d'emploi agricole du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Stéphane St-Pierre ou Jessica Ruelland Téléphone : 418 542-5666
Alexandra Gagnon Conseillère en gestion
GESTION
L’évolution du montant de la prime du lait biologique en lien avec le volume de lait livré entre 2019 à aujourd’hui
Sources:
Le graphique ci-dessus illustre l’évolution du volume de lait biologique livré (en litres) et du montant de la prime biologique ($/hl) entre janvier 2019 et février 2025, à partir des données disponibles sur le site des Producteurs de lait du Québec. Deux tendances opposées s’en dégagent: une hausse progressive du volume de lait livré et une diminution graduelle de la prime versée aux producteurs. Les lignes pointillées représentent les tendances linéaires des deux variables, prolongeant leur trajectoire possible jusqu’en décembre 2026, selon l’hypothèse que les conditions actuelles se maintiennent et que les tendances démontrées dans le graphique ci-dessus se poursuivent.
La prime biologique est ajustée régulièrement par les producteurs de lait du Québec (PLQ) et les variations sont en partie dues à l’équilibre entre l’offre et la demande en lait biologique. La présence d’une liste d’attente pour les nouveaux producteurs certifiés biologiques justifie la volonté du système en place pour maintenir un équilibre en évitant la surproduction. Cela n’empêche toutefois pas un engorgement dans la liste d’attente, où désormais les producteurs se retrouvant sur celle-ci ont droit à une portion de la prime biologique.
Graphique A. Évolution du volume de lait biologique livré (L) et de la prime ($/hl) sur des données mensuelles de 2019 à 2024 avec projection linéaire jusqu’en 2026.
Producteurs de lait du Québec
Comme illustré dans l’histogramme B, l’écart entre l’offre et la demande est bien réel et semble avoir beaucoup augmenté depuis 2019. Ce paradoxe nous permet donc de valider l’intérêt d’une liste d’attente, mais également de comprendre pourquoi la prime biologique a une tendance à la baisse.
Plusieurs facteurs peuvent exercer une influence sur l’évolution de ces deux indicateurs. Du côté du volume, la tendance à la hausse pourrait s’expliquer par une augmentation du nombre de fermes laitières certifiées biologiques, ainsi que par un accroissement de la production moyenne par ferme.
En ce qui concerne la prime, une hypothèse est que la croissance de l’offre en lait biologique pourrait excéder celle de la demande des consommateurs, exerçant ainsi une pression à la baisse sur la prime versée. Une prime réduite pourrait par ailleurs contribuer à rendre les produits biologiques plus accessibles, ce qui pourrait avoir un effet favorable sur la demande et donc accélérer la réduction du nombre de fermes dans la liste d’attente. Mais encore, même si la courbe de croissance de la demande en lait biologique n’est pas identique à celle du lait conventionnel, les producteurs biologiques et conventionnels ont le droit d’avoir les mêmes émissions de quota par la fédération des producteurs de lait, qui sont illustrés dans l’histogramme ci-dessous. De plus, la formule d’achat mensuelle de quota est la même pour les deux types de production.
Une autre hypothèse envisageable repose sur le contexte économique postpandémique. À la suite de la vague inflationniste des dernières années, les consommateurs consacrent une plus grande part de leur revenu à l’alimentation. Dans ce contexte, le prix devient un facteur plus déterminant dans les décisions d’achat, ce qui pourrait influencer la demande pour des produits à valeur ajoutée comme les produits biologiques.
Histogramme B: L’écart entre la production de lait biologique et les besoins du marchés québécois entre 2019 et 2024.
Histogramme B : Total des émissions de quota au fil des années depuis 2019 à 2024.
Source : Rapports annuels des producteurs de lait du Québec
En résumé, l’évolution simultanée du volume de lait biologique livré et du montant de la prime soulève des questionnements économiques pour les années à venir. Le secteur serat-il en mesure de maintenir un équilibre entre croissance de la production, sécurité des marchés et rentabilité pour les producteurs biologiques ? Les prochaines années permettront d’évaluer dans quelle mesure les mécanismes en place auront un impact sur les tendances et s’ils sauront répondre aux besoins de l’ensemble de la filière.
MERCIànos MERCIànos généreuxpartenaires!!généreuxpartenaires!!
Samuel Dulac Conseiller en Agroenvironnement
Repenser la matière organique : une révolution silencieuse dans nos champs
Pourquoilamatièreorganiqueest-ellesiimportante?
La matière organique du sol joue un rôle fondamental dans la santé et la fertilité des terres agricoles. Pourtant, sa compréhension reste incomplète, même aujourd’hui. Bien qu’on puisse croire qu’il s’agit d’un concept simple, la matière organique est en réalité complexe, et les théories qui la décrivent sont en constante évolution. Ces avancées scientifiques transforment notre façon de penser et de travailler dans les champs.
Comprendre la matière organique est crucial, car elle est souvent utilisée comme indicateur clé de la santé des sols. Elle influence les propriétés physiques (comme la structure et la rétention d’eau), chimiques (capacité d’échange cationique, disponibilité des nutriments) et biologiques (activité microbienne, biodiversité) du sol. Sa présence et sa qualité conditionnent donc la productivité à long terme des systèmes agricoles.
Lesconceptsconventionnelsdelamatièreorganique
Pendant plusieurs décennies, le consensus scientifique était que la stabilité de la matière organique du sol reposait sur la complexité chimique de certaines de ses composantes. On assumait donc que la structure chimique complexe de la matière organique formée par humification était le principal mécanisme limitant sa dégradation et qu’elle assurait la stabilisation dans le sol sur le long terme.
Cette fraction se divisait en trois types de composés : les humines, les acides humiques et les acides fulviques. Ces substances étaient considérées comme résistantes à la décomposition microbienne et capables de persister dans le sol durablement.
Cette vision a exercé une influence majeure sur les pratiques agricoles. Par exemple, le carbone disponible dans les molécules organiques complexes comme la lignine se stabilisait plus rapidement dans le sol grâce à sa capacité intrinsèque biochimique à résister à la dégradation par les micro-organismes. Ainsi, plus les composés amenés au champ étaient résistants à la dégradation des micro-organismes, plus ils devaient contribuer à l’augmentation de la matière organique stable dans le sol.
Un changement de paradigme : l’importance de la protection physique et des micro-organismes
Les recherches des dernières décennies ont conduit à un changement de paradigme : la stabilité du carbone dans le sol est désormais davantage attribuée à sa protection physique qu'à sa récalcitrance biochimique. Un élément clé de ce paradigme est l’efficacité d’utilisation des substrats organiques par les micro-organismes et souligne l’importance des interactions entre les matières organiques et les constituants minéraux du sol, ainsi que le rôle central des microorganismes dans la formation de la matière organique stable. Cotrufo et al (2013), ont séparé la matière organique selon la taille des particules ainsi que leur densité en deux catégories :
• La matière organique particulaire (POM)
Il s'agit de la fraction la plus volumineuse de la matière organique ((POM; >50-63 μm). Elle est principalement composée de matière organique fraiche, encore peu transformée, et se décompose et répond plus rapidement aux changements de pratiques culturales. Son temps de résidence dans le sol est généralement court.
La stabilité de la POM dépend en grande partie de son intégration dans les agrégats du sol, ce qui la protège temporairement de la décomposition. Cette stabilisation est assurée par des agents de stabilisation organiques temporaires et transitoires, tels que les racines, les hyphes fongiques et les polysaccharides produits par les micro-organismes.
• La matière organique fine (FOM)
Issue de résidus de la dégradation microbienne, la FOM est constituée de particules très petites (< 50 à 63 µm). Cette fraction est plus stable, car elle peut se lier fortement aux particules minérales du sol, notamment par des interactions chimiques avec les surfaces minérales réactives (argiles, oxydes de fer et d’aluminium).
La FOM est souvent enrichie en azote et forme des complexes organo-minéraux durables, ce qui lui confère un temps de résidence élevé dans le sol. Ainsi, une augmentation de la FOM se traduit par un stockage du carbone à long terme.
Implications pour les pratiques agricoles
Cette nouvelle compréhension de la formation et de la stabilisation de la matière organique peut favoriser deux pratiques pour les producteurs agricoles (Samson et al, 2021) :
1) Réduction du travail du sol : Le travail intensif du sol peut perturber les agrégats et exposer la matière organique à la décomposition. Des pratiques comme le semis direct ou le travail réduit du sol peuvent aider à préserver la matière organique tout en permettant une biomasse microbienne plus élevée dans le sol.
2) Apports réguliers de matière organique : Il est bénéfique d’apporter régulièrement de la matière organique fraîche pour nourrir les micro-organismes et favoriser la formation de matière organique avec une augmentation des cultures de couvertures dans le temps et l’espace (cultures intercalaires, couvertures), en laissant les résidus de cultures au champ et en apportant des engrais organiques comme les engrais de ferme.
Conclusion : vers une gestion durable des sols
La matière organique du sol est au cœur de la santé des sols, de la productivité agricole et de la lutte contre les changements climatiques. Notre compréhension de sa formation et de sa stabilisation a profondément évolué, passant d’une vision centrée sur la complexité chimique à une approche intégrant la microbiologie et la physique du sol. Plusieurs études doivent encore être effectuées afin de bien comprendre l’impact de nos pratiques agricoles sur les nouvelles fractions.
Pour les agriculteurs et les gestionnaires de terres, cela signifie adopter des pratiques qui favorisent la vie microbienne, qui protègent la structure du sol et assurent des apports réguliers de matière organique. En faisant cela, nous pouvons construire des sols plus sains, plus fertiles et plus résilients pour les générations futures.
Christine Gagnon Agronome
Corriger son pHe, une opération toujours nécessaire !
Ayant écrit sur le sujet il y a quelques années, je sens le besoin de m’adresser à une nouvelle génération de lecteurs ou de faire un rappel pour certains d’entre vous. Durant l’hiver, j’ai été consultée à plusieurs reprises, comme conseillère en agroenvironnement, par ma clientèle ayant des pâturages. Les fermes que je desserre étant majoritairement situées dans le Haut-du-Lac, je vois fréquemment des sols ayant un pHe inférieur à 6,0. J’ai donc tenté de sensibiliser les gens autour de la table sur les conditions plus acides que pouvait avoir les terres de ce secteur et d’autant plus les producteurs qui ont des pâturages. Les questionnements m’ont amenée à revoir les recherches et elles m’ont rappelé que les bienfaits d’un bon pHe étaient fortement connus et que la correction du pH devrait être une priorité pour tous les producteurs dont le besoin est mesuré.
D’abord, je tiens à préciser que les sols du Haut-du-Lac sont non-calcaires, de par leur origine, et qu’au départ, une argile Normandin nécessite un besoin en chaux plus élevée qu’une argile de Chicoutimi, c’est dans la nature des sols. J’en conclus que le plan de chaulage pour les agriculteurs devrait faire l’objet d’une surveillance annuelle par une prise d’analyses de sol régulière et par l’établissement des priorités de chaulage avec votre agronome au même titre que l’on planifie la fertilisation.
Comme l’échelle de mesure de pH est logarithmique, un pH de 5.7 est 6.25 plus acide qu’un pH de 6.5, cela demande donc beaucoup d’effort pour le corriger. Afin de mieux comprendre l’acidité, voici quelques notions à se rappeler :
Les facteurs qui causent l’acidification des champs sont : l’eau de pluie, les minéraux du sol, l’activité biologique et les engrais ammoniacaux acidifiants. Par exemple, l’acidité causée par l’activité biologique fait que la chaux appliquée sur un vieux pâturage cause une réduction possible du pH dans les 6 premiers mois et une augmentation par la suite pour observer un effet maximal 12 à 18 mois suivant l’application.
Pour ce qui est des engrais minéraux, le niveau d’impact dépend du type d’engrais. Par exemple, il faut 2.5 t. de chaux pour neutraliser l’effet acidifiant de 1.0 t de 46-0-0, alors qu’il faut 7.6 t de chaux pour neutraliser l’effet acidifiant de 1.0 t de 18-46-0 ou de 21-0-0-24S. La tendance à mettre un engrais avec du soufre devrait donc être questionnée pour certains champs considérés acides et dont le besoin des plantes en soufre n’est pas démontré.
Chaque culture a un intervalle de pH adéquat connu. Cet intervalle signifie que le potentiel agronomique de la culture n’est pas limité par le pH. Voici quelques exemples de variation pour les plantes fourragères, mais cela s’applique également à toutes les cultures comme les cultures annuelles et autres.
Il est donc important de corriger vos pHe en étape si vos sols ne correspondent pas au pHe optimal. Considérant que le pHe de 5.5 est le pHe critique en sols minéraux (les sols organiques ont une autre échelle). Chauler pour viser un pHe cible minimal de 5.5 est la première étape pour éviter un surchaulage. Ensuite, on vise un pHe de 6.0 qui est un pH intermédiaire. Pour ma part, je pense qu’on peut viser par la suite 6.2 afin d’établir les priorités raisonnablement afin de répartir les achats et ensuite si on vise un pHe cible de 6.5, pour obtenir un pH situé au centre de l’intervalle adéquat pour plusieurs cultures. Selon des études, le gain peut être plus marginal à partir de 6.0 et il varie en fonction de l’espèce. Par exemple, l’augmentation de rendement pour la luzerne sera plus importante avec une augmentation de pH entre 6.2 et 7.4 que pour le trèfle rouge.
Il existe plusieurs facteurs à considérer pour votre plan de chaulage comme le type de sol, la teneur en matière organique, la CEC, le type d’amendement, les modalités d’application et les impacts dans le temps. Mais sachez que les bénéfices sont importants comme les impacts sur la structure de sol, la réduction de la toxicité de l’aluminium, la stimulation de la vie microbienne et l’activité des vers de terre, l’augmentation de la disponibilité du phosphore et de l’azote, ainsi que l’amélioration de la fixation atmosphérique des légumineuses. Bref, malgré toutes les améliorations agronomiques de pointes qui vous sont offertes, le chaulage est une notion de base en agriculture qu’il faut toujours prioriser !
Sources: -Vincent Poirier. Les sols/-propriété chimiques. Cours Les pâturages en production animales, Université du QuébecenAbitibi-Témiscamingue,2018. -Gilles Bélanger, Annie Classens, Marie-Noëlle Thivierge et Gaëtan Tremblay (Éditeurs scientifiques). 2022. Guide de production-Plantes fourragère. 2 édition. Volume 1. Centre de référence en agriculture et agroalimentaireduQuébec.273p.ISBN978-2-7649-0636-1. ième
Christine Gagnon Agronome
Les plantes fourragères; précisions pour optimiser le rendement.
En mars dernier, le MAPAQ a diffusé un webinaire sur la productivité des plantes fourragères qui m’a beaucoup interpellée. La première conférence donnée par Julie Lajeunesse, chercheuse à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), et intitulée «Du semis à la gestion des coupes : comment optimiser le rendement» m’a accrochée sur certains détails que j’aimerais vous partager afin d'améliorer vos productions de prairies ou de pâturages.
D’abord, il est maintenant connu que les plantes abri sélectionnées pour une implantation de plantes fourragères doivent être hâtives et pouvoir se battre debout. Les deux principaux objectifs sont les suivants ;
Faire de la lumière tôt pour les petites plantes qui sont sous la céréale
Éviter l’effet de paillis causé par les andains, qui affectent la productivité du couvert.
On doit choisir également des semences dont les périodes de coupes sont synchronisées.
Les graminées du mélange fourrager apportent des sucres solubles qui améliorent l’utilisation de la protéine avec la légumineuse. Il est donc important d’en avoir une certaine proportion également pour cet aspect. Cela est sans compter les avantages sur la biomasse et le sol dont Marie-Noëlle Thivierge, également chercheuse à AAC, nous a fait part dans un précédent article.
Pour ce qui est de l’ajout de soufre, on constate une bonne augmentation de rendement pour les légumineuses dont une carence en soufre est démontrée avec des analyses foliaires. Le soufre permet au rhizobium (bactéries qui se trouvent sur les racines) de mieux fixer l’azote atmosphérique. On constate aussi un impact sur la quantité de protéines et sur le regain. Le marché des engrais offre des sources de soufre avec de l’azote ou avec du potassium. Dans l’étude menée de 2019 à 2022 à Normandin, on constate une augmentation de rendement significative avec l’ajout de soufre par rapport au témoin sans soufre, mais on ne constate pas de différence significative sur le rendement entre les types d’engrais soufrés. Par contre, lorsque le soufre est avec de l’azote, on constate une plus grande proportion de graminées dans la récolte que si c’est du potassium où la légumineuse est plus élevée à ce moment. Un apport de 28 kg/ha de soufre est suffisant lorsqu’une application est justifiée.
Mme Lajeunesse a aussi discuté de la question des stades de coupe des prairies. Cela peut répondre à certaines interrogations que j’ai eues durant la dernière année concernant la gestion de coupes avec la possibilité de faire 4 coupes dans la région, suite aux changements climatiques. On peut voir d’abord les divers résultats de rendement et de valeur nutritive dans la figure ci-bas selon le moment de coupe.
Dans un cas de sécheresse où la plante épie rapidement, il vaut mieux couper la plante plus vite, car il y a une chute de qualité observée.
Ensuite, les résultats d’une autre étude menée par AAC dans deux stations de recherche montrent une diminution de rendement global avec des intervalles de coupe plus courts. La figure ci-bas montre l’impact sur le rendement :
Les résultats présentés par la chercheuse poussent l’expérience jusqu’au calcul de l’impact sur la production de lait pour la période de 4 ans. Malgré une meilleure valeur nutritive du fourrage fauché sur un court intervalle, on estime une diminution de la production laitière en kg/ha, car le rendement global est moindre malgré l’augmentation des unités nutritives totales (UNT).
Lors de cette webconférence, Mme Lajeunesse nous a présenté beaucoup d’outils comme l’arbre décisionnel pour l’évaluation des prairies au printemps ainsi que des outils de gestion de coupe, comme le site Agrométéo Québec, très utile pour estimer l’indice d’assèchement par localité. Il a aussi été question de l’accroissement du niveau de risque de pertes à la fauche automnale.
Je vous invite à visionner ce webinaire qui contient deux autres présentations très intéressantes.
Christine
Émy McRea Conseillère en agroenvironnement
Comprendre la hernie des crucifères : une menace croissante pour vos cultures de canola
La hernie des crucifères est une maladie qui gagne du terrain dans plusieurs régions productrices de canola. Pourtant, bien des producteurs ne la connaissent pas ou la sous-estiment. Discrète au départ, cette maladie peut entraîner des pertes de rendement importantes et compromettre la rentabilité à long terme d’un champ. Voici ce que vous devez savoir pour la reconnaître, la comprendre et surtout, l’éviter.
La hernie des crucifères, c’est quoi exactement ?
La hernie des crucifères est une maladie causée par un organisme microscopique du sol : Plasmodiophora brassicae. C’est un champignon qui s’attaque aux racines des plantes de la famille des crucifères (ou brassicacées), comme le canola, le chou ou la moutarde. Une fois installé sur la plante-hôte, les racines malades relâchent des spores qui s’installent dans le sol. Ces spores installés dans le sol, peuvent y survivre plus de 18 ans, même en l’absence de culturehôte. C’est ce qui rend la hernie si difficile à éliminer une fois présente.
Comment la maladie se propage-t-elle?
Le parasite se propage surtout par le sol contaminé, transporté par :
La machinerie agricole (particulièrement lorsqu’elle n’est pas nettoyée entre les champs)
L’eau de ruissellement
Les bottes, les animaux, le vent
Un champ peut devenir contaminé sans qu’on s’en rende compte, et le parasite peut ensuite se répandre rapidement.
Quels sont les symptômes
?
Les symptômes apparaissent surtout au niveau des racines ; Les symptômes sur la partie aérienne de la plante apparaissent lorsque la maladie a considérablement progressée au niveau des racines.
Formation de galles (grosses déformations) sur les racines principales.
Les plantes affectées sont souvent rabougries, jaunies et flétries, surtout par temps chaud.
Le champ peut montrer des zones en plaques, où les plantes semblent moins vigoureuses.
À l’œil nu, la culture semble manquer d’eau ou de nutriments ; ce qui rend le diagnostic trompeur si on ne vérifie pas les racines. Attention, il existe des cultivars résistants/tolérants. Ceux-ci ne présentent pas de symptômes, bien que la maladie soit présente dans le sol.
Commentprévenirlaherniedescrucifères?
Voici plusieurs stratégiespourprévenirouralentir l’apparition de la maladie :
Allonger la rotation de cultures ; Évitez de semer du canola (ou une autre crucifère) plus souvent qu’aux 4 ans. Le parasite a besoin d’une culture-hôte pour se reproduire. Un bon intervalle permet de diminuer sa population dans le sol.
Améliorer le chaulage et le drainage; Un sol acide et humide favorise le développement de la maladie. Un pH au dessus de 7 tant à inhiber la germination des spores. Corriger le pH du sol constitue le moyen le plus efficace et le plus stable sous nos conditions de culture des crucifères.
Surveiller régulièrement les champs ; Inspectez vos cultures, en particulier si vous remarquez des et examinez les racines. Une détection précoce change tout.
Nettoyer la machinerie ; Prenez l’habitude de laver l’équipement (roues, châssis, etc.) entre les champs, pour enlever toute la terre. Idéalement, désinfectez les équipements avec un produit efficace comme le spray nine.
Contrôler les mauvaises herbes ; Faire le contrôle des mauvaises herbes de la famille des crucifères, qui peuvent également être porteuses. Ex: bourse à pasteur, moutarde, radis sauvage, tabouret des champs...)
La hernie des crucifères est une maladie sérieuse mais évitable, à condition de bien la connaître. En adoptant des pratiques préventives dès maintenant, vous protégez vos champs et vos rendements pour les années à venir. Ne laissez pas ce parasite s’installer chez vous ; mieux vaut prévenir que guérir.
Les
anges du blé arrivent au Lac !
La culture du blé d’automne connaît un essor remarquable dans certaines régions périphériques du Québec, notamment au Lac-Saint-Jean. Traditionnellement, la majorité des producteurs québécois privilégiaient la culture du blé de printemps, mais ces dernières années, le blé d’automne s’est imposé comme une alternative viable, offrant plusieurs avantages pour les agriculteurs de cette région; couverture du sol pendant l’hiver, captage de l’eau au printemps, rendement supérieur au blé de printemps, récolte hâtive permettant le semis d’un engrais vert l’automne et diminution de la facture d’engrais pour les cultures subséquentes.
Le Lac-Saint-Jean, avec ses conditions climatiques particulières, a vu émerger plusieurs réussites dans la culture du blé d’automne. La réussite vient en partie du changement climatique. Pour une bonne survie à l’hiver, on doit semer assez tôt pour accumuler 375 degrés-jours (DJ) afin de faire taller le blé et idéalement 540 DJ pour un rendement optimal.
Qu’est-ce que les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance sont une unité de mesure utilisée pour évaluer l'accumulation de chaleur sur une période donnée. Il s’agit simplement d’une façon alternative de suivre l’évolution d’une culture.
Quel est l’avantage d’utiliser les degrés-jours de croissance ?
Souvent, les producteurs calculent un certain laps de temps qui doit s’écouler pour que la culture passe au stade suivant de son développement physiologique. Cependant, la vitesse de croissance de la culture dépend fortement de la chaleur. Ainsi, cette façon de faire est incomplète puisqu’elle omet d’inclure la chaleur dans l’équation.
Quelle est la formule pour calculer les degrés-jours de croissance ?
La formule est la suivante :
Dans laquelle :
T est la température maximale atteinte dans la journée. Max
T est la température minimale atteinte dans la journée. Min
T est le seuil utilisé sous lequel la croissance est négligeable. Base
Quel est le seuil de croissance du blé (T ) ? Base
Le seuil de croissance du blé généralement utilisé est de 0 °C. Cette valeur dépend du type de blé et de la variété. La majorité des variétés canadiennes de blé tolèrent bien des températures s’étalant de -2 °C à 30 °C avec des conditions optimales de croissance de 15-20 °C.
Quels sont les degrés-jours de croissance nécessaires pour atteindre chaque stade physiologiquemajeurdudéveloppementdublé?
Le type et la variété du blé ont une grande influence sur les degrés-jours nécessaires pour chaque stade de développement. Le tableau ci-dessous présente les DJ nécessaires selon le stade de croissance du blé.
Pour vous assurer d’une expertise en région, en 2024, Marie-Hélène Côté, agronome au GMA devient ce que j’appelle une ``Wheat Angel`` ou Ange du blé pour le secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle bénéficie d’un mentorat avec un projet initié par Concertation grain Québec (CGQ) qui vise la formation d’un réseau d’expertise en blé de consommation au Québec. Marie-Hélène a formé, à l'automne 2024, une cohorte axée sur la production de blé (de printemps et d'automne). Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec le GMA.
Elisabeth Vachon, Coordonnatrice de l’agriculture raisonnée pour Les Moulins de Soulanges.
Évolution du prix net du lait
Prix payé aux producteurs selon la moyenne mensuelle des composantes provinciales
Le mois de mai 2025 constitue le premier mois depuis octobre 2023 où le prix net du lait est nettement inférieur au même mois de l’année précédente. Il s’agit d’une baisse de 2,93 $/hl sur prix d’avril 2025. De plus, la baisse provient de la diminution globale des composantes laitière dans une proportion de seulement 31 % (-0,94 $/hl). Les PLQ expliquent cette baisse par les transferts interprovinciaux pour la mise en commun, ainsi que des corrections liées aux ventes des mois antérieurs. Une partie des facteurs explicatifsnedevraientêtrequeponctuels.Onpeutdoncespérerquecettetendancebaissièresecorrige même si les prix des prochains mois devraient se situer sous la moyenne annuelle avec les mois d’été affectantlescomposanteslaitières.
Le point sur les taux d’intérêt
Pour une 2 fois de suite (il y a annonce par la BDC tous les 2 mois) la Banque du Canada a décidé de laisser son taux directeur inchangé en juin après 7 baisses consécutives. C’est l’incertitude actuelle sur l’évolution de l’activité économique et de l’inflation qui a guidéladécisiondelaBDC.Onpeut
tout de même s’attendre à d’autres baisses de taux dans les prochains mois. La prochaine annonce sera dévoiléele30juilletprochain.
Prix offerts aux producteurs du Québec pour la récolte 2024 selon la période de livraison
* Estimation du prix reçu à la ferme lors des ventes de mai
Source: SRDI des PGQ, 16 juin 2025.
On se situe dans les mois précédents la nouvelle récolte qui justifie bien souvent l’entreposage des grains. C’est ce qu’on peut observer dans ce tableau où les prix sont supérieurs à la période précédente pour la plupart des céréales. De plus, les prix affichés pour livraison à la prochaine récolte sont inférieurs auxprixactuels.
Transactions au SCVQ
La dernière vente de quota a été très décevante pour les acheteurs et s’explique par la très faible quantité offerte en vente à laquelle s’ajoute la plus grande quantité offerte en achat de l’histoire. L’offre de vente provient d’un des plus faibles nombres de producteurs des six dernières années (19) alors qu’on a déjà observé un plus grand nombre de producteurs acheteurs dans le passé (1983 acheteurs en mars 2022 vs 1887 ce mois-ci), mais pour une offre beaucoup plus basse par producteur. Avec l’augmentation considérable d’offres d’achat dans les derniers mois, nous avions prévu que le pourcentage comblé aurait tendance à diminuer et c’est ce qui est en train de se passer. En 2024, un producteur de 70 kg/jour misant chaque mois a pu acheter 4,1 kg/jour alors que si l’on se base sur les ventes des 6 premiers mois de 2025, un producteur de la même taille ne pourra plus acheter que 2,6kg/jouren2025.
Pierre
Produitslocauxofferts Produitslocauxofferts parnosmembres parnosmembres
Producteur de farine et légumineuses
Producteur de viande
Laiterie
Grossiste fruitier
Produitslocauxofferts Produitslocauxofferts parnosmembres parnosmembres
Fromagerie
Légumes et petits fruits
Grossiste fruitier
membreVousêtestransformateuret n’apparaîtduGMAetvotrelogo passurcespages? Pourfaireajoutervotrelogo, communiquezavecl’équipedu journal!
(418)679-5661 poste 251 Marc (418)547-9191 poste 262 Alexandra