LES CHEMINS DE L’ENGAGEMENT
LES ARCHITECTES FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE
ELVIRE DUBOIS SOUS LA DIRECTION DE SABRINA BRESSON

LES ARCHITECTES FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE
ELVIRE DUBOIS SOUS LA DIRECTION DE SABRINA BRESSON
Prise d’un grand vertige en dernière année de licence, je me suis questionnée sur l’architecte que je souhaitais devenir car je ne me reconnaissais pas dans les pratiques architecturales qui m’étaient présentées Née dans une famille engagée où chacun exprime ses idées et développe son sens critique, très jeune j’ai pris conscience qu’il était important d’avoir des convictions sur les choses que l’on entreprennait Lors du stage obligatoire de licence, réalisé dans une grande agence parisienne en Juillet 2018, j’ai pris conscience que de nombreux acteurs entraient en jeu Ainsi, j’ai craint devoir toute ma vie, mettre de côté mes convictions environnementales et mes valeurs humaines dans le but de satisfaire un commanditaire, répondre à un marché et rentrer dans un système J’ai alors débuté l’écriture de mon rapport de licence : L’architecture comme forme de pouvoir, le pouvoir des architectes Ce rapport interrogeait les différents impacts que peut créer l’architecture, dans quelle mesure est ce une forme de pouvoir et si le rôle de l’architecte est politique Cette réflexion a nourri mon besoin de voir ce qu’il se passait ailleurs
J’entame alors une année de césure par un stage facultatif de 5 mois, au sein de l’agence TEZUKA Architects à Tokyo au Japon Immergée dans une culture différente et une réflexion architecturale engagée d’un point de vue social et sociétal, je me suis rendue compte de la complexité d’instaurer ces valeurs tout au long du processus de projet Par la suite, j’ai réalisé un stage de 3 mois en Thaïlande avec un groupe d’artistes, permaculture designer et autodidactes Nous devions concevoir et réaliser une résidence d’artistes Les enjeux étaient multiples, nous devions réussir à travailler en équipe et comprendre le langage de l’autre Au départ, déroutante, cette expérience est ensuite devenue très enrichissante Les mois qui suivirent furent consacrés à un long voyage en Asie du sud est, où j’ai décidé de partir à la rencontre des hommes et des femmes qui mènent des initiatives qui sortent du cadre et répondent aux enjeux actuels Aujourd’hui, ce projet est devenu une association loi 1901 qui s ’appelle Les Bâtisseurs Elle vise à libérer l’information autour de la construction écologique, démocratiser l’acte de
construire et donner de la visibilité à toutes les pratiques et initiatives différentes menées
Cette introspection entamée en licence, élémentaire, brute et presque naïve m ’ a mené à ce voyage tant physique qu’intellectuel Ce travail de mémoire est perçu comme la première étape d’une longue réflexion qui guidera mes choix de pratique architecturale
AVANT PROPOS
I. Crise économique : une profession qui s’appauvrit ? 11
I 1 Un contexte de décroissance 11
I 2 L’architecture, une profession de plus en plus réglementée 12 I 3 Création de nouveaux modèles économiques liés à l’écologie : l’exemple de l’économie sociale et solidaire 14
II.“Crise identitaire” : l’architecture, un métier en peine ? 17 II 1 Du métier d’architecte aux métiers de l’architecture 17 II 2 La fin de l’exercice en libéral 18
II 3 Médiatisation de l’architecture : être architecte, une nouvelle image de marque 20
III. Crise écologique : un tournant pour le métier d’architecte ? 22
III 1 Un moment de prise de conscience de l’urgence écologique : la fin de l’innocence 22 III 2 L’architecture durable : un nouveau marché réglementé 23 III 3 La logique de marché : un risque de “greenwashing” 25 III 4 L’architecture écologique : s’écarter de la pratique mainstream 26
I Présentation des collectifs
I 1 Archipel Zéro Frédéric Denise
2 ARTI/CHÔ Mathilde Héraut
I 3 Collectif LOKAL Aurélien Cantegrel
I 4 SCOP fair Ivan Fouquet
II Les collectifs et leur fonctionnement
1 Caractéristiques des collectifs
2 Une diversité de projets
Méthodologie
I. Des engagements, des histoires personnelles (cf : Biau) 48
I 1 L'école, premier lieu de sensibilisation 49
I 2 L'engagement étudiant, la réaction à un manque 50
I 3 L’insertion professionnelle, entre désillusions et espérances 52
I 4 Profession et convictions personnelles, une reconversion militante 54
II. Valeurs et pratiques architecturales 55
II 1 Un positionnement plus ou moins revendiqué 55
II 2 Le double engagement vers des valeurs écologiques, un renouveau dans les manières de faire de la conception 57
III Des engagements mais aussi un marché 59
III 1 Des choix de statuts juridiques variés 59
III 2 Accès à la commande : introduction dans des marchés particuliers 63
III 3 Architectes VS les autres : la communication entre les acteurs du processus de projet 66
IV. Architectes et militants d’un monde meilleur ? (cf : Alain Guillheux) 69
IV 1 Être un architecte engagé : lorsque l’acte de construire devient un acte militant 69
IV 2 Une jeune génération d’architectes dépolitisées 71
V. A l’heure d’un renouveau architectural : quelles évolutions pour les pratiques ? 73
V 1 La transition écologique, la seule alternative 73
V 2 Une nouvelle génération d’architectes, “électrons libres” 76 CONCLUSION
REMERCIEMENTS
Annexe n° 1 : Grille d’entretien pour l’étude de cas 91
Annexe n° 2 : Tableau de croisement des données 94
Ce travail de mémoire se greffe dans une série de travaux qui s’intéresse à l’évolution de la profession d’architecte Simultanément, écrit pour une prise de responsabilité et enquêtes sur les incidences d’un positionnement militant dans le cadre de sa profession, il met en avant l’engagement de groupes d’architectes face à la crise écologique Il repose sur des valeurs environnementales et sociales Ces revendications se sont affirmées à la suite de l’ère industrielle, période correspondant à l'entrée vers une crise générale du secteur du bâtiment Cette situation s ’ 1est constamment aggravée au cours des dernières décennies, elle marque la conjonction de plusieurs facteurs : économiques, identitaires et environnementaux Face aux enjeux de notre époque, des associations de jeunes architectes défendent une démarche de projet “frugale” Ces collectifs, initiés par des étudiants en fin d’étude ou des jeunes diplômés, défendent une nouvelle approche de la profession Ils s’implantent dans un territoire accordant une proximité avec les acteurs locaux, s ’associent avec d’autres professionnels et proposent une large diversité de formes d’actions à travers leurs projets Ils remettent en question la nécessité de bâtir et soutiennent la préservation de l’environnement et du vivant 2Ces engagements semblent révéler des pratiques architecturales qui participent à une prise de conscience de l’urgence climatique et bousculent les codes traditionnels du champ de l’architecture Serait ce la genèse d’une nouvelle manière d’exercer le métier d’architecte ?
Cet écrit nous a mené à enquêter auprès d’architectes engagés Ce positionnement se traduit à tous les âges Étant en dernière année d’étude, j’ai pu constaté qu ’ une grande partie des personnes de ma génération se qualifiait d’engagées L’enquête réalisée à travers cette étude de cas fût donc l’occasion de mettre en perspective deux générations de professionnels Les jeunes collectifs exposés dans ce travail font partie des acteurs méconnus de 2BORNAREL A , GAUZIN MULLER D , MADEC P (2018), “Manifeste pour une frugalité heureuse et créative” Manifeste pour une frugalité heureuse (frugalite org)
1 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
la production architecturale du fait notamment d’une entrée récente sur le marché et de leur posture critique vis à vis de la profession (Macaire, 2015)
Quant aux agences plus anciennes, elles se sont faites connaître en raison de leur marginalité et ont développé un réseau particulier Nous allons essayer de comprendre ce qu’implique ces démarches dont l’éthique professionnelle se présente de façon singulière
La problématique s ’est constituée à travers une hypothèse principale : l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels engagés développant des pratiques architecturales particulières face à l’urgence climatique et aux crises sociales qu ’elle engendrera Nous nous intéressons donc aux processus d’engagements des architectes qui agissent aujourd’hui en faveur d’un renouveau architectural Ce mémoire s ’articule autour de deux problématiques principales, il vise à comprendre comment se projette la jeune génération et à connaître les effets de l’engagement des architectes sur leurs pratiques architecturales et leur exercice du métier Dans ce contexte, notre travail s’intéressera aux structures, coopérations et démarches apparues à la suite des nombreuses alertes quant à la situation climatique Nous verrons les leviers qui ont guidé les architectes vers leurs engagements et s'ils induisent des rapports de travail différents dans la manière d’accéder à la commande et de produire de l’architecture Une architecture singulière est elle produite ? Quels liens se nouent, entre les architectes et la maîtrise d’œuvre, lorsque les convictions et le militantisme s ’ en mêlent ? Les architectes engagés transforment ils leur exercice en un acte militant ? Pouvons nous dire que ces engagements “ politisent” l’acte de construire ? Nous nous intéresserons également à la vision du métier d’architecte de la jeune génération
L’hypothèse générale de ce travail est que les convictions environnementales de l’architecte le conduisent vers l’expérimentation d’une architecture singulière, vers une évolution de ses pratiques et vers des choix de structure juridique particulière Cette hypothèse se décline en deux sous hypothèses : tout d’abord, certains architectes, sensibles aux enjeux écologiques, se positionnent dans sa profession pour correspondre à leurs valeurs mais aussi afin de rentrer dans un système de marché Ensuite,
l’engagement dans l’exercice de son métier transmute l’acte de construire des architectes en un acte militant
Ce mémoire est organisé en trois grandes parties : des données d’ordre générale sur l’évolution du métier des architectes dans un contexte de crises, la présentation des collectifs analysés et de la méthodologie adoptée et enfin une analyse des principes selon lesquelles les architectes illustrent leurs engagements
La situation économique du secteur du bâtiment a considérablement évolué depuis le début du XXe siècle Ces évolutions sont liées aux grands évènements historiques, écologiques et sociaux qui ont marqué ces dernières décennies Ces changements sont à l’origine de grands bouleversements dans le domaine de l’architecture L’accessibilité à la commande s ’est affaiblie au moment où l’implication de l’Etat s ’accroît et assujettit la profession à de nouvelles réglementations Ces normes sont imposées aux architectes et elles découlent du croisement de plusieurs évènements : le développement général de la construction, le changement des commandes et le fractionnement des marchés 3
Au XXe siècle, la situation économique du secteur du bâtiment est plutôt stable jusqu’aux années 20 C ’est un moment où le marché privé 4était prédominant dans la filière, les commandes, souvent de luxe, ont permis de générer une grande partie de la production architecturale du mouvement moderne en France Dans les décennies qui ont suivi, une diminution de la commande est observée en raison de la crise économique des années 30 et ce jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale (Peyceré, 2000) A l’approche de la libération, la France est en grande partie détruite et de nombreux conseils ont été mis en place pour définir les principes directeurs d’urbanisme qui guideront les bâtisseurs pour la reconstruction du pays (Pouvreau, 2004) L'immédiat après guerre est caractérisé par une forte croissance économique qui rayonne sur le niveau de vie de la population Les
3 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
4 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
Trente Glorieuses” voient de nombreux chantiers naître, cette période a été favorable pour les architectes dont les activités ont crû de 7 % par an 5
Bien que cette période corresponde à un moment prospère pour le secteur du bâtiment, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 marquent le commencement d’une crise économique généralisée qui touche aussi le secteur du bâtiment Ces fluctuations économiques s'accompagnent d'évolutions internes qui ne sont pas favorables aux acteurs du monde de la construction Parallèlement à ces évènements, le nombre d’architectes diplômés a considérablement augmenté Les effectifs sont passés de 14 500 en 1970 à 39 500 aujourd’hui Cette augmentation s ’explique par l’ouverture d’accès aux études supérieures, la suppression du numérus clausus et le baby boom En parallèle, la proportion des travaux réalisés par 6les architectes dans l’ensemble de la filière du bâtiment est passée de 38 % dans les années 70 à 26,3 % en 1982 Cette diminution fait écho à la baisse du volume global d’activité du secteur du bâtiment En 1985, celui ci finit par augmenter et le taux des travaux réalisés par les architectes croît pour atteindre 37 % Mais à partir de 1991 et pendant presque cinq années, l’activité de la filière diminue seulement de 2 % mais celle des architectes décroît de 15 % Cet environnement hostile pousse l’Etat à réagir en faveur des 7architectes, afin de protéger leur secteur d’activités
L’Etat constate que les activités du secteur du bâtiment ont largement ralenti à partir des années 1970, c ’est pourquoi les premiers travaux sous le contrôle de la mission interministérielle, créée par décret le 20 octobre 1977, sont réalisés Alors présidée par Bernard Tricot, elle a 8pour objectif de promouvoir la qualité architecturale dans le domaine des constructions publiques L’Etat en profite également pour s’imposer dans le
5 Sénat (2004) Métiers de l architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
6 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
7 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
8 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
domaine de la réglementation (Peyceré, 2000) Notamment à la suite du premier choc pétrolier de 1973, l’Etat a rapidement mis en place la RT 1974 afin de diminuer les coûts énergétiques, puisque les prix des hydrocarbures avaient considérablement augmenté Cet évènement a fait prendre conscience que le pays dépendait trop de l’énergie fossile pour fonctionner Cette réglementation s ’est vue s ’appliquer à la totalité des bâtiments neufs d’habitation et sera réévaluée quatre fois afin de renforcer progressivement les paramètres de consommation des bâtiments neufs La deuxième version a été réalisée en 1982 à la suite du second choc pétrolier Elle vise un gain de 20 % sur la consommation énergétique par rapport à la précédente Ces règles, parfois attribuées à la lutte contre le réchauffement climatique, ont été créées pour des raisons économiques (Collet, 2011) L’Etat établit d’autres règles comme la loi sur l’urbanisme en 1975, la loi sur l’architecture en 1977 ou encore les lois sur la commande publique avec le décret ingénierie de 1973 et la loi MOP sur la maîtrise d’ouvrage publique de 1985
Ces changements de réglementation auront de multiples impacts sur l’accès à la commande et sa nature En raison de la loi MOP sur la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports à la maîtrise d’œuvre privée, les architectes réalisent une grande part de la commande publique depuis sa mise en place, en 1985 La plupart des missions confiées sont complètes, de la conception à l’exécution du projet Du côté de la commande privée, les architectes y ont plus difficilement accès : particulièrement, dans celui de la maison individuelle qui correspond au plus important marché de la construction dans le secteur du bâtiment Ici, les missions données par la maîtrise d’ouvrage privée sont moins communément complètes 9Les statistiques de la Mutuelle des architectes français (MAF) le montrent, elles indiquent que seulement deux tiers des commandes sont entières Toutefois, une régression de la commande publique en faveur de la commande privée a été constatée depuis une dizaine d'années Le marché d’équipements publics ne correspondrait plus qu’à 25 à 30 % de la demande, alors que celui du privé équivaudrait jusqu’à 60 % de l’activité des architectes Celui ci est désormais prépondérant dans la profession des architectes alors que les missions restent fragmentées La prédominance croissante de la commande privée sur la commande publique est l’une des raisons des problèmes
9 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)économiques que rencontrent le métier Les types de commandes ont également évolué, puisque le taux de commandes portant sur des constructions neuves a légèrement diminué depuis une vingtaine d’années Une inversion du rapport entre travaux neufs et travaux d’entretien et de réhabilitation est observée Alors que les travaux neufs constituaient un peu plus de la moitié du montant global des travaux en 1985, il n ’ en représente plus que 46 % aujourd’hui A l’inverse, les travaux d’entretien et de réhabilitation ont largement augmenté et incarnent 54 % du marché de la filière Néanmoins, les architectes ne réalisent que 15 % de ces activités de rénovation Cette faible proportion se justifie par de multiples paramètres : 1la 0 mise en concurrence avec d’autres maîtres d’œuvre dans un secteur qui n ’est pas réglementé, la part de créativité moins importante et une rémunération plus faible (Peyceré, 2000) La part de travaux d’entretiens et de rénovation dans leurs commandes a atteint 30 % en 2002 alors qu ’elle ne dépassait pas les 20 % en 1985 Les enquêtes de la MAF démontrent que les architectes visent à mieux s’imposer sur ce marché Les activités de conseil viennent élargir le champ des activités des architectes Les missions sans exécution, dans le secteur du conseil, de l’expertise et de l’urbanisme, représentaient 28 % de leurs prestations à la fin des années 90 Elles admettent un apport financier complémentaire, même si le montant des honoraires qu ’elles génèrent n ’est pas connu, et elles permettent la polyvalence des missions des architectes En dépit des mesures prises par l’Etat, la 1situation 1 économique du secteur du bâtiment reste incertaine Alors, certains architectes s ’orientent vers des modèles économiques alternatifs
I.3 Création de nouveaux modèles économiques liés à l’écologie : l’exemple de l’économie sociale et solidaire
Les décisions d’industrialiser le secteur du bâtiment, de produire en masse et d'urbaniser le territoire ont été prises lors des conseils organisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale Elles sont le résultat de plusieurs intentions Les membres du Congrès de l’Union des ingénieurs et techniciens combattants à Alger, notamment Eugène Claudius Petit, voulaient développer économiquement le pays et positionner la France
10 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
11 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
comme pionnière dans la production architecturale moderne (Pouvreau, 2004) Cependant à la suite de ces orientations, de multiples problèmes environnementaux ayant des effets négatifs sur la vie humaine sont apparus comme la diminution des ressources naturelles disponibles, la propagation des déchets dans la nature, la bétonisation des espaces végétalisés ou encore la dégradation de la qualité de l’air (Diemer, 2009) L’environnement bâti et l’industrie de la construction ont un rôle important à jouer dans la transition énergétique 12
En parallèle, des modèles économiques alternatifs ont été imaginés afin d’être plus solidaires, plus locales et plus soucieux de l’environnement L’économie sociale et solidaire, longtemps dominée par l’univers associatif, s ’est répandue dans les années 80 en France Il n ’est pas fondé sur l’appât du gain et la glorification de la réussite individuelle mais sur l’innovation socio économique dans le but de contribuer collectivement au bien commun et au mieux vivre Il se soucie de l’environnement, de la cohésion sociale et promeut la démocratie participative pour ouvrir l’économie à tous Il est également une force au niveau de l’emploi, les associations ont créé plus d’emplois que les organismes privés depuis les années 2000 Le 1secteur 3 de l’architecture aussi s ’ y souscrit Romain Minod, fondateur du collectif d’architectes Quatorze expliquait au Journal Libération “On assiste à une montée de projets alternatifs dans la lignée de l’économie sociale et solidaire”
Malgré la volonté de conquérir de nouveaux marchés et de s ’ ancrer dans de nouveaux modèles, la situation économique de la profession demeure aujourd’hui, très précaire La loi de 1977 qui promettait aux architectes le monopole des projets soumis à un permis de construire s ’est illustrée assez illusoire, puisque les moyens de dérogations ou de
heureuse
non respect à ce principe sont nombreux Elle a également vu son 1effectif 4 largement augmenté au moment où elle a été touchée par une diminution de sa commande, ce qui a considérablement appauvri la profession De plus, ce phénomène implique principalement les femmes et les jeunes architectes Une étude réalisée par l’Observatoire de l’économie de l’architecture a constaté une chute considérable d’architectes de moins de 30 ans, entre 1990 et 2000 Le recensement du début des années 1990 indique que l’on comptait 10 % d’architectes de moins de 30 ans Ce nombre est estimé à 4 % dix années plus tard, alors que de nombreux étudiants ont été diplômés (DPLG) durant cette décennie Quant à la proportion des femmes, elle est restée stable à 18 % alors que la féminisation des diplômés s ’est développée (Rouanet, 2013) L’entrée dans la vie professionnelle est difficile et jugeant que la jeune génération d’architectes ne pourront pas exercer leur métier convenablement, ils préfèrent changer de voie 1Ces 5 fluctuations économiques se réalisent en parallèle de changements de positionnement de la figure de l’architecte
14 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
15 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
Le rôle de l’architecte a été redéfini de nombreuses fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale La politique architecturale de l’Etat passe du productivisme de la Reconstruction avant les années 60, à sa remise en question avec une réorganisation de la commande dans les années 70 16
Bien que la professionnalisation du métier d’architecte se soit manifestée par l’instauration d’un relatif monopole et par la reconnaissance par l’Etat, ils n ’ont pas réussi à imposer une définition unique et stable sur lesquelles fonder leurs compétences (Camus, 2010) Autrefois seuls aux commandes, les architectes se voient dépossédés de la maîtrise d’œuvre après la fin de la Seconde Guerre mondiale (Dubost, 1985)
La crise économique du bâtiment, la complexification du processus de construction et les règlements mis en place par l’Etat ont conduit les architectes à solliciter de nombreux intervenants extérieurs Cela 1a 7 engendré l’apparition de nouveaux métiers Ce phénomène, étudié par Bernard Haumont, indique qu’il se réalise également à travers l’extension du salariat, la spécialisation et la coopération avec d’autres métiers On le qualifie par le terme de socialisation (Macaire, 2012) On parle dès lors “des métiers de l’architecture” pour exprimer l’ouverture des pratiques professionnelles Ils correspondent aux aménageurs, promoteurs, paysagistes, écologues, économistes, géographes, sociologues, etc (Blanc , 2010) Initiés sous les incitations de l’Etat, les professionnels maîtrisent leur secteur de spécialisation Néanmoins la multiplication de spécialistes et la polyvalence des fonctions ont engendré une disparition des limites entre les fonctions de chacun Au départ, les architectes étaient responsables de la conception du projet et du suivi de chantier ; les ingénieurs et les bureaux d’études se chargeaient de la technique et de la mise au point de l’exécution ; et les économistes de la construction du contrôle des coûts du projet Cependant, le chevauchement des compétences implique que les réels attendus ne sont pas clairement établis (Dubost, 1985) Les acteurs de la filière du bâtiment
16 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
17 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
expriment une insatisfaction devant le flou qui entoure leur rôle Cette indétermination pousse les partenaires à la concurrence où chacun revendique une part du travail de l’autre (Peyceré, 2000)
Au moment où l’architecte n ’est plus considéré comme artiste de prestige, l’architecte est conduit à évoluer dans un contexte assujetti par le néolibéralisme mondialisé Le tête à tête avec le client qui faisait la singularité de sa pratique a largement reculé pour laisser place aux méthodes des sociétés (Biau, 2020)
II.2. La fin de l’exercice en libéral
L’exercice libéral à titre individuel concorde à la vision classique de l’architecte artiste Elle reste la forme juridique la plus fréquente malgré les fluctuations qu ’ a engendrées la crise du bâtiment En 2013, l’ordre des architectes compte 51 % des architectes inscrits tandis qu’ils atteignaient les 83% en 1983 A l’opposé, sur la même période, la part des architectes associés passe de 5 % au début des années 1980 à 38 % en 2013 Il existe 1d’autres 8 modes d’exercices comme en qualité de fonctionnaire, de salarié dans une société ou dans une association Il est également possible de cumuler différentes activités sous certaines conditions, établis par la loi de 1977 sur l’architecture 19
Dans le cadre d’une étude, le Conseil National a demandé à l’Institut français d’opinion publique d’effectuer un observatoire du métier de l’architecte Cette enquête a été réalisé en avril 2013, elle souhaitait comprendre comment la profession se projette dans l’avenir à l’horizon 2030 à travers 11 thèmes abordés qui sont : la part de créativité lié à la conception architecturale, l’autonomie d’organisation et de décision, la diversité des problèmes à résoudre, les relations humaines développées dans l’exercice de la profession, la direction du chantier, la rémunération, la reconnaissance sociale du métier d’architecte, la charge de travail et les responsabilités, les
18 Ordre des architectes (2015) La profession en chiffres La profession en chiffres | Ordre des architectes
19Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
opportunités de carrière professionnelle, la gestion des questions administratives et les avantages sociaux Presque 1000 praticiens ont répondu au questionnaire L’enquête dévoile que les architectes pensent que l’exercice en société sera le bon modèle dans les prochaines années En 2013, au moment de l’étude, ce type de structure ne représente qu ’ un tiers des architectes français, alors que l’exercice en individuel correspond à plus de la majorité Elle montre également que la plupart des praticiens questionnés (60 %) pensent que le modèle en société se fera avec 4 salariés ou plus, tandis qu’à ce jour une agence française sur deux est sans salarié Le Conseil National constate, à travers cette recherche, que la profession souhaite faire évoluer les formes juridiques et la taille des agences (Rouanet, 2013)
En parallèle, l’exercice en société s ’est amplement développé depuis les années 1970, période où d’ambitieux programmes de logements sociaux étaient lancés et où la commande publique correspondait à un marché privilégié Cela avait permis de faire apparaître de grandes agences d’architecture Toutefois, ce modèle a largement diminué en raison de la crise du bâtiment et donc , au début des années 1980, les sociétés composées de 2 à 5 architectes sont majoritaires Il est important de noter que la plupart des architectes salariés sont des femmes ou des jeunes Ces constats sont liés au fait que ce statut est plus protecteur en cas de crise Pour les architectes non expérimentés, il est perçu comme la voie d’accès à la profession et représente une étape avant le passage au statut libéral indépendant ou associé 20
Au moment où les modèles juridiques de la profession évoluent, les missions de l’architecte changent aussi Elles ne se limitent plus à la conception et à la réalisation du projet A l’heure de la communication digitale, les architectes peuvent davantage communiquer sur leurs projets et se façonner une identité propre (Biau, 1995)
20 Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)En parallèle de ces transmutations au sein du métier, une politique de communication architecturale se met en place dans les années 1980 Les constructions sont largement médiatisées dans la presse Alors il faut anticiper ce phénomène en soignant les images et les discours qui en facilitent la réception auprès des médias et des jurys Ce nouveau paradigme caractérise une habileté qui n ’est plus seulement régentée par l'esthétique ou des procédures administratives, mais aussi par une popularité médiatique (Molina, 2014) Cela positionne également les architectes comme des communicants, parfois qualifiés de “ vendeurs d’images” Champy signalait que cela pouvait mener à une dévalorisation de la profession, où le métier ferait face à “ un déficit de compétences et de professionnalisme auquel il faudrait remédier ” (Champy, 1999) Les pratiques de communication prennent autant d’aspects qu’il y a d’architectes Elles visent à faire connaître l’architecte et ses projets Certains d’entre eux souhaitent faire connaître leur production à travers des publications et en démarchant des clients potentiels ou au contraire, ils consacrent tout leur temps à la conception et le suivi de la réalisation dans le but de renouveler leur carnet de commandes
Les formes de présentation de soi prennent également des tournures différentes : certains architectes convoitent la confiance de clients pour assurer un renouvellement des commandes et la propagation d’une appréciation positive de leur service ou au contraire, ils recherchent la reconnaissance par leurs pairs par la réception de prix, publications, distinctions, etc Il est important de noter que l’activité architecturale fait l’objet d’au moins deux grands enjeux, un enjeu économique (avoir des commandes) et un enjeu symbolique (être reconnu comme un praticien de qualité) (Biau, 1995)
De plus, les grands noms de l’architecture et de l’urbanisme s’évertuent à façonner leur image publique en se mettant en scène à travers leurs discours ou leurs écrits Ils racontent leur histoire personnelle, révèlent leur manière d’appréhender le monde et de le vivre Pour mener à bien cette mise en scène de soi, ces acteurs usent de plusieurs procédés comme l’écriture, les conférences, les expositions ou encore leur tenue vestimentaire
Ils abordent également leurs goûts et leurs pratiques dans d’autres domaines que celui de l’architecture Ces éléments jouent un rôle important dans la constitution d’un star system basé sur la reconnaissance individuelle Les architectes sont poussés à devenir une image de marque où ils doivent se démarquer (Molina, 2014)
La complexification du processus de construction a favorisé l’apparition de nouvelles professions de maîtrise d’œuvre C ’est ce qui a poussé les architectes à se recentrer uniquement sur les missions de conception, voir dans certains cas à la constitution des permis de construire au service de projets déjà définis Ce changement forcé des missions de l’architecte les ont conduits à la perte de leur identité (Champy, 1999)
Globalement insatisfaits de leurs conditions de travail, les architectes sont de moins en moins nombreux Une étude réalisée en 2013 par l’Institut français d’opinion publique, sous la demande du Conseil National a observé que les architectes demeurent majoritairement optimistes en regard de leur situation professionnelle mais que ce taux avait diminué de 15% entre janvier 2008 et avril 2013 Les facteurs importants d’insatisfaction dans la profession sont la gestion des questions administratives, la rémunération, la charge de travail et les responsabilités Ils sont imaginés comme allant en se dégradant Néanmoins, face à l’urgence climatique, les praticiens dirigent leurs compétences vers de nouveaux champs L’étude fait voir que la prise en compte de la qualité environnementale globale des bâtiments se révèle comme la première piste d’amélioration de performance de l’architecte (43% de citations au total) (Rouanet, 2013)
Les architectes s ’avèrent être responsables de la façon dont les édifices échangent avec leurs milieux et invitent ses usagers à poser un regard singulier sur le monde L’architecture incarne des lieux où l’humain peut se rapprocher de la nature et lui fait constater les transformations qu’il endure Mathias Rollot, comparait l’architecture à “ une forme de Visage lévinassien qui nous place en tant qu’être sensible, empathique et responsable” Ainsi, elle se traduit par des choix architecturaux, de modes constructifs ou de matériaux Ces choix sont visibles et transmettent des messages : une structure en bois et des murs en terre crue transmettront un message bien différent qu ’ une ossature en acier et une façade en verre L’architecture peut être utilisée comme une arme pour mettre en mouvement l’opinion publique sur les questions environnementales Elle serait la représentation immédiate de sujets politiques, comme du rapport nature culture d’une société (Rollot, 2018) Alors si une vraie métamorphose doit survenir dans les institutions, il n ’est pas exclu qu ’ un changement radical puisse passer aussi par une révolution dans les pratiques individuelles de chacun
III.1. Un moment de prise de conscience de l’urgence écologique : la fin de l’innocence
Le secteur du bâtiment a également une part de responsabilité dans la crise écologique que le monde traverse Autrefois, les édifices construits étaient ancrés dans un territoire et conçus avec des matériaux renouvelables qui permettaient le développement de savoir faire C ’est au moment de l’industrialisation du pays et la découverte de matériaux innovants, vers le milieu du 19e siècle, que l’architecture évolue L’industrialisation et la préfabrication vont largement se développer dans le domaine de l’architecture à la fin de la Seconde Guerre mondiale (Ceballos & Ehrlich, 2015) Au même moment, le Centre d’études et de recherches en urbanisme (CERU) définit les principes directeurs d’urbanisme qui guideront les bâtisseurs pour la reconstruction du pays Ils préconisent le recours à des
solutions innovantes comme le béton, l’acier, le verre ou le plastique (Pouvreau, 2009) Les bâtiments employant ces matériaux vont se multiplier jusqu’à la prise de conscience de leur impact environnemental L’origine de nombreuses positions urbanistiques ou architecturales sont les résultats de choix politiques (Ceballos & Ehrlich, 2015) Par exemple, les décisions d’aménagements du territoire, mises en place dès le milieu du XXe siècle, ont engendré l’étalement urbain et l’artificialisation des sols d’après l’IPBES Ils seraient l’une des principales causes de l’extinction de la biodiversité en France Par ailleurs, quelle que soit la nature des bâtiments, ils utilisent de l’énergie, de l’eau, de la matière, ils produisent des déchets et émettent du CO² Le ministère de la transition écologique déclare le 9 mai 2021 que le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France, sans compter et qu’il émet plus de 123 millions de tonnes de CO² par an, soit 25 % de l’émission totale Toutes les étapes de la construction sont prises en compte, de l’extraction de la matière première en passant par sa transformation et son transport, jusqu’à la consommation énergétique du lieu Le ministère indique également que ce secteur serait à l’origine de 46 millions de tonnes de déchets chaque année Les politiques d’aménagements du territoire qui ont engendré l’étalement urbain, causent chaque jour des déplacements de milliers de personnes L’ensemble de ces données font du secteur du bâtiment l’un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et conduit à la recherche de la durabilité dans les processus de construction (Ceballos & Ehrlich, 2015)
Ainsi, le concept de durabilité et l’essor des préoccupations environnementales va initier de nombreux changements dans le domaine de l’architecture, notamment à travers la mise en place de normes et des systèmes de certification de construction écologique
III.2. L’architecture durable : un nouveau marché réglementé
Ces inquiétudes pour l’environnement n ’atteignent les institutions, les lois et la politique qu’à la fin des années 1980 Bien qu’à la suite du premier choc pétrolier, la première réglementation thermique a été instituée en 1974 Elle a, par la suite, subi de nombreuses modifications La RT2012, issue du
Grenelle de l’environnement régentait des hautes exigences en matière de conception du bâtiment, de confort et de consommation d’énergie La dernière réglementation thermique de 2020 s ’est mutée en une réglementation environnementale, RE2020, qui est encore plus exigeante pour la filière construction Elle vise la modification des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels D’autres règles ont été établies, comme le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) C ’est un outil de planification au service de la transition énergétique et un projet territorial de développement durable Il a été statué en 2016 et il a pour objectif de rendre les bâtiments plus économes en énergie Il met en avant la rénovation de l’existant et avance des normes plus strictes en termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs 21
Depuis le début des années 2000, on constate l’apparition de règles de plus en plus strictes s’intéressant aux questions environnementales et plus spécifiquement à la diminution de l’empreinte énergétique d’un édifice A mesure que l’intérêt pour les projets de constructions écologiques s ’est développé, de multiples labels et certifications se forment au début du XXIe siècle, comme la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) en 2004 Cette réglementation visait à la diminution des impacts environnementaux à travers 14 thématiques Elle s’étend à toutes les phases du cycle de vie d’un bâtiment : construction, gestion, d’usage et déconstruction Les systèmes de certification et de normes sont des stratégies pour construire en minimisant l’impact écologique de la filière L’architecture durable peut aussi être qualifiée d’architecture écologique, respectueuse de l’environnement, saine ou encore à haut rendement Il est intéressant de comprendre l’évolution du qualificatif “écologique”
Auparavant les édifices qualifiés avec ce terme correspondaient à des édifices sensibles à la nature, alors qu ’aujourd’hui seuls les édifices respectant les nombreux critères de durabilité peuvent se voir attribuer ce terme Ces codes ont été mis en place par des professionnels du secteur du bâtiment comme des spécialistes de l’industrie de la construction, architectes et ingénieurs génies civils (Ceballos & Ehrlich, 2015)
Les architectes doivent prendre en compte ces réglementations de plus en plus contraignantes, ils conçoivent alors de nouveaux dispositifs, mettent à jour les solutions existantes et incluent ces notions dans leurs enseignements
Les bâtiments certifiés écologiques ont créé un nouveau marché La demande de bâtiments écologiques a largement augmenté, aujourd’hui ils sont l’un des sous secteurs les plus importants dans la filière de la construction L’importance de la durabilité, la sensibilisation à l’environnement et la protection de la nature a largement évolué depuis les années 1990 En raison de l’évolution des prises de conscience écologique, le concept de durabilité est devenu un puissant outil de communication marketing De nombreuses agences d’architecture souhaitent refléter une image de structure engagée afin d’influencer les potentiels clients à choisir leur service (Ceballos & Ehrlich, 2015) Parfois utilisé de manière trompeuse, le terme de “greenwashing” s ’est développé en architecture, au même titre que dans d’autres domaines, depuis le début du siècle Toutefois, le greenwashing mène à une perte de crédibilité pour l’industrie du bâtiment écologique Les bâtiments durables et verts, les villes écologiques futuristes, les fermes urbaines verticales visent à balancer les villes modernes Elles s ’engagent à une empreinte carbone faible et à un retour à la nature Cependant, elles sont loin d’examiner les causes profondes des problèmes environnementaux et incarnent ce qu ’ on appelle “ une illusion verte” (Kurnaz, 2021)
Mathias Rollot pointe aussi du doigt les architectures écologiques mensongères Il illustre ces édifices par “les modes désastreuses de la végétalisation mensongère des façades et des toitures, des fausses promesses d’une agriculture urbaine peu durable, du simulacre d’écolo créé par les façades en revêtements bois apposés sur la construction en béton” Le développement du “greenwashing” ou de l’injonction au durable correspond
au moment où la presse joue un rôle important Dans le processus de projet, les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvres n ’ont pas les mêmes objectifs, ceux ci ne sont pas forcément compatibles (Biau, 2020) De plus, les dispositifs correspondant à l’amélioration énergétique des bâtiments sont souvent perçus comme trop contraignants Un effet contre productif est notifié, dans le cas où ils ne correspondent pas aux habitudes des usagers Les économies prévues à l’origine sont rattrapées par l’attitude des habitants, qui se relâchent car ils sont déculpabilisés On parle “d’effet rebond” (Ramau & Roudil, 2012)
Toutefois aujourd’hui concevoir un bâtiment durable, c ’est considéré l’ensemble de son cycle de vie avec une approche sociale et environnementale responsable, qui vise à minimiser les dommages causés par le bâtiment et ses utilisateurs (Kurnaz, 2021)
A partir des années 1910, quelques architectes ont amorcé la réflexion autour de l’architecture dite aujourd’hui “écologique” Par exemple, Franck Lloyd Wright s’interrogeait sur l’autosuffisance des bâtiments et intégrait ses bâtiments dans la nature environnante Il présage les orientations des années 70 avec la maison Jacobs qui a été conçue en suivant la course du soleil Il a également créé les Prairie Houses, symboles de ce qu’il nommait lui même d’architecture organique (Dassa, 2016) Quelques années plus tard, Leberecht Migge, architecte paysagiste allemand, concevait des dispositifs spatiaux afin d’établir un lien organique entre villes et jardins Cette réflexion s ’est faite sur la base du recyclage des eaux et des déchets urbains A travers ses réalisations de parcs publics, jardins privés ou ses écrits, il milite en faveur d’une agriculture d’autosubsistance (Jacquand, 2013)
Toutefois, ce n ’est qu’à partir des années 1960 que le secteur du bâtiment voit émerger de nombreux collectifs d’architectes sensibles à ces sujets Quelques années auparavant, lors des chocs pétroliers, la population a pris conscience qu’il était nécessaire de changer nos modes de vies face à
l’ampleur des conséquences de la crise environnementale, qui est déjà en marche Les architectes ont développé une relation différente au paysage et au climat, où ils sont sortis des pratiques architecturales enseignées à l’époque Une grande partie de ces réflexions a été initiée aux Etats Unis Les jeunes architectes américains, alors qualifiés de pionniers en architecture bioclimatique, esquissaient le mouvement de la contre culture (Maniaque, 2014) Ces idéaux devenaient de plus en plus ancrés dans la culture américaine, alors de nombreux bâtiments manifestes ont été conçus et parfois réalisés Les édifices suivaient les principes d’une conception respectueuse de l’environnement, d’une économie d’espace et d’une harmonie avec la nature Le plan directeur étudiait l’écologie locale, les vents dominants, les microclimats, les plantations et d’autres conditions (Ceballos & Ehrlich, 2015) Ces réflexions sont apparues un peu plus tard en France
Les années 1990 sont également marquées par une hausse de collectifs professionnels ou semi pro de jeunes architectes en France, mais ils ne revendiquent pas les mêmes orientations Ces groupes apparaissent à la suite du mouvement des écoles d’architecture qui ont refusé le transfert de leur tutelle du Ministère de l’équipement vers le Ministère de la culture et de la communication Les architectes cherchent à se rapprocher des populations, ils explorent de nouvelles façons d'exercer leur métier sur le terrain Ils adaptent leurs méthodologies afin de co concevoir et de co produire l’architecture Ces collectifs professionnels ou semi pro croient en France Ils s’éloignent des mouvements sociaux et de l’art pour être davantage sur le terrain de la participation habitante car le métier était perçu comme élitiste et détaché de la société (Macaire, 2015)
Quelques décennies après ces basculements, nous constatons que les crises sociales et environnementales sont encore d’actualité L’écrivaine, Caroline Maniaque déclare que les expériences collectives ou individuelles menées dans la deuxième partie du XXe siècle revêtent d’une étonnante actualité (Maniaque, 2014) L’évolution de la situation environnementale, sa conscientisation dans la filière construction et les changements de réglementations qu ’elle engendre, depuis les années 1980, ont fait émerger
de nouveaux enjeux dans le secteur du bâtiment 2Néanmoins, 2 l’aménagement des territoires, le renouvellement urbain et l’intégration du paysage sont plus largement considérés par les métiers de l’architecture depuis le début du siècle De nouvelles théories se manifestent comme la thèse de l’anthropocène au début des années 2010 Par exemple, Léa Mosconi explique dans sa thèse qu ’elle se traduit par l’injonction de sortir d’une approche strictement énergétique des changements climatiques, pour penser à développer une autre approche des lieux : leur conception, leur transformation, leur réalisation et leur habitabilité (Mosconi, 2019)
Comme nous l’avons évoqué auparavant, depuis la deuxième partie du XXe siècle, des architectes se mobilisent vers des valeurs environnementales et sociales Cependant, la grande majorité des autres professionnels du secteur du bâtiment restent sur la réserve Depuis quelques années, la situation s ’est légèrement améliorée et les acteurs du processus de construction sont davantage sensibilisés et formés sur ces sujets Par exemple, l’initiative du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative a été signée par plus de 10 000 personnes Ce texte incite le corps professionnel à s ’ engager vers des valeurs sociales et environnementales à travers leurs pratiques architecturales Ses adhérents s'engagent à construire en ayant un impact énergétique minime, en respectant l’environnement et le vivant, en utilisant les ressources et savoir faire locaux, en s’intéressant aux bien être des travailleurs, du voisinage et des utilisateurs (Bornarel & Gauzin Müller & Madec, 2018)
Dans la pratique des architectes, ces engagements s'expriment de manières différentes L’initiative du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative n ’est pas le seul mouvement de cet ordre en France Ces groupes permettent d’avoir un impact plus important face aux dirigeants car ils regroupent un large nombre d’adhérents aux valeurs similaires Nombreux sont les collectifs d’architectes qui misent sur la transmission des savoirs à travers l’expérimentation et les discussions Par exemple, l’école zéro est un collectif dont l’objectif est de réfléchir aux différentes manières de “faire école” collectivement C ’est un espace de rencontre, de partage, de recherche et d’expérimentation à différentes échelles et sous des formes alternatives Le festival Bellastock organisé par le collectif du même 2nom, 3 accueille une fois par an, des participants pour fabriquer collectivement une ville éphémère autour d’une thématique spécifique C ’est un laboratoire à ciel ouvert où l’on explore le processus collectif du projet, les cycles de la matière, l’occupation temporaire d’espaces déqualifiés et/ou en mutation 2A 4
travers ces évènements, les architectes veulent aussi faire réseau afin de mettre en place des filières Par exemple, l’architecte Morgan Moinet a fondé en 2017 un groupe de discussions sur les réseaux sociaux qui a pour but de valoriser le réemploi dans le secteur du bâtiment
Au cours de recherches réalisées dans le cadre de mon association au début de l’année 2019, j’ai découvert que de nombreux acteurs du secteur du bâtiment étaient engagés vers des valeurs sociales et environnementales dans l’exercice de leur métier Lorsque j’ai commencé les études d’architecture, en septembre 2016, ces initiatives existaient déjà mais je n ’ en avais pas connaissance Elles n ’avaient que très peu de visibilité dans mon école d’architecture et dans les médias que je consultais A ce moment là, les étudiants intéressés par l’écoconstruction se faisaient rares dans mon entourage C ’est au cours de ces deux dernières années, que j’ai pu rencontrer de nombreux acteurs engagés à travers la France et l’Asie Ils sont architectes, artisans, enseignants, autodidactes et ils ont la même quête, réagir à l’urgence climatique Les recherches et les rencontres que nous avons réalisées m ’ont guidé vers les réflexions qui ont rythmé cet écrit Ce projet fut pour moi un cadre qui m ’ a accompagné dans la mise en place de ma réflexion, tant par le choix des références que pour la mise en place de la méthodologie à travers les études de cas
Ces observations m ’ont conduite à réaliser une des études de cas qui s’intéressera à un nombre limité d’acteurs Pour cela, un premier repérage et une sélection de collectifs engagés ont été effectués Je connaissais déjà une partie de ces collectifs, je les avais déjà vu à l'œuvre, alors j’ai approfondi mes recherches sur leurs réalisations, leur évolution et leur discours sur leurs documents de présentation Il me semblait important qu’ils aient tous réalisé plusieurs projets à plus ou moins grande échelle J’ai également choisi des collectifs ayant à peu près la même ancienneté Les collectifs qui ont été étudiés sont au nombre de quatre : Archipel Zéro, SCOP fair, Collectif LOKAL et ARTI/CHÔ Un seul d’entre eux, Archipel Zéro, n ’est pas basé en région parisienne Dans un premier temps, j’ai effectué des fiches d’identité synthétique faites à partir des informations disponibles sur les sites internet
des structures, des écrits et des interventions réalisées par les acteurs enquêtés Elles s ’organisent autour de plusieurs thématiques : la localisation, la date de création du collectif, son histoire, ses porteurs et l’organisation de la structure, les possibilités d’interventions, les partenaires, l’activité et ses engagements Un projet construit a également été analysé dans le but de mieux comprendre leurs pratiques architecturales avant de les contacter
Localisation : Le Havre Stains
Date de création : 2017
Porteurs : Architectes HMOP (4), secrétaire de direction (1)
Nombre de personnes : 5 (4 femmes et 1 homme)
Organisation de la structure : Agence d’architecture
Evolution : Dans un premier temps, Fréderic Denise, architecte et fondateur d’Archipel Zéro, a travaillé en tant en libéral pendant 25 ans Il a par la suite créé Archipel Zéro qui est un groupement d'individualités, d'agences, de lieux
Champs : “Objectif : zéro béton, zéro carbone, zéro déchet ; ne construire que si nécessaire ; le moins et le mieux possible !”
Activité : Ils répondent à des appels d'offres publics et à des commandes privées Ils conçoivent et rénovent des bâtiments médico sociaux, tertiaires (bureaux, enseignes, hôtellerie), espaces publics et logement (collectif, maison individuelle)
Partenaires : Le Hangar 0, ARPE Normandie, Permac , Bellastock, [URBS!]
Engagements : “Construire avec ce que l'on a sous la main et sous les pieds Il s'agit en premier lieu de la terre du terrain, matériau avec lequel nous entretenons une véritable passion, pour ses qualités immenses, et dans laquelle nous n'ajoutons jamais de sable extrait Il y aussi toutes les fibres végétales bois local, tiges et paille qui poussent à proximité Enfin, les matériaux de réemploi, issus des chantiers locaux de déconstruction, ainsi que toutes matières résiduelles provenant de nos surconsommations : papier, carton, plastique qui sont dorénavant à considérer comme de nouveaux gisements dans lesquels puiser sans réserve ”
Comment ? : “La connaissance de ces matériaux et l’expérience de leur mise en œuvre nous inspire une architecture pleine de sens et d'évidence, au service de l'esthétique et du confort de vie Les principes bioclimatiques sont également porteurs d'une architecture qui dialogue intimement avec son
environnement ( ) Cette participation inclut un environnement humain plus large afin de diffuser ces pratiques au plus grand nombre, lors de chantiers participatifs Maîtriser ces pratiques et contribuer à les diffuser pour les rendre ordinaires est le rôle que se donne archipel zéro, avec un enthousiasme qui se veut le plus communicatif !”
Projet : Ferme urbaine Résilience est le siège social de Novaedia, coopérative d'insertion qui développe une boucle alimentaire locale, biologique et solidaire En cohérence avec les pratiques de la coopérative, inspirées par la permaculture et en symbiose avec son territoire, le bâtiment a été construit de façon bioclimatique avec des matériaux bio/géo sourcés et des matériaux de réemploi Il concilie au sein d'un même bâtiment une approche low tech et high tech : mur trombe et enduits en terre crue côtoient sans complexes cuisine laboratoire et thermo frigo pompe Le bâtiment est en structure bois, portiques en lamellé collé et planchers en CLT, réalisés avec du bois de forêts françaises
Localisation : Aubervilliers
Date de création : 2019
Porteurs : Léonard Pierson, William Gomes et Mathilde Héraut
Nombre de personnes : 3 (2 hommes et 1 femme)
Organisation de la structure : Association loi 1901
Evolution : L’association a été créée pendant leurs études, depuis ils n ’ont pas changé la forme juridique de la structure Il souhaite la faire évoluer en société coopérative et participative dans le futur
Champs : “Faire de manière éthique, alternative et ascendante”
Activité : Conception et construction (mobiliers, design d’intérieur, microarchitecture) et médiation autour de la construction à travers l’organisation d’ateliers pédagogiques
Partenaires : In Seine Saint Denis, CAVAPU, Mairie d’Aubervilliers
Engagements : "À travers nos projets nous valorisons l’utilisation de matériaux de réemploi et la réalisation de projets en collectif ”
Comment ? : “Nous organisons régulièrement des ateliers de conception collective et de construction avec les usagers des lieux où nous intervenons Nous annonçons également à nos commanditaires que les matériaux dont nous avions convenu lors de la conception du projet pourraient être amenés à changer car cela dépendra de ce que nous trouvons en matériaux de réemploie ”
Projet : Réalisation d’un ensemble de mobiliers d’extérieurs L’association a conçu et réalisé l’ensemble du mobilier d'extérieur d’une propriété privée en Normandie Ces éléments de mobiliers ont été réalisés en kit en atelier, puis montés sur place Ils sont essentiellement en bois de réemploie Une lasure à base d’huile naturelle a été appliquée sur le bois
Localisation : Paris
Date de création : 2020
Porteurs : Aurélien Cantegrel, Henri de Dieuleveult
Nombre de personnes : 6 (5 hommes, 1 femme)
Organisation de la structure : Association loi 1901
Évolution : Pendant les premiers mois, le collectif a d’abord été informel Puis, ils se sont organisés en association à but non lucratif loi 1901
Champs : “Construire ensemble”
Activité : Conception et construction (mobiliers, design d’intérieur, microarchitecture) et organisation de chantiers participatifs (logistique, conseils et transmission)
Partenaires : Ecole Zéro, Association des Gens Heureux
Engagements : “Nous sommes passionnés par cette architecture artisanale qui a su empiriquement et avec une grande simplicité répondre aux enjeux territoriaux Il nous semble essentiel de redécouvrir les filières d’approvisionnement locales, les mécaniques constructives vernaculaires, et de valoriser les artisans qui les maîtrisent encore Nous essayons à travers nos pérégrinations sur le territoire d’identifier et d’appréhender localement les techniques constructives, les matériaux et les archétypes architecturaux Dans la pratique, nous cherchons à sensibiliser les gens à la construction et aux enjeux que cela représente Nous leur permettons, lors de chantiers participatifs, d’appréhender et de mettre en œuvre les matériaux locaux ”
Comment ? : “Ainsi, nous expérimentons collectivement en quête d'innovations frugales, souvent inspirées des savoir faire ancestraux Lorsque nous travaillons dans des cadres plus urbains, nous privilégions une ressource curative ; les déchets et autres rebuts de la construction ou de la consommation En utilisant ou détournant ces matériaux de seconde main, nous évitons la production de déchets et réduisons l’exploitation de matières premières Notre échelle d’action n ’est pas bien grande mais nous avons bon
espoir de faire germer des idées dans l’esprit de celles et ceux ayant participé à nos chantiers ”
Projet : Permanence architecturale à la résidence du Crous de Cachan
L’intervention du collectif consistait à concevoir à l’aménagement des espaces communs et des chambres de la résidence étudiante avec ses usagers Ils devaient également organiser les chantiers participatifs Ce poste est un outil de recherche de la Chaire mutation de la vie étudiante menée par Jean Sébastien Lagrange et Agathe Chrion Ce poste est pour le moment encore expérimental, mais la Chaire vise à multiplier les permanences architecturales dans d’autres résidences étudiantes
Date de création : 2015
Porteurs : Ivan Fouquet, Baptiste François
Nombre de personnes : 3 (2 hommes, 1 femme)
Organisation de la structure : Société Coopérative et Participative
Evolution : Le collectif a directement été monté en SCOP en 2015 A l’origine, les deux cofondateurs étaient les deux seuls sociétaires Aujourd’hui, ils sont quatre sociétaires (à parts inégales)
Champs : “La pratique de l’agence suit quatre pistes de travail : écoute et co construction, architecture et urbanisme frugal, prendre soin et réparer le déjà là ”
Activité : Ils ne répondent qu’à des appels d'offres publics Ils rénovent et construisent des bâtiments tertiaires (bureaux), médicalisés (centre thérapeuthique) et de loisirs (salle polyvalente)
Engagements : “Aujourd’hui, il s ’agit plus de réparer que de construire L’agence s ’emploie à préserver, à réemployer, à rénover et réhabiliter à toutes les échelles, du détail au territoire, des infrastructures techniques à la vie organique qui le composent ”
Comment ? : “Chaque projet commence par une écoute attentive, par le partage des demandes, des problèmes, des contraintes, par la mise en commun des envies C ’est là l’occasion pour les habitant es de concevoir la forme de leur logement, d’interroger les salarié es sur leurs activités quotidiennes et pour les enfants de dessiner l’école ou de construire le terrain de jeux de leurs rêves Le projet est pensé avec son territoire, le lieu où il viendra s ’ ancrer, sa lumière, son histoire, son genius loci Architectes artisans, l’agence multiplie maquettes, dessins et croquis pour travailler son architecture dans un tâtonnement joyeux, habile et précis Oscillant entre ingéniosité, frugalité et simplicité, ‘fair ’ veille à réduire les
besoins en ressources, à rester sobre en sol, en eau, en énergie, et en matériaux Prendre soin du vivant concerne aussi l’attention portée aux occupant es, habitant es, aux corps comme aux esprits Les questions de santé, de qualité de l’air, d’acoustique, d’ergonomie traversent la pratique de l’agence ”
Projet : CFA et Bureaux bioclimatiques La SCOP faire s ’est chargé de la réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS logés dans un bâtiment du début du XXème siècle La réhabilitation de l'immeuble procède d'objectifs environnementaux élevés sur les consommations d'énergie mais aussi sur la qualité d'air et le confort d'été sans recours à la climatisation Le système de ventilation naturelle qu’ils ont développé a permis de diviser par trois les consommations de chauffage du bâtiment L'enveloppe de l'immeuble a été entièrement isolée, les menuiseries remplacées Une stratégie de confort d'été vise à rafraîchir le bâtiment naturellement par une ventilation naturelle nocturne associée à l'inertie du bâtiment Les eaux de pluie sont collectées pour l'arrosage des plantes Enfin le chantier a donné lieu à un travail approfondi sur le réemploi et la réutilisation sur site Ils ont également utilisé des matériaux trouvés sur le site ainsi que des matériaux de réemploie Un travail de co conception a été réalisé avec les personnels des bureaux pour les ambiances des espaces communs et individuels
Ces premières recherches m ’ont permis d’identifier un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles commencer mon analyse L’un des premiers éléments que nous pouvons noter est l’écart d’années d’expériences entre les collectifs observés, bien qu’ils ont tous été fondés après 2015 C ’est à la suite d’échanges que j’ai pu avoir avec des jeunes architectes ou des étudiants diplômants que je me suis rendue compte que la jeune génération d’architectes, dont je fais partie, exprimait davantage le désir de s’impliquer dans des projets architecturaux qui font sens Soucieux de l’environnement et du vivant, cette volonté est plus largement exprimée depuis 2 ou 3 ans Ils sont également nombreux à créer ou rejoindre des petites associations en parallèle de leurs études ou de leur emploi (Macaire, 2015) Comme nous l’avons évoqué dans les parties précédentes, l’opposition entre leur activité professionnelle, souvent perçue comme un travail alimentaire, et leur seconde activité, beaucoup plus épanouissante, m ’ a interrogé sur le champ des possibles exposé aux jeunes architectes au moment d’entrer dans le monde du travail (Raybaud, 2020) Donc , ce constat m ’ a poussé à choisir des collectifs de génération différentes dans le but de comprendre la vision des jeunes sur leur avenir et les évolutions probables de carrière chez les acteurs engagés
Ainsi, j’ai choisi un certain nombre de collectifs organisés sous des formes juridiques différentes dont les membres se revendiquent engagés vers des valeurs environnementales et sociales Ils pratiquent l’architecture et le design par la conception, la réhabilitation et la réalisation de bâtiments et souhaitent la démocratisation de l’architecture à travers des démarches inclusives L’enquête a été limitée à la France et s ’est arrêtée sur quatre collectifs Il y a le collectif Archipel Zéro au Havre, FAIR et LOKAL à Paris et ARTI/CHÔ à Aubervilliers Ils ont tous été fondés par des acteurs du domaine de l’architecture et ils sont composés d’un à six membres actifs A l’origine, ces personnes ont des profils similaires car ils sont presque tous architectes ou étudiants en architecture, mais certains d’entre eux ont suivi des masters ou des formations complémentaires à leur formation d’origine L’un des
collectifs dérogent à cette note et intègre également des designers Le collectif avec le plus de membres, soit six, est le groupe avec une majorité d’étudiants Les architectes avec le plus d’ancienneté font partie des plus petites structures Elles sont également plus cadrées et ancrées dans le secteur du bâtiment
Tableau : Caractéristiques des collectifs par ancienneté
Âge : 40 à 50 ans
2 entretiens (avec deux hommes)
1 SCOP et 1 collectif informel
Archipel Zéro (Le Havre) :
Le collectif est encore informel Il a été créé en 2019 par l’architecte DPLG Frédéric Denise (enquêté) Il n ’ y a officiellement qu ’ un seul membre pour le moment
FAIR (Paris, 11e) :
La SCOP a été fondée en 2015 par les architectes Ivan Fouquet et Baptiste François, respectivement DPLG et HMONP Ils sont actuellement quatre sociétai res
Âge : 20 à 30 ans
2 entretiens (avec une femme et un homme)
2 associations
ARTI/CHÔ (Aubervilliers) : L’association a été fondée en 2019 par les designers Mathilde Héraut, William Gomes et Léonard Pierson Ils sont actuellement deux membres pour le moment
LOKAL (Paris, 15e) :
L’association a été fondée en 2020 par Aurélien Cantegrel et Henri de Dieuleveult, alors j eune diplômé HMONP et en dernière année d’école d’architecture Ils sont actuellement six bénévoles au quotidien
A l’origine, ces collectifs ont été sélectionnés en raison de leurs engagements environnementaux Ils se traduisent essentiellement par les choix de dispositifs architecturaux et de matériaux Après mes premières recherches sur les sites internet des acteurs, j’ai remarqué qu’ils s ’annonçaient tous comme étant aussi engagés vers des valeurs sociales Elles s ’expriment par des principes de conception en collectif, de chantiers participatifs ou encore par le choix des différents acteurs intervenants dans le projet Sur cet échantillon, tous les collectifs mènent des approches participatives et formatrices, en revanche seulement deux collectifs justifient en grande majorité leur engagement à travers cela Ces deux groupes sont ceux avec le moins d’ancienneté Bien que les méthodologies revendiquées d’un premier
abord soient différentes, ils mêlent tous des approches environnementales et sociales dans leurs travaux L’ensemble des collectifs organisent des moments de discussions et de débats dans le but d’échanger sur leurs domaines d’expertise Il est intéressant de souligner que les deux collectifs qui évoquent clairement un double engagement dans leur discours, sont les collectifs avec le plus d’expériences
Archipel Zéro (Le Havre)
“Défendre une empreinte écologique minimale par une architecture frugale qui préserve les ressources et les énergies, non polluantes, réversibles et réemployables”
“Redonner à la matière la noblesse qu ’elle a perdu au détriment de la forme, en privilégiant les matériaux locaux et naturels de qualité”
“Promouvoir le réemploi”
“Concerter largement pour une architecture bien traitante dans une approche sens ible et empathique”
FAIR (Paris, 11e)
“Architecture et urbanisme frugal, prendre soin et réparer le déjà là”
“ Veille à réduire les besoins en ressources, à rester sobre en sol, en eau, en énergie et en matériaux”
“Ecoute et co construction"
LOKAL (Paris, 15e)
“Faire de manière éthique, alternative et ascendante”
“Construire ensemble”
Ces éléments sont mentionnés sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux Les médias qui diffusent leurs travaux mettent également ces informations en avant
Ces collectifs ont tous participé à la conception et à la réalisation d’un projet de plus ou moins grande envergure, ou encore à la fabrication de mobiliers et d’aménagement d’intérieur Les deux structures avec le plus
d’ancienneté ont réalisé un plus grand nombre de projets Leurs commandes proviennent des marchés privés et publics
Par exemple, Frédéric Denise s ’est fait reconnaître pour le bâtiment Résilience qui accueille la Ferme des Possibles à Stains dans le 93 Ce bâtiment a été conçu en fonction des principes de l’architecture bioclimatique, il est majoritairement composé de matériaux bio ressourcés et de réemplois Une démarche inclusive a été mise en place par l’architecte et les commanditaires, ils ont essentiellement fait appel à des entreprises stanoises et ont organisé des chantiers participatifs pour une partie des travaux
Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade est, qui est en matériaux de réemploi Elle a été prise depuis le jardin partagé qui entoure le bâtiment Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
Figure 2 (à gauche)
Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de l’espace de circulation en rez de chaussée Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
Figure 3 (à droite)
Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade sud, qui est en matériaux de réemploi Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
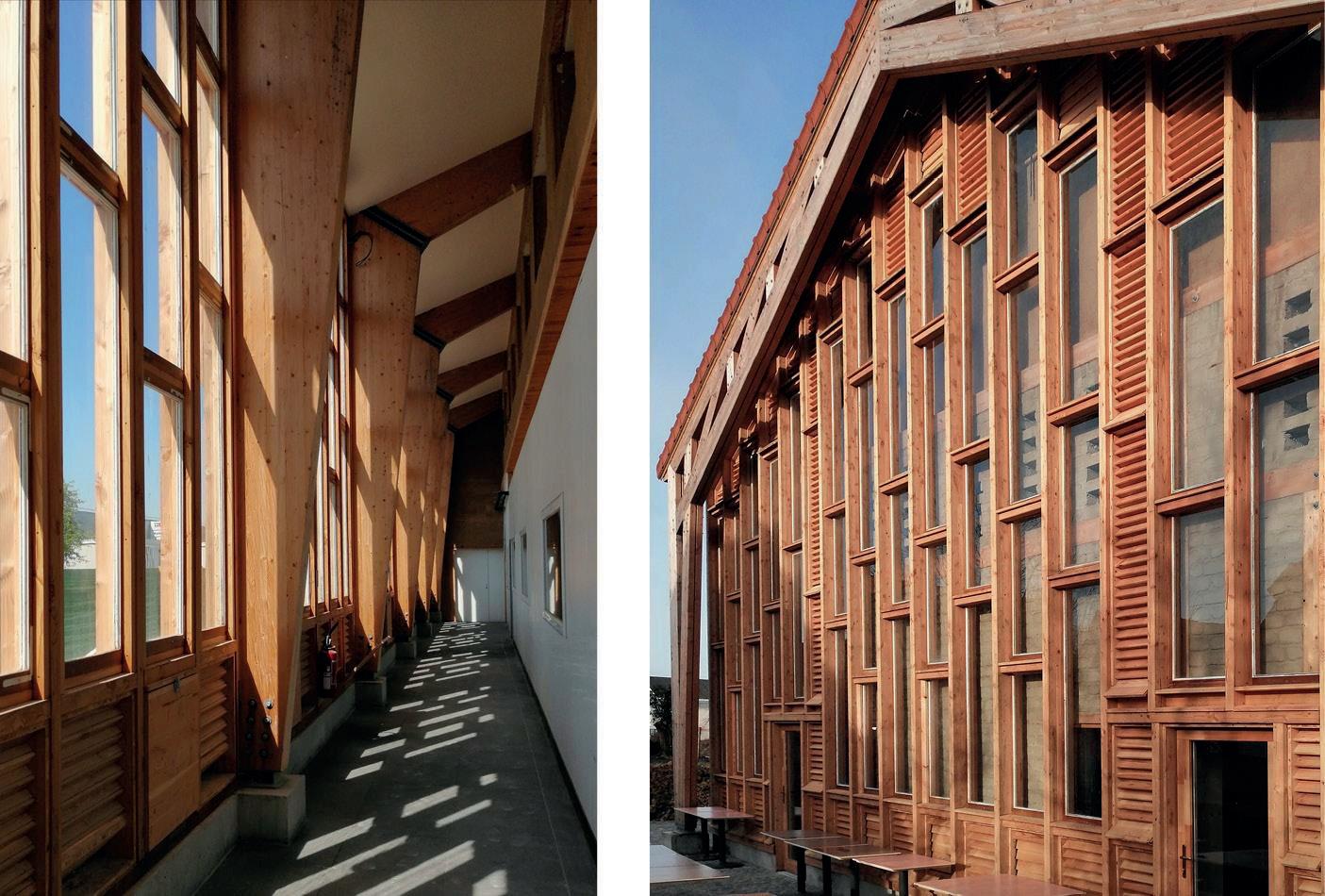
 Figure 1
Figure 1
La SCOP fair se définit comme un outil dédié à la transition énergétique, écologique et sociale Son approche qualifiée d’innovante, leur a permis d'obtenir l’appel d’offre pour la réhabilitation de bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS logés dans un bâtiment du début du XXème siècle à Levallois Perret Ce projet répond à des objectifs environnementaux élevés sur les consommations d'énergie mais aussi sur la qualité d'air et le confort d'été sans recours à la climatisation Ils ont développé un système de ventilation naturelle qui a permis de diviser par trois les consommations de chauffage du bâtiment L'enveloppe de l'immeuble a été entièrement isolée et les menuiseries ont été remplacées Une ventilation naturelle nocturne associée à l’inertie du bâtiment assure un rafraîchissement des locaux en été Les eaux de pluie sont également collectées pour l'arrosage des plantes Ils ont également utilisé quelques matériaux de réemploi et sourcés sur site Cette fois ci l’approche “collective” est moins mise en avant, bien qu’ils aient tout de même réalisé des réunions avec les usagers de ces bureaux pour convenir des ambiances des espaces communs et individuels
 Figure 4
Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte de l’espace commun dans les bureaux Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 4
Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte de l’espace commun dans les bureaux Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 5 (à gauche)
Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 6 (à droite)
Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte des espaces de réunions partagés Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Les plus jeunes structures ont, quant à elles, en grande partie réalisé des projets de mobiliers ou de microarchitectures dans le cadre de commandes privées ou publiques L’association ARTI/CHÔ a conçu et construit un ensemble de mobiliers avec leurs chutes de bois qu’ils ont gardés de leurs précédents chantiers Ces éléments de mobiliers sont préfabriqués en atelier et ils sont essentiellement en bois de réemploie Ils organisent aussi des ateliers participatifs pour leur construction

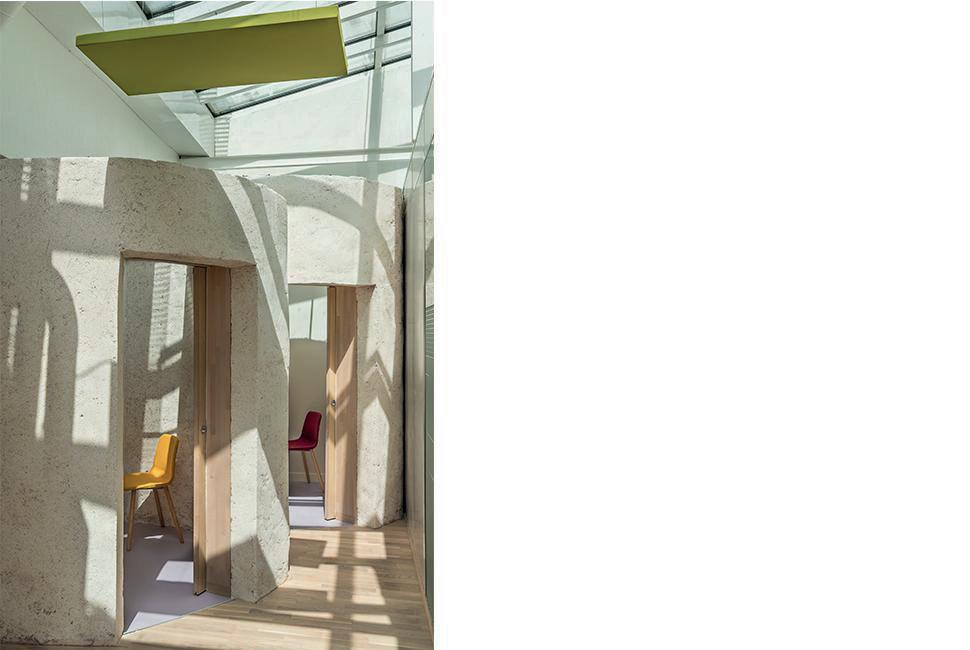
 Figure 7
Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte d’un atelier participatif organisé par l’association Ils construisaient un fauteuil avec des matériaux de réemploie Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
Figure 7
Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte d’un atelier participatif organisé par l’association Ils construisaient un fauteuil avec des matériaux de réemploie Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
Ils participent également à des projets alternatifs, où la production architecturale est moins importante, ce sont souvent des missions d'accompagnement dans le cadre d’une permanence architecturale Par exemple, le Collectif LOKAL est intervenu dans le cadre de la Chair mutation de la vie étudiante menée par Jean Sébastien Lagrange et Agathe Chrion Ils devaient concevoir à l’aménagement des espaces communs et des chambres de la résidence étudiante avec ses usagers Ils ont également organisé et encadré des chantiers participatifs


 Figure 8
Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte de quelques pièces de la série de mobiliers réalisés par l’association Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
Figure 8
Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte de quelques pièces de la série de mobiliers réalisés par l’association Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
11
12
Figure 9 10 11
Photographies tirées de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte de l’aménagement de l’une des chambres étudiantes Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan

Figure 12
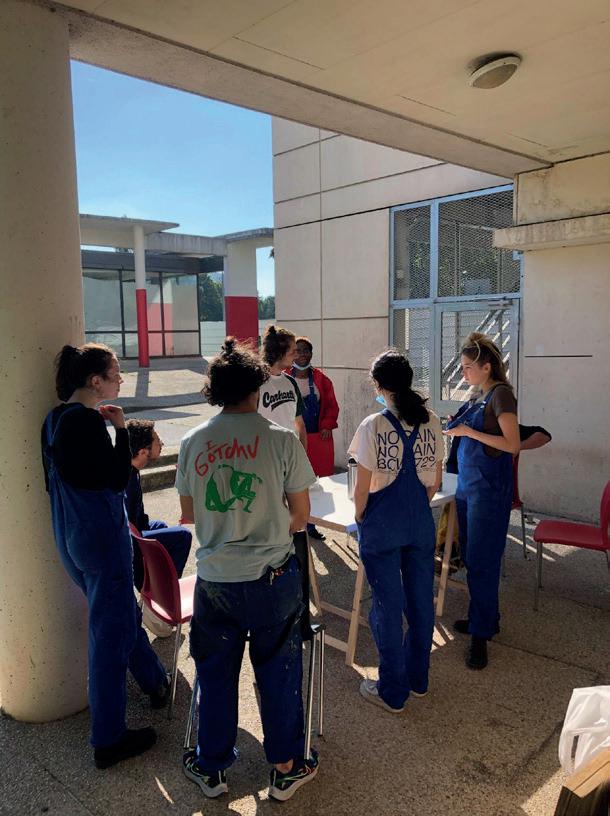
Photographie tirée de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte d’un moment d’échanges avant de commencer les ateliers du chantier participatif Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan
Les projets que nous venons de commenter illustrent une partie des valeurs revendiquées dans le discours de ces collectifs Certains procédés de conception (en collectif, concertation avec les usagers, ), de réalisation (auto construction, préfabrication, ) et de médiation (organisation de chantiers participatifs, discussion avec des entreprises non sachantes, ) sont des éléments essentiels à la construction de projets engagés pour ces acteurs Pour au moins deux des collectifs présentés, Collectif LOKAL et ARTI/CHÔ, les activités participatives ont été une des raisons à l’origine de la création du groupe Ils ont mis en place une méthodologie spécifique qui prend en compte les moyens, les propositions et les autres acteurs du processus de projet Les choix de dispositifs architecturaux, de matériaux et des techniques de mise en œuvre justifient également les engagements de ces collectifs
Ces recherches m ’ont fait remarquer que les structures s'engagent de manières différentes, cela m ’ a conduit à les rencontrer Les entretiens que nous avons réalisés sont semi directifs et tous les acteurs ont participé au
développement du collectif depuis sa création Ils évoquent leur trajectoire personnelle et professionnelle, ainsi que l’histoire de leur collectif J’ai réalisé quatre entretiens, deux ont été fait avec des architectes de moins de 30 ans, dont un avec une femme Les deux autres entretiens se sont fait avec des professionnels de plus de 40 ans
Après la retranscription de ces entretiens, j’ai examiné les propos des architectes fondateurs de ces collectifs Ces échanges m ’ont permis de comprendre le cheminement professionnel et d’identifier les moments clés de leur parcours Parfois, les discours de ces quatres architectes se rejoignent ou se différencient Les thématiques abordées, réfléchies au préalable lors de la réalisation de la grille d’entretien (Annexe n° 1), sont abordées de manières plurielles Une fois les entretiens réalisés, je les ai retranscrit et j’ai notifié toutes les idées qui émergeaient de ces récits J’ai alors constitué un tableau de croisement des données (Annexe n° 2) qui m ’ a permis d’analyser les récits et d’organiser ma réflexion pour l’écriture de la dernière partie de ce mémoire
L’analyse des entretiens témoigne du parcours personnel et professionnel mais aussi sur l’approche qu ’ont mis en place les architectes dans l’exercice de la discipline Les manières de faire, d’échanger et de statuer sont multiples et nous constatons qu’il existe autant de façons de s ’ engager que d’architectes (Biau, 2020) Néanmoins, l’accomplissement de ces quatre entretiens nous ont permis de mettre en parallèle les approches des architectes face aux mêmes enjeux C ’est donc à travers les trajectoires personnelles, les valeurs et les pratiques architecturales, le “faire ensemble”, le militantisme et l’évolution des pratiques que nous avons construit l’étude de ces entretiens
Dans cette analyse, nous tenterons de comprendre les leviers qui ont guidé les architectes vers leurs engagements et s'ils induisent des rapports de travail différents dans la manière d’accéder à la commande et de produire de l’architecture Nous nous demanderons dans quelles mesures les architectes engagés transforment leur exercice en un acte militant Enfin, nous nous intéresserons également à la vision du métier d’architecte de la jeune génération
Cette première section s ’attache aux trajectoires personnelles des architectes interrogés : quels ont été les leviers qui ont guidé les architectes vers leurs engagements ? Les valeurs des architectes rencontrés sont à mettre en relation avec leurs trajectoires personnelles Des études à l’insertion professionnelle, ils développent des pratiques architecturales suivant ces valeurs qui évoluent à la suite d’expériences diverses Par exemple, l’engagement de certains architectes vers des projets particulièrement engagés, comme l’habitat alternatif, se ferait en cohérence avec leurs parcours de vie : expériences de vie communautaire, intérêt ou contribution au mouvement des squats (Biau, 2020)
Tous les architectes interrogés ont évoqué, plus ou moins longuement, leur histoire personnelle et les événements marquants, qui les ont amenés à s ’ engager dans leur profession Ces changements d’orientation se sont déroulés à des périodes de vie différente Frédéric Denise et Ivan Fouquet ont plus d’ancienneté, alors ils ont créé leur structure et se sont positionnés dans la profession avant les deux autres collectifs Toutefois, ce sont les membres des collectifs ARTI/CHÔ et LOKAL , les plus jeunes structures, qui se sont engagés le plus rapidement dans leur carrière professionnelle
I.1. L'école, premier lieu de sensibilisation
Les enseignements suivis par les étudiants, lors de leur formation en école d’architecture, influencent leur prise de position dans leur profession
Bien qu’il existe un programme à suivre par toutes les écoles d’architecture, les cours reçus sont très variés et chaque école d’architecture française développe des particularités Elles sont définies par les professeurs qui y enseignent et dépendent du territoire dans lequel l’école s ’est implantée Les étudiants sont de plus en plus sensibilisés et instruits face aux enjeux climatiques et sociaux, mais ce n ’est pas une généralité Certains professeurs ne considèrent pas ces données, alors de nombreux jeunes ne sont pas formés C ’est pourquoi de nombreux enseignants souhaitent faire réseau avec d’autres collègues engagés La première rencontre d’enseignants portant sur la thématique de l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme à l’ère du développement durable a eu lieu en 2006 Pendant presque trois années, un réseau a commencé à se former et de nombreuses rencontres vont être organisées à Lyon, Grenoble et Versailles Le mouvement s ’est essoufflé à cause du manque de soutien du Ministère Néanmoins, il a repris à l’aube de la COP 21 sous la forme du réseau de l’enseignement de la transition écologique dans les ENSA , aussi dit “ENSAECO” L’objectif était de fédérer les enseignants et d’illustrer la richesse et la pluralité des propositions pédagogiques effectuées par le corps enseignant, en lien avec l’écologie 29
29 ENSAECO L’enseignement de la transition écologique en école d’architecture Repéré à : Accueil ENSAECO (archi fr)L’un des architectes interrogés, Aurélien Cantegrel, a été diplômé en 2018 Il souligne que les étudiants d’aujourd’hui sont beaucoup plus sensibilisés à l’architecture écologique que lui pouvait l’être à la fin de ses études Les étudiants de sa génération ont suivi des enseignements sur l’ambiance d’un bâtiment et le biomimétisme afin de limiter la consommation énergétique d’un édifice Toutefois, ils restaient assez sommaires Ils étaient enseignés dans le cadre des travaux dirigés et non pas dans les cours de projets, enseignement principal en école d’architecture Il considère que les étudiants actuels sont beaucoup plus sensibilisés à l’écologie Ils seraient également davantage attirés vers l’expérimentation
“Les pratiques de construire plus durable avec les gens et pas tout seul dans notre bureau, il y a 5 ans les professeurs n’ en parlaient même pas ( ) Par contre, au sein des générations qui ont suivi, ce sont des choses qui étaient beaucoup plus ancrées. C’est pourquoi avec le Collectif LOKAL , on a touché beaucoup plus de personnes de cette génération là. Ils étaient très contents de venir expérimenter avec leurs mains.” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Les enseignements suivis à l’école interfèrent directement les manières de faire de l’architecture chez les jeunes étudiants Systématiser les cours en lien avec la transition écologique permettraient ils d'accélérer le changement des mentalités au sein du secteur du bâtiment ?
I.2. L'engagement étudiant, la réaction à un manque
Dès le début des études d’architecture, les étudiants peuvent s’impliquer dans des associations internes, représenter les étudiants aux commissions de l’école et participer à des évènements pédagogiques Ces formes d’engagement ont des impacts différents Ils ouvrent ainsi une voie de formation intellectuelle : définir un enseignement de l’architecture, produire une critique de la profession et de l’enseignement, échanger avec des personnes plus expérimentées ; et sur une formation organisationnelle : animer une association, monter des projets, organiser des séminaires et voyages d’études Cette formation complémentaire au cursus académique apparaît comme essentielle dans la suite du parcours de chacun, notamment par le choix du sujet du diplôme et par des projets menant à l’insertion professionnelle (Macaire, 2012) Certains étudiants, souvent plus
avancés dans le cursus, créent leur propre collectif avec leurs camarades de promotion et d’ateliers Ces groupes ne sont pas directement liés à une école Bien souvent, ils préparent leur entrée dans le monde du travail ou alors ils expérimentent sur des sujets qu’ils n ’ont pas abordés à l’école
Les deux jeunes collectifs enquêtés ont été créés pendant les études de l’un des membres Ils ne sont pas forcément de la même année mais ils se sont rencontrés à l’école Le collectif ARTI/CHÔ a été formé par cinq étudiants et amis, qui se sont rencontrés lors de leur Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués à Vitry sur Seine Leur master étant assez poussé sur les questions sociales, ils désiraient faire des projets en parallèle de leurs études pour appliquer ce qu’ils apprenaient
“On était tous les 5 en DSAA , Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués à Vitry sur Seine On était en cours en deuxième année et on trouvait ça bien de faire des projets qui étaient en prolongement de ce diplôme là qui est assez engagé Cela nous plaisait bien On a créé l’association un peu vite On s’est retrouvé avec des commanditaires, ( ) on a accepté et tout s’est passé très vite ” (Mathilde Héraut, ARTI/CHÔ)
Les membres du collectif LOKAL se sont également connus lors de leurs études, mais cette fois ci en école d’architecture Ils ne font pas partie de la même promotion mais ils ont suivi la même pédagogie vu qu’ils étaient dans le même atelier Aurélien Cantegrel, le membre qui a été interrogé, est à l’initiative du collectif Lors de sa création il n’était plus étudiant mais le reste de l’équipe était encore en étude Ils ont monté ce projet car ils voulaient expérimenter, cela avait été un véritable manque dans leur enseignement
L’intégration aux associations et la participation aux projets proposés par un établissement souligne un engagement de la part des étudiants Néanmoins, la démarche de créer son collectif lors de ses études à un autre rayonnement, c ’est souvent la réponse à des envies formulées par leurs initiateurs Le processus d’engagement dans un collectif pendant ses études, revient il à préparer son entrée dans le monde professionnel ?
Les premiers pas dans le monde professionnel correspondent souvent à des moments de déceptions chez les étudiants en architecture Aurélien Cantegrel a réalisé une année de césure entre la licence et le master, pendant laquelle il a fait un stage de 6 mois dans une agence d’architecture en banlieue parisienne Il a rapidement compris qu’il ne s’épanouirait pas dans une structure classique Il désire alors s ’orienter vers des agences d’architecture alternative Elise Macaire évoque le stage de fin d’étude comme un moment où se manifeste une idéologie professionnelle (MACAIRE, 2012)
“Pendant cette année là, j’ai fait un stage dans une agence d’architecture J’avais plutôt bien aimé, mais je me suis vite rendue compte que nous étions des petits pions derrière des ordinateurs Dans les projets, la marche de flexibilité était assez réduite et même si mon agence l aissait la place aux jeunes, ( ) je me suis vite rendue compte que de rester sur une chaise derrière un ordinateur ça ne me plaisait pas trop ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
En parallèle de ses études, il avait créé un statut d’auto entrepreneur pour travailler sur des projets de rénovation d’appartement, création de mobiliers, qu’il a obtenu par des connaissances Cela lui a permis de mettre un pied dans le monde professionnel tout en étant assez libre C ’est grâce à ce travail de gestion de chantiers et d’entreprises, qu’il s ’est rendu compte des aberrations du secteur du bâtiment
“Cela m’a permis d’avoir une première approche avec l’industrie de la construction et (…) Je me suis quand même un peu rendu compte de l’aberration de ce que c ’était, et l’abondance de moyens car là c ’était du luxe pour le coup. C’était vraiment de la débauche de moyen ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
“Les entrepreneurs avec q ui je travaillais ne pensaient pas à mettre le système de réemploi dans leur projet car cela n’avait pas d'intérêt économique pour eux donc à partir de ce moment là, ils ne mettaient pas les choses en place pour Ce n’est pas qu’ils ne voulaient pas s’y sensibiliser mais cela n’avait pas d'intérêt économique " (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Il finit par passer son diplôme d’architecture avec un projet en réemploi dans l’Essonne Lors du projet de fin d’études, la manière dont les futurs diplômés se voient exercer commence à se dessiner Cet exercice a une force symbolique importante car c ’est le moment où l’on change de statut (MACAIRE, 2012) Après cela, il a travaillé sur un projet de start up qui proposait un système innovant pour faciliter le recyclage des déchets sur les
chantiers La démarche intellectuelle et théorique était convaincante mais le projet n ’ a pas pu se développer Une fois sur le terrain, ils se sont retrouvés face à des entreprises qui n ’avaient pas assez d’argent et de temps pour mettre en place ce système Les échanges entre les différents corps de métiers sont difficiles et contraignants Une énième expérience professionnelle lui a confirmé ce ressenti puisque lorsqu’il a passé son HMNOP, il a travaillé avec un architecte qui était en train de créer son agence Il a accompagné son employeur dans le montage de sa société et il a assisté à une phase difficile dans une carrière professionnelle, où l’on doit réaliser des projets ayant peu d’intérêts architecturaux Les intérêts économiques prédominent tous les choix architecturaux et constructifs La place de la conception et in fine, la place de l’architecte est réduite à son minimum Ces différents emplois ont été plutôt révélateurs sur la pratique architecturale qu’il voulait mener
"J’ai pu assister au montage d’une agence mais également à une phase très sombre de l’architecture, où tu construis des logements collectifs pour 1300 euros du m2 Je me suis rendue compte que c ’était un monde dirigé par l’économie L’idée même de penser à utiliser un matériau pour d’autres raisons que l’économie est impossible, même s'il est plus qualitatif, plus pérenne ou quoi que ce soit d'autre Les promoteurs et les baill eurs sociaux n’en ont rien à foutre Ça a été un peu une gifle, ( ) c ’était violent de se dire que l’on a aucun impact ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
En réaction à ces impressions, il a eu l’idée de fonder le collectif LOKAL pendant la période du premier confinement Il voulait utiliser ses mains, expérimenter avec la matière et être au contact des gens Le projet était au départ une réponse très spontanée à leurs envies Au fur et à mesure, ils ont constaté l’effervescence naissante autour du projet, alors ils ont décidé de continuer Aujourd’hui, la rémunération n ’est pas encore envisageable mais ils considèrent qu’ils cumulent deux activités
Face à la déception ressentie par de nombreux jeunes diplômés au moment de l’insertion professionnelle, ils multiplient leurs activités En parallèle de leur travail, souvent perçu comme “alimentaire”, ils créent des structures informelles ou associatives qui font écho à leurs valeurs environnementales et sociales (Macaire, 2012) Cette double casquette leur assure une stabilité financière, ainsi qu ’ un épanouissement professionnel La double activité professionnelle est elle une réponse pérenne aux maux que vivent la jeune génération d’architectes ?
Une fois dans le monde du travail, les architectes peuvent travailler sous différents statuts Ils peuvent être employés dans une agence d’architecture, exercer en libéral ou encore être fonctionnaire Les architectes avec le plus d’ancienneté ont tous les deux exercé en libéral, avant de monter leur structure Frédéric Denise s ’est installé directement en sortant de l’école, en 1988 A cette époque, il était intéressé par la construction bois mais il n’était pas spécialement militant Aujourd’hui, il considère qu’il n ’avait pas l’aplomb d’imposer à ses clients ce qu’il voulait alors il produisait de l’architecture assez classique Il a construit en béton, en verre, en métal C ’est au moment où il s ’est engagé en politique, dans le mouvement de la décroissance, qu’il a bouleversé sa pratique architecturale Ce basculement s ’est fait autour des années 2010, il n ’arrivait plus à assumer l’intervalle entre ses convictions politiques personnelles et sa pratique architecturale Alors, il s ’est éduqué Il a suivi une formation d’un an sur la construction écologique pendant laquelle il a écrit un mémoire intitulé “Architectes, objecteurs de croissance”
“Je m’étais engagé en politique dans le mouvement de la décroissance On s’était présenté aux élections locales Il y a un moment où ce n’était plus possible d’assumer. Il y avait vraiment un fossé entre mon engagement philosophique, politique et ma pratique. Ce n’était pas cohérent avec ces engagements là. C’est à ce moment que j’ai renversé la table. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire ce que je fais dans mon métier et militer pour la décroissance. Cette prise de conscience remonte à une douzaine d’années ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Il ne s ’est pas reconverti au sens d’un changement radical de profession mais il a totalement réorienté sa manière de faire de l’architecture Ces changements d’objectifs peuvent être moins absolus et se faire par étapes Lors de ses études d’architecture, Ivan Fouquet a étudié deux ans à San Francisco où il a commencé à fréquenter des activistes écologiques Après son diplôme, qui n’était pas autour des questions environnementales, il a travaillé dans des agences qui s'intéressaient vaguement aux matériaux de réemploi Il a répondu à des missions en freelance et s ’est formé sur les principes de l’architecture bioclimatique Il a pu participer à un projet plutôt innovant pour l’époque, c ’était la conception d’une ville écologique dans le désert marocain, même si aujourd’hui cette démarche lui semble assez incohérente C ’est pendant son exercice d’architecte libéral qu’il a rencontré son futur associé, avec qui il a fondé la SCOP fair en 2017 A ce moment là, il a
pris la décision d’arrêter ses missions en freelance et ses contrats dans des agences d’architecture, afin de s’investir totalement dans son projet
Les architectes installés depuis quelques années et ayant déjà mené à bien des projets, transforment de manière plus ou moins radicale, leurs activités afin d’être plus en accord avec leurs convictions personnelles L’affirmation de ses convictions dans sa profession, ont elles des conséquences ?
Cette deuxième section s’intéresse aux valeurs et à l’évolution des pratiques architecturales établies par les architectes interrogées : les engagements induisent ils des rapports de travail différents dans la manière de produire de l’architecture ? Produisent ils une architecture singulière ?
Tous les architectes enquêtés ont été sélectionnés en raison des valeurs sociales et environnementales qu’ils portent au sein de leur structure
Initiateurs de ces projets, ils ont déterminé les engagements qu’ils voulaient défendre dans leur activité professionnelle
II.1. Un positionnement plus ou moins revendiqué
Lors de nos entretiens, les deux architectes installés se sont rapidement positionnés en tant que structure engagée vers des valeurs sociales et environnementales, alors que les valeurs que portent les plus jeunes architectes n ’ont pas toujours été clairement définies Elles sont encore floues L’association ARTI/CHÔ explique qu’il travaille en réemploi Ils ont déjà refusé des propositions de projets car les clients ne voulaient pas le réaliser en ce type de matériaux C ’est un point essentiel dans leur pratique Toutefois, dans leur discours les membres du collectif ne l’affirment pas frontalement
“Cette question d’engagement, on ne se l’est jamais vraiment posée On prend rarement de recul sur ce qu’on fait, sur notre démarche, notre travail Ça fait deux ans que l’on a la tête dans l’eau, on fait ce qu’on fait mais on ne se pose pas pour définir nos valeurs, notre mission et nos engagements ” (Mathilde Héraut, ARTI/CHÔ)
De leur côté, les membres du Collectif LOKAL ont fixé, après plus d’un an d’exercice, les caractéristiques de leur pratique architecturale Ils organisent des chantiers participatifs dont les objectifs sont d’apprendre ensemble, d’expérimenter et de partager des moments de convivialité Leur pratique est définie mais elle ne repose pas forcément sur des valeurs visant à contribuer au bien commun dans le même sens que les architectes plus anciens Les trajectoires personnelles évoquées dans le chapitre précédent révèlent que les groupes ARTI/CHÔ et Collectif LOKAL ont été fondés spontanément et induits par des rencontres Ils établissent leurs pratiques en fonction de leurs désirs personnels Ils veulent tout de même faire en collectif et ouvrent leur projet à tous
Le double engagement, vers des valeurs sociales et environnementales, se traduit de plusieurs manières dans l’exercice du projet des structures plus anciennes L’architecte Frédéric Denise, parle de radicalité dans la manière de concevoir l’architecture Il compare ce principe à de la navigation à vue en bateau, dans le sens où il faut atteindre sa destination en choisissant le meilleur chemin pour y arriver, quelles que soient les conditions météorologiques Selon lui, cela produit une architecture plus engagée qui s’interdit de dévier
“La radicalité est importante car c ’est un peu la boussole. Au départ, le projet est toujours un peu idéaliste. On répond le mieux possible à un programme, on le développe et tout cela va être confronté à la réalité. Une réalité qui est corrosive Malheureusement, le projet va forcément perdre de l’engagement ( ) La radicalité est nécessaire comme boussole, comme une cape afin de rester le plus près possible de l’idéal ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Il est possible d’affirmer que la conscience des enjeux environnementaux et sociaux contraint ou permet la production d’une architecture singulière par ses concepteurs L’ensemble des possibilités se voit réduit par les filtres d’une architecture qui se veut frugale, nécessaire et
en lien avec son territoire Le double engagement vers des valeurs écologiques indique t il l’apparition d’un nouvel esthétisme ?
II.2. Le double engagement vers des valeurs écologiques : un renouveau dans les manières de faire de la conception
Ce double engagement se traduit de plusieurs façons Tout d’abord, les principes de conception et de réalisation sont obligatoirement adaptés aux paramètres de la construction écologique L’orientation des bâtiments, leurs matériaux, les dispositifs d’économie en eau et en énergie sont assimilés et directement intégrés à la manière de concevoir un bâtiment Frédéric Denise affirme que l’on s’interdit forcément des choses mais qu ’ on s ’ en permet d’autres Puis l’exercice du projet est également renouvelé, il se pense davantage avec les usagers Depuis le début des années 90, des associations d’architectes mettent en avant des démarches alternatives au processus traditionnel d’élaboration du projet architectural ou urbain Ils proposent des méthodes alliant pédagogie de la création et participation démocratique (Macaire, 2012) La totalité des acteurs ont évoqué la notion de faire en commun, de concevoir les projets avec les habitants et d’échanger avec les autres professionnels du secteur du bâtiment Par exemple, les projets portés par le Collectif LOKAL sont systématiquement remis en question lors des chantiers participatifs, notamment quand il y a beaucoup d’architectes Le président de l’association soulignait qu’ils passaient parfois toute une journée à discuter autour de la conception alors qu’ils avaient prévu de construire
“On essaye de travailler au maximum avec les clients et les usagers. On veut les intégrer dans la conception et dans la construction. Le collectif et la gouvernance partagée sont importants pour nous. Je pense qu’en groupe il est possible de faire lien et de ce grou pe là naît une force qui est plus grande.” (Mathilde héraut, ARTI/CHÔ)
“On essaye d’être à l’écoute de chacun des acteurs On forme souvent des comités de pilotage et les réunions sont assez classiques On a expérimenté une nouvelle méthode récemment dans le cadre d’un projet pour la CFDT On a travaillé avec la méthode des 6 chapeaux, c ’est une méthode intéressante car elle permet de faire parler tout le monde ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Cependant, l’intérêt vers la conception diffère entre les structures Les deux jeunes collectifs sont moins attachés à l’idée de dessiner leurs projets
Les membres du Collectif LOKAL ont finalement conçu une minorité des projets qu’ils ont auto construits
“Ce n’est pas une obligation que cela soit nous et seulement nous qui concevons un projet, mais on ne se voit pas construire le projet de quelqu’un qui a un projet totalement abouti et “clos” car on a besoin d’avoir n otre mot à dire pour organiser les chantiers participatifs ( ) On fait plus une conception technique et pratique plutôt que architecturale On participe aussi à la sélection des matériaux car on est aussi là pour apprendre On ne veut pas se restreindre à quelques matériaux ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Alors que les trois autres acteurs, notamment Fréderic Denise et Ivan Fouquet mettent en place des moments d’échanges avec les usagers et les autres acteurs afin de concevoir un édifice le plus adapté possible mais ils gardent tout de même la main sur la conception Par exemple, les membres de la SCOP fair travaillent beaucoup plus en amont avec les ingénieurs pour réfléchir à des dispositifs adaptés, ils incluent également très rapidement la question du budget Leur méthodologie est en constante évolution
“Ma pratique elle même évolue sans arrêt, à chaque projet j’essaye d’aller plus loin ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Les pratiques architecturales des professionnels engagés ont des objectifs communs, elles sont établies et se déclinent en fonction des valeurs de leurs initiateurs et des projets sur lesquels elles interviennent La manière de faire de l’architecture évolue et intègre de nouveaux paramètres comme la volonté de concevoir en collectif et d’établir un programme le plus adapté possible, l’intérêt vers les ressources et savoir faire locaux ou encore l’envie d’expérimenter la matière Ces éléments participent à un renouveau architectural Au delà d’une évolution des pratiques architecturales, par quels autres moyens est il possible de représenter ses engagements dans l’exercice du métier d’architecte ?
Bien qu'apparut dans les années 1970 (auteur date), nous observons une montée des modèles de production autour du “faire ensemble” dans le secteur du bâtiment Ces pratiques abordées sous les termes de “collaboration”, “coopération” ou encore “ participation” s'attachent à l’idée de faire en collectif mais leur déclinaison concrète reste encore floue (Delaunay & Gourvennec , 2020)
Dans cette troisième partie, nous allons voir que le développement de l’intérêt vers les enjeux environnementaux et sociaux et la revendication de faire en commun dans l’exercice architectural interroge les statuts juridiques, les moyens d’accès à la commande ou encore les rapports professionnels
Ces questionnements induisent de nouvelles fonctions aux agences d’architecture III.1. Des choix de statuts juridiques variés
Ici, nous nous intéressons aux statuts juridiques choisis par les structures engagées : pour quelles raisons, les architectes interviewés ont ils choisi ce type de structure ? Tous les architectes rencontrés, seuls ou à plusieurs, sont à l’origine de la structure dans laquelle ils exercent Ils ont donc déterminé la forme juridique de celle ci et les valeurs qu ’elle porte Ils sont tous engagés vers des valeurs environnementales et sociales similaires mais ils ont adopté des formes juridiques diverses comme l’association, la SCOP ou le collectif informel
Les deux plus jeunes collectifs, Collectif LOKAL et ARTI/CHÔ, sont des associations à but non lucratif Les membres du Collectif LOKAL , âgés de 23 à 26 ans, sont étudiants ou jeunes diplômés Leur implication au sein du collectif reste une activité bénévole qu’ils développent en parallèle de leurs études ou de leurs activités professionnelles Au départ, ils ont entrepris leur projet de manière informelle et c ’est à l’occasion d’un premier projet rémunéré qu’ils ont choisi de créer une association Ce statut est intéressant économiquement pour des jeunes projets, les charges sont réduites voire
inexistantes et ils ont la possibilité de recevoir des subventions publiques et privées Aujourd’hui, l’association a plusieurs projets rémunérés et la question de la gratification s ’est posée lors de leur dernière assemblée générale
“ On se considère toujours en train d’apprendre Moi donner mon temps bénévolement ça me convient et tant que je peux le faire et que je continue à apprendre, je le ferai La question de la rémunération se pose car on va avoir des projets rémunérés bientôt Je me considère encore en période de formation Du coup, on s’est plutôt dit qu’au lieu de se payer avec de l’argent, on allait se payer des temps de formation. Finalement, c ’est de l’argent qui est réinvesti dans le collectif. Pour les premiers temps, cela peut bien fonctionner comme ça. On remplit notre sac à dos de connaissances et de formations (…) puis on verra après. Je trouve que c ’est dommage de nous payer alors que notre sac n’est pas encore plei n. Il faut qu’on ait plus d’expériences et on veut se sentir encore libre sur nos projets et sur l’organisation de notre temps ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Il semble clair que la question de la rémunération, dans le cadre associatif où l’activité était essentiellement bénévole, génère de nouveaux enjeux L’assujettissement potentiellement ressentie n'est pas forcément la bienvenue La plupart du temps, ces projets sont initiés spontanément par un désir de découverte, de rencontre et d’épanouissement personnel L’approche du collectif ARTI/CHÔ est différente Les membres de ce collectif ont entre 26 et 31 ans, ils sont tous en activité professionnelle depuis moins de cinq ans Ici leur part dans l’association n ’est pas que bénévole, leur statut d'auto entrepreneur leur permet de travailler pour leur association mais par manque de moyens ils ne sont pas salariés Le collectif s ’est formé à la fin de leurs études, d’abord informel ils ont rapidement fondé une association pour pouvoir être payés pour un projet qu’ils ont obtenu
Les deux autres acteurs interrogés, Frédéric Denise et Ivan Fouquet, ont choisi d’autres formes de statuts juridiques pour leur structure Plus installées et plus ancrées, ces entités correspondent à leur seule activité professionnelle Ils font partie d’une génération plus ancienne pour laquelle travailler en tant qu ’architecte se faisait par l’exercice en libéral ou en société
Les deux architectes interrogés ont travaillé selon ces deux modèles Ivan Fouquet explique qu’il a travaillé avec un statut d'auto entrepreneur pendant presque 15 ans Il faisait des missions de sous traitance pour des agences d’architecture Aujourd’hui encore beaucoup de jeunes architectes travaillent avec ce statut et réalisent des missions plus ou moins longues pour des cabinets Cela correspond à du salariat maquillé, bien que cela soit officiellement interdit il n ’ y a pas de vérification Il a par la suite co fondé FAIR,
une Société Coopérative et Participative (SCOP) C ’était pour eux un moyen de pérenniser leur engagement sur le long terme
“ Quand on crée son agence, certains disent qu’ils vendront leurs parts plus tard mais c ’est un peu bizarre car la valeur de l’agence correspond aux gens qui sont dedans. (…) Nous l’idée c ’est qu’en développant ce projet, l’agence perdure après nous ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
La SCOP peut aussi être qualifiée d’engagée car elle apporte quelque chose à la société Elle permet de sortir de l’individualisme des sociétés d’architecture et du modèle économique capitaliste qu ’elle nourrit
“La SCOP c ’est l’inverse, on emploie les gens, on les salarie, ils profitent de la couverture sociale, du chômage et de la retraite Cela fait partie d’un modèle de société plus vivable On cotise et en parallèle on apporte des choses à la société, et aussi on bénéficie de ses avantages C’est l’inverse du modèle indivi dualiste que l’on retrouve dans de nombreuses agences, même de grosses agences qui emploient quasiment que des auto entrepreneurs. C’est assez scandaleux. Les directeurs d’agences avaient peur d’être contrôlés car il faisait du salariat maquillé. Aujourd’hui, il n’y a aucun contrôle, tout est laissé libre. On retrouve la même chose avec un certain nombre de stagiaires. C’est encore pire. Après nous avons aussi des stagiaires et c ’est une bonne chose car cela nous perm et de connaître la personne et de la former aussi Cela nous prend du temps aussi mais nous sommes vraiment dans une démarche de pédagogie Et si cela se passe bien, après deux ou trois mois de stage on les salarie ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Le principe de la SCOP incarne une démarche de coopération au travail Dans ce cas de figure, tous les membres de l’entité sont sociétaires à des taux différents, mais tous les sociétaires ont la possibilité de discuter sur l’évolution de l’agence Souvent perçu comme l’illustration de l’horizontalité en entreprise, les échanges où une personne est égale à une voie ne se réalise en réalité qu ’ une seule fois par an, lors de l’assemblée générale Un modèle pyramidal s ’applique tout de même lorsqu’il y a un certain nombre de sociétaires Ivan Fouquet explique qu’ils veillent à équilibrer les rapports entre les personnes par l’écoute et les valeurs humaines qu’ils incarnent La vision d’entreprise n ’est donc pas neutre dans le cas de la pratique de l’architecture
Frédéric Denise, fondateur du collectif Archipel Zéro, a travaillé pendant des années en libéral Présentement, il mène une agence d’architecture avec deux salariés, pendant quelques années il avait embauché une dizaine de personnes pour l’aider à réaliser un gros projet d’immeuble de logements à Paris Aujourd’hui, il ne souhaite plus avoir d'employés Il explique que par nature il a tendance à faire cavalier seul, qu’il
n ’apprécie pas la gestion de salariés, il ne sait pas déléguer, manager et parfois il déteste licencier Il souligne également qu’il est difficile de se positionner en tant que patron lorsqu’un lien affectif se crée avec ses employés, d’autant plus qu’ils passent une grande partie de leur journée ensemble
"Je me suis rendue compte que j’étais incapable de gérer une agence de plus de deux ou trois personnes. Je ne sais pas déléguer le travail, je suis un vrai handicapé pour ça. Je suis fait pour travailler seul. J’aime travailler en collectif mais je ne sais pas mener, je ne sais pas obéir non plus. (…) Après je m’oblige à partager ça pour être en phase à mes engagements.” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Il y a quelques années, il a fondé Archipel Zéro Ce groupe vise à regrouper plusieurs professions du secteur du bâtiment qui adhèrent aux mêmes objectifs Il est pour le moment informel et s’installera bientôt dans le Hangar Zéro, au Havre Pour le moment en cours de création, la limite entre sa propre agence et un collectif reste encore un peu floue L’objectif du projet est de partager un lieu avec d’autres architectes libéraux, sociétés ou coopératives afin d’échanger sur leurs pratiques, d’expérimenter et de collaborer sur certains projets Bien qu’il déclare ne pas apprécier le système pyramidal engendré par une société dont on est le patron, il apprécie collaborer avec d’autres entités Ce fonctionnement de collaboration entre plusieurs individualités incarne une horizontalité dans les rapports de travail
“Cependant, j’aime travailler avec d’autres collectifs, architectes libéraux, agences qui ont leur liberté Je n’ai pas à leur imposer quoi que ce soit, c ’est beaucoup plus agréable pour moi Je peux céder à mon envie de travailler seul avec d’autres, on se partage le boulot Cela me permet d’être plus à l’écoute Lorsqu’on est patron, c ’est un peu t rop facile pour moi de faire ce que j’ai envie de faire Même si je prends du plaisir à travailler seul, cela m’oblige à partager et d’être à égalité et en horizontalité avec d’autres agences.” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Par exemple, il réalise un projet avec une coopérative de jeunes architectes qui s ’appelle LAO SCOP Ils se sont associés pour répondre à l’appel d'offres de la maison de la biodiversité à Epinay sur Seine, sous la demande de la jeune structure Tout d’abord, cela leur permettait de partager leurs références mais également d’être accompagnés par Frédéric Denise sur les questions techniques car ils n ’ont jamais construit d’aussi gros projets
Toutefois, ils sont à égalité d’un point de vue de la conception
Les choix de la forme juridique de ces collectifs, au départ informels, dépendent de plusieurs paramètres Tout d’abord, le facteur économique est
l’une des principales raisons de ces orientations Les collectifs sous forme associative n ’ont pas justifié ce choix par des valeurs sociales et sociétales mais plutôt par des motifs financiers Une autre facteur qui est apparu, plus subjectif, est celui de l’émotion et de la personnalité Certains groupes ne désirent pas employer des collaborateurs, peu importe la forme de la structure, car ils n ’aiment pas ce que cela implique Enfin, nous pouvons considérer que l'orientation politique, ici sous entendue de gauche, influence parfois ces décisions Les structures sous la forme de SCOP par exemple, visent à soutenir la société en créant des emplois et en cotisant pour le système de retraite
III.2. Accès à la commande : introduction dans des marchés particuliers
Cette partie s’intéresse aux moyens d’accès à la commande des structures porteuses de valeurs : les engagements induisent ils des manières différentes pour accéder à la commande ? Dans la partie sur les valeurs et les pratiques, nous avons constaté que tous les architectes questionnés soutenaient des engagements Ils se sont affirmés à travers leur choix de pratiques architecturales et de forme juridique pour leur collectif Les projets qu’ils réalisent sont le résultat d’appels d'offres publiques ou de commandes privées Ces demandes sont constituées avec un cahier des charges qui oblige à répondre à certains critères Ils sont d’ordre sociaux, environnementaux, économiques, etc Ce cahier des charges peut exiger de correspondre à certaines normes pour obtenir des certifications et des labels Bien qu’il soit fréquent que la maîtrise d’ouvrage visent à acquérir des labels comme la certification HQE, afin de recevoir des subventions (Biau, 2020) La maîtrise d’œuvre prend des positions diverses et certains d’entre eux affichent clairement leurs engagements Cela les conduit à accéder à un type de commande spécifiques
Par exemple, Frédéric Denise explique qu’il n ’ a pas toujours été aussi engagé dans sa manière de faire de l’architecture Il a réellement pris conscience de l'impact du secteur du bâtiment dans les changements climatiques avant les années 2010 A cette époque, il a réalisé une formation diplômante autour de l’écoconstruction pendant laquelle il a écrit un
mémoire intitulé “Architectes objecteurs de croissances” où il a formulé ce qu’il applique aujourd’hui, c ’est à dire “Ne pas construire, construire le moins possible et le mieux possible” Le fondateur du collectif Archipel Zéro explique qu’il ne réalise que des projets éco conçus pour plusieurs raisons
En se formant sur l’écoconstruction et en réalisant des projets du même type, il a développé des compétences particulières grâce auxquelles il s ’est distingué
“(…) au fur et à mesure du temps je me suis totalement orienté vers des projets éco conçus. Je me suis fait un peu connaître pour ça aussi, maintenant on me propose des projets bioclimatiques ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Les multiples projets qu’il a réalisés lui ont permis de développer une expertise que l’on peut associer à une qualification supplémentaire à son exercice d’origine Il est régulièrement contacté pour la réalisation de projets semblables à ceux qu’il a déjà réalisés Il est possible de parler d’une logique de marché dans laquelle les concepteurs se retrouvent dans une niche économique et sont valorisés par l’aspect expérimental et singulier de leurs pratiques (Biau, 2020) Néanmoins il continue à recevoir des propositions de projets sans aucun engagement social ou écologique Aujourd’hui, il se permet de refuser les projets qui ne correspondent pas à ses valeurs Cette sélection a été en majeure partie motivée par ses engagements, mais il reconnaît que cela a aussi été possible car il avait d’autres propositions
“Lorsque je me suis radicalisé, j’ai commencé à refuser des projets C’est aussi parce que j’avais la possibilité de le faire car on me proposait autre chose qui était beaucoup plus en phase avec mes valeurs Mais sinon j’aurai bien été obligé de faire des choses que je réprouve car j’ai une famille à nourrir ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Ivan Fouquet évoque aussi ce phénomène de sélection dans les propositions qu’ils reçoivent ou dans les appels d’offre auxquels ils répondent Ils légitiment une partie de leur engagement à travers ces choix
“On sélectionne les appels d'offres qui nous paraissent les plus intéressants en fonction de nos engagements.” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Par ailleurs, il est également possible de changer la commande établie par le client Frédéric Denise a déjà vécu cette situation, cela a été possible car les gens ont confiance en lui et son travail Le collectif ARTI/CHÔ est plus jeune, mais il arrive qu’ils répondent à des appels d’offres qui ne sont
pas spécifiquement engagés au départ Ils souhaitent convaincre la maîtrise d’ouvrage en soumettant des propositions d’architecture en matériaux de réemploi, par exemple
Certaines prises de positions peuvent projeter les acteurs dans des secteurs particuliers Comme nous l’avons évoqué auparavant, Ivan Fouquet a fondé avec son associé, Baptiste François, une société coopérative et participative, il y a presque cinq ans Ce modèle spécifique leur a permis d’intégrer le secteur de l’économie sociale et solidaire où ils ont pu se connecter à d’autres structures similaires Depuis, ils font partie d’un réseau qui leur donnent accès à des commandes en harmonie avec leurs valeurs
“On travaille aussi avec des structures de l’économie sociale et solidaire ou d’autres SCOP Il existe un réseau des SCOP Notre expert comptable fait aussi partie d’une SCOP. Depuis 5 ans, on a rencontré pas mal de gens. C’est aussi du réseauta ge. Les prometteurs ne s’intéressent pas à nous, on ne s’intéresse pas à eux. Il y a déjà énormément de travail dans le secteur que l’on vise.” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Le “ réseautage” , communément défini par le fait de créer un réseau 3social 0 de contacts professionnels, est un moyen d’accéder à la commande Toutefois, les manières d’ y parvenir changent en fonction des acteurs Ces différences se justifient en grande partie par l’ancienneté des structures, les groupes plus installés ont pu établir un carnet d’adresse depuis plusieurs années Alors que les deux plus jeunes structures, pour le moment moins connues, sont en train de le remplir Ces derniers constituent une grande partie de leur carnet d’adresse lors d’évènements festifs ou grâce aux réseaux sociaux Ces rencontres conduisent parfois à l’obtention de projets
“On n'a jamais démarché personne, tout nous est tombé dessus C’est dans nos cercle individuel, d’amis ou de relations que l’on rencontre les gens et que l’on a nos projets On participe à des festivals, des évènements et on rencontre des gens, on fait des connexions ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Les manières d’accéder à la commande sont légèrement renouvelées sur le terrain de l’engagement mais le processus reste relativement similaire à celui des structures d’architecture traditionnelle Une sélection est tout de même effectuée par les architectes engagés, afin que les attendus des projets concordent avec leurs valeurs Certains d’entre eux se permettent de
changer l'objet de la commande, voire de convaincre ses interlocuteurs, si elle ne correspond pas tout à fait à leur approche Néanmoins l’obtention de projets, quelle que soit leur nature, engendre des rapports humains plus ou moins aisés III.3. Architectes VS les autres : la communication entre les acteurs du processus de projet
Cette section s’intéresse aux relations entre les acteurs intervenants dans le processus de projets engagés : quels liens se nouent, entre les architectes et les autres intervenants, quand les valeurs et les engagements s ’ en mêlent ? Comme expliqué dans la partie sur les valeurs et les pratiques, tous les architectes questionnés sont attachés au fait de produire de l’architecture en collectif Les procédés du “faire en commun ” sont adaptés aux types de projets et engendrent des dialogues entre les architectes, la maîtrise d’ouvrage, les entreprises, les usagers, etc
“A l’école on nous donne l’impression qu’on peut être un métier solitaire et qu’on va créer comme ça son objet architectural à partir de rien. Mais dans la réalité ce n’est pas comme ça, nous on croit que nous sommes au service de notre société, au service de nos clients et aussi de la planète ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Lors des entretiens, les quatre professionnels interrogés ont parlé de leurs liens avec les autres acteurs des projets Avant de les décrire, il est important d’éclaircir les contextes de ces relations Certains ont choisi de travailler avec un entourage portant les mêmes valeurs qu ’ eux, alors que d’autres composent avec les personnes présentes, bien souvent non sensibilisées à ces enjeux Il y a deux types d’approches, elles n’induisent pas les mêmes rapports et la manière de communiquer doit être adaptée
Par exemple, Ivan Fouquet déclare qu’ils ne travaillent pas pour les promoteurs ni pour les grandes entreprises pour des raisons éthiques et qu’ils se concentrent sur le secteur de l’économie sociale et solidaire, le milieu associatif et les commandes publiques Dans ces cas de figure, sauf exception, la communication ne semble pas être un problème, il n ’ a pas exprimé de difficulté particulière L’aisance de ces échanges est en partie dû aux similarités des valeurs et des objectifs du projet
“Ce n’est pas si compliqué que ça car c ’est souvent des demandes de leur part Il y a 10 ans c ’était plus compliqué, les gens ne comprenaient pas forcément et pour eux c ’était des choses qui leur étaient imposées ( ) Aujourd’hui, ils ont conscience de ces enjeux et ils comprennent pourquoi c ’est important de changer les choses, donc du côté maître d’ouvrage c ’est beaucoup plus simple aujourd’hui ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Par ailleurs, certains acteurs notamment les entreprises se tournent vers des techniques constructives ou des matériaux écologiques pour des raisons de bien être Par exemple, Ivan Fouquet explique que les ouvriers s ’orientent de plus en plus vers des isolants naturels comme celui en coton recyclé et évitent ceux en laine de verre ou de roche Ce choix ne fait pas écho à des engagements en particulier mais il correspond à des envies de confort Lors du chantier, les isolants naturels sont plus doux à manier Mathilde Héraut du collectif ARTI/CHÔ partage le même ressenti, l’essentiel de leurs relations se déroule avec facilité La plupart de leurs clients les contactent pour leur démarche Ils sont ravis de constater qu’ils sont dans une approche écologique, pas toujours consciente au départ Toutefois, il leur est arrivé quelques difficultés notamment avec des commandes privées
“Les difficultés arrivent avec les clients quand ils se rendent compte que le bois de réemploi ne correspond pas à ce qu’ils avaient imaginé et que cela fait des changements sur le projet On leur explique que l’on fait avec ce que l’on a et que c ’est comme ça et pas autrement ” (Mathilde Héraut, Collectif ARTI/CHÔ)
L’architecte Frédéric Denise souligne qu ’ une chaîne d’acteurs engagés et réceptifs aux mêmes valeurs permet de faire des projets pilotes Ils sont extrêmement engagés et peuvent montrer la voie aux autres afin de les rassurer Il affirme que le monde du bâtiment est très conservateur et centré autour de la crainte, au sens où de nombreuses personnes pensent qu’ils ne pourront pas être assurés en utilisant des matériaux naturels ou de réemploi Ce type de projets suppose donc un maître d’ouvrage convaincu, qui fait appel à un architecte en particulier car il sait qu’il a les mêmes engagements Cela requiert également une sélection des autres intervenants comme les entreprises, les bureaux d’études et de contrôles, etc L’opération est impossible sans une équipe qui ne va pas dans la même direction
“On reste en entre soi mais cela permet d’aller loin Si on a un bureau d’étude qui ne joue pas le jeu ou une entreprise qui ne veut pas faire, on ne peut rien faire sans eux Le projet ne pourra pas aller loin dans l’engagement ( ) C’est impossible, si l’un d’entre eux est en désaccord ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Lorsque les acteurs ne sont pas sensibilisés à ce genre de valeurs sociales ou environnementales, les liens entre eux changent L’architecte doit faire preuve de pédagogie et convaincre en expliquant pourquoi c ’est mieux de faire comme ça Le projet se réalise différemment
“Je pense que c ’est vers ça qu’il faut aller, travailler avec des entreprises qui font déjà du réemploi c ’est bien, c ’est confortable mais je préfère travailler avec des entreprises ordinaires et les convaincre à changer de pratique ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
La collaboration avec des acteurs non engagés est plus difficile et contraignante Les bâtiments produits ne sont pas les plus innovants mais c ’est peut être ceux qui font le plus avancer les mentalités Frédéric Denise soutient que c ’est en les convainquant qu’il se sent le plus engagé
“Je me dis que c ’est justement là que je fais le mieux. C’est vachement valorisant, on se sent bien quand on fait ça car on a l’impression d’avoir œuvré dans le bon sens, d’avoir changé les pratiques y compris chez des gens qui n’étaient pas acquis à la cause dès le départ. (…) C’est là où l’engagement dépasse la pratique. Le fait que ça fasse avancer les gens, c ’est mon exercice militant ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Les rapports entre les acteurs du projets sont pluriels et dépendent des projets La tâche est beaucoup plus aisée lorsque l’ensemble des professionnels et des usagers sont sensibles aux valeurs sociales et environnementales Certains architectes considèrent que c ’est un contexte de travail propice à la création de projets manifestes Cependant, ce n ’est pas toujours le cas La grande majorité des professionnels du secteur du bâtiment n ’ont pas connaissances de ces enjeux et peuvent se montrer réticents aux propositions des architectes C ’est à ce moment là que la force de conviction et la pédagogie des architectes entrent en jeu Les échanges deviennent alors un moyen de sensibiliser de nouveaux acteurs Peut on considérer que c ’est une forme de militantisme ?
Dans cette quatrième partie, nous allons tenter de souligner en quoi les éléments évoqués dans les parties précédentes peuvent être assimilés à une forme de militantisme : les architectes engagés transforment ils leur exercice en un acte militant ? Pouvons nous dire que ces engagements “ politisent” l’acte de construire ? Les parties précédentes exposent les engagements dans l’exercice des architectes interrogés Ils dessinent les contours de pratiques qui participent au changement des valeurs traditionnelles de l’architecture (MACAIRE, 2012) Bien qu’ils s’inscrivent dans un marché spécifique, ces groupes restent minoritaires dans le secteur du bâtiment Cela peut se justifier par les postures militantes et critiques, vis à vis de la profession, que prennent certains collectifs (BIAU, 2020)
Dans nos études de cas, les acteurs n ’ont pas tous déclarés avoir une posture militante dans l’exercice de leur métier Toutefois, ils se déclarent tous comme des structures engagées vers des valeurs sociales et environnementales, même si leurs missions sont plus ou moins bien exprimées Les architectes qui ont une ancienneté plus longue dans le métier, Frédéric Denise et Ivan Fouquet se sont clairement qualifiés comme architectes militants Ils utilisent leur métier et leurs projets pour manifester leurs convictions IV.1. Être un architecte engagé : lorsque l’acte de construire devient un acte militant
Ivan Fouquet décrit son implication militante par la réalisation de contre projets architecturaux Il en a constitué plusieurs avec son associé Ils portaient sur des projets urbains ou architecturaux qui ont fait polémique comme le projet de centre commercial Europa City, la destruction des jardins d’Aubervilliers ou encore la construction d’un aéroport à Notre Dame des Landes Pour ce dernier, les personnes investies dans ce combat avaient des compétences très variées, mais il n ’ y avait pas d’architectes Étant
d’origine nantaise et sensible aux enjeux du territoire, Ivan Fouquet a décidé de rejoindre le combat
“Par connaissance de militants écolos nantais, j’ai pu rencontrer des gens qui étaient dans la lutte et ils m’ont dit qu’il y avait des profils variés mais pas d’architectes. Grâce à toutes ces compétences, on a créé des ateliers citoyens bénévolement Cela nous a permis de montrer que l’aéroport existant pouvait être rénové et agrandi et donc que construire un nouvel a éroport sur Notre Dame des Landes n’était pas du tout logique On a donc eu raison car c ’est la solution qui a été choisi aujourd’hui ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Il s’était rendu compte que les porteurs du projet du nouvel aéroport justifiaient leurs propositions par des expertises Ils ont donc suivi le même processus en démentant leurs avancements par des contre expertises Les échanges n ’ont pas été simples mais cela a fait avancer le débat Ivan Fouquet prend position par cet exercice et soutient que la lutte en tant qu ’architecte se fait par contre expertise La lutte a finalement été gagnée pour Notre Dame des Landes mais ce n ’est pas toujours le cas Par exemple, les jardins d’Aubervilliers ont commencé à être détruits pour construire une piscine olympique dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024 Leur contre expertise avait prouvé qu’il était possible de construire la piscine sur le parking à côté des jardins et donc qu’ils auraient pu être sauvegardés Bien qu’ils n ’aient pas eu gain de cause, ils ont montré qu’il était possible de faire autrement
“J’ai pu montrer qu’on pouvait construire la piscine sur le parking à côté et pas sur les jardins. On s’est engagé pendant plus d’un an à essayer de convaincre que le projet était inutile, non pas la piscine mais la destruction des jardins. C’est assez mal engagé car ils ont commencé à construire la piscine et à détruire les jardins Globalement, on fait quand même avancer le débat, et ce n’est pas sûr que si aujourd’hui il y avait des décisions à prendre ils ne le feraient pas de la même manière ” (Ivan Fouquet, SCOP fair)
Le fondateur du collectif Archipel Zéro a également tout de suite qualifié sa pratique de “ militante” Comme nous l’avons évoqué dans la partie sur les trajectoires personnelles, Frédéric Denise s ’est d’abord engagé politiquement dans sa vie personnelle Ce sont ses convictions politiques qui l’ont mené à sa pratique actuelle d’architecte Il se désigne d’abord par le terme de militant puis d’architecte
“Dans ma pratique, je sens bien qu’aujourd’hui j’ai plus une approche militante Je me sens plus militant qu’architecte J’essaye de faire avancer les choses et c ’est ce qui me motive le plus J’utilise mon métier pour militer Je milite pour des valeurs sociales et environnementales ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Il affirme ses valeurs à travers l’exercice de sa profession qui se transcende en un exercice militant Pour cela, sa pratique architecturale s ’est adaptée Par exemple, il organise des chantiers participatifs, met en place des démarches inclusives, il travaille avec des entreprises d’insertion professionnelle, il bannit le béton de ses constructions et promeut les matériaux de réemploi L’acte de construire se transforme en un acte politique, non pas au sens d’un parti politique mais au sens du bien commun Ici, le politique ne correspond pas à ce que font les politiciens, ce n ’est pas partisan ou coloré C ’est une démarche orientée vers le bien commun
A contrario, les deux architectes de la jeune génération interrogés ne se sont pas positionnés sur la question du politique et du militantisme De manière générale, la France voit les jeunes générations se désintéresser de la politique Par exemple, les dernières élections présidentielles ont connu une importante baisse de la participation chez les 18 25 ans Ce détachement s ’explique par plusieurs phénomènes Ils n ’ont pas connu de grandes mobilisations et pour celles qu’ils ont vu, elles se sont terminées par des échecs (MILCENT, 2019) La sociologue Anne Muxel a partagé un constat dans le hors série du mensuel Sciences Humaines, Où va la France ? : “N’ayant connu que les crises sociales, économiques et aussi politiques taraudant la société française depuis une bonne trentaine d’années, les jeunes sont de fait porteurs d’une défiance globale” Entre déceptions et désillusions, les jeunes ne se sentent pas représentés dans les discours (MILCENT, 2019) Ils n ’admettent aucun parti politique particulier Jacques Ion affirme qu’il existe une multitude de manières d’être acteur de la société Il distingue des formes d’engagement qui vont de l’engagement militant à l’engagement distancié Il dit dans son ouvrage La fin du militantisme ?, “Si la modernité se caractérise par l’affaiblissement des modes d’appartenance et la pluralité des univers d’expérience, l’ère des individus n ’est pour autant pas nécessairement celle de la fin du politique ; au contraire, elle peut
précisément susciter de nouvelles aspirations à définir le cadre commun du vivre ensemble ” (ION, 1997) Ce phénomène est également présent chez les jeunes architectes Ils ne sont pas forcément dans une posture militante, au sens du militantisme politique, mais sur une posture du “faire”
“Cette question d’engagement, on ne se l’est jamais vraiment posée On prend rarement de recul sur ce qu’on fait, sur notre démarche, notre travail Ça fait deux ans que l’on a la tête dans l’eau, on fait ce qu’on fait mais on ne se pose pas pour définir nos valeurs, notre mission et nos engagements ” (Mathilde Héraut, Collectif ARTI/CHÔ)
Il est aussi important de noter que ces deux collectifs ont moins d’expériences et ont peut être plus de difficultés à se positionner clairement sur leur lien à la politique dans leur discours
Ces désirs d’engagements formulés par les architectes de notre étude de cas, se traduisent de manières plurielles dans leur activité professionnelle Ces échanges nous indiquent qu’ils vont largement au delà de l’acte de construire A travers ces positionnements, ils participent à une nouvelle forme de militantisme A l’heure d’une prise de conscience mondialisée et de profonds changements dans le métier d’architecte, nous nous demandons de quelle manière se projettent les professionnels de la construction
Cette dernière section se questionne sur l’évolution des pratiques à l’heure de la transition écologique : comment les architectes voient évoluer leur profession ? Comment les jeunes générations d’architectes se projettent dans l’exercice du métier ? La profession survit à de nombreuses crises depuis les années 1970 Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de ce mémoire, elles sont d’ordre économiques, identitaires et environnementales Le métier d’architecte s ’est alors vu modifié, réglementé et même déqualifié En parallèle, les conséquences dues aux changements climatiques se sont amplifiées L’intérêt pour les enjeux environnementaux et sociaux s'est accru et depuis quelques années, la population a été largement sensibilisée Ces problématiques sont apparues dans le secteur du bâtiment, tout d’abord de manière assez marginale puis de façon plus importante (Macaire, 2012) Une enquête d’opinion publique a été réalisée par l’IFOP en 2013, sous la commande du Conseil national Elle visait à comprendre les perspectives des architectes sur les objectifs du métier à l’horizon de 2030 L’étude a émis le constat que les architectes faisaient face à l’émergence de nouveaux enjeux : la qualité environnementale globale des bâtiments, ainsi que la compréhension des aspects techniques liés aux consommations énergétiques, sont perçues comme les principales pistes d’amélioration des agences d’architecture (Rouannet, 2013)
V.1. La transition écologique, la seule al ternative
L’ensemble des acteurs interrogés ont rejoint les constats de l’enquête évoquée précédemment Le développement des connaissances autour des principes conceptuels et des techniques constructives pour réaliser des bâtiments plus écologiques sont les enjeux des prochaines décennies Frédéric Denise affirme que les acteurs du secteur du bâtiment ont compris l’impact écologique qu'ils avaient et quelles étaient les améliorations envisageables pour chaque corps de métier Néanmoins, il soutient que le renouvellement des pratiques pourrait se faire plus
V. A l’heure d’un renouveau architectural : quelles évolutions pour les pratiques ?
rapidement mais les craintes vers les nouveaux modes constructifs freinent ces évolutions
“On voit bien qu’il y a une prise de conscience. On sait bien que nous sommes les plus pollueurs de la planète si on prend en compte : l’énergie dépensée en construction des bâtiments, l’extraction des matières premières, la production des déchets et la consommation des bâtiments Je pense qu’ils sont assez ouverts à faire leur part Cependant, cela avance assez doucement Il y a au ssi cette peur, qui va être compliquée à effacer Changer le regard des architectes sur des pratiques émergentes comme le réemploi, l’usage de la terre crue, ou des choses assez expérimentales va être long Je pense aussi qu’ils n’ont pas envie de prendre trop de risques ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Il est important de se souvenir que les architectes de sa génération ont vu toutes les réglementations arriver et se modifier au fil des années La même étude évoquée auparavant, émise par l’IFOP, signale que la gestion des questions réglementaires et administratives est le premier élément d’insatisfaction des architectes (Rouannet, 2013) Frédéric Denise témoigne des effets de ces événements
“Dans le secteur du bâtiment, les professionnels sont fatigués des changements de réglementations, surtout dans la réglementation thermique, qui sont de plus en plus compliquées. La réglementation d’accessibilité a changé beaucou p de choses et cela a été long à digérer. Avant ça, il y avait eu la réglementation incendie. Cela commençait à devenir assez pesant. C’est possible que les architectes se sentent un peu perdus et craintifs, notamment ceux de ma génération qui a vu tout ça arriver ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
La génération à laquelle appartiennent les architectes et par conséquent les évènements qu’ils traversent, peuvent jouer sur leur manière d’appréhender les nouveaux enjeux Ce n ’est pas l’unique raison de leur réserve mais c ’est un élément à prendre en considération Toutefois, certains architectes ne perçoivent pas les choses de la même façon Frédéric Denise assume, avec un ton légèrement provocateur, avoir réalisé des projets en béton qui n’étaient pas spécialement engagés Il n’était pas éveillé aux questions sociales et environnementales à cette époque là Pourtant, il a changé sa manière de faire de l’architecture afin d’être en phase avec ses convictions politiques Aujourd’hui, il pense que cela lui a même apporté car il sait comment fonctionne le système de la construction
“J’ai la chance d’être passé par là car ( ) cela m’a apporté la connaissance de la façon dont les autres construisent Il faut bien connaître l'ennemi, comment il fonctionne, comment il avance Pour pouvoir déjouer ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Cependant, il soutient que la jeune génération peut faire évoluer les pratiques en venant bouleverser les habitudes des générations d’architectes plus installées Il considère que les jeunes architectes sont tous sensibilisés aux questions environnementales et qu’ils désirent s’investir dans des projets qui font sens Frédéric Denise partage également son ressenti, il a l’impression que les femmes sont plus attirées par l’architecture écologique
“Je vois bien que la génération des trentenaires, n’a rien à voir avec la génération 10 ans avant. Tous les CV que je reçois pour me rejoindre sont des trentenaires, et la plupart sont des femmes. Il y a une question de génération et d e genre. Je pense aussi que le féminin est aussi plus attiré par le soin que l’on porte autour de nous, sur le monde, pour le réparer, pour lui faire moins de mal ” (Frédéric Denise, Archipel Zéro)
Aurélien Cantegrel du Collectif LOKAL remarque également que les étudiants de ces trois dernières années sont beaucoup plus sensibilisés à l’architecture écologique que la sienne Sa génération a suivi des cours d’architecture écologique mais elle était abordée par la technique, ils pensaient à l’impact des bâtiments pendant la phase de l’usage, sans inclure la phase de construction et de production des matériaux Une fois sur le marché du travail, ils ont été déconcertés d’observer à quel point il était difficile d’amener ce genre de réflexions lors de projet
“Quand je compare ma génération à celle 2/3 ans plus ancienne que moi, ou 2/3 ans plus jeune, il y a une évolution au niveau des mentalités qui est assez folle Et là, je te parle juste des promos que j’ai vu au sein de l’école Les pratiques de construire plus durable, avec les gens et pas tout seul dans notre bureau, il y a 5 ans les professeurs n’en parlaient même pas. Ce n’était même pas envisageable, on parlait un peu d’écologie mais par la technique. C’était le bio mimétisme, on faisait des choses très poussées, des doubles parois en verre. On pensait vraiment à l’impact énergétique de la phase d’utilisation du bâtiment sans penser à sa phase de constructio n Ce questionnement est arrivé assez tard dans mes études Par contre, au sein des générations qui ont suivi, c ’était des choses qui étaient beaucoup plus ancrées ” (Aurélien Cantegrel, Collectif LOKAL)
Néanmoins, bien que la jeune génération d’architectes aient davantage conscience des enjeux sociaux et environnementaux engendrés
par la crise écologique, leurs mentalités et leur approche au travail sont également le résultat d’une société libéralisée et mondialisée
Ivan Fouquet témoigne de l’engagement de la jeune génération qui a conscience des problèmes écologiques Cependant, il a constaté que le rapport au travail était différent chez les jeunes architectes Tout d’abord, il condamne les emplois proposés aux jeunes architectes dans les grandes agences d’architecture, où ils sont contraints de dessiner sur des logiciels toute la journée en gagnant un salaire misérable Lors de leur entrée sur le marché du travail, le nombre de jeunes diplômés en architecture saisis par la déception et la désillusion est colossal (Raybaud, 2020) Aujourd’hui, il constate qu ’ une grande partie des architectes cherche à donner un sens à leur pratique Aurélien Cantegrel voit que les architectes de sa génération n ’acceptent plus de travailler dans une agence où ils ne s’épanouissent pas Lorsqu’ils ne trouvent pas de sens à leur emploi, ils finissent par démissionner La jeune génération semble, en partie, façonner une nouvelle conception du travail Le développement personnel à travers leur activité professionnelle est important Ils désirent un équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie, en termes de sens et de valeurs Ce souhait peut les amener à choisir l’insécurité dans un emploi qui a du sens plutôt que la stabilité dans un travail qui n ’ en a pas Ils appréhendent moins l’instabilité que les générations précédentes et envisagent la précarité comme un événement temporaire (Meda & Vendramin, 2010) Toutefois, Ivan Fouquet assure que ce n ’est pas le type de travail que de nombreuses agences proposent Il explique également qu’il y a une cinquantaine d’années lorsque l’on décrochait un travail, il était possible de se dire que l’on va y travailler toute sa carrière et même si depuis le milieu des années 90, l’idée de l’emploi à vie n ’existe plus, l’organisation n’était pas aussi ouverte Les jeunes architectes craignent de s ’ engager plusieurs années dans une seule agence
Ivan Fouquet associe ce phénomène à la libéralisation du modèle économique français depuis plusieurs années Il souligne tout de même que c ’est important de trouver une stabilité dans une agence, spécialement en architecture où les projets durent plusieurs mois
“Le rapport au travail de la nouvelle génération est assez différent C’est ce qu’on a remarqué dans le milieu des SCOP ( ) Lors des entretiens, on parle de la SCOP et qu’il est important de s’engager un peu dans ce type de structure On sent que ça fait peur aux jeunes Il ne s’agit pas de leur dire qu’il va falloir qu’ils y travaillent toute leur vie mais en même temps c ’est important de trouver une certaine stabilité. S’il y a trop de “turn over ” dans une agence ou sur un projet c ’es t compliqué. Un projet d’architecture prend un an, deux ans et l’urbanisme ça dure encore plus longtemps. Si les personnes ne veulent pas travailler plus d’un an ou deux dans une entreprise, cela devient assez problématique. Je ne pense pas que cela soit uniquement du fait de la génération car l’économie a aussi été orientée comme ça Le modèle a été complètement libéralisé pour favoriser ça, donc aujourd’hui c ’est possible ” (Ivan Fouquet, scop FAIR)
Le collectif ARTICHÔ partage ce ressenti, il considère que leur génération ne se projette pas Elle se situerait dans le “faire” maintenant, le “faire” tout de suite
“On fait partie d’une génération qui ne se projette pas trop, on fait maintenant et on verra comment ça se passe plus tard ” (Collectif ARTICHO)
Pourtant ce n ’est pas une vérité absolue pour l’ensemble des jeunes architectes Face aux difficultés qu’ils traversent, ils ne réagissent pas de la même manière, certains se reconvertissent ou partent travailler à l’étranger (Topaloff & Vignando, 2016) et d’autres créent leur propre structure et mènent, au début, une double activité cumulant un travail “alimentaire” et un travail “épanouissant” Ils finissent par développer leur structure où leur pratique architecturale pour être en résonance avec leurs valeurs
Cet écrit interroge l’évolution de la profession d’architecte par le prisme de l’engagement dans l’exercice du métier Notre propos a été de comprendre les modes d’engagement des architectes, ainsi que les effets qu’ils induisent sur la manière de faire de l’architecture Ces positionnements induisent une architecture singulière, des choix de statuts juridiques spécifiques pour les structures, des procédés de communication et un accès à la commande particuliers Ces démarches, dont l’éthique professionnelle se présente de façon singulière, participent elles à un renouveau architectural ? Serait ce la genèse d’une nouvelle manière d’exercer le métier d’architecte ?
Ce sont ces questions qui ont encadré notre réflexion Nous avons d’abord identifié ces engagements et leurs conséquences, pour ensuite s ’attacher à l’étude des souhaits et perspectives de la jeune génération d’architectes
Les entretiens réalisés nous permettent de constater que les trajectoires personnelles influencent les parcours professionnels des architectes Bien que les études soient perçues comme un moment indicatif de leur orientation, de nombreux étudiants n ’ont pas toujours eu des cours prenant en compte les enjeux de la transition écologique Néanmoins, les deux architectes plus installés nous démontrent que les enseignements suivis en école d’architecture ne sont pas un frein à l’engagement social et environnemental Eux même n ’ayant pas été sensibilisés à ces questions à l’époque se sont auto formés à ces sujets Les positionnements des acteurs, que nous avons étudiés, dans leur profession engendrent un renouveau architectural Ces nouvelles manières de faire de l’architecture participent à la production d’une architecture singulière qui in fine bouleverse les approches à l’architecture L’architecte romain Vitruve énonçait, dans son traité De Architectura, les trois piliers de sa philosophie de l'architecture Firmitas, Utilitas et Venusta soit solidité, utilité et esthétisme L’équilibre de ces principes doit être retrouvé dans l’architecture Il est important de noter que les pratiques architecturales ne sont pas les seules façons de s ’ engager Les architectes de notre étude de cas, justifient leur positionnement à travers les choix de forme juridique pour leur structure, leur manière d’accéder à la commande et de communiquer avec les autres acteurs du processus de
projet Ces éléments peuvent être assimilés à une forme de militantisme L’acte de construire devient alors un acte que l’on peut qualifier de “ politique”, non pas au sens partisan mais vers le bien commun Comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente, la plupart des professionnels sont convaincus que l’évolution du métier va se réaliser par la prise en compte des paramètres écologiques Toutefois, nous pouvons affirmer qu ’ un mouvement est en marche
Notre écrit indique une transformation importante de la profession d’architecte, et si le métier change, la formation doit également s ’adapter Ainsi, ce travail de mémoire pourrait être complété par une étude de l’évolution des enseignements en école d’architecture et leurs perspectives face aux enjeux de la transition écologique Ces transformations interfèrent directement avec les manières de faire de l’architecture chez les étudiants et la jeune génération de professionnels Seulement une partie d’entre eux bénéficie de cours d’architecture et de l’urbanisme à l’ère du développement durable De nombreux enseignements ne prennent pas encore en compte ces questions, les étudiants ne sont donc pas formés de la même manière Toutefois, des initiatives sont à l'œuvre comme le réseau ENSAECO, qui a pour objectif de mettre en réseau les professeurs sensibles à l’écologie On pourrait également s’interroger sur la production architecturale conçue par ces futurs architectes qui n ’auront suivi que des enseignements tournés vers la transition écologique
Une seconde perspective de recherche pourrait être abordée à la suite de ce travail Elle porterait sur le renouvellement des principes et des objectifs de l’architecture Comme nous l’avons constaté dans cet écrit, les engagements sociaux et environnementaux des architectes étudiés participent à un renouveau architectural Nous pourrions nous interroger sur sa composition, dans les architectures frugales, vertueuses et nécessaires, quelle est la place laissée au beau ? Selon Vitruve, les trois piliers de l’architecture “utilitas, firmitas, venustas” soit l’utilité, la solidité et la beauté, représentent les trois principes fondamentaux de l’architecture Toutefois, pour les professionnels de ces nouveaux groupes ce n ’est pas nécessairement le principal, ils privilégient d’autres paramètres dans leur manière de faire de l’architecture
Ces interrogations, à l’origine émises lors de mes années de licence en école d’architecture, m ’ont poussé à m'interroger sur ma future pratique professionnelle Avec du recul, je me rends compte que je manquais cruellement d’exemples et de références d’architectes engagés Ces carences, alors vécues comme une remise en question de mon orientation professionnelle, m ’ont poussé à m’informer La découverte de structures engagées m ’ont donné espoirs et ambitions Ainsi, j’ai voulu approfondir ma compréhension de ces processus d’engagements Souvent raconté de manière succincte, je m’interrogeais sur les détails de ces cheminements : pour quelles raisons ? par quels moyens ? quelles conséquences ? Ces travaux de recherches, de lectures et d’analyses m ’ont permis de prendre conscience que la manière de s ’ engager est plurielle et finalement, assez personnelle Ainsi, je me sens davantage en harmonie avec la discipline que j’aborde depuis maintenant cinq années J’intègre le monde professionnel avec une vision plus optimiste, et certainement moins naïve, du métier d’architecte
Un peu plus de cinq années d’études se sont écoulées depuis que mes camarades et moi même avons fait nos premiers pas en école d’architecture J’aimerai profiter de ces lignes qui me sont accordées, pour remercier l’ensemble des personnes qui sont intervenues tout au long de mon cursus Enseignants, intervenants, amis, nos discussions m ’ont apporté un regard aiguisé sur la vie et l’architecture
Je tiens à remercier tout particulièrement ma directrice de mémoire, Madame Sabrina Bresson, pour son investissement, son accompagnement et ses conseils avisés ces dernières semaines J’ai également des pensées pour Madame Nadine Roudil, Madame Joséphine BASTARD, Madame Fanny Delaunay, Madame Antonella Di Trani et Monsieur Yankel Fijalkow qui m ’ont suivi dans l’élaboration du sujet de ce mémoire, nos échanges m ’ont permis de développer ma réflexion et mon approche
Merci à mes parents pour leur soutien et leurs relectures Merci à mes amies Mila Berton, Marie Feyfant, Ines Azzoug et Charlotte Dhommée qui m ’ont soutenu tout au long de l’écriture de ce mémoire Merci à mon amie Emma Thieffry, avec qui j’ai passé de longues journées à la bibliothèque Ces moments m ’ont permis d’apprécier ces séances de travail et m ’ont poussé à me dépasser Cela me manquera
Enfin, je souhaite remercier Monsieur Frédéric Denise, Monsieur Ivan Fouquet, Monsieur Aurélien Cantegrel et Madame ???? q ui m ’ont accordé leur temps et leur patience lors des entretiens A tous, un grand merci
AMBROISE RENDU A , HAGIMONT S , MATHIS C , VRIGNON A (2021), Une histoire des luttes pour l’environnement : 18e 20e, trois siècles de débats et de combats, Paris, Textuel, 304 p
BACQUE M , BIEWENER C (2015), L’empowerment, une pratique émancipatrice ?, Paris, La Découverte, 176 p
BIAU V (2020), Les architectes au défi de la ville néolibérale, Paris, Editions Parenthèses, 288p
CHADOIN O (2013), Être architecte : les vertus de l’indétermination, Pulim, 383p
ION J (1997), La fin des Militants ?, Paris, Editions de l’Atelier, 130 p
POUVREAU B (2004), Un politique en architecture Eugène Claudius Petit (1907 1989), Evreux, Moniteur, 358 p
TETRIACK P (2001), Faut il pendre les architectes ?, Points, 208 p
TAPIE G (2008), Les architectes : mutation d’une profession, L’Harmattan, 318 p
ASSOCIATION DIDATTICA (2007), “Construire quoi, comment ? L’architecte, l’artiste et la démocratie”, Architecture institutionnelle
BIAU V (1995), “Les architectes français et la tentation du "star system"”, Revue du Centre Franco Russe des Sciences Humaines de l'Académie des Sciences de Moscou, 18 p
BLANC M (2010), “Métiers et professions de l’urbanisme : l’ingénieur, l’architecte et les autres”, Espaces et sociétés, n° 142, pp 131 150
CAMUS C (2010) “Pour une sociologie “constructiviste” de l’architecture”, Espaces et sociétés, vol 142, no 2, 2010, pp 63 78
CHAMPY F (1999), “ Vers la déprofessionnalisation ? : L’évolution des compétences des architectes en France depuis 1980”, Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, pp 27 38
CHAMPY F (2009), “L’engagement des professionnels comme conséquence de tensions consubstantielles à leur pratique : l’architecture moderne entre les deux guerres ” , Revue Sociétés Contemporaines, n° 73, pp 97 119
DELAUNAY F , GOURVENNEC E (2020) “Les SCOP d’architecture : un modèle de coopération ? ” , Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère Repéré à Les SCOP d’architecture : un modèle de coopération ? (openedition org)
DUBOST F (1985), “Les nouveaux professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme”, Sociologie du travail, n° 2, pp 154 164
JACQUAND C (2013), “Leberecht Migge et la colonie agricole évolutive “selon les principes biologiques” ” , In Situ Revue des patrimoines Repéré à Leberecht Migge et la colonie agricole évolutive « selon les principes biologiques » (openedition org)
LAZUECH G (2006), “Les cadres de l’économie sociale et solidaire : un nouvel entreprenariat ? ” , Revue Française de Sciences Sociales Repéré à Les cadres de l’économie sociale et solidaire : un nouvel entreprenariat ? (openedition org)
MACAIRE E (2008), “ Ville, art et politique : un nouveau champ d’action pour les architectes”, Presses Universitaires de Nancy
MACAIRE E (2015), “Collectifs d’architectes, expérimenter la coproduction de l’architecture”, Lieux communs, n° 17
MATHIS C (2021), “L’émergence de la pensée écologique en ville”, Métropolitiques Repéré à L’émergence de la pensée écologique en ville Métropolitiques (metropolitiques eu)
MERCKAERT J (2011), “Agir à gauche L'économie sociale et solidaire”, Revue Projet, n° 323, pp 105
MEDA D , VENDRAMIN P (2010), “Les générations entretiennent elles un rapport différent au travail ? ” , SociologieS Repéré à https: //doi org/ 10 4000/sociologies 3349
MILCENT M (2019), “Les jeunes sont ils vraiment dépolitisés ? ” , LVSL Repéré à Les jeunes sont ils vraiment dépolitisés ? (lvsl fr)
MOLINA G (2014), “Mise en scène et coulisses du star system architectural : la théâtralisation des vedettes et ses paradoxes”, Espaces et sociétés, n° 156 157, p 197 212 Repéré à https: //www cairn info/revue espaces et societes 2014 1 page 197 htm
PEYCERE D (2000), “La pratique de l'architecture en France au XXe siècle”, La Gazette des archives, n° 190 191, Les archives des architectes, pp 187 198
POUVREAU B (2009), “Quand le communisme municipal rimait avec laboratoire urbain”, Acte des journées « Les territoires du communisme » CHS
RAMAU , ROUDIL N (2012), “Fabriquer la ville à l’heure de l’injonction au durable”, Métropolitiques Repéré à Fabriquer la ville à l’heure de l’injonction au « durable » Métropolitiques (metropolitiques eu)
ROUANET F (2013), “Les architectes et l’évolution du métier à l’horizon de 2030”, Cahier de la profession, n°47, 2013
CEBALLOS R , EHRLICH P (2015), “Accelerated modern humaninduced species losses : Entering the sixth mass extinction”, Science Advances, vol 1, n°5 Repéré à Global Science Teaching for Human Well Being (scirp org)
COLLET P (2011), “La réglementation thermique de 1974 à aujourd’hui”, Actu Environnement Repéré à La réglementation thermique de 1974 à aujourd'hui La RT 2012 bientôt en ordre de marche (actu environnement com)
DASSA N (2016), “Frank Lloyd Wright, précurseur de l’architecture organique”, D’CO Magazine Repéré à Frank Lloyd Wright, précurseur de l’architecture organique TRAITS D'CO Magazine (traits dcomagazine fr)
KURNAZ A (2021), “Green building certificate systems as a greenwashing strategy in architecture”, Bartin University International Journal of Natural and Applied Repéré à Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences » Submission » GREEN BUILDING CERTIFICATE SYSTEMS AS A GREENWASHING STRATEGY IN ARCHITECTURE (dergipark org tr)
RAYBAUD A (2020), “ « On nous a vendu un rêve » : de l’école à l’agence, les désillusions des jeunes architectes”, Le Monde Repéré à « On nous a vendu un rêve » : de l’école à l’agence, les désillusions des jeunes architectes (lemonde fr)
TOPALOFF A , VIGNANDO D (2016), “Boudés chez eux, les jeunes architectes français s ’exportent”, Ecolobs Repéré à Boudés chez eux, les jeunes architectes français s'exportent
Réglementation environnementale RE2020 (2022) Ministère de la Transition écologique, 24 Janvier Repéré à Réglementation environnementale RE2020 | Ministère de la Transition écologique (ecologie gouv fr)
MACAIRE, E (2012) L’architecture à l’épreuve des nouvelles pratiques : recompositions professionnelles et démocratisation culturelle (Thèse)
Université Paris Est
MOSCONI, L (2019) Emergence du récit écologiste dans le milieu de m ’architecture 1989 2015 : de la réglementation à la thèse de l’anthropocène (Thèse) ENSA Paris Malaquais
BORNAREL A , GAUZIN MULLER D , MADEC P (2018), “Manifeste pour une frugalité heureuse et créative” Manifeste pour une frugalité heureuse (frugalite org)
DIEMER A (2009) Le rapport Meadows (1972) Repéré à : MOOC UVED EDD
LEJEUNE L (2013) Coconstruction : l’architecture solidaire a enfin pignon sur rue Libération Repéré à : Coconstruction : l’architecture solidaire a enfin pignon sur rue Libération (liberation fr)
Les Bâtisseurs (2021) Manifeste Repéré à : MANIFESTE | Bâtisseurs d'un monde meilleur (batisseursdunmonde wixsite com)
Ministère de la transition écologique (2022) Bâtiment et Biodiversité Repéré à : Bâtiment et Biodiversité | Ministère de la Transition écologique (ecologie gouv fr)
Ministère de la transition écologique (2021) Energie dans les bâtiments Repéré à : Énergie dans les bâtiments | Ministère de la Transition écologique (ecologie gouv fr)
Ordre des architectes (2015) La profession en chiffres Repéré à : La profession en chiffres | Ordre des architectes
ROLLOT M (2018) Faire l’expérience du tournant climatique : l’architecture est elle un levier potentiel ? Repéré à : Faire l'expérience du tournant climatique: l'architecture est elle un levier potentiel? (archives ouvertes fr)
Sénat (2004) Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril Repéré à : Métiers de l'architecture et du cadre de vie : les architectes en péril (senat fr)
The Shifters (2021) Synthèse vulgarisée du résumé aux décideurs du groupe de travail de l’AR6 Repéré à : Synthèse du rapport AR6 du GIEC publié le 09/08/2021 (theshiftproject org)
Conférence de Stockholm (1972) (univ valenciennes fr)
ENSAECO, L’enseignement de la transition écologique en école d’architecture Repéré à : Accueil ENSAECO (archi fr)
Ecole Zéro (2019) Ecole Zéro, site internet Repéré à : École Zéro (ecolezero com)
Conférence de Sophie Ricard, La permanence architecturale, organisé par Frugalité heureuse et créative « La permanence pour un urbanisme vivrier » , avec Sophie Ricard
Conférence de Marie et Keith Zawistowski, Construire pour apprendre ou apprendre à construire, organisé par Frugalité heureuse et créative https: //youtu be/ uUv CSsrzU
Conférence de Samuel Bonnet, La construction au Comité internationale de la Croix Rouge, organisé par la Maison d’architecture d’Aquitaine https: //youtu be/pFf 6e0FVq8w
Les Bâtisseurs, Morgan Moinet Réemploi : une norme en devenir, 25’
Les Bâtisseurs, Concevoir avec la réutilisation : les sédiments marins comme ressource Gwilen, 31’
Les Bâtisseurs, École à ciel ouvert : faire preuve par le terrain Bellastock, 36’
Mies FR, Véronique Biau UNI, 8’
Emicfd, Jean Louis Laville Agir à gauche / L'économie sociale et solidaire, 13’
Figure 1 : Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade est, qui est en matériaux de réemploi Elle a été prise depuis le jardin partagé qui entoure le bâtiment Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
Figure 2 : Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de l’espace de circulation en rez de chaussée Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
Figure 3 : Photographie tirée du site internet du collectif Archipel Zéro Elle rend compte de la façade sud, qui est en matériaux de réemploi Projet de construction du bâtiment Résilience qui accueille La Ferme des Possibles à Stains
Figure 4 : Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte de l’espace commun dans les bureaux Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 5 : Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 6 : Photographie tirée du site internet de la SCOP fair Elle rend compte des espaces de réunions partagés Projet de réhabilitation des bureaux du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ADAFORSS à Levallois Perret
Figure 7 : Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte d’un atelier participatif organisé par l’association Ils construisaient un fauteuil avec des matériaux de réemploie Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
Figure 8 : Photographie tirée des réseaux sociaux de l’association ARTI/CHÔ Elle rend compte de quelques pièces de la série de mobiliers réalisés par l’association Construction de mobiliers design avec des matériaux de réemploi
Figure 9, 10 et 11 : Photographie tirée de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte de l’aménagement de l’une des chambres étudiantes Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan
Figure 12 : Photographie tirée de la plaquette du Collectif LOKAL Elle rend compte d’un moment d’échanges avant de commencer les ateliers du chantier participatif Permanence architecturale au sein de la résidence CROUS de Cachan
Annexe n° 1 : Grille d’entretien pour l’étude de cas.
Pouvez vous nous parler de votre structure ? Comment est elle née ? Comment a t elle évolué ?
Positionnez vous comme une structure engagée ? Quelles sont les valeurs que vous soutenez ?
Ces engagements vous ont ils orientés vers des choix de structure différente et pourquoi ?
Sur quels types de projets travaillez vous ? Et pourquoi vous êtes sensible à ces projets ?
Pourquoi avez vous choisi de suivre ces engagements dans votre profession ? Ont ils évolué ?
Pour quelles raisons êtes vous sensibles à ces valeurs ? Est ce que vous les avez depuis longtemps ? (Construite en suivant une trajectoire)
Quelle est cette trajectoire ? Pouvez vous me parler de votre parcours ?
Comment avez vous choisi de pratiquer l’architecture ? (motivations, moments déterminants)
De quelle manière traduisez vous les engagements, évoqués auparavant, dans l’exercice de votre métier ?
Ont ils un impact dans votre pratique architecturale ? Quels sont ils ? (choix de conception différent ou “ en fonction de” pour respecter vos valeurs, frein à la créativité dans certains cas)
Est ce que cela vous conduit à produire une architecture singulière ?
4 . Projet (un exemple choisi au préalable)
Pouvez vous nous parler plus précisément d’un projet ?
Que pouvez vous nous dire sur ce projet ? Quelle approche architecturale avez vous eu ?
Comment s ’est passé le déroulement du projet ? (liens avec les acteurs, etc)
Quelles sont les éventuelles difficultés rencontrées ?
5 L’accès à la commande, le marché, positionnement
Les engagements que vous avez évoqués auparavant, induisent ils des rapports de travail différents dans la manière d’accéder à la commande ? (privé, public)
Positionnez vous dans un marché en particulier ? Pour quelles raisons ?
Avez vous dû faire des choix dans les projets de construction qui vous étaient proposés ?
6 Relations avec les autres acteurs
Quels liens se nouent, entre les architectes et les autres acteurs, quand les convictions et les valeurs s ’ en mêlent ? (maître d’œuvre, entreprises, artisans)
Quelles ont été les difficultés ou les facilités que vous avez pu rencontrer ?
Comment s ’est déroulé la suite du projet ? Quelles ont été vos stratégies pour le convaincre ?
Comment voyez vous la pratique de l'architecture évoluer ? Et votre propre pratique ?
Comment vous voyez évoluer votre pratique ?
Annexe n° 2 : Tableau de croisement des données
“J’aime travailler en collectif mais je n ’aime pas être patron Je ne sais pas faire et je me rends compte que je ne sais pas déléguer non plus ”
“Cependant, j’aime travaille r avec d’autres collectifs, architectes libéraux, agences mais en tant que deux individualités Je ressens plus d’égalité comme cela et je peux parfois être seul ”
“Ce projet vise à créer un collectif informel qui vise à regrouper des architectes, ou des professions connectées qui partagent les mêmes objectifs Ainsi, trouver une véritable horizontalité ”
Association
“Nous avons fait le choix d’une association pour des raiso ns administratives ”
“Nous ne sommes pas employés de l’association, mais nous travaillons sous le statut d'auto entrepren eur On aimerait pouvoir se payer à partir de l’année prochaine ”
Association
“On pourrait peut être payer une partie des membres mais ce n ’est pas l’objectif car nous sommes toujours en train de nous former ”
“Nous voulons nous payer avec des formations, cela reviendrait à investir dans le collectif ”
“C’est selon nous le modèle le plus engagé vers la société ”
“Ce modèle vise à pérenniser une structure ”
“Ce fût un vrai choix, pour nous l’engagement se situe davantage par le fait d’apporter quelque chose à la société et sortir du modèle individualiste des grosses agences d’architectures ”
Se positionne comme une structure engagée vers un double engagement (social et environnement al)
“La radicalité est importante dans un projet Le projet est toujours idéal lorsqu’on le dessine puis la réalité est corrosive Les objectifs deviennent de perdre le moins possible d’engagement au moment de la réalisation ”
“Ma pratique est en constante évolution, chaque projet nourrit le prochain ”
“On s’interdit des choses lorsque l’on est engagé, mais on ose aussi d’autres choses ”
Ne se positionne pas vraiment comme un structure engagée (frontalement) “Nous n ’ avons pas vraiment réfléchi aux valeurs et à notre mission avant aujourd’hui Nous voulions surtout faire des choses en réemploi ”
“Je dirai que nos valeurs sont le faire ensemble et la gouvernance partagée, donc c ’est travailler avec le client, les usagers par des chantiers participatifs ”
“Lorsque l’on construit en réemploi, le projet change forcémen t Lorsque l’on veut faire en groupe, le projet change aussi Cela prend beaucoup de temps et on ne fait pas le projet de la même façon ”
Ne se positionne pas vraiment comme un structure engagée (frontalement) “Nous organisons des chantiers participatifs dans le but d’apprendre ensemble, d’expérimenter et de partager des moments de convivialité "
“Nous ne concevons pas toujours nos projets mais nous avons toujours besoin d’une marche de manœuvre pour organiser les chantiers, le choix des matériaux ”
“Nous devons remettre en question la conception lors du chantier, c ’est une démarche intéressante ”
Se positionne comme une structure engagée vers un double engagement (social et environnemental ) “Pour ce qui est du social : nous ne travaillons pas pour des promoteurs ou de grandes entreprises On travaille pour des associations ou dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, ou pour des projets publics ”
“Pour ce qui est de l'environnement : nos principes de conception et de réalisation sont les plus vertueuses possib les ”
“Nous travaillons beaucoup plus en amont avec les ingénieurs pour réfléchir à des dispositifs plus économes en énergie ”
“Nous incluons très rapidement le budget pour ne pas avoir de mauvaise surprise ”
Deux types de liens sont illustrés
“Les projets très engagés : ne peuvent se faire qu ’ avec un ensemble d’acteurs engagés Cela fait des projets pilotes pour montrer la voie aux autres et les rassurer Les projets avec des acteurs pas sensibilisés, il faut faire place à de la pédagogie pour sensibiliser et convaincre Je trouve que c ’est très valorisant Je trouve le sens du métier à travers cela L’engagement dépasse la pratiq ue et c ’est l’exercice militant qui entre en jeu ”
“On vient me chercher pour ma pratique et ma radicalité Parfois, je refuse des projets car ils ne collent pas à mes valeurs Je peux le faire car je suis installé ”
“Les personnes qui les sollicitent les contactent pour ce qu’ils font, donc généralement il n ’ y a pas de problèmes ”
“Nous avons quelques difficultés avec des clients privés et l'utilisation du réemploie car cela arrive qu’il y a du changement en fonction du matériel que l’on a et les gens ne le comprennent pas forcément ou ne l’acceptent pas ”
“Ce n ’est pas de notre fait mais on travaille avec beaucoup d’associations
On vise à arrêter les projets avec des clients privés car c ’est trop complexe "
“Nous répondons à des appels d’offres, pas forcément engagés, dans ce cas ils essayent de ramener les choses à leur pratique en argumentant ”
“Cela a été difficile de communiquer avec entreprises car ils ne voulaient pas s ’ y sensibiliser car pas d'intérêts économiques ”
“Nous apprenons aux côtés des autres ”
“Nous n ’ avons jamais démarché, tout se fait par nos réseaux et nos rencontres ”
“Les acteurs avec lesquels nous travaillons ont de plus en plus conscience des enjeux ”
“Pour les entreprises : c ’est l’économie qui dirige tout, c ’est compliqué mais il faut choisir les bonnes personnes “
“Nous, nous sommes dans le réseau des SCOP ”
“Nous répondons à des appels d’offres publics mais nous faisons une sélection Nous n ’ avons pas de difficultés particulières avec les autres acteurs ”
“Nous avions conscience au départ personnelle, là appliquer dans sa profession trouve son approche militant dans sa pratique et ils militents pour des valeurs environnement ales et sociales : mise en place de chantiers participatifs, démarches inclusives, travaillent avec des entreprises d’insertion, zéro béton, réemploi, etc démarche est totalement politique, pas au sens d’une couleur mais a u sens du bien commun “comment on gère la ville tous ensemble”
Au départ c ’est un choix politique qui l’a mené à sa pratique puis ajd c ’est sa pratique qui soutient ses choix politiques du départ
“Nous avons participé à la réalisation des contre projets de l'aéroport de Notre Dame de Landes et aux Jardins d’Aubervilliers ”
Prise de conscience chez les jeunes et les femmes
“Je remarque une peur du risque chez les générations d’architectes plus anciens, là où la jeune génération a tout de suite été dedans donc peut y faire beaucoup ”
“J’observe beaucoup d’engagements de la part des trentenaires, notamment des femmes ”
Evolution des pratiques
“Je pense que cela va vers le positif mais que ça va être encore long à cause de la peur et de toutes les normes qui verrouillent tout ”
“La question de la génération, des enseignements que l’on a eu et aussi du genre se pose ”
“Nous sommes une génération qui ne se projette pas trop, on fait maintenant et on verra comment ça se passe plus tard ”
“On observe de plus en plus de jeunes collectifs et c ’est super, peut être que tout cela sera finalement une pensée unique ”
“J’ai constaté une énorme évolution des enseignements en 5 ans ”
“La nouvelle génération est beaucoup plus sensibilisée ”
Evolution des pratiques “A l’époque, on parlait d’écologie mais par la technique comme le biomimétisme etc On pensait à l’impact d’un bâtiment seulement pendant sa phase d’usage, sans penser à sa phase de construction etc ”
Jeune génération a conscience du problème mais développe un rapport au travail différ ent
“Je constate comme une peur face à l’engagement ”
“La jeune génération a un rapport différent au travail, ce n ’est pas que lié à l’époque mais aussi grâce au modèle économique qui permet ça depuis des années Le problème c ’est qu ’ en architecture c ’est qu ’ un projet dure souvent au moins un ou deux ans?
C’est difficile de garder des jeunes longtemps dans les structures ”
TRAJECTOIRES PERSONNELLE S
Évènements marquants, change de pratique radicalement
“Je me suis installé en sortant de l’école A ce moment là, je n’étais pas militant, je n ’avais pas l’aplomb d’imposer ce qu’il voulait à mes clients donc j’ai fait de l’architecture classique ”
“J’ai pris conscience de ces enjeux un peu avant 2010 A ce moment là, je me suis engagé en politique dans le mouvement de la décroissance pour les élections locales ”
“A un moment , il n’était plus possible d’assumer le fossé entre mon engagement politique et ma pratique qui ne suivait pas J’ai renversé la table ”
“J’ai alors fait une formation autour de l’éco construction, où j’ai écrit un mémoire qui s’intitule “architectes objecteurs de croissance”
“J’ai monté l’association en 2019 avec 5 personnes de mon DSAA , diplôme supérieur d’arts appliqués à vitry sur seine On était en cours et on voulait fa ire des projets concrets et engagés ”
Plusieurs désillusions et évènements marquants qui l’ont poussé à créer l’association
“J’ai travaillé en freelance pendant mes études, alors j’ai été sur des chantiers traditionnels, j’ai vu l’absurdité que c ’était, la débauche de moyen ”
“Après mon diplôme, je me suis lancé dans un projet entrepreneurial sur le recyclage sur les chantiers avec une start up ”
“J’ai fait mon hmonp, j’ai travaillé pour un architecte qui lançait son agence, j’ai assisté au côté sombre de l’architecture avec les promoteurs Ce fût une véritable gifle ”
“Pendant le confinement j’ai beaucoup bricolé, j’ai alors eu l’idée avec un ami de lancer notre association ”
“Je continu de travailler à côté et voudrait créer un écolieu ”
“J’ai étudié à La Villette qui était une école assez engagée sur des sujets sociaux de l’époque Je suis parti deux ans aux Etats Unis, à San Francisco Il y avait
énormément de personnes très engagées ”
“Puis j’ai travaillé en freelance et je me suis formé sur l’architecture bioclimatique J’ai travaillé chez Shigeru Ban qui était dans le réemploi et j’ai bossé pour une agence franco marocaine qui réfléchissait à une ville écologique ”
“J’ai également tenu un blog sur la construction écologique ”
“J’ai rencontré mon associé et on a fondé la scop fair en 2017 environ ”
Face aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque, des groupes d’architectes défendent une démarche de projet “frugale” Ces collectifs défendent une nouvelle approche de la profession Ils s ’engagent vers des valeurs environnementales et sociales Ce positionnement se traduit de plusieurs façons dans l’exercice du métier d’architecte Il semble révéler des pratiques architecturales qui participent à une prise de conscience de l’urgence écologique et bousculent les codes traditionnels du champ de l’architecture Ce travail de mémoire s’intéresse à l’évolution de la profession d’architecte Il se divise en trois parties Tout d’abord, nous avons effectué une analyse croisée des crises majeures qui touchent les architectes depuis le début du XXe siècle Puis, nous avons présenté les collectifs sélectionnés pour notre enquête d’étude de cas Enfin, nous avons analysé les principes selon lesquels les architectes définissent leurs engagements Simultanément, écrit pour une prise de responsabilité et enquêtes sur les incidences d’un positionnement militant dans le cadre de sa profession, ce travail met en avant l’engagement de groupes d’architectes face à la crise écologique
Mots clefs : Architectes Engagement Ecologie Pratique architecturale Militantisme