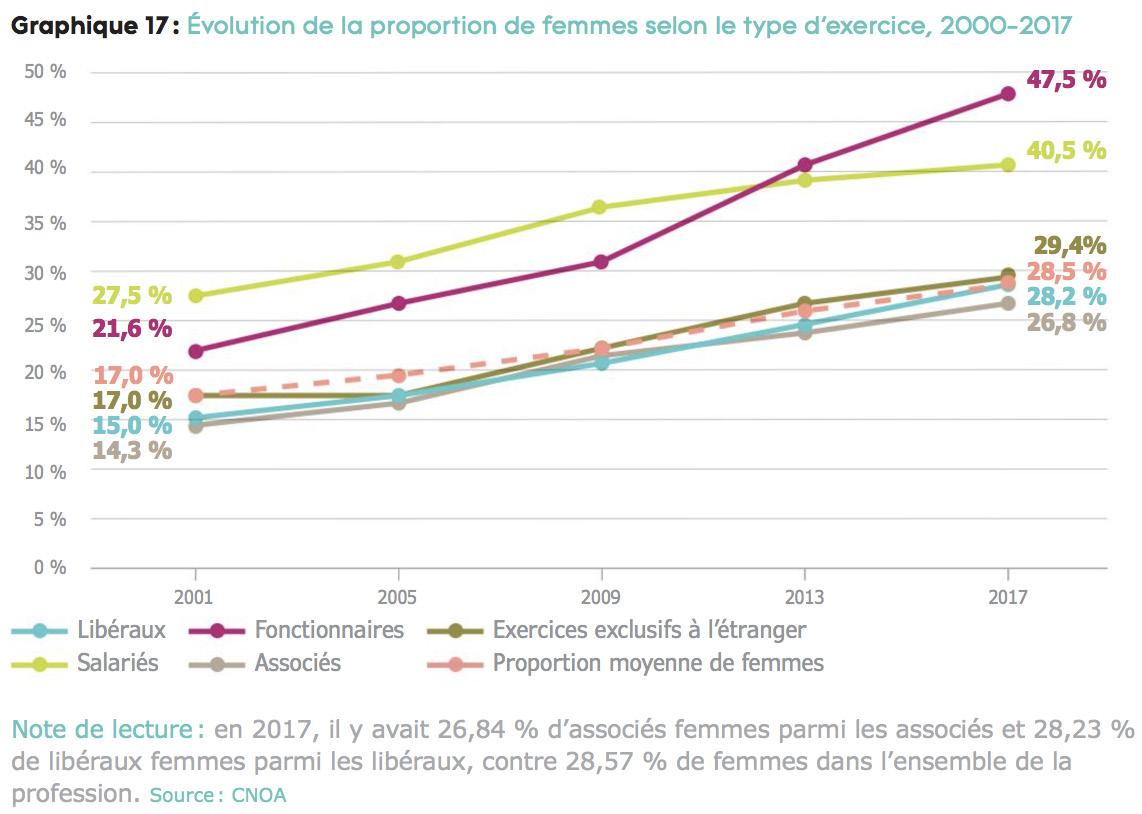6 minute read
Ré-enchanter la ville
from #8 Mars 2020
Ré-enchanter la ville Un équilibre entre poésie du projet et enjeux contemporains
C’est avec les yeux pleins de magie que nous appréhendons l’idée d’enchantement. Elle appartient au registre du merveilleux, évoque le bucolique des contes de fées de notre enfance et laisse notre imagination débridée prendre son envol. Le terme est pourtant loin d’être anodin dès lors qu’il concerne les problématiques urbaines. Depuis toujours, la ville concentre les flux de personnes, d’informations et de marchandises. Sa morphologie et son fonctionnement semble être le juste reflet des problématiques qui animent le quotidien de ses habitants. Nous nous interrogeons sur le renouvellement de la morphologie urbaine et sur l’implication du citadin et de l’architecte dans ce processus.
Advertisement
La ville contemporaine
Une échelle de ville qui change
La ville européenne traditionnelle était déjà vecteur de flux, aujourd’hui ceux-ci se sont accélérés et dématérialisés. De fait, la ville traditionnelle était limitée par les déplacements de ses habitants. Ils s’y déplaçaient principalement à pied, la vie se centrait sur un ou plusieurs points d’intérêt collectifs, tels que la place du marché et de l’église. La ville d’aujourd’hui est en expansion constante, et si ce n’est en terme d’expansion spatiale, ça l’est en termes de densification et de rayonnement culturel. Le développement des réseaux de transports accélère nos déplacements, remet en question les limites et l’échelle d e la ville : on ne raisonne plus en terme de distance mais en terme de temps. Par ailleurs les lieux de vie collectifs se diluent dans l’immensité de la ville. Nous comprenons que l’échelle de la ville se déforme, de même que le rapport au réel : quand la ville traditionnelle s’ancre dans la proximité et le pragmatisme, la ville contemporaine - plus ambitieuse - se déconnecte de ses préoccupations primaires, se soustrait aux distances pour devenir virtuelle et étendre son influence.
Le cas de la canopée des Halles
La nature profonde de la ville est en mutation. Tel un organisme vivant et sensible, elle possède une histoire, un patrimoine et des temporalités qui constituent son identité. Cependant, elle doit pouvoir continuer à répondre au même besoin essentiel : abriter et accueillir la vie. Elle doit loger, restaurer, soigner, enseigner, divertir ses habitants et aussi affirmer son influence à l’échelle de la région, du pays, voire du monde. L’enjeu est donc de créer des infrastructures capables de supporter des fonctions toujours plus lourdes et qui respectent le fonctionnement et l’identité de chaque ville. La complexité du problème peut être illustrée par la Canopée des Halles de Paris. De fait, Patrick Berger et Jacques Anziutti proposent un projet aux allures futuristes, qui se pose tel un OVNI au milieu de la capitale pour recouvrir le fameux « trou des halles ». L’édifice se densifie en sous-sol, afin d’accueillir des commerces, et de connecter le nombre phénoménal de réseaux de transports qui y transitent. Cette canopée souhaite s’affirmer comme l’équivalent 2.0 des anciennes Halles Baltard. Celles-ci étaient représentatives d’une époque, où l’échelle de vie et des échanges permettaient la rencontre et le contact humain. Pouvons-nous en dire autant de la canopée? Pas si sûr, l’espace public y est assailli par les marques internationales, les individus y transitent sans se connaître ni se rencontrer. L’infrastructure impressionne mais ne charme pas. Nombreux sont ceux qui pleurent la perte des Halles Baltard et de leur valeur historique. Les réprobations virulentes peuvent être faciles, mais elles ne seraient pas justes car l’exemple de la canopée ouvre de nouvelles questions assorties de possibilités. Celle de l’identité du lieu, qui même dans un nouveau contexte temporel demande une attention particulière pour son passé. Mais aussi et surtout, la nécessité de canaliser les flux tout en préservant leur qualité - ou en d’autre terme - la vie, la valeur et la force intrinsèques aux interactions humaines.
De ce fait, la ville mouvante doit relever trois défis : celui de préserver les relations humaines dans des pôles urbains intensifiés, d’affirmer une écriture architecturale contemporaine en veillant à sa cohérence historique et ce tout en tenant compte de l’urgence écologique.
Renouveler notre manière de faire projet
La féérie de la ville a tendance à se noyer dans les besoins d’une société pragmatique et ergonomique qui qui a tendance à discréditer son charme. Certains ouvrages certes, fonctionnalistes, négligent parfois la poésie, et l’exaltation que devrait offrir l’architecture. Évidemment, la question du beau reste subjective mais, au-delà des questions fonctionnelles, l’architecte conserve sa mission initiale d’esthète responsable. Ré-insuffler la vie, susciter l’émotion, trouver un équilibre entre concept et problématiques contextuelles se profilent comme les objectifs qui caractérisent cette mission.
Les grands projets urbains
La ville court et ne s’est jamais arrêtée à l’état d’utopie figée. Ce concept illusoire, est un idéal fantasque irréalisable (littéralement d’un “lieu qui n’existe pas”) dont les tentatives de mise en place s’avèrent parfois désastreuses. L’utopie contemporaine serait - peut-être - de broder un urbain contemporain sur le tissage existant. Faire lieu en se réappropriant les espaces, leur offrir une nouvelle identité sans brusquer l’ancienne. Comme le dit si bien Luigi Snozzi : “rien n’est à inventer, tout est à réinventer”.
Or, on observe depuis maintenant quelques années l’apparition des ZAC qui fleurissent dans l’hexagone, en périphérie des villes. Ces nouveaux quartiers viennent se greffer brusquement à l’existant et composent un catalogue architectural hétérogène où chaque projet tente de se démarquer. Ils s’érigent en déployant un urbanisme de grande consommation ; ces nouveaux quartiers semblent tous semblables car ils sont soumis à des normes rigides. À l’inverse, certaines villes ré-investissent leurs bâtiments abandonnés en leur donnant une nouvelle vie. La ville de Nantes a pris le parti de conserver la structure des quais pour créer le projet des «Mondes Marins» au sein des anciens chantiers navals. Ce lieu ayant pour vocation de réveiller l’art forain avec les différentes machineries, rend compte de l’attachement des Nantais au passé maritime de la ville.
Projet spontané des habitants
Les habitants prennent également des initiatives en développant des projets participatifs et animent les quartiers. Ce type d’action volontaire illustre aussi l’importance de la petite échelle. L’exemple des Grands Voisins à Paris, mis en place dans un cadre associatif, illustre une réussite en la matière. Ces lieux reposent sur l’investissement des citoyens, l’échange et la sensibilisation à des sujets tels que l’écologie ou la culture. À sa manière, la ville de Détroit (États-Unis) a réussi à se remettre de la crise économique après une période de désertification. Récemment la Maison Blanche a alloué un budget aux habitants organisés au sein d’associations et de fondations. Le résultat est plutôt encourageant : les friches ont été transformées en trames vertes, des projets artistiques, agricoles et éducatifs fleurissent de ces lieux alternatifs. Le succès de ces projets participatifs contribue à faire entendre la voix des citoyens auprès des acteurs décisionnels, qui laissent davantage place aux réflexions et actions collectives.
L’architecte comme médiateur
Finalement, le rôle de l’architecte consisterait à orchestrer toutes ces actions. Avoir une vision à grande échelle n’est pas indissociable de la création de lieux plus restreints agissant comme des points chauds, attractifs au sein de la ville. S’inspirer de l’implication citoyenne, l’intégrer au projet garantirait la conception de “petits projets bien pensés”. De même, Manuelle Gautrand, avec son projet de logement Edison Lite à Paris, amorce la conception participative, l’habitant a la possibilité de personnaliser son logement via l’application Habbix. Cependant, cette co-projection questionne, d’une part pour les possibilités qu’elle ouvre, d’autre part pour les nouveaux problèmes qu’elle pose. Loin d’être une solution toute faite et idyllique, qui permet d’impliquer l’habitant à la conception, elle interroge sur la possibilité d’appropriation future de ces logements.
Cette perception de l’évolution de la ville nous amène à de nouvelles manières de penser l’urbain, le commun et l’individuel. Cela implique de requalifier les rôles de chacun en restant ouvert à de nouvelles alternatives. Des mécanismes sont en marche, l’avenir seul confirmera - ou non - ces conjectures de conception participative...
Valora Brice Sarah Ramzi