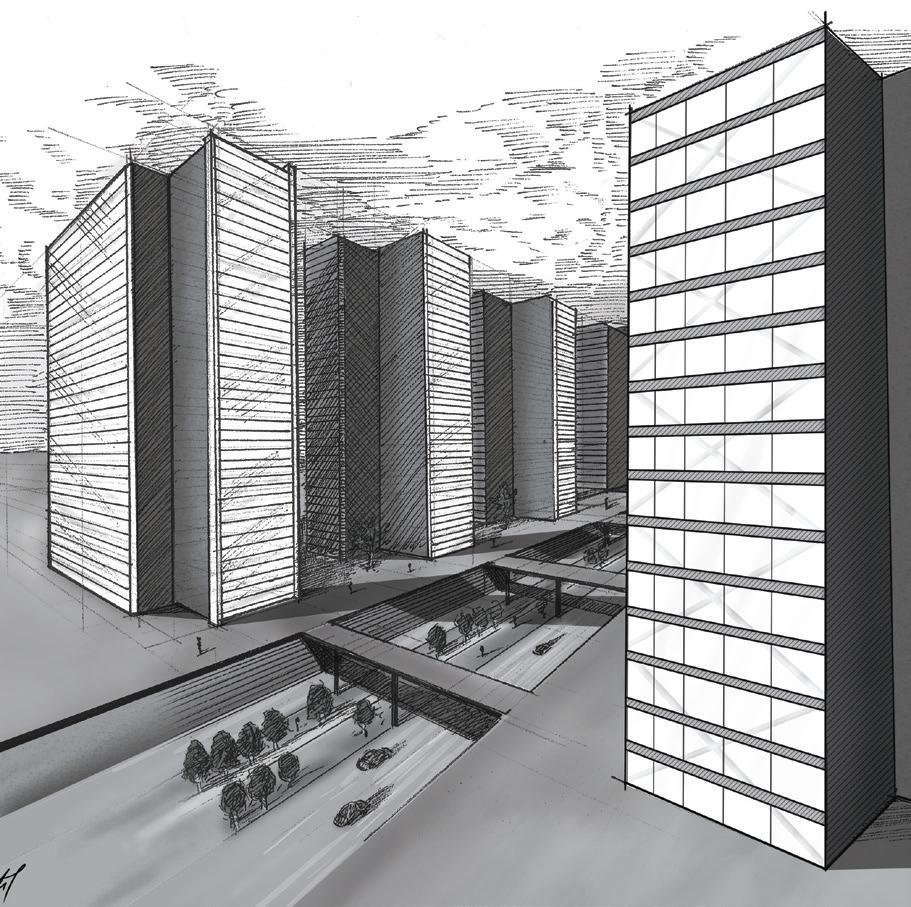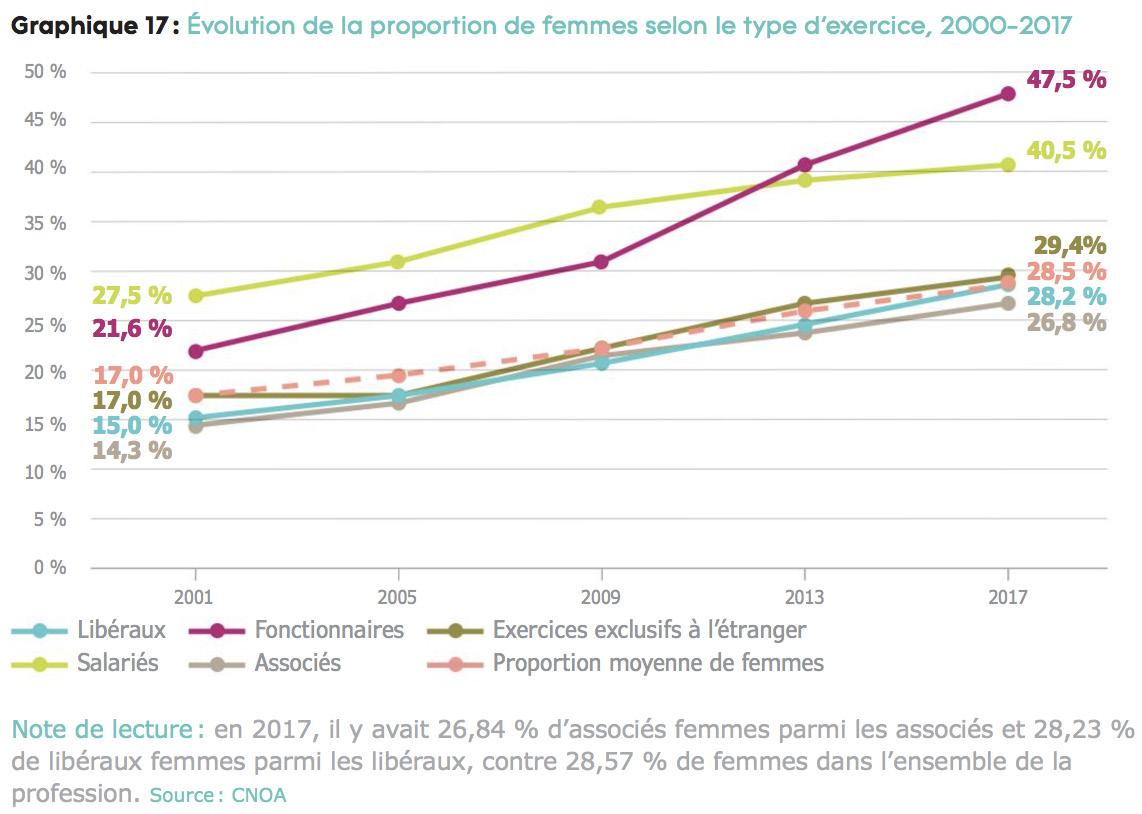4 minute read
Vie étudiante
from #8 Mars 2020
Un vent de colère dans les ENSA
Le 5 mars 2020, étudiants, chercheurs et enseignants de Paris Val-de-Seine, accompagnés des autres écoles nationales d’architecture, se sont joints à la manifestation des universités, de Diderot à la Sorbonne. Afin de clarifier les raisons de cet embrasement restées floues pour certains, Double Hauteur vous propose un état des lieux de l’enseignement et de la recherche architecturale en France.
Advertisement
À l’origine de ce vent de révolte se trouve la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche, ou LPPR. Sous ce nom barbare se cache un projet de loi qui instaurera, selon Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, un “darwinisme” [sic] censé sauver la recherche française. Il va sans dire que celle-ci est en berne, non pas à cause de quelques technocrates financiers incapables de comprendre que le savoir et la matière grise ne s’évaluent pas en euros, mais bel et bien en raison de la paresse de nos chercheuses et chercheurs. Pourtant ces fainéants multiplient les tâches pour espérer vivre décemment : communication dans des colloques ou des journées d’étude, intégration à des réseaux de recherche, organisation d’événements académiques, et enseignement. Cette dernière n’est pourtant pas garante de stabilité. En effet, 130 000 enseignants sont des vacataires. C’est-à-dire qu’ils travaillent sous un contrat extrêmement précaire, les privant parfois d’accès aux congés payés et à l’assurance chômage ou maladie. Ils peuvent pourtant se considérer comme chanceux au regard des 14% de docteurs au chômage. Un Bac+7 n’est donc plus garant d’un emploi décent.
Il est ainsi nécessaire que nous, étudiantes et étudiants, nous nous approprions cette lutte. D’une part, car la situation des chercheurs et enseignants nous impacte directement mais aussi parce que nous devons faire entendre les revendications qui nous sont propres. En effet, la précarité frappe également à notre échelle. Par ailleurs, chaque année, le coût de la vie étudiante augmente de 3% et près d’un cinquième d’entre nous vivent sous le seuil de pauvreté. Les inégalités qui en découlent sont importantes, car, même si l’école est gratuite pour les boursiers, les loyers, le prix des maquettes ou les coûts d’impressions sont incompressibles. Certains doivent alors travailler sur le peu de temps libre qui leur reste, sacrifiant vie sociale et sommeil. N’en déplaise à quelques réactionnaires, cette situation a un impact indéniable sur la réussite. Un élève obligé d’avoir un emploi à côté de ses études a 43% moins de chance d’obtenir son diplôme qu’un de ses camarades qui n’en éprouve pas le besoin.
Face à cette situation pourtant loin d’être nouvelle, l’État fait la sourde oreille. Il y a quelques années, le Ministère de l’Enseignement Supérieur proposait aux ENSA de les prendre partiellement sous son aile. Cela dans le but de faciliter les équivalences avec une organisation Licence-Master-Doctorat mais aussi pour déployer davantage de fonds financiers et égaler ceux des autres domaines. Seulement, les dépenses moyennes allouées pour un étudiant d’ENSA sont toujours 35% inférieures à celles d’un universitaire, respectivement 7 597€ contre 11 670€. Ainsi, alors que notre Président veut donner à notre discipline “une place toute particulière”, il nous subventionne toutefois moins qu’un collégien. Ajoutons à cela le recul des aides sociales censées réparer ces injustices, et nous obtenons une situation bien loin des valeurs d’égalité et de fraternité que notre République prétend porter.
Cette situation financière a donc un impact sur la qualité de nos enseignements. Alors que l’objectif de l’école est de former des architectes, acteurs majeurs face aux crises sociales et environnementales contemporaines, les SHS s’effacent peu à peu des programmes avec la perte de la sociologie, de la philosophie et des arts plastiques. Le reste de la formation n’en est pas moins impacté. Les travaux pratiques ou dirigés se font rares et beaucoup de professeurs ne sont pas formés aux enjeux contemporains pour les mener à bien.
Cette mobilisation est aussi l’occasion de mettre en lumière les problématiques internes à nos écoles. Il est temps que cessent le racisme et le sexisme latent qui gangrènent nos établissements. Nous devons mettre fin à cette culture de la charrette, contreproductive, qui ne sert qu’à trier les élèves sur leur résistance au manque de sommeil. Et pour cela, il est impératif que nous soyons écoutés. Encore trop de CA et de CFVE n’accueillent des étudiants uniquement parce que c’est inscrit dans la loi. Il est nécessaire que nous soyons considérés et que ces instances fassent preuve de plus de transparence.
Face à cette situation devenue insoutenable, les étudiants des écoles d’architecture de France exigent d’être considérés par les Ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur, ainsi que par l’État, que les subventions soient revues à la hausse et qu’un plan d’urgence de refonte des aides sociales soit mis en place.
Afin de faire entendre leur voix, les étudiants et étudiantes souhaitant se mobiliser sont invités à rejoindre les groupes Facebook “archi révolté·e·s !”, qui rassemble les élèves mobilisés de toute la France. Cette page est ainsi notre outil de mobilisation, par lequel nous souhaitons vous informer de nos rassemblements et étendre nos débats.
Théo Maiques Mathilde Brunet