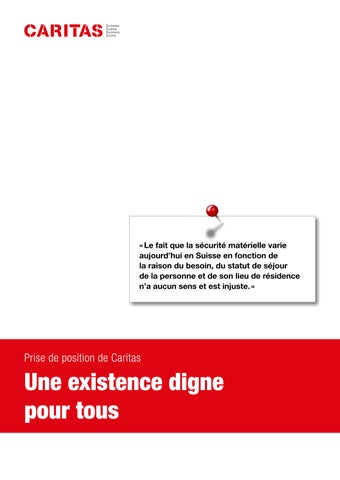« Le fait que la sécurité matérielle varie aujourd’hui en Suisse en fonction de la raison du besoin, du statut de séjour de la personne et de son lieu de résidence n’a aucun sens et est injuste. »
Une existence digne pour tous



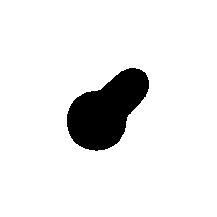
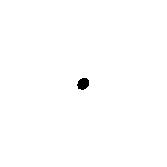
En bref : Les personnes en situation de pauvreté ou menacées de l’être sont de plus en plus sous pression en raison de l’augmentation du coût de la vie depuis des décennies. Notre système de sécurité sociale présente diverses lacunes et défauts. Certains risques, certaines réalités de vie, certaines formes de travail et certains groupes de personnes ne sont pas couverts par ce système, ou insuffisamment. Les prestations ne couvrent pas toujours les besoins vitaux et on voit que les différentes institutions qui forment ce réseau complexe entrent parfois en concurrence les unes avec les autres. Du point de vue de Caritas, il est temps de changer de système : il faut établir un minimum vital homogène, suffisant et décent pour toutes et tous ; il faut aussi regrouper les différents systèmes en une seule institution. Il faut enfin dissocier la couverture du minimum vital du droit migratoire et développer une prévoyance publique de base.
Une charge difficilement supportable pour beaucoup
Au cours des dernières décennies, le coût de la vie a considérablement augmenté pour les ménages à bas revenus. Les loyers des logements ont pris l’ascenseur, surtout dans les zones urbaines, et grignotent désormais en moyenne plus d’un tiers du revenu brut des ménages les plus pauvres. Et l’on s’attend à ce qu’ils continuent de grimper ces prochaines années. Depuis de nombreuses années, les primes d’assurance maladie également ne cessent d’augmenter. Depuis le début du millénaire, elles ont augmenté d’environ 130 % en termes réels ; les salaires et les réductions de primes en revanche n’ont pas suivi la même courbe. Pour de nombreuses familles, et jusque dans la classe moyenne, la charge des primes d’assurance maladie est devenue difficilement supportable. Depuis le début de l’année 2022 s’ajoute à cela une inflation comme la Suisse n’en a plus connu depuis les années 1990. C’est surtout l’énergie – mazout, gaz et électricité – qui a pris l’ascenseur, notamment à cause de la guerre en Ukraine. La hausse des prix de l’énergie et les pénuries d’approvisionnement qui durent font grimper les prix des biens importés et des denrées alimentaires.
Pour les ménages à faibles revenus, l’augmentation du coût de la vie a atteint un seuil insupportable. Cela ne concerne pas seulement les plus pauvres. Des personnes qui vivent un peu au-dessus du seuil de pauvreté n’ont plus guère de marge de manœuvre non plus. Nombreuses sont les personnes qui ont dû puiser dans leurs maigres réserves pendant la pandémie de Covid 19 et qui, avec ce renchérissement, se retrouvent maintenant dans une situation de détresse existentielle. Selon
une étude de Caritas et de la Haute école spécialisée bernoise, près d’un cinquième de la population suisse en âge de travailler et ses enfants vivent dans des conditions financières difficiles.
Les personnes qui gagnent trop peu ou qui n’exercent pas d’activité professionnelle – parce qu’elles ne trouvent pas d’emploi, parce que leur état de santé ne le permet pas ou parce qu’elles assument des tâches de prises en charge de proches – ne sont pas suffisamment couvertes par le système suisse de sécurité sociale. Parfois, elles n’ont pas droit aux prestations ou ne peuvent toucher que des prestations trop basses. Conséquence : une partie de la population ne peut plus payer pour des besoins fondamentaux, comme une alimentation équilibrée ou des prestations médicales, ne peut plus participer à la vie sociale, doit s’endetter et perd toute perspective d’améliorer sa propre situation. C’est particulièrement tragique pour les enfants qui voient leurs chances de développement se réduire massivement d’entrée de cause.
Il est urgent de donner aux familles et aux individus concernés une plus grande marge de manœuvre. Pour cela, il faut en premier lieu une sécurité matérielle suffisamment élevée pour toutes les personnes vivant en Suisse. Le système actuel de sécurité sociale ne peut pas garantir cette couverture. Il y a trop de lacunes et trop d’institutions différentes avec leurs propres intérêts (financiers). La politique de « raccommodage » de certaines prestations n’a jusqu’à présent pas apporté d’améliorations durables. Désormais, il ne suffit plus de serrer quelques boulons. Il faut procéder à une réforme fondamentale du système.
La sécurité sociale en Suisse
Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, toute personne a « droit à la sécurité sociale » (art. 22). L’Organisation internationale du travail (OIT) a expliqué en 1952 déjà ce que cela signifie (Convention 102 sur les normes minimales de sécurité sociale). Celle-ci précise qu’il existe neuf risques sociaux différents contre lesquels une personne devrait être protégée : maladie, perte de revenus à la suite d’une maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle, maternité, invalidité, décès et charges de famille. La Suisse a ratifié cette convention en 1977.
La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale construite à plusieurs niveaux. En principe, chacune et chacun est responsable de sa propre sécurité matérielle et sociale. La Constitution fédérale en effet met l’accent sur la responsa -
bilité individuelle (art. 6 Cst., art. 41 Cst.). Celle-ci se base essentiellement sur le travail rémunéré : dans les faits, la majorité des personnes en âge de travailler peuvent assurer leur propre sécurité matérielle et sociale et celle de leur famille grâce à leur salaire. En outre, nous pouvons compter sur des services de base , notamment un bon système juridique, éducatif et sanitaire. L’État veille à ce que les biens et services essentiels et de bonne qualité soient disponibles pour toutes et tous. Une partie de ces services de base sont gratuits, mais plusieurs sont tout de même payants. L’école primaire par exemple est gratuite en Suisse. En revanche, nous payons au moins une partie des frais de traitement à l’hôpital et des transports publics.
En Suisse, il existe en outre différentes assurances sociales qui offrent aux personnes qui vivent et travaillent ici, ainsi qu’à leurs proches, une protection contre les risques dont elles ne peuvent pas assumer seules les conséquences financières. Pour la plupart, ces assurances sociales sont obligatoires pour la population active ou les personnes vivant en Suisse et elles sont ancrées dans une loi fédérale. Elles sont financées au moins en partie par les assurés (cotisations sur les revenus du travail ou primes). La contribution des pouvoirs publics diffère selon les assurances.
Le système suisse d’assurance sociale est globalement divisé en cinq domaines (voir tableau) : vieillesse, décès et invalidité ; maladie et accident ; allocations pour perte de gain ; chômage et allocations familiales.
Les assurances sociales sont régies par le principe de causalité : la fourniture de prestations dépend d’une cause déterminée et est indépendante de la situation économique des personnes concernées – à l’exception des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
Ceci contrairement aux prestations sous condition de ressources , qui sont cantonales et communales et constituent le troisième élément du système de sécurité. Ces prestations ne sont versées que lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’assurer elle-même sa propre subsistance ou celle de personnes dépendantes. Certaines prestations sociales sous condition de ressources sont inscrites dans une loi fédérale et valables dans tous les cantons. Il s’agit des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ainsi que des réductions individuelles de primes pour l’assurance maladie obligatoire. Pour ces dernières, il existe toutefois de grandes différences
entre les cantons en ce qui concerne le cercle des ayants droit, le montant des contributions et le système de paiement. D’autres prestations liées au besoin sont aussi accordées par tous les cantons, à savoir les bourses d’études, les avances sur pensions alimentaires et l’aide sociale. Mais ces prestations varient également beaucoup d’un canton à l’autre, voire d’une commune à l’autre – même s’il existe certains standards minimaux comme dans le cas des bourses d’études (concordat sur les bourses d’études) ou des directives comme dans le cas de l’aide sociale.
De nombreux cantons et communes proposent encore d’autres prestations sociales spécifiques sous condition de ressources. Il s’agit par exemple des contributions au loyer, des aides aux parents ou à la maternité, des allocations de chômage (en plus des indemnités journalières de l’AC) ou des prestations complémentaires pour familles.
L’aide sociale se situe en aval de toutes les autres prestations. Elle intervient donc lorsqu’aucune autre assurance sociale ne fournit de prestations ou que ces prestations ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux, et lorsque les prestations sous condition de ressources versées en amont ne sont pas utiles ou suffisantes et qu’il n’y a pas de patrimoine. L’aide sociale vise à protéger les personnes en situation de détresse de la pauvreté et de l’exclusion. Par conséquent, ses prestations sont modestes et n’assurent que le minimum vital absolu. Les personnes qui bénéficient de l’aide sociale sont en outre tenues de chercher et d’accepter un travail rémunéré « raisonnable » et de maintenir leurs propres coûts de vie à un niveau bas, par exemple en matière de logement. Dans de nombreux cantons, les prestations d’aide sociale doivent être remboursées si la situation financière le permet.
Vieillesse, décès, invalidité
Assurance-vieillesse et invalidité (LAVS, LAI)
Prestations complémentaires sous condition de ressources (LPC)
Prévoyance professionnelle, « deuxième pilier » (LPP)
Maladie et accident
Assurance maladie (LAMal)
Assurance-accidents (LAA)
Loi sur le contrat d’assurance (LCA ; surtout pour l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie)
Allocation pour perte de gain
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, paternité (LAPG)
Chômage
Assurance chômage (AC)
Allocations familiales
Allocations familiales (LAFam)
Allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
Lacunes et défauts dans le système de la sécurité sociale
Le moyen le plus important de subvenir à ses besoins est d’exercer une activité professionnelle rémunérée. La majorité des adultes en Suisse peuvent financer leur propre subsistance et celle des personnes dépendantes par le salaire d’un travail rémunéré. Mais il y a aussi des personnes qui n’y parviennent pas, parce que leur santé ou la prise en charge de leurs proches ne leur permet pas d’exercer une activité professionnelle, parce qu’elles n’ont pas de formation ou ne maîtrisent pas la langue et qu’il n’y a pas de place pour elles sur le marché du travail, ou encore parce que leur travail n’est pas suffisamment rémunéré ou qu’elles sont employées, sans que ce soit de leur volonté, à de faibles taux d’occupation.
Le système suisse de sécurité sociale vise à couvrir les grands risques qui empêchent les personnes de garantir leur propre sécurité matérielle et sociale. Il fonctionne dans de nombreux cas. Mais les systèmes de sécurité sociale et les prestations sont conçus pour répondre à des risques et à des situations déterminées, des risques et des situations qui reflètent une époque, des constellations et représentations sociétales et une réalité économique bien précises. Les assurances sociales suisses ont été conçues pour la plupart au milieu du 20e siècle. Elles se basaient sur des réalités sociales et des modèles de vie qui ne sont plus vraiment la norme aujourd’hui. Pensons seulement aux modèles familiaux et professionnels, ou à ce qui concerne la mobilité des personnes et leurs relations de vie transfrontalières.
Notre système de sécurité sociale présente différentes lacunes et défauts. On peut les classifier en quatre catégories :
• certains risques et certaines réalités de vie actuels ne sont pas couverts, ou très mal ;
• certaines formes de travail et des groupes de personnes ne sont pas couverts, ou très mal ;
• certaines prestations ne garantissent pas le minimum vital ;
• certains problèmes du système sont inhérents à ce dernier.
Risques et réalités de la vie non ou mal couverts
Les personnes qui s’occupent de leurs enfants ou d’autres proches ne peuvent pas exercer une activité professionnelle à plein temps et subissent donc une perte de revenus. Comme la couverture par les assurances sociales est majoritairement liée au travail rémunéré, le travail de care non rémunéré comporte des risques financiers à court et à long terme : les personnes qui travaillent à 50 % et s’occupent de leurs enfants le reste du temps n’ont droit, en cas de perte
d’emploi, qu’à des allocations de chômage pour les 50 % d’activité professionnelle. Comme les allocations chômage couvrent au maximum 80 % du salaire précédemment perçu, ces allocations ne permettent pas de vivre pour les personnes ayant occupé un emploi à 50 %.
Le travail à temps partiel sur une longue période à un faible taux d’occupation a également des conséquences sur la couverture vieillesse : la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit un seuil d’entrée (salaire annuel minimum) et, en plus, une déduction dite de coordination, de sorte que les salaires ne sont constitutifs de rentes qu’à partir d’environ 25 000 francs. Ce seuil doit être abaissé dans le cadre de la révision en cours de la LPP. Mais contrairement à l’AVS, le deuxième pilier ne prend pas en compte les bonifications pour le travail de prise en charge non rémunéré. Un faible revenu est donc souvent synonyme de manque de prévoyance professionnelle. Les personnes concernées dépendent uniquement de la rente AVS, qui est loin de couvrir leurs besoins vitaux. Les politiques reconnaissent que la mauvaise couverture des bas revenus et du travail à temps partiel dans la prévoyance professionnelle pose un problème. Mais à ce jour, les solutions satisfaisantes et susceptibles de recueillir une majorité font toujours défaut.
En Suisse, ce sont encore et toujours les femmes qui fournissent l’essentiel du travail de care non rémunéré. Elles travaillent pendant des années gratuitement, et fournissent ce faisant un travail qu’il faudrait autrement salarier. En 2020, les tâches non rémunérées de garde d’enfants représentaient plus de 219 millions d’heures, c’est-à-dire plus de 10 milliards de francs par année. Ce sont des femmes également qui assurent près de 70 % de la garde d’enfants non rémunérée. Cette prise en charge est de première importance pour le bon fonctionnement d’une société. Mais elle n’est ni indemnisée ni assurée, ce qui entraîne souvent des difficultés financières.
Indépendamment du travail de soins non rémunéré, les bas salaires et les faibles taux d’occupation posent également un problème. Ils concernent particulièrement les personnes qui n’ont pas de formation post-obligatoire. En 2020, environ 10 pour cent des personnes en emploi travaillaient à un taux d’occupation inférieur à 20 pour cent. 16,3 pour cent des femmes actives et 8,2 pour cent des hommes actifs touchaient un bas salaire (moins de 4443 francs bruts par mois).
Le chômage de longue durée est également mal couvert en Suisse. Les indemnités journalières de l’assurance chômage ne sont versées que pendant une durée limitée, en général deux ans. Une fin de droit auprès de l’assurance chômage signifie également que la couverture de l’assurance-accidents
prend fin et que les cotisations AVS ne sont plus payées par la caisse de chômage. L’insécurité financière due à l’absence d’indemnités journalières s’accompagne donc d’un manque de sécurité sociale. La personne concernée doit également prendre en charge ces frais. Nombreuses sont les personnes qui doivent s’inscrire à l’aide sociale presque tout de suite après être arrivées en fin de droits.
Enfin, en Suisse, l’assurance d’arrêt de travail pour cause de maladie n’est pas obligatoire. De nombreux employeurs assurent volontairement leurs collaborateurs ou le font en vertu de dispositions de conventions collectives ou de contrats types de travail. Mais c’est loin d’être le cas pour tous les travailleurs. Les indépendants peuvent également souscrire à titre privé une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Celle-ci est toutefois très chère, si bien que beaucoup y renoncent. Malheureusement, aucun chiffre ne permet de savoir combien de personnes indépendantes sont assurées pour arrêt de travail dû à une maladie.
Formes de travail et groupes de personnes non protégés, ou mal protégés
Les personnes qui ont un contrat de travail à durée déterminée, qui travaillent sur appel et sont payées à l’heure ou qui offrent leur force de travail par le biais d’une plateforme numérique (travail sur plateforme) sont en général moins bien protégées que les travailleurs ayant un contrat de travail classique. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2020, plus de 10 pour cent des travailleurs se trouvaient dans des formes d’emploi dites atypiques , et cette fois encore les femmes y sont plus nombreuses que les hommes. Le travail sur appel est particulièrement répandu dans les emplois à bas salaire, notamment chez les travailleurs auxiliaires (11,1 pour cent), les travailleurs des services et de la vente (10,5 pour cent) ainsi que dans l’agriculture et l’hôtellerie-restauration (environ 15 pour cent chacun). Cette forme de travail est souvent combinée à des taux d’occupation faibles.
Les estimations du nombre de personnes travaillant sur des plateformes divergent fortement. Les syndicats parlent de 10 pour cent de la population suisse qui effectuent régulièrement du travail de plateforme, qui représenterait l’unique source de revenus pour environ 135 000 personnes. L’Office fédéral de la statistique (OFS) présente des chiffres beaucoup plus bas : seul 0,4 % de la population effectuerait un travail de plateforme, ce qui correspond à un peu moins de 35 000 personnes. Si les estimations divergent autant, c’est sans
doute parce qu’il n’existe pas de définition claire du travail de plateforme.
Ce qui est clair, cependant : le travail de plateforme et les autres formes d’emploi atypiques sont souvent précaires. Le statut des travailleurs de plateforme (indépendants ou salariés) n’est toujours pas clarifié. De nombreuses plateformes ne se considèrent pas comme des employeurs et par conséquent, ne paient pas de cotisations de sécurité sociale. Les personnes concernées sont considérées comme indépendantes ; elles n’ont pas droit aux allocations de chômage et doivent payer elles-mêmes les cotisations AVS. Les personnes qui travaillent sur appel ne sont guère protégées non plus contre le chômage, selon leur contrat de travail. En règle générale, les travailleurs atypiques ne sont pas affiliés à une caisse de pension, pour cause de salaire trop bas.
Il en va d’ailleurs de même pour les personnes qui exercent plusieurs emplois ( pluriactivité ). En 2021, cela concernait près de 8 % de la population active. Comme le seuil d’entrée dans la prévoyance professionnelle s’applique séparément à chaque employeur et que les salaires ne sont pas cumulés, les personnes ayant plusieurs employeurs ne sont pas ou peu couvertes par le deuxième pilier. En outre, les travailleurs qui ne sont pas employés par un employeur pendant au moins 8 heures par semaine ne sont pas assurés collectivement contre les accidents non professionnels. C’est par exemple souvent le cas des personnes qui font le ménage chez des particuliers et qui ne sont pas employées par une agence. Elles doivent demander une couverture pour les accidents non professionnels auprès de leur caisse de maladie et la payer elles-mêmes. Ce faisant, elles sont nettement moins bien couvertes en cas d’accident que si elles avaient souscrit une assurance-accidents collective auprès de leur employeur.
Les indépendants – qui représentent tout de même plus de 12 % des personnes actives en Suisse – sont également mal couverts. Ils et elles ne peuvent pas s’assurer contre la perte de gain (au sens du chômage), même à titre volontaire. Il n’existe pas non plus d’assurance obligatoire pour l’incapacité de travail due à une maladie ou un accident. Ces assurances peuvent certes être souscrites volontairement. Mais leurs primes sont très élevées, et les indépendants aux revenus modestes, notamment, renoncent souvent à s’assurer contre ces risques. Les indépendants ont également souvent des lacunes en matière de prévoyance vieillesse. Ils et elles peuvent évidemment s’affilier volontairement à une caisse de pension (2e pilier) et épargner individuellement pour la retraite (3e pilier). Mais beaucoup ne le font pas. Près de 30 pour cent ne cotisent pas à une caisse de pension et n’effectuent aucun versement pour le 3e pilier. Seuls 15 pour cent cotisent
à un pilier 3a. Il faut partir du principe que les indépendants aux revenus modestes ne disposent en général, à la retraite, que d’une rente AVS – or, cette assurance obligatoire est très loin de couvrir les besoins vitaux.
Enfin, les personnes qui n’ont pas le passeport suisse rencontrent également des restrictions à différents niveaux. Selon leur statut de séjour, elles sont plus ou moins précaires. Les problématiques spécifiques à la migration sont examinées séparément dans ce document (voir page 9).
Prestations ne couvrant pas le minimum vital
Les assurances sociales sont donc mal adaptées à certains risques et à des modes de vie et de travail « hors norme ». À cela s’ajoute que les prestations sont parfois tout simplement trop basses.
Les rentes de vieillesse de l’AVS n’assurent pas le minimum vital – elles ne l’ont d’ailleurs jamais fait depuis leur introduction en 1948. C’est d’autant plus vrai pour la pension mensuelle minimale qui s’élèvera à 1 225 francs en 2023. Dans de nombreux cas, les pensions d’invalidité ne couvrent pas non plus le coût réel de la vie. Des prestations complémentaires sont tout de même versées en plus des rentes AVS et AI lorsque qu’il n’existe pas d’autres sources de revenus. En 2021, 12,5 % des bénéficiaires de rentes AVS et la moitié des bénéficiaires de rentes AI percevaient des prestations complémentaires. Le problème : il faut les demander, car elles ne sont pas versées automatiquement. De nombreuses personnes y renoncent alors qu’elles y auraient droit. Il n’existe malheureusement pas d’étude complète sur le non-recours aux prestations complémentaires. Une étude pour le canton de Bâle-Ville l’estime à près de 30 pour cent. Pour l’ensemble de la Suisse, il existe une estimation qui se limite aux prestations complémentaires à l’AVS et qui indique que le non-recours s’élève à 15,7 pour cent des ayants droit.
Les indemnités journalières de l’assurance chômage ne couvrent pas non plus systématiquement les besoins vitaux. Le montant des indemnités journalières est déterminé en fonction du revenu soumis à l’AVS réalisé au cours des 6 à 12 derniers mois. En règle générale, les assurés reçoivent 70 pour cent du salaire assuré, et 80 pour cent s’ils ont des obligations d’entretien ou un revenu nettement inférieur à 4000 francs. Concrètement, cela signifie que les allocations de chômage ne suffisent pas à couvrir le minimum vital dans les cas où la personne touchait un revenu faible avant de se retrouver au chômage. En outre, seules les personnes
qui ont cotisé à l’assurance chômage pendant au moins 12 mois durant les deux années précédentes, c’est-à-dire qui ont travaillé (ou qui ont été exemptées de cotisations pour cause de maternité ou de formation), ont droit aux allocations de chômage.
Si les allocations de chômage ne suffisent pas ou s’il n’y a pas (ou plus) de droit aux indemnités journalières, il ne reste plus qu’à s’adresser aux services sociaux. Toutefois, l’ aide sociale est également trop faible pour couvrir les besoins minimaux sur une longue période. Elle est basée sur les dépenses des 10 % des revenus les plus faibles. Estimer combien d’argent on veut accorder aux gens pour vivre est une décision politique. Dans le cas de l’aide sociale, ce montant est environ 30 % inférieur à celui des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
L’aide sociale a été conçue comme un soutien à court terme dans les situations de détresse. Mais aujourd’hui, de plus en plus de personnes dépendent de l’aide sociale pendant des mois ou des années. Le montant de l’aide n’est tout simplement pas suffisant dans ces cas. Il est possible de vivre quelques mois avec si peu d’argent, mais pas pendant des années. Même si les dépenses nécessaires, par exemple les frais de mobilité pour la recherche d’un emploi ou les cours de sport pour les enfants, sont parfois payées séparément, ces prestations dites de situation dépendent de l’appréciation des autorités et ne vont pas de soi. La participation à la société est ainsi de facto refusée aux bénéficiaires de l’aide sociale. Dans de nombreux cantons, on s’efforce même de réduire l’aide aux bénéficiaires de longue durée, en quelque sorte pour les inciter à retomber plus rapidement sur leurs pieds. Mais cela n’a guère l’effet escompté et ne fait que réduire encore la marge de manœuvre et les perspectives des personnes concernées. En effet, les personnes qui dépendent de l’aide sociale pendant une longue période n’ont pratiquement aucune chance sur le marché du travail et se retrouvent coincées dans une situation de pauvreté. Ces personnes n’ont pas besoin d’une pression supplémentaire ; il leur faudrait plutôt un soutien adapté à leur situation et des possibilités de s’engager dans une activité utile, même en dehors du marché du travail.
Il existe un problème supplémentaire en ce qui concerne l’aide sociale : de nombreuses personnes ne font pas valoir leur droit à cette aide. Selon les estimations, ce que l’on appelle le non-recours à l’aide sociale concerne entre 25 et 35 pour cent de tous les ayants droit. Beaucoup ont honte de leur situation et ne veulent pas l’aide de l’État. D’autres craignent la spirale de l’endettement, car dans de nombreux cantons, les prestations d’aide sociale doivent être remboursées lorsque
la situation économique de la personne s’améliore. Enfin, ce sont surtout les ressortissantes et ressortissants étrangers qui renoncent à l’aide sociale parce qu’ils et elles craignent des répercussions négatives sur leur statut de séjour (voir le point fort sur les défis spécifiques à la migration à la page 9).
Problèmes inhérents au système
La sécurité sociale en Suisse est tributaire de l’histoire de sa création et souffre de la structure fédéraliste de notre pays.
Le système de sécurité sociale s’est mis en place progressivement depuis la fin du 19e siècle. Souvent, on a créé de nouvelles institutions pour répondre à des risques nouvellement identifiés. Résultat : trop d’institutions garantissent aujourd’hui la sécurité sociale de la population suisse. Il n’est pas toujours évident de savoir quelle institution est compétente pour tel cas donné et qui finance quelle prestation. De plus, chaque œuvre sociale est soumise à une pression politique visant à économiser le plus d’argent possible. Mais les mesures d’économie sur les prestations en amont n’en -
traînent pas une diminution du nombre de personnes ayant besoin d’un soutien. Elles ne font qu’entraîner des transferts de ces personnes vers l’aide sociale.
Les assurances sociales sont tout de même ancrées dans une loi fédérale, de sorte que les mêmes droits et les mêmes règles s’appliquent dans toute la Suisse. Ce n’est pas le cas des prestations sous condition de ressources. Selon le canton ou la commune de domicile, une personne qui demande une aide pour une situation donnée recevra plus ou moins d’aide, voire pas du tout. En matière de prestations sous condition de ressources, la structure fédéraliste du pays crée de grandes injustices.
Enfin, le non-recours aux prestations sous condition de ressources, déjà abordé plus haut, est également un problème inhérent au système. Souvent, les personnes concernées ne connaissent même pas les prestations auxquelles elles ont droit ; les formulaires de demande sont beaucoup trop compliqués ou encore des exigences formelles augmentent les obstacles. Or, un système de sécurité sociale proposant des prestations qui n’atteignent pas les gens, que ce soit intentionnellement ou non, est un mauvais système.
Les conséquences : pauvreté et exclusion
Les lacunes et les défauts du système de sécurité sociale ont de graves conséquences pour certaines personnes. Selon l’Office fédéral de la statistique, environ 1,3 million de personnes en Suisse (15,4 % de la population) sont touchées ou menacées par la pauvreté. Elles vivent dans la crainte permanente de ne plus avoir assez d’argent demain pour régler une facture inattendue.
Les mères élevant seules leurs enfants, les employés aux conditions de travail précaires et les indépendants dans les branches à bas salaires, les chômeurs de longue durée, les personnes souffrant de maladies psychiques et certains groupes de migrants sont particulièrement menacés de tomber dans la détresse. Ces personnes sont mal couvertes par le système de sécurité sociale pour diverses raisons : elles ne peuvent pas exercer d’activité professionnelle parce qu’elles s’occupent de leurs jeunes enfants et qu’une place en crèche
est beaucoup trop chère. Le salaire ou les indemnités journalières de l’assurance chômage ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux de la famille. Elles travaillent en indépendants et ne sont pas assurés pour un arrêt de travail en cas de maladie, parce que c’est beaucoup trop cher. Elles n’ont aucune chance de trouver un travail assurant leur minimum vital et doivent vivre pendant des années avec l’aide sociale, qui est bien trop basse. Ou bien elles ne souhaitent pas recourir aux prestations de l’État parce qu’ils craignent la stigmatisation ou la perte de leur permis de séjour et d’autres conséquences en matière de droit de migration.
Cette situation précaire concerne notamment de nombreux enfants. En Suisse, un enfant sur cinq vit dans un ménage avec peu de moyens. Les chances de ces enfants sont considérablement réduites dès le début.
Point fort : défis spécifiques à la migration pour le minimum vital
Pour les personnes qui n’ont pas de passeport suisse, le droit des migrations a une influence non négligeable sur la possibilité de faire appel à la sécurité sociale, sur la manière de le faire et sur les conséquences qui en découlent. En principe, pour diverses raisons, les migrants sont de plus en plus nombreux à occuper des emplois précaires – à durée déterminée sans que ce soit de leur fait, sous-employés et dans le secteur des bas salaires – et le travail sur appel est en augmentation. En matière d’assurances sociales, leurs droits sont donc de fait souvent limités. À cela s’ajoutent des directives et des délais qui les concernent particulièrement. Par exemple, les personnes originaires de pays dits tiers doivent vivre en Suisse depuis au moins dix ans sans interruption pour avoir droit à des prestations complémentaires à l’AI ou à l’AVS. La condition de trois années de cotisation pour obtenir une rente AI est un obstacle qui touche également surtout les migrants.
Mais c’est surtout au niveau du dernier filet de la sécurité sociale, l’aide sociale, qu’il existe diverses restrictions spécifiques à la migration. Les personnes qui n’ont pas de droit de séjour (les sans-papiers) n’ont pas droit à l’aide sociale ; cette absence de droit concerne d’ailleurs aussi des personnes étrangères qui ont un droit de séjour valable.
Pour certaines personnes, selon leur type de permis, le droit à l’aide sociale est nettement réduit ; pour d’autres, le fait de percevoir l’aide sociale comporte le risque de perdre leur droit de séjour. Pour certains, les deux risques existent.
Trop peu d’argent pour vivre à cause de la « fausse
» carte d’identité
Au printemps 2022, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi qui prévoit une réduction de l’aide sociale pour les personnes issues de « pays tiers » pendant les trois premières années. Une aide sociale nettement réduite est déjà une réalité pour les personnes admises à titre provisoire (F), les demandeurs d’asile (N) et désormais aussi les personnes en quête de protection (S). Ces personnes reçoivent une aide sociale en matière d’asile nettement moins élevée que les autres, indépendamment de la durée de leur séjour ou de leur activité professionnelle antérieure. Les montants varient considérablement d’un canton à l’autre. Pour subvenir à ses besoins (hors caisse maladie et loyer), un adulte seul reçoit entre 9,70 et 26.80 francs par jour selon le canton de résidence. Les modalités de versement diffèrent également, raison pour laquelle il est souvent souligné que les montants ne couvrent pas toujours tout à fait la même chose. Les grandes différences
fédérales n’en sont pas moins une réalité. Elles témoignent du fait que les montants sont fixés de manière arbitraire, selon des critères politiques, et ne suivent aucune logique de calcul. Les personnes admises à titre provisoire restent souvent dans cette situation pendant des années, voire des décennies, lorsqu’elles n’obtiennent pas un revenu suffisant, par exemple en raison de problèmes de santé, d’un faible salaire ne permettant pas de faire vivre toute la famille ou tout simplement par manque d’accès au marché du travail. Tant qu’elles n’ont pas d’autre statut que celui de personne admise provisoirement, elles ne bénéficient pas d’une aide leur permettant de subvenir à leurs besoins. Et en même temps, tant qu’elles bénéficient de l’aide sociale en matière d’asile, elles n’ont pas le droit de changer de statut et de transformer leur permis de séjour.
Crainte pour le droit de séjour en cas de recours à l’aide sociale
Le recours à l’aide sociale n’influence pas seulement les possibilités juridiques des personnes admises à titre provisoire. Les personnes titulaires d’un permis de séjour ordinaire (B) ou d’un permis d’établissement (C) risquent de perdre leur droit de séjour ou d’être rétrogradées si elles bénéficient de l’aide sociale.
Il est difficile d’évaluer à quel point le danger est réel. Mais les durcissements apportés notamment par la nouvelle loi sur les étrangers et l’intégration (AIG) déstabilisent visiblement les personnes concernées. Beaucoup jouent donc la carte de la sécurité et renoncent à un soutien dont elles auraient pourtant bien besoin.
Mais la menace d’une perte ou d’un éventuel déclassement n’est pas la seule chose qui pèse sur les personnes qui vivent ici depuis longtemps. Le recours à l’aide sociale empêche, dans la plupart des cas, le regroupement familial ou l’amélioration du droit de séjour. La pérennisation, c’est-à-dire la transformation en une « meilleure autorisation de séjour » et finalement la naturalisation, prend beaucoup de temps. Là aussi, les obstacles se sont multipliés ces dernières années. Par exemple, il est interdit de percevoir des allocations d’aide sociale pendant les trois à cinq années précédant la procédure de naturalisation et pendant celle-ci. L’autorisation d’établissement, qui constitue désormais une condition pour une demande de citoyenneté, n’est de toute façon accordée qu’à celles et ceux qui ne bénéficient d’aucune aide financière. Ainsi, un besoin d’aide sociale au mauvais moment peut très vite réduire à néant les efforts fournis pendant des décennies.
La voie vers une existence digne pour toute personne en Suisse
La pauvreté ne signifie pas seulement ne pas avoir assez d’argent pour vivre. Souvent, les personnes en situation de pauvreté sont également désavantagées dans d’autres domaines. Elles n’ont par exemple aucune chance de trouver un bon emploi avec un salaire permettant de garantir le minimum vital, parce qu’elles n’ont pas pu suivre de formation professionnelle. Elles ne bénéficient de soins médicaux que de façon limitée, parce qu’elles ne peuvent pas se permettre de payer la franchise de 10 % sur les factures médicales. Elles vivent dans des logements trop petits, et mal isolés. Et elles ont moins de possibilités d’entretenir des contacts sociaux, car elles ne peuvent pas s’offrir des activités de loisirs.
Cependant, les ressources financières sont d’une importance capitale. Elles permettent d’acquérir les produits d’usage quotidien et ouvrent la possibilité de participer à la société. L’accès à l’éducation et la formation ou au marché du travail dépend également beaucoup du revenu disponible. En d’autres termes : lorsqu’on n’a pas d’argent, on est fortement limité dans notre capacité d’action et on a peu de perspectives pour changer quelque chose à la situation. Une sécurité matérielle suffisante pour toutes les personnes vivant en Suisse est donc un élément central de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de l’égalité des chances.
Uniformiser la protection matérielle
Les personnes âgées qui n’ont pas assez d’argent pour vivre ont droit à des prestations complémentaires. Celles-ci couvrent la différence entre les revenus et les dépenses nécessaires pour assurer un minimum vital. En 2023, le montant destiné à couvrir les besoins généraux s’élève à 20 100 francs pour une personne seule et à 30 150 francs pour un couple. À cela s’ajoutent des montants maximaux pour le loyer allant – selon la région – de 15 540 francs à 17 580 francs par an pour une personne seule. Le montant des prestations complémentaires est politiquement reconnu comme le montant minimum dont les ménages ont besoin pour vivre en Suisse. Les personnes percevant une pension d’invalidité bénéficient de la même prestation. Dans quatre cantons – Tessin, Soleure, Vaud et Genève – les familles avec des enfants en bas âge bénéficient en outre de prestations complémentaires pour familles conçues selon le même principe.
Ce qui est valable pour les personnes de plus de 65 ans et pour les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité devrait l’être pour toutes les personnes en Suisse : si l’argent ne suffit pas pour vivre, les revenus sont complétés jusqu’à concurrence des besoins. Le fait que la sécurité matérielle varie aujourd’hui en Suisse en fonction de la raison du besoin, du statut de séjour de la personne et de son lieu de résidence n’a aucun sens et est injuste.
Un système de sécurité sociale qui se décompose en plusieurs parties avec des réglementations, des prestations et des groupes cibles différents est en outre inutilement complexe, crée des rivalités entre les institutions avec leurs budgets séparés et, surtout, des inconvénients pour les personnes concernées. Ces dernières ne savent parfois pas à quelle institution elles peuvent ou doivent s’adresser et quels sont leurs droits. De leur côté, les différentes institutions sont soumises à des pressions pour réduire leurs coûts et tentent, dans la mesure du possible, de transférer les personnes concernées vers d’autres institutions. C’est ainsi que beaucoup de personnes ayant besoin d’aide tombent de Charybde en Scylla : on leur refuse des prestations, elles doivent faire valoir leurs droits devant les tribunaux et suivre des années de procédure.
Pour toutes ces raisons, un changement fondamental de système est nécessaire. Caritas considère qu’un système de sécurité sociale fonctionnel et complet devrait proposer les éléments suivants :
• Des prestations complémentaires pour toutes les personnes dont les revenus ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins
Ces prestations sont versées aux personnes indépendamment de la raison pour laquelle leur revenu est insuffisant – obligations d’assistance, invalidité, maladie, chômage, salaire trop bas ou autre –, indépendamment du statut d’activité et de séjour et indépendamment du lieu de résidence. Les prestations sont payées aussi longtemps que le besoin existe. Cela peut être quelques mois, par exemple en cas de chômage temporaire, ou des années, par exemple pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite.
• Pour que ce système fonctionne, chacun doit apporter sa contribution : les employeurs doivent garantir des salaires suffisants pour vivre, des horaires de travail favorables à la famille et une sécurité sociale. Et les personnes en âge de travailler doivent être prêtes à effectuer un travail rémunéré à ces conditions si elles en sont capables –c’est-à-dire si elles sont en bonne santé et ne sont pas limitées par d’autres obligations.
• Une seule institution pour tout : prestations financières, conseil, accompagnement
Les prestations complémentaires seraient versées par une seule institution, quelle que soit la raison du besoin d’aide. Outre les prestations financières, cette institution proposerait également des conseils et un accompagnement aux personnes en situation difficile – que ce soit par le biais d’une aide à la recherche d’emploi, d’un conseil budgétaire ou de l’orientation et du financement d’offres de formation. Souvent, les personnes concernées sont confrontées à différents problèmes. Elles auraient besoin d’un seul lieu d’accueil où l’on prendrait le temps de s’occuper d’elles, d’examiner leur situation individuelle et de chercher avec elles des solutions.
Avec l’Assurance générale de revenus AGR+, le think tank Denknetz a élaboré un bon modèle qui reprend également ces deux éléments clés.
En outre, les réformes suivantes sont nécessaires :
• Dissocier la couverture du minimum vital du droit migratoire
L’imbrication du droit des étrangers avec le droit au minimum vital doit être supprimée. Les personnes qui n’ont pas de passeport suisse sont désavantagées dans de nombreux domaines de l’économie et de la vie sociale, ce qui rend la protection sociale d’autant plus importante. Les dispositions du droit des étrangers ne doivent pas empiéter sur la sécurité sociale et notamment sur la garantie du minimum vital, de quelque manière que ce soit – taux plus bas ou sanctions relevant du droit des étrangers, p. ex.
• Renforcer le service public
Les personnes disposant de peu de moyens sont particulièrement tributaires d’un service universel fonctionnel, complet et avantageux. Il ne s’agit pas seulement d’infrastructures telles que des hôpitaux publics et un bon réseau de transports publics, mais aussi, dans une conception plus large du service public, d’un bon système éducatif public, de soins de santé accessibles et inclusifs et d’une politique familiale développée. Pour ces derniers, la Suisse a encore beaucoup de retard : les ménages à bas et moyens revenus paient beaucoup trop cher leurs primes d’assurance maladie tout en ne pouvant souvent pas se payer certains traitements médicaux. Et les structures d’accueil des enfants font toujours défaut dans de nombreuses communes, sont beaucoup trop chères pour les parents et n’offrent aucune solution en cas d’horaires de travail irréguliers.
Du point de vue de Caritas, ces quatre éléments sont nécessaires pour que toutes les personnes habitant la Suisse puissent effectivement profiter de la prospérité de notre pays et participer à la société. Ce sont des éléments centraux pour une Suisse sans pauvreté.
Juin 2023
Autrice et auteur : Aline Masé, service Politique sociale, courriel amase@caritas.ch, et Michael Egli, service Politique de migration, megli@caritas.ch.
Traduction : Nicolas Couchepin
Version en ligne de ce document : www.caritas.ch/fr/politique-sociale

Regardez notre vidéo explicative sur le thème « Une existence digne pour tous ».