axel wlody
post master recherches en architecture, ensa paris-la villete sous la supervision de Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis

axel wlody
post master recherches en architecture, ensa paris-la villete sous la supervision de Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis

images de sàigòn et ses environs pendant la guerre américaine (1954-1975)
iconographie d'un impérialisme images de sàigònet ses environs pendant la guerre américaine (1954-1975)
septembre 2025
post-master recherches en architecture
ensa paris-la villette
La transcription des termes en vietnamien utilisés dans ce texte essaie de systématiquement respecter les signes diacritiques propres à la langue vietnamienne, y compris pour la transcription des noms propres. Si ce n'est pas le cas, pour quelconque raison, typographique ou autre, le mot ou nom sera suivi d'un astérisque*.
Certaines images qui suivent contiennent des scènes graphiques de violence, de blessures et de décès qui pourraient être perturbantes.
Je tiens avant tout à remercier Philippe Zourgane, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang et Christian Pédelahore de Loddis pour le suivi de ce travail, les références transmises et les différentes opportunités,
le post-master de recherches en architecture de l'ensa paris-la villette,
Philip Pham, Hung Le*, Nguyen Ngoc Son*, Marie Gibert-Flutre et Mel Schenck pour les riches conversations ici et là,
l'équipe des archives nationales vietnamiennes de Sài Gòn
mes ami·es, au quotidien, qui m’ont aussi aidé à développer et soutenir mes idées,
ma famille pour le soutien inconditionnel.


Je me suis levé entre les histoires, les livres et les images : les instants suspendus. Ils peuvent paraître somptueux. J’ai longtemps nagé dans l’image. Ce travail prolonge les rencontres physiques et photographiques vécues avec Sài Gòn — cette ville que j’ai d’abord côtoyée au travers de photographies noir et blanc, vestiges d’une époque traversée–. En retraçant à l’aide d’un corpus visuel soigneusement constitué, les lignes de force d’une présence américaine massive entre 1954 et 1975, ce travail cherche à comprendre ce que la photographie peut dire d’une architecture instrumentalisée, inscrite dans une topographie de contrôle, de symboliques urbaines et de rencontres imprévues.
introduction
chapitre un
cadres théoriques et approches critiques
perspectives décentrées et études subalternes
l’image comme source : lecture iconologique
chapitre deux
sài gòn : lieu, histoire et regards
racines culturelles et pensée fondamentale
brève histoire de la ville de Sài Gòn
contexte politique
chapitre trois présence et impérialisme américain
usaid et financements étrangers
infrastructures stratégiques et installations de soutien comme pivots d'un dispositif d'occupation
continuités et détournements de l'héritage colonial français
programmes de logements
militarisation de l'espace public
destructions
La guerre américaine au Việt Nam a non seulement redessiné les frontières géopolitiques de la région mais a aussi profondément marqué les paysages urbains, les architectures et les dynamiques sociales. Au cœur de cette confrontation, Sài Gòn, capitale de la République du Việt Nam (Sud-Việt Nam), fut le théâtre privilégié de la présence américaine. Loin d’être une simple force militaire, cette présence fut un phénomène d’impérialisme américain inédit, d’une nation mariée à la guerre et exerçant une influence polymorphe sur la ville et ses habitant·es, bien au-delà des champs de bataille.
Le contexte vietnamien, en particulier son paysage sous influence étrangère, paraît trop peu étudié à un moment où les études postcoloniales émergent de plus en plus depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Il semble rare d’apercevoir de vastes études francophones du genre sur le contexte asiatique et plus particulièrement sur celui du Việt Nam à travers le prisme précis de la présence physique et urbaine américaine au cœur de Sài Gòn. En 2024, l’architecte Vũ Hiệp confirme une certaine absence de théories et d’études du patrimoine vietnamien sur le territoire, étroitement liées aux questions d’identité. Pour lui, « la recherche sur le patrimoine architectural au Việt Nam en est actuellement à ses balbutiements. La naissance de l’Atelier de réparation et de restauration (1971), qui s’est ensuite transformée en l’Institut pour la conservation des monuments (2003), n’a satisfait qu’au besoin de recherche sur la conservation du patrimoine architectural (la science de la conservation), mais n’a pas vraiment remis en question le patrimoine de l’architecture ». Christian Pédelahore de Loddis [2001] relève néanmoins l’honneur qu’il a eu de relancer les recherches sur les villes vietnamiennes en France à partir de 1979 et également « l’apport éminent des chercheurs anglo-saxons à l’analyse historique et critique de l’urbanisme colonial français et dénote l’explosion, dans la deuxième partie des années 90 de recherches internationales sur le Việt Nam ». Si les asiodescendant·es tentent récemment de porter
une voix plus forte, il est aisé d’affirmer qu’elle est pour l’instant toujours presque invisible (et/ou invisibilisée).
L’Histoire du Việt Nam est comme attendue à l’issue d’une posture colonisée, le reflet d’une multiplicité de variations politiques, culturelles, de conflits et de transferts. Si l’on se penche par exemple sur l’étude de Hà Nội, au nord du pays, Christian Pédelahore de Loddis souligne que les dominations successives sur la ville n’est pas tant « l’imposition de modèles importés mais bien plutôt, par tous ses pores, la métamorphose et la percolation de ceux-ci opérée par le bas, par un terroir, une civilisation et une population têtus ; qui, souterrainement et inexorablement prennent l’avantage sur des modélisations extérieures pour la faire leur » [2001]. Cette particularité poreuse profondément ancrée pour Hà Nội (peut-être pour d’autres villes vietnamiennes ; on sait que Hội An présente aussi des manifestations architecturales françaises, japonaises et chinoises) est sans aucun doute très intéressante dans le cadre d’une étude des structures linguistiques architecturales coloniales et postcoloniales. Les colons français en « Indochine » ont essayé de contrôler puis de garder un apparent contrôle du contenu sémiotique et sémantique laissant alors apparaître des changements forcés. D’après l’architecte Nguyễn Hữu Thái [2024] se référant à Christian Pédelahore de Loddis, il semblerait que peu d’endroits dans le monde doivent subir autant de sacrifices à long terme pour reconnaître leur identité. Bien que le développement de la ville coloniale ait été observé et commenté de longue date par des historien·nes ou par des géographes, il a également grandement été étudié par des agents directement impliqués dans la construction des villes sur ces mêmes territoires coloniaux. Les études sur l’architecture vietnamienne avant l’ouverture des échanges internationaux ont en effet d’abord été menées par des universitaires occidentaux·les autorisé·es par le gouvernement colonial français. Toutefois, l’étude de la ville dite coloniale a majoritairement été très superficielle. En raison des différences culturelles, les
études françaises se sont principalement concentrées sur des études formelles et techniques, sans jamais aller jusqu’à l’analyse et l’évaluation des couches de signification et des notions culturelles dans l’architecture traditionnelle vietnamienne [SON LÊ et THÁNH TRẦN 2023, 2]. Autrement dit, les recherches vietnamiennes et étrangères sur l’architecture vietnamienne ont généralement passé sous silence, volontairement ou non, les nombreuses valeurs immatérielles et les significations culturelles associées. Symbol and Space in Architecture-Urban et Architecture and Cultural Symbiosis de Thanh Son Lê en 2001 sont alors deux des premiers ouvrages publiés prenant réellement en compte l’impact et le rôle des valeurs culturelles immatérielles au sein de l’architecture vietnamienne. Selon Thanh Son Lê et Điem Thánh Trần, ces recherches ne restent néanmoins qu’à leurs balbutiements, contrairement aux États-Unis d'Amérique, à l’Europe ou encore au Japon qui, depuis le milieu du 20e siècle, ont intégrés la question sémantique de l’immatérialité, notamment avec Complexity and Contradiction in Architecture par Robert Venturi en 1966.
Ce travail propose alors d’explorer la présence américaine à Sài Gòn et dans ses environs entre 1954 et 1975, à travers une analyse iconologique d’archives photographiques. Ces dates se réfèrent respectivement aux accords de Genève ayant séparé le pays en deux, et à ce que certain·es appellent la chute de Sài Gòn et d’autres, sa libération. Si l’historiographie dominante a souvent abordé ce conflit sous l’angle stratégique ou militaire, ou par une perspective unilatérale focalisée sur l’expérience américaine, cette démarche s’inscrit ici dans le prolongement des études postcoloniales et des réécritures historiographiques. Il s’agit surtout de décentrer le regard, de questionner les narratifs établis et de saisir comment l’impérialisme américain s’est manifesté, non seulement par la puissance des armes, mais aussi par des transformations urbaines,
architecturales, sociales et culturelles, souvent subtiles mais profondément ancrées. Cette prise de recul permet à la fois d’affirmer l’existence d’une réelle emprise américaine sur le paysage sud-vietnamien à une époque précise, tout en essayant d’y déceler les nombreuses dynamiques complexes et leurs différent·es acteur·ices sans immédiatement tomber dans des affirmations superficielles qui poseraient le récit d’une présence américaine indépendante des différentes strates historiques du territoire.
Les archives photographiques constituent ici un corpus d’une richesse incomparable pour cette investigation. Plus qu’une simple illustration, l’image est ici considérée comme un document historique à part entière, porteuse de sens, de symboles et d’idéologies. En mobilisant les outils de l’iconologie, nous chercherons à décrypter les couches de significations de ces photographies – qu’elles soient issues de la presse, des fonds institutionnels ou de collections privées. Comment les cadrages, les sujets, les décors et les interactions humaines figées par un objectif révèlent-ils les dynamiques de pouvoir, les tensions, les appropriations spatiales, l’émergence d’une culture américaine et ses impacts sur le tissu urbain et social de Sài Gòn ? Autrement, comment ces images, souvent produites dans un contexte donné, permettent-elles de comprendre les multiples facettes de l’impérialisme américain et ses répercussions sur une ville en pleine mutation ? En s’appuyant sur une approche sémiotique et iconologique, cette recherche propose une lecture critique des formes architecturales en relation avec les mutations sociopolitiques et les transferts culturels induits par les migrations de guerre.
Le corpus visuel organisé trace les contours d’un territoire réinventé à coups de caméras : façades fortifiées, vitrines translucides, frontières invisibles... Les photographies deviennent autant de preuves visuelles de trajectoires urbaines, depuis la construction de la deuxième ambassade américaine en 1967 jusqu’à l’effervescence des terrasses du Caravelle ou du Rex.
Elles parlent de rencontres croisées en criant des tensions entre impérialismes et réalités locales.
Ce travail s’inscrit ainsi à l’intersection de l’histoire urbaine, des histoires —post/néo—coloniales/impérialistes et de l’analyse visuelle en se construisant autour d’un corpus visuel bien précis. L’objectif est de constituer un premier jalon dans une recherche plus vaste : recoudre l’histoire urbaine de Sài Gòn à travers ses images, et éclairer la treille complexe d’un langage spatial façonné par l’impérialisme.
Les phénomènes urbains et architecturaux au sein des colonies ont systématiquement procédé de stratégies visant à rattacher et à reconfigurer un territoire, même si les modalités sont très variées selon les différents contextes.
L’architecture au sens large (et ses représentations toponymiques, écrites, peintes, racontées, contées, photographiées, filmées etc.) sont alors d’évidents marqueurs essentiels des dynamiques identitaires, particulièrement dans des contextes postcoloniaux où les espaces urbains en portent les traces d’héritages historiques, des reconfigurations politiques et des mutations sociales. Au Sud-Việt Nam entre 1954 et 1975, et plus particulièrement à Sài Gòn, la guerre et les migrations forcées ont profondément bouleversé l’organisation de la ville et de sa région et ses expressions architecturales. La confrontation entre des formes modernistes occidentales, les héritages coloniaux et les autoconstructions issues des déplacements de population constituent un terrain d’étude privilégié pour interroger les transformations spatiales et culturelles de l’époque. Plus largement, la sensibilité et l’acceptation de l’hétérogénéité générale oblige quelque part un inversement des repères temporels, guidés par la notion de non-simultanéité au sein de l’Histoire de l’architecture. Cela n’exclut pas l’importance et l’existence d’acteur·ices développant des œuvres de manière pertinente et conséquente mais ces dernier·es se confrontent sans doute aux contradictions historiques de la modernité, transformant l’ « œuvre » elle-même en clé de lecture de compréhension de ces différentes tensions. Un des points les plus importants dans le cadre de ce travail est alors de comprendre et d’essayer de transmettre l’explication d’un contexte régional et national singulier. L’objectif ici est d’analyser comment des contacts culturels retranscrits par des reconfigurations spatiales et architecturales, qu’elles soient imposées par le contexte de guerre ou issues de processus d’appropriation locale, ont participé à la redéfinition des
identités urbaines. Ce travail s’inscrit alors naturellement dans un contexte d’écriture ou de réécriture postcoloniale et décoloniale d’un modernisme se voulant universel à cette époque. On sait dorénavant qu’il existe d’évidentes faiblesses dans les lectures dominantes des courants architecturaux occidentalo-centrées remises en question à partir des années 1960 puis davantage dès les années 80. Cet effort persiste encore malheureusement dans son incomplétude. Les historiographes de l’architecture du 19e et du 20e siècle se sont en effet chargé·es de la construction d’un récit à la couverture unifiée et quasi théologique. Le courant dominant semblait avancer l’architecture moderne comme une conséquence presque logique et inévitable des évènements historiques précédents, gouvernés par des élites dites avant-gardistes prônant majoritairement la science et la rationalité au service du grand Progrès (persistant aussi généralement à travers des concepts considérés universels comme la démocratie, les droits humains, l’héritage, la raison...).
L’architecture moderne s’érigeait alors inévitablement en destin d’un monde internationalisant [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 4]. Comme le rappelle Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett, il existe continuellement un fossé plus ou moins profond mais inévitable entre les histoires telles qu’elles étaient et les histoires telles qu’elles sont racontées. Le poststructuralisme insiste par exemple sur le fait qu’un retard ou décalage persistant est toujours continuellement présent et signifiant dans la construction de tout sens, dans tout récit, historiographique ou autre, résultant en un sens ou une compréhension sous instabilité continuelle –au mieux provisoire–. En ayant affirmé cela, il est désormais nécessaire, ou en tout cas important, de faire attention aux récits stables et aux « vérités objectives » qui construisent globalement de manière pragmatique des sens au sein des différents intérêts d’institutionnalisation des pouvoirs existants. Loin de l’idée d’affirmer que l’historiographie moderne complète a été constamment falsifiée ou manipulée, les études de situations marginales permettent régulièrement de répondre à des lacunes évidentes tout en corrigeant de potentielles erreurs ou imprécisions si nécessaire. [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 4]. Ces études sont par ailleurs évidemment soumises
aux mêmes affirmations poststructuralistes de l’instabilité historique de la notion même de récit. Cela sert au mieux à s’assurer que les routes dominantes n’ont pas effacé les autres chemins. Pour Walter Benjamin, le chercheur critique en histoire doit toujours être vigilant quant à la propension de la modernité à mythologiser son passé [1942]. Le sujet de l’Occident comme influence mondiale semble par ailleurs également être un prisme à (re)questionner. Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett [2022] affirment ici qu’il pourrait s’agir de la modalité la plus persistante au sein de toutes les autres modalités dites coloniales ou néocoloniales. Cette modalité est d’ailleurs encore aujourd’hui toujours énormément présente dans l’historiographie commune qui persiste encore à placer sans arrêt le modernisme occidental au centre, sur un modèle concentrique, influençant voire inspirant alors les existences considérées comme périphériques.
« a global modernist, or a post-postcolonial, perspective seeks to outline the advent of—and, by extension, advances a future for—modernist ideas and practices as indexed to the multilateral ebbs and flows of the colonial and postcolonial world. The problem here is that while the simple hub-and-spoke model of international modernism provides a clear model for organizing one’s understanding of how things happened, the "actual" modalities of how things occurred is inherently convoluted, entangled, and resistant to easy generalizations. There is not a simple and clear picture from which one can zoom out and quickly outline »1
[PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 17]
Ici, une des façons avancées dans la résolution de cette construction historiographique serait de reconstruire la mécanique du modernisme comme étant un processus diffractif (au sens physique du terme)2. A l’opposé du modèle
1[Traduction] une perspective moderniste globale, ou postcoloniale, cherche à esquisser l’avènement des idées et pratiques modernistes –et, par extension, à en promouvoir l’avenir– en les indexant sur les flux et reflux multilatéraux du monde colonial et postcolonial. Le problème est que, si le modèle simple du modernisme international en étoile fournit un modèle clair pour organiser la compréhension de la manière dont les choses se sont produites, les modalités « réelles » de la manière dont les choses se sont produites sont intrinsèquement alambiquées, enchevêtrées et réfractaires aux généralisations faciles. Il n’existe pas d’image simple et claire à partir de laquelle on puisse faire un zoom arrière et tracer rapidement les grandes lignes.
2Voir également la discussion sur le « modernisme diffractif » dans PRAKASH Vikramaditya, One Continuous Line : Art, Architecture and Urbanism of Aditya Prakash, 2021, p.277-87
La discussion de PRAKASH s’appuie sur les écrits de la physicienne quantique et théoricienne culturelle féministe queer Karen Barad.
concentrique (dit « en étoile » dans ce texte-ci) et en décalage par rapport à la simple affirmation de « modernités multiples », il est proposé par Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et Daniel E. Coslett de « penser l’architecture moderne comme une série de pratiques onto-épistémiques interactives qui sont constamment productives et reproductives les unes des autres, rebondissant et ricochant les unes sur les autres, non pas au hasard, mais avec des degrés significatifs d’incertitude inhérente »[2022, 18]. Autrement dit, les choses ne sont évidemment pas le fruit du simple hasard, cela n’implique pas néanmoins qu’elles doivent être systématiquement rigoureusement causales [PRAKASH, CASCIATO et COSLETT 2022, 18].
En étudiant des réalités temporelles plus actuelles, AbdouMaliq Simone [2022] semble néanmoins interroger indirectement des configurations semblables à celles observables avec la rapide urbanisation de Sài Gòn entre 1954 et 1975. En réalité, on pourrait même poser l’hypothèse de situations presque analogues entre cette période et l’urbanisation actuelle, au moins dans ces conséquences. Dans Massive urbanization and the circulation of eventualities, il est question d’interroger l’expansion volumineuse de l’espace urbain et donc des intersections entre ces différentes existances matérielles, biologiques, urbaines etc. en essayant de dévoiler « certains des rôles que joue le temps des éventualités en tant qu'aspect critique de l'urbanisation et les façons dont l'ampleur apparente de l'urbanisation, en particulier dans les pays du Sud, offre un contexte important pour la refonte collective en cours d'une majorité urbaine » [SIMONE 2022, 353]. Parallèlement, si le contexte urbain autorise de potentielles attirances et forces gravitationnelles, il exclut inévitablement d’autres forces de sa réalité. Ces différentes modalités d’inclusion, d’exclusion, de déplacements etc. « modifie[nt] également la signification et la position de ces choses en composant de nouveaux « quartiers » de relations, c’est-à-dire en multipliant les produits spatiaux » [SIMONE 2022, 353]. Autrement dit, l’urbain n’est pas soumis et ne soumet pas uniquement à son caractère extensif en tant que volume spatial mais aussi à des entremêlements inévitables de processus parfois inconciliables. La dépossession générale de l’espace entraîne par ailleurs des
fig. 1 : babaie sussan, eshraqi tasnim, the woods, représentant une vision imaginaire des cultures architecturales et de leurs généalogies flexibles, basée sur l'histoire mondiale de l'architecture de fischer von erlach, date inconnue
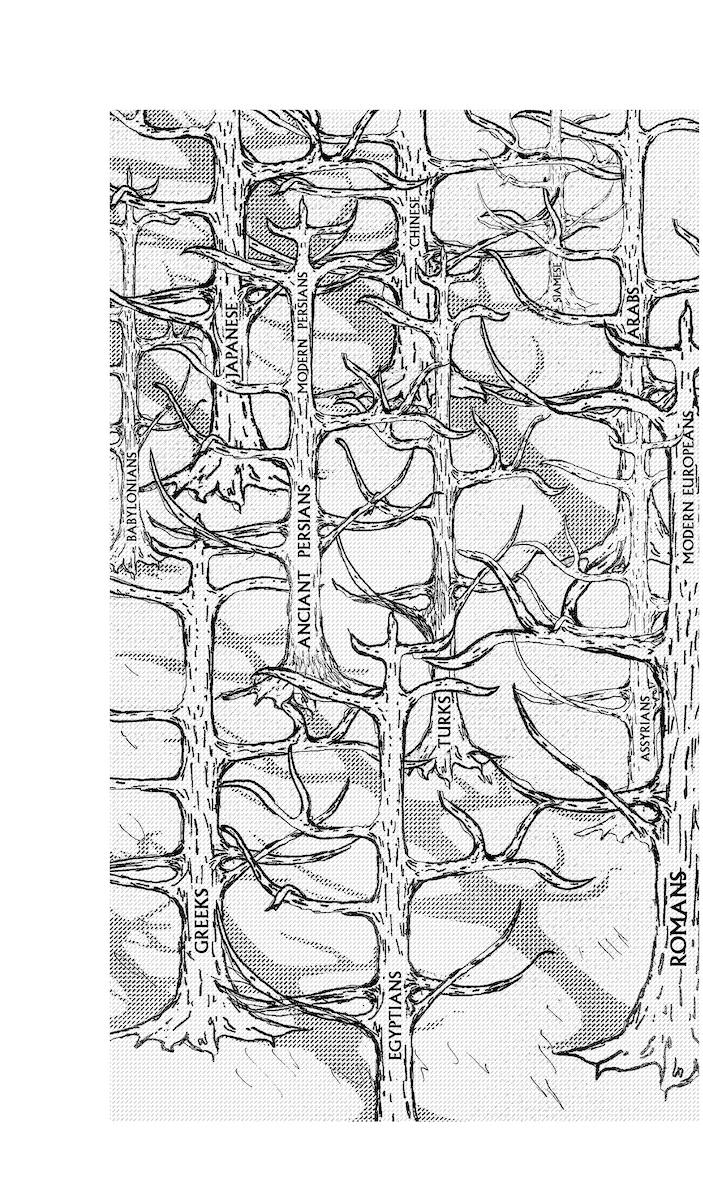
dépossessions des ancrages, des histoires cohérentes et de la position compensée par d’autres formes de dépossessions qui se traduisent alors par des engagements plus timides de la part des résident·es envers des manières plus particulières à la fois de se placer dans l’espace urbain mais également d’y naviguer
[CHITONGE et MFUNE 2015, 209-218].
« While certainly anticolonial struggles had certain urban dispositions in mind that corresponded with prevailing notions of popular will, social justice, and national aspirations, much of postcolonial urban history has been a deferral of settling into any definitive or determinate trajectory of what the urban should be. There are modernist imaginaries, rampant and voluminous conversions of public assets into private accumulation, and the persistence of widespread impoverishment and dispossession. But most urban areas of the Global South resound in ambivalence and ambiguity, where the "popular" is expressed more as a tacit form of resistance, of throwing things askew, than in institutionalizing a clear-cut imagination of efficacy or justice while at the same time holding out for eventualities of all kinds, utopian and dystopic »3
[SIMONE 2022, 358]
Pour AbdouMaliq Simone [2022], la marginalisation semble en grande partie opérée au niveau des périphéries devenant alors un exemple efficace des entremêlements de temporalités et de réalités coexistentes : « métayage, zones industrielles, fabrication à petite et moyenne échelle, lotissements haut et bas de gamme, terres agricoles détenues par la communauté, zones de loisirs et bassins versants » [SIMONE 2022, 359]. L’auteur affirme alors que « les périphéries semblent souvent être le théâtre d’atmosphères instables en raison du développement rapide, du manque de clarté et de coordination concernant les responsabilités juridictionnelles et du fait que de nombreux types d’argent différents sont en jeu » [SIMONE 2022, 359]. Nous verrons plus tard que la question du développement urbain périphérique est particulièrement pertinente lorsque l'on étudie Sài Gòn pendant la guerre américaine. Par ailleurs, ces zones de contact persistent alors
3[Traduction] Alors que les luttes anticoloniales avaient certainement à l’esprit certaines dispositions urbaines correspondant aux notions dominantes de volonté populaire, de justice sociale et d’aspirations nationales, une grande partie de l’histoire urbaine postcoloniale a été un report de l’établissement d’une trajectoire définitive ou déterminante de ce que l’urbain devrait être. Il y a des imaginaires modernistes, des conversions rampantes et volumineuses de biens publics en accumulation privée, et la persistance d’un appauvrissement et d’une dépossession généralisés. Mais la plupart des zones urbaines du Sud global résonnent dans l’ambivalence et l’ambiguïté, où le « populaire » s’exprime davantage comme une forme tacite de résistance, de remise en question, que dans l’institutionnalisation d’un imaginaire clair et net d’efficacité ou de justice, tout en s’attendant à toutes sortes d’éventualités, utopiques et dystopiques.
continuellement dans une hétérogénéité multi-scalaires soumise à des disparités évidentes de développements très ou trop rapides, « des milliers de petits promoteurs aux grandes sociétés immobilières »[SIMONE 2022, 364] transformant parfois le paysage en un enchevêtrement d’entrepôts, de logements collectifs, de logements individuels, de centres commerciaux etc. voire même de planifications urbaines plus larges n’émergeant jamais, ne remplissant que partiellement les fonctions originellement prévues, ou aux taux d’occupation faible.
« Urban life will be remade in the interstices, in those moments and places where things could go in different directions, where the relations among discrete urban actors, locations, built environments, and eco- nomic functions rub up against each other in ways that resist total control, which indeed spur the continuous elaboration of various "settlements"—both in the sense of political negotiations, spatial and social forms, and modes of belonging »4
[SIMONE 2022, 365]
Ce que l’on entend ici en développant ce propos concerne non seulement l’actualité de tels sujets mais aussi la potentielle répétitivité d’une histoire qui, tout en prenant en compte les différents déplacements opérés par les dynamiques et ses acteur·ices, mérite qu’on y développe un intérêt certain. De la dépossession des corps à celle des espaces, les différentes structures impérialistes agissent à travers une multiplicité d’outils bien spécifiques.
Par ailleurs, l’architecture au sens large dans les pratiques coloniales relevaient presque uniquement de principes jugés comme « bons » liés à des facteurs spécifiques : chaleur, hygiène, confort thermique etc. L’objectif a toujours résulté d’une logique d’appropriation des terres colonisés comme étant des territoires à bâtir, processus également appliqué aux êtres vivants. Cette logique passait avant tout par la recherche de construction d’une architecture européenne « parfaite », n’hésitant jamais à appliquer les pratiques européennes associées afin de lutter contre la chaleur par
4[Traduction] La vie urbaine sera refaite dans les interstices, dans ces moments et ces lieux où les choses pourraient prendre différentes directions, où les relations entre les acteurs urbains discrets, les lieux, les environnements bâtis et les fonctions économiques se heurtent les uns aux autres d'une manière qui résiste au contrôle total, ce qui stimule en fait l'élaboration continue de divers « accords » - tant au sens de négociations politiques, de formes spatiales et sociales que de modes d'appartenance.
exemple. Techniquement, cela pouvait se retranscrire par l'apparition de doubles toitures, de systèmes d’aération, de climatisation (apportée au Việt Nam par les américain·es), de persiennes, brise-soleil, de certains matériaux, de techniques de construction... Si l’on se penche aussi par exemple sur la situation du « Congo belge » entre 1908 et 1960, certaines situations locales ont particulièrement servi des logiques de conceptions spatiales profondément racistes. Ici, à cause de maladies comme la malaria, les populations blanches avaient décidé de se séparer des populations noires à travers un urbanisme ségrégateur et une zone neutre de séparation entre les deux populations. Il est nécessaire d’être conscient qu’en plus des nombreux impacts sur ces territoires colonisés, l’écriture du mouvement moderne occidental a servi la transmission de ces mêmes dynamiques à l’époque au sein des institutions et des formations occidentales. Si l’on voit pendant le 20e siècle la multiplication de figures occidentales « explorant » le reste du monde (Le Corbusier, Ernst May, Louis Kahn...), ces mouvements ont permis la création et l’entretien d’un corpus particulièrement critiquable aboutissant par exemple à l’apparition en Angleterre de cours de Tropical Architecture dispensés en 1955 à l’Architectural Association de Londres par une série d’architectes comme Maxwel Fry ou Otto Koenigsberger. Ces architectes ont une longue expérience de construction en conditions tropicales (qui ne sont officiellement plus des colonies — on voit aussi un glissement de la terminologie et de la sémantique) [PERZIANI 2021]. Ce nom d’architecture tropicale, pour caractériser les climats non-tempérés de ces régions sera d'ailleurs ensuite partagé par l’ensemble des métropoles. Bien qu’elle agisse déjà dans un cadre de « décolonisation » (encore discutable), cette architecture est donc également sérieusement interrogeable : au-delà d’une architecture climatique, c’est aussi une architecture de prédominance d’un confort occidental. S’inscrire dans une posture critique postcoloniale ou subalterne relève alors d’une volonté bien affirmée de prendre un recul certain et de requestionner ces différentes dynamiques. Ces volontés émergent au moment où les forces coloniales et colonisées commencent à étudier les énergies qui permettent
de lutter contre les mécanismes coloniaux parallèlement aux premiers mouvements d’indépendance. Parmi certaines figures importantes de l’apparition de ces remises en question, on peut notamment citer Aimé Césaire, né en Martinique, et son Discours sur le colonialisme [1950].
« Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en tant que tel, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les Nègres d’Afrique » [1950, 13-14]
L’entreprise coloniale, loin d’être un mouvement bienveillant de « civilisation », propos encore publiquement tenu aujourd’hui par certaines personnes occidentales, généralement blanches, fut en réalité bel et bien un processus de « chosification » et d’exploitation. Césaire dénonce ici l’hypocrisie des colonisateur·ices qui, tout en prétendant sauver les peuples colonisés, se livraient elleux-mêmes à des actes de violence, de pillage et de destruction. Il va même plus loin en affirmant, avec une ironie cinglante, que ces méthodes barbares ne sont pas restées confinées aux colonies, mais ont contribué à un « ensauvagement » de l’Europe elle-même. Avec d’autres figures comme Frantz Fanon et les Damnés de la Terre [1961], la pensée postcoloniale apparaît alors au sein des universités à la fin des années 70, continuant à interroger les dynamiques coloniales à travers « une approche, une manière de poser les problèmes, une démarche critique qui s’intéresse aux conditions de la production culturelle des savoirs sur Soi et sur l’Autre, et à la capacité d’initiative et d’action des opprimés dans un contexte de domination hégémonique » [SMOUTS 2007, 33]. Ensuite éclairées par l’Orientalisme [1978] d’Edward Saïd, les études postcoloniales ont radicalement transformé la compréhension du colonialisme. Loin de se limiter à une domination militaroéconomique, Saïd révèle comment l’Occident a construit un
« Orient » stéréotypé par une « infrastructure discursive » et une « économie symbolique », justifiant ainsi son contrôle tout en affirmant sa propre identité par une altérisation réductrice et souvent déshumanisante [PERZIANI 2021]. Cette perspective est essentielle pour déconstruire les récits établis et s’inscrit pleinement dans les « subaltern studies », qui visent à légitimer les histoires « autres » et à rendre visibles les populations et les paysages ignorés par les récits eurocentriques. Achille Mbembe, quant à lui, souligne que le colonisé n’est pas une entité passive, mais un individu actif, dont l’existence est façonnée par la biopolitique et des dynamiques d’« enchevêtrement ». Cette reconnaissance de l’hybridité, développée par des penseurs comme Homi Bhabha et illustrée par Jyoti Hosagrahar, défie les oppositions binaires rigides telles que colonisateur·ice/colonisé·e ou traditionnel/moderne, montrant que les cultures et les identités sont constamment en interaction et en mutation [PERZIANI 2021].
« Postcolonial thought questions the dominance of universalizing paradigms and simplistic categorizations in conventional scholarship in architecture and urbanism focused on Western Europe and North America. Dichotomies such as those between West and non-West, traditional and modern, have persisted as rigid oppositions that deny both the interdependence and the inequalities in the relationship.
Postcolonial perspectives challenge the notion of a universal modernism that privileges those in positions of power and authority, legitimating their right to define fundamental values, policies, operations, and identities. They acknowledge instead the multiple dimensions of subordinate experiences. In so doing, postcolonial perspectives particularize universal narratives and globalize narrowly parochial ones »5
[HOSAGRAHAR 2012, 1]
En architecture et urbanisme, cette approche postcoloniale remet en question les paradigmes universalistes et les
5[Traduction] La pensée postcoloniale remet en question la prédominance des paradigmes universalistes et des catégorisations simplistes dans les études conventionnelles en architecture et en urbanisme axées sur l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Les dichotomies telles que celles entre l'Occident et le non-Occident, le traditionnel et le moderne, ont persisté sous forme d'oppositions rigides qui nient à la fois l'interdépendance et les inégalités dans la relation.
Les perspectives postcoloniales remettent en cause la notion d'un modernisme universel qui privilégie ceux qui occupent des positions de pouvoir et d'autorité, légitimant leur droit à définir les valeurs fondamentales, les politiques, les opérations et les identités. Elles reconnaissent plutôt les multiples dimensions des expériences subordonnées. Ce faisant, les perspectives postcoloniales particularisent les récits universels et mondialisent ceux qui sont étroitement paroissiaux.
catégorisations simplistes souvent centrées sur l’Occident. L’architecture coloniale n’est plus vue comme une simple importation de modèles, mais comme un « réceptacle de la culture » où s’expriment les rapports de pouvoir. Des travaux comme ceux de Thomas Metcalf et Kathleen JamesChakraborty démontrent que même l’intégration d’éléments locaux relevait souvent d’une stratégie de légitimation du pouvoir colonial, plutôt que d’un véritable respect des traditions. La modernité occidentale est ainsi intrinsèquement liée au colonialisme, les territoires colonisés ayant parfois servi de laboratoires d’expérimentation pour des solutions architecturales ensuite appliquées en Occident [PERZIANI 2021]. La prétendue « architecture tropicale » ou « écologique » est également nuancée, puisque l’attention portée au confort visait avant tout celui de l’homme blanc, reproduisant les hiérarchies coloniales. Que ce soit d’ailleurs à travers les éléments architecturaux, les matériaux utilisés etc., tout cela a également nécessité des infrastructures qui ont aussi participé à la colonisation de l’espace — qui n’est donc pas seulement le fait d’architectes, mais aussi d’ingénieur·es, de militaires, de médecins... Ce cadre théorique invite alors à une lecture critique des formes architecturales et urbaines, à la recherche des multiples dimensions des expériences subordonnées et des résonances culturelles complexes inscrites dans le bâti, tout en reconnaissant les défis méthodologiques et la nécessité de décoloniser, démarchandiser, démocratiser et démasculiniser le patrimoine hérité de cette période.
Le contexte de la guerre américaine au Việt Nam résonne particulièrement avec cette volonté de décentralisation historiographique tant elle a reposé sur une multitude de récits bien différents, souvent soutenus par des efforts de propagande qu’elle soit communiste ou américaine. Une étape importante de cette relecture du conflit est notamment la publication des Pentagone Papers dès 1971 par le New York Times, documents secrètement fournis par Daniel Ellsberg, alors analyste pour l’étude classifiée du secrétaire à la Défense Robert McNamara sur la guerre du Việt Nam. Ellsberg et son coaccusé Anthony Russo avaient secrètement copié un rapport de 7000 pages ensuite envoyé au New York Times et au Washington Post
[CHOMSKY 2010]. Si ces documents révèlent bel et bien que le mensonge gouvernemental était une partie essentielle de la guerre, il est curieux de constater, encore trop souvent, une lecture toujours positiviste et soi-disant bienveillante de l’intervention américaine, notamment par d’ancien·nes acteur·ices de ce même conflit.
Dès lors, la question des archives, en particulier dans le contexte d’une présence impérialiste comme celle des États-Unis d'Amérique à Sài Gòn, est bien plus qu’une simple quête de documents ; elle constitue une démarche critique fondamentale. Les fonds officiels, qu’ils soient textuels ou visuels, ne sauraient être appréhendés comme des dépositaires neutres de l’histoire.
Ils sont, au contraire, des constructions intrinsèquement liées aux idéologies et aux rapports de pouvoir de l’époque, reflétant la perspective de la puissance dominante et contribuant à la légitimation de ses actions. Une relecture postcoloniale exige une mise à distance de ces sources, cherchant les silences, les omissions et les biais qui masquent les voix subalternes ou les réalités dissonantes avec le récit hégémonique.
L’iconologie, appliquée aux archives photographiques et architecturales, devient alors un outil puissant pour déconstruire le « regard » colonial ou impérial, révélant comment les images peuvent à la fois révéler la construction symbolique et spatiale du territoire, tout en dissimulant les tensions, les résistances et les complexités des interactions entre dominant·es et dominé·es.
Comme explicité précédemment, la modernité occidentale est intrinsèquement liée au colonialisme et à la découverte du monde « non-occidental ». Cette interdépendance complexe exige une vigilance particulière dans l’analyse. Il est crucial d’éviter le piège de substituer un discours dominant par un autre. Bien que la pensée postcoloniale s’oppose à une narration universaliste, elle doit opérer une lecture critique nuancée. Cela signifie reconnaître l’existence de certains supports et aspirations globales, telles que la volonté de démocratisation, sans pour autant nier l’absence totale d’interdépendances entre certaines histoires. Ce questionnement méthodologique, fondamental pour comprendre comment lire l’histoire, est particulièrement délicat car il navigue entre la spécificité des récits et les connexions universelles, exigeant une attention constante aux dynamiques de pouvoir et aux contextes. Une approche méthodologique subalterne sous-entend par exemple aussi une remise en question non seulement de la gestion historique des archives (coloniales) officielles, manipulées et particulièrement biaisées. Comment pouvonsnous accéder à l’Histoire non officielle ?
Au sein de ce travail, l’examen des représentations visuelles de la présence américaine à Sài Gòn s’appuie sur une approche iconologique, comprise comme l’étude approfondie des strates de significations culturelles, politiques et idéologiques que recèlent des images. Ce cadre analytique postule que les photographies et autres iconographies, loin d’être de simples reflets passifs, constituent des instruments actifs dans la construction et la légitimation des réalités territoriales et des dynamiques de pouvoir. La démarche méthodologique souhaite d’abord interroger les registres iconologiques et discursifs propres aux différent·es acteur·ces impliqué·es dans la documentation de cette période. L’objectif est ensuite de réussir à déchiffrer les complexes relations de pouvoir –qu’elles soient de rivalité, de collaboration ou d’autres natures –qui les unissent. Enfin, nous nous attacherons à démontrer l’incidence
de ces rapports sur les configurations territoriales produites et perçues. Ainsi, les paysages de Sài Gòn ne sont pas uniquement appréhendés comme de simples scènes photographiées ou cartographiées ; ils sont résolument pensés, construits et contestés à travers le prisme des images. L’iconologie offre de ce fait un outil heuristique afin de déceler certaines logiques de pouvoir figées à travers l’image de zones chargées d’enjeux, mettant en lumière les tensions entre visibilité, effacement et résistance.
En premier lieu développé dans les pays anglo-saxons, William J.Thomas Mitchell, professeur aux départements de littérature anglaise et d’histoire de l’art de l’université de Chicago, est l’un des premiers à utiliser la notion d’iconologie en 1986 dans son ouvrage éponyme. À la confluence de l’histoire de l’art, de la théorie littéraire, de l’esthétique, de l’histoire des idées et des cultural studies, les « visual studies » apparaissaient alors comme un tout nouveau champ d’investigation. Si l’image a cependant régulièrement remué de nombreuses questions esthétiques, il s’agit ici d’essayer de ne dégager que les considérations liées aux systèmes de lecture des images, au cœur de ce travail.
« Analysée en termes de conflit, de lutte territoriale, voire de guerre entre médias, mais aussi en termes de liaisons sociales, familiales, voire amoureuses, la relation entre texte et image trouve dans Iconologieune méthodologie propre à son étude, qui évite soigneusement la restauration des dualismes. À partir d’une lecture très judicieuse des « différences », elle n’apparaît plus à Mitchell sous laforme d’un dialogue de sourds, d’une relation exclusive, mais comme un échange constant, vital et inhérent aux médias ; et il ne peut donc plus s’atteler à la définition d’un média proprement visuel, mais plutôt à la description de la manière dont ce média altère et est altéré par un autre »
[MITCHELL 1986, 9]
Mitchell soutient par ailleurs que la distinction apparemment évidente entre les images sans distinctions (mentale, verbale, métaphorique) et les mots (ou textes) est une construction culturelle et historique, et non une différence naturelle et essentielle. La lutte pour la domination entre ces deux modes de représentation semble être une constante de l’histoire culturelle, reflétant des oppositions plus profondes comme celles entre
nature et culture, espace et temps, ou corps et esprit. En développant une réflexion sur la dualité picture/image, Mitchell développe aussi une pensée intéressante d’une approche iconologique des images. Ici est opérée une distinction (propre à l’anglais) où la picture est l’objet matériel (une peinture, une photo) tandis que l’image est l’entité immatérielle qui survit au-delà de sa condition physique dans la mémoire, les récits etc.
[MITCHELL 1986, 21]. Elle est ce qui peut être invoqué par l’esprit rien qu’en étant nommé.
« La notion panofskienne de « motif » est ici pertinente, au sens du détail d’une représentation picturale suscitant la connaissance, et plus particulièrement la reconnaissance, la prise de conscience que « ceci est cela », la perception de l’objet nommable, identifiable, qui apparaît comme une présence virtuelle, la « présence absente » paradoxale mais fondamentale à toute entité représentationnelle »
[MITCHELL 1986, 22]
Cette notion de « motif » paraît très importante dans le contexte de la guerre américaine au Việt Nam qui fut l’un des premiers grands principaux conflits particulièrement médiatisé et photographié. Son image reste aujourd’hui gravée dans la plupart des esprits à travers des clichés désormais mondialement connus et intégrés sans même devoir prendre la peine de les citer ou de les montrer. Autrement dit, ces considérations posent un certain constat que Mitchell emprunte à Wittgenstein : « s’il n’y avait plus d’esprits, il n’y aurait plus d’images, qu’elles soient mentales ou matérielles. Le monde ne peut être dépendant de la conscience, mais les images dans le monde (pour ne pas dire du monde) le sont de toute évidence ; non seulement parce que la conscience emploie une main humaine pour produire un tableau, un miroir ou n’importe quelle autre forme de simulacre (en un certain sens, les animaux sont eux aussi capables d’engendrer des images, par exemple lorsqu’ils se camouflent ou qu’ils s’imitent entre eux), mais parce qu’une image ne peut être vue comme telle sans un artifice paradoxal de la conscience » [MITCHELL 1986, 56]. Les images reflètent, à travers l’interprétation consciente ou inconsciente, des réalités sociales, culturelles, politiques et humaines assez flagrantes.
Au sujet des représentations visuelles, on peut alors historiquement distinguer deux principales façons d’envisager

l’imagerie verbale. La première concerne cette dernière en tant que langage métaphorique, détournant quelque part le sujet littéral de l’image. Pour Joseph Addison [1961] par ailleurs, « l’image verbale (habituellement assimilée à la « description ») forme la clé de voûte de toute langue. Une bonne description produit des images « qui découlent des expressions verbales » de manière plus vivante que les « images qui émanent des objets » »
[MITCHELL 1986, 65]. Suivant cette dernière affirmation, Mitchell développe à la suite un propos intéressant encadrant le travail d’analyse des images comme contenu communiquant total. Contrairement à un texte où chaque lettre est un caractère unique et réutilisable, une image est dense d’un point de vue syntaxique et sémantique. Cela implique qu’aucune marque ne peut être extraite de son contexte sans en perdre son sens car elle ne possède pas de référence unique. La signification de chaque partie dépend de sa relation avec le tout, dans un champ continu. En prenant l’exemple de la peinture, Mitchell avance alors qu’une tache de peinture spécifique peut être interprétée comme le reflet sur le nez de la Joconde, mais que cette signification est entièrement dépendante du système pictural de cette œuvre et ne peut être transposée sur d’autres toiles [MITCHELL 1986, 123]. Il est maintenant important, si l’on questionne le rapport entre image et lecture, d’aborder le sujet de l’interprétation. Comme le texte est apte à subir théoriquement une infinité d’interprétations, il en est de même pour l’image. En ce sens, le précédent propos de Mitchell est tout particulièrement intéressant. Certes le texte est composé de mots indépendamment incarnés mais on peut supposer, ici pour le cas de la photographie, qu’il en est presque de même. Autrement dit, une scène de paysage avec une patrouille militaire au premier plan par exemple pourrait en effet être analysée simplement, élément par élément. L’image photographique du « soldat » révèle l’élément « soldat », indéniablement porteur de sens pour (presque) n’importe quel être humain. Il s’agit ensuite de donner du sens au-delà de la simple compréhension de l’image visualisée, d’interpréter. En ce sens, différentes stratégies ont existé tout au long de l’histoire des études visuelles. Pour Karl Marx par exemple et sa théorie de la camera obscura, cette dernière est employée comme
analogie décrivant la manière dont la réalité sociale semble être inversée ou déformée, en particulier en ce qui concerne l’idéologie et la conscience de classe. En ce sens, tout en étant très critique de l’outil photographique ou cinématographique en général, ce dernier propose de ne jamais croire en la représentation et de ne s’en tenir qu’aux choses telles qu’elles sont.
« Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation d’autrui, pour aboutir ensuite aux hommes, en chair et en os ; non, on part des hommes dans leur activité réelle ; c’est à partir de leur processus de vie réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que l’on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles »
[ENGELS et MARX 1968, 51]
Parallèlement, Jonathan Crary déclare lui aussi :
« Plusieurs conséquences majeures découlent de la modernisation capitaliste : l’une d’elles est la marginalisation de l’image comme « intériorité », au sens d’une création ou d’une production mentale individuelle. La paralysie et la dévaluation radicale de la capacité humaine à produire ses propres images (autrement dit, de l’imagination) est indissociable de l’essor des images manufacturées, qui s’imposent progressivement comme le matériau brut et impersonnel de la vie psychique, et qui déterminent les conditions formelles de toutes les « images mentales ». L’hégémonie des industries globales de l’image entraîne la disparition de l’image visionnaire »
[CRARY 2006, 178-179]
A cette injection, Mitchell développe l’alternative suivante, « celle de pénétrer l’idéologie au moyen d’un processus d’interprétation, au moyen d’une herméneutique du soupçon qui sache défier le contenu superficiel des représentations, une herméneutique qui transpercerait cette surface pour atteindre la signification profonde qu’elle dissimule. Aussi, si nous ne sommes pas en mesure de déjouer les images inversées de la camera obscura, du moins pourrons-nous les rectifier par un acte
de ré-interprétation » [MITCHELL 1986, 256]. Néanmoins, entre cette lecture idéaliste et l’empirisme pur de Marx, on peut aisément admettre qu’aucune des deux solutions ne semblent complètement convaincantes.
Ce travail d’analyse d’archives photographiques, au-delà de l’analyse d’images, rejoint à travers son approche archivistique de l’objet, des considérations intrinsèquement historiques. Dans ce cadre-ci, ces recherches s’inscrivent alors pleinement dans une troisième alternative d’analyse aussi avancée par Mitchell, la plus convaincante dans l’objectif de révéler la présence américaine à Sài Gòn pendant la guerre. Le chemin emprunté peut donc être celui d’une reconstitution du processus historique rattachée aux images autrement dit, dévoiler les contextes de production et de circulation qui ont permis à ces images d’exister. La seule façon de corriger les illusions de l’idéologie serait donc de ne pas de chercher une vision « directe » et non médiatisée de la réalité mais de reconstituer l’histoire matérielle de la production et des échanges qui ont donné naissance à ces images idéologiques. En ce sens, on arrive aussi à ne pas simplement considérer les images comme de simples données statiques inertes comme pourrait l’envisager une approche empiriste de la question.
« Dès que l’on représente ce processus d’activité vitale [...] l’histoire cesse d’être une collection de faits sans vie, comme chez les empiristes [...], ou l’action imaginaire de sujets imaginaires, comme chez les idéalistes » [ENGELS et MARX 1968, 51]
De ce fait, l’approche historique iconologique ici envisagée se rapproche aussi du concept d’image dialectique développé par Walter Benjamin en 1982 dans Paris, capitale du XIXe siècle. L’image dialectique rompt alors avec la conception linéaire et continue de l’histoire. Elle est un arrêt dialectique, un moment où ce qui a été rencontre le « maintenant », dans un éclair, pour former une constellation. Autrement, elle vise à faire éclater le continuum de l’Histoire en révélant une vérité qui est restée non perçue ou refoulée. Envisagé comme un outil de conscience politique chez Benjamin, l’image pourrait défaire les orthodoxies idéologiques et provoquer une prise de conscience
exposant des contradictions et des violences sous-jacentes.
« For Benjamin, the crucial moment of historical reflection is hermeneutically based in the ‘reading’of the dialectical image, in which the innate contradictionsand injustices of culture are imprintedlike fossils. In this way, history is not teleologically determined, but a living possibility that must beconstantly reimagined. Therefore, the reading ofthe dialectical image exists within a duality of objectand optic. The dialectical image, thus, is not justan abstract idea but a way of seeing both past and present simultaneously »6 [LIPTON 2016, 81]
Ross Lipton nuance néanmoins ce propos en essayant d’exposer dans Benjamin’s Dialectical Image and the Textuality of the Built Landscape, le potentiel réductionnisme auquel une telle approche peut se confronter. L’acte d’appréhender une topographie comme un texte suppose une réduction préalable des diverses formes d’habitation humaine à une langue commune et totalisante. Cette démarche, précisément celle que Benjamin critiquait dans la monumentalité symbolique du Paris du XIXe siècle, pourrait transformer la richesse des existences vécues en une abstraction réductrice. Cette tentative d’abstraire la complexité d’un lieu habité pour la confiner dans l’espace conceptuel puis de « traduire » ses paramètres formels et esthétiques par-delà les frontières géographiques et culturelles, pourrait s’enraciner dans la conviction qu’un langage spatial et architectural universel existe, susceptible de s’appliquer indifféremment à chaque recoin du globe [LIPTON 2016, 76]. Dans La Production de l’Espace [1974], Henri Lefebvre met tout autant en garde contre le danger de déterminer l’espace comme un système de motifs linguistiques/codes. Là où Lipton finit néanmoins à se réconcilier avec l’image dialectique de Benjamin, c’est au sujet de la conscience historique et subjective de la lecture et de l’interprétation liés aux implications textuelles de l’image. Autrement dit, « la composante textuelle de l'image dialectique n'est pas une vision de totalité inscrite, mais une rencontre entre le passé, en tant que confluence de
6[Traduction] Pour Benjamin, le moment crucial de la réflexion historique repose, d'un point de vue herméneutique, sur la « lecture » de l'image dialectique, dans laquelle les contradictions et les injustices inhérentes à la culture sont imprimées comme des fossiles. Ainsi, l'histoire n'est pas déterminée de manière téléologique, mais constitue une possibilité vivante qui doit être constamment réinventée. Par conséquent, la lecture de l'image dialectique s'inscrit dans une dualité entre l'objet et l'optique. L'image dialectique n'est donc pas seulement une idée abstraite, mais une façon de voir simultanément le passé et le présent.
récits disparates, et le moment contemporain (Jetztzeit). Dans cet éclair de reconnaissance, l'histoire est perçue comme un objet à « construire » activement plutôt que simplement à se remémorer »[LIPTON 2016, 76] [BENJAMIN 1942].
« Benjamin’s approach offers an alternative means of viewing architecture, by emphasising the task of observation as an embodied encounter rather than an objective analysis or a detached reading of a text. A place cannot be lifted out of the ‘blank space’ of time and studied in isolation but only as a crucial intersection between what it has signified, what it currently signifies, and what it will come to signify »7
[LIPTON 2016, 87]
« La théorie des images dialectiques se pose en tant que perspective politique et théologique, diagnostique et projective, de l’histoire, comme celle d’une mémoire involontaire d’une humanité délivrée, en tant qu’établissement d’une temporalité de l’achèvement comme complétude et de la discontinuité »
[BAROT 2018]
Si le matérialisme historique de Marx éclaire comment les conditions matérielles façonnent l’idéologie, Benjamin en offre donc une relecture radicale en brisant la notion de progrès historique linéaire. Loin d’une évolution continue, Benjamin compare l’histoire à un kaléidoscope : chaque rotation détruit un ordre pour en révéler un nouveau, soulignant l’absence de nécessité prédéfinie dans le cours du monde. Cette vision non linéaire est le terrain fertile de l’image dialectique. Celle-ci n’est pas une simple représentation, mais une constellation fulgurante où passé et présent entrent en collision pour dévoiler une vérité critique, subvertissant les récits figés et les idéologies dominantes. L’image dialectique devient ainsi un outil puissant pour une analyse iconologique qui dépasse la surface des apparences, révélant les tensions et les dynamiques de pouvoir cachées dans les représentations visuelles, notamment celles liées à l’impérialisme.
Maintenant que l’on a posé le cadre iconologique comme devant être une prise en compte du processus historique, il
7[Traduction] L'approche de Benjamin offre une autre façon d'appréhender l'architecture, en mettant l'accent sur l'observation comme une rencontre incarnée plutôt que comme une analyse objective ou une lecture détachée d'un texte. Un lieu ne peut être sorti de l'« espace vide » du temps et étudié de manière isolée, mais uniquement comme une intersection cruciale entre ce qu'il a signifié, ce qu'il signifie actuellement et ce qu'il signifiera à l'avenir..
faut rappeler que ce dernier est ici aussi envisagé d’une manière bien spécifique. Tout comme « Marx considère le « processus historique » comme la cause des « inversions » de la camera obscura, de la même manière que le « processus de vie physique » inverse les images sur la rétine » [MITCHELL 1986, 271], l’intérêt de l’étude menée est ici de ne jamais circuler au sein d’un système considérant une Histoire universelle mais bel et bien de croiser une méthodologie historique spécifique (se reporter à la section perspectives décentrées et études subalternes, p.21) et une approche iconologique tout autant spécifique dans le but d’imaginer une lecture d’images pertinente et particulièrement révélatrice des enjeux identifiés.
Le traitement graphique de cette guerre est d’autant plus intéressant que la montagne d’images dont fut inondée la Terre entière a non seulement documenté la guerre, mais a également influencé l’opinion publique et façonnée la perception du conflit à travers le monde. Par ailleurs, Ouriel Reshef [1984] met en avant le fait que la guerre paraît comme le moment où la représentation du monde est soudain remise en question, où sont abolies les normes régissant la vie quotidienne en temps de paix ; les modèles connus à partir desquels était appréhendée la réalité sont mis à l’épreuve du sens dans l’expérience.
Dans Images de la violence, violence de l’image, l’iconographie de la guerre à l’épreuve des conflits du xx siècle, Claire Aslangul discute, pour la peinture, d’une « cristallisation de certains motifs qui deviennent au fil du siècle des symboles, des « icônes », une « signalétique » de la violence de guerre, et, en définitive, de toutes les violences. » [2004, 362]. En ce sens, analyser des images produites en contexte de guerre permet de « cerner cet imaginaire –« collectif » au sens d’un univers symbolique partagé »[2004, 360]. Ici, contrairement à l’emploi en peinture de motifs de domination claire comme les barbelés, les tranchées, les bombes etc., l’objectif est de démontrer la réalité presque indéniable d’un impérialisme à travers un corpus photographique pas nécessairement tout le temps produit dans une représentation explicite de la guerre et qui, dès lors, ne paraît pas aussi évident.
Le corpus d’étude sera constitué de photographies d’archives, explorées pour la représentation de l’impérialisme américain et des stratégies d’appropriation territoriale. Contrairement à une
vision réductrice qui circonscrit le rôle de la photographie à une simple illustration des phénomènes observés, cette recherche considère les représentations iconographiques et territoriales comme un binôme fécond, indispensable à la compréhension des stratégies d’acteur·ices et de leurs inscriptions spatiales au sein d’une ville alors marquée par un impérialisme.

[fig.2 : Cette photographie aérienne en noir et blanc révèle un paysage urbain dense et organique, où l’agglomération s’est intimement développée le long d'une rivière. L’image documente une urbanisation sans planification rigide, où la géographie fluviale dicte la structure du bâti traditionnel.
Les maisons basses, souvent en matériaux légers ou maçonnés et disposées de façon irrégulière, longent les rives et les ruelles étroites, traduisant un mode d’urbanisation vernaculaire hérité de la ruralité environnante. Cette photographie est la preuve d’un langage urbain auto-construit, ancré dans un territoire et une certaine résilience environnementale, offrant un aperçu d’une identité urbaine profondément tissée. La présence de quelques bâtiments maçonnés met en évidence des écarts sociaux et économiques, tandis que les zones agricoles visibles à l’arrièreplan soulignent la porosité encore forte entre ville et campagne.
Cette vue aérienne de 1955, antérieure à l’escalade militaire américaine, montre un quartier périphérique de Sài Gòn structuré par une forte densité d’habitations. L’image illustre un moment de transition : à la veille des grands bouleversements de la guerre et de la présence américaine, Sài Gòn apparaît comme un espace hybride où se superposent héritages coloniaux, pratiques locales d’adaptation et premières pressions démographiques issues des migrations internes.]
Étudier le contexte vietnamien passe par une première étape primordiale : essayer d’approcher une compréhension relative d’une certaine conception spécifique de l’environnement, des relations au tout et, plus largement, d’un rapport au monde. En ce sens, ce propos ne prétend néanmoins en rien à une exhaustivité ou à une vérité quelconque. Simple compte-rendu de lectures (de personnes concerné·es ou non), de discussions et de synthèses personnelles, les biais de compréhension sont trop nombreux pour pouvoir ici affirmer que la totalité d’une façon de penser est ici saisie, au contraire. Au Việt Nam, les villes ont traditionnellement été fondées sur un système culturel bien précis, de la ville impériale à la cellule familiale en passant par la province et le district. Dans sa thèse soutenue en 2019, Marie Gibert-Flutre commence par aborder son étude des réseaux viaires par une approche purement linguistique afin de déceler certaines visions spécifiquement locales de l’espace urbain. À travers l’usage linguistique de certaines expressions comme diện tích đất công cộng (peut être traduit en « superficie (diện tích) des terres (đất) publiques (công cộng) ») afin de désigner l’espace public, on peut déjà en remarquer une projection bidimensionnelle. Cette expression couvre principalement les établissements scolaires ou les hôpitaux par exemple, les séparant des usages commerciaux (đất thương mại), résidentiels (đất căn cứ) ou des espaces verts (đất cây xanh). Cette même thèse se concentre ensuite sur l’expression không gian(le vide, la pièce) công cộng, qui désigne cette fois une autre approche des espaces publics par le biais de ses usages sociaux. Không gian, d’origine étymologique chinoise (kongjian), est apparue au Việt Nam durant la période coloniale du début du 20e siècle, calquée sur l’expression « espace public » des enseignements « indochinois » de l’architecture et de l’urbanisme [2019,44].
Il semblerait cependant que les documents administratifs, les presses etc. ne désignent les espaces publics qu’à travers leur
dénomination propre (parcs, places, espaces de circulation) sans réellement désigner un ensemble.
« Historiquement, il n’y a donc pas en vietnamien d’expression désignant l’ensemble des espaces publics et l’espace public n’est pas une catégorie de conception de la ville »
[GIBERT-FLUTRE 2019, 45]
Ensuite, il faut essayer de comprendre les relations traditionnelles des espaces avec ses habitant·es. Les notions culturelles du Âm Dương (Yin-Yang*), du Phong Thủy (feng shui*), le confucianisme, le bouddhisme, les croyances populaires etc. influencent à la fois les existences sociales mais également les différents rapports à l’espace. Introduit au début de la domination chinoise du territoire, le confucianisme par exemple n’a jamais vraiment perdu son influence. Florissant en même temps que la culture Việt-Mường (un des quatre groupes ethniques parmi les Kinh, Thổ et Chứt) entre l’an 1 et 230, cette dernière a su au début résister à cette influence en conservantune volonté d’indépendance. C’est donc à partir du 11e siècle à peu près que les systèmes féodaux vietnamiens commencent à réellement apprécier le confucianisme.
« To build and complete the State institutions, the feudal class found sharpened weapons from Confucianism, which could not be provided by the contemporary Buddhism and Taoism: the mystique could create royalty ; the sacredness could create the king and subject relationship ; the norms and content of the government official training could help to extend to power of the King »8 [LY 2015, 72]
Réservé à l’élite impériale, le confucianisme devient par la suite la religion principale des dynasties Nguyễn (18021945). Le système social centralisé a alors développé, jusqu’au
8[Traduction] Pour construire et compléter les institutions de l’État, la classe féodale a trouvé dans le confucianisme des armes affûtées que le bouddhisme et le taoïsme contemporains ne pouvaient pas lui fournir : la dimension mystique pouvait créer la royauté ; le caractère sacré pouvait créer la relation entre le roi et le sujet ; les normes et le contenu de la formation des agents de l’État pouvaient contribuer à étendre le pouvoir du roi.
colonialisme français (à partir de 1862), les principes confucéens des « quatre liens moraux » et des « cinq vertus constantes » afin de maintenir continuellement une hiérarchie roi-sujet et renforcer le pouvoir constant de la lignée royale. Utile à l’édification de la nation et primordial pour le contrôle des populations, le confucianisme s’est néanmoins infiltré dans la culture spirituelle vietnamienne à travers une certaine bourgeoisie, créant une forme sinovietnamienne des principes confucéens. Les acteur·ices culturel·les vietnamien·nes étaient divisé·es en deux groupes, l’un composé d’érudit·es confucéen·nes, d’aristocrates et de fonctionnaires suivant le modèle confucéen, et l’autre composé de classes inhérentes telles que les agriculteur·ices, les artisans et les hommes et femmes d’affaires [LY 2015, 73]. Le confucianisme a essentiellement eu un impact très important sur l’organisation des ménages, s’hybridant avec la culture Han* (dynastie chinoise), formant au passage un régime fortement patriarcal. Même si l’influence du confucianisme comme savoir prédominant a décliné à l’arrivée des Français·es, les « quatre vertus » et les « cinq constantes » ont continué à particulièrement marquer la structure familiale et les valeurs sociales au Việt Nam, en plaçant la famille au centre. Ces dernières sont pour les quatre vertus, la piété filiale, la loyauté, la contingence, et la droiture et, pour les cinq constantes, la bienveillance, la justice, le respect des rites, la sagesse et l’intégrité. Les liens familiaux ont alors une place prédominante et ses enseignements ont eu une influence durable sur la société vietnamienne, tant au niveau familial qu’au niveau communautaire. Ces philosophies sociales ont indéniablement marqué les organisations spatiales des lieux de vie. Comme l’avancent Thanh Son Lê et Điem Thánh Trần, les vietnamien·nes « ont intelligemment métaphorisé des messages spirituels et des notions culturelles dans la forme de l’architecture traditionnelle » [2023]. En ce sens, que ce soit des notions comme le Âm Dương ou une philosophie sociale comme le confucianisme, ces catalyseurs d’expressions symboliques imprègnent les constructions vietnamiennes traditionnelles et
les rapports du corps à l’espace. Un des principes fondamentaux par exemple est que tous les objets et événements sont une combinaison et une transformation mutuelle entre deux côtés opposés selon le principe que dans « Âm » (Yin*) il y a « Dương » (Yang*), dans Yang* il y a Yin* ; Yin* génère Yang* et Yang* génère Yin*.
« Yin-Yang philosophy plays an important role in the worldview of ancient Vietnamese and has influenced their way of spatial organization in traditional architecture. It is expressed by a strong contrast in spatial combination and through opposite characteristics : solid - hollow, high - low, light - shadow.... These contrasting forms aim at a special effect, the harmony in both space and form structure. The solid-hollow contrast can be seen most clearly between a roof that is large and seemingly soar overhead and a system of solid, low wooden columns below. What connects a dark brown roof with four curved corners and a brick courtyard in the ground is a profound ‘‘ void ’’ of the space behind the columns. All of these leads to a distinctive contrast from a visual art perspective. A very large size of the roof opposed to the entire construction creates a solid, discreet and graceful form »9
[SON LÊ et THÁNH TRẦN 2023, 6]
Pour résumer, les vietnamien·nes semble avoir traditionnellement et historiquement négocier un certain équilibre entre les formes bâties et la nature dans l’objectif de véhiculer des idées, des valeurs, des principes culturels ou encore des philosophies religieuses. L’architecture devient alors un système sémantique entier, évoqué par des structures tangibles [2023]. La question de la tradition reste néanmoins à étudier avec un certain recul. Si l’on qualifie le confucianisme de valeur traditionnelle, les études citées précédemment explicitent
9[Traduction] La philosophie Yin-Yang joue un rôle important dans la vision du monde des ancien·nes Vietnamien·nes et a influencé leur mode d’organisation spatiale dans l’architecture traditionnelle. Elle s’exprime par un fort contraste dans la combinaison spatiale et par des caractéristiques opposées : solide - creux, haut - bas, lumière - ombre.... Ces formes contrastées visent un effet particulier, l’harmonie à la fois de l’espace et de la structure de la forme. Le contraste entre le solide et le creux est particulièrement évident entre un toit de grande taille qui semble s’élever et un système de colonnes basses en bois solides en dessous. Ce qui relie un toit brun foncé aux quatre coins incurvés et une cour en briques au sol, c’est le profond « vide » de l’espace derrière les colonnes. Tous ces éléments créent un contraste distinctif du point de vue de la perspective visuelle. La très grande taille du toit par rapport à l’ensemble de la construction crée une forme solide, discrète et gracieuse.
clairement l’importation de ladite philosophie sociale au cœur des dynamiques historiques de domination chinoise. Il est donc aisé d’affirmer que l’architecture de chaque pays possède ses propres caractéristiques en matière d’expression culturelle, plus ou moins transmises et parfois soumises à une multiplicité d’influences extérieures. Étudier le contexte vietnamien et plus particulièrement Sài Gòn signifie alors d’une part comprendre un contexte historique local et par ailleurs, faire face à un territoire et une histoire particulièrement marqués par les différentes guerres et ses nombreuses dynamiques d’acculturation.
fig. 3 : auteur·ice inconnu·e, sài gòn : une rue du quartier indigène , ancien fonds du musée des colonies, cedrasemi collection, 1860
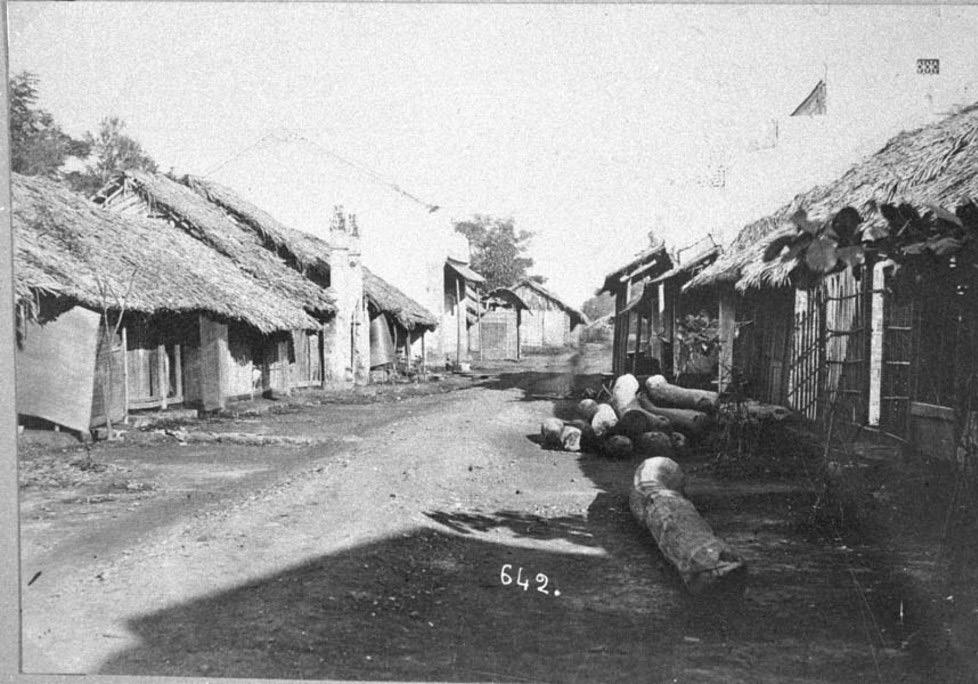
Connue sous le nom de Thành phố Hồ Chí Minh depuis le 2 juillet 1976 mais toujours couramment nommée Sài Gòn, l’approche du territoire sur lequel repose actuellement cette ville au sud du pays est particulièrement liée à la multiplicité de ses annexions successives au sud du delta du Fleuve Rouge. Même si des traces archéologiques pré-chrétiennes de présences humaines ont été retrouvées et datées, les premières émergences d’une réalité pré-urbaine vietnamienne ont été plus ou moins accordées en 1698 avec l’apparition progressive de Gia Định, devenue Sài Gòn (pour résumer brièvement) puis Thành phố Hồ Chí Minh. Sa construction est évidemment très marquée et impulsée par ses refondations coloniales entre 1869 et 1954 mais aussi par la présence antérieure de populations chinoises. Dès le départ, ses existences bâties sont définitivement marquées par des formes d’hybridation, de zones de contact et d’entremêlements importants. Plusieurs chercheur·euses s’accordent encore à ce jour pour affirmer la relative absence de travaux historiques sur la genèse et l’évolution de la ville jusqu’à aujourd’hui. En 2015, Cẩm Dương Ly Nguyễn énonce :
« Jusqu’à présent, la recherche concernant les transformations typomorphologiques urbaines de Hồ Chí Minh-Ville, et particulièrement celles de son espace central, n’est que très peu traitée et donne l’impression que cet espace a peu d’intérêt. Pédelahore de Loddis (1993) mène un inventaire général et sommaire sur les conditions des villas coloniales à Hồ Chí Minh-Ville sous forme d’une description de villas existantes avec des photos illustrées et des informations sur les hauteurs, l’utilisation des bâtiments, les types de propriété. Lê et Dovert (1998) font un bilan exceptionnel des phases de fondation et de développement de Sài Gòn. Ce livre devient une des meilleures références sur l’évolution urbaine et architecturale de Hồ Chí MinhVille. Cependant, il reste à discuter et à développer les mécanismes et les enjeux des transformations urbaines » [NGUYỄN 2015, 18]

En réalité, on peut observer une certaine quantité de sources, notamment cartographique, juridique et photographique, datant de la période coloniale française, imposant de fait un déséquilibre certain au service d’une place prépondérante offerte à cette même période. L’analyse des tracés viaires de la ville par Marie Gibert-Flutre en 2019 et le travail de Cẩm Dương Ly Nguyễn en 2015 permettent de retracer assez largement l’évolution de cette ville à travers des considérations urbaines, démographiques mais aussi intrinsèquement politiques.
Au 10e siècle, la recherche d’une construction territoriale entraîne en premier lieu une « marche vers le Sud » (nam tiến) à partir du delta du Fleuve Rouge puis jusqu’à l’arrière-pays montagneux de l’ouest. De ces mouvements découle alors une assimilation progressive des populations déjà présentes, celles du Champa* par exemple, contrôlant jusqu’alors les différentes routes maritimes côtières du 11e au 15e siècle. Le Royaume de Champa*, originellement construit aux contacts culturels entre l’Inde et la Chine, est totalement conquis au 17e siècle, suivi du delta du Mékong alors sous le joug du royaume khmer. Jusqu’au 16e et 17e siècle, les villes mentionnées sont Prei Nokor* et Kas Krobei*, correspondant respectivement aux emplacements actuels du centre historique de Sài Gòn et de Chợ Lớn. Au cours de ces différents processus, un objectif récurent de revalorisation systématique de terre à potentiel rizicole semble clair.
« [Ces entités] n’étaient probablement que de petites villes, construites en matériaux légers, avec une petite population khmère, situées sur la route de trafic et d’échanges de produits par voie maritime et terrestre des peuples du sud du pays, un endroit favorable pour les activités économiques et le contrôle politique »
[SĨ KHẢI 1987, 94]
Étant donné la position stratégique des terres et de la ville au
sein de l’ancien carrefour commerçant khmer Prei Nokor*, la mise en valeur territoriale de ces terres promet une activité commerciale prometteuse au contact des navires hollandais, malais, portugais et chinois. La position stratégique de ce plateau semble avoir perdurer tout le long de l’Histoire de la ville avec la construction de la citadelle vietnamienne au même endroit au 18e et 19e siècle puis avec le choix du centre-ville colonial français, encore aujourd’hui un épicentre important des activités économiques et politiques de la ville. A l’arrivée des populations vietnamiennes à la fin du 16e siècle, une importante lutte de pouvoir a lieu entre deux familles seigneuriales vietnamiennes à savoir, les Trịnh et les Nguyễn qui perdura entre 1620 et 1788. Le territoire vietnamien est alors divisé en deux fiefs distincts séparés par le fleuve Gianh* au nord de l’actuelle province de Quảng Bình. Le royaume du Sud fut alors grandement épaulé par les populations chinoises alors établies depuis le 17e siècle. A ce même moment, le roi cambodgien Prey Chey* accorde au « gouvernement » deux entités stratégiques, un au centre du berceau originel de la ville de Sài Gòn et l’autre au sein d’un village existant à population majoritairement chinoise, alors futur site de Chợ Lớn
[BOUCHOT, 1927, 88]. En effet, vers 1623, le roi du Cambodge accepta la requête vietnamienne concernant l’installation à Prei Nokor et Kas Krobei de postes fiscaux et commerciaux en échange de perceptions d’impôts et de taxes commerciales. Cette première présence vietnamienne administrative démontre déjà le commencement d’une extension urbaine de Sài Gòn
[VIỆN SỬ HỌC 2020, 397]. Il est aussi important de préciser que ces ajustements territoriaux s’accompagnent de politiques de migrations forcées de certaines populations (vagabonds etc.)
[BRIFFAUT 1912, 60-66]. En 1693 est informellement instaurée la fondation de la préfecture de Gia Định [NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU, 2006] par le gouverneur des nouvelles terres. Le commandant Nguyễn Hữu Cảnh est en effet envoyé dans le sud du pays par le seigneur vietnamien Nguyễn afin d’inspecter, de prendre contrôle des terres alors administratives et d’établir la souveraineté sur ce nouveau territoire.
« L’armée disposait d’escouades, d’équipes, de bateaux, de troupes d’élite navales et terrestres et de soldats subordonnés pour la garde. Le territoire s’étendit sur des milliers de kilomètres, et des migrants de Bố Chánh et de l’intérieur furent recrutés pour vivre partout, établirent des quartiers, des hameaux, des communes et des villages, divisèrent le territoire, chacun divisa la terre, uniformisa l’impôt de capitation et établit un recensement des impôts de capitation » [TRỊNH HOÀI ĐỨC vers 1820]
La stratégie est claire, recruter les gens qui s’étaient dispersés vers le sud puis établir des communes, des quartiers, des hameaux, déterminer des quotas fiscaux et commencer un recensement administratif. Évènementfondateur de l’appareil gouvernemental de Sài Gòn, la ville devient à ce moment un centre géographique administratif, résidentiel et commercial particulièrement propice à la gouvernance. A cette époque, la région comptait environ 20 000 habitant·es, soit peut-être un tiers de la population vietnamienne [TRẦN VĂN GIÀU 1987]. On ne peut pas encore réellement parler de ville à part entière mais plutôt d’une circonscription militaire et administrative (phủ, signifiant « siège de la préfecture »). Pendant la période de fondation de cette entité pré-urbaine a lieu l’érection d’une forteresse en terre vers 1753, au-dessus de l’actuel marché de Điều Khiển. En permettant au site de devenir à la fois une ville et une forteresse militaire, ces premières fortifications donnent déjà l’orientation de la future citadelle vietnamienne détruite par les français en 1858. Un peu plus tard, vers les années 1790, le missionnairefrançais Pierre Joseph Pigneau de Behaine, l’officier du Génie Olivier de Puymanel et Théodore Lebrun amènent les populations autochtones au contact de l’art des places fortes avec la construction de la citadelle Bát Quái en 1790, empruntant et imposant clairement des conceptions militaires et géomantiques chinoises mais aussi en citant les forteresses Vauban [NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU, 2006]. Si les précédentes forteresses ont guidé l’orientation de la citadelle, cette dernière guidera elle le tracé des rues du futur centre-ville colonial. La rue Catinat par exemple (future rue Đồng Khởi),
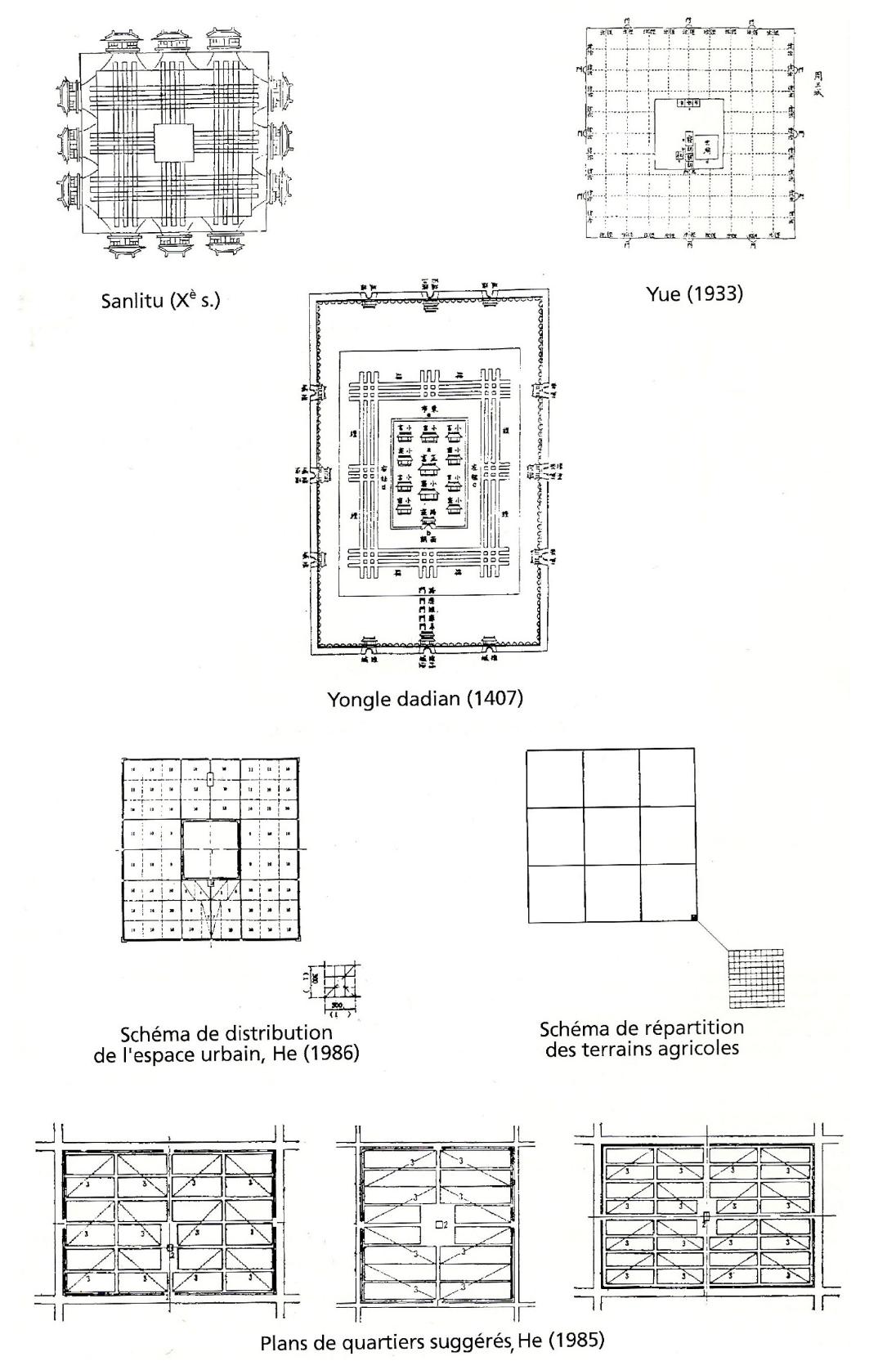
fig 4 : [ modèles de trames de capitales royales chinoises ], [CLEMENT, 1995]
semble déjà apparaître en 1795. D’après Charles Lemire, la rue Lagrandière (actuelle rue Lý Tự Trọng) aurait aussi été dessinée sur l’emplacement des anciens fossés de la citadelle. Ces différentes effervescences sont évidemment intriquées à des réalités démographiques. La circonscription de Gia Định aurait apparemment assez rapidement compté 40 000 foyers répartis dans une quarantaine de villages aux environs de la citadelle
[NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU, 1998]. En réalité, la périphérie de la citadelle est principalement composée de camps, de forts militaires et d’ateliers artisanaux, laissant apercevoir l’organisation typomorphologique d’une cité interdite et de marges commerçantes, rappelant la composition des capitales chinoises. La citadelle est détruite en 1836, ses fondations servent alors à en édifier une nouvelle au même emplacement, mais plus petite. Tout en conservant certaines structures urbaines, la ville est donc marquée par une forte discontinuité avant même la période de colonisation française : carrefour commerçant au 17e siècle, centre militaire politique et administratif dès 1698, capitale impériale en 1790 puis ville commerciale à partir de 1802. Cette date marque aussi l’annexion de cinq autres provinces
Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (aujourd’hui Mỹ Tho), Vĩnh Thanh et Hà Tiên et les fondations de grands marchés avec l’aide de la population chinoise installée sur place depuis la fin du XVIIe siècle [BRIFFAUT 1912, 135]. En 1819, la ville compte environ 60 000 habitant·es sur un total national de 180 000. Dans son journal publié à titre posthume, le naturaliste écossais George Finlayson (1790-1823) envoyé par le gouverneur général des Indes britannique Lord Hastings pour une mission commerciale écrit le 29 août 1822 :
« En approchant de la ville, nous fûmes surpris de la trouver si étendue. Elle est construite principalement sur la rive droite du fleuve. Nous avions déjà parcouru plusieurs kilomètres et nous étions encore en plein cœur de la ville. Les maisons sont vastes, très larges et, compte tenu du climat, très confortables. Les toits sont couverts de tuiles et soutenus par de beaux piliers en bois noir, lourd et résistant, appelé sao . Les murs sont en terre, encadrés de bambou et plâtrés.
Le sol est en planches et surélevé de plusieurs pieds. Les maisons sont proches les unes des autres, disposées en lignes droites, le long de rues spacieuses et aérées, ou le long des berges des canaux. Le plan des rues est supérieur à celui de nombreuses capitales européennes » [FINLAYSON 1826, 43].
En 1832, à la suite du décès du gouverneur Lê Van Duyêt, le roi Minh Mạng*, insatisfait, démit ce dernier de ses fonctions et divisa le sud du Việt Nam en six provinces. En réaction, dans la nuit du 5 juillet 1833, Lê Văn Khôi et ses hommes s’emparèrent de la citadelle de Gia Định, tuant le gouverneur Nguyễn Văn Quế. Se proclamant Grand Maréchal, Khôi et ses troupes prirent le contrôle des six provinces du Nam Kỳ (sud du Việt Nam). Le roi Minh Mạng dépêcha alors une armée pour contrer la rébellion. Lê Văn Khôi sollicitera l’aide du Siam, mourut de maladie et la citadelle finit par tomber le 8 septembre 1835 sous l’assaut de l’armée royale, marquant la fin du soulèvement.
La conquête du territoire par la France dès 1958 met ensuite clairement en avant une volonté première d’ouverture stratégique vers la Chine. La forme française définitive du territoire en 1900 se compose alors d’une colonie au Sud (Cochinchine ou Nam Bộ) et de deux protectorats (Annam ou Trung Bộ pour le centre et Tonkin ou Bắc Bộ au Nord).
On peut également nommer les protectorats du Cambodge et du Laos mais en réalité, peu de distinctions étaient faites entre colonie et protectorat. Les empereurs restants n’étaient que des monarques nominaux [CESARI, 2021].
La présence d’une population française sur place est par ailleurs très faible. Celle-ci ne se soulignait qu’à travers des fonctionnaires, des militaires et des hommes et femmes d’affaire. La France s’appuie alors localement, pour la gestion administrative, sur des chefs de village devenus subalternes aux yeux du gouvernement français. Certain·es se voient même offrir la nationalité française [CESARI, 2021]. On souligne dès lors que la plupart des récits coloniaux des conquérants et voyageur·ses français·es à leur arrivée décrivent presque toujours
fig. 5 : fonds cartographique de l’IPRAUS 1897, 1942, 1964 ; image google earth 2009, 2025
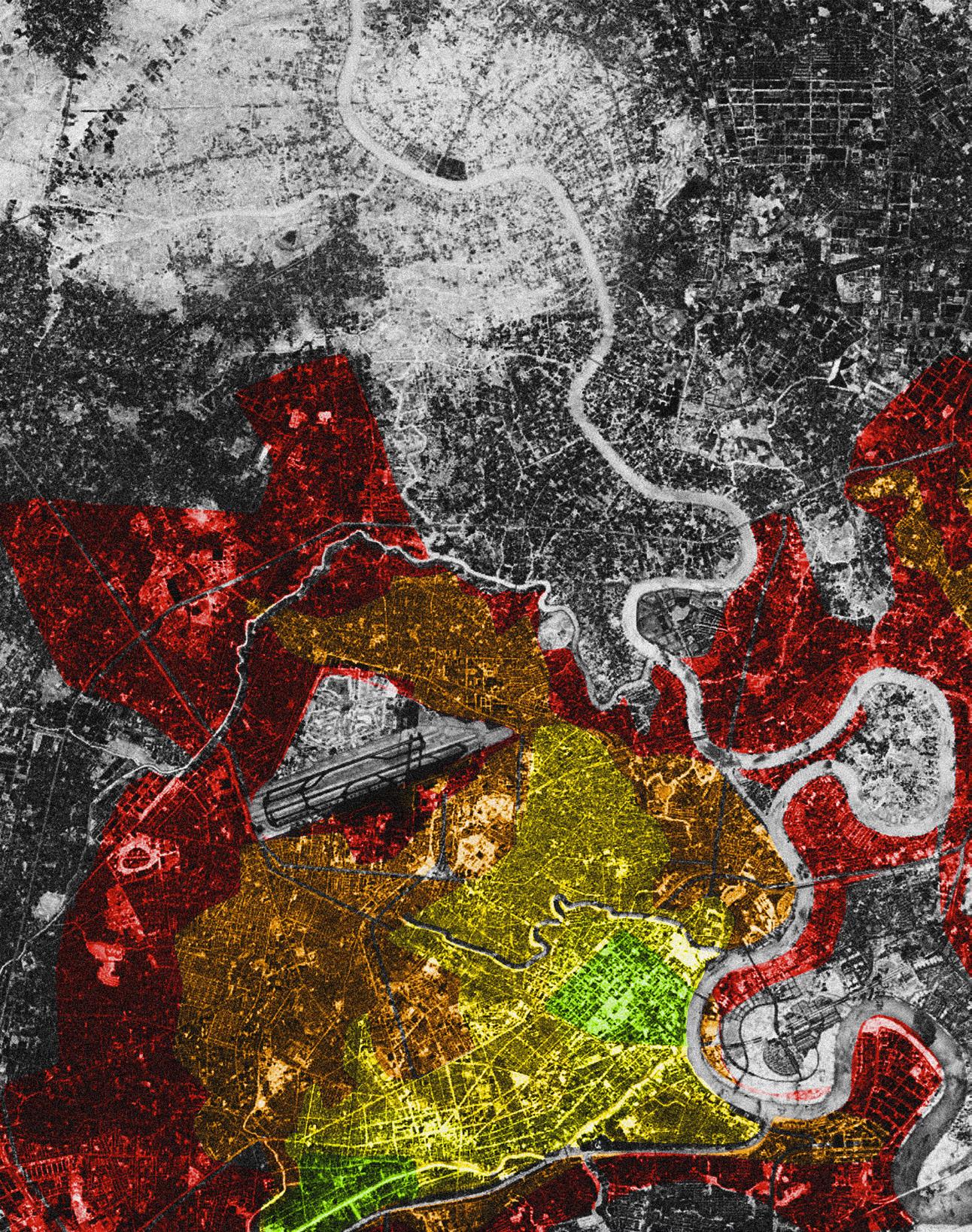
Sài Gòn comme étant un territoire déserté et marécageux, ou encore un « campement provisoire » d’après Edouard du Hailly.
« Sài Gòn […] n’est pas une ville dans l’acceptation européenne du terme. Ce n’était plus une place forte […]. De ses chantiers, où se trouvaient en 1819, avant la guerre des rebelles, deux frégates à l’européenne et 190 galères ; de son vaste palais impérial, de son arsenal maritime, il ne restait rien »
[PALLU DE LA BARRIERE 1862, 46]
L’Annuaire de la Cochinchine française en 1865 décrit :
« Au début de notre occupation, la partie basse de l’emplacement actuel de la ville de Sài Gòn n’était guère qu’une plaine marécageuse couverte par les eaux à chaque grande marée. Les mandarins civils et militaires et les gens riches habitaient le Plateau, qui s’étend à partir de la citadelle vers la plaine des tombeaux, tandis que la classe qui demande sa vie au travail de chaque jour était parquée, comme on le voit encore, sur la rive droite de l’arroyo chinois, dans des paillotes à demi-suspendues le long des rives du fleuve. Quelques chemins étroits, mais exhaussées au-dessus du niveau de la mer, reliaient la ville industrieuse avec les quartiers aristocratiques »
[BOUCHOT 1927]
1960
1964
1969
1970
1971
1974
2 300 000
2 400 000
3 150 000
3 300 000
3 500 000
4 000 000
évolution du nombre d’habitant·es à Sài Gòn
Les différentes réalités passées nous permettent déjà d’affirmer soit que les récits d’aménagements urbains coloniaux sur des sites vierges semblent volontairement ou non erronés ou exagérés, soit tout simplement que le biais occidental a rapidement appliqué une vision européenne de la ville sur des
constructions territoriales culturellement et historiquement complètement différentes. A partir d’ici, la trame viaire a été la première chose planifiée par l’entité coloniale française. Autrement dit, la monumentalité du bâti n’a pas été une influence particulière sur la construction du réseau viaire, les bâtiments comme les cathédrales, les hôpitaux etc. s’étant intégrés au fur et à mesure par pur pragmatisme progressif en fonction des différents besoins [GIBERT-FLUTRE 2019]. Dès lors, Sài Gòn commence à se transformer selon des lectures urbaines d’amiraux et de gouverneurs français, soutenus par quelques premiers promoteurs privés. Les dynamiques de Chợ Lớn en tant que ville chinoise et carrefour d’échanges de produits agricoles amènent une activité importante pour les deux villes. On peut par exemple citer la proposition d’un premier plan d’aménagement par le colonel Coffyn, approuvé en 1862 mais jamais réalisé au regard des ressources économiques non disponibles [LY NGUYỄN 2011]. L’arrivée de l’amiral de La Grandière en 1863 provoque l’élimination des dernières résistances militaire avec la mise en place simultanée d’une administration urbaine coloniale. (budget, travaux publics etc.). En plus de nombreux travaux d’assainissement de la ville basse, les années entre 1878 et 1916 montrent une extension urbaine vers le noyau de Chợ Lớn. On estime alors 7000 à 8000 habitant·es au centre de Sài Gòn et 10000 à Chợ Lớn. En 1883, la population de Sài Gòn – Chợ Lớn a atteint les 100 000 habitant·es [NGUYỄN KHAC 1974, 288]. En 1909, la population de Sài Gòn compte 53 000 habitant·es et celle de Chợ Lớn 180 000. En 1911, Sài Gòn est animé par 8500 européen·nes permanent·es, 17000 chinois·es e 41 500 vietnamien·nes. Chợ Lớn, de son côté, se compose de 300 européen·nes, 96500 vietnamien·nes et 85000 chinois·es. Les populations vietnamiennes étaient de fait majoritairement établies hors des limites de la ville planifiés, sous la forme de noyaux villageois. De fait, l’urbanisme de la région est jusqu'ici divisé en deux développements assez distincts. D’un côté, la zone de Sài Gòn suit une planification française et quadrillée tandis que Chợ Lớn évolue selon une logique autonome,

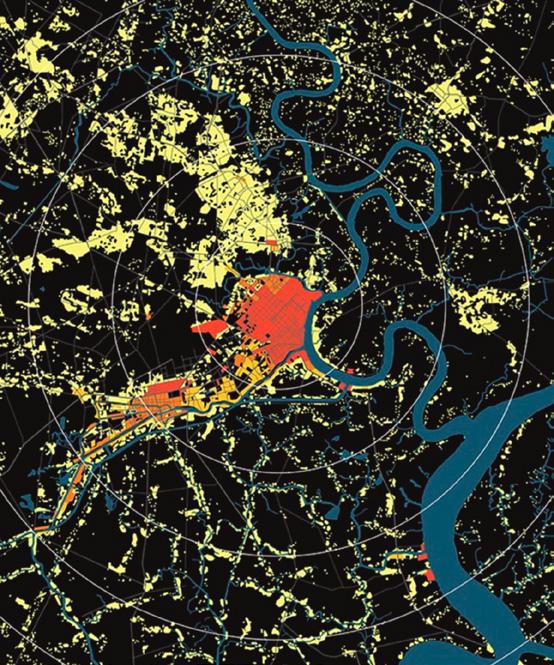
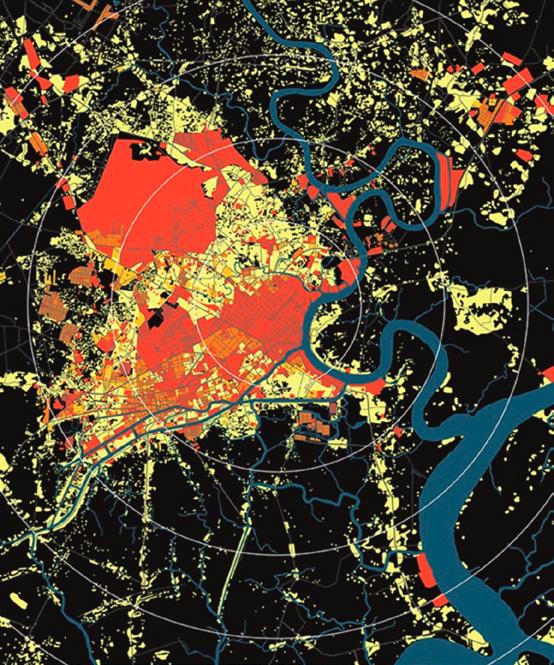
morphologie de bâtiments :
auto-construits
mélanges auto-construits mélanges planifiés planifiés
auto-construits : non planifiées et/ou non identifiables comportant des bâtiments auto-construits et des réseaux d’accès informels
mélanges auto-construits : bâtiments auto-construits dans un réseau d’accès mixte ou bâtiments mixtes dans un réseau d’accès informel et mixte
planifiés : zones résidentielles, commerciales et industrielles et espaces verts planifiés/conçus de manière formelle
mélanges planifiés : bâtiments auto-construits et mixtes dans des réseaux d’accès formels
fig. 6 : [ distribution spatiale des morphologies auto-construit/planifié à Sài Gòn ], [THINH, 2024]
continuant à s’étendre en tant que ville commerçante historique [THINH, 2024, 7]. À partir de 1921, du congrès colonial de Marseille et de l’acceptation d’un « urbanisme colonial », le Service central d’architecture et d’urbanisme en Indochine française est créé sous la direction d’Ernest Hébrard, très critique de l’aménagement en damier impulsé par le colonel Coffyn. Le développement urbain d’Hébrard veut fonctionner par zonages, avec une redistribution des infrastructures de transport. Néanmoins, aucun de ses plans d’aménagement ni même de son successeur Louis George Pineau ne seront réalisées. Le pragmatisme continuera a exercé son pouvoir avec une densification importante du bâti jusqu’en 1930, soutenue par des programmes d’équipements publics (dispensaires, marchés) et l’arrivée de sociétés immobilières.
On compte 341 000 habitant·es à Sài Gòn – Chợ Lớn en 1926 puis environ 1 000 000 en 1947 [QUÁCH-LANGLET THANH 1991, 185-206].
À partir de 1931, lorsque Sài Gòn et Chợ Lớn fusionnent pour ne former qu’une seule entité urbaine, la multiplication d’habitats auto-construits est observable, s’étalant principalement vers le nord-ouest. Le départ de l’armée française et l’accord de Genève signent ensuitel’arrivée des américains sur le territoire sud-vietnamien : la République du Việt Nam. C’est aussi pendant ce début de 20e siècle que l’on peut observer l’assainissement des arroyos, petits cours d’eau intermittents. Les périodes de conflits entre 1939 et 1975 sont assez mal renseignées dans les archives alors même que la population urbaine explose, transformant de manière radicale les réalités urbaines et les différentes modalités d’expansion. Ces périodes sont généralement façonnées par une absence de planification urbaine et des expansions très rapides d’une urbanisation absolument spontanée dépassant les trames viaires pré existantes. D’après certaines estimations en 1991, la population urbaine de Sài Gòn passe de 460 000 en 1946 à 1 700 000 en 1954 puis plus de 4 000 000 en 1975 [QUÁCHLANGLET THANH 1991, 185-206]. L’occupation japonaise entraina aussi des migrations vers Sài Gòn. Entre 1946 et 1951, on
observe une perte de 20% de la population rurale [PAIREAUDAU et TAINTURIER 1998, 198-233]. Après la scission du pays en deux en 1954, on estime également 800 000 migrations du Nord du pays vers Sài Gòn, s’intallant principalement au sein de quartiers auto-construits.
L’après-accords de Genève de 1954 marqua un bouleversement démographique majeur au Sud-Việt Nam, particulièrement à Sài Gòn où la population connut une explosion spectaculaire. Passant de 256 000 habitant·es en 1936 à plus de 2 millions en 1956, la ville vit sa population multipliée par près de dix en deux décennies. Cette croissance fulgurante engendra un chaos urbain caractérisé par une grave pénurie de logements, un chômage massif en milieu urbain, une dégradation environnementale sévère et une stagnation économique due à des infrastructures industrielles héritées de l’époque coloniale française et totalement inadaptées. La migration massive des campagnes vers la capitale, motivée par la recherche d’emploi et de subsistance, désertifia les zones rurales et submergea Sài Gòn. Cette dynamique précipita une négligence des conditions de vie, entraînant l’émergence de vastes installations spontanées – des « nhà lá » (maisons de fortune en chaume et bois) et des habitations sur pilotis ou bateaux – érigés sans planification, souvent de manière « chaotique », et héritant de pratiques rurales inadaptées au milieu urbain. Ces quartiers précaires, dépourvus d’eau courante et d’électricité, présentaient des conditions sanitaires déplorables et un risque incendie constant, tout en continuant d’attirer un flux ininterrompu de nouveaux arrivants. Entre 1954 et 1975, les interventions planifiées au nord du pays par la République démocratique du Việt Nam sont elles soutenues par le bloc de l’Est puis interrompues sous menace de bombardements de la part des États-Unis d’Amérique. Les architectes sont limité·es par différents facteurs : la pénurie d’investissements, de matériaux de construction et de directives de conception communes appliquées à tous les projets financés par l’État. Au sein de la République du Việt Nam, les
conditions sont plus favorables. On y observe une urbanisation soutenue par les États-Unis d’Amérique. Le capitalisme appliquait un riche marché de commandes, de client·es, de matériaux etc. Ces fonds alloués par le gouvernement américain constituent une source de financement majeure pour l’essor immobilier et le développement urbain de la capitale du Sud [LY NGUYỄN 2011].
Parallèlement, les vagues de migrations s’intensifient particulièrement à partir de 1963 et l’échec du programme des hameaux stratégiques. Mis en place à Washington et proposé au gouvernement sud-vietnamien (particulièrement soutenu par les États-Unis d’Amérique), ce programme avait pour ambition de regrouper les populations rurales au sein de villages protégés avec comme objectif à la fois de créer des entités rurales autonomes mais aussi d’endiguer la progression du Front National de Libération du Sud-Việt Nam, résistance majoritairement communiste chargée de faire front face au gouvernement du Sud-Việt Nam dirigé par Ngô Đình Diệm sous impérialisme américain.
Face à l’explosion démographique de Sài Gòn après 1954, le gouvernement de la Première République du Việt Nam lança un plan de réhabilitation urbaine et de reconstruction rurale (1954-1963). Ce programme visait à désengorger la capitale par la répartition de la main-d’œuvre et l’équipement du pays. Il se traduisit par la création de nouvelles villes et provinces (comme Bảo Lộc, Phước Vĩnh), la construction d’infrastructures et de logements, et l’expansion de Sài Gòn le long de l’axe est-ouest.
Le projet phare de ce plan fut la Conurbation de Sài Gòn - Chợ Lớn, conçue par l’architecte lauréat du Grand Prix de Rome, Ngô Viết Thụ [LY NGUYỄN 2011].
Ce design résolument moderniste proposait un nouveau centre structuré en grille entre Sài Gòn et Chợ Lớn, intégrant zones administratives, immeubles de grande hauteur et parcs, le tout relié par des boulevards. Ce projet était remarquable pour son ambition de modifier une capitale existante, se distinguant de Brasilia (nouvelle capitale planifiée) ou du Plan Voisin de Le Corbusier (qui visait des centres historiques), en se concentrant
sur l’expansion et la création d’un nouveau cœur urbain sans détruire les quartiers anciens. Malgré cet ambitieux plan, l’instabilité politique du Sud-Việt Nam empêcha sa réalisation.
[fig. 7 : Le premier documentest un plan de situation de la conurbation de Sai Gon* et Cho Lon*. Elle délimite les zones urbaines existantes et les extensions prévues, telles que des « zones résidentielles » et des « zones industrielles ». Cette vue d’ensemble montre une vision macro de l’espace, où la ville est découpée en secteurs fonctionnels, une approche typique de l’urbanisme moderniste. Le second plan se concentre lui sur le futur centre administratif de la ville. On y observe une organisation spatiale extrêmement rigide et ordonnée. Les bâtiments sont représentés par des blocs rectilignes, alignés le long de larges avenues, formant un contraste saisissant avec la densité urbaine organique et les rues sinueuses du centre historique.
La légende du plan est particulièrement révélatrice. Elle mentionne l’objectif de « limiter les dépenses pour l’aménagement » et de « faciliter le remembrement » et la « plus-value des terrains ». Ces termes renvoient à une logique de développement immobilier et de spéculation foncière, en plus de la simple organisation spatiale. La création de ce centre administratif est donc envisagé comme un pouvoir économique et politique, visant à remodeler la ville pour répondre aux besoins d’une nouvelle élite et d’une administration centralisée.]
Par ailleurs, le plan de réhabilitation impulsa une industrialisation locale (ciment, acier, briques, préfabriqués), fournissant de nouveaux matériaux et transformant l’architecture près d’un modernisme que l’on connaît historiographiquement. Les installations spontanées furent progressivement remplacés par des logements permanents en béton et maçonnerie, y compris dans les quartiers non planifiés qui se développèrent alors spontanément, donnant naissance aux « hẻm » (ruelles sinueuses) emblématiques. Cette période fut marquée par un « nouveau vent de pratique de construction » d’une intensité inédite, où infrastructures et habitations s’édifiaient simultanément. Les investissements au sud du pays se traduisaient en fait principalement par la construction d’infrastructures militaires et par l’expansion urbaine accélérée, résultant d’un phénomène
fig. 7 : [ projet de conurbation de Sài Gòn-Chợ Lớn par l’architecte Ngô Viết Thụ ], 1959
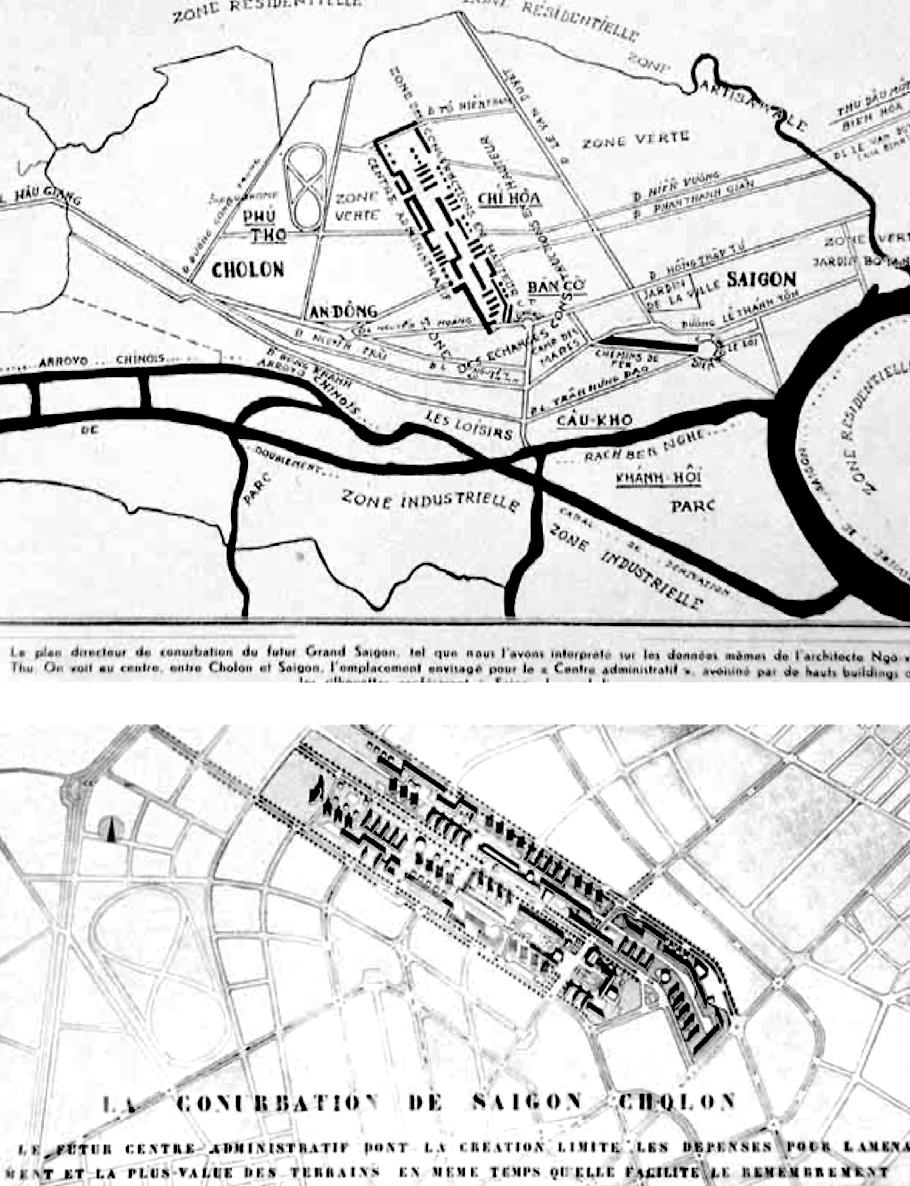
d’urbanisation contrainte par le conflit. Le 4 mai 1957, le Décret 112-a/KT exige des plans d’aménagement pour la ville de Sài Gòn. À l’instar d’autres métropoles asiatiques de la même période, Sài Gòn est le théâtre de plusieurs initiatives de planification urbaine, dont la mise en œuvre reste cependant fragmentaire ou incomplète [LY NGUYỄN 2011].
L’élaboration de ces projets repose en grande partie sur des architectes vietnamien·nes formé·es selon les principes des écoles d’architecture occidentales — principalement française et américaine — ainsi que sur des architectes étranger·es, souvent américain·es, mobilisant des expertises internationales en matière d’urbanisme. Dès lors, plusieurs plans directeurs sont étudiés dont le plan Ngô Viết Thụ, le plan Doxiadis ou encore le plan WBE. Aucun plan directeur n’a néanmoins été pleinement mis en œuvre en raison de la guerre [LY NGUYỄN 2011].
Parallélement, à partir des années 1970, les vagues de migration entraînent une urbanisation s’exprimant de plus en plus au cœur des îlots, à distance des axes routiers majeurs, l’objectif étant tout simplement de remplir les espaces vacants. Par extension, plus l’on s’engouffre au cœur de ces îlots, plus les méthodes de constructions apparaissent comme précaires. En 1975, à la fin du conflit, ce que l’expression populaire appelle « trous à rats » (khu ổ chuột) recouvrent plus d’un tiers de la superficie totale de la ville de Sài Gòn. C’est dans ces configurations là que se sont alors développés des réseaux de ruelles ramifiées et non bitumées [GIBERT-FLUTRE 2019]. Une articulation particulière s’est alors créée entre la ville régulière structurée et les entremêlements spontanés, développant la zone urbaine sous deux modalités : « par extension des zones bâties dans les faubourgs [...] et par densification, à la fois des îlots planifiés datant de la période précédente et dans les nouveaux îlots, beaucoup plus vastes et produits de manière informelle dans les faubourgs » [GIBERT-FLUTRE 2019, 164]. Entre 1965 et 1974, on suggère que les importantes migrations des zones rurales vers Sài Gòn ont produites des zones de bâtiments auto-construits dispersées en zone périurbaine, autour de terres agricoles ou le
fig. 8 : [ projet d’aménagement de la métropole de Sài Gòn de James Bogle ] ; deux modèle sont proposés : modèle de développement dit « naturel » (en haut) et modèle de développement des villes-satellites (en bas), 1971

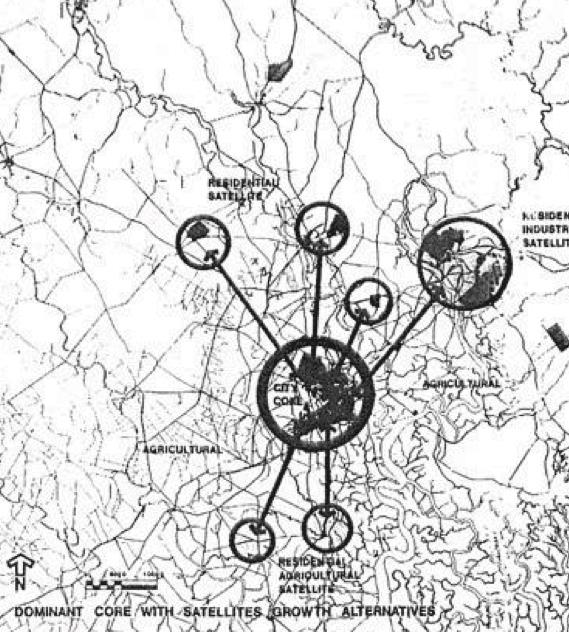
long des arroyos assainis au début du siècle, et non forcément concentrées autour du centre historique [KONTGIS et al. 2014 ; THINH et al. 2023]. Les autoconstructions représentent environ 27% de la surface bâtie de Sài Gòn en 1900 (68% entre 1932 et 1945) pour environ 60% entre 1965 et 1974. Globalement, il s’agit d’un km2 de constructions planifiées pour 0,86km2 d’auto-construction [THINH 2024, 10]. Plus administrativement, cela correspond à un passage de 5 arrondissements en 1956 à 13 en 1957, 14 en 1959, 15 en 1963 puis à 17 arrondissements en 1967 [NGÔ 2014, 51]. Il est cependant important de comprendre que l’étude de Ngô Kiến Thinh sur laquelle se base ces chiffres, même si très complète, ne distingue pas les types de constructions. Une des raisons pour laquelle la surface autoconstruite passe de 68% à 60% de la surface totale entre 19321945 et 1965-1974 est par exemple principalement dû à la construction du grand aéroport au Nord de la ville. Cela permet alors de projeter un paysage urbain mais pas réellement une réalité humaine qui se transposerait peut-être mieux à travers une étude typologique en prenant par exemple en compte la proportion de logements auto-construits. Tout cela nous montre néanmoins que le tissu saïgonnais s’est formé sous une pression importante due aux besoins urgents provoqués par les différentes périodes de conflits et de colonialisme/impérialisme.
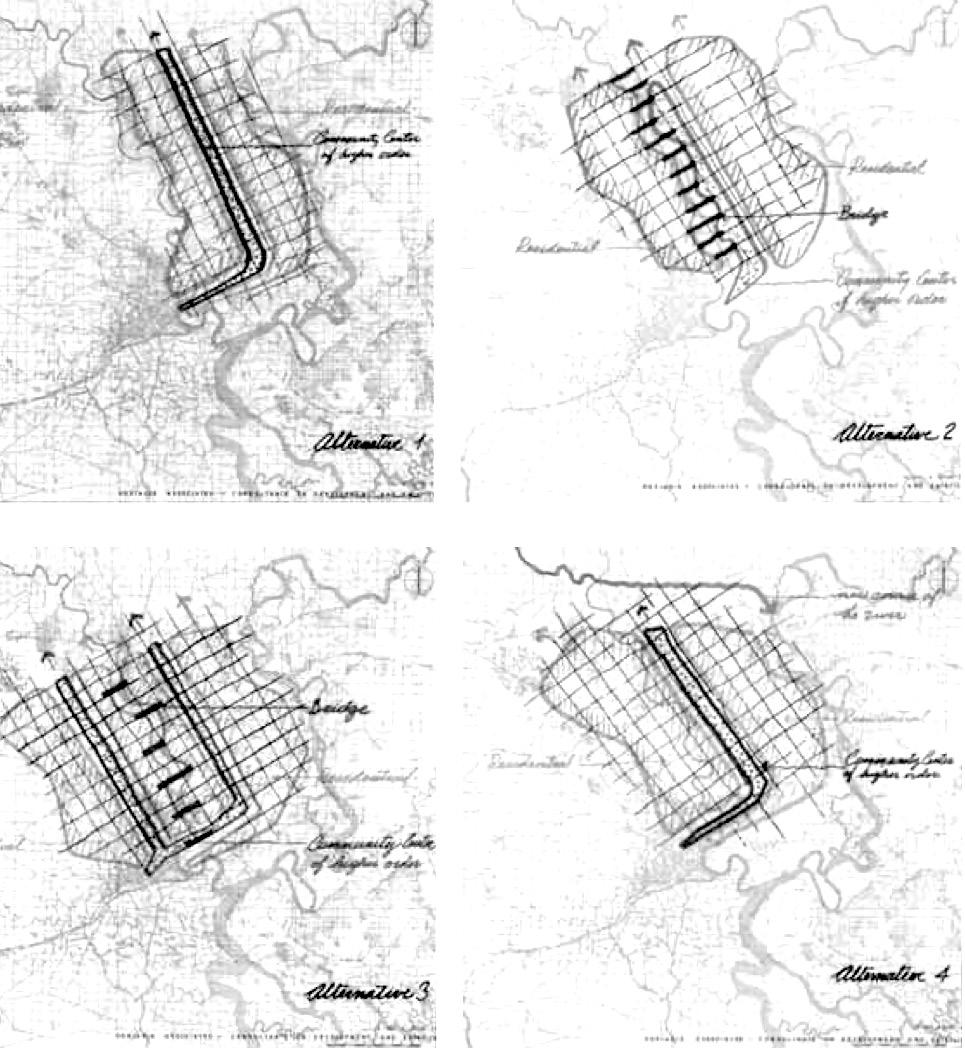
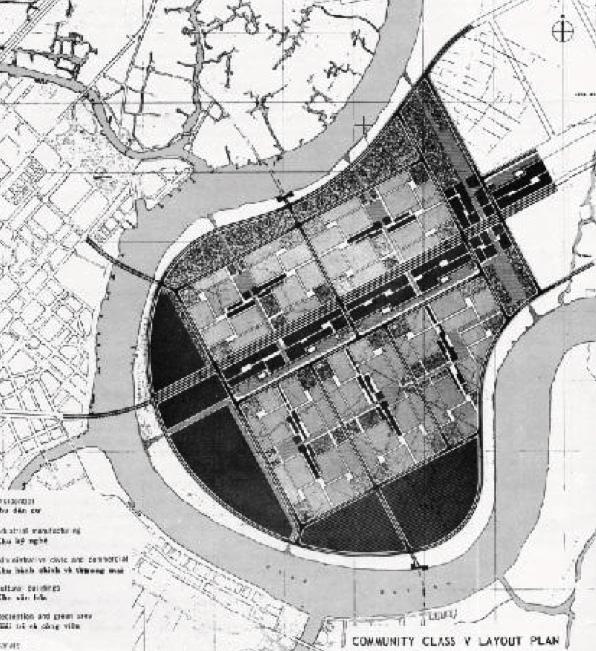
fig. 9 : [ quatre modèles de développement de la métropole de Sài Gòn par Doxiadis ], 1965
Gòn de Lê Văn Lắm ], 1968
fig. 10 : [ projet d’aménagement de la métropole de Sài
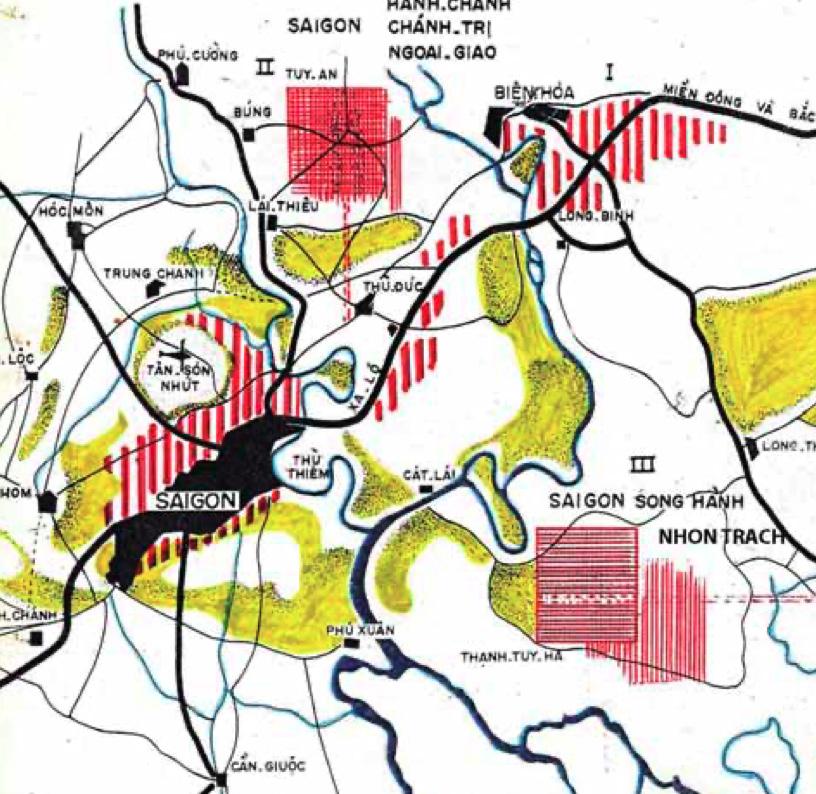
Le territoire qui devait constituer l’entité géopolitique du Sud-Việt Nam possédait une historicité riche et stratifiée, dont la complexité demeurait largement opaque à la majorité des Américain·es qui y furent déployé·es dans le cadre des programmes d’édification nationale (nation-building). L’intervention américaine s’est majoritairement matérialisée dans la période consécutive à l’effondrement du régime de Ngô Đình Diệm (1954-1963), mais les défis structurels auxquels les architectes de cette reconstruction furent confronté·es étaient profondément enracinés, non seulement dans les dynamiques propres à la gouvernance de Diệm, mais aussi et surtout dans la matrice laissée par l’héritage colonial français. Les fractures socio-économiques endémiques à la paysannerie rurale, les dispositions comportementales et les faiblesses institutionnelles de l’élite dirigeante sud-vietnamienne, ainsi que la nature même de l’insurrection communiste, étaient toutes des manifestations directes ou indirectes de cette empreinte coloniale. L’incapacité de Diệm à transcender cet héritage a servi de catalyseur à la première tentative américaine d’ingénierie étatique au SudViệt Nam. Bien que ces efforts initiaux n’aient pas atteint leur objectif — l’émergence d’un gouvernement vietnamien à la fois efficace et légitime avant 1963 —, ils ont néanmoins servi de laboratoire, révélant une pluralité de paradigmes d’intervention américains qui allaient ultérieurement informer les programmes plus systématisés et intégrés du CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support).
À son accession à l’indépendance, le Sud-Việt Nam hérita d’une structure administrative quasiment intacte, celle-là même qui avait collaboré avec l’autorité française dans sa domination de la Cochinchine et du sud de l’Annam. En tant qu’instrument de construction nationale, cet appareil étatique présentait des déficiences rédhibitoires. La France, bien que professant un engagement rhétorique envers une mission civilisatrice visant à moderniser le Việt Nam, subordonnait en réalité toute action gouvernementale à un impératif primordial : la protection
des intérêts économiques des exportateurs et investisseurs métropolitains. Cette gestion de l’« Indochine française » comme une entreprise quasi-commerciale induisit une logique de minimisation des coûts administratifs. Par conséquent, l’État colonial ne fut jamais développé au-delà du seuil minimal requis pour le maintien de l’ordre, la perception des impôts et la sécurisation des axes de communication et des centres urbains. Son emprise, déjà ténue, fut davantage érodée par l’occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, puis par le conflit d’indépendance contre le Việt Minh. Le gouvernement sud-vietnamien postcolonial se retrouva donc doté d’une bureaucratie sans expérience ni tradition d’engagement dans les campagnes, précisément là où le mouvement communiste puisait sa force et sa légitimité [GAWTHORPE 2018, 20]. Au-delà de la conjoncture, l’histoire longue du Việt Nam suggérait également une difficulté inhérente du pouvoir central à exercer son autorité sur les territoires méridionaux.
Le centre de gravité historique de la civilisation vietnamienne se situait dans le delta du Fleuve Rouge, au nord. L’expansion vers le sud fut un processus graduel, et le delta du Mékong, cœur du Sud- Việt Nam, ne fut significativement peuplé par les Vietnamien·es qu’à partir de la fin du 18e siècle. Ces colons méridionaux développèrent, selon l’historienne Li Tana, « une nouvelle manière d’être Vietnamien » [TANA 1998, 99], caractérisée par une plus grande fluidité sociale et une moindre perméabilité au contrôle centralisé. La dynastie des Nguyễn, qui unifia le pays en 1802, ne parvint à gouverner le sud qu’à travers des intermédiaires au contrôle lâche. Toute tentative d’imposer une administration directe, comme celle de l’empereur Minh Mạng en 1833, provoqua des insurrections violentes, illustrant la nécessaire prudence du pouvoir impérial face à cette population rétive [GAWTHORPE 2018, 20]. Le paysage même du delta, avec ses frontières indistinctes entre la terre et l’eau, semblait historiquement réfractaire à l’emprise ferme de l’autorité étatique.
Le succès de l’État sud-vietnamien dépendait alors de la capacité de ses administrateur·ices à surmonter ce passif
historique, une tâche que les empereurs eux-mêmes n’avaient pu accomplir. Or, la colonisation française avait précisément démantelé la tradition séculaire de la gouvernance mandarinale. Ce système reposait sur une classe de lettré·es, imprégné·es de doctrine confucéenne, qui servaient de médiateur·ices essentiel·les entre le pouvoir impérial, perpétuellement en déficit d’information, et les myriades de villages vietnamiens. La France a subverti ce système par nécessité et par dessein.
Confronté·es au refus de collaboration de la plupart des mandarins en Cochinchine, iels durent s’appuyer sur des parvenu·es, souvent dépourvu·es de la culture administrative précoloniale. L’élite bureaucratique qui en émergea, et qui forma l’ossature de l’administration post-1954, provenait d’une strate sociale restreinte et culturellement aliénée de la population rurale [GAWTHORPE 2018, 21]. Recruté·es au sein de la classe moyenne urbaine, éduqué·es selon des curricula français puis américains, majoritairement issu·es des cercles de Sài Gòn et avec une surreprésentation catholique, ces fonctionnaires incarnaient la fraction de la société la plus associée au colonialisme. Leur vision du monde et leurs valeurs avaient divergé de manière abyssale de celles de la paysannerie. Cette bureaucratie hérita en outre d’un formalisme et d’un centralisme omniprésents, legs de la nécessité pour les proconsuls français de brider l’initiative de leurs subordonné·es vietnamien·nes, au point où un chef de district ne pouvait même pas adresser une félicitation officielle sans une approbation supérieure [GAWTHORPE 2018, 21]. Malgré sa relative légèreté administrative, le régime colonial français avait imposé à la paysannerie un appareil coercitif d’une efficacité sans précédent. Comme le note l’historien David Marr, il disposait de « capacités de contrôle et de coercition dont les dirigeants précédents n’auraient jamais osé rêver » [MARR 1971, 3]. Là où les empereurs témoignaient d’une grande déférence envers les intérêts locaux, l’État colonial était capable d’imposer sa volonté sans nécessairement recourir à la force brute. Pour ce faire, il récompensa ses collaborateur·ices par de vastes concessions terriennes, accélérant un processus de
prolétarisation de la paysannerie, de plus en plus réduite au statut de métayer·es ou d’ouvrier·es agricoles. En l’espace de quelques générations, ce système a provoqué l’effondrement de l’ordre social villageois traditionnel et une polarisation accrue des classes. Ce fut un terreau extraordinairement fertile pour l’ascension du Việt Minh, puis du Front National de Libération (FNL), qui surent incarner et canaliser les aspirations des fractions les plus dépossédées de la paysannerie.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la puissance de l’État colonial suffisait à écraser les rébellions locales, mais il ne pouvait empêcher la gestation d’un mouvement national structuré, capable de contester sa légitimité sur le long terme : le communisme vietnamien.
Lorsque Ngô Đình Diệm devint Premier ministre en juin 1954, il prit la tête d’un État-client français dont la souveraineté était largement fictive. Les accords de Genève consacrèrent la partition du pays, lui confiant un territoire au sud du 17e parallèle. Son défi principal fut de consolider son autorité sur ce territoire, la République du Việt Nam (RVN), face à une triple menace : les sectes politico-religieuses (Cao Đài et Hòa Hảo) qui contrôlaient de vastes fiefs, les rémanences de l’influence française, et une insurrection communiste renaissante.
Contrairement à l’historiographie traditionnelle qui le dépeint soit comme une marionnette américaine, soit comme un réactionnaire sans vision, des études plus récentes ont révélé la complexité du personnage [GAWTHORPE 2018, 31]. Nationaliste intransigeant, Diệm avait démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur en 1933 pour protester contre le refus français d’accorder une autonomie réelle aux Vietnamien·nes. Il développa une doctrine politique personnelle, un syncrétisme singulier de catholicisme personnaliste et de confucianisme, visant à créer une « troisième force » alternative à la fois au colonialisme et au communisme. C’est avec cette ambition qu’il revint d’exil en 1954 pour prendre le pouvoir. La mise en œuvre de son projet impliquait une centralisation forcenée du pouvoir. Cela le plaça immédiatement en conflit avec les autonomies locales, qu’elles soient incarnées par les sectes
politico-religieuses ou par les communautés paysannes traditionnelles. S’il parvint, avec un soutien américain massif, à démanteler la puissance militaire des sectes —ce qui lui valut son titre d’« homme miracle de l’Asie »—, il se heurta à un problème plus insoluble : combler le vide politique ainsi créé et rallier la paysannerie à sa cause nationaliste [GAWTHORPE 2018, 31]. Pour ce faire, il militarisa l’administration provinciale et districale, nommant des officiers de l’Armée de la République du Việt Nam (ARVN) aux postes clés, perpétuant une tradition de pacification militaire du sud. En 1962, la quasi-totalité des chefs de province étaient des militaires. Dans le contexte de la « Campagne de Dénonciation des Communistes », l’efficacité répressive primait sur toute autre considération. Un chef de province confiait en 1957 :
« Un fonctionnaire qui traite le Việt Minh avec sévérité est utile, peu importe qu’il soit honnête ou compétent. Mieux vaut un chef de district voleur qu’un district infesté de communistes » [GAWTHORPE 2018, 33]
Afin d’empêcher l’opposition, notamment les sympathisant·es du Việt Minh, de prendre des postes dans les conseils locaux, Diệm a donc dissous ces structures et imposé ses propres partisans comme dirigeant·es, souvent des réfugié·es catholiques du Nord. La « réforme agraire » qu’il a instaurée n’était qu’un prétexte pour expulser les populations des terres qu’iels avaient récupérées après la guerre contre la France, et les redistribuer aux partisans du régime [YOUNG 1991, 57]. À la fin des années 1950, Diệm s’était solidement ancré au pouvoir, soutenu activement par les États-Unis d'Amérique. Ce soutien se manifestait par une répression systématique qui englobait les arrestations, les interrogatoires, la torture, les exécutions et le déplacement forcé des populations. Les médias américains, de leur côté, soutenaient ouvertement ce régime répressif, le présentant comme une force essentielle dans la lutte contre le communisme, célébrant les actions de Diệm tout en dissimulant les atrocités commises contre la
population. Conscients des lacunes de l’administration héritée des Français·es, Diệm et son frère et conseiller Ngô Đình Nhu tentèrent de la doubler par un réseau d’organisations politiques et paramilitaires directement loyales à leur famille. Admirant l’efficacité organisationnelle des communistes, ils cherchèrent à imiter leurs techniques en créant des fronts de masse. Cependant, comme l’analysa un de ses anciens architectes, cette tentative était vouée à l’échec car elle inversait la logique du modèle communiste. Le régime de Diệm perpétua ainsi la relation essentiellement coercitive avec la paysannerie qui avait caractérisé la période coloniale. Cette logique culmina avec la loi 10/59, qui instaurait la peine capitale pour toute « atteinte à la sécurité nationale », et le Programme des Hameaux Stratégiques, qui visait à relocaliser de force une grande partie de la population rurale pour la couper physiquement de l’insurrection [GAWTHORPE 2018, 35].
L’arrivée d’Albert J. Fraleigh à Sài Gòn en mai 1962 est emblématique de cette période. Archétype de l’expert américain en contre-insurrection et développement rural, il fut convoqué pour renforcer un régime de Diệm alors en grande difficulté face à une offensive communiste généralisée [GAWTHORPE 2018, 38]. Le rapport Taylor-Rostow de 1961 avait préconisé une nouvelle initiative visant à tisser des liens entre le régime et la paysannerie, marquant le début d’une présence américaine officielle et permanente dans les campagnes. Parallèlement, le Commandement de l’Assistance Militaire au Việt Nam (MACV) fut créé, et des conseiller·es militaires américain·es furent assigné·es aux unités de l’ARVN et aux chefs de province. Cette prolifération d’acteurs américains (USOM, CIA, MACV) sur le terrain, sans coordination centrale efficace avant la création du CORDS, engendra ce que William Colby a décrit comme des « baronnies autonomes ». « Tels les aveugles examinant un éléphant », écrivit-il, chaque agence américaine appréhendait une partie différente du problème sud-vietnamien et définissait l’ensemble en fonction de son expérience parcellaire [COLBY 1989, 74-105]. Cette dispersion des efforts rendait non seulement la communication avec le gouvernement
vietnamien incohérente, mais reflétait aussi une profonde divergence doctrinale sur la nature même du nation-building. Contrairement aux affirmations de Washington, toutes les preuves disponibles montrent que la reprise de la guerre civile au Sud en 1958 a été le fruit d’une initiative locale, menée par des Sud-Vietnamien·nes elleux-mêmes, et non dictée par Hanoï [KAHIN et LEWIS 1967, 120]. Cette réalité contredit la version officielle américaine, selon laquelle le Front National de Libération (FNL) obéissait directement aux ordres de Hồ Chí Minh et des autorités communistes du Nord, qui seraient à leur tour manipulées par l’Union soviétique et la Chine. En 1963, les responsables de Kennedy se sont ensuitealarmés en découvrant que le frère de Diệm, Ngô Ðình Nhu, avait tenté de négocier un accord de paix avec le Nord-Việt Nam et le FNL, incluant un cessez-le-feu et le retrait des troupes américaines. Kennedy refusa de permettre un tel compromis, qui impliquait aussi l’inclusion des communistes dans le gouvernement sudvietnamien [MARCIANO 2021, 2767]. Les Pentagon Papers révèlent par ailleurs que les États-Unis d'Amérique ont soutenu le coup d’État contre Diệm en 1963, le présentant comme une volonté populaire. Cela faisait partie d’une série de renversements orchestrés par Washington, qui avait installé puis destitué plusieurs dirigeants, assurant ainsi que le régime de Sài Gòn restait sous contrôle américain. Le conflit n’était donc pas une guerre civile, mais un affrontement entre les Vietnamien·nes et une puissance impérialiste étrangère. Finalement, l’offensive du Tết en 1968 constitua une rupture stratégique et psychologique majeure. Elle ne fut pas un événement ponctuel, mais le début d’une année de pression militaire incessante qui anéantit le sentiment de sécurité, y compris dans les centres urbains comme Sài Gòn, et infligea des destructions matérielles considérables. Près de 150 000 habitations furent détruites, souvent par la puissance de feu américaine, ce qui créa un risque de retournement de l’opinion urbaine, jusqu’alors principal soutien du gouvernement. La propagande du FNL exploita habilement ce ressentiment, accusant le régime Thiệu-Kỳ de complicité dans la destruction
de son propre pays. Pour les responsables américains, le choc fut profond. L’optimisme, déjà fragile, s’effondra. Robert Komer, l’architecte de la pacification, exprima un pessimisme radical, concédant des revers majeurs et s’inquiétant de l’incapacité du gouvernement vietnamien à exploiter le « vide » laissé dans les campagnes par les lourdes pertes communistes [GAWTHORPE 2018, 99].
[fig. 11 et 12 : Les deux images montrent une organisation en plan, une vue schématique et une photographie aérienne, documentant ce qui semble être un même phénomène. Le schéma est un plan simplifié et généralisé se concentrant sur les dispositifs de contrôle et de sécurité. On y voit la structure comme une entité clairement délimitée par une succession de barrières : une digue de terre (« Earthen
Mound with Bamboo Spears »), des barbelés (« Bamboo & Barbed Fence »), un fossé (« Moat »), et une autre barrière de bambou. Ces couches de protection concentriques créent un espace fermé et isolé, dont la porosité est strictement contrôlée. À l’intérieur de ce périmètre, l’organisation spatiale est fonctionnelle. Des points d’entrée uniques (la « Gate » avec un « Guard Post ») gèrent l’accès. Les bâtiments sont disposés en rangées ordonnées et sont désignés par leur fonction : « School », « Dispensary », « Market Place ». On trouve également des installations purement militaires, comme les « Watchtowers » et les « Arms Storage ». L’espace est mesuré et planifié par une puissance extérieure. Ce plan est un document de l’intention ; il ne montre pas une réalité, mais un modèle idéal et coercitif de l’organisation imposée. La photographie, elle, nous offre elle une vue concrète de ce même concept, ici matérialisé sur le terrain. L’angle de vue aérien nous donne une perspective similaire à celle du plan. On reconnaît immédiatement la forme ovoïde et les multiples couches de fortification (tranchées, monticules de terre) qui entourent le hameau. L’ordre des habitations à l’intérieur est visible, bien que moins schématique que sur le plan. Les toits des maisons, d’apparence simple, sont groupés en un motif qui, tout en étant organisé, présente une certaine irrégularité. L’image révèle également ce que le plan omet : le contexte paysager et l’environnement réel. Le hameau est implanté dans une zone rurale, potentiellement forestière ou montagneuse. L’espace qui le sépare de la nature environnante est un terrain déboisé, une zone tampon de sécurité qui rend le hameau encore plus isolé. Ces images illustrent les des hameaux stratégiques mis en place par le gouvernement sud-vietnamien, avec le soutien américain, durant la guerre américaine. Il s'agit, visuellement, d'une stratégie de domination par le contrôle spatial : la population n’est plus libre de circuler ; elle est concentrée et enfermée afin d'être mieux
fig. 11 : autteur·ice inconnu·e, [ plan schématique d'un p hameau stratégique ], date inconnue
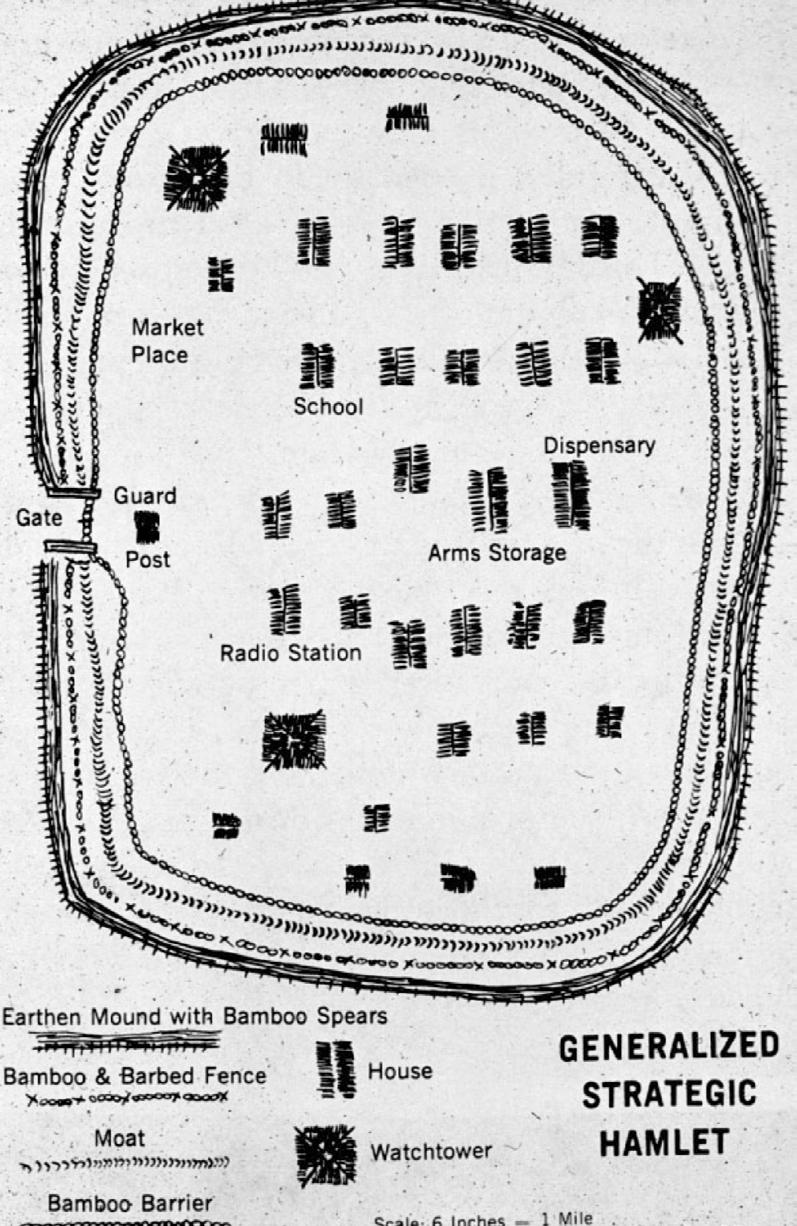
fig. 12 : associated press, [ photo aérienne d'un p hameau stratégique ], 1963
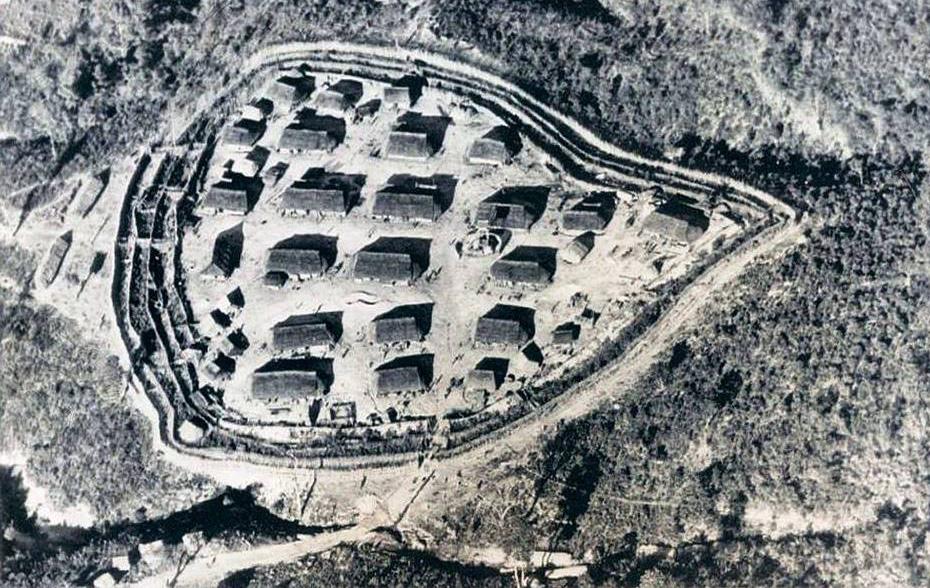
surveillée. La logique de l’enfermement remplace celle du pouvoir symbolique (comme un bâtiment monumental). Les structures architecturales sont ici des outils directs de cette domination, les fossés, les palissades et les miradors ne sont pas seulement défensifs ; ils sont des dispositifs coercitifs qui définissent l’espace de vie et le limitent strictement.
Ces hameaux stratégiques offrent un contre-point essentiel à l’analyse. Si certaines infrastructures incarnent la domination par la modernité ostentatoire, le hameau représente la domination par le contrôle physique et la réorganisation forcée de l’espace de vie rural. Ensemble, ils montrent la dualité de la stratégie impérialiste : une domination de l’ordre, de la modernité et du prestige en ville, et une domination de la contrainte, de la sécurité et de l’enfermement dans les zones rurales.]
Face à l’urgence de la reconstruction urbaine, le gouvernement vietnamien, méfiant envers sa propre bureaucratie corrompue, lança le projet Recovery. Celui-ci reposait sur un principe d’action communautaire : le gouvernement fournirait les fonds et les matériaux, et la population reconstruirait ses propres maisons. L’enthousiasme de Komer pour ce projet illustrait, une fois de plus, une mécompréhension fondamentale des enjeux [GAWTHORPE 2018, 102]. Assurer la distribution de l’aide matérielle était une chose ; engager les réformes structurelles nécessaires pour bâtir une légitimité politique en était une autre. Le projet Recovery fut, au mieux, un succès palliatif. Il permit au gouvernement sud-vietnamien d’éviter un effondrement total en 1968, un résultat non négligeable mais purement conjoncturel. Il ne résolvait aucune des pathologies de fond : la sclérose bureaucratique, la centralisation paralysante, et l’absence de relais efficaces dans les campagnes. Pire, la crise des réfugiés s’aggrava considérablement cette année-là. L’abaissement des ambitions de Komer « du souhaitable au faisable » avait atteint son nadir. Le projet n’avait fait que maintenir l’État en survie artificielle, sans garantir en rien sa viabilité une fois la crise immédiate passée [GAWTHORPE 2018, 102]. La suite dépendait entièrement de la volonté politique vietnamienne, une volonté que des décennies d’histoire avaient rendue profondément incertaine. Les États-Unis d'Amérique, par l’intermédiaire de la CIA et des forces spéciales, ont donc saboté les accords de Genève,
favorisant un régime répressif dirigé par Diệm au Sud, qui a persécuté les ancien·nes Việt Minh et d’autres opposant·es. La répression violente menée par Diệm a provoqué une résistance populaire croissante, bien que les États-Unis d'Amérique aient tenté de justifier cette guerre par la thèse de l’agression communiste, malgré l’origine indigène du mouvement de résistance. L’historien George Kahin a d'ailleurs souligné que le refus américain d’organiser les élections de 1956 avait rendu la guerre civile inévitable [KAHIN 1965]. L’historienne Marilyn Young décrit elle le régime répressif de Diệm comme une campagne brutale contre les ancien·nes combattant·es vietnamien·nes du Việt Minh, accusé·es de collaborer avec les Français·es [YOUNG 1991, 56]. Des milliers de Việt Minh ont été capturé·es, envoyé·es dans des « camps de rééducation », ou exécuté·es.
Sous l’administration de Johnson, l’escalade de la guerre au Việt Nam en 1965 a ensuite été justifiée par la thèse d’une « agression » nord-vietnamienne [GREENE 1966, 146]. Toutefois, Chomsky souligne que, cinq mois après l’intensification des combats, les États-Unis d'Amérique n’avaient toujours pas rencontré d’unités régulières nord-vietnamiennes au Sud-Việt Nam [CHOMSKY 1972, 196]. Cette fausse présentation visait à convaincre l’opinion publique américaine que le Việt Nam du Sud était victime d’une invasion extérieure, occultant ainsi la réalité d’une guerre de résistance contre l’intervention américaine. Le programme Phoenix de la CIA, lancé en 1965, a ensuite permis de détruire le réseau du FNL, entraînant la mort de dizaines de milliers de civil·es, souvent victimes de torture et d’exécutions sommaires. Ce programme faisait partie d’une politique de répression brutale, qui a alimenté les mensonges officiels, comme celui de l’attaque du Golfe du Tonkin en 1964, largement démenti par des fuites ultérieures.
Le mensonge gouvernemental était une partie essentielle de la guerre. Ellsberg a exposé peut-être le plus grand mensonge, ayant eu un impact profond sur le conflit : l’histoire officielle de la crise du golfe du Tonkin en août
1964. Le président Johnson et le secrétaire à la Défense Robert McNamara déclarait alors au public « que les NordVietnamiens, pour la deuxième fois en deux jours, avaient attaqué des navires de guerre américains en patrouille de routine dans les eaux internationales » ; qu’il s’agissait d’un schéma « délibéré » d’« agression nue » ; que les preuves de la deuxième attaque étaient « sans équivoque » ; que l’attaque avait été « non provoquée » ; et que les États-Unis d'Amérique, en répondant afin de dissuader toute répétition, n’avaient aucune intention de déclencher une guerre plus large. Toutes ces déclarations sont fausses [ELLSBERG 2002, 12-13] .
[fig. 13 : Cette photographie en noir et blanc représente une manifestation de rue. Au premier plan, un groupe d’hommes, dont plusieurs sont identifiés comme des vétérans par leur apparence, défile. Deux hommes au centre de l’image tiennent une grande bannière sur laquelle est inscrit en lettres majuscules : « WE WON’T FIGHT ANOTHER RICH MAN’S WAR ». Leurs visages sont déterminés. La composition de l’image est dynamique. Le groupe de vétérans remplit le cadre et crée un sentiment de mouvement et de force collective. La bannière, au centre de l’image, agit comme une déclaration politique. Le premier plan avec les visages des vétérans est crucial : leur présence, et leur message, sont d’autant plus puissants que ce sont eux-mêmes qui ont combattu.
L’image ne contient pas d’éléments architecturaux symboliques liés au Viet Nam*, mais elle dépeint une Amérique des années 1960. Les publicités en arrière-plan et les façades des magasins ancrent la scène dans un contexte urbain spécifique. Le slogan de la bannière est aussi un élément puissant, exprimant le sentiment d’avoir été utilisé par une élite politique et économique, un thème central de l’opposition à la guerre du Viet Nam*. Cette photographie est une archive visuelle de la dissidence et du désenchantement face à la guerre du Viet Nam*. Elle met en lumière une facette importante de l’impérialisme américain : sa capacité à générer un fort mouvement de résistance intérieure. Elle documente comment l’opinion publique s’est retournée contre le conflit, en particulier parmi ceux qui ont été le plus directement touchés : les soldats qui sont revenus de la guerre. Le VVAW (Vietnam Veterans Against the War) a joué un rôle majeur dans l’escalade de la contestation, et cette photo, prise au moment de sa fondation en 1967, est un document rare qui capture les débuts de ce mouvement. Elle montre que l’impérialisme, même s’il est puissant à l’étranger, peut être contesté de l’intérieur.]
Au final, la guerre du Việt Nam a été une guerre d’agression menée par les États-Unis d'Amérique, une puissance impérialiste cherchant à maintenir son contrôle en Asie du Sud-Est.
fig. 13 : auteur·ice inconnu·e, Việt Nam Veterans Against the War in Philadelphia, vers 1970
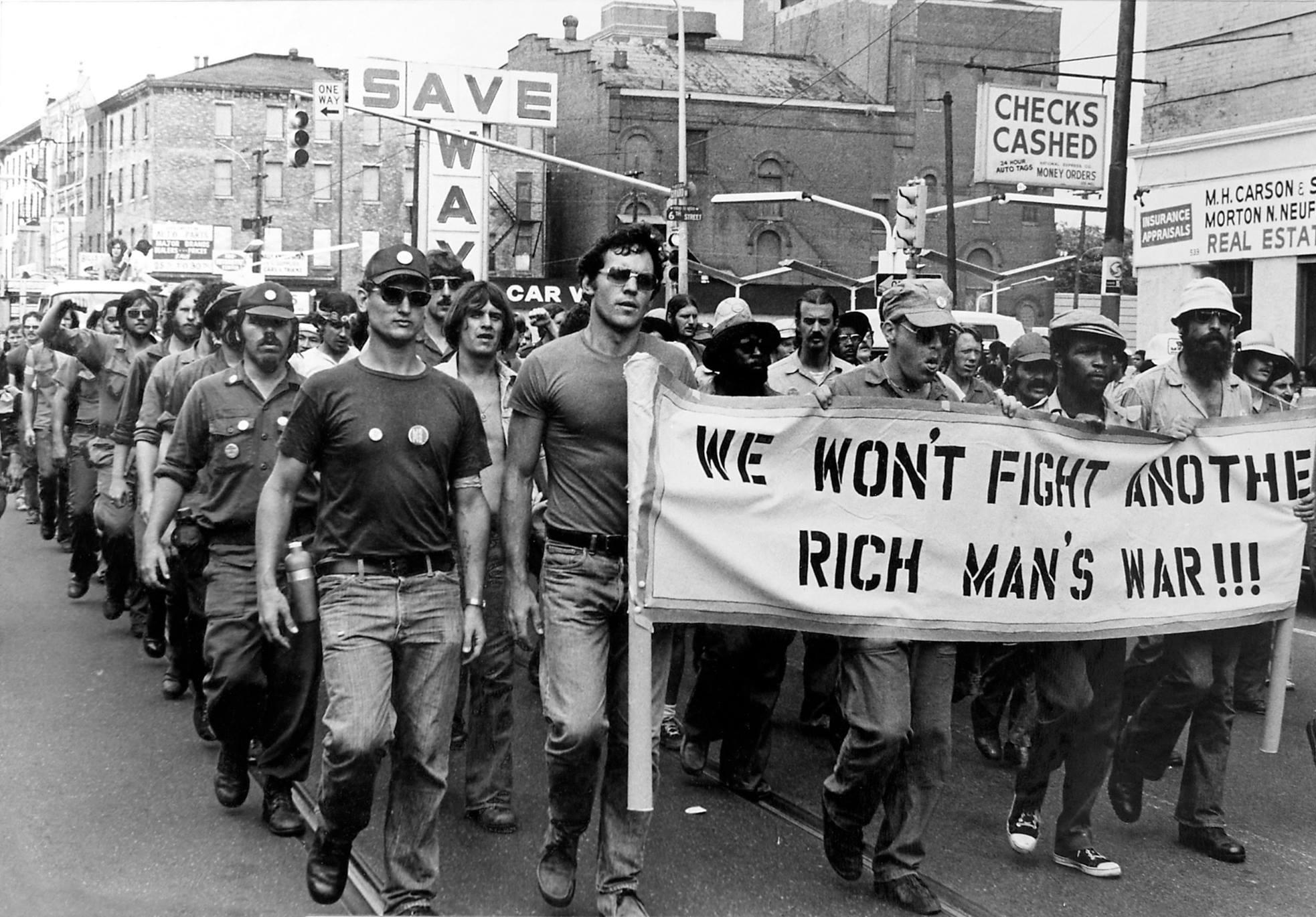
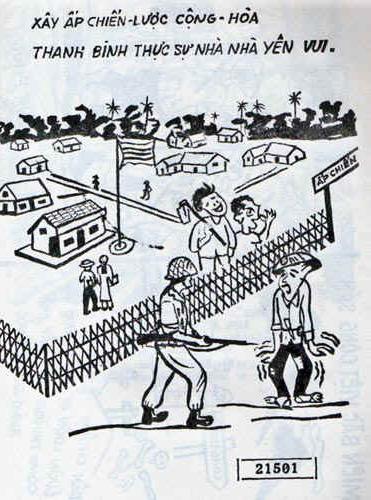
fig. 14 : auteur·ice inconnu·e, leaflet 21 501 prepared by the Vietnamese to be used by PSYOP troops in Vietnam, dans Leaflet
Catalog Psywar Training, 1963
[Traduction] Construire des hameaux stratégiques dans la République afin de réaliser une paix véritable et d'apporter joie et tranquillité à chaque famille.
fig. 15 : auteur·ice inconnu·e, Poster 2553, imprimé et distribué par le Joint U.S. Public Affairs Office, mai 1968
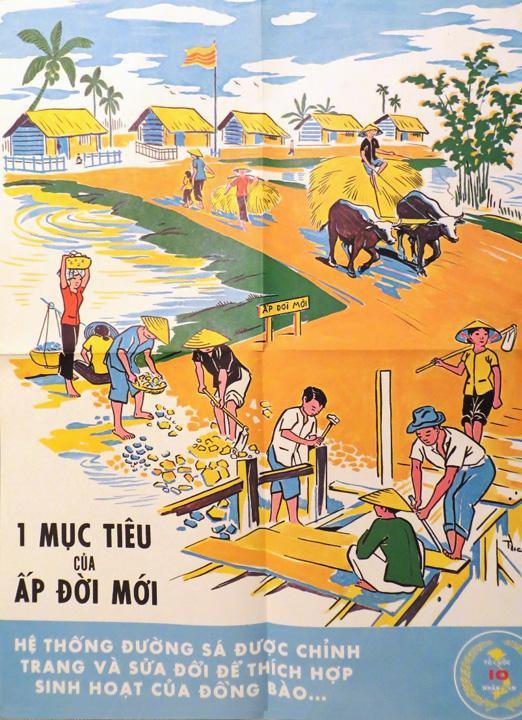
[Traduction] L'un des objectifs des nouveaux hameaux de vie. Le réseau routier est en cours de réparation et d'amélioration afin de s'adapter aux activités des compatriotes.
fig. 16 : auteur·ice inconnu·e, Leaflet NT3/A/TD4, imprimé et distribué par le Joint U.S. Public Affairs Office, date inconnue
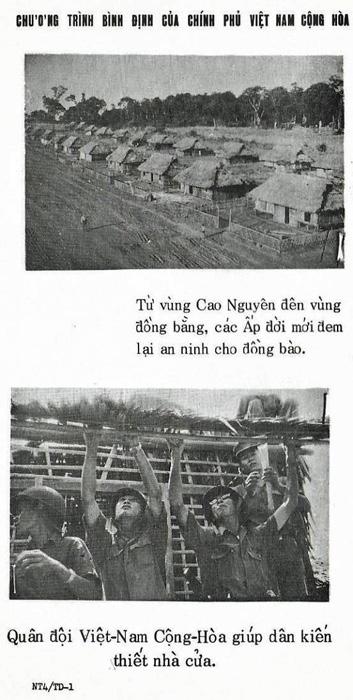
[Traduction] Programme de pacification de la république du Việt Nam :
Des hauts plateaux aux basses terres, les hameaux New Life redonnent la sécurité aux citoyen·nes.
Les forces armées de la République du Việt Nam aident la population à construire des maisons.
Les hameaux nouvellement pacifiés ont un avenir prometteur.
présences et impérialisme

fig. 17 : axel wlody, inventaire des présences bâties urbaines américaines à Sài Gòn entre 1954 et 1975, 2025

en rouge : chaque bâtiment, qu'il ait été construit, occupé, réhabilité, financé etc. l'a été par le gouvernement américain, ses forces armée ou sa population.
en blanc : le bâti approximatif général de Sài Gòn
L'aide étrangère, et en particulier celle dispensée par des agences gouvernementales comme l'U.S. Agency for International Development (USAID), est trop souvent perçue à travers le prisme de l'assistance humanitaire et du développement économique. Une analyse approfondie révèle néanmoins que ces programmes ne sont pas de simples actes de bienveillance, mais bel et bien des instruments sophistiqués de politique étrangère, dont la nature et les objectifs évoluent en fonction des dynamiques de l'hégémonie mondiale. Le rôle de l'USAID au Việt Nam offre une étude de cas particulièrement révélatrice de cette mutation. Historiquement, l'aide américaine s'est manifestée comme une composante directe d'une stratégie de contre-insurrection. Plus récemment, dans l'ère postnormalisation, ses fonctions se sont transformées pour s'aligner sur une nouvelle logique de pouvoir que certains théoriciens décrivent comme l'hyper-impérialisme. Le rôle de l'USAID au Việt Nam peut aisément illustrer une transformation des outils de l'hégémonie américaine. Durant la guerre américaine, cette organisation a opéré dans un contexte de conflit armé, où son rôle a été profondément imbriqué dans la stratégie militaire et politique américaine. L'agence fonctionnait au sein d'une structure « mixed militarycivilian » (opération civilo-militaire) connue sous le nom de CORDS (Civilian Office of Rural Development Support)
[ADST s.d.]. L’objectif affiché était de « gagner les cœurs et les esprits » de la population vietnamienne afin de soutenir le gouvernement du Sud-Việt Nam et de contrer l’influence du Việt Cộng et de ses allié·es soviétiques [EGE 2015]. Les initiatives civiles de l'USAID étaient vastes et visaient officiellement à stabiliser et à développer la société civile de la République du Việt Nam. Les archives nationales américaines témoignent de la diversité de ces programmes, qui incluaient : le développement communautaire, la réforme agraire, les efforts de migration et de réinstallation des populations, et de multiples projets dans le domaine de la santé publique, comme l'éradication du
paludisme [USAID 1950-1957]. Des divisions entières étaient dédiées à ces initiatives, montrant l'ampleur des ressources allouées pour créer une alternative attrayante au modèle communiste.
Les efforts de l'USAID pour le développement durable n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen tactique de pacification. Le fait que les objectifs militaires, tels que la défoliation d'une zone pour des raisons tactiques, aient eu le pas sur les succès civils démontre clairement la hiérarchie des priorités.
L'aide n'était pas un substitut à la guerre, mais une extension de celle-ci, utilisée pour consolider les gains territoriaux et idéologiques. Ce mode opératoire établit les prémisses de l'instrumentalisation des financements étrangers à des fins stratégiques. En effet, derrière cette façade de bienveillance se cachait une intention stratégique bien plus profonde.
L'USAID, créée dans la continuité du plan Marshall, n'était pas un simple organisme d'assistance. Dès ses débuts, elle a été conçue comme un outil politique ayant comme objectif d'exporter le modèle américain, d'ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises des États-Unis d'Amérique et de déstabiliser les régimes jugés hostiles [EGE 2015]. L'agence incarnait l'idée du soft power, où son aide pouvait servir à étendre l'hégémonie idéologique et économique américaine sans recours direct à la force militaire. Cette instrumentalisation a parfois été encore plus directe, l'USAID ayant été utilisée par la CIA dans les années 1970 et 1980 pour s'infiltrer dans les milieux politiques et déstabiliser des gouvernements socialistes en Amérique latine par exemple [EGE 2015]. L'aide au développement était ainsi subordonnée aux impératifs d'une politique de puissance, posant les bases d'un impérialisme indirect par la dépendance programmée.
Ici, on soutient qu'un quelconque impérialisme américain ne s'analyse pas uniquement à travers ses présences physiques et matérielles mais bien par tout un processus d'importation d'une culture, de produits de consommation etc. En fait, Sài Gòn étant la ville principale de repos pour les
soldats américains, ces derniers n'ont jamais hésité à imposer leur mode de vie loin de chez eux. La ville devient une surface de divertissement et de récréation où l'on y importe alcool, drogue, prostitutions, supermarché...
La Vietnamese American Association, par exemple, basée au cœur de Sài Gòn se présente elle-même à travers un programme bien clair :
« Ce n'est que lorsque les peuples du monde apprendront à connaître et à respecter leurs origines culturelles divergentes qu'une véritable compréhension et une véritable amitié pourront voir le jour. C'est pour cette raison qu'un groupe de résidents vietnamiens et américains de Sài Gòn s'est réuni en 1955 pour fonder l'Association vietnamienne-américaine. [...]
L'Association est une organisation privée, à but non lucratif, non confessionnelle et apolitique. Parmi ses activités, elle accorde une attention particulière à l'enseignement de l'anglais et du vietnamien, car la communication est la première étape vers la compréhension. Elle parraine également un certain nombre d'activités culturelles telles que des expositions d'art, des conférences et des concerts, et publie un magazine semestriel ainsi que d'autres documents ou livres adaptés à son rôle dans la communauté » [Vietnamese American Association, 1969]
Néanmoins, une simple lecture des livrets et des programmes mensuels de l'année 1969 révèle aisément la manière dont, loin des déclarations publiques, les dynamiques culturelles sont principalement axées sur l'importation américaine.
« - 8 mai, 15h30, Auditorium : projection d'un film en anglais, Campus International, qui décrit le programme pour étudiants étrangers de l'université d'Arizona.
Centers of Learning, montre la liberté dont jouit chaque individu de choisir son université et sa carrière, ainsi que la liberté dont jouit l'université d'exister et d'enseigner sans restriction.
- 12 mai, 9h00, Information Hall, Combat Art Exhibition, une exposition d'art de combat, parrainée par la 25e division d'infanterie de l'armée américaine et la
VAA, sera ouverte au public.
- 15 mai, 15h30, Auditorium : film, Dependable Hands, l'histoire du parcours et de la formation de quatre membres d'équipage de vol outre-mer.
Coastguard Cutters Around the Continent, trois navires de la garde côtière américaine effectuent un voyage historique en établissant la première traversée de l'ouest vers l'est de la partie arctique du continent nordaméricain.
- 22 mai, projection d'un film en vietnamien, Follow the Sun, qui retrace le voyage d'un touriste étranger à travers les États-Unis. Frontiers, nous découvrons l'Amérique de l'Ouest, incarnée par les États de l'Utah et de l'Idaho. Le film couvre l'histoire, la géographie, l'industrie, la culture, les sports et les habitants de la région.
- 26 mai, 19h30, Auditorium
Conférence : Common Law et Civil Law : flexibilité juridique ? par le lieutenant Charles H. Dicks Jr., juge avocat général, réserve navale américaine, assistant du juge avocat général/quartier général MACV.
- 29 mai, 15h30, Auditorium, film, This is Louisiana, le film dépeint la beauté semi-tropicale de l'État du Bayou. Tennessee Holiday, un circuit en voiture à travers le Tennessee ... »
[Vietnamese American Association, 1969]
Par ailleurs, le journal de la VAA de Janvier-Juin 1974 révèle que la « VAA just signed a contract with USAID to take over many of the programs ». Le propos ici tend de fait à démontrer l'importance d'un recul critique nécessaire lorsqu'il est sujet de la potentielle bienveillance de programmes tel que l'USAID, thèse encore et toujours soutenue par certaines personnes.
Si l'on revient aux conséquences physiques de ces organisations et de l'impact de larges financements extérieurs dans l'effort de guerre de l'époque, l'importante somme d'argent déployé au sud du pays a été inimaginablement élevé, laissant
d'ailleurs affirmer un impérialisme non seulement physique mais également financier. Les documents des archives nationales de Sài Gòn révèle clairement une dépendance du gouvernement vietnamien vis-à-vis des investissements étrangers. Ici, on ne parle pas uniquement de grands projets de construction, certaines lettres d'instituts culturels vietnamiens révèlent par exemple des commandes d'embouchures de trompette directement adressées aux instances gouvernementales américaines. En plus d'avoir presque multiplié les taxes par 5 sur le sud du pays, la situation régionale est fortement économiquement guidé et influencé par les impératifs américains (certains documents évoquent des financements canadiens, allemands etc.). Il faut donc comprendre que l'USAID est une force non militaire, mais néanmoins coercitive, qui vise à s'assurer de l'alignement des États du « Sud global » sur les objectifs de l'Occident dirigé par les États-Unis. Le cas du Việt Nam n'est donc pas une anomalie, mais un paradigme d'une phase de domination bien spécifique où le contrôle n'est pas uniquement opéré par l'occupation, mais aussi par une dépendance culturelle, politique, religieuse et économique programmée.

Định, 1966
fig. 18 : auteur·ice inconnu·e, Sân Golf trong công viên Gia

fig. 19 : Brian Wickham, titre inconnu , 1968-1969
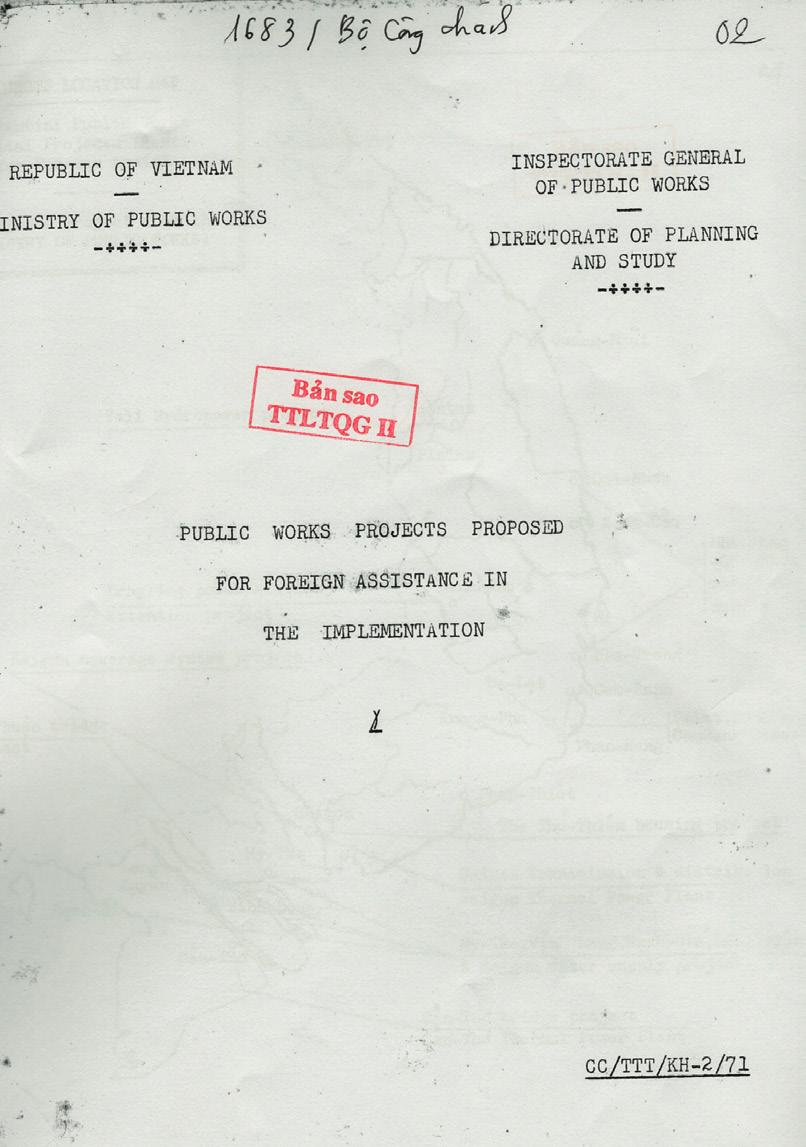
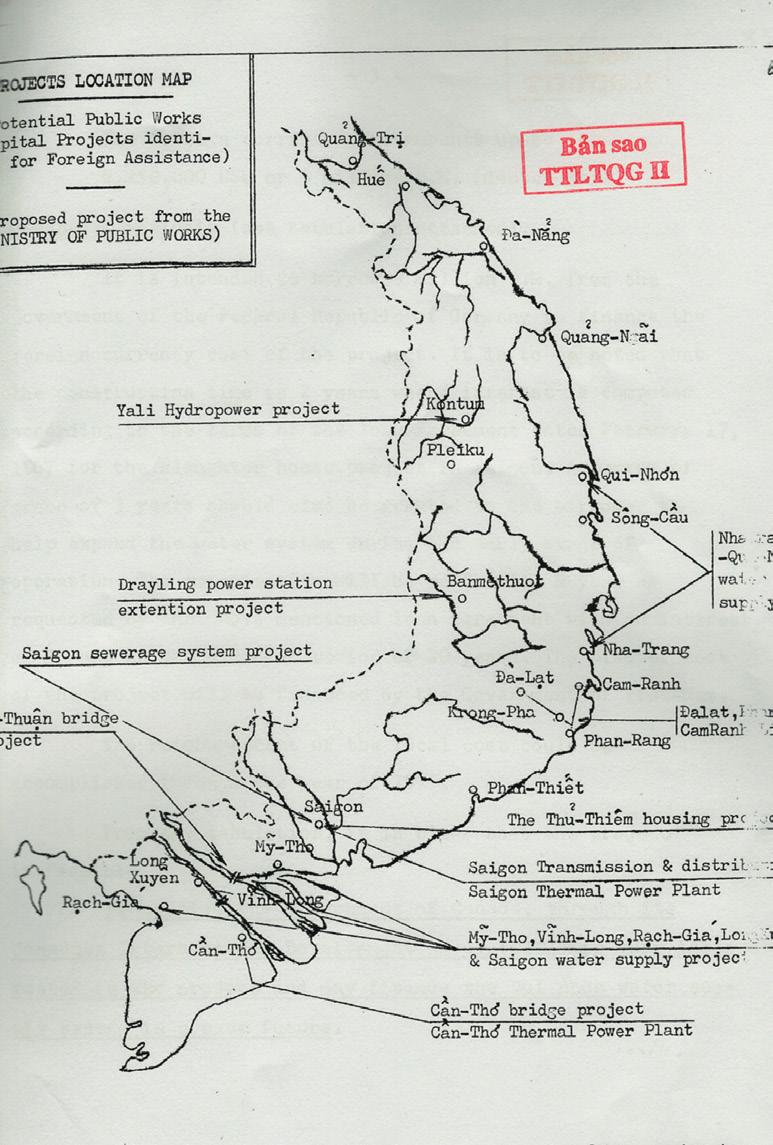
fig. 20 : auteur·ice inconnu·e, Public works projects proposed for foreign assistance in the implementation, archives nationales du Việt Nam II, 1970-1971
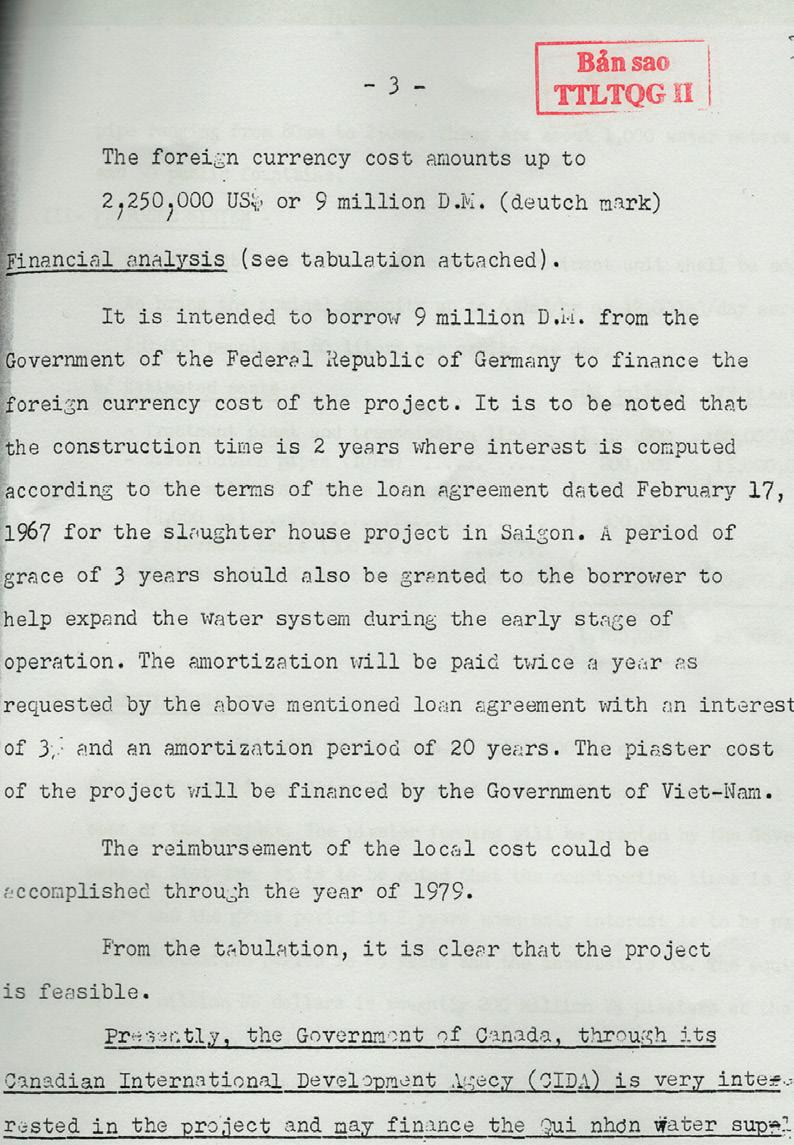
fig. 21 : mel schenck, new catholic church along highway ql-20 , 1970-1972


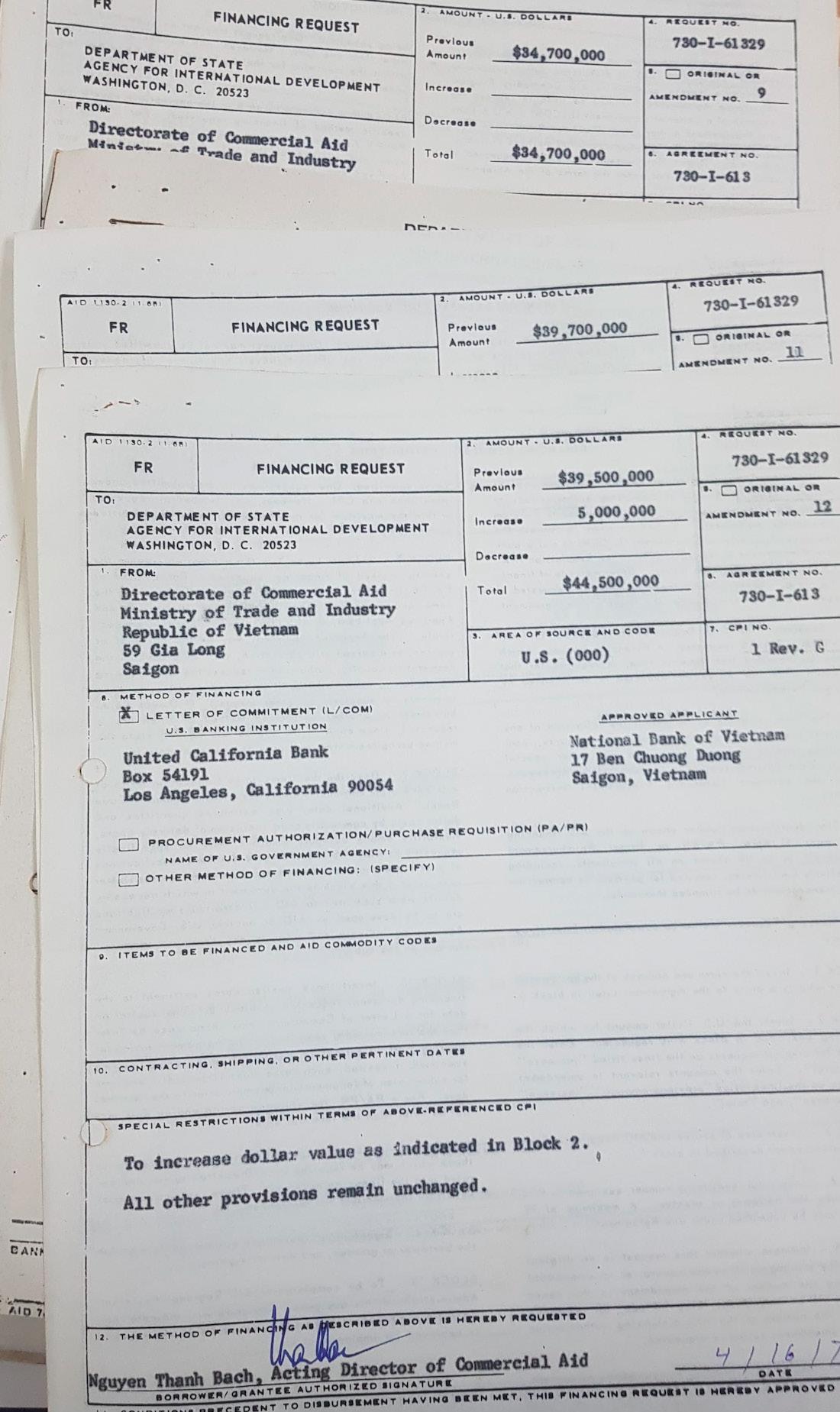
fig. 22 : auteur·ice inconnu·e, financing requests, 1974
le 12 août 1971
« To spread the light of education »
"What, then, have been the USAID’s assistance programs during 1966, In the year just ended, USAID provided some $700 million dollars of additional economic assistance to Vietnam. These resources [...] are a gift from the people of the United States to the people of Vietnam [...] : First, to win the fight against inflation. Second, to provide direct support of the military effort itself ; and third, to step up the pace of revolutionary development in the countryside" [...]
Just as the war requires a stable economic base –it creates other needs. Let me mention just a few among the next category of USAID activities I want to tell you about. They are the war-related activities which accounted for another 20 percent of USAID assistance last year. Vietnam’s roads must carry the vehicles, not only of commerce, but those of war as well. Allied convoys–vehicles of the Vietnamese Army, the US Military Assistance Command, and of other Free World Forces–drive these roads day in and day out. They must be maintained, and Allied use is not the only damage done them. Their bridges and culverts are the targets of Viet Cong sabotage at every turn.
During the past year, USAID has provided both material and technical assistance to repair, maintain, and extend the roads of Vietnam. And the armed forces of Vietnam and her allies have made them increasingly secure. In 1965, 274 acts of Viet Cong sabotage temporarily cutting the highways were reported. In 1966, there were only 85 such incidents.
I am sure that no one here has forgotten the exodus of refugees from North Vietnam in 1954. They numbered well over a million people then. Since that time, the war has produced each year its harvest of homeless. At the beginning of 1966 there were 700 000 refugees in Vietnam’s refugee camps. During the year, 900 000 more appeared to be cared of, making a total of 1.6 million homeless people. But at the same time 850 000 were returned to their homes or resettled in new areas under the joint Government of Vietnam – USAID refugee program. This represents another substantial accomplishment »
L’historien Michael Parenti définit l’impérialisme comme un processus dans lequel la classe dominante d’une nation s’approprie les ressources, la main-d’œuvre et les marchés d’autres peuples, au profit des sociétés multinationales. L’objectif ultime est de protéger les intérêts économiques des grandes entreprises, tout en imposant des régimes répressifs pour éviter l’émergence de nations autonomes et indépendantes qui pourraient menacer l’hégémonie des États-Unis d'Amérique
[PARENTI 2010] . De son côté, Noam Chomsky critique lui l’idée que les guerres américaines sont menées dans l’intérêt national ou pour des raisons de sécurité nationale. Selon lui, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique est dictée par une petite élite liée aux grandes entreprises, aux banques et aux cabinets d’avocats, et non par une vision collective de la nation
[CHOMSKY 2003, 93].
Les interventions impérialistes américaines depuis 1945, selon William Blum, ont visé à maintenir un environnement favorable aux sociétés transnationales américaines, en empêchant l’émergence de régimes alternatifs qui pourraient menacer le modèle capitaliste [BLUM 2000, 13-14]. Ces interventions ont principalement visé les nations non occidentales, leur crime étant de chercher à s’autodéterminer et à se développer indépendamment des intérêts américains [BLUM 1995, 15]. L’ancien leader du mouvement anti-guerre Carl Oglesby, pour sa part, a souligné que l’implication des États-Unis d'Amérique au Việt Nam n’était pas motivée par la défense des libertés, mais par le désir de contrôler l’économie vietnamienne et d’empêcher toute alternative au capitalisme mondial [OGLESBY 1967, 112]
Sous l’administration Kennedy, les États-Unis d'Amérique ont intensifié leur engagement militaire, envoyant des troupes d’élite et menant une guerre secrète contre le Việt Nam du Nord. En 1961, Kennedy a approuvé l’utilisation de la
guerre chimique et la formation de forces paramilitaires pour soutenir le régime de Diệm, entraînant une escalade violente du conflit. Les États-Unis d'Amérique ont cherché à maintenir l’hégémonie capitaliste en Asie du Sud-Est, en utilisant la théorie des dominos pour justifier l’interdiction de toute alternative au modèle capitaliste mondial.
« le monde ouvert et hospitalier pour […] les sociétés transnationales basées en Amérique, […] empêchant l’émergence de toute société qui pourrait servir d’exemple de succès d’une alternative au modèle capitaliste, et étendant l’hégémonie [de classe] sur autant de parties du globe que possible » [Blum 2000, pp. 13–14]
De même, on peut soutenir que la domination coloniale française était fondée sur une exploitation économique brutale et justifiée au motif qu’elle offrait « l’avancement matériel et l’élévation morale – en accomplissant . . . une ‘mission civilisatrice ». Tout cela a profondément changé la vie de la grande majorité des Vietnamien·es tout en enrichissant une petite élite qui servait la France – à mesure que l’écart entre les quelques riches et les nombreux pauvres se creusait [LAWRENCE 2008, 11-12]. Que ce soit le mythe de l’attaque nord-vietnamienne ou toutes les autres raisons, les puissances américaines s’en sont emparé afin de justifier la présence militaire américaine sur le territoire sud-vietnamien et par extension, tous les projets de construction et d’occupation que cela a entraîné. Un fait demeure alors indiscutable. À partir du moment où Washington choisit d’intervenir militairement et non plus seulement de conseiller l’armée de la République du Việt Nam, il devint nécessaire de mettre en place un dispositif logistique et infrastructurel sans précédent. Acheminer et soutenir plus de deux millions d’Américain·es au Sud-Việt Nam impliquait alors de bâtir en un temps extrêmement réduit tout un réseau de ports, d’aéroports, de bases et de logements, ainsi que des infrastructures routières, énergétiques et sanitaires. En 1960,
Sài Gòn ne disposait que d’un port en eau profonde et de deux aéroports aptes à recevoir des avions à réaction – Tân Sơn Nhất et Đà Nẵng. La congestion du port de Sài Gòn était telle que les navires restaient plusieurs semaines à l’ancre avant de pouvoir décharger [SCHENCK 2018]. Pour soutenir l’effort de guerre, les États-Unis d'Amérique confièrent à la marine la responsabilité des chantiers militaires en Asie du Sud-Est. Celle-ci créa l’Office of the Officer in Charge of Construction, Republic of Vietnam (OICC-RVN), chargé de superviser les contrats. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a donc supervisé un vaste programme de planification visant à concilier les besoins immédiats liés au conflit —tels que la construction de ponts, de routes et de casernes, des hôpitaux— avec les exigences civiles à long terme, incluant la mise en place de centrales électriques et de réseaux d’eau. Parallèlement, des infrastructures stratégiques d’envergure —ports, aérodromes et axes de transport —sont développées pour assurer l’acheminement régulier de vivres, d’armements et de matériels vers les forces déployées dans une région éloignée [DUNN 1991]. Dans ce contexte, les ingénieurs militaires, opérant à un rythme soutenu, conçoivent et supervisent la réalisation de dizaines de projets, en collaboration avec l’Agence pour le développement international (USAID), également placée sous administration fédérale. Cependant, une part substantielle —et de loin la plus onéreuse— de ces opérations a été confiée au secteur privé américain.
En 1962 fut donc constitué le consortium RMK (Raymond International et Morrison-Knudsen), rejoint en 1965 par Brown & Root et J.A. Jones, devenant RMK-BRJ. Au total, quatre sociétés de construction et d’ingénierie américaines se sont associées au sein d’un consortium majeur sous le nom de RMK-BRJ, pour mener ces projets. Il s’agit de Raymond International (Manhattan), Morrison-Knudsen (Boise, Idaho, principal initiateur du regroupement), Brown & Root (Houston) et JA Jones (Charlotte, Caroline du Nord).
Le contrat, de type « cost plus fee », devait compenser les
risques considérables de chantiers menés dans un contexte de guerre et avec des délais extrêmement contraints [SCHENCK 2018]. Contrairement aux guerres mondiales, l’absence de fronts stabilisés imposait une dispersion des bases et un maillage du territoire. La stratégie américaine reposait donc sur la création de centres logistiques côtiers capables de redistribuer hommes [fig. 23 : La photographie aérienne en noir et blanc met en exergue un bâtiment moderniste et massif qui contraste avec le tissu urbain dense de Sài Gòn. L’image capture visuellement la juxtaposition entre l’architecture fonctionnelle importée et les constructions locales, servant de témoin historique de la présence étrangère au Viet Nam*.
Au centre se dresse un imposant complexe de bâtiments modernes, dont le principal est une structure rectangulaire, haute et massive, aux façades régulières. Un bâtiment plus bas et allongé est rattaché à sa gauche. Les bâtiments se distinguent nettement du reste de l’environnement urbain, composé d’un réseau dense de rues et de toits plus bas et moins uniformes, typiques de l’habitat local. On aperçoit des véhicules circulant sur les routes au premier plan, des arbres dispersés dans le quartier, et l’étendue de la ville qui s’éloigne vers l’horizon. La photographie met en évidence les formes géométriques du complexe moderne et la texture plus organique de l’environnement qui l’entoure.
Le bâtiment central est isolé du reste du quartier par de vastes espaces ouverts et des allées. Cette organisation spatiale crée une distance symbolique et physique, suggérant que le bâtiment est une entité distincte et non intégrée à la ville. Le bâtiment s’impose comme un îlot de modernité, signalant sa fonction d’installation étrangère. De plus, on peut relever une architecture moderniste, caractérisée par des lignes épurées et des formes cubiques, renvoie à un pragmatisme technique et à une efficacité logistique. Ce design, qui s’écarte de l’esthétique locale, symbolise la capacité de la puissance américaine à construire des infrastructures sophistiquées.
L’Hôpital Thong Nhat*, en tant qu’archive visuelle, incarne la stratégie de « soft power » de l’impérialisme américain. L’hôpital n’est pas seulement un lieu de soin ; il est une manifestation de pouvoir par le biais de la construction et de la technologie. Sa présence massive dans le paysage urbain de Sài Gòn montre comment la modernisation des infrastructures a été utilisée comme un outil pour gagner l’influence et la légitimité. L’édifice est un symbole du contrôle sur le corps social et politique, où même l’aide humanitaire, principalement mise en place pour les corps américains, devient un élément de la stratégie de guerre et d’influence.
fig. 23 : auteur·ice inconnuu·e, [vue aérienne de l'hôpital Thống Nhất], 2025

En réalité, cet hôpital servait principalement les militaires et les fonctionnaires de la République du Viet Nam*, de sorte que les médicaments et les équipements provenaient du trésor public destiné à l'armée. Il s'agissait d'un marché de consommation de médicaments organisé par un magnat pharmaceutique du sud du pays.]
et matériels vers l’intérieur.
L’expérience quotidienne des ingénieur·es et architectes américain·es souligne également la coexistence de temporalités urbaines multiples. Alors que Sài Gòn connaissait déjà une forte densification de constructions privées, marquant une volonté d’investissement malgré le conflit, les chantiers de RMK-BRJ imposaient une architecture industrialisée, utilisant massivement le béton précontraint et la préfabrication. Des usines, comme celle de Châu Thới (province de Bình Dương), produisaient poutres et éléments standardisés pour accélérer la réalisation de ponts et d’autoroutes. Le programme RMKBRJ, d’un montant cumulé d’environ 25 milliards de dollars actuels, reste l’un des plus vastes jamais entrepris par l’armée américaine. Ensemble, RMK-BRJ mobilise 1 433 américain·es et 22 710 Vietnamien·nes, répartis sur quarante projets d’envergure et une centaine d’opérations de moindre ampleur.
Les réalisations –ports, aéroports, 1 047 km d’autoroutes et de ponts– structurent encore aujourd’hui le réseau vietnamien.
Mais cet héritage doit être lu à double tranchant : il constitua une modernisation forcée et asymétrique, orientée d’abord vers des objectifs militaires, et non civils [TIME 1965]. Par exemple, après la destruction de la travée de l’ancien pont français sur la rivière La Ngà (route QL-20) par le Front National de Libération, les ingénieur·es américain·es se sont immédiatement mobilisé·es. Sur le site, le montage rapide d’un pont Bailey préfabriqué a rétabli le passage, tandis qu’un pont flottant sur pilotis était réservé aux convois militaires, garantissant un flux sécurisé des véhicules et du matériel.
Le trafic civil devait, lui, se contenter de l’ancien pont en sens unique, illustrant la hiérarchie stricte des usages. La construction du nouveau pont a été confiée à Eiffel-Asia, héritière de la célèbre maison Eiffel, capable de travailler sans
grues dans le lit de la rivière [SCHENCK 2024]. Ce chantier devait assurer la mobilité sécurisée des troupes et du matériel, renforcer le contrôle stratégique des forces américaines et témoigner de leur capacité à reconstruire rapidement des infrastructures critiques [SCHENCK 2024]. Par ailleurs, il affirme symboliquement l’autorité et la modernité militaire, en distinguant clairement les usages civils et militaires et en consolidant le contrôle spatial sur le territoire.
Un contre amiral, William M. Heaman, chargé de la liaison avec la marine, ira jusqu’à déclarer que « toutcetendroit[sera] eneffervescenceaveclestravauxdeconstruction» [TIME 1965].
Le Front national de libération du Sud-Việt Nam (NLF) et les forces de l’armée populaire du Việt Nam (APV) étant disséminés sur l’ensemble du territoire, adoptaient une stratégie de guérilla qui rendait impossible la localisation d’un front défini. En réponse, la stratégie militaire américaine visait donc à identifier, localiser et détruire ces unités de manière simultanée sur l’ensemble du Sud-Việt Nam.
Dans cette logique, l’armement et le matériel de guerre devaient être distribués en permanence à travers le pays. Pour ce faire, les États-Unis d'Amérique mirent donc en place un réseau de centres logistiques considérable le long de la côte sud-vietnamienne. Ces centres, véritables carrefours stratégiques, facilitaient le transport et la distribution des ressources militaires aux unités américaines déployées sur le terrain, contribuant ainsi à l’efficacité de leur mobilisation et à l’expansion rapide de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’effort de guerre à l’échelle nationale. Entre 1962 et 1972, RMK-BRJ a par exemple entrepris la construction de six nouveaux ports maritimes répartis sur des sites stratégiques : Đà Nẵng, la baie de Cam Ranh, Quy Nhơn, Vũng Rô, Vũng Tàu et Newport à Sài Gòn [SCHENCK 2024]. Ces ports étaient équipés de 29 postes d’amarrage destinés à accueillir des navires de transport à fort tirant d’eau, facilitant ainsi l’acheminement des ressources et du matériel militaire vers les unités sur le terrain. En parallèle, six nouveaux aéroports capables d’accueillir des avions à réaction furent construits à Biên Hòa, la baie de Cam
[fig. 24 : Cette photographie en couleur montre un chantier en pleine zone rurale, non urbanisée, dominée par un cours d’eau enjambé par deux ponts. Le pont de gauche semble plus ancien, tandis que le pont central est en cours de construction. Des routes en terre battue s’étendent sur les deux rives, et on aperçoit plusieurs véhicules militaires, notamment des camions. L’arrière-plan est une dense forêt tropicale. La scène est structurée par le fleuve et les ponts montrant clairement l’ingénierie militaire. La construction du pont, visible par l’équipement et les matériaux, est l’élément central. L’activité humaine est dominée par les véhicules et le chantier imposé en milieu naturel, soulignant le caractère intrusif de cette présence. Les ponts sont les principaux éléments architecturaux. Montrant la capacité de l’impérialisme à transformer les paysages et à imposer son contrôle sur le territoire, un pont devient un outil stratégique qui permet le déplacement des troupes, des fournitures et des ressources. Sa construction est une démonstration de force et de logistique, essentielle à la capacité d’une armée étrangère à se déplacer et à se maintenir. Cette image est un document visuel illustrant l’aspect logistique de la guerre du Viet Nam*. Elle ne montre pas l’affrontement direct, mais plutôt l’infrastructure nécessaire pour le soutenir. Elle met en lumière un aspect fondamental de l’impérialisme : le contrôle du territoire par la construction de routes et de ponts, qui non seulement facilitent les opérations militaires, mais étendent également l’influence politique et économique de la puissance occupante sur les zones rurales.]
Ranh, Chu Lai, Phan Rang, Tuy Hòa et Phù Cát. L’entreprise a également élargi les infrastructures existantes, notamment les aérodromes français de Đà Nẵng et Sài Gòn, permettant ainsi d’accroître la capacité de mobilité aérienne. Par ailleurs, RMK-BRJ assura aussi la construction des infrastructures pour 26 camps de base militaires, dont Long Binh Post, qui devint alors la plus grande base militaire en dehors des ÉtatsUnis d'Amérique [SCHENCK 2024]. Ces bases furent ensuite dotées de vastes installations de cantonnement, intégrant des infrastructures et des aménagements destinés à soutenir le bien-être des troupes, souhaitant ainsi consolider les capacités opérationnelles américaines sur l’ensemble du territoire sudvietnamien.
« Le quartier général de l’armée américaine au Vietnam (USARV) a été construit par RMK-BRJ en 1966. Le gouvernement américain avait
fig. 24 : mel schenk, bridges across the la ngà river on highway ql-20 , 1970-1972


fig. 25 : mel schenk, usarv headquarters, long bình post , 1970-1972
évacué tout le personnel militaire non essentiel de Sài Gòn afin de réduire l’apparence d’une force d’occupation dans la ville. Le nouveau quartier général du MACV (Pentagon East), situé près de l’aéroport, a également été achevé par RMK-BRJ en 1967. Ceux d’entre nous qui avaient le privilège d’être à Sài Gòn étaient encouragés à porter des vêtements civils le week-end »
[fig. 25 : Cette vue aérienne, prise depuis un hélicoptère, est une archive visuelle de l’impérialisme militaire américain à grande échelle au Viet Nam*. La photographie met en évidence le contraste saisissant entre l’ordre géométrique des bâtiments militaires en rangées et le paysage environnant. L’architecture des structures, purement fonctionnelle et uniformisée, symbolise la capacité logistique et technologique de l’armée américaine à construire ses propres infrastructures sur un territoire étranger. L’image capture la création d’une enclave autonome, un monde à part du reste du Viet Nam*, qui représente non seulement un point d’ancrage militaire, mais aussi une manifestation physique de l’occupation et de la séparation entre la puissance étrangère et la population locale.]
[SCHENCK 2024, 13]
La construction du Pentagon East apparaît aussi comme un élément important de la présence américaine sur le territoire vietnamien. D’après un article du New York Times relatant les constructions à Sài Gòn et l’installation de l’armée américaine en son sein durant l’été 1967, ce complexe, également désigné par l’armée sous le nom de « Bullseye » en raison de sa vulnérabilité théorique aux attaques de roquettes et de mortiers par le Việt Cộng, représente un investissement majeur pour les États-Unis d'Amérique, d’un coût de 25 millions de dollars [NEW YORK TIMES 1967]. Il se composait d’une série de quadrangles interconnectés à l’intérieur d’une clôture de haute sécurité, à proximité de l’aéroport de Tân Sơn Nhất, en périphérie de Sài Gòn. L’architecture de cet édifice présente des similitudes avec celle du Pentagone, notamment à travers des éléments fonctionnels tels que les plans de localisation, les cartes à chaque entrée indiquant « Vous êtes ici » et les couloirs interminables bordés de portes identiques, donnant à l’espace une dimension standardisée et méthodique. Ce vaste complexe abritait dès lors, sous un même toit, l’ensemble des
commandants militaires américains, les sections principales du personnel, ainsi que les centres de collecte du renseignement et de communication.
L’installation du nouveau quartier général a permis de regrouper, pour la première fois, toutes les fonctions administratives et stratégiques du commandement des ÉtatsUnis d'Amérique. Avant ce regroupement, le bureau du général William C. Westmoreland et les sections de planification et d’opérations étaient dispersés dans deux maisons privées situées rue Pasteur, au cœur de Sài Gòn, tandis que d’autres bureaux étaient logés dans un manoir ancien de Chợ Lớn, à une demiheure du quartier général principal.
[fig. 26 : Cette photographie aérienne en noir et blanc présente une vaste infrastructure moderne, pouvant êtree un complexe industriel ou logistique, qui domine un paysage rural. Au centre, un grand bâtiment aux lignes épurées et géométriques, composé de plusieurs sections et patios intérieurs, se détache nettement de son environnement. Autour de ce complexe, on observe des zones de végétation, des terrains dégagés, des routes et de plus petites habitations dispersées. Au premier plan, deux châteaux d’eau se dressent.
La composition de l’image est centrée sur le grand complexe, dont la taille et la régularité architecturale contrastent avec l’organisation plus diffuse des habitations alentour. La structure du bâtiment principal, avec ses patios, suggère un design fonctionnel et rationalisé, typique des grandes installations industrielles et militaires. L’espace est organisé pour maximiser l’efficacité et le contrôle, créant un sentiment d’ordre et de puissance au sein d’un environnement plus diffus. La présence des châteaux d’eau peut renforcer l’idée d’une infrastructure complète et autonome, potentiellement capable de subvenir à ses propres besoins.
Les éléments architecturaux principaux sont les bâtiments massifs et fonctionnels, dépourvus d’ornementation. Le style moderniste et utilitaire de ces structures est un symbole de la logistique, de l’efficacité et de la puissance technologique. Il incarne l’idée d’une force capable de construire et de maintenir des infrastructures gigantesques afin de soutenir ses opérations. Le fait que ces bâtiments s’implantent au milieu d’un paysage mixte, et non dans une zone industrielle existante, peut symboliser une imposition de l’ordre étranger sur le territoire local, une transformation forcée du paysage pour répondre aux besoins d’une puissance impérialiste.
Cette photographie témoigne d’une violence de l’impérialisme économique et logistique.
26 :

Le complexe, par sa taille et sa nature, représente une intervention majeure dans le développement urbain et économique de la région. Il ne s’agit pas seulement d’un bâtiment, mais d’une manifestation concrète de l’influence étrangère qui transforme le paysage pour ses propres objectifs militaires. Cela peut être interprété comme un signe de la capacité d’une puissance dominante à restructurer un territoire pour la production, la logistique militaire ou le soutien de ses opérations, illustrant la manière dont l’impérialisme s’exprime par la construction et l’appropriation des espaces.]
En tout, le complexe s’étendait sur plus de cinq acres, avec 575 chambres, 685 fenêtres et 900 portes. L’infrastructure est équipée de plus de 2 500 tonnes de systèmes de climatisation, utilisant 500 000 livres de métal pour les conduits, et de 55 miles de conduits électriques. Le bâtiment avait alors était conçu pour accueillir environ 2000 personnes, dont 16 généraux et l’ambassadeur Robert Komer, chargé de la pacification [NEW YORK TIMES 1967].
L’article du New York Times montre également qu’à cette époque, l’accent mis sur la centralisation des fonctions militaires suscitait des préoccupations concernant la sécurité, surtout en raison de la proximité immédiate de la base aérienne de Tân Sơn Nhất, régulièrement attaquée par les forces ennemies. Toutefois, malgré les inquiétudes concernant la vulnérabilité du complexe, les responsables militaires minimisaient les risques et les mesures de sécurité renforcées, telles que l’installation de bunkers et de fenêtres en plexiglas de 3 mm d’épaisseur.
Si le bâtiment satisfait aux critères d’une architecture fonctionnelle et moderne, il révèle également les tensions entre la rationalisation architecturale et les enjeux géopolitiques de la guerre [NEW YORK TIMES 1967]. Les premiers témoignages des occupant·es du complexe témoignent d’une structure impressionnante, mais dénuée des commodités classiques, adaptée à une vie militaire spartiate. Cette configuration, bien qu’efficace, soulignait un contraste entre la nécessité pragmatique d’un environnement de travail et les conditions difficiles du contexte géopolitique. En somme, ce quartier
général ne représente pas uniquement un centre d’activité pour les militaires américain·es, mais devient un véritable symbole de l’empreinte stratégique et politique des États-Unis au Việt Nam. Il incarne à la fois la centralisation de l’effort de guerre et les paradoxes d’une présence militaire sur un sol occupé [NEW YORK TIMES 1967]. À travers sa construction, on perçoit l’urgence de l’engagement américain dans le conflit, et la rationalisation des moyens nécessaires pour mener à bien leurs objectifs militaires, tout en soulignant la mise en place d’un contrôle renforcé sur le territoire, marqué par les tensions inhérentes à une occupation étrangère. En cela, si l’on se réfère à l’idée hobesienne du Léviathan, l’idée même d’un « Pentagon East » à Sài Gòn est de fait une idée particulièrement symbolique. Dans son ouvrage, Hobbes décrit un État souverain et omnipotent, dont le pouvoir absolu est nécessaire pour imposer l’ordre et éviter la guerre de tous·tes contre tous·tes. Le « Pentagon East » représente parfaitement cette logique de pouvoir et l’appareil militaire et logistique américain à Sài Gòn n’est pas une simple garnison : il est une entité géante et autosuffisante, un véritable « corps » qui opère sur un territoire étranger. Comme le Léviathan [1651], il est une construction artificielle, une machine sophistiquée dont le but est de projeter la puissance et de garantir la sécurité des intérêts américains. Il englobe non seulement les troupes, mais aussi les infrastructures, les systèmes de communication, les chaînes d’approvisionnement et même les espaces de loisirs. Cette complexité et cette autarcie sont des caractéristiques centrales chez Hobbes. Le « Pentagon East » incarne la volonté ultime de puissance et de contrôle total de l’impérialisme américain. Il symbolise le désir d’imposer un ordre rationnel et structuré sur ce qui est perçu comme une région chaotique et instable en mettant en œuvre une force massive afin d’atteindre ses objectifs de matérialisation physique de la souveraineté.
Les hôpitaux et autres infrastructures, tels que les ponts, les bases militaires et les quartiers généraux, partagaient un rôle central dans la mise en place et le maintien de l’occupation américaine au Việt Nam. Tandis que les bases

fig. 27 : auteur·ice inconnu·e, [ quai bạch đằng ],1967
militaires et les installations de commandement comme le quartier général du MACV (Military Assistance Command, Vietnam) permettaientt d’assurer la gestion des opérations militaires et logistiques, les hôpitaux fonctionnaient comme des centres névralgiques, soutenant non seulement les besoins en soins des troupes américaines, mais aussi en jouant un rôle dans la propagande et le soutien moral des soldats.
[fig. 27 : Ce cliché en noir et blanc de 1967 montre un port, le quai de Bach Dang*, à Sài Gòn*. L’image capture une scène urbaine animée, avec un large boulevard en premier plan, des véhicules qui circulent, et de nombreux bateaux de différentes tailles amarrés dans le port à l’arrière-plan. Le quai est bordé par des piles de marchandises témoins d’une forte activité économique ou militaire.
Au premier plan, on trouve une large route avec une circulation dense. Le plan intermédiaire est occupé par le quai, avec ses entrepôts, ses véhicules de marchandises et ses travailleurs. L’arrière-plan est dominé par le fleuve et ses nombreux bateaux, du petit navire de commerce aux grands cargos. Cette division de l’espace met en évidence la multifonctionnalité de l’espace, qui est à la fois une artère de transport urbain, un port de commerce et un lieu d’activité maritime. Les éléments les plus significatifs sont l’infrastructure du port et les véhicules. Les grues, les bateaux de différentes tailles et les entrepôts sont des symboles du commerce mondial et du flux de marchandises. En 1967, le port de Sài Gòn était un point de ravitaillement essentiel pour la guerre du Viet Nam*. La présence de navires et d’infrastructures de transport symbolise la capacité logistique de la puissance américaine à maintenir un flux constant de matériel et de ressources nécessaires à son effort de guerre.
Le quai de Bach Dang* est lui une archive visuelle de l’impérialisme économique et logistique. Le port, installé et transformé par les besoins de la guerre, est un lieu d’intersection entre l’économie locale et l’infrastructure de guerre d’une puissance étrangère. L’image montre la coexistence du commerce civil avec une logistique de guerre, suggérant que la vie quotidienne à Sài Gòn est profondément affectée par le conflit. Le port n’est pas seulement un lieu de commerce, c’est aussi un point de contrôle stratégique pour les forces étrangères. Cette photographie illustre la manière dont un impérialisme peut se manifester à travers la transformation des infrastructures civiles en outils de guerre.]
De même, les infrastructures comme les ponts, les routes et les aéroports étaient des éléments essentiels du réseau logistique
qui permis aux États-Unis d'Amérique de maintenir sa domination territoriale et de soutenir ses opérations militaires. Ces bâtiments, bien que de natures diverses, étaient les maillons d’un même système stratégique qui articule les dimensions militaires, sanitaires et logistiques de l’occupation. Ensemble, ils symbolisaient la construction d’un espace géopolitique américain, où chaque infrastructure contribue à la pérennité de la présence militaire tout en réorganisant le territoire pour répondre aux impératifs de la guerre. À travers ces programmes, pouvant paraître parfois uniquement et simplement logistique, les constructions en découlant ont profondément marquer le paysage rural mais également les espaces urbains en venant confronter des langages, des traditions constructives et des rapports d’échelle et de culture imposés.
« Quatre ponts importants ont été construits le long des 75 kilomètres d’autoroute, auxquels s’ajoute le pont Biên Hoà (aujourd’hui connu sous le nom de Cầu Hoá An) qui enjambe la rivière Đồng Nai. Des pièces standardisées ont été utilisées autant que possible dans tous ces ponts afin de pouvoir les construire rapidement et à moindre coût. Par exemple, des poutres en béton précontraint préfabriquées ont été produites dans l’usine de béton RMK-BRJ de Châu Thới, dans la province de Bình Dương, au nord de Sài Gòn. C’est également là que se trouvait l’immense carrière de RMK-BRJ, appelée Sài Gòn
University Mineral Products Company, juste au nord de l’université de Sài Gòn prévue à Thủ Đức. L’usine de béton de Châu Thới est toujours en activité aujourd’hui, et de nombreux ponts construits au cours des dernières décennies utilisent les poutres standardisées de Châu Thới. La marine avait décidé de mettre fin au contrat RMK-BRJ en juillet 1972. Il a été clôturé pour une valeur de 1,9 milliard de dollars américains après une décennie de construction, ce qui équivaut à 17 milliards de dollars aujourd’hui, ce qui en fait le plus gros contrat de construction militaire de l’histoire jusqu’à cette date. Si l’on ajoute le coût des matériaux et des équipements fournis par la marine à l’entrepreneur, le coût total s’élèverait à environ 25 milliards de dollars »
[SCHENCK 2024, 21-22]


fig. 28 : mel schenk, titre inconnu , 1970-1972
Discours de l’ambassadeur Ellsworth Bunker lors de la cérémonie de clôture du programme de RMK-BRJ :
le 3 juillet 1972
« Je suis heureux et fier de participer à la commémoration de l’achèvement du programme de construction de la RMK-BRJ au Vietnam. Cet événement, qui marque la conclusion réussie d’une décennie de réalisations, est un moment particulièrement gratifiant et porteur d’espoir, car il nous rappelle que la construction au service de la guerre a également apporté la construction au service de la paix et du progrès…
À une époque où trop de forces sont vouées à la destruction, les dix années de réalisations du RMK-BRJ ont été, à mon avis, l’un des plus beaux épisodes de l’histoire de notre nation »

fig. 28 : auteur·ice inconnu·e, [aéroàport tân sơn nhứt ] , 1962
fig. 29 : mel schenk, steel building at hàm tân logistics center , 1970-1972


fig. 30 : us army military history institute, ambassade américaine , 1968


continuités et détournements de l’héritage
En parallèle des nouvelles constructions, très souvent militaires ou logistiques, l’inventaire urbain des présences américaines à Sài Gòn pendant la guerre révèle une intensité américaine au cœur de la ville historique, réinvestissant très souvant d’anciennes constructions coloniales françaises. Cette insertion dans le tissu urbain colonial de Sài Gòn met en avant une présence multiple : d’un côté, les ÉtatsUnis d'Amérique édifiaient ex nihilo des infrastructures monumentales à Long Binh ou Cam Ranh ; de l’autre, ils s’inséraient dans l’architecture existante du centre colonial, en louant hôtels, immeubles et villas, accentuant la fragmentation urbaine et les logiques d’occupation différenciée. De fait, on peut aisément développer l’idée qu’en s’installant dans les édifices hérités de l’administration française (palais, casernes, sièges administratifs), l’armée et les services diplomatiques américains ont non seulement prolongé la logique spatiale coloniale, mais l’ont également transformée en y superposant de nouvelles fonctions stratégiques et symboliques, consolidant ainsi le centre colonial comme cœur de pouvoir. Cette continuité s’accompagne d’une transformation significative. Les Américain·es n’ont pas seulement hérité de l’espace ; ils l’ont investi de nouvelles fonctions stratégiques et symboliques. Les casernes et bâtiments administratifs, auparavant tournés vers la gestion et le contrôle colonial, ont été adaptés pour soutenir des opérations militaires, logistiques et diplomatiques complexes, intégrant des technologies et des infrastructures propres aux besoins contemporains de guerre et de gouvernance. Les anciens palais de l’administration française, quant à eux, sont devenus des lieux de représentation et de décision où se superposent autorité politique, prestige diplomatique et puissance militaire. Ainsi, l’occupation américaine a produit un double effet : elle a renforcé la centralité historique du centre colonial en tant que cœur du pouvoir urbain, tout en inscrivant dans cet espace une
nouvelle couche de signification, intimement liée à la projection de puissance et à la présence étrangère. Pour illustrer cette dynamique, on peut par exemple citer l’ancienne villa S.A.M.I.P.I.C. (Société pour l’Amélioration Morale, Intellectuelle et Physique des Indigènes de la Cochinchine). En février 1962, après l’arrivée des premières unités d’aviation de l’armée américaine, le MAAG (Military Assistancee Advisory Group) est devenu une partie du Commandement d’assistance militaire du Việt Nam (MACV), qui a été créé pour fournir une structure de commandement plus intégrée avec l’entière responsabilité de toutes les activités et opérations militaires américaines au Việt Nam. En 1966, à la suite du transfert des opérations du MACV à la base aérienne de Tân Sơn Nhất, le bâtiment a été libéré par les Américain·es et est devenu le quartier général des forces de la République de Corée du Việt Nam, qui y sont restés jusqu’à la signature des accords de paix de Paris en 1973.
[fig. 31 et 32 : Ces photographies présentent un bâtiment de style colonial français,. On y voit, sur la première photographie, des pancartes identifiant le U.S. Military Assistance Advisory Group et surmonté de nombreuses antennes. En premier plan, une voiture, d’un modèle américain importé, est garée, et l’entrée est protégée par une clôture. Le bâtiment s’impose par sa taille et sa position centrale. Ses ajouts technologiques et la clôture le distinguent de l’environnement urbain, soulignant sa fonction spécifique. La présence d’une voiture occidentale au premier plan déploit également une présence américaine sur le territoire.
L’architecture coloniale est transformée en un symbole de la nouvelle puissance impériale américaine par l’ajout des antennes, de signalisations militaires et du drapeau américain. Le bâtiment devient une archive vivante de la transition du pouvoir, où les structures du passé sont réappropriées pour servir les besoins technologiques et stratégiques du présent. De ce fait, l’image témoigne également de l’escalade militaire américaine au Viet Nam*, avant le déploiement massif de troupes. Le bâtiment, siège du MAAG, est une incarnation de la présence naissante des États-Unis d'Amérique et de l’intégration de leur aide militaire dans le tissu social de Sài Gòn.
La deuxième photographie, elle, montre l’entrée du complexe, désormais sous contrôle coréen. Le premier plan est dominé par un poste de garde en sacs de sable, une
fig. 31 : auteur·ice inconnue, 606 Trần Hưng Đạo , 1963

fig. 32 : auteur·ice inconnue, 606 Trần Hưng Đạo , fin des années 60
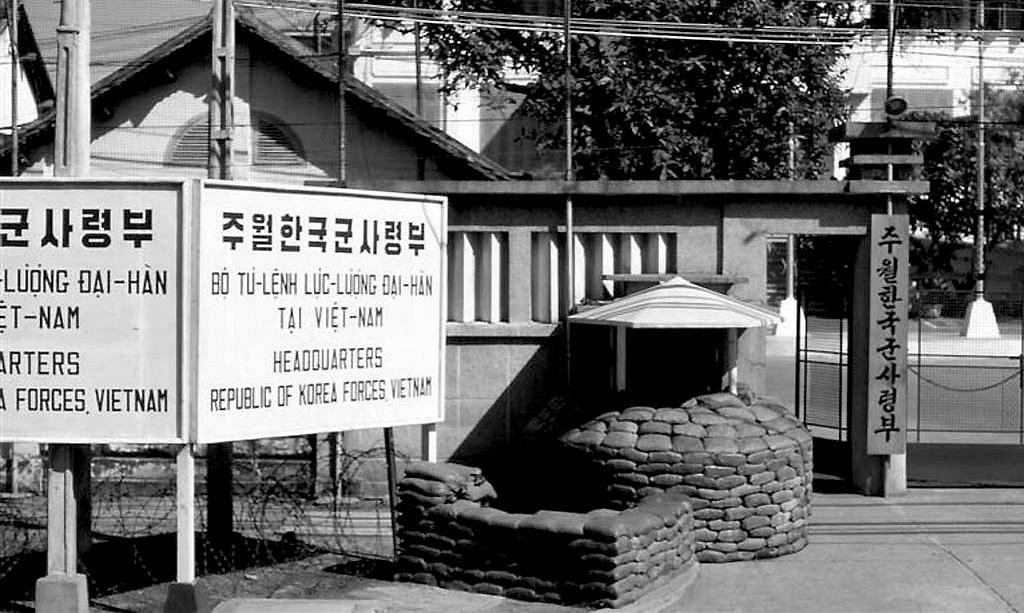
guérite et une clôture surmontée de barbelés. Deux grands panneaux trilingues (coréen, vietnamien, anglais) identifient les lieux, et des bâtiments traditionnels sont visibles à l’arrière-plan. La composition souligne la séparation entre l’extérieur et l’intérieur. Les dispositifs de sécurité créent une barrière physique et symbolique entre le personnel de la base et la ville. Cet agencement souligne la nature de l’installation : une enclave militaire étrangère. La juxtaposition d’une architecture avec des éléments militaires temporaires (sacs de sable) symbolise la nature transitoire et conflictuelle de l’occupation. La signalisation multilingue est l’élément le plus symbolique, car elle représente l’alliance internationale et l’internationalisation de la guerre du Viet Nam*. Cette image est une archive visuelle de l’alliance militaire coréenne avec les États-Unis d'Amérique, un aspect souvent oublié du conflit. Elle témoigne de l’internationalisation de la guerre et montre comment Sài Gòn était un carrefour pour les forces de plusieurs nations, illustrant la complexité et l’ampleur du conflit.]
Cette occupation, pouvant certes relever d’une logique pragmatique d’utilisation de l’existant, traduit aussi une continuité symbolique : la reprise de lieux marqués par l’autorité coloniale afin d’y installer une nouvelle puissance étrangère. On soutient ici que ces espaces deviennent alors des supports matériels d’un transfert de domination, où l’architecture coloniale se voit investie de nouvelles fonctions militaires, diplomatiques ou logistiques. Leur réaffectation révèle une double dynamique : d’une part, une rationalité opérationnelle liée à la guerre, d’autre part, un geste politique qui inscrit la présence américaine dans la filiation directe de la colonisation française.
Ce processus illustre parfaitement la manière dont les acteur·ices extérieur·es peuvent à la fois reproduire et reconfigurer un héritage spatial colonial, en mêlant continuité fonctionnelle et innovation stratégique, tout en transformant la ville en un instrument de contrôle et de représentation. La question de la réutilisation des bâtiments coloniaux par une nouvelle puissance impériale, comme les États-Unis d'Amérique, est très intéressante. Bien que les recherches se concentrent peu sur des exemples précis où l’armée américaine s’installerait dans d’anciens bâtiments coloniaux
pour des raisons postcoloniales, la thèse d’une continuité de l’impérialisme pourrait s’avérer pertinente à un niveau stratégique plus large. Le cas de la base américaine de Camp Lemonnier à Djibouti est éloquent. Ancienne colonie française, Djibouti accueille aujourd’hui la plus grande base militaire américaine en Afrique. De même, au Maroc, les installations militaires américaines subsistent maintenant une présence stratégique après le départ de l’ancienne puissance coloniale française [BUREAU OF INTELLIGENCE AND RESEARCH 1970]. Cette situation montre que même en l’absence de réoccupation directe d’un édifice spécifique, la fonction impériale d’un territoire peut être transmise d’une puissance hégémonique à une autre. La présence militaire stratégique, initialement établie par une puissance coloniale (la France), est continuée par une nouvelle (les États-Unis d'Amérique) dans le même lieu géopolitique, renforçant ainsi un « hyper-impérialisme » contemporain, empruntant le terme à Gisela Cernadas, Mikaela Nhondo Erskog, Tica Moreno et Deborah Veneziale [2024], où la puissance des États-Unis est inégalée en termes de dépenses militaires et de déploiement mondial de bases. Cette succession de l’emprise militaire dans des territoires postcoloniaux représente une continuité fonctionnelle de l’impérialisme, où les infrastructures et l’emplacement stratégique hérités du passé sont réinvestis pour de nouvelles ambitions de contrôle global.
L’urbanisme développé par l’occupation française s’est bel et bien appuyer sur une politique de destruction et d’« européanisation », qui répond à une politique fondée sur la glorification du pouvoir de l’occupant et la démonstration de sa supériorité.
De ce fait, le propos ici soutenu met en exergue le fait que le réemploi des bâtiments coloniaux n’est jamais un acte neutre. Il s’inscrit dans un spectre de significations qui reflètent les dynamiques de pouvoir, de mémoire et d’économie du monde postcolonial. De la continuité militaire à la réappropriation symbolique, chaque cas révèle des enjeux profonds. Par exemple, les anciens hôtels « de prestige » de Sài Gòn, hérités de la période coloniale française, constituent des
témoins privilégiés des dynamiques de réappropriation et de redéfinition symbolique qui ont marqué l’histoire urbaine du Việt Nam. Conçus à l’origine pour incarner la présence et l’influence française en « Indochine », ces édifices n’ont pas seulement survécu aux bouleversements politiques du XXe siècle : ils ont été investis de nouvelles significations, intégrés aux politiques urbaines et au récit national. Le Rex, hôtel emblématique, est devenu un repère historique.
Érigé en 1927 par l’homme d’affaires français M. Bainier, l’édifice servait initialement de concession automobile et de garage, sous l’appellation « Auto Hall Bainier ». On y commercialisait des véhicules Citroën ainsi que d’autres grandes marques européennes. En 1959, M. et Mme Ung Thi* entreprennent une rénovation majeure du bâtiment, transformant celui-ci en le Complexe Rex [LA VIE A SÀI GÒN 2012]. L’établissement comprend alors trois salles de cinéma, une cafétéria, une salle de danse ainsi qu’une bibliothèque, offrant un espace multifonctionnel dédié aux loisirs et à la culture. Durant la guerre du Việt Nam, l’intégralité de l’hôtel est louée par le Service d’Information des forces américaines, qui y installe ses bureaux. Le Rex acquiert une notoriété particulière en accueillant la conférence de presse quotidienne du commandement militaire américain, surnommée par les journalistes « The Five O’Clock Follies » (le « délire de 17 h »), en raison de l’optimisme jugé excessif des responsables militaires. Jusqu’en 1964, il a donc non seulement abrité les bureaux de l’USIS et la bibliothèque Abraham Lincoln, mais a également fourni un hébergement à l’hôtel à de nombreux conseillers militaires américains. Le bar situé sur le toit de l’établissement constitue, par ailleurs, un lieu de rencontre emblématique pour les officiers et les correspondants de guerre. Le Caravelle, lui, inauguré en 1959, suit un parcours analogue. Devenu l’auberge de choix pour les médias américains à la fin des années 1960, il abritait les bureaux à Sài Gòn de nombreuses agences de presse américaines, dont NBC, ABC, CBS, le Washington Post et le New York Times, tandis que son bar sur le toit (aujourd’hui Sài Gòn Sài Gòn Bar) est
fig. 33 : auteur·ice inconnue, [ façade de l'hôtel Rex ] , 1965

fig. 34 : auteur·ice inconnue, [ façade de l'hôtel Caravelle ] , 1959

devenu un « club de presse » non officiel dans lequel des journalistes tels que Walter Cronkite, Neil Sheehan et Peter Arnett se retiraient le soir. Destiné initialement à offrir aux voyageur·ses européen·nes un cadre luxueux et familier dans un environnement tropical, ces édifices devinrent rapidement des espaces de sociabilité cosmopolite où se croisaient journalistes, écrivains, diplomates et figures politiques étrangères. Lieu de mondanités mais aussi de débats, ils ont participé à la fabrique symbolique de la ville (néo)coloniale.
[fig. 35 : Cette photographie en couleur, prise entre 1966 et 1967, montre un grand groupe de personnes, sûrement des militaires, réunis sur une terrasse couverte. Nous n’apercevons que des hommes blancs, assis à des tables rondes en métal, vêtus de chemises décontractées, et certains ont des boissons et des cigarettes. L’éclairage tamisé, probablement en fin de journée, crée une atmosphère de club privé. L’image est prise depuis le fond de la pièce, capturant les visages et les conversations.
L’espace est aménagé pour le loisir et la convivialité. Les tables et les chaises sont agencées en créant un espace collectif où les personnes peuvent se regrouper et interagir.
Cette organisation crée un cocon social qui isole les occupants de l’environnement extérieur. L’image met l’accent sur la vie interne de la base, montrant comment les individus recréent un environnement familier et sécurisant à l’intérieur d’un territoire étranger, illustrant la manière avec laquelle un espace peut être transformé pour servir les besoins d’une puissance étrangère.
Le Rex, à l’origine un complexe commercial et de divertissement, a été réquisitionné pour loger les officiers américains. C’est un symbole de l’appropriation des infrastructures locales à des fins militaires. Le mobilier simple et fonctionnel, ainsi que l’ambiance décontractée, contrastent avec la violence de la guerre. Cette image incarne une facette de l’impérialisme quotidien, qui ne se manifeste pas seulement par la force militaire, mais aussi par la création de zones de confort pour les forces d’occupation. Cette photographie est une archive visuelle de l’infrastructure sociale de la présence américaine à Saï Gon. Elle montre que la guerre n’était pas seulement une affaire de combat, mais aussi de gestion de la vie quotidienne et du moral des troupes. Le Rex BOQ devient un symbole de la manière dont l’impérialisme américain a reproduit son propre mode de vie dans un contexte étranger, créant des espaces de vie sociale qui séparent et protègent les occupants de la réalité du conflit. C’est un document qui témoigne de la dimension sociale et humaine de l’occupation, une facette souvent négligée au profit des scènes de combat.]
fig. 35 : capt. ted r. snediker/the snediker family, Rex BOQ Sunday after work, Sài Gòn , 1966-1967

La présence américaine et son impérialisme ont impliqué, en parallèle des dynamiques évoquées précédemment, la construction et le suivi de programmes de logements bien particuliers. En plus de la nécessité de devoir loger les Américain·es, la ville de Sài Gòn, a aussi subi un taux d’immigration très important en très peu d’années. En cela, le gouvernement sud-vietnamien, toujours sous perfusion économique américaine, a entrepris la construction à la fois d’immeubles de logements mais aussi la création ou la restructuration de zones urbaines et rurales entières.
L’aide au logement constituait un instrument de diplomatie particulièrement stratégique. À la suite de la Révolution cubaine de 1959 par exemple, le président John F. Kennedy lança l’Alliance pour le Progrès, vaste programme d’aide économique et sociale en Amérique latine, intégrant des initiatives de logement [RABE 2016]. L’objectif déclaré était de contrer l’influence du communisme en améliorant les conditions de vie et en promouvant un modèle de développement capitaliste et modernisateur.
Le Housing Investment Guaranty Program, créé par l’USAID en 1961, a joué un rôle central dans cette politique du sud-Việt Nam. Plutôt que de construire directement des logements, ce programme garantissait des prêts privés destinés à financer des projets résidentiels dans les pays en développement. L’ambition était de stimuler le secteur privé local, en facilitant l’accès au crédit et à la propriété, et de favoriser l’implantation de normes américaines de construction et d’organisation urbaine.
Les projets de logement financés par les États-Unis ont en fait fréquemment inspirés par le modèle suburbain américain, que ce soit au Chili, en Iran ou encore au Pérou. Ces ensembles visaient à diffuser le « rêve américain » d’accession à la propriété, en conjuguant architecture standardisée et urbanisme rationnel, tout en inscrivant les habitant·es dans un modèle de consommation et de vie domestique directement inspiré des États-Unis [RENNER 2010].
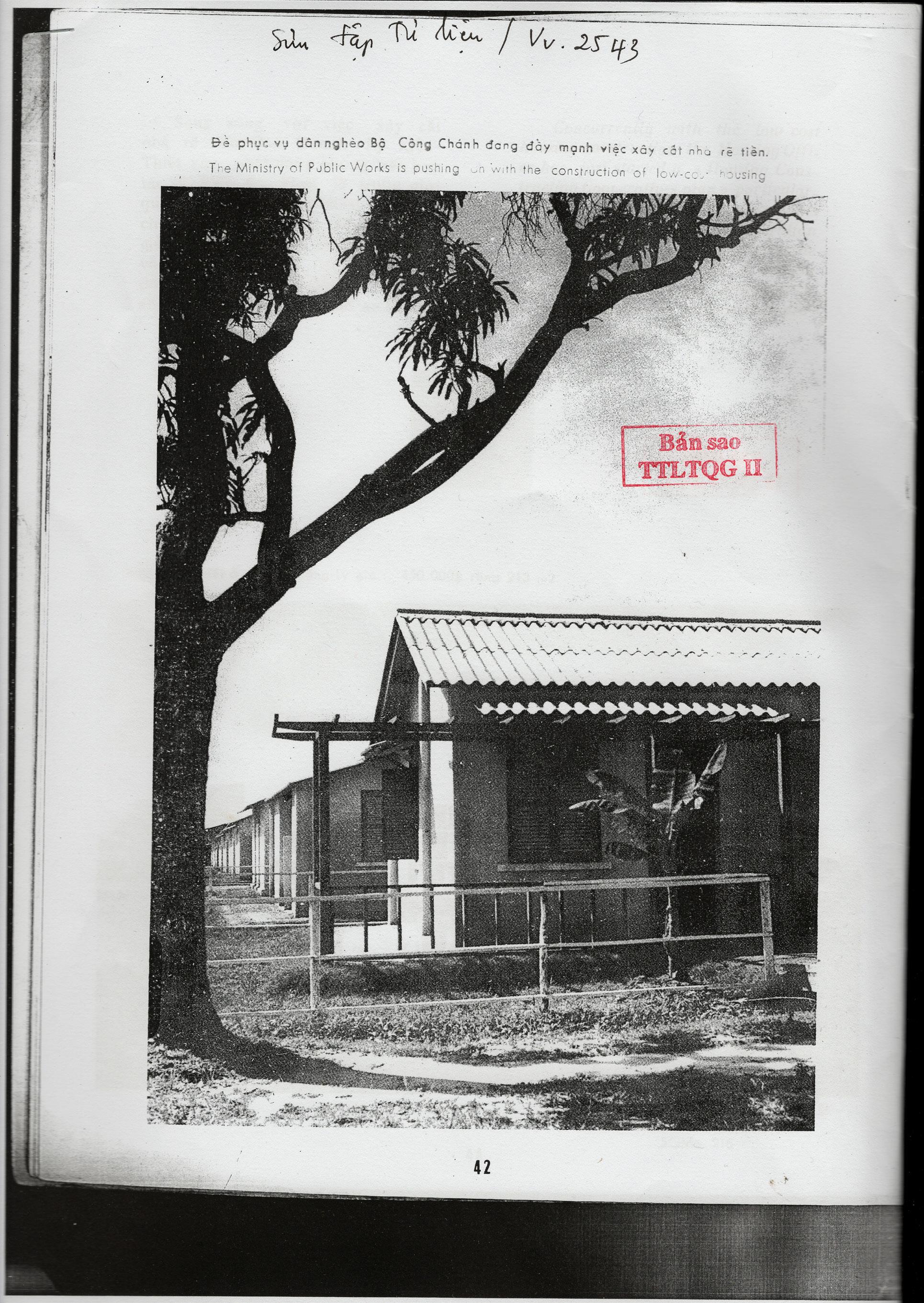
fig. 36 : ministère des travaux public du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
« le ministère de la Défense, y compris l’armée, a dû naviguer dans un réseau complexe d’exigences et de programmes pour répondre aux besoins en logements familiaux pendant la guerre du Vietnam. Tout d’abord, les planificateurs militaires ont évalué la capacité du secteur civil à servir de source principale de logements familiaux. Ce n’est qu’après avoir recensé les logements disponibles dans le secteur privé local, combiné à l’analyse des effectifs actuels et prévus et des niveaux de logement actuels sur place, que l’armée autorisait la construction de nouveaux logements sur place en se basant sur une détermination de l’insuffisance des logements disponibles. En collaboration avec la Federal Housing Administration, l’armée a cherché à inciter les constructeurs du secteur privé à construire des logements abordables pour les militaires du rang et les officiers subalternes. Un certain nombre de programmes ont été mis en place pour encourager la construction de logements par le secteur privé. [...] Le programme de logement familial de l’armée a fonctionné avec un déficit permanent pendant cette période, et ce pour plusieurs raisons. Le secteur civil n’était pas en mesure de fournir un nombre suffisant de logements et l’armée n’était pas en mesure d’obtenir les fonds nécessaires pour soutenir la construction de nouveaux logements. Souvent, l’armée ne parvenait pas à combler l’écart entre la demande de logements et le nombre de logements autorisés, financés et construits »
[US ARMY 2022, 3]
Afin de répondre à la pénurie chronique de logements, l’Office du logement a réorienté sa politique en abandonnant la construction de logements à loyers élevés au profit d’habitations sociales accessibles aux ménages les plus modestes, dont le coût est plafonné entre 30 000 et 40 000 VN$. Plus de 2 000 unités ont ainsi été programmées dans différentes provinces, dont plus de 500 déjà livrées à Sài Gòn (Tân-qui Đông, Vĩnh-Hôi, Phú Thọ-Hòa), tandis qu’un fonds de plus de 300 millions de VN$ a été alloué à la mise en œuvre du programme annuel. Dans le même temps, des infrastructures ont été aménagées sur plus de 50 acres de terrains à Thạnh-MỹTây et Thanh Da, et 40 acres supplémentaires ont été acquis afin de permettre l’auto-construction. Parallèlement, un « plan de coopératives de construction » a été lancé pour associer civil·es, fonctionnaires et militaires à l’effort de relogement, avec le soutien d’un fonds initial de 300 millions de VN. Dans
la continuité du programme de 1965, plusieurs réalisations notables ont vu le jour : 220 logements jumelés au centre de réinsertion de Tân-qui Đông (sur 440 prévus), 108 logements populaires à Phú Thọ Hòa, 84 appartements au 56 Chi Hỏa et un logement collectif à Vĩnh-Hôi [ARCHIVES DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DU VIỆT NAM]. Dans les capitales provinciales et les zones rurales, l’État a également entrepris l’édification de près de 800 logements, de 56 salles de classe, de 12 dispensaires et maternités, ainsi que de 26 bâtiments administratifs, en plus de divers équipements communautaires (centres d’accueil, écoles, logements collectifs). Enfin, un plan de construction de 1 000 logements supplémentaires avait été commandé, avec une priorité accordée aux zones placées sous contrôle gouvernemental, illustrant la volonté de combiner urbanisation planifiée, redistribution sociale et consolidation territoriale [ARCHIVES DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DU VIỆT NAM]. Cette recherche de construction rapide et bas de gamme est une conséquence directe à la fois des destructions de la guerre, des migrations qui en découlent tout en mettant en exergue les immenses investissements américains associés.
[fig. 37 et 38 : L’image est structurée par une forte répétition de motifs. Les maisons, de conception similaire, sont disposées en rangée. Les espaces entre chaque maison sont réguliers, renforçant l’idée d’une organisation rigide et préconçue. Un véhicule et une figure humaine isolée parcourent la rue. L’ensemble est ordonné, fonctionnel.
L’architecture de ces maisons est simple et moderniste, caractérisée par des lignes épurées, des toits plats ou à faible pente et des matériaux sûrement préfabriqués.
Ces éléments évoquent un design typiquement européen du milieu du XXe siècle, souvent associé au progrès, à l’efficacité et à l’hygiène. Ces maisons ne sont pas le résultat d’une croissance organique, mais d’un projet de développement de masse. Elles symbolisent un nouveau mode de vie, standardisé et rationnel, qui rompt avec les habitats traditionnels. Ce type de construction incarne l’idéologie de la modernité imposée.
Cette photographie est une archive qui documente une stratégie de développement urbain liée à des enjeux géopolitiques. Ces logements n’ont pas été construits pour s’adapter à la vie quotidienne existante, mais pour y substituer un nouvel ordre. Ils peuvent symboliser les efforts des puissances néocoloniales ou de leurs successeurs
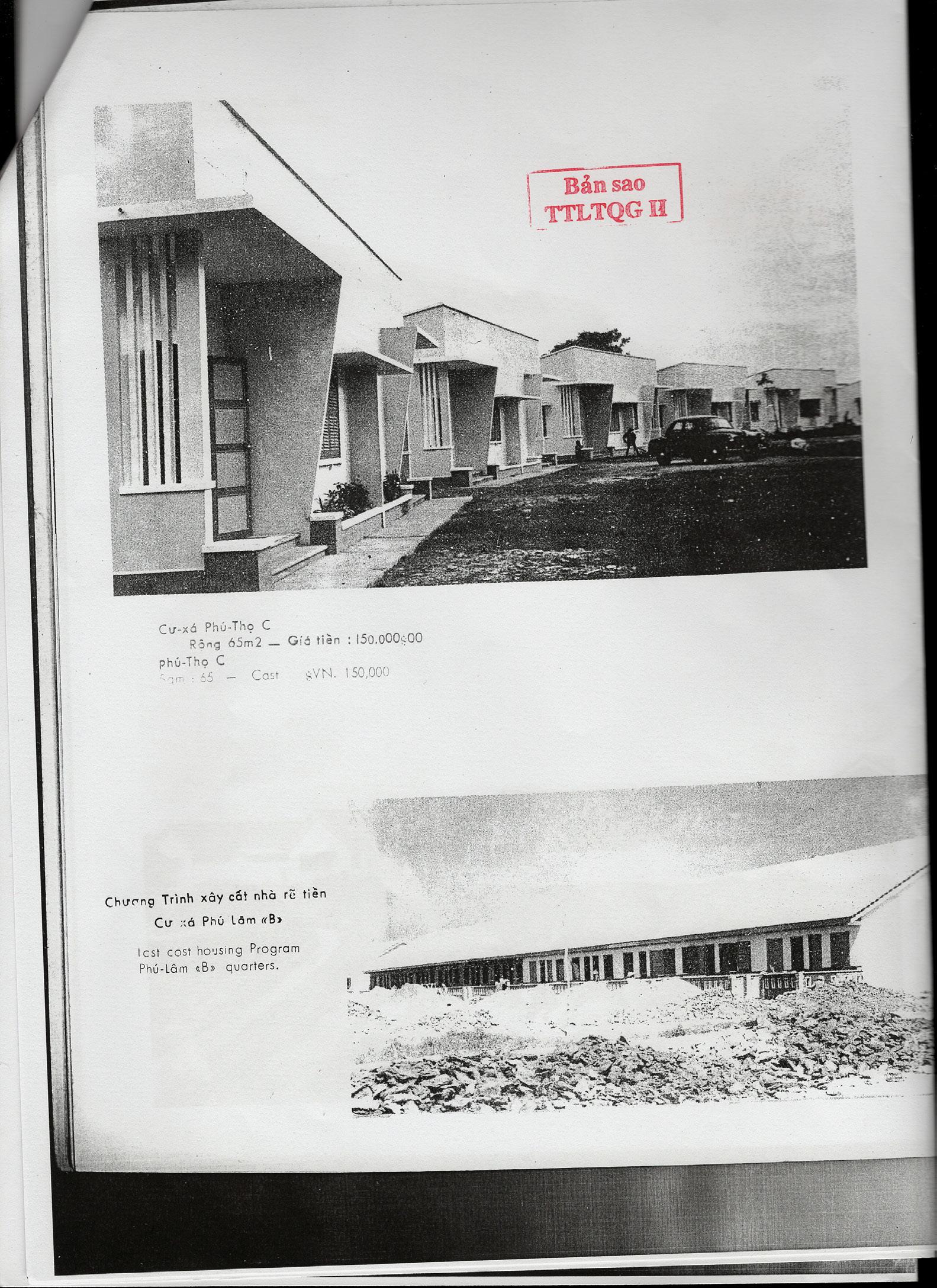
fig. 37 : ministère des travaux public du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
pour modeler la société à travers l’urbanisme, en imposant de nouvelles normes de vie et de nouvelles formes d’habitat. L’image révèle ainsi la tension entre le projet de modernisation et la réalité culturelle et sociale de la ville, marquant la création d’une nouvelle strate urbaine qui se superpose au paysage.
Cette seconde photographie, aérienne, présente un quartier résidentiel de Sài Gòn* dont la structure est rigoureusement ordonnée. La vue plongeante met en évidence une forte répétition de motifs, où des rangées de logements identiques ou très similaires s’étendent sur une vaste zone. L’image est une archive qui documente un projet d’urbanisme à grande échelle, contrastant avec l’irrégularité des quartiers voisins, à droite du document.
L’organisation de l’espace est dominée par un quadrillage strict et une disposition en rangées. Les bâtiments sont alignés de manière répétitive le long d’axes parallèles, créant une structure urbaine rigide et géométrique. Les rues, bien que non clairement visibles, semblent desservir chaque rangée de manière systématique.
Les espaces entre les bâtiments sont minimes, ce qui donne une impression de forte densité, mais cette densité semble être le résultat d’une planification et non d’une croissance organique.
Les bâtiments sont des unités standardisées, caractérisées par un design simple et fonctionnel. Cette uniformité architecturale est hautement symbolique. Elle évoque un projet de modernisation et de rationalisation du logement de masse. La répétition des formes et des toits suggère que ces habitations ont été produites en série pour répondre à un besoin d’efficacité et d’économie. Ces logements ne sont pas construits pour refléter une identité individuelle, mais pour incarner un idéal de vie standardisée et moderne.
Cette image est une archive visuelle d’une forme d’ingénierie sociale et urbaine.
La création de tels quartiers est souvent liée à des politiques gouvernementales visant à gérer la croissance démographique, à loger des réfugiés ou à moderniser la ville. La planification stricte de ces logements pourrait refléter une approche « top-down » où le pouvoir cherche à organiser non seulement l’espace, mais aussi la vie des habitant·es. La photographie témoigne de la création d’une strate urbaine nouvelle, qui s’ajoute au paysage existant de Sài Gòn* et reflète les aspirations d’ordre, de contrôle et de modernisation de l’époque.]
À la fin du conflit, les programmes de construction connaissent une nouvelle phase d’expansion, conçue pour renforcer la résilience du Sud-Việt Nam et soutenir son effort de guerre tout en dynamisant l’économie. Une politique résidentielle

fig. 38 : ministère des travaux publics du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
à visée militaire est donc mise en œuvre par les États-Unis d'Amérique, qui financent la construction de logements pour environ 450 000 soldats sud-vietnamiens et leurs familles. Ces initiatives visent explicitement à améliorer les conditions de vie des militaires, à accroître leur moral et, ce faisant, à consolider les capacités opérationnelles de l’armée vietnamienne. Les archives nationales vietnamiennes permettent alors également de mettre en évidence l’intégration des programmes de logement dans une politique plus large de travaux publics au début des années 1970. En 1972, l’Inspection générale des travaux publics et le Département de la planification et de la recherche soulignent l’importance de coupler la rénovation des infrastructures de transport (routes, voies aériennes) avec une politique de construction résidentielle d’ampleur. Les objectifs portent sur l’édification de près de 2 659 logements dans de grands ensembles urbains tels que Thanh Đa, Nguyễn Văn Thoại, Lý Văn Phức ou Cầu Chữ Y, auxquels s’ajoutent environ 1 737 unités en province, ainsi que 500 logements supplémentaires projetés dans la zone de Thủ Thiêm, conditionnés à l’obtention d’une aide étrangère, principalement américaine [ARCHIVES NATIONALES DU VIỆT NAM II]. En 1973, dans le cadre du Plan quadriennal (1972-1975), le ministère des Travaux Publics réaffirme cette orientation, tout en l’adaptant aux conséquences directes du conflit. Le programme inclut la construction de plus de 10 000 abris temporaires pour les victimes de guerre, la réalisation de 500 logements à Thủ Thiêm et Rạch Ông (si financés), et de 2 000 unités supplémentaires dans les zones résidentielles déjà ciblées (Thanh Đa, Nguyễn Văn Thoại, Lý Văn Phức ou Cầu Chữ Y) ainsi qu’en province. Ces opérations sont accompagnées d’investissements massifs dans les infrastructures d’eau et d’assainissement, indispensables à la viabilité de ces nouveaux quartiers [ARCHIVES NATIONALES DU VIỆT NAM II]. Ces documents issus des archives nationales de l’Inspection générale des travaux publics et du Département de la planification et de la recherche illustrent comment, au début des années 1970, les programmes de logement étaient pensés non seulement comme une réponse
sociale et humanitaire à la crise urbaine et aux destructions de guerre, mais aussi comme une composante d’une stratégie plus large de modernisation urbaine et de consolidation de l’autorité gouvernementale, fortement dépendante du soutien financier et technique des États-Unis d'Amérique.
En ce sens, les programmes de logement financés par ces derniers dans des contextes postcoloniaux, notamment via l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), peuvent être perçus non seulement comme des instruments d’assistance, mais également comme des vecteurs de projection de la puissance américaine et de diffusion de son modèle socio-économique. Ces initiatives ne se limitaient pas à la simple fourniture d’un abri ; elles véhiculaient des idéologies liées à la propriété privée, à l’urbanisme et au développement économique, contribuant parfois à reproduire des inégalités ou à modifier profondément les structures sociales locales. Dans un document intitulé « L’Association vietnamienneaméricaine pour le soutien du peuple à la construction de maisons bon marché », on peut notamment y lire :
« L’Association d’entraide entre les peuples vietnamien et américain a pour objectif de financer un programme de logement abordable pour aider les Vietnamiens à accéder à des logements salubres, améliorant ainsi leurs conditions de vie et contribuant positivement à la lutte contre le communisme.
La contribution du gouvernement vietnamien sera démontrée en veillant à ce que le capital investi dans ce programme ne soit pas nationalisé. Ce programme contribuera à la victoire et aura un effet de propagande positif sur le peuple vietnamien, l’aidant à prendre conscience de l’aide nécessaire du gouvernement américain pour améliorer ses conditions de vie, corrigeant ainsi la propagande communiste selon laquelle les Américains seraient venus ici pour faire la guerre au peuple vietnamien. De plus, le parrainage de ce programme aura un impact psychologique considérable sur le peuple et l’armée vietnamienne. Le soutien du gouvernement américain sera perçu par le peuple et l’armée vietnamienne comme un engagement et une détermination à rester sur cette terre, avantposte du monde libre, à aider le peuple vietnamien à protéger son indépendance et sa liberté en particulier, et à lutter contre la propagation du communisme dans le monde en général. Par conséquent, le parrainage et l’encouragement du programme d’aide
interpersonnelle par le gouvernement américain sont une excellente politique. [...]
Le programme sera financé par des associations bancaires privées américaines, par l’intermédiaire de l’Association d’entraide populaire Vietnam-Amérique. [...] le financement du programme sera assuré par un accord de prêt entre l’American Private Bankers Association et le gouvernement vietnamien. [...]
L’agencement et le prix d’une maison dépendent du type de personne qui sera le futur propriétaire de la maison »
[fig. 39 : Cette photographie en couleur, prise depuis le niveau de l’eau, présente un long bâtiment en construction, s’étendant horizontalement le long d’une berge. Le ciel est clair, et le soleil illumine la structure de béton brut. Des échafaudages sont encore visibles sur le toit et sur les façades. Le bâtiment, en grande partie ouvert, révèle ses étages et ses nombreuses ouvertures de fenêtres. La structure contraste fortement avec la végétation et la large étendue d’eau au premier plan. L’image est dominée par la structure massive du bâtiment, qui s’allonge en une ligne droite, imposant une géométrie rigide au paysage. Cette horizontalité s’étend sur le bord de l’eau, suggèrant une nouvelle forme de rapport au milieu naturel, où la construction planifiée et de grande échelle se confronte aux rives. Sa disposition en enfilade, avec la répétition des ouvertures de fenêtres, renforce l’idée d’un projet de logement de masse, conçu pour accueillir un grand nombre de personnes de manière standardisée.
Le bâtiment, dans son état inachevé, est un symbole puissant. Le béton exposé et la répétition rythmée des éléments architecturaux évoquent un modernisme et un fonctionnalisme occidentaux, idéologies architecturales axées sur la production de masse et l’efficacité. Dès lors, le projet veut représenter une vision de l’avenir pour Sài Gòn*, axée sur la modernisation et la résolution de la crise du logement par des solutions industrielles.
Cette archive visuelle documente les efforts pour transformer la ville face à une croissance démographique explosive, en partie due à l’afflux de réfugié·es de guerre. La construction d’un tel complexe de logements de masse reflète une réponse politique à la crise du logement, mais elle pourrait aussi s’inscrire dans une logique de remodelage social. On pourrait suggérer un encadrement des populations dans de nouveaux environnements contrôlés, reflétant l’influence de l’urbanisme moderniste occidental. Cette image est un témoignage d’une strate urbaine qui se superpose au paysage, créant une tension certaine.]

fig. 39 : mel schenk, thanh đa housing , 1972
En même temps que ces différents projets pavillonnaires, le gouvernement vietnamien construisait des logements dans ce qui était alors la banlieue. Face à une énorme pénurie de logements dûs aux migrations intensives causées par le conflit, il est par exemple convenu d’ériger le complexe d’appartements Thanh Đa à seulement 5 km du centre de la ville. Tout le quartier occupe une superficie d’environ 55 hectares, tandis que le groupe d’appartements en occupe environ 36. Selon le comité populaire du district de Bình Thạnh, le complexe d’appartements de 23 lots a été construit en 1972. En 1972, le projet résidentiel a été lancé avec une planification méthodique rare, calqué sur un modèle urbain dit « moderne » : des appartements au sein d’une densité de construction qui n’atteint que les 30 à 40 %. Le reste devait être un espace ouvert, pour que les gens vivent avec le vent, la lumière et les sentiers de promenade autour du bâti. À l’époque, le projet était considéré comme le plus grand lotissement résidentiel du pays. Toute la zone était planifiée avec un système de circulation interne complet, des écoles, des postes médicaux, des administrations, des commerces et des services, des parcs verts... En raison du manque d’attention et de gestion, la zone résidentielle a été déformée par rapport à l’objectif initial [THANH et al. 2019]. Le projet de Thanh Đa, destiné à une élite gouvernementale, et bien que l’aide du gouvernement américain ne soit pas écrite noir sur blanc, s’inscrit dans des contextes de construction mettant en œuvre d’importantes sommes d’investissements, principalement américain [THUẬN 2013]. Si l’on tend à reconnaître une autonomie vietnamienne certaine sur certains projets civils et sur certains développements stylistiques architecturaux, il est aussi important de faire état de ce qui a pu être à l’origine de certains projets de construction à savoir, des pénuries de logements bel et bien causées par les migrations massives. On ne parle alors peut-être pas d’impérialisme direct mais l’influence des présences américaines semble présente, se matérialisant ici, admettons, à travers une conséquence indirecte. De ce fait, l’apparition de tels projets impacte de manière non négligeable la mise en œuvre de
méthodes constructives bien spécifiques, le paysage régional et l’organisation urbaine.
L’introduction de modèles de logement occidentaux au sud-Việt Nam a fréquemment ignoré les spécificités culturelles, les techniques de construction traditionnelles et les modes de vie locaux, menaçant ainsi la durabilité et l’habitabilité des projets. De surcroît, bien que certains programmes cherchaient peut-être à « améliorer les conditions de vie », ils ont parfois déclenché des dynamiques de déplacement et de gentrification, en augmentant la valeur foncière et en rendant les zones adjacentes inabordables pour les populations à faible revenu. Parallèlement, l’objectif de ces initiatives ne se limitait pas à la seule résolution des crises de logement ; elles ont également servi à intégrer les marchés immobiliers locaux dans l’économie mondiale en favorisant les investissements d’entreprises de construction et d’institutions financières internationales. Cette dimension économique a soulevé des questions sur l’impérialisme économique, où l’aide au logement devient un instrument au service des intérêts financiers des nations donatrices.
Par ailleurs, cela révèle une distinction cruciale entre les stratégies urbaines des deux parties. L’influence américaine sur le paysage urbain de Sài Gòn, a été d’une nature caractérisée par un paradoxe : les millions de dollars investis dans la ville afin de servir la machine de guerre faisaient face à la majorité de la population de la ville qui vivait dans des habitats autoconstruits le long des berges de la rivière. Le choix réfléchi des investissements est une illustration frappante de la priorisation militaire de l’aide américaine, qui a conduit à la construction et à la militarisation de l’environnement physique du pays, tout en ne répondant pas forcément aux besoins fondamentaux de la population urbaine en matière de logement.
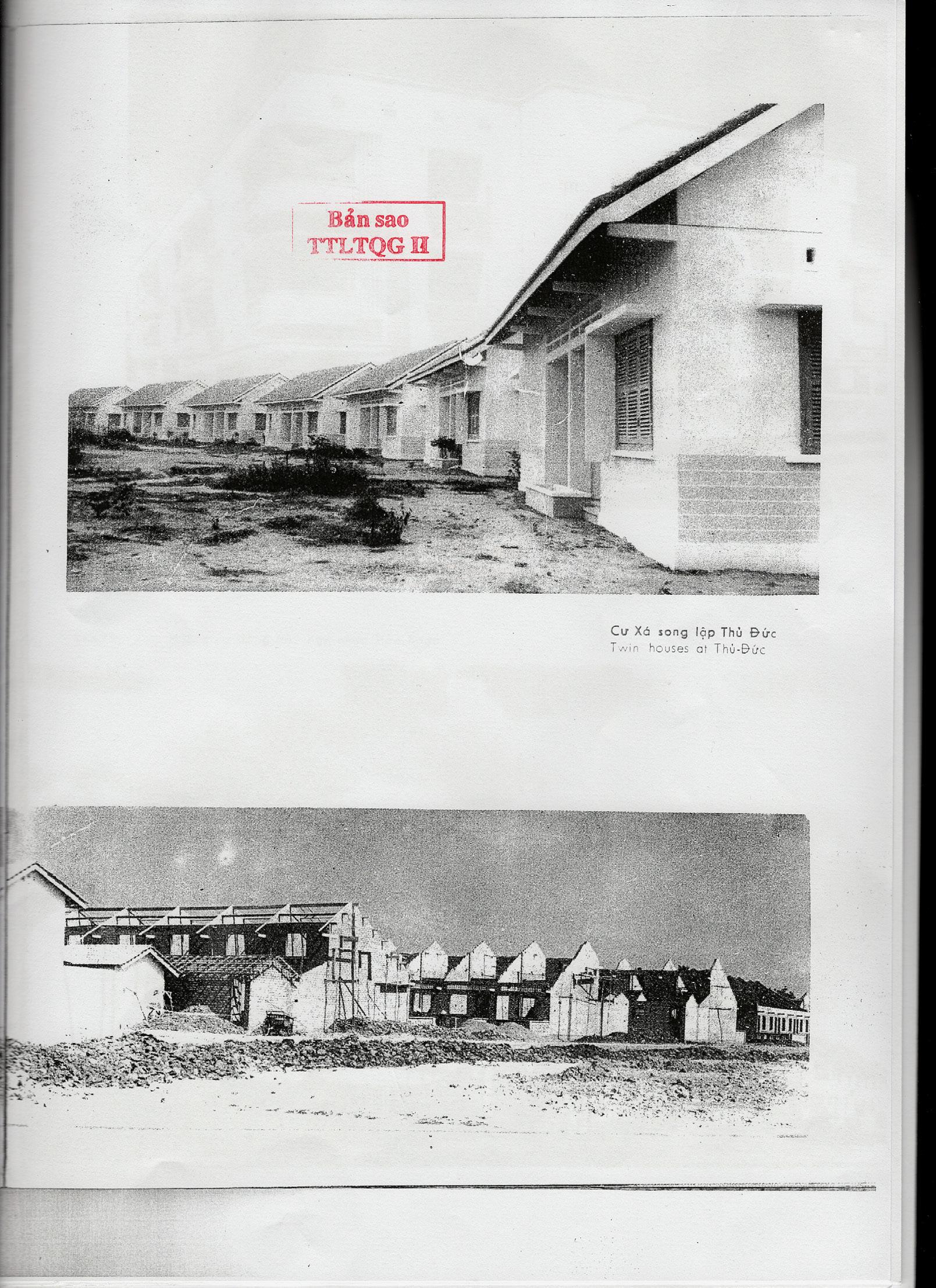
fig. 40 : ministère des travaux public du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
fig. 41 : ministère des travaux public du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
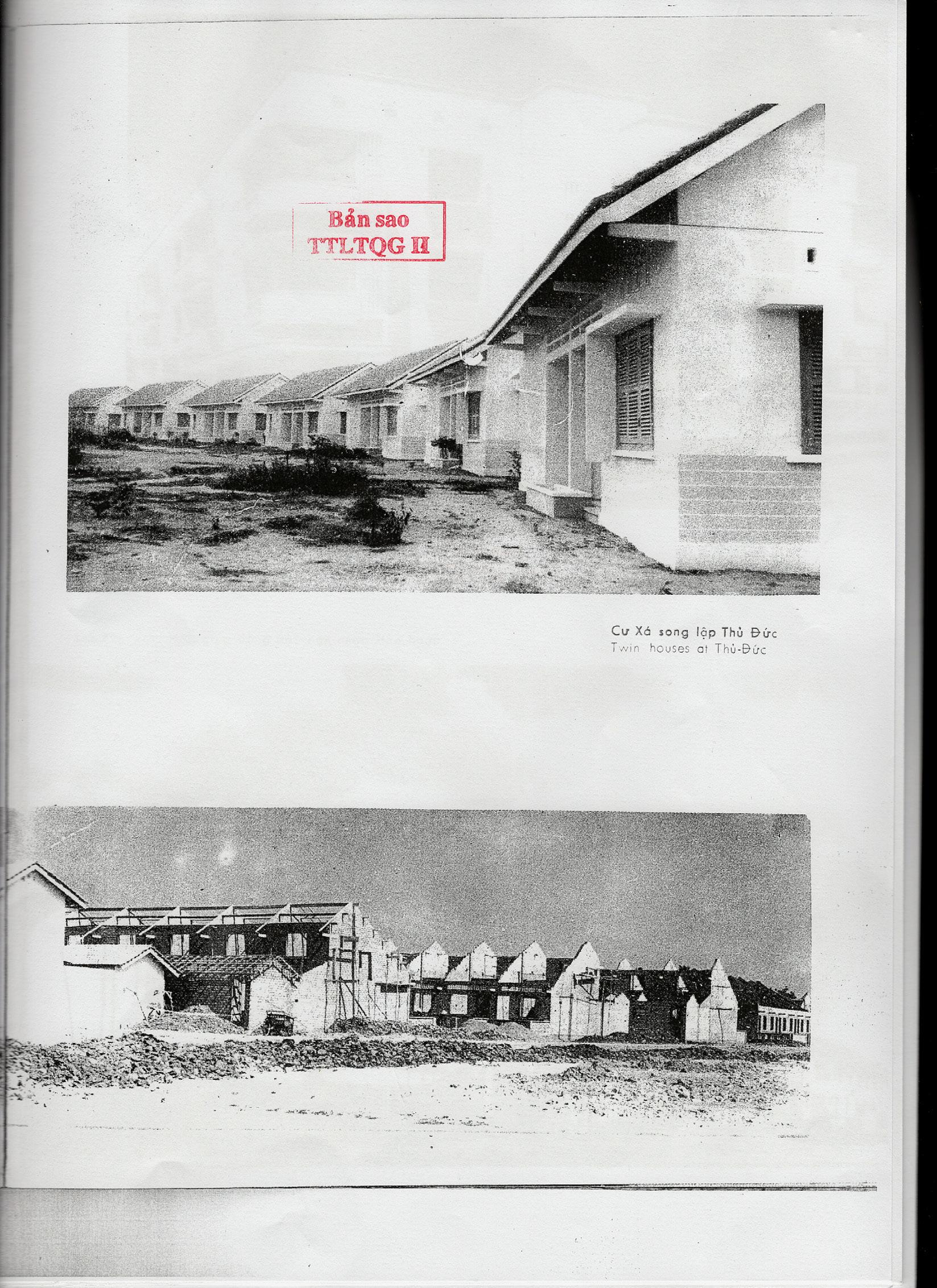
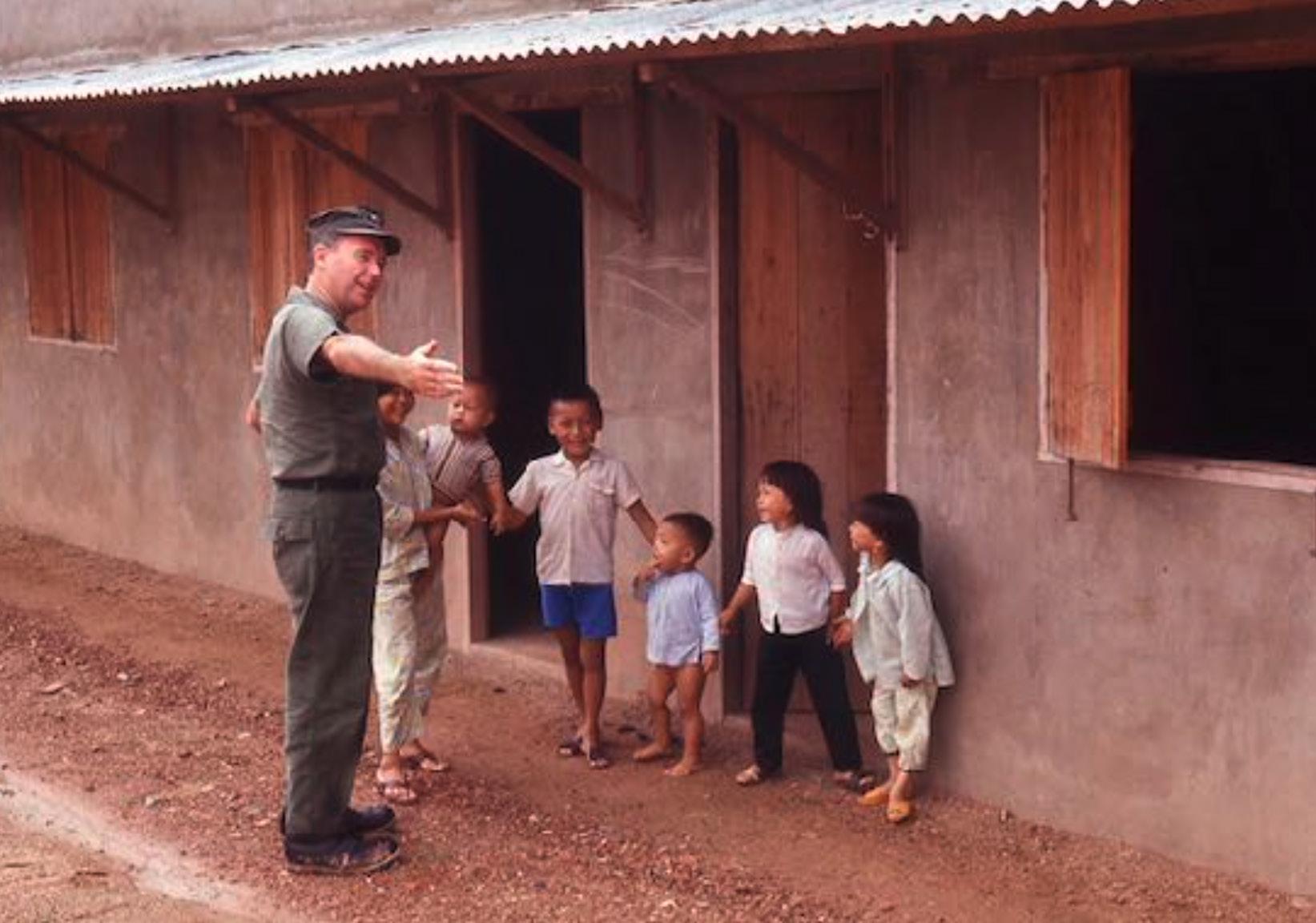
fig. 42 : mel schenk, commander belton at long binh housing , 1970-1972
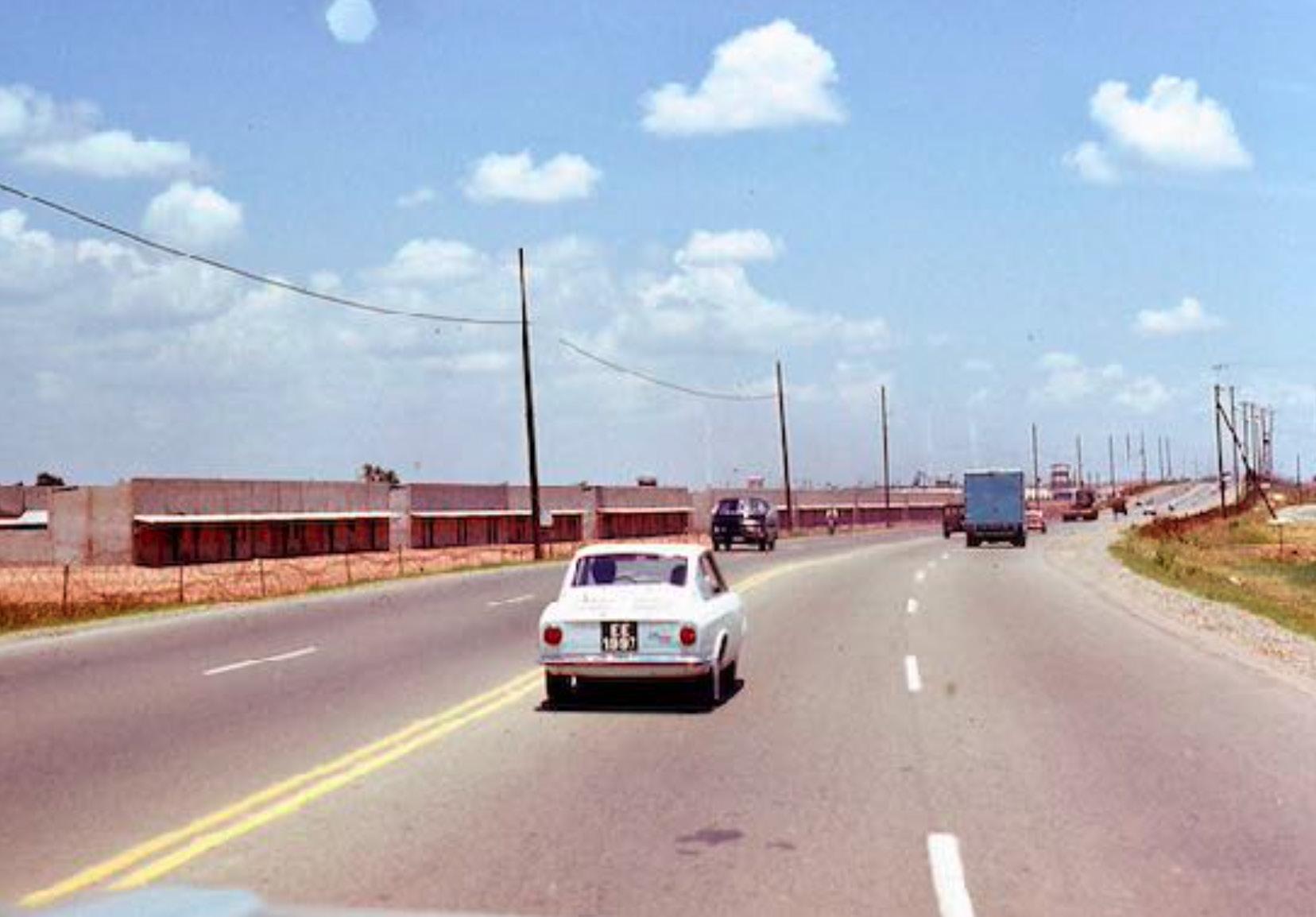
« We constructed 360 units of family housing for Vietnamese Navy families in four different locations in southern Vietnam. The naval officer in the photograph was the successor to the Officer in Charge of Construction, in September 1972. These family housing units had a budget of US$600 per unit, which might be about US$5,375 today, or 125-million VND. So they used a very simple design with standard materials and construction standards » [SCHENCK 2024, 13] fig. 43 : mel schenk, family housing at long binh , 1970-1972
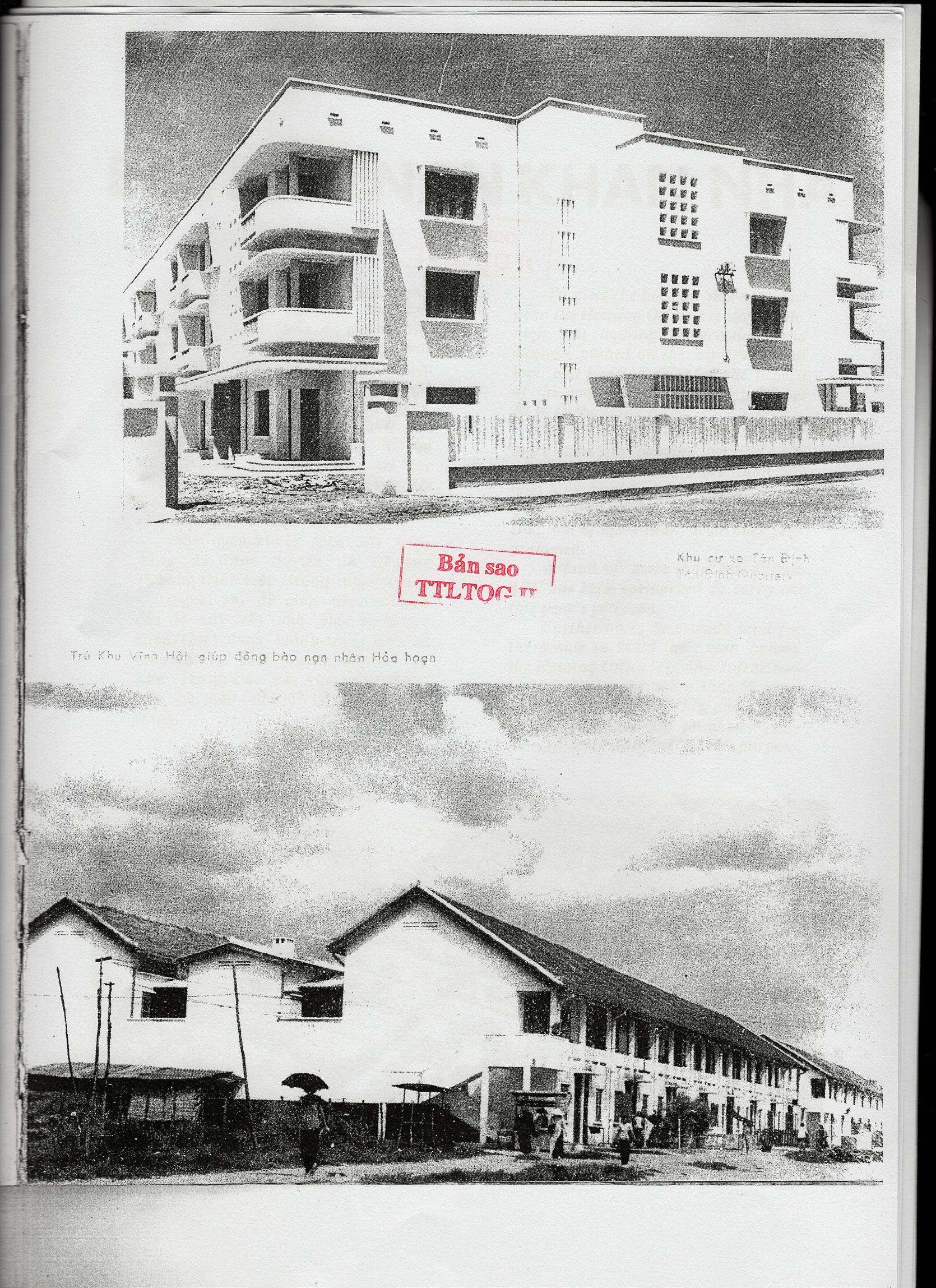
fig. 44 : ministère des travaux public du Việt Nam, faire face à la pénurie de logements , date inconnue
fig. 45 : mel schenk, foundations for housing units at cửa đại beach, hội an , 1970-1972

Alors que certains projets de constructions émergent, le paysage de la ville de Sài Gòn est aussi bien modifié. Lorsque l’on fait défiler un nombre importants de photographies de la ville pendant la guerre, on s’aperçoit très rapidement de l’apparition d’un langage militaire bien spécifique. Ces mêmes photographies révèlent alors des dispositifs spatiaux mis en œuvre par les forces imperialistes afin de contrôler l’accès urbain, de rendre évident la présence militaire tout en essayant, semble-t-il, de disuader de potentielles attaques extérieures.
Ici, la militarisation de l’espace public est un phénomène qui se traduit par l’intégration croissante de mesures et d’éléments de sécurité, à l’origine militaires, dans l’architecture et le design urbain. Cette transformation vise à prévenir les menaces (terrorisme, criminalité) et à contrôler les foules, mais elle altère également la nature de l’espace public. Cette militarisation se manifeste ici de diverses manières. reconnaissance faciale qui transforment l’espace public en un environnement sous constante surveillance, soulevant des questions sur la vie privée et les libertés civiles. À Sài Gòn, la guerre ne se limitait pas aux champs de bataille périphériques mais pénétrait directement l’espace urbain, transformant la ville en un véritable front hybride. Loin de constituer un simple arrièreplan, l’environnement urbain fut systématiquement militarisé sous l’effet des stratégies de contre-insurrection américaines et sud-vietnamiennes. Cette dynamique semble avoir redessiné le tissu social et spatial, chaque rue et chaque infrastructure devenant une zone de surveillance et de contrôle. L’approche théorique de Stephen Graham sur le « nouvel urbanisme militaire » [GRAHAM. 2010] éclaire cette mutation : les villes sont perçues comme des champs de bataille habités par des ennemis invisibles, où les infrastructures civiles – routes, marchés, logements, lieux publics – se transforment en instruments de commande et de contrôle. À Sài Gòn, bien avant l’avènement des technologies de surveillance modernes, ce processus se manifesta par une militarisation diffuse du quotidien : pour les
forces armées américaines, marchés, cafés et logements purent cacher des combattants, des tunnels ou des pièges, brouillant la distinction entre civil et insurgé et instaurant une atmosphère de vulnérabilité permanente. En réponse, les forces américaines et sud-vietnamiennes mirent en œuvre une contre-insurrection systémique. L’essentiel des troupes de l’ARVN fut mobilisé pour des missions de pacification et de garde statique, appuyées par une vaste infrastructure de renseignement (Combined Intelligence Center Vietnam, Combined Military Interrogation Center)
[BUREAU OF INTELLIGENCE AND RESEARCH 1970].
[fig. 46 : Cette photographie en couleur représente une rue animée de Sài Gòn*, où la vie civile quotidienne se déroule sous l’ombre omniprésente d’une militarisation manifeste. L’image capture une intersection où véhicules militaires, éléments de fortification, et passant·es civil·es se côtoient dans une cohabitation forcée. La composition de l’image est dominée par la présence d’éléments militaires qui structurent et restreignent l’espace public. Au premier plan à gauche, une barrière de sacs de sable, surmontée de barbelés, surmontent une partie du trottoir et de la chaussée. Plus à droite, un imposant camion militaire américain se mêle au flux de véhicules civils (motos, vélos-taxis etc.). Ces éléments créent des entremêlements et signalent une réorganisation de l’espace urbain où la sécurité prime sur la fluidité. La présence de poteaux et de signalisations renforce l’idée d’un espace quadrillé.
Les éléments architecturaux, bien que traditionnels ou coloniaux en arrière-plan (bâtiment à arcades), sont ici subsumés par les marqueurs de la militarisation. Les sacs de sable et les barbelés ne sont pas de simples ajouts ; ils transforment l’architecture, en créant des bastions improvisés qui altèrent la fonction première des bâtiments. Le camion militaire est un symbole direct de la puissance étrangère et de son déploiement visible dans les rues. L’ensemble symbolise la transformation de l’espace public en un espace de contrôle et de surveillance, où la ligne entre le civil et le militaire s’estompe. Cette image est une archive visuelle éloquente de la militarisation de l’espace urbain à Sài Gòn pendant la guerre du Viet Nam*. Elle révèle comment le conflit ne se cantonne pas aux zones de combat, mais s’infiltre et redéfinit le quotidien des habitants. La présence ostentatoire de l’armée étrangère et des fortifications témoigne d’une stratégie de contrôle territorial et de gestion de la sécurité qui affecte directement la circulation, les interactions sociales et la perception de la
fig. 46 : auteur·ice inconnu·e, titre inconnu, hội an , 1970
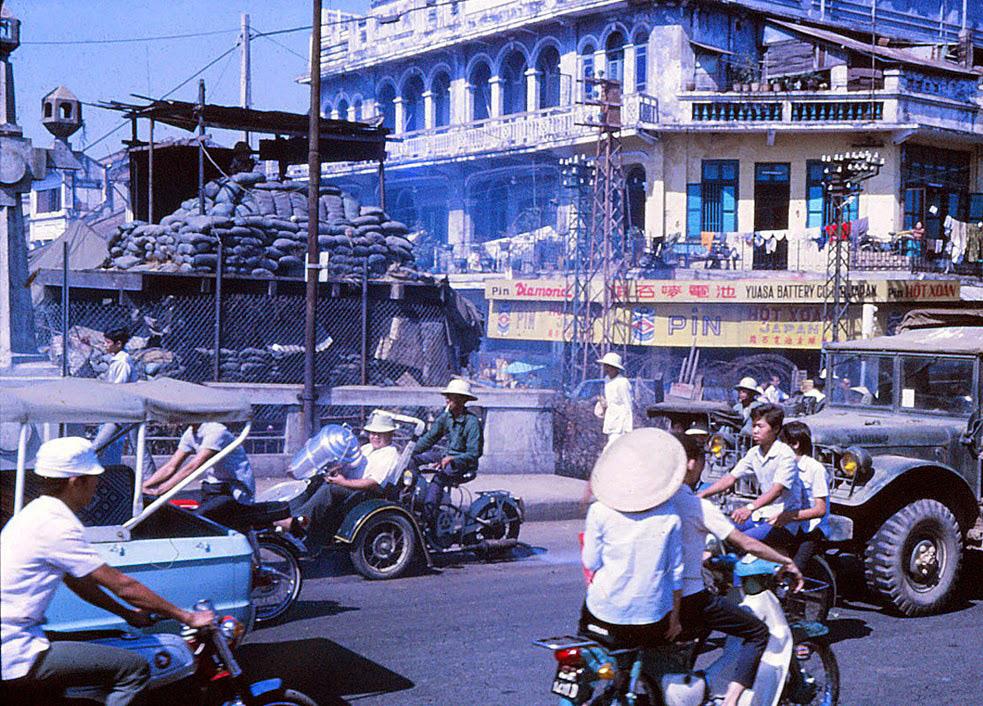


fig. 47 : iparkes, [ ambassade amércaine ] , 14 juillet 1975
ville. Cette photo documente la « porosité » urbaine dans un sens inversé : la ville civile est rendue poreuse à l’intrusion militaire, créant des tensions visibles et une mémoire urbaine marquée par la présence armée.]
Le Programme Phoenix en représente l’expression la plus emblématique : il visait la neutralisation de l’infrastructure politique du Việt Cộng, en ciblant ses cadres au sein de la population civile. Cette stratégie traduisait la militarisation de l’État lui-même, qui transformait la ville en espace de surveillance, de filtrage et de coercition sociale [VIETNAM WAR 50TH COMMEMORATION 2025]. Ainsi, Sài Gòn devint un cas exemplaire de « front urbain » où les programmes militaires et civils –qu’il s’agisse de logement, d’infrastructures ou de sécurité– s’entrecroisaient pour répondre à une insurrection insaisissable. La militarisation de l’espace urbain y fut à la fois un objectif stratégique et une condition de survie politique pour le régime sud-vietnamien. Cette transformation du paysage urbain n’est pas sans conséquences. La militarisation a créé un environnement social qui a involontairement fait le jeu de l’insurrection en aliénant la population civile, démontrant que l’implémentation de ces tactiques était tactiquement efficace mais stratégiquement contre-productive à long terme. L’évolution du conflit à Sài Gòn illustre par ailleurs de manière spectaculaire la nature dynamique de la militarisation urbaine. Initialement caractérisée par la guerre de l’ombre, les tactiques de harcèlement et les programmes de contrôle systémique, la militarisation de la ville a atteint son apogée lors de la phase finale du conflit. Le retrait des forces américaines en 1973 a laissé l’ARVN affaiblie, ouvrant la voie à une offensive nord-vietnamienne d’une ampleur sans précédent. La guerre, qui avait été hybride, a évolué vers une confrontation conventionnelle, transformant Sài Gòn d’un environnement de conflit infiltré en une cible militaire ouverte et totale. En avril 1975, les forces nord-vietnamiennes ont encerclé la ville avec 100 000 soldats, 300 chars T-54, des lance-roquettes multiples et de l’artillerie lourde : les diplomates et les Marines américains se préparaient pour la plus grande évacuation par hélicoptère de l’histoire [FERREIRA 2025]. L’entrée des chars dans le palais
présidentiel le 30 avril 1975 a marqué la fin de la guerre. Ce siège final a constitué le point culminant de cette militarisation.
La guerre invisible et psychologique a cédé la place à une militarisation brute, visible et totale, où la ville elle-même est devenue l’enjeu et la cible de l’affrontement final.

fig. 48 : auteur·ice inconnu, capital hotel beq entrance, date inconnue
fig. 49 : auteur·ice inconnu·e, zonage des activités et des occupations de Sài Gòn pendant la guerre , date inconnue
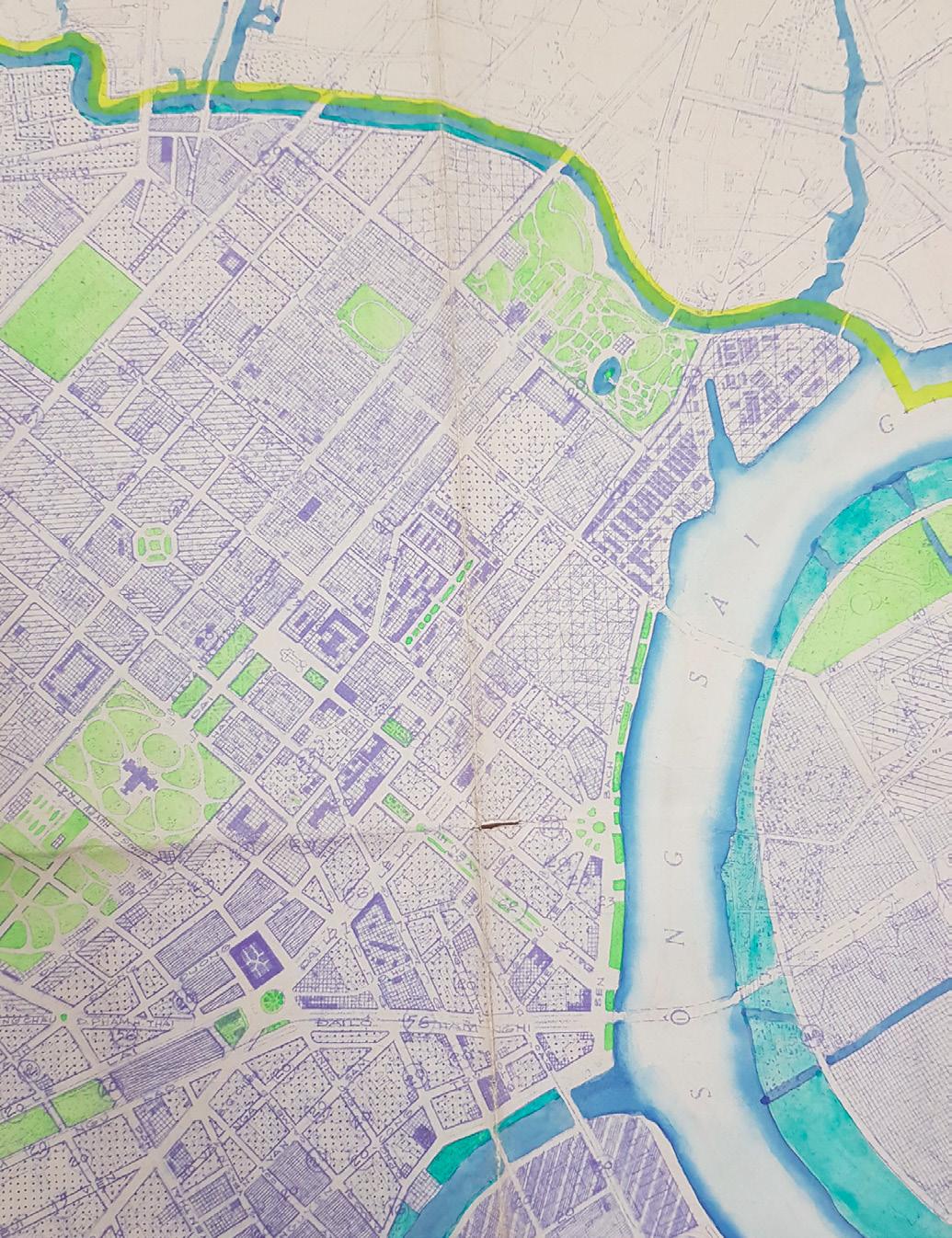
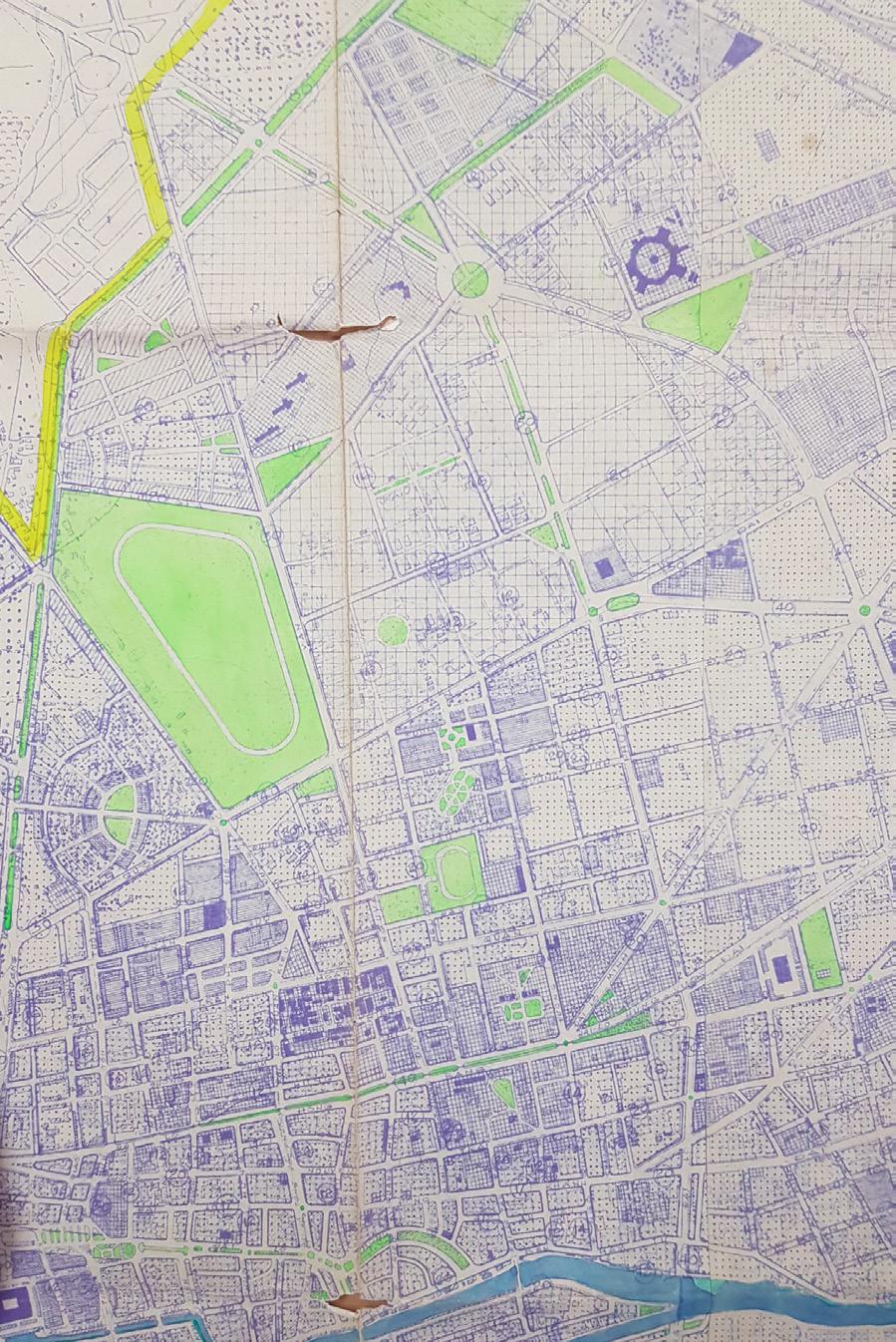
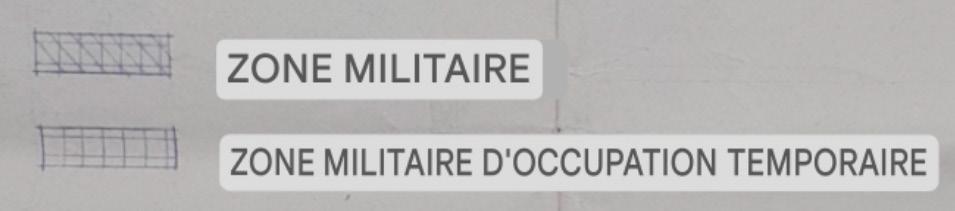
Lorsque l’on parle de l’architecture, de la ville ou d’infrastructures, le sujet est bien trop souvent concentré sur l’environnement bâti. Il ne faut pas oublier qu’en temps de guerre ou de génocide, on fait généralement face à un environnement détruit.
Les génocides et conflits armés organisés dans le monde depuis un siècle ont fait apparaître, jusqu’aujourd’hui, une conscience particulière du patrimoine bâti et culturel comme instrument de pression et de manipulation, généralement utilisé par les puissances dominantes.
Cela peut paraître évident, voire inutile à rappeler, mais il est malheureux de constater que la couverture médiatique occidentale actuelle des conflits internationaux oscille parfois encore et toujours entre l’absence de couverture et une représentation biaisée résonnant avec la médiatisation de la guerre du Golfe : des images de « bombes intelligentes », de « frappes chirurgicales », déshumanisées, aseptisant le conflit et niant de nombreuses réalités destructrices.
Bien que des stratégies de destruction du patrimoine symbolique visent généralement à détruire ou à réécrire des réalités historiques (à Gaza par exemple), nos existences ne se marquent pas seulement à travers la ténacité de la Grande Mosquée de Gaza ou de l’opulence de la tour Eiffel ; elles se teintent d’un quotidien, de rencontres, d’habitudes, de lieux communs visités que l’on aimerait évidemment conserver. Kevin Lynch soutient en ce sens que l’observateur·ice, ou plutôt la personne pour subjectiviser la relation, organise et charge de sens ce qu’elle voit autour d’elle et les expériences vécues en lien avec son environnement bâti [LYNCH 1960]. Cette relation se trouve alors aujourd’hui meurtrie par de nouvelles stratégies de guerre développées où l’espace est complètement redéfini. En analysant l’attaque de la ville de Naplouse en avril 2002 menée par des unités de l’armée israélienne, Eyal Weizman avance que « parce qu’elle consiste à se déplacer à travers des bâtiments privés, [ces manœuvres] transforme[nt] l’intérieur en extérieur et
les espaces privés en voies de communication » [WEIZMAN 2023]. En « démurant le mur », la guerre s’est invitée dans la sphère privée, les salons et les chambres, ne laissant derrière elle que traumatisme et humiliation10. Ces réalités-là forgent un aspect important des identités subjectives, à l’échelle de l’individu. Le propos suggère ici que, positivement ou négativement, la disparition d’une réalité urbaine a un impact évident sur nos présences. La destruction en tant que traumatisme urbain subsiste en nous, non pas comme un simple état révolu auquel nous repensons stoïquement mais comme une forme de traumatisme, de marque, de cicatrice, qui vient se stratifier. Jusqu’à la fin des années 1960, les affrontements les plus violents de la guerre du Việt Nam se déroulaient surtout dans les campagnes.
[fig. 50 : La photographie représente une maison rurale en flammes, réduite à l’état de brasier. La toiture de chaume s’embrase violemment, tandis que l’intérieur de l’habitation est déjà consumé, les flammes jaillissant par l’ouverture de la porte et les interstices des fenêtres. L’intensité du feu dépasse la simple contingence matérielle. On perçoit l’irréversibilité de l’instant : ce foyer, espace domestique et familier, est en train de se faire détruire.
À droite, un porche soutenu par deux colonnes de maçonnerie subsiste momentanément, offrant une impression trompeuse de stabilité face à la dévastation qui progresse inexorablement. À l’avant-plan, les objets du quotidien dispersés et partiellement consumés, posés sur un sol sablonneux, témoignent d’une vie interrompue brutalement, entre ordre architectural et effondrement annoncé.
L’habitation combine des éléments vernaculaires fragiles et des structures plus durables, ce qui illustre un mode de construction rural typique du Vietnam central dans les années 1960. Le toit en chaume, hautement inflammable, montre la vulnérabilité des foyers paysans face à la guerre, tandis que les colonnes maçonnées et le soubassement en brique traduisent une recherche de pérennité et une inscription dans le temps long. Autour de la maison, les jarres, les paniers et les outils agricoles rappellent l’ancrage du quotidien villageois, immédiatement anéanti par l’incendie. La destruction d’un foyer ne se réduit pas à une perte matérielle : elle incarne la négation d’une communauté, la disparition d’un espace intime et collectif, et traduit la violence politique et militaire qui s’abat sur des civil·es désarmé·es. Replacée dans le contexte du massacre de My Lai* en 1968, cette image prend une
10Aussi à lire : Weizman Eyal. 20 mars 2008. À travers les murs. L’architecture de la nouvelle guerre urbaine. Éditions La Fabrique
fig. 50 : 16 mars 1968, my lai* massacre , ron haeberle


fig. 51 : james f. fitzpatrick, avsg-s-c-3584-16/aga68 rvn cholon an arvn soldier runs through the destruction caused during the street fighting in cholon , 1968
dimension tragiquement exemplaire. Elle illustre la stratégie militaire consistant à anéantir les villages soupçonnés de soutenir la guérilla, au prix d’une violence indiscriminée touchant directement les civil·es. L’incendie des habitations paysannes n’était pas seulement un acte de guerre immédiat : il participait d’une recomposition forcée de l’espace rural, contraignant des milliers de personnes à fuir, à rejoindre des camps ou à être relogées dans des zones sous contrôle gouvernemental. Sur le plan géopolitique, ces destructions soulignent la militarisation du territoire et la dissolution de la frontière entre espace civil et champ de bataille. L’habitat, au cœur de la vie quotidienne, devient ici le théâtre et la victime de la guerre, révélant l’ampleur du traumatisme infligé à la société vietnamienne.]
L’offensive du Tết, déclenchée le 30 janvier 1968, bouleversa radicalement cette dynamique en portant soudainement les combats au cœur des centres urbains. Les villes, jusque-là perçues comme des sanctuaires relatifs, se transformèrent en véritables champs de bataille, exposant leurs habitants à une violence inédite. Le choc de l’offensive fut d’abord psychologique. Plus de 85 000 combattants de l’Armée populaire vietnamienne et du Front national de libération parvinrent à s’infiltrer jusque dans des lieux hautement symboliques, tels que l’ambassade des États-Unis d'Amérique et le palais présidentiel à Sài Gòn [ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
2025]. L’attaque, menée en pleine trêve du Nouvel An lunaire, surprit les forces alliées par son ampleur et sa coordination. Si la contre-offensive américaine et sud-vietnamienne permit, en quelques semaines, de reprendre le contrôle et d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi, les images de combats en plein cœur de Sài Gòn fissurèrent irrémédiablement la crédibilité du discours officiel, qui proclamait jusque-là la guerre en voie d’être gagnée. La riposte alliée, d’une intensité exceptionnelle, provoqua des destructions massives, en particulier dans le quartier de Chợ Lớn, où les combats et bombardements se prolongèrent durant plusieurs mois. Les photographies d’organisations humanitaires comme la Croix-Rouge témoignent de l’ampleur des ruines. Les destructions dans les zones urbaines furent avant tout le résultat de la contre-offensive américaine et sudvietnamienne. Le photographe Philip Jones Griffiths a
documenté comment les forces du FNL ont utilisé leur connaissance du terrain et l’ignorance des forces américaines pour les manipuler, les amenant à détruire des zones civiles avec leur propre puissance de feu [HAVLIN 2018]. L’APV et le FNL visaient délibérément des « quartiers de la classe moyenne », qui ont été « dûment détruits par la puissance de feu des ÉtatsUnis » [HAVLIN 2018]. Les G.I. de la 9e division, stupéfaits de découvrir des immeubles de plusieurs étages, ont rapidement pris conscience qu’ils détruisaient les maisons de gens dont le confort matériel était parfois supérieur au leur aux États-Unis. Cette situation a conduit à la déclaration de « Free Fire Zones » (zones de tir libre) dans certains quartiers, comme à Chợ Lớn, où les habitants recevaient l’ordre d’évacuer leurs maisons avant qu’elles ne soient détruites par les bombardements pour débusquer les forces ennemies. L’emploi massif de la puissance de feu dans un environnement urbain dense a rendu les dommages collatéraux inévitables et a entraîné la mort de milliers de civil·es. Le gouvernement sud-vietnamien a rapporté que 7 721 civil·es avaient été tué·es et 18 516 blessé·es dans tout le pays pendant l’offensive, avec 75 000 foyers endommagés ou détruits [ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 2025].
La véritable destruction opérée au Sud-Việt Nam réside dans le fait qu’elle n’a pas été un événement singulier, mais un processus systémique de déstructuration. Les bombes tombées sur les campagnes ont d’abord poussé des millions de civil·es à se réfugier dans la ville, créant une crise sociale et humanitaire qui a précédé et aggravé les combats de 1968. Les destructions physiques de ces combats ont ensuite précipité la ville dans un chaos humanitaire qui a préparé le terrain pour l’effondrement total de 1975.
Plus de 670 000 personnes furent désignées comme réfugié·es, s’ajoutant aux 1,5 million déjà déplacées [ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 2025]. La destruction physique s’est ainsi transformée en une détresse humanitaire massive, exacerbant une crise de réfugiés déjà grave. Cette logique
fig. 52 : james f. fitzpatrick, avsg-s-c-3133-17/aga68 rvn cholon a platoon of arvin rangers moves through the rubble of cholon in a sweep of the area following allied air strikes , 1968

entraîna des milliers de mort·es, militaires et civil·es, et un exode massif, venant s’ajouter à la crise des réfugié·es déjà alimentée par les bombardements aériens et l’usage de défoliants dans les campagnes. En 1968, près de 670 000 personnes furent déplacées, en plus du million et demi précédent.
fig. 53 : auteur·ice inconnu·e, tet* offensive , mai 1968


fig. 54 : james f. fitzpatrick, avsg-s-3585-17/aga68 rvn cholon an arvn ranger races toward an open doorway in cholon as sniper fire ricochets on the doorway overhead , 1968
fig. 55 : james f. fitzpatrick, avsg-s-c-3133-18/aga68 rvn cholon vietnamese rangers pause during a sweep of cholon in front of a building in that was heavily damaged by allied air strikes , 1968

fig. 56 : philip jones griffiths the levelled village of ben tre in the delta after the tet offensive, south vietnam, 1968


Le Việt Nam, à travers ses multiples facettes historiques, architecturales et culturelles, nous dévoile une réalité profondément marquée par des siècles de conflits, de luttes identitaires et de transformations sociales radicales. Ces recherches essaient de saisir les différentes dimensions de cette réalité, en particulier à travers l'analyse de la planification urbaine, des symbolismes architecturaux et des répercussions de la guerre du Việt Nam. Autrement dit, l'objectif a été d'aborder à la fois une exploration historique, une analyse des structures de pouvoir et un examen des conséquences sur l’espace urbain et la mémoire collective.
L'impact de la guerre du Việt Nam, quant à lui. Si l’on peut parler de la guerre en termes de pertes humaines et matérielles, il est tout aussi pertinent d’évoquer ses répercussions sur l’architecture. Le bombardement systématique des infrastructures, la destruction de sites historiques et la mise en place de nouvelles structures de pouvoir, souvent à des fins stratégiques, ont modifié en profondeur l’organisation des villes vietnamiennes. L’urbanisme, après la guerre, a dû se réinventer pour faire face à la reconstruction, tout en s'adaptant à de nouvelles réalités économiques et sociales. Les villes non-occidentales ont ainsi dû jongler entre la préservation de certains éléments hérités de l’époque coloniale et la mise en place de structures modernes dictées par les idéologies postrévolutionnaires.
Au-delà de ça, ces recherchent permettent de mettre en avant l'impact de la guerre mais surtout de l'impérialisme étranger, qu'il soit culturel, économique ou matériel. La vérité est que les régimes de Sài Gòn n'ont jamais été indépendants du contrôle américain. Le conflit n'était donc pas une guerre civile entre le Nord et le Sud, mais entre les Vietnamien·nes et une puissance impérialiste extérieure.
Ce phénomène, qui désigne l’extension du pouvoir d’un État sur d’autres territoires, s’est souvent accompagné de pratiques d’exploitation et de domination, justifiées par des idéologies de supériorité culturelle, économique et raciale. L’impérialisme a eu un impact direct et profond sur les pays colonisés,
modifiant non seulement leurs structures économiques et politiques, mais aussi leur culture, leur identité et leur rapport à l'Histoire, à leurs propres histoires. Les nations impérialistes, en particulier les puissances européennes comme la GrandeBretagne, la France et les Pays-Bas, ont non seulement cherché à s’imposer militairement, mais ont également investi dans des infrastructures coloniales destinées à servir leurs propres intérêts, trop souvent au détriment des populations locales. Ce modèle impérialiste a imposé des structures de pouvoir inégales, hiérarchisées, et a contribué à l’émergence de tensions ethniques, religieuses et sociales qui perdurent parfois bien après la fin des régimes coloniaux. En Asie, par exemple, l’impérialisme a laissé des traces indélébiles dans des pays comme le Việt Nam, où l’occupation française a non seulement bouleversé les structures économiques, en exploitant les ressources naturelles et humaines, mais a aussi imposé une vision occidentale du monde, étrangère aux traditions et valeurs locales. Cette intrusion dans les affaires internes des pays colonisés a généré des résistances et des révoltes, comme en témoignent les luttes pour l’indépendance qui ont traversé tout le siècle.
Par ailleurs, l'aide au développement et les partenariats stratégiques, comme ceux menés par l'USAID au Việt Nam ne visent pas seulement à la contre-insurrection, mais à la sécurisation des chaînes de valeur, à la promotion des intérêts commerciaux et à l'endiguement de puissances rivales.
Ces bouleversements ont fait naître des mouvements de réappropriation culturelle et de redéfinition de l’identité nationale, souvent dans une tension et des entremêlements à toutes les strates entre l’héritage colonial et la nécessité de se réinventer face à un monde globalisé. L’impérialisme, en ce sens, a créé des fractures complexes et des dynamiques de pouvoir qui ont façonné, et continuent de façonner, les trajectoires des anciennes colonies, notamment dans le monde postcolonial. Les relations internationales contemporaines, les rapports Nord-Sud, et les défis liés à la décolonisation
économique et culturelle sont encore largement influencés par l’héritage impérial, qui a redéfini la notion de souveraineté et de dépendance, et qui continue de façonner les échanges, les identités et les conflits mondiaux.
auteur·ice inconnu·e, bombing of victoria hotel , 1966


auteur·ice inconnu·e, world university service building blasted by vc explosive charge , mai 1968
auteur·ice inconnu·e, tân sơn nhất , mai 1968


fig. 30 : us army military history institute, ambassade américaine , 1968

auteur·ice inconnu·e, titre inconnu , 1969

auteur·ice inconnu·e, associated press , 1963
auteur·ice inconnu·e, hotel ambassador , 1969
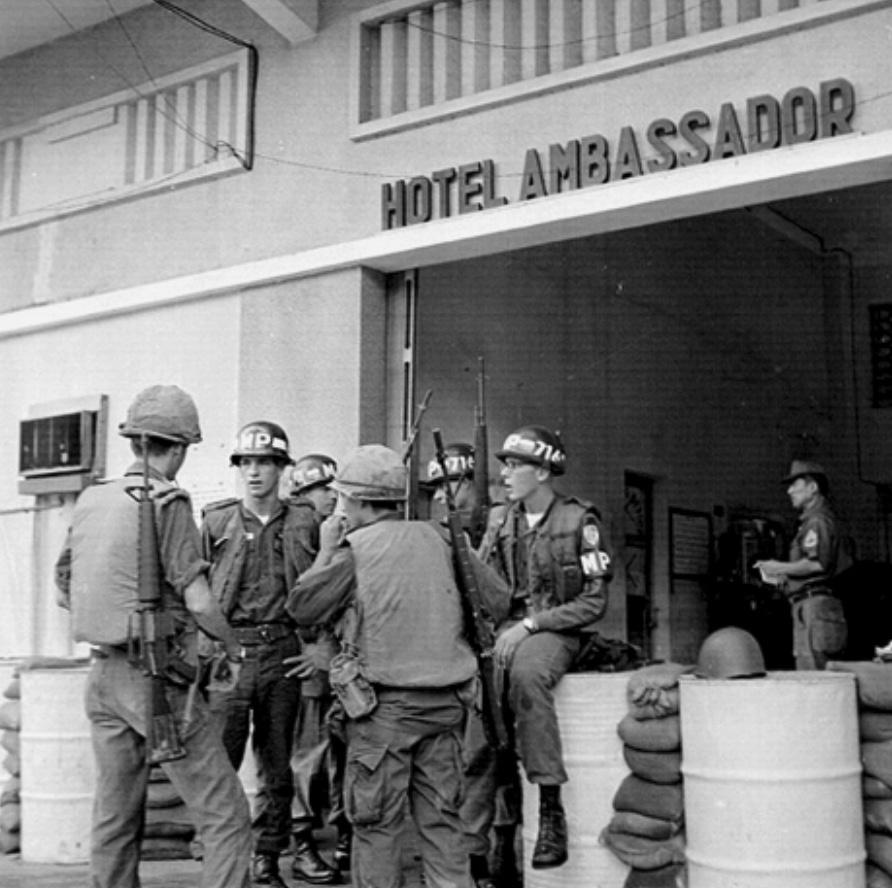

auteur·ice inconnu·e, macv, 137 pasteur street , 1962
auteur·ice inconnu·e, bombing of the us embassy , 30 mars 1965
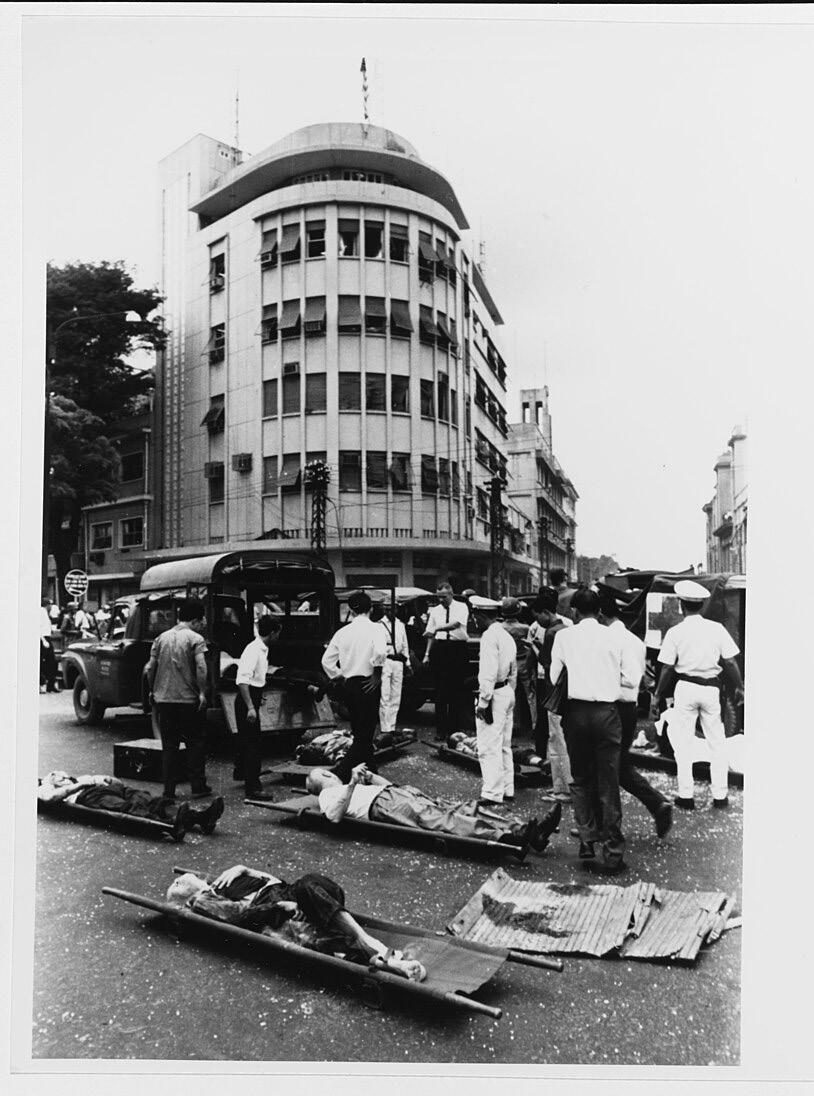

auteur·ice inconnu·e, sài gònnguyen hue boulevard , 1969

mel schenck, cinema at long binh post , 1970-1972

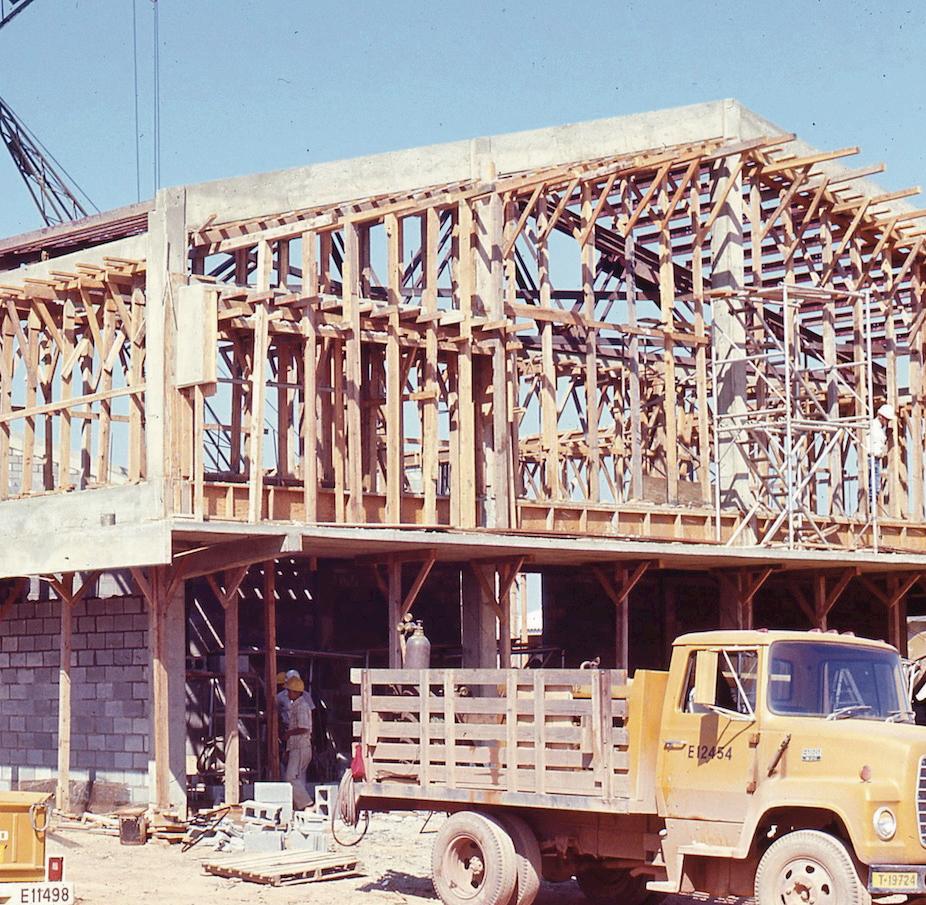
Bastea, Eleni. Memory and Architecture. Albuquerque: UNM Press, 2004.
Briffaut, Camille. La Cité annamite - Tome 2: Les sédentaires. Paris: L. Larose et L. Tenin, 1912.
Dunn, Carroll H. VIETNAM STUDIES BASE DEVELOPMENT IN SOUTH VIETNAM 1965-1970. Washington, D.C.: Department of the Army, 1991.
Frampton, Kenneth. Invisible Cities Lecture. Fonds Kenneth Frampton, Collection du Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Années 1980.
Frampton, Kenneth. Research Proposal: Modern Architecture and Cultural Identity. Fonds Kenneth Frampton, Collection du Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Années 1980.
Gibert-Flutre, Marie. « Les ruelles de Hô Chi Minh Ville, Viet Nam*: trame viaire et recomposition des espaces publics. » Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne, 2014.
Hosagrahar, Jyoti. « Interrogating difference: Postcolonial perspectives in architecture and urbanism. » In Handbook of Architectural Theory, 70–84. Londres: Sage, 2012.
Jo, Seungkoo. « Aldo Rossi: Architecture and Memory. » Journal of Asian Architecture and Building Engineering 2, n° 1 (2003).
Kovacs, Kázmér. « Metaphorical Function of the Architectural Form. » In On Form and Pattern, édité par Cătălin Vasilescu. Bucarest: Editura Academiei Române, 2015.
Lefaivre, Liane, et Alexander Tzonis. Critical Regionalism: Architecture and Identity in a Globalized World. Munich: Prestel, 2003.
Lefebvre, Henri. La production de l’espace. Paris: Anthropos, 1974.
Loos, Adolf. Paroles dans le vide. Traduit de l’allemand par Cornelius Heim. Paris: Editions Champ Libre, 1979.
Lynch, Kevin. L’image de la cité. Paris: Dunod, 1969. Traduction de The Image of the City (Cambridge: M.I.T. Press, 1960).
Marot, Sébastien. L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture. Paris: Editions La Villette, 2010.
Mumford, Lewis. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York: Harcourt Brace, 1961.
Mumford, Lewis. The Culture of Cities. New York: Harcourt Brace, 1938.
Nguyen, Cam Duong Ly. « Outils d’urbanisme et investissements immobiliers privés: fabrication de l’espace central de Hô Chi Minh-ville. » Thèse de doctorat, Université Paris-Est, 2013.
Norberg-Schulz, Christian. L’art du lieu, architecture et paysage, permanence et mutations. Paris: Groupe Moniteur, 1997.
Pallasmaa, Juhani. « Space, place, memory and imagination. » In Memory and Architecture, édité par Eleni Bastea. Albuquerque: UNM Press, 2004.
Pédelahore de Loddis, Christian. « L’habitat Collectif à Hanoi, Généalogies Historiques et Typologies de la Transformation (1941-2001). » In Hanoi, le cycle des
Métamorphoses. Formes architecturales et urbaines, 297–309. Paris: Editions Recherches, 2001.
Pédelahore de Loddis, Christian. « Transitivité et transductivité dans l’Architecture Urbaine vietnamienne. »
Communication présentée au séminaire Hanoi au miroir des Métropoles asiatiques, 13 septembre 2001.
Prakash, Vikramaditya, Maristella Casciato, et E. Coslett Daniel, dir. Rethinking Global Modernism: Architectural Historiogaphy and the Postcolonial. Londres: Routledge, 2022.
Remizova, Olena. « Architectural memory and forms of its existence. » Journal of Architecture and Urbanism 44, n° 2 (janvier 2020): 112–21.
Saint Girons, Baldine. « De l’architecture comme image de notre existence. » Le Portique, n° 31 (2013): 89–115.
Sandweiss, Eric. « Framing urban memory, The Changing Role of History Museums in the American City. » In Memory and Architecture, édité par Eleni Bastea. Albuquerque: UNM Press, 2004.
Schenck, Mel. « The Largest Military Construction Project in History. » The New York Times, 16 janvier 2018.
Scott-Brown, Denise, Robert Venturi, et Steven Izenour. L’enseignement de Las Vegas: ou Le symbolisme oublié de la forme architecturale. Pierre Mardaga Éditeur, 2018.
Semper, Gottfried. Style in the Technical and Tectonic Arts, or, Practical Aesthetics. Réédition, Los Angeles: Getty Research Institute, 2004. (Écrit en 1860).
Simone, AbdouMaliq. « Massive urbanization and the circulation of eventualities. » In Rethinking global modernism:
architectural historioraphy and the postcolonial, dirigé par Vikramaditya Prakash, Maristella Casciato, et E. Coslett Daniel. Londres: Routledge, 2022.
Stanford, Anderson. « Memory without Monuments: Vernacular Architecture. » Traditional Dwellings and Settlements Review 11, n° 1 (1999): 13–21.
Thai, Nguyen Huu. « Gardez l’identité architecturale et l’âme urbaine de Hanoi. » Tạp Chí Kiến Trúc, 20 avril 2024.
Treib, Marc. Spatial Recall: Memory in Architecture and Landscape. New York: Routledge, 2009.
Vantoorn, Roemer. « Contesting the Neoliberal, Urbanization. The Right to the City. » In Visionary Power. Producing the Contemporary City. Rotterdam: NAi Publishers, 2007.
Wright, Gwendoline. The Politics of Design in French Colonial Urbanism. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
Histoire, guerre et géopolitique
Aslangul, Claire. « Images de la violence - violence de l’image: l’iconographie de la guerre à l’épreuve des conflits du XXe siècle. » Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande 36, n° 3-4 (juillet-décembre 2004): 359–81.
Blum, William. Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II. Monroe, MA: Common Courage Press, 1995.
Blum, William. Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower. Monroe, MA: Common Courage Press, 2000.
Chomsky, Noam. « The Pentagon Papers as propaganda and as history. » In The Pentagon Papers, Vol. V. Critical essays, édité
par Noam Chomsky et Howard Zinn. Boston: Beacon Press, 1972.
Chomsky, Noam Towards a New Cold War: U.S. Foreign Policy from Vietnam to Reagan. New York: New Press, 2003.
Colby, William, et James McCargar. Lost Victory: A Firsthand Account of America’s Sixteen-Year Involvement in Vietnam. Chicago: Contemporary, 1989.
Ellsberg, Daniel. Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers. New York: Penguin Books, 2002.
Greene, Felix. Vietnam, Vietnam. Palo Alto: Fulton Publishing, 1966.
Kahin, George McT., et John W. Lewis. The United States in Vietnam. New York: Dell, 1967.
Lawrence, Mark. The Vietnam War: A Concise History. New York: Oxford University Press, 2008.
Marr, David G. Vietnamese Tradition on Trial, 1920–1925. Berkeley: University of California Press, 1971.
Oglesby, Carl. Containment and Change. New York: Macmillan, 1967.
Parenti, Michael. « What do empires do? » Consulté le 13 septembre 2025. www.michaelparenti.org/WhatDoEmpiresDo. html.
Reshef, Ouriel. Guerre, mythe et caricature. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1984.
Young, Marilyn B. The Vietnam Wars 1945–1990. New York: HarperCollins, 1991.
Études postcoloniales et culturelles
Bernstein, Susan. « Goethe’s Architectonic Bildung and Buildings in Classical Weimar. » MLN 114, n° 5 (décembre 1999): 1018–38.
Brown, Adam D., Yifat Gutman, Lindsey Freeman, Amy Sodaro, et Alin Coman. « Introduction: Is an Interdisciplinary Field of Memory Studies Possible? » International Journal of Politics, Culture, and Society 22, n° 2 (2009): 123–29.
Césaire, Aimé. Discours sur le Colonialisme. 1950. Réédité par Présence africaine, 1989.
Crary, Jonathan. « Image. » In New Keywords: A revised Vocabulary of Culture and Society, édité par Tony Bennett, Lawrence Grossberg et Meaghan Morris, 178–80. Blackwell Publishing, 2005.
De Sousa Santos, Boaventura. Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide. Boulder: Paradigm Publishers, 2014.
Fanon, Frantz. Les damnés de la terre. 1961. Réédition, Paris: La Découverte, 2010.
Groys, Boris. « On the New. » Conférence, 22 juillet 2014.
Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Albin Michel, 1925.
Lüderitz, Ana-Josefa. « Walter Benjamin et l’image dialectique: l’histoire comme une dialectique des images. » Thèse de doctorat, Université Toulouse 2, 2018.
Matviyenko, Svitlana, Sitora Rooz, et E. Vincent. «
Technologies du colonialisme russe: occupation, persistance, implication. » Traduit par Léopold Lambert. The Funambulist, n° 55 (septembre-octobre 2024).
Mitchell, W.J.T. Iconologie: image, texte, idéologie. Traduit par Maxime Boidy et Stéphane Roth. Avant-propos de Maxime Boidy et Stéphane Roth. Paris: Les Prairies ordinaires, 2009.
Nora, Pierre. Les lieux de mémoire. Vol. 1. Paris: Gallimard, 1997.
Said, Edward W. L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident. Paris: Seuil, 1980.
Smouts, Marie-Claude, dir. La situation postcoloniale: Les postcolonial studies dans le débat français. Paris: Presses de Sciences Po, 2007. https://doi.org/10.3917/scpo. smout.2007.01.
Histoire du Viet Nam*
Bouchot, Jean. La naissance et les premières années de Sài Gòn ville française. Sài Gòn: Éditions Albert Portail, 1927.
Le, Son, et Thanh Tran. « Tradition as innovative opportunities for contemporary Vietnamese architecture. » AIP Conference Proceedings (2023). https://doi.org/10.1063/5.0125450.
Li Tana. Nguyen Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.
Nguyễn Đình Đầu. De Sài Gòn à Ho Chi Minh Ville 300 ans d’histoire. Ho Chi Minh Ville: Service du cadastre de Ho Chi Minh Ville, 1998.
Nguyễn Khắc Viện. Histoire du Vietnam. Paris: Éditions
sociales, 1974.
Pairaudeau, Natasha, et François Tainturier. « De Sài Gòn à Ho Chi Minh Ville: croissance et changement depuis 1945.
» In Sài Gòn 1698-1998: architectures, urbanisme, dirigé par Le Quang Ninh et Stéphane Dovert. Ho Chi Minh Ville: Nhà xuât ban Thành phô Hô Chi Minh, 1998.
Quach-Langlet, Târn. « Sài Gòn, capitale de la République du Sud Viêtnam (1954-1975), ou une urbanisation sauvage. »
In Péninsule indochinoise: études urbaines, dirigé par PierreBernard Lafont, 185–206. Paris: L’Harmattan, 1991.
Tung Hieu, Ly. « Confucian Influences on Vietnamese Culture. » Vietnam Social Sciences, n° 5(169), 2015.
Võ Sĩ Khải. Dat gia dinh the ky VII den the ky XVI. Ho Chi Minh Ville, 1987.
———. « Dât Gia Dinh 10 thé ky dâù công Nguyen. » In Dia chi van hoa Thành phô Hô Chi Minh. Tap I, lich su, dirigé par Trần Văn Giàu et Trần Bạch Đằng. Ho Chi Minh Ville: Nhà xuât bàn Thành pho Hô Chi Minh, 1998.
Documents officiels et sources en ligne
« Dossier n° 73: Hyper-impérialisme. » The Tricontinental. Consulté le 13 septembre 2025. https://thetricontinental.org/ fr/dossier-73-hyper-imperialisme/.
Ferreira, Sylvain. « HISTOIRE MILITAIRE – Il y a 50 ans, la chute de Sài Gòn. » Le Diplomate, 2025. https://lediplomate. media/2025/04/histoire-militaire-50ans-chute-Sài Gònguerre-vietname/sylvain-ferreira/monde/?print=print.
Havlin, Laura. « The Tet Offensive: The Battle for Vietnam’s Cities. » Magnum Photos, 31 janvier 2018. https://www.
magnumphotos.com/newsroom/conflict/tet-offensivevietnam-cities-philip-jones-griffiths/.
Hiền, Thanh. « Dự án xây dựng mới chung cư Thanh Đa đã quá hạn thực hiện. » Sài Gòn Giải Phóng Online, 11 avril 2025. https://www.sggp.org.vn/du-an-xay-dung-moi-chungcu-thanh-da-da-qua-han-thuc-hien-post790204.html.
Hiep, Vu. « Théorie de l’identité architecturale et du patrimoine architectural au Vietnam. » Tạp Chí Kiến Trúc, 20 avril 2024.
Kahin, George McT. « Address to the inter-faith seminar for clergy on Vietnam. » Boston University, 1 octobre 1965. Ithaca: Kahin Papers, Cornell University.
Lambert, Léopold. « L’architecture une arme coloniale en Palestine. » Vidéo YouTube, 2:00:20. Postée par ENSA Saint-Etienne, 10 janvier 2025. https://www.youtube.com/ watch?v=YJ_-yknc0RI.
« La vie à Sài Gòn, L’hôtel Rex: Un monument à l’histoire de Ho Chi Minh-Ville. » La Vie à Sài Gòn, 11 décembre 2012. https://www.lavieaSài Gòn.fr/hotel-rex-Sài Gòn/.
« L’USAID, une ONG au service de la puissance des ÉtatsUnis dans le monde. » EGE Infoguerre, février 2015. https:// www.ege.fr/infoguerre/2015/02/lusaid-une-ong-au-service-dela-puissance-des-etats-unis-dans-le-monde.
« Project Recovery. » Mémo, 28 février 1968. Dossier « #17: History Backup [I], » boîte 6, Westmoreland Papers, LBJL.
Renner, Andrea. « The American Way: IBEC Housing Projects in Latin America. » Mémoire de maîtrise, Université de Colombie-Britannique, 2010.
Rabe, Stephen G. « Alliance for Progress. » Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 3 mars 2016. https://oxfordre.com/latinamericanhistory/ view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore9780199366439-e-95.
Thắng, Thuận. « Góc tối ở chung cư Thanh Đa. » Tuổi Trẻ Online, 26 septembre 2013. https://tuoitre.vn/goc-toi-ochung-cu-thanh-da-571139.htm.
Trịnh Hoài Đức. Gia Định thành thông chí. Vers 1820.
Tuyên, Thanh. « 50 năm cư xá Thanh Đa: Hồi ức và ước nguyện. » Pháp Luật Online, 21 juillet 2019. https://plo. vn/50-nam-cu-xa-thanh-da-hoi-uc-va-uoc-nguyen-post533760. html.
U.S. Department of State, Office of the Historian. « Document 1. » Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume I, Vietnam, 1961–1963. Consulté le 13 septembre 2025. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196163v01/d1.
U.S. National Archives and Records Administration. « U.S. Foreign Policy: Assistance to Vietnam. » Consulté le 13 septembre 2025. https://www.archives.gov/research/foreignpolicy/assistance/vietnam.
US Army. HISTORIC CONTEXT FOR ARMY VIETNAM WAR ERA HISTORIC HOUSING, ASSOCIATED BUILDINGS AND STRUCTURES, AND LANDSCAPE FEATURES (1963-1975), VOLUME 1. 20 janvier 2022.
Weizman, Eyal. « Gaza: passer à travers les murs. » Le Grand Continent, 8 octobre 2023. https://legrandcontinent.eu/ fr/2023/10/08/gaza-passer-a-travers-les-murs-x/.
