
10 minute read
Actualités
La pandémie et nous
Elle est toujours là qui va et vient et qui revient encore quand on l’espérait sur le départ : la pandémie. Elle a charrié son lot de deuils, fait couler des torrents de larmes. Ses regrets éternels. Effarement, sidération d’abord : nous nous pensions si puissants et nous trouvions soudain si démunis devant ce Covid avide de vies ! Est née ensuite une sourde colère contre des pouvoirs publics manifestement dépassés. N’est-il pas démocratiquement permis de se souvenir avec une certaine rage de cette porte-parole gouvernementale (imprudemment prénommée Sibeth) qui, devant l’inconcevable pénurie de masques protecteurs, en moqua l’utilité affirmant que, d’ailleurs, elle ne saurait pas même en mettre un ! Les débats d’aujourd’hui sont plus protéiformes. Ils travaillent la société toute entière, opposent ses citoyens. Les vaccins ne présentent-ils aucun risque d’effets secondaires graves ? L’obligation du masque et du passe sanitaire, même limitée, n’est-elle pas une insupportable atteinte à nos libertés ?
Advertisement
Quant au vaccin, on s’abstiendra prudemment d’exprimer une position définitive ; après, cependant, avoir opportunément noté qu’à ce jour, des millions de personnes en ont reçu leur troisième dose, des centaines de millions leur seconde, et que les peurs entretenues ne paraissent pas trouver dans les faits une confirmation claire.
Masque et passe sanitaire posent la question de nos libertés et de leurs limites. Question éminemment politique certes, mais d’abord, question morale. Le masque est-il une insupportable contrainte que l’on ne saurait plus longtemps nous imposer même dans des lieux publics clos ? Le passe sanitaire n’est-il pas attentatoire aux libertés publiques les plus fondamentales ?
Ces questions pourraient, semble-t-il, alimenter assez facilement une dissertation de philo pour élèves de terminale : « Où ma liberté s’arrête-elle ? ». Et l’ultime réponse jaillirait vite de la bouche des potaches attentifs tant elle semblerait aller de soi : « là où commence celle des autres ». Mais il faudrait alors questionner cette réponse au regard de la situation concrète que nous vivons, celle de la pandémie. Quelle est ici la liberté menacée ? Celle du quidam contraint d’exhiber un passe sanitaire ou de porter un masque ? Où celle de la personne âgée ou malade, fragile en un mot, qui ignore l’éventuelle dangerosité pour elle du voisin côtoyé incidemment ?
Ces questions, on le voit bien, n’ont pas grand sens. Plutôt que de liberté ne faudrait-il pas parler de responsabilité ? Ma liberté, tout spécialement dans pareil contexte, ne doit-elle pas s’autolimiter là où est susceptible de commencer ma responsabilité ? Notre temps, cependant, est-il encore capable d’entendre ce mot dans la plénitude de son sens ? Le souci d’autrui, jusque et y compris de celui que l’on ne fait que croiser un instant, peut-il encore trouver sa place dans cette société des individus qui se veulent « libres » jusqu’au caprice ? Responsables ! Pour notre part, nous Juifs, disposons pour l’être effectivement d’une aide puissante. Chaque matin nous affirmons clairement, à l’orée de la prière, Aréni mekabel : je m’engage à mettre en œuvre le précepte « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ainsi faisons-nous de l’acceptation de notre responsabilité la conséquence nécessaire d’un engagement premier, plus élevé encore. Amour premier, donc, par rapport à quoi le sentiment de responsabilité est second, mais prend un sens encore plus fort.
Puissions-nous toujours nous en souvenir même par les matins routiniers, quand il peut arriver que nous entrions à la synagogue nez au vent. ■






Alors qu’une seule petite fiole d’huile cacher a été retrouvée pour allumer la Ménora du Temple qui ne devait durer qu’une seule journée, elle brûla 8 jours ! C’est ainsi que ‘Hanouccah est né. Depuis, pour remercier Dieu, on allume des bougies chaque soir, en allumant une en plus. Cette célébration commémore la victoire de l’armée juive des Maccabées sur les Gréco-Syriens.

PAR DEVORAH WEISBERG
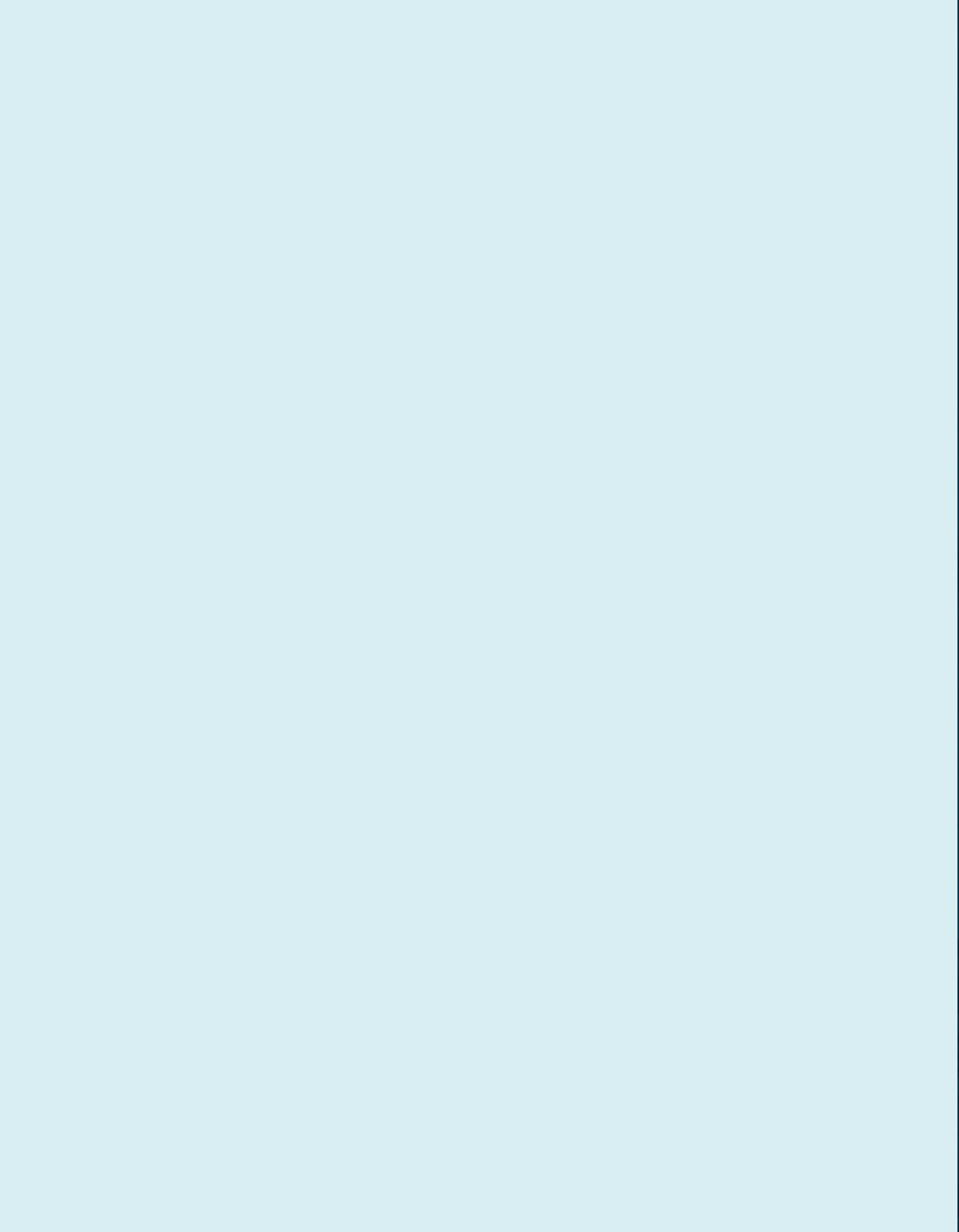
Il y a quelque chose de mystique dans une flamme. On dirait presque quelque chose de magique. Elle émerveille les enfants. Selon les circonstances, elle peut créer une atmosphère de fête, de solennité et de sainteté. Il y a quelques années, New York fut plongée dans l’obscurité penlant douze heures, c’était le black-out ! Les lumières se trouvaient à l’avant-scène et inspiraient à tous de nobles sentiments et de nobles actions. Les gens étaient très serviables les uns envers les autres. Les adolescents, auxquels on attribue souvent tous les défauts, sautaient sur l’occasion pour se rendre très utiles aux endroits critiques, comme les croisements de rues et le métro. En même temps, on a remarqué que, cette nuit où il a fallu allumer des bougies, on avait commis moins de crimes. En bref, cette lumière, ou plutôt son absence, avait provoqué un regain de bonne volonté et avait amélioré la nature lumaine.
Dans nos traditions, les bougies, quelle que soit la circonstance, joie ou tristesse, sont liées à notre rituel. En fait, les bougies servent plus d’une fois au cours d’une vie, elles soulèvent des réactions et révèlent des émotions différentes. A l’occasion d’un mariage, par exemple, les parents des mariés viennent avec des bougies allumées pendant qu’ils accompagnent leurs enants à la ‘houpah. A cet instant, les bougies, aux flammes incertaines, entrent, pour une grande part, dans la solennité qui enveloppe les familles réunies et leurs invités. Cependant, par la suite, tout le monde se réjouit à l’occasion du repas, dans une atmosphère de gaîté rehaussée par les bougies posées sur les tables. Les mots, même les plus poétiques, sont trop faibles pour exprimer et décrire la sérénité et la félicité que les bougies de Chabbat dévoilent dans toutes les maisons et dans tous les coeurs juifs.
En d’autres occasions, cependant, les bougies sont là pour donner un ton plus sérieux, et pour nous faire aussi réfléchir davantage sur la destinée humaine. A Yom Kippour, par exemple, on allume les bougies pour se rappeler de la gravité du jugement de D.ieu en ce qui concerne les vivants comme ceux qui ne sont plus. Le lien entre la Nechamah (l’âme juive) et la flamme de la bougie est encore plus évident quand on allume une bougie d’anniversaire, le jour où l’un de nos proches a quitté ce monde. La relation bougie/ âme se manifeste encore davantage à travers la coutume d’allumer des bougies auprès d’un mort pendant les sept jours de deuil. Nos Sages nous disent que la Nechamah ressemble à la flamme d’une bougie, par sa forme et son allure. De même que la flamme vacille sans arrêt, poussée vers le haut par une force divine, de même l ‘âme juive tremble quelquefois, montre une faible lueur, mais est partout pleine d’ardeur et d’aspiration vers D.ieu. Il n’y a rien d’étonnant à ce que dans les moments les plus profonds, de joie ou de peine, nous laissions aux bougies le soin d’exprimer et de communiquer nos pensées les plus intimes dans le langage mystique qui est le leur. Les bougies ont aussi une dimension grandiose, très impressionnante. Dans le Beth Hamikdache (le Temple de Jérusalem), par exemple, la flamme occidentale brûlait plus longtemps que les six autres flammes de la Ménorah (le Candélabre à sept branches). Elle avait pourtant la même quantité d’huile. Ce miracle était considéré comme un symbole de la Présence Divine dans le Temple. La lumière était là-bas le signe de la révélation divine. Cela devrait nous faire prendre conscience, une fois de plus, de la valeur mystique des lumières. Cela nous amène inévitablement à la mitsvah, très connue et très importante, des bougies de ‘Hanouccah. Nous savons qu’à ‘Hanouccah, il est interdit de se servir de la lumière des bougies, car nous sommes seulement autorisés à les regarder. Oui, nous pouvons, nous devons regarder leurs flammes scintillantes car elles sont pleines de souvenirs historiques. Elles nous racontent divers épisodes héroïques de notre vieille histoire. Tout comme la flamme occidentale demeure un témoignage vivant de l’amour que D.ieu nous porte, de même, les lumières de ‘Hanouccah narrent notre loyauté inflexible envers D.ieu, malgré les difficultés et les épreuves. Si nous observons cette mitsvah, nous aurons le mérite de voir à nouveau la lumière divine parmi nous, dans le Beth Hamikdache. Nous ne devons pas en faire une utilisation personnelle, car les lumières de ‘Hanouccah ne sont pas là pour exprimer un quelconque sentiment personnel, mais pour parler le langage spirituel auquel seule notre Nechamah peut répondre. Quand nous allumerons à nouveau ces lumières, laissons-les luire plus longtemps, afin que notre Nechamah réponde à l’appel de leurs flammes. ■
Mettez les mains à la pâte !
BEIGNETS DE ‘HANOUCCAH
COMMENCER PAR PRÉPARER LE LEVAIN • Pour ça rien de plus simple. Dans un bol, tamiser la farine puis émietter la levure par dessus et ajouter l’eau. • Bien mélanger avec une cuillère en bois en essayant de faire rentrer de l’air à l’intérieur. • Racler les bords avec une spatule de manière à ramener la pâte vers le centre ( sinon les résidus de pâte risquent de sécher et d’alourdir le résultat ). • Couvrir et laisser lever pendant 2 heures à température ambiante.
Les ingrédients
POUR LE LEVAIN ► 250g d’eau ► 250g de farine ► 10g de levure fraiche de boulanger
POUR LA PÂTE ► entre 250 et 300g de farine ► 125g de jaunes d’oeufs (environ 6 ) ► un cube de levure de boulanger soit 42 g ► 75g de sucre en poudre ► 2 sachets de sucre vanillé ► 10g de sel ► 75g de beurre
POUR LA PÂTE À BEIGNETS
• Dans un robot ou dans un bol mettre la farine tamisée, puis émietter la levure au dessus comme pour un crumble. • Ajouter le sucre en poudre, puis les jaunes d’oeufs et le levain et mélanger. • Pétrir pendant 2 minutes, puis ajouter le sel et continuer de pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle de la paroi du bol. • Quand la pâte est bien lisse et homogène, ajouter le beurre froid en morceaux et pétrir à nouveau jusqu’à jusqu’à ce que la pâte retrouve son aspect lisse et sa consistance un peu molle. • Fariner légèrement le plan de travail puis verser la pâte dessus et la rouler en boule.
La déposer dans un bol légèrement fariné. • Couvrir d’un torchon propre et laisser pointer jusqu’à ce qu’elle double de volume. • Au bout d’à peu près une heure, dégazer la pâte avec le poing et la diviser en 25 morceaux environ ( chaque morceau doit faire entre 35 et 45 g grand max) ç’est petit mais c’est normal. • Mettre la moitié des petits bouts de pâte sur une plaque et les recouvrir avec du papier film. Puis les mettre au frigo le temps de façonner les premières. • Façonner chaque petits bouts en petites boules en vous huilant légèrement les
mains ou en farinant légèrement le plan de travail et déposer chaque petites boules finies sur du papier sulfurisé. • Faire ainsi avec tous les bouts de pâte et recouvrir avec un torchon. • Laisser doubler de volume. • Faire frire les beignets dans une grande casserole avec assez d’huile de friture pour que les beignets ne touchent pas le fond. • Attention les beignets doivent frire dans une huile entre 160 et 170 degré pendant 7 à 8 minutes environ . • A mi cuisson, on tourne les beignets pour que l’autre face cuise. • Déposer les beignets sur du papier absorbant pour enlever l’excédent de matière grasse puis sur une grille.
• Saupoudrer de sucre glace et déguster !








