Coraline Gajo


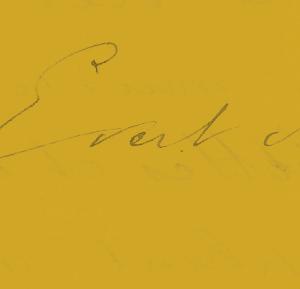










Des Helvètes à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle



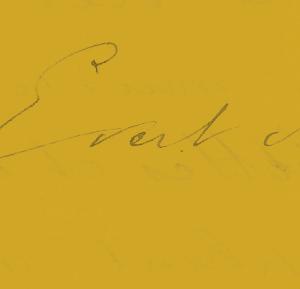










Des Helvètes à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle
dans la seconde moitié du XIXe siècle
Schwabe Verlag
L’étape de la prépresse de cette publication a été soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Open Access: Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Toute exploitation commerciale par des tiers nécessite l’accord préalable de la maison d’édition. Toute utilisation du contenu de l’œuvre à des fins de développement ou d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle sans le consentement explicite de l’éditeur est interdite.
Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.dnb.de.
© 2026 Coraline Gajo, publié par Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite de l’autrice
Illustrations : Les illustrations reproduites dans cet ouvrage sont issues de collections privées, ainsi que d’institutions muséales. Chaque image est accompagnée d’une mention spécifique des droits d’utilisation.
Illustration couverture: Evert van Muyden, [Départ pour Paris],1875, mine de plomb sur papier. Lettre d’Evert van Muyden à Gustave de Beaumont, 4 octobre 1875, Paris, Association des amis de Gustave de Beaumont, Genève.
Correctrice: Nadine Sauterel, Fribourg
Conception graphique: icona basel gmbh, Basel
Couverture: icona basel gmbh, Basel
Composition: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim
Impression: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Printed in Germany
Informations relatives au fabricant: Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch
Personne responsable au sens de l’art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Livre imprimé 978-3-7965-5433-9
ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-978-3-7965-5434-6
DOI 10.24894/978-3-7965-978-3-7965-5434-6
L’e-book est identique à la version imprimée et permet la recherche plein texte. En outre, la table des matières et les titres sont reliés par des hyperliens.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
Pour aborder le beau livre de Coraline Gajo, il n’est peut-être pas totalement illégitime de partir, en l’inversant, du titre du roman que James Joyce consacra en 1916 à la trajectoire intellectuelle, religieuse et esthétique de son alter ego, Stephen Dedalus, un jeune homme qui choisit de se consacrer à l’art afin de mettre à distance les fausses opportunités du monde moderne. Car cette enquête est bien, elle aussi, un roman : le roman des apprentissages de jeunes peintres suisses, quasi contemporains de Dedalus et de Joyce, qui firent le choix à la fois nécessaire et difficile de venir dans la capitale parisienne dans la seconde moitié du XIXe siècle pour y accomplir leur rêve de devenir artiste. Des jeunes gens, en majorité des hommes, mais Coraline Gajo sait accorder l’attention qu’elles méritent aux passionnantes figures féminines, plutôt bien nés, les « juniors des classes dominantes », qui refusèrent les carrières bourgeoises qui s’offraient à eux, acceptèrent « l’insécurité psychologique et par intermittence matérielle » (P. Bourdieu), sortirent en apparence de leur monde, de leur ville et de leur canton, de leur famille pour tenter d’investir un univers social en plein bouleversement : le champ artistique parisien, prestigieux mais instable, prometteur et risqué, si proche géographiquement et si loin symboliquement.
Comme dans tout bon roman d’apprentissage, Coraline Gajo sait décrire et interpréter les tribulations de ces artistes en devenir, les difficultés financières ou relationnelles qu’ils rencontrent, les illusions et les désillusions devant les conditions véritables de la formation artistique, l’évolution des manières de faire carrière, de se faire un nom, de vivre ou non de son art. Cette histoire au quotidien n’est pourtant pas une histoire de détails : elle lui permet, au contraire, de comprendre parfaitement les enjeux majeurs de ce qui se joue autour et avec ses personnages, c’est-à-dire à la fois les effets de la formation du champ artistique moderne (les Salons, les revues, les rivalités d’atelier) et les conséquences de l’essor de ce que Nathalie Heinich a qualifié de modèle vocationnel. Une double perspective donc sur ces artistes, heureux ou malheureux, promis au succès ou rapidement relégués aux marges du nouveau panthéon artiste, que résume bien le terme de trajectoire : il renvoie aussi bien à la personne qui se déplace, le jeune homme ou la jeune femme qui considère qu’il faut aller à Paris pour réaliser le rêve d’être enfin artiste, qu’ à la configuration de l’environnement dans lequel il ou elle le fait. Le livre est
donc tout sauf une collection d’anecdotes ou une série de portraits, même s’il repose sur une documentation archivistique exceptionnelle par sa richesse et par sa diversité. C’est une véritable enquête d’histoire sociale comparée sur « la vie d’artiste », « la Bohème », la formation des écoles « nationales » dans l’internationalisation des carrières et des marchés, le fonctionnement de « l’idée de vocation » et ce qu’elle conduit à faire, que l’on découvrira ici. Le livre est à la hauteur de ces grandes ambitions théoriques et méthodologiques et il faut donc prendre le temps d’en souligner quelques-uns des apports.
Le premier concerne l’interprétation à la fois neuve et suggestive que Coraline Gajo donne de la géographie des échanges culturels et artistiques dans la seconde moitié du XIXe siècle, de la dynamique sociale de l’attractivité parisienne, des formes et des ressorts de la domination symbolique. La thèse reprend ici et discute avec de nouveaux arguments les analyses classiques de Pascale Casanova et Christophe Charle, notamment, sur les capitales culturelles et littéraires, de Gisèle Sapiro sur la circulation des biens et des réputations littéraires : elle dévoile les ressorts de l’attirance qu’exerce Paris dans un moment décisif de bouleversement des carrières artistiques et de la condition artiste, en partie comparable à ce que Pierre Bourdieu avait observé dans Les règles de l’art, à propos de la littérature et de la bohème littéraire de « l’art pour l’art ». Pour ces hommes et ces femmes qui quittent plus ou moins durablement la Suisse pour venir se former et s’informer dans les ateliers parisiens, prendre part à la nouvelle manière d’être artiste, venir dans la capitale c’est s’acquitter d’une quasi-obligation, accomplir une étape difficile mais nécessaire pour réaliser leur vocation et devenir ce qu’ils pensent être appelés à être. Vocation et mobilité (ou exil) vont ainsi de pair. La démonstration de Coraline Gajo s’inscrit en cela de manière parfaitement convaincante dans le prolongement des grands travaux de la sociologie de la circulation culturelle et des pratiques culturelles que l’on vient d’évoquer, mais aussi dans le sillage des enquêtes sur les transferts culturels de Michel Espagne et Michael Werner.
Le deuxième apport du travail de Coraline Gajo réside dans un déplacement décisif de la question de la formation artistique, qu’elle fait passer d’une étude de l’apprentissage technique ou des techniques (le dessin sur le modèle, la copie etc.) à une analyse de l’acquisition d’un habitus spécifique par les acteurs. En venant à Paris, en vivant la bohème parisienne, en fréquentant d’autres artistes exilés ou déplacés, d’autres compagnons d’ateliers qui connaissent les mêmes inquiétudes et partagent les mêmes ambitions, ceux-ci ne cherchent pas seulement à acquérir un savoir-faire précis mais aussi un savoir-être, une manière de se penser et d’agir, de marquer son statut. On l’a dit, la thèse prend ainsi des allures de roman sociologique d’apprentissage, qui nous fait suivre les pérégrinations, les illusions et les désillusions, les rencontres et les amitiés des agents, et qui montre qu’à travers ces péripéties apparemment banales se joue en fait à la fois un changement individuel majeur pour les protagonistes – le « Je serai artiste !» titre de la thèse – et un bouleversement collectif du statut de peintre avec l’avènement du marché roi.
Ce déplacement de l’attention vers l’habitus artiste n’est possible qu’à la faveur d’un pari documentaire parfaitement réussi qui constitue le troisième apport majeur de ce travail : s’appuyer sur les écrits du for privé, les journaux, les autofictions, les correspondances abondantes, jusque-là peu sollicités par les travaux d’histoire sociale de l’art et des artistes, qui se sont longtemps montrés plus sensibles aux questions relatives aux relations avec les commanditaires, aux formes de financement et de consécration, au rôle des institutions comme les Salons, les Académies et les revues. On pourrait, à première vue, juger qu’il y avait probablement peu à tirer de ces récits du quotidien artiste à Paris, de ces plaintes répétitives sur le manque de ressources, les plaies d’argent et les logements trop froids et trop petits, de ces descriptions morcelées et en apparence convenues. C’est pourtant tout le contraire qui apparaît dès lors qu’on les étudie systématiquement, de manière comparative et contextualisée. Car en portant au jour les conditions de leur écriture, Coraline Gajo montre qu’ils participent pleinement de l’expérience parisienne et de l’apprentissage, non d’un simple métier mais d’une condition, et qu’ils contribuent à forger une identité helvétique spécifique absente avant le voyage et « l’exil » parisien.
Olivier Christin
Remerciements
Première
2.2 Mobilité et dépaysement, récit d’un voyage
2.3 Découvrir Paris, de l’exaltation à la déception
1.1 Écrire pour atténuer l’absence
1.2 Le rituel de l’écriture et ses contraintes
1.3 Le revers de la correspondance
Récits d’une jeunesse
2.2 Récits d’artistes
Deuxième partie – Paris enseigne
Chapitre 3 : L’apprentissage idéal à l’épreuve
1. La formation rêvée
1.1 La traditionnelle École des beaux-arts, crainte ou désintérêt ? . . .
1.2 L’accumulation des savoirs .
2. L’apprentissage en classe, le mythe tutélaire du maître
2.1 Le maître absent et irrégulier
2.2 S’éloigner du maître
2.3 Les divergences esthétiques : bifurcations
2.4 Les désaccords idéologiques : la rupture
Chapitre 4 : L’atelier, de la plaisanterie à la xénophobie
1. La culture d’atelier du bizutage au rite de passage
1.1 L’arrivée du nouveau
1.2 De la créativité à la vulgarité
1.3 L’illusoire sororité
2. L’humour sur fond de xénophobie
2.1 Les querelles patriotiques
2.2 L’envahissement des étrangers
Chapitre 5 : Au-delà de l’atelier
1. De l’émulation à l’entraide
1.1 S’exercer entre condisciples
1.2 Se réunir entre condisciples
2. L’apprentissage dans Paris
2.1 Le Louvre, à la fois professeur et modèle
2.2 Maîtres et modèles muets dans les rues de Paris
2.3 Les jardins de Paris, théâtres silencieux
Troisième partie – Le fantasme parisien
Chapitre 6 : La bohème, du rêve à la réalité
1. Vivre en artiste, vivre en bohème ?
2. Vivre en bohème, vivre libre ?
Chapitre 7 : Paris comme foyer
1. Les Helvètes à Paris, la quête identitaire
De l’impossibilité de conserver son helvétisme
De la nécessité de « s’emparisianiser
2. L’Helvète à la recherche d’une position sociale
2.1 Accepter le déclassement
2.2 Reclassement helvétique au sein du foyer
2.3 Se reclasser, au-delà de l’habitat
2.4 Oser le surclassement
3. L’Helvète à la recherche de l’amour
3.1 Expériences et découvertes
3.2 Les lieux de l’amour
3.3 L’âme sœur artistique
Chapitre 8 : Paris comme enjeu
1. La dette originelle
1.1 Échelonner sa dette
1.2 La nation comme créancière
1.3 L’implication parentale
2. Les illusions perdues
2.1 L’étape du Salon
2.2 La fin des études
2.3 Rester ou s’en aller…
Annexe 1 – Liste des artistes
Annexe 2 – Inventaire des sources
Annexe 3 – Liste des correspondants/es
Annexe 4 – Âge des artistes
Annexe 5 – Générations d’artistes
Annexe 6 – Les artistes suisses à L’école des beaux-arts
Annexe 7 – Les formations parisiennes des artistes suisses
Annexe 8 – Adresses et loyers des artistes à Paris
Annexe 9 – Dépenses des artistes
Annexe 10 – La fin de la formation
Derrière chaque thèse publiée, il y a un chemin fait de lectures, de réflexions, mais aussi de voix amies, de regards bienveillants et de présences discrètes, mais essentielles. Ce livre porte la trace de toutes ces influences, et ces remerciements en sont le modeste écho.
Merci à mes directeurs de thèse, Olivier Christin et François-René Martin, pour m’avoir accompagnée et soutenue durant ces années de recherches, pour leurs conseils avisés et leur bienveillance. Merci aux membres de mon jury Valentine von Fellenberg, Clémentine Vidal-Nacquet et Laura Karp-Lugo pour avoir accepté de relire mon travail avec un regard critique, mais constructif.
Merci aux éditions Schwabe, et plus particulièrement à Fabrice Flückiger, dont les conseils avisés m’ont accompagnée depuis le commencement de la thèse jusqu’à sa publication.
Si ce travail a souvent été solitaire, il a été porté par de nombreux échanges et soutiens. Merci à Aude Monié, Anne-Valérie Zuber et Magali Michelet pour leur indéfectible présence, ainsi qu’à Marc Aberle, Catherine Herr-Laporte et Eléna Guillermard, Clara Lespessailles et Raphaël Villanueva pour leurs précieux conseils. À la chaire d’histoire moderne, Olivier Lamon, Henri-Pierre Mottironi et Lucia Arboux-Beauquier, des compagnons de route essentiels. Un grand merci à Nadine Eschmann pour son soutien constant, et à Edwige Guyot-Vez, Anne-Lise Gajo, Patricia Jan-Guyot, Francine et Yves Petitpierre pour leurs relectures attentives. Merci également à Olivier de Beaumont, dont l’aïeul fut le point de départ de cette recherche.
Ce travail a grandement bénéficié des sources consultées grâce au soutien précieux de nombreuses personnes et institutions. Je tiens à remercier notamment Bernadette Walter, Geneviève Grandjean, Marco Giacometti, AnneCatherine Krügger, Jean-Dominique Lormand, Philippe Kaenel, Paul Müller, Sylvie Genoud-Jungo, Martine Noirjean de Ceunick, Susanna Tschui, Virginie Piller, Sylviane Messerli et Matthias Brefin pour leur aide, leurs conseils, l’accès aux archives ou encore leurs échanges enrichissants.
Je souhaite exprimer encore ma plus profonde gratitude à mes parents, Jean-Michel et Edwige, à ma sœur Audrey, à ma grand-maman Renée, ainsi qu’à ma belle-famille – Laurent, Anne-Lise, Nicolas, Elias, Tania, Anaïs, Andrea et Marie. Chacun, à sa manière, a joué un rôle essentiel dans l’aboutissement de cette
thèse, que ce soit par ses réflexions, son soutien ou les précieux moments de rires partagés.
Merci également à mes amies et amis, qui ont accepté d’écouter sans relâche mes discussions sur mes recherches et, surtout, qui m’ont permis de m’en évader lorsque cela était nécessaire : Morgane, Sabrina, Gaël et Anthony.
À mon mari Matthias qui a partagé chaque étape de cette thèse à mes côtés.
À mon fils Elyo, dont l’arrivée a certes rendu la fin de cette thèse plus complexe, mais aussi infiniment plus belle.
À ma fille, qui viendra au monde presque en même temps que ce livre.
Dans un souci d’authenticité, nous avons pris le parti de retranscrire toutes les sources en l’état sans intervenir sur l’orthographe ou les fautes de syntaxe. L’étude rassemblant à la fois des sources d’archives et des sources publiées, nous souhaitions rendre le lecteur, la lectrice attentive aux éventuelles inégalités de retranscriptions puisque certaines ont pu faire l’objet de corrections avant publication. Ce choix étant systématique, nous n’avons pas signalé chaque faute de la mention (sic).
En octobre 1888, nous étions prêts à partir. Tôt le dimanche matin, nous descendîmes à la Gare de l’Est et fûmes accueillis par le plus brillant des soleils matinaux parisien. Je vois encore la sciure jaune blanchâtre et le serveur au long tablier blanc qui, après notre premier français approximatif, nous apportait le café et les premiers croissants. Je nous vois encore sur le banc du boulevard en train de consulter le plan de la ville que nous venons d’acheter pour savoir comment se rendre au plus vite au Pont-des-Arts et au Quartier latin.
Cuno Amiet, Erinnerung aus meiner Pariser Zeit, 1934.
Eh bien non, je n’ai pas voulu t’écrire parce que si je l’avais fait, je serais surement parti chez vous avec la lettre ; la semaine passée a été terrible, j’ai eu des moments comme j’espère ne plus jamais en avoir, découragé, abattu, avec une peur terrible de ce grand Paris où je me sentais si seul ! …. Tout cela je l’ai bien vu après, c’était de l’ennui, je vous avais tous constamment devant les yeux, j’ai dû lutter, je voulais partir, fuir tout ce bruit de la grande ville …. Si tu as passé déjà par de tels moments tu dois me comprendre, sinon tu ne peux te faire une idée de ce que c’est et tu croiras que je blague ………. d’ailleurs on invente pas ces choses-là !
Lettre d’Edmond Bille à sa mère Caroline Bille, 18951
Le 1er novembre 1895, à Paris depuis quelques mois déjà, Edmond Bille, écrit à sa mère pour justifier l’absence de lettres des derniers jours. Dans la capitale pour se former à l’Académie Julian et à l’École des Arts décoratifs, le Neuchâtelois raconte les désillusions, les difficultés, l’éloignement de ses proches et le dépaysement complet qui, durant plusieurs jours, l’ont contraint au silence2. L’envers de l’expérience parisienne semble être, tout entier, cristallisé dans ce court extrait qui dépeint le séjour sous un angle nouveau. Au cours du xix e siècle, l’apprentissage artistique s’articule autour de diverses injonctions, dont le détour par l’étranger fait partie. Les artistes en herbe, prêts à renoncer à leur patrie, préfèrent ainsi au « poids de
1 Lettre d’Edmond Bille à sa mère Caroline Bille, 1er novembre 1895, Paris, Archives de l’État du Valais, Fonds Edmond Bille, fonds principal, 189. La citation précédente, de Cuno Amiet date de 1934, mais est reproduite dans une publication plus tardive : C. Amiet, Die Freude meines Lebens : Prosa und Poesie, Stäfa, Rothenhausler, 1987, p. 19. Traduit de la source originale : « Im Oktober 1888 waren wir zur Abfahrt bereit. Am frühen Sonntagmorgen stiegen wir in der Gare de l’Est aus und wurden empfangen vom hellsten Pariser Morgensonnenschein. Ich sehe noch das weisslichgelbe Sägemehl und den Kellner mit der langen weissen Schürze, der uns nach unserem ersten hergestaggelten Französisch den Kaffe brachte mit den ersten Croissants. Ich sehe uns noch auf der Boulevardbank den eben gekauften Stadtplan befragen, wie man am kürzesten zum Pont-des-Arts und in das Quartier Latin komme ».
2 Pour la question de l’absence et du manque à travers les relations épistolaires, les travaux de Clémentine Vidal-Naquet ont été particulièrement utiles. Elle développe cela pour les couples en temps de guerre et bien que le contexte et l’éloignement physique y soient régis par une expérience bien plus douloureuse, le rituel épistolaire, lui, répond à des normes similaires, voir : C. Vidal- Naquet, Couples dans la Grande Guerre : le tragique et l’ordinaire du lien conjugal, Paris, Les Belles Lettres, 2014, p. 246–247.