SEPTEMBRE 2025
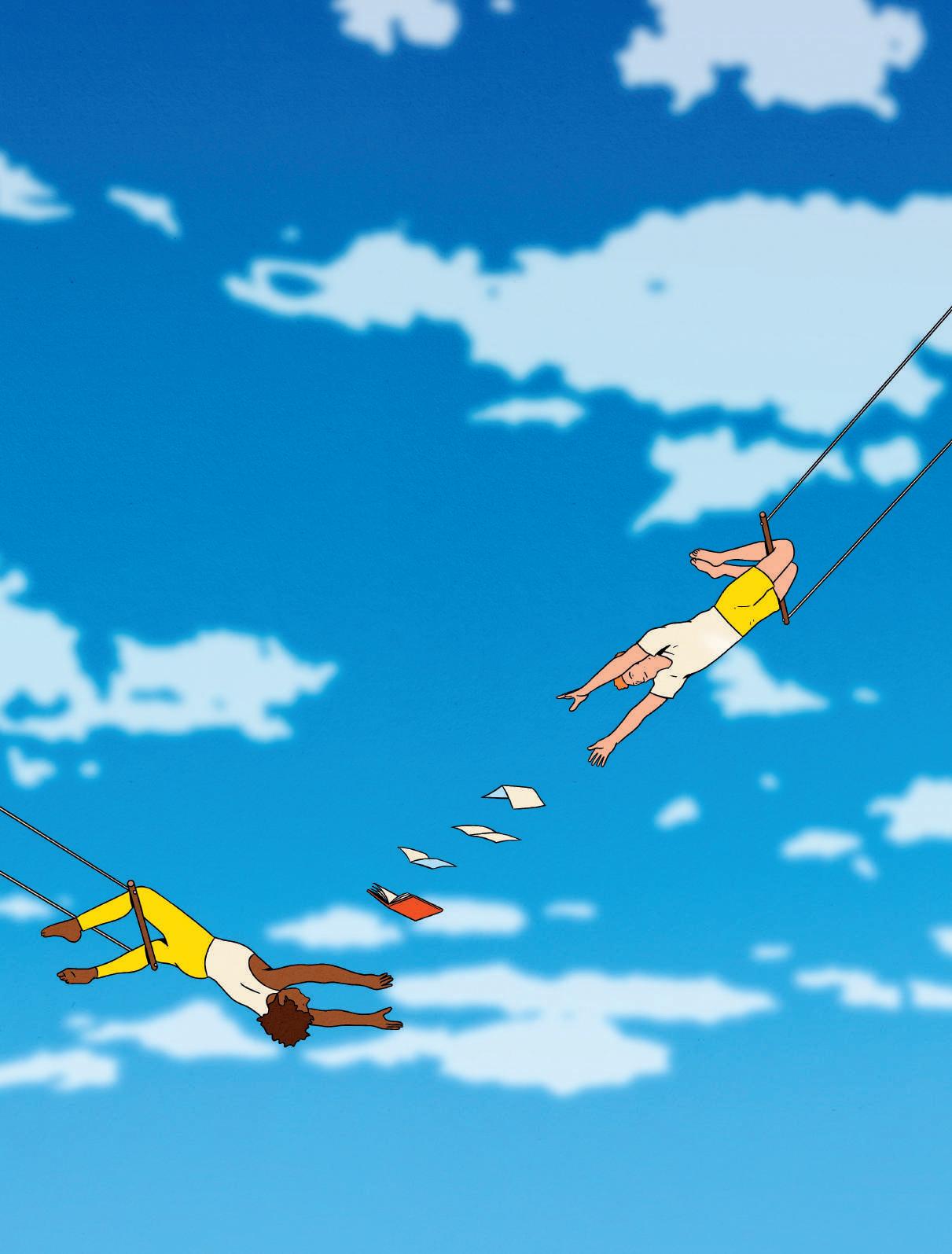
À voir
Spécial rentrée culturelle
Municipales 2026
La culture à Strasbourg
Dossier
Apprendre des Peuples Racines.
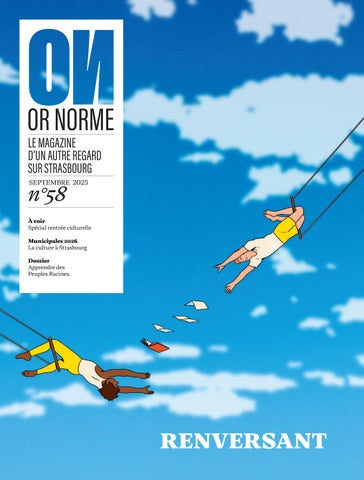
SEPTEMBRE 2025
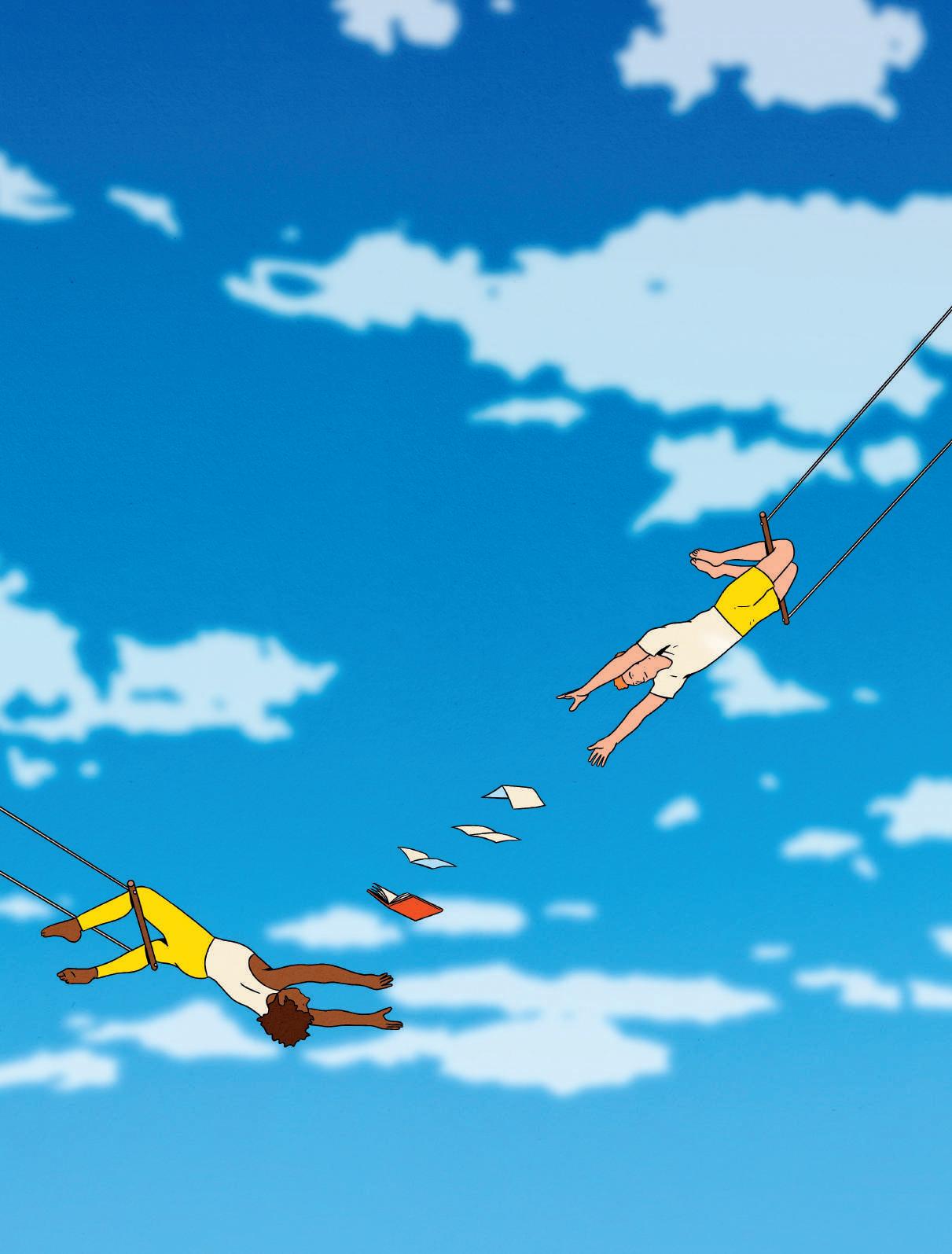
À voir
Spécial rentrée culturelle
Municipales 2026
La culture à Strasbourg
Dossier
Apprendre des Peuples Racines.
Par Patrick Adler, directeur de la publication et de la rédaction.
renverse
Tout existe et bouge sans toi.
Quelle mise en garde dans ces vers d’Aragon !
Ils nous rappellent que rien n’est jamais acquis. Rien. Ni la stabilité d’une société, ni les valeurs collectives, ni même ce que nous pensons immuable. Dans un monde où les repères que l’on croyait solides se fissurent et où les signes de fragilité de nos sociétés se multiplient, l’inversion des repères, hier encore impensable, s’installe dans nos vies quotidiennes.
La vérité n’est plus une quête commune, mais un champ de bataille. Les rumeurs, les complots ou les « faits alternatifs » prospèrent dans le tumulte des réseaux sociaux. On en est venu à mettre sur le même plan la rigueur du travail scientifique et le soupçon sans preuve, la parole d’experts et le tweet anonyme. Quand la vérité et les valeurs se renversent, c’est la confiance dans la démocratie elle-même qui vacille.
C’est ce qui permet à Pierre Assouline, grand écrivain et témoin averti de notre époque, d’évoquer dans l’interview qu’il nous a accordée (page 62) la « dérive vers une démocratie illibérale » qui est devenue « une réalité presque mondiale. »
Or, quand les valeurs fondatrices sont renversées, ce n’est pas un simple changement de décor. C’est le socle lui-même qui se dérobe. Que devient la démocratie si la parole publique est réduite à un vacarme où tout se vaut ?
Certes, une société qui ne change pas se fige et se condamne. Mais l’histoire enseigne qu’un basculement radical, un renversement complet de repères, porte en lui les germes de la violence.
Autre renversement : celui du rapport à l’autorité et à la loi. Là où l’État de droit devrait garantir l’égalité et la sécurité, on voit la défiance grandir, alimentée par des discours qui glorifient la violence ou le refus des règles. L’Histoire nous apprend qu’un monde où les repères s’inversent, bascule généralement très vite dans la brutalité. Lorsque la vérité n’a
plus de valeur, c’est la propagande, la désinformation et la manipulation qui triomphent. Lorsque la loi est méprisée, c’est celle du plus fort, ou du plus violent, qui s’impose. Lorsque la liberté est dévoyée, c’est l’anarchie ou la tyrannie qui guettent. Nous en percevons déjà les échos : ultra violence dans certains quartiers devenus de « non-droit », agressions contre des élus, attaques contre des journalistes, polarisation extrême du débat public. Autant de signaux qui rappellent que la civilisation est un fil ténu, toujours susceptible de se rompre.
Et le très beau dossier sur la sagesse des peuples racines que vous retrouverez dans ce numéro (page 88) vous permettra de vous interroger sur ce qu’est réellement une civilisation, qui ne peut survivre que sur des valeurs profondément ancrées dans ce que l’Humanité peut produire de plus beau... et de plus sage !
La vigilance et la bienveillance dont nous devons tous faire preuve pour préserver notre humanité ne doit évidemment ni nous conduire à refuser le changement, ni à considérer naïvement que tout est acceptable, mais à discerner ce qui peut évoluer sans détruire le socle commun de notre civilisation. Préserver la dignité humaine, le respect de la vérité, la primauté du droit : voilà des repères qui ne relèvent pas de la nostalgie, mais de la nécessité.
Aragon nous avertit : nul n’est maître de l’Histoire, et la vapeur peut se renverser à tout moment. Mais il nous appartient de ne pas laisser l’inversion totale balayer ce qui nous unit. La question n’est pas de savoir si le monde changera – il change sans cesse –, mais si nous aurons la lucidité de sauver ce qui fonde encore notre humanité, de demeurer les gardiens vigilants du respect et de la dignité.
Sinon la vapeur, une fois renversée, pourrait bien nous entraîner jusqu’à l’abîme. ←
Spécial rentrée culturelle 8
Les Carnets Or Norme 22
Reportage
Bars de vie(s) ↓
Quand les bars deviennent des scènes culturelles à part entière.
26
Actualités
L’étoffe du courage
Une lingerie qui redonne forme à l’invisible.
32
L’enfance comme terrain de liberté
Le réseau de micro-crèches Krysalis s’apprête à souffler ses dix bougies.
34
Quai de scène, acte II À l’aube d’une première saison complète.
38

Rencontres
Au Zénith avec Sylvie Chauchoy 40
Sur la pelouse avec Pierre Habourdin & Jean-Michel Heintz 44
À la Cour européenne des droits de l’homme avec Mattias Guyomar 46
Au potager avec Simon Le Mellec 50
Au Petit Tigre avec Frédéric North 52
Sur le toit du monde avec Constance Schaerer ↓ 54
Au bureau avec Stéphane Libs 58
L’interview
Pierre Assouline 62
Dossier Municipales 2026
La culture à Strasbourg 70
Décryptage
La culture strasbourgeoise en chiffres.
84


Rénovation Grange - Geispolsheim HABITAT . RETAIL . TERTIAIRE . SANTÉ
L’inventaire
Dans les coulisses, c’est le show ! 86
Dossier ↓
Apprendre des Peuples Racines. 90
Business
Comment ça va chez... Batorama 100
Portfolio ↘
Simon Bailly 104
Le jour où... est né le drapeau européen
Chronique Histoire 112
La guerre en un cliché Chronique d’Ukraine 116

Or Norme n° 58 – Septembre 2025 est une publication éditée par Ornormedias 1 rue du Temple Neuf – 67000 Strasbourg. Dépôt légal : à parution – N°ISSN : 2272-9461 contact@ornorme.fr – www.ornorme.fr Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, X & Linkedin
Couverture Illustration par Simon Bailly Instagram : @simonbailly
Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Adler (patrick@adler.fr)
Directrice Projet Lisa Haller (l.h.)
Publicité Régis Pietronave (publicité@ornorme.fr)
Lettre versane 3
Chronique d’Ailleurs 118
Strasbourg dans tous les sens Chronique Patrimoine 120
Crocs, cru, et crédulité Chronique Vins 122
Trop vite
Chronique Parti-Pris 124 ☛
Sélections par la rédaction de Or Norme 128 ☛ Or Champ par le professeur Patrick Pessaux 134

Rédaction (redaction@ornorme.fr)
Vanessa Chamszadeh (v.c.) – Salomé Dollinger (s.d.)
Hélène Edel (h.e.) – Jean-Luc Fournier (j-l.f.) – Guylaine Gavroy (g.g.)
Thierry Jobard (t.J.) – Véronique Leblanc (v.l.) – Alain Leroy (A.l.)
Olivier Métral (o.m.) – Christophe Nonnenmacher (c.n.)
Jessica Ouellet (J.o.) – Maria Pototskaya (m.p.)
Barbara Romero (b.r.) – Sébastien Ruffet (s.r.)
Photographie Pascal Bastien – Line Brusegan
Tobias Canales – Alban Hefti – Abdesslam Mirdass
Simon Pagès – Laetitia Piccarreta – Caroline Paulus
Sabrina Schwartz – Christophe Urbain
Direction artistique et mise en page
Cercle Studio (cerclestudio.com)
Impression Imprimé en CE
RETROUVEZ-NOUS À LA PLACE DE L’ANCIENNE PÂTISSERIE PATRICK, À L’ANGLE DU BOULEVARD DE LA DORDOGNE ET DE L’ALLÉE DE LA ROBERTSAU

Du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 19h
Du mardi au samedi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 21h et le dimanche de 8h à 14h 116 GRAND’RUE
LA HALLE DU MARCHÉ GARE
THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Après une flamboyante première saison-signature fréquentation en hausse de 38 % ! — Caroline Guiela Nguyen, directrice du TNS, affiche sa volonté de continuer à « travailler à la naissance du public » en échappant à « deux écueils mortifères », « le populisme et l’élitisme ». Ne lui parlez pas d’« humanisme » ou de « démocratisation », mots aux relents de « mépris de classe » qu’elle rejette. Son ambition est de « servir la beauté qui est partout » et d’ouvrir grand les portes du théâtre. Au programme de cette saison 25-26 : 19 spectacles, 7 créations, 7 productions, 10 coproductions dont Sepukku El funeral de Mishima, prochain opus de la célèbre metteuse en scène Angelica Lidell (29 janvier-7 février) ou bien encore les nouveaux épisodes de Radio Live où Aurélie Charon rencontre la jeunesse des pays en conflit (7-15 janv.). Valentina de Caroline Guiela Nguyen ouvrira la saison (16 sept-3 oct.) en posant la question de la langue du pays où l’on vit sans y être né. Un verrou trop souvent négligé auquel le TNS a décidé de s’attaquer en proposant, pour sept spectacles, un surtitrage puisé dans dix langues parlées à Strasbourg. Andromaque mis en scène par Stéphane Braunschweig sera ainsi surtitré en dari, pachto ou grec (3-18 déc.). Les Galas se poursuivront avec la participation d’habitants de Strasbourg dans des créations telles que En attendant Oum Klthoum d’Hatice Özer (3-7 mars). Et le Comedy Club reviendra après avoir fait salle pleine la saison dernière. Rire c’est aussi servir la beauté. v.l.
→ En photo : Valentina de Caroline Guiela Nguyen ouvrira la saison du 16 septembre au 3 octobre.

Toujours pertinente, Barbara Engelhardt interroge la démocratie et la citoyenneté dans son édito de rentrée et en appelle aux arts pour créer l’ambiguïté, « levier de la réflexion » indispensable à une « véritable liberté d’expression ». Les artistes, dit-elle, invitent à expérimenter la « tolérance des divergences » dans une société encline aux polarisations. Ce thème sera d’ailleurs au cœur du Temps fort du premier semestre de cette saison 25-26. Douze spectacles sont au programme d’ici décembre, douze moments de théâtre, danse, musique et cirque qui aborderont les thèmes aussi actuels que le transhumanisme, la confrontation pourquoi pas joyeuse des « identités », les vertiges d’un monde suffoquant à force de connexions, les violences sexuelles, la fragilité de la masculinité, l’indestructible besoin d’amour, etc. De retour au Maillon du 15 au 17 octobre, Tiago Rodrigues, actuel directeur de Festival d’Avignon, proposera La Distance, une dystopie futuriste où un père resté sur Terre dialogue avec sa fille qui a migré sur Mars. Le lien intime subsiste au-delà de l’expérience collective de la finitude et il pose cette question douloureuse : comment une société est-elle amenée à chercher un ailleurs pour survivre ? v.l.
→ En photo : La Distance, écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues. Avec Adama Diop et Alison Dechamps, du 15 au 17 octobre au Maillon.
Face aux coups de boutoir qui assaillent la culture en cette rentrée de tous les dangers, les salles de Strasbourg et au-delà ne baissent pas les bras. Programmations foisonnantes, pertinence et exigence sont une nouvelle fois au rendez-vous. Pour s’émouvoir, vibrer, réfléchir, réapprendre à écouter l’autre et rire dans un moment partagé. Opéra, théâtre, musique, danse, nouveau cirque, le choix est vaste. À vous d’y trouver votre bonheur.

Opéras du répertoire, œuvres rares et redécouvertes
(Le Miracle d’Héliane de Korngold du 21 janvier au 1er février) ponctués de comédies musicales, Alain Perroux signe sa dernière programmation à la tête de l’Opéra national du Rhin en appliquant la recette qui a fait le succès de son mandat. À l’aube de cette nouvelle saison, il peut revendiquer un taux de remplissage de plus de 92 % en moyenne et des recettes propres en augmentation de plus de 26 %. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Placée sous le signe du théâtre, la programmation à venir se veut une « discrète réflexion sur la vanité terrestre et le pouvoir incommensurable du temps », écrit Alain Perroux dans son édito de rentrée. « N’être pas dupe des apparences, se défaire des illusions, traquer la vérité sous les fake-news, révéler le vrai grâce au masque, voilà sans doute quelques-unes des fonctions essentielles du théâtre qui le rendent si nécessaire à nos démocraties ». Neuf opéras et comédies musicales, sept ballets et cinq récitals ponctueront une programmation convaincue que le spectacle doit continuer dans une époque troublée. Avec, parmi les nouvelles productions, Otello de Verdi dirigé par Speranza Scappucci du 29 octobre au 9 novembre en ouverture de saison, Le Roi d’Ys d’Édouard Lalo qui marquera le retour d’Olivier Py du 11 au 19 mars, Les Noces de Figaro de Mozart dirigées par Corinna Niemeyer et mises en scène par Mathilda du Tillieul McNicol du 28 avril au 7 mai ou bien encore la comédie musicale américaine Follies de Stephen Sondheim et James Goldman proposée du 7 au 12 juin avec la soprano Natalie Dessay. v.l.
→ En photo : Le Miracle d’Héliane, trésor oublié d’Erich Wolfgang Korngold sera dirigé par Robert Houssart dans une mise en scène de Jakob Peters-Messer du 21 janvier au 1er février.
POLE-SUD — CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE STRASBOURG

Rester proche mais partir vers l’ailleurs, ouvrir des imaginaires tout en pensant le monde, créer des rencontres avec « la danse comme seul outil »... dans son édito de rentrée, Joëlle Smadja, la directrice de POLE-SUD a su trouver les mots pour accompagner sa 36e et dernière saison à la tête du Centre de développement chorégraphique national de Strasbourg. Celle-ci sera rythmée par 32 spectacles où se succéderont nouvelles têtes d’affiche et complices de longue date. Au rang des fidèles, on peut citer l’inclassable chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin dont toutes les pièces ont été programmées à POLE-SUD. Elle reviendra avec ses compatriotes du Garage Dance Ensemble, les 18 et 19 novembre, pour présenter How in salt deserts is it possible to blossom (Comment peut-on fleurir dans un désert de sel). Une ode à la vitalité de ceux qui sont dominés. Désormais bien installé, le festival L’Année commence avec elles se tiendra du 15 au 29 janvier. Huit spectacles conçus par des artistes chorégraphes femmes jalonneront ce cycle qui se terminera avec Maldonne de Leïla Ka les 28 et 29 janvier. Cinq femmes s’emparant d’une quarantaine de robes exploreront le féminin sous toutes ses coutures. Une pièce de corps et de lutte. Intensément vivante. v.l.
→ En photo : Robyn Orlin – Garage Dance Ensemble – UKhoiKhoi présenteront How in salt deserts is it possible to blossom les 18 et 19 novembre à POLE-SUD
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

Distingué « meilleur orchestre 2024 » par Radio Classique, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg est suivi par quelque 2 300 abonnés rejoints par un public de plus en plus diversifié. En témoigne le succès des Concerts relax et de L’Heure joyeuse qui seront reconduits cette année. Des concerts des pianistes Alexandre Kantorow (2 octobre), Anna Vinnitskaya (21 mai) et Alexandre Tharaud en duo avec le violoncelliste Jean-Guilhen Queyras (6 mars) jalonneront cette saison dont l’ouverture sera consacrée à la Symphonie alpestre de Strauss dirigée par Aziz Shokhakimov le 11 septembre. Des musiques de films aussi, et non des moindres avec, notamment, Metropolis et Star Wars les 28 et 29 avril. Louise Farrenc ou bien encore Marie Jaëll disparue il y a cent ans compteront au rang des compositrices à redécouvrir. La seconde, Alsacienne élève de Saint-Saëns à Paris et pédagogue novatrice, sera célébrée le 5 novembre en l’église Saint-Guillaume avec le pianiste Adam Laloum. Occasion aussi de découvrir en avant-première le documentaire que lui a consacré Damien Fritsch. Citons aussi un concerto de Karol Szymanowski le 12 février, un autre de Kurt Weill le 21 mai ou encore, la Sinfonia concertante pour piano et violoncelle d’Oscar Strasnoy en création mondiale le 6 mars. Il s’agit d’une commande de l’OPS et de la Philharmonie de Paris aux deux complices que sont Alexandre Tharaud et Jean-Guilhen Queyras. v.l.
LA LAITERIE

Saison d’exception pour La Laiterie qui célébrera le 24 avril 2026 la réouverture de sa salle après deux ans de rénovation. Avec, pour marquer l’événement, un concert de Last Train, sold out en deux heures (!), tout comme la seconde date annoncée pour le 25, complète en moins d’une journée. Les quatre Sundgauviens qui ont enflammé la Greenroom de Belfort cet été étaient décidément très attendus après avoir séduit maintes scènes européennes cette année. D’ici la réouverture de sa salle historique, Artefact Prl poursuit sa proposition La Laiterie on Tour, formule hors les murs permettant de continuer à offrir une proposition dans des lieux tels que Le Point d’eau à Ostwald, L’Illiade à Illkirch, La Briqueterie à Schiltigheim, la Halle verrière à Meisenthal, l’église Saint-Pierre-le-vieux et le PMC à Strasbourg. À noter, dans une programmation foisonnante, Popa Chubby (16 novembre au Point d’eau), The Limiñanas (20 novembre à l’Illiade), Oxmo Puccino (13 décembre à la Briqueterie), Cœur de Pirate (26 février au Point d’eau) ou bien encore Dead South (22 mars à La Briqueterie). Événement à ne pas manquer, le concert du groupe norvégien de néofolk Wardruna qui fera étape au PMC le 8 décembre dans le cadre de sa tournée mondiale avec la voix à nulle autre pareille du chanteur et compositeur Einar Selvik. Retour à la grande salle de La Laiterie le 26 avril avec un concert tout juste annoncé de Bertrand Belin, prémices à une programmation qui sera progressivement mise à jour sur le site. v.l.
→ En photo : Wardruna en concert le 8 décembre au PMC.
TAPS — THÉÂTRE ACTUEL ET PUBLIC DE STRASBOURG

1500 s
Vingt-six spectacles sont à l’affiche du TAPS pour cette saison 2025/2026. Autant de moments d’énergie théâtrale, le plus souvent en résonance avec les questionnements contemporains. Dans Cortex/Diptyque (du 4 au 7 novembre) mis en scène par le directeur de la structure Olivier Chapelet, deux textes mis en miroir – écrits tout spécialement pour les acteurs
Pauline Leurent et Logan Person par Catherine Monin et Mélie Néel – jettent un pont entre écriture et scène pour traiter de la santé mentale avec émotion et humour. Ingrédients que l’on retrouve dans Deux ou trois choses dont je suis sûre, création de la jeune compagnie de L’Onde emmenée par Manon Ayçoberry. Une musicienne et trois comédiennes-karatékas s’y emparent d’un texte de Dorothy Allison, grande figure du féminisme des années 1970. Une histoire d’amour-haine écrite de Greenville, Caroline du Sud, un parcours de délivrance et de réparation, un combat organique sensible et drôle contre les assignations de genre ; ce sera du 7 au 11 octobre. Du 27 au 30 janvier, Le Talon rouge, autre compagnie strasbourgeoise, proposera Revenir de Guillaume Poix dans une mise en scène de Catherine Javaloyès. Deux frères et une sœur entrent par effraction dans leur maison d’enfance aujourd’hui habitée par d’autres. Une quête de nostalgie où les souvenirs des uns se cognent à ceux des autres dans le joyeux fracas d’une fratrie réunie envers et contre tout mais bien consciente qu’il lui faudra repartir. v.l.
→ En photo : Deux ou trois choses dont je suis sûre, création de la compagnie de l’Onde, au TAPS Laiterie du 7 au 11 octobre.
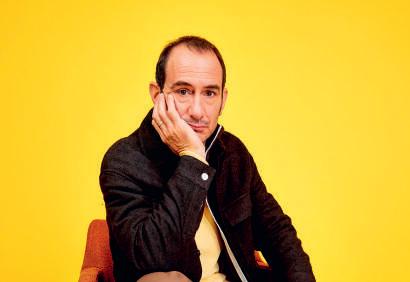
« Rions encore » enjoint Jean-Luc Falbriard dans l’édito de rentrée de l’Espace K, rions ensemble, rions même si « ça craint du boudin ! » à peu près partout et particulièrement dans le monde de la culture. Pas question de rire jaune pour le Capitaine Sprütz, « seul et unique héros de l’espace, sex-symbol de l’Alsace » qui dans sa Compile de rentrée (du 25 septembre au 4 octobre) proposera un regard décalé « cosmique et surtout comique » sur les affres de nos humaines destinées. Tout en poésie intergalactique et à la carte puisque les spectateurs choisiront en direct le contenu du spectacle.
Plus loin dans la saison, du 29 au 31 janvier, Yohann Métay livrera le troisième volet d’un triptyque existentialiste entamé avec La tragédie du dossard 512, poursuivi avec Le sublime sabotage et désormais bouclé avec La Solitudinnée ou l’incroyable retour de Tomy Paquet. Une route du Soi parcourue dans un seul en scène avec de grands moments de vertige explorés par le rire. « Vous savez... ces instants où on “dézoome” parce que, par exemple, une ola de stade de foot ben... y a des soirs où on ne la sent pas. »
Sans oublier, à la bascule 25-26, l’indispensable Krismass Show, plateau d’artistes au programme d’un décembre avec paillettes mais sans chichis. v.l.
→ En photo : Yohann Metay dans La Solitudinnée ou l’incroyable retour de Tomy Paquet, du 29 au 31 janvier.

« L’enfance est un trésor avec lequel nous naissons et que la vie, trop souvent, nous dérobe », écrit Kaori Ito, la directrice du Théâtre jeune public alias Madame TJP, personnage fantasque « qu’on appelle parfois une artiste », qui dira au public tout son amour en ouverture de saison les 7 et 9 septembre, avant de l’accompagner au long d’une programmation destinée à « toutes les jeunesses ». Du 3 au 11 octobre, Kaori Ito proposera sa nouvelle création Dance Marathon Express, spectacle en japonais surtitré en français qui explore la notion de don de soi enracinée au pays du soleil levant. Le voyage remonte la discographie japonaise des années 2000 aux années 30 et explore avec pudeur et émotion un thème lourd. Autre moment fort, du 14 au 21 novembre, Les Fantasticks, spectacle co-réalisé avec l’Opéra national du Rhin et mis en scène par Myriam Marzouki. Tout pétille dans cette comédie musicale librement inspirée des Romanesques d’Edmond Rostand.
Deux exemples parmi d’autres au sein d’une programmation attentive à l’intergénérationnel et soucieuse de partage. Seront ainsi poursuivis les extras Lieu commun du TJP, moments de rencontre tels que les Réveils créatifs pour inventer en famille avec les enfants, les Midis vivants, pour découvrir une forme courte, les Apéros artistiques partagés avec les deux artistes associées Delphine Lançon et Juliette Steiner et les soirées Radio plateau qui prolongent les spectacles. Pour le TJP, le spectacle vivant est à inventer par tous et tout le temps. v.l.
→ En photo : Dance Marathon Express, au TJP du 3 au 11 octobre.

Tourbillon de têtes d’affiche et de spectacles époustouflants pour les mois à venir au Zénith de Strasbourg, le plus grand de France, rappelons-le. En octobre, se succéderont, notamment, Julien Doré, Santa, Gims puis Amir, Hamza, Soprano, Louane, Pierre Garnier et M. Pokora programmés en novembre. Sans oublier Le Petit Prince sur la glace, spectacle musical qui revisite le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dans une fusion de patinage artistique, acrobaties, musique originale et technologies visuelles de pointe. Ce sera le 9 novembre, peu avant l’incontournable ballet Casse-Noisette programmé le 22 novembre et le 21 décembre en prélude à la magie des fêtes de fin d’année. Le combat de la petite fille et du bonhomme de bois contre les souris malveillantes ne cessera jamais d’émerveiller les petits et de fasciner les grands...
Au programme de janvier, toute la fougue sensuelle des Carmina Burana, chef d’œuvre de Carl Orff composé entre 1935 et 1936. Magistral. Suivront, entre autres artistes, La Fouine toujours en janvier, Eros Ramazzotti, Mika et Indochine en février, Kendji Girac en mars et, le 15 mai, le retour sur scène de Vanessa Paradis avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères. v.l.
→ En photo : Vanessa Paradis au Zénith le 15 mai 2026.

En ouverture de saison, le 20 septembre, l’Espace Django a misé sur la rumba congolaise réinventée par Kokowumba & Friends qui se produira après une Déambulation cyclo-sombrero emmenée par les deux musiciens de DosPaVos et un grand Boum sculpté par les Femelles du faisan, duo d’artistes performeuses. Fête et musiques, participation de tous et lien fort avec le quartier, tout est dit de l’esprit Django !
Le 3 octobre sera reggae avec le passage de Queen Omega, artiste à la voix puissante originaire de Trinité-et-Tobago. De ses débuts en Jamaïque à son succès mondial avec No Love Dubplate, elle marque les esprits avec des textes militants et une présence scénique inoubliable. Pour poser l’ambiance, en première partie, Django a fait appel à « la Mama du reggae alsacien » accompagnée de son bien nommé Sun System. Autres sons le 17 octobre avec la Fanfare Ciocarlia, une des plus réputées au monde. Originaire de Roumanie, elle draine une déferlante musicale 100 % tzigane et une puissance inégalée. À découvrir tout comme les autres pépites d’une programmation éclectique. v.l.
→ En photo : Queen Omega, le 3 octobre à l’Espace Django.

Pour sa troisième saison, l’association Passions croisées reste fidèle à son ADN : décloisonner les arts et les publics en mêlant art lyrique, pole dance, rencontres littéraires, etc. dans une église, Saint-Guillaume en l’occurrence. « Pari complexe », concède le directeur musical Cyril Pallaud, « mais passionnant ». Trois immenses artistes sont au programme des Récitals de cette édition : Martina Roussomanno, qui fut notamment le rôle-titre de Traviata cette année à l’Opéra National du Rhin, tout en étant soliste à la Scala de Milan ou au Festival de Salzbourg, qui se produira en partenariat avec les Bibliothèques idéales, le 26 septembre, Philippe Jaroussky, le 20 janvier, et Benjamin Bernheim qui décloisonnera musique classique et chanson française le 10 avril. Au rang des Incontournables, citons les Banquets de Noël avec cette année Le Lac des cygnes, le Festival de Noël, le Banquet de Saint-Valentin, L’Anniversaire de Bach (21 mars), la Nuit blanche (30 mai) et les Barbecues lyriques début juillet. Orlando de Haendel concert « piano et art numérique » de Vyacheslav Gryaznov, un hommage à la compositrice alsacienne Marie Jaël ou le Bal viennois du Nouvel An seront autant de Soirées prestige qui se clôtureront le 15 avril avec un défilé drag- show « rococco-barock », carte blanche à Victor Weinsanto jouée en partenariat avec l'OPS. Un programme de haut vol à découvrir dans l'intimité d'une église, en proximité rare avec les artistes. v.l.
→ En photo : La soprano italienne Martina Roussomanno se produira à Saint-Guillaume le 26 septembre

Tout nouveau lieu culturel strasbourgeois créé par l’artiste performeuse Evelyn Zelada Biecher, Quai de scène revendique une programmation éclectique voire subversive, en tout cas à mille lieues des codes établis. La saison 2025/2026 se déclinera en in et en off. Avec, du côté du in généralement payant, des productions internationales et, sur les planches du off, des propositions souvent gratuites mettant en avant des créations émergentes, des événements récurrents comme le Quai du rire tous les jeudis ou le Son del Quai les vendredis, ainsi que des spectacles plus expérimentaux. Manière pour la salle de diversifier l’offre culturelle et de soutenir la scène artistique locale et nationale. Se profilent dans le in du 27 novembre, deux concerts exceptionnels inscrits dans la première édition du Trinational MicroFest, événement francogermano-suisse dédié aux musiques microtonales et à la création contemporaine. À 19h30, le collectif Piano Latino avec Marcela Lillo Tastets et à 21h l’ensemble contemporain Vertebrae. v.l. → Photo : Lieu de vie face à la Presqu’île Malraux, Quai de scène est aussi une casa avec sa cuisine ouverte, son bar convivial et sa terrasse au bord de l’eau. Au 5 quai du Général Kœnig.

Impossible de brasser la programmation de L’Illiade en quelques mots tant elle est dense, éclectique, exigeante. Pointons Madame Fraize le 30 septembre, bulle poétique dans un monde fatigué. Au travers de ce personnage en robe verte fendue, le clown lunaire Marc Fraize fête ses vingt ans de scène et son ahurissement perpétuel face à un monde cruel. Cruel mais (presque) parfait, ce Monde retiendra l’attention de Sébastien Bizzoto les 10 et 11 octobre dans un spectacle documenté et drôle où il tente de donner des réponses à des questions aussi essentielles que « qu’est-ce qui se passe dans notre cortex cérébral si on range sa brosse à dents dans le réfrigérateur ? » Le 28 novembre on sera aux côtés de Debout sur le zinc pour célébrer leurs 30 ans de scène et la sortie d’un 11e album studio Mémoire électrique. Poésie des mots et audace des sons garanties. Michel Jonasz en piano-voix le 9 décembre et à l’orée du printemps, le 5 mars, un goût de renaissance avec Paradisum de la Recirquel Company. Le mouvement comme seule langue commune après le silence d’un monde détruit. v.l.
→ En photo : Paradisum de la Recirquel Company, le 5 mars à L’Illiade

C’est avec Éric Métayer alias Sam et tous ses interlocuteurs téléphoniques que le Diapason ouvrira sa saison le 2 octobre. De l’humour auréolé d’un Molière, un One man show où le héros, acteur au chômage catapulté standardiste d’un grand restaurant se coltine une galaxie de personnages emblématiques de notre Monde fou. Beaucoup de musique aussi dans cette programmation où on trouve la Boîte de Pandore du mythique Cirque des mirages (16 octobre), Barbara Carlotti et son nouvel album Chéris ton futur (13 novembre), Le Grand Huit de Tartine Reverdy pour s’étourdir en famille (19 novembre), Les Fo’plafonds proposé par un orchestre de bric et de broc (20 novembre)... Sans oublier les musiques du monde avec Here and Now de Walid Ben Selim, porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie (3 décembre) ou le cabaret Dry Martini de la Cage aux piafs (11 déc.).
Un zeste de théâtre alsacien avec D’Stüdentin un de Monsieur Henri de Yannick Hornecker (26 octobre). Côté théâtre, on notera, le 7 novembre, Le Sanctuaire d’après Laurine Roux, l’histoire d’une renaissance au cœur d’une montagne refuge frappée de chaos. Le 10 janvier, Liane Foly livrera un seule en scène époustouflant où se mêlent comédie, humour et imitations. La Folle repart en thèse qu’on se le dise. Plus grave mais aussi passionnant que bouleversant le 21 mai, Croire aux fauves de la compagnie Lucie Warrant. Laure Werckmann y incarne Nastassja Martin, une anthropologue marquée, au sens premier du terme, dans sa chair par la rencontre avec un ours. v.l.
→ En photo : Les Fo’plafonds au Diapason le 20 novembre.

Concerts, humour, théâtre, cirque, le PréO Scène d’Oberhausbergen reste pluridisciplinaire et jubilatoire. En témoigne The Loop, « comédie en boucle » de Robin Goupil, sacrée Molière 2025 de la meilleure comédie. Programmée le 4 octobre, cette « sale affaire... » prendra la tête de flics américains incorruptibles tout droit sortis des années 90. Un texte de haut vol, une mise en scène au cordeau et des comédiens virtuoses. La Compagnie Mira reviendra quant à elle le 25 octobre pour une carte blanche hip-hop juste avant le Troisième Quinquennat des Goguettes (en trio mais à quatre) prévu le 1er novembre. Aussi engagé qu’hilarant, ce groupe musical tranchera dans le vif de l’actualité et du quotidien. Du jazz le 14 novembre avec Arthur H & Pierre Le Bourgeois, En concert autour du soleil, du cirque chamanique le 4 décembre avec Reclaim des Belges du Théâtre d’un jour... ce ne sont là que quelques titres d’une programmation foisonnante qui n’oublie pas de faire la part belle à un jeune public toujours choyé par le PréO. v.l.
→ En photo : Arthur H et Pierre Le Bourgeois, au PréO le 14 novembre.
LE POINT D’EAU — OSTWALD

Ouvert il y a tout juste trente ans, le Point d’eau porte haut l’idée que la culture est « une énergie essentielle pour toutes et tous » et la saison qui s’annonce confirme cet engagement. Beaucoup de théâtre et d’humour au programme. Du stand-up avec Daniel Morin le 15 février, Meryem Benoua le 10 mars ou bien encore Djamil le Schlag qui, le 19 mai, présentera Exode(s), son nouveau spectacle. Des clowns aussi toujours tendres, un peu lunaires... ils annonceront le printemps. Le 24 avril, Barolosolo affrontera l’O’rage dans un spectacle comique et aquatique alors que, le 25, le duo multiprimé de la compagnia Baccalà rejouera dans Pss Pss avril, l’art d’être deux, sans un mot mais sur la gamme de toutes les émotions humaines. Pour la Saint-Valentin, rendez-vous avec Virginie et Paul, comédie (musicale) romantique créée par Hervé Devolder et Jacques Mougenot de la Compagnie Zap. De l’esprit, du rythme et de la malice ! Du 13 au 18 janvier, la compagnie du Matamore accueillie depuis plusieurs années au Point d’eau, proposera La Mouette de Tchekhov, chef d’œuvre intemporel qui dit tout de nous et du théâtre. Côté cirque, les Québécois de Éloize proposeront les 5 et 6 janvier une nouvelle version de ID, leur spectacle emblématique. Sans renoncer à la liberté des origines, mais en s’ouvrant au numérique. Avec pour finir deux coups de cœur, La Sœur de Jésus-Christ proposé par le Théâtre de poche de Bruxelles le 30 janvier et Blanche, l’odyssée d’une vie proposé du 14 au 16 mai par la compagnie Hecho en casa. Une pépite où se mitonne la recette du bonheur d’être au monde. v.l.
→ En photo : Blanche, l’odyssée d’une vie par la compagnie Hecho en casa, du 14 au 16 mai.

Jazz, pop, musique urbaine, théâtre, danse, humour, jeune public, la nouvelle saison culturelle de la ville de Schiltigheim est prête à se déployer dans ses trois salles, au Cheval Blanc, au Brassin et à la Briqueterie.
Au rang des concerts, citons Chris Thile, virtuose de la mandoline venu des États-Unis le 7 novembre, Kaz Hawkins voix soul-blues intense et généreuse le 5 mars, Cédric Myton, Joy White & Omar Perry, icônes du reggae roots annoncés le 28 mars ou bien encore Alexis HK et Benoît Dorémus, duo amoureux de la chanson d’auteur qui se produira le 12 février... De grands artistes aussi en ce qui concerne la scène jazz avec Tyreek McDole, révélation vocale du jazz contemporain les 5 et 6 octobre, le contrebassiste virtuose Renaud Garcia-Fons annoncé le 13 mars, le Belmondo Quintet et son jazz français d’exception le 29 avril et Omar Sosa, pianiste cubain au croisement des styles qui se produira le 21 novembre.
Sans oublier les spectacles décalés et engagés avec, le 20 mai, Madame Arthur, nouvel opus musical du cabaret mythique de Pigalle, et Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?, texte de Sylvain Levey proposé le 19 mars.
Quant à La Revue scoute, toujours mordante et hilarante, on l’attend du 15 janvier au 8 mars à La Briqueterie.
Pour goûter à l’énergie culturelle de Schiltigheim, ne ratez pas la fête de lancement de saison le mercredi 10 septembre à La Briqueterie. Dès 16h pour le jeune public, dès 19h pour tous. v.l.
→ En photo : Omar Sosa et Souad Asia, le 21 novembre à La Briqueterie.

→ En photo : Starship Troopers de Paul Verhoeven sera projeté dans le cadre de la rétrospective FasciFiction. (c)
En préparation cet été, la programmation de la 18e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg sera dévoilée début septembre. L’affiche, signée comme de coutume par l’artiste Mahon, est quant à elle déjà connue et révèle le thème auquel sera consacré la rétrospective de cet événement devenu incontournable.
« Nous avons intitulé cette rétrospective FasciFiction », annonce Daniel Cohen, directeur artistique. « Il nous a semblé essentiel de parler des dystopies au cinéma à l’heure de la montée des régimes autoritaires dans le monde et en Europe. Force est de constater que beaucoup d’auteurs se sont penchés sur cette question en faisant preuve d’une clairvoyance presqu’inquiétante. »
Les festivaliers pourront ainsi revoir des classiques tels que Fahrenheit 451 de François Truffaut, La Ferme des animaux de John Halas et Joy Batchelor, Starship Troopers de Paul Verhoeven, Les Cannibales de Liliana Cavani, THX 1138 de George Lucas ou bien encore La Servante écarlate de Volker Schlöndorff. Autodafés, contrôle de la pensée, négation des libertés fondamentales sous la botte de l’autoritarisme... l’affiche est effectivement percutante. Elle accompagnera les dix jours d’un festival fort d’une sélection éclectique de longs et de courts métrages, allant des plus récentes productions européennes et internationales aux classiques du cinéma de genre, sans oublier de passionnantes masterclasses, des événements hors les murs et des rencontres professionnelles. Un incontournable pour les cinéphiles strasbourgeois. v.l.

La 43e édition de Musica s’ouvrira le 19 septembre à l’Opéra national du Rhin avec In dreams, hommage à David Lynch, le plus musicien des grands cinéastes de notre époque. Du générique de Twin Peaks d’Angelo Badalamenti au thème d’Elephant Man composé par John Morris en passant par les titres lynchiens de David Bowie, Chris Isaak ou Jimmy Scott, la soirée tiendra du film imaginaire finement ciselé. Autre axe fort de ce festival qui sera marqué par 40 projets dont de nombreuses créations mondiales, le retour d’un nouveau folk dans la scène contemporaine. En atteste la pièce Elja proposée le 20 septembre par le Kronos Quartet, quatuor à cordes emblématique de la musique américaine de retour à Strasbourg après plus de 30 ans d’absence. Inspiré par les musiques traditionnelles norvégiennes et les violons Hardanger, ce programme s’inscrit aux côtés d’autres projets faisant également appel à des instruments populaires. Ce sera le cas des Français de La Novia qui, à coups de bombarde et vielle à roue, exploreront les lisières entre tradition et expérimentation à travers les compositions de Conlon Nancarrow et d’une commande à l’artiste sonore Jessica Ekomane. Ce sera au Palais des fêtes le 1er octobre. v.l.
→ En photo : Hommage à David Lynch le 19 septembre à L’ONR.
JAZZDOR — 7 AU 21 NOVEMBRE

Le festival Jazzdor revient en novembre à Strasbourg, du 7 au 21 pour être tout à fait précis en cette année 2025 qui marque le passage de relais entre Philippe Ochem, directeur pendant 36 ans de cette unique Scène de musiques actuelles (SMAC) dédiée au jazz dans le Grand Est, et Vincent Bessières, son nouveau directeur qui a pris ses fonctions en juin. Le panaméen Danilo Perez ouvrira cette 40e édition de Jazzdor Strasbourg le 7 novembre à la Cité de la musique et de la danse. Reconnu comme l’un des pianistes les plus brillants de sa génération, il se présente à la tête d’un trio puissamment organique formé avec le bassiste John Patitucci – son complice des années 2000 dans le génial quartet du saxophoniste Wayne Shorter – et le batteur Adam Cruz. Une musique raffinée, métisse et réjouissante mêlant l’exubérance rythmique latine à des harmonies empruntées à la musique savante occidentale. Relevons aussi Soleil d’hiver le 19 novembre, un solo dédié par Grégory Dargent à l’oud, cet instrument du monde arabe auquel il a consacré 25 ans de travail et de recherches. Un concert très onirique où images et sons se combinent en intégrant effets électroniques et bandes magnétiques manipulées en temps réel. Le 9 novembre, la flûtiste et compositrice Sylvaine Hélary signera son premier programme à la direction artistique de l’Orchestre national de Jazz avec With Carla, hommage à Carla Bley, figure inclassable du jazz disparue en octobre 2023. Un programme réalisé avec le saxophoniste Rémi Sciuto qui alterne moments chambristes et fresques orchestrales. Un univers protéiforme. v.l.
→ En photo : L’Orchestre national de Jazz emmené par Sylvaine Hélary, le 9 novembre à la Cité de la musique et de la danse.
FORMAT(S) — 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE

Le travail graphique d’Helmo réalisé pour le festival Jazzdor sera mis à l’honneur à l’occasion d’une exposition rétrospective au cœur de la Chaufferie, la galerie d’exposition de la Haute école des arts du Rhin. L’exposition présentera 23 ans de collaboration graphique entre les deux entités, par la monstration de divers formats dont les affiches sérigraphiées de saison. L’exposition se tient pendant un mois et sera également l’occasion pour Thomas Couderc et Clément Vauchez, les graphistes d’Helmo, d’une rencontre publique autour de l’histoire de cette collaboration au long cours. Le vernissage de l’exposition sera mis en musique par les élèves du Département Jazz et Musiques Improvisées de la Hear. Cet évènement, né dans le cadre de l’initiative du Festival de design graphique FORMAT(S), est une coproduction de l’association Central Vapeur, la Hear et Jazzdor.
→ Infos : Conférence à l’auditorium de la Hear le jeudi 23 octobre à 17h suivie du vernissage de l’exposition dès 18h30 à la Chaufferie.
5 rue de la Manufacture des Tabacs — Strasbourg formats-festival.org – www.hear.fr/la-hear/la-chaufferie jazzdor.com – helmo.fr
Rendez-vous incontournable et essentiel des saisons culturelles strasbourgeoises depuis 18 ans, les Bibliothèques idéales réinvestissent la capitale européenne et ses lieux les plus emblématiques. Avec plus de 70 rencontres, débats, lectures et spectacles au programme pour célébrer la littérature dans ce qu’elle a de plus vivant, sa capacité à éveiller, à questionner, à résister.
Rédaction : Alain Leroy
Photographie : Alban Hefti
Il n’est pas du tout certain que la littérature puisse sauver le monde, si c’était le cas, cela se saurait. Mais enfin, elle peut, peut-être, éviter qu’il ne coure trop vite à sa perte. Peut-être, seulement peut-être, mais c’est déjà beaucoup de pouvoir imaginer que, peut-être, les livres, les auteurs, la réflexion ont encore un peu leur place et, peut-être on y revient car comment être sûr, qu’au milieu du tumulte informationnel, de la volonté désormais généralisée de saboter tous les repères, de mélanger le vrai du faux pour que les opinions comme les faits se valent, peut-être qu’il y a encore un espace pour la raison et la réflexion. En un mot, enfin trois, un espace pour ce qui constitue ce qu’on peut parfaitement appeler un esprit de résistance. Quand, en 2010, Stéphane Hessel publie un petit ouvrage d’une trentaine de pages intitulé Indignez-vous !, il ne croit sans doute pas lui non plus que la littérature sauvera le monde. Mais que peut-être, peut-être, les livres ont encore le pouvoir d’éveiller les consciences et que cet esprit de résistance qui l’a animé toute sa vie et comme jamais au plus fort de la tourmente des années de guerre ne s’est pas éteint.
Quinze ans et quatre millions d’exemplaires vendus plus tard, le monde n’a pas changé d’inflexion, mais quatre millions de consciences éveillées en 34 langues, ce n’est pas rien. D’où l’hommage que rendront les Bibliothèques idéales (BI) à Stéphane Hessel en ce début d’automne ; et encore, le mot hommage est-il
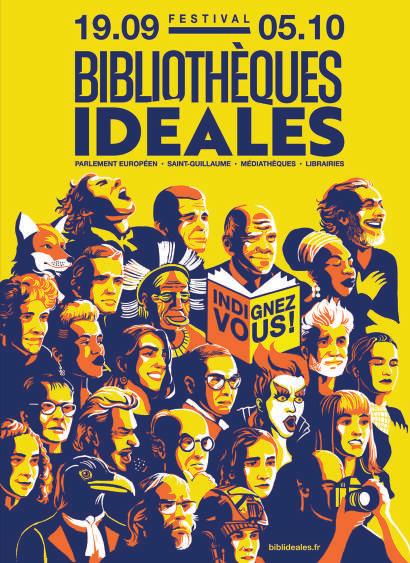

impropre puisqu’il s’agit de bien plus que ça : d’une volonté de maintenir le souffle.
« Oui, parce qu’aujourd’hui il y a de jeunes auteurs qui poursuivent l’œuvre de Stéphane Hessel avec des textes qui correspondent entre les générations », explique François Wolfermann, créateur des BI. « Ce sont des passerelles entre les unes et les autres et il nous a paru important de leur donner une parole. »
La journaliste Salomé Saqué – dont le Résister, déjà vendu à plus de deux millions d’exemplaires, est plus qu’un écho au Indignez-vous ! de Hessel dont elle préface la réédition – ouvrira ainsi ce festival de littérature au Parlement européen le samedi 20 septembre. Donnant ainsi le ton d’une édition très engagée, très forte dans laquelle, du dernier prix Goncourt Kamel Daoud à Rokhaya Diallo, de Delphine Horvilleur à Alfred de Montesquiou, de Laurent Gaudé à Sorj Chalandon, de Rachid Benzine et Marie Semelin qui débattront de cette question essentielle qui est de savoir comment rester humain face à l’incompréhensible, à la sociologue iranienne Chahla Chafiq, Isabelle


↑
Ci-dessus : événement BI au Parlement européen. À droite : Delphine Horvilleur.
Autissier ou à la poétesse ukrainienne Yaryna Chornohuz, il sera question d’humain et d’humanité. À ce titre, la rencontre du dimanche 21 septembre, toujours au Parlement européen, sur le thème des Peuples Racines sera un rendez-vous incontournable car rare avec la présence des représentants des peuples Maya (Amérique centrale et du Sud), Betsimisaraka (Madagascar), Kariri-Xocó (Brésil), Pénan (Bornéo) et Amazigh (Afrique du Nord) : cinq cultures inspirantes, et pour une fois le mot n’est pas galvaudé, cinq façons de voir le monde et de le porter. Des voix qui ne doivent pas être étouffées tant ce qu’elles ont à nous dire mérite d’être entendues. Plus que jamais, il s’agit donc de prendre ici le pouls du monde, de l’entendre respirer douze jours durant depuis le prestigieux hémicycle du Parlement européen (dont l’architecte Rodo Tisnado viendra parler lors de la journée inaugurale), l’église SaintGuillaume, la BNU et une douzaine de librairies indépendantes, de médiathèques, d’écoles et de quartiers de la ville et de l’Eurométropole.
Le plus difficile finalement avec les Bibliothèques idéales est de toujours résister à la tentation de citer tous les noms des intervenants, tentant mais par nature impossible puisque cette année encore quelque 70 rencontres sont programmées. Rencontres littéraires donc et avant tout – avec de nouveaux formats comme des déjeuners littéraires en compagnie d’auteurs comme Pierre Assouline, des croisières sur l’Ill ou des ateliers participatifs – des débats de société, des lectures musicales, des rencontres avec le jeune public, mais aussi des rendez-vous croisés où le texte répond à la musique, au dessin, à la danse et à la performance. Avec des soirées musicales, des concerts (Weepers Circus, un hommage à Nina Simone avec Grégory Ott et Sélia Setodzo, un autre à Darwich) et des spectacles comme celui de clôture qui consistera en un cabaret & Drag avec Léopoldine HH, Élysée Moon & Co.
Une façon totale, décomplexée, assumée d’habiter le monde qui est aussi, par quelque bout qu’on le prenne, une forme de résistance. ←
Avec plus de 70 rendez-vous au programme, difficile de tout voir, de tout entendre, de tout lire ! Pour vous guider dans cette édition foisonnante, nous avons choisi quelques temps forts, des rencontres et des spectacles qui reflètent l’esprit des Bibliothèques idéales : curieux, engagé, multiple.
À ne pas manquer.

Roselyne Bachelot (vous) embarque sur l’Ill avec son franc-parler légendaire et son humour redoutable !
Ancienne ministre, passionnée de musique et de culture, elle livre confidences et anecdotes dans une traversée singulière.
→ Samedi 27 septembre à 11h Embarcadère Étoile. Sur réservation

À chaque livre, Emmanuel Carrère fait événement. Dans Kolkhoze (POL), il évoque sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, et une histoire familiale au cœur des fractures du siècle. Entre intime et universel, une parole lucide, parfois bouleversante, qui donne à entendre l’un des écrivains les plus essentiels de notre époque.
→ Samedi 4 octobre à 18h St-Guillaume. Entrée libre

Véritable prodige de la guitare, Thibault Cauvin emporte le public dans un voyage sensible et virtuose. Entre récits de vie et morceaux inédits, son concert littéraire résonne comme une traversée intime, où chaque note raconte une histoire.
L’un des moments musicaux immanquables de cette édition.
→ Samedi 27 septembre à 19h St-Guillaume. Entrée libre

Écrivain-voyageur, aventurier des mots et des hauteurs, Sylvain Tesson déploie sa bibliothèque idéale comme un refuge et un manifeste. Solitude, effort, liberté : ses livres sont des compagnons de route pour résister au tumulte. À Strasbourg, sa voix sonnera comme une respiration nécessaire.
→ Dimanche 5 octobre à 14h30 St-Guillaume. Entrée libre
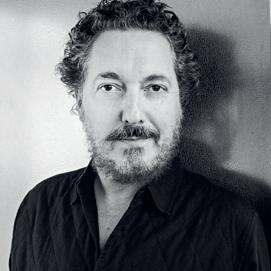
Comédien de la ComédieFrançaise, réalisateur et conteur hors pair, Guillaume Gallienne vient partager un récit intime avec Le Buveur de brumes (Stock). Entre racines, mémoire familiale et hommage aux femmes qui l’ont façonné, il livre une méditation sensible et lumineuse.
→ Samedi 4 octobre à 15h St-Guillaume. Entrée libre

Clore les BI en fête : cabaret berlinois des années 1920, chansons folles et liberté totale, avant de basculer dans l’univers flamboyant du drag et de l’opéra ! Léopoldine HH et Élysée Moon transforment la scène en manifeste joyeux et libérateur. Une apothéose haute en couleurs, entre rires, musique et audace.
→ Dimanche 5 octobre à 18h St-Guillaume. Sur réservation

Musées, théâtres, centres d’arts et festivals, la Caisse d’Epargne
Grand Est Europe s’engage pour faire vivre la culture en région.

DÉVALER, c’est un parcours d’art contemporain imaginé par Christophe Urbain et Michel Bedez, deux artistes amoureux du Val d’Argent. Ici, l’art contemporain se frotte aux paysages, dialogue avec l’histoire minière et textile, réveille la mémoire des pierres. Après une première édition réussie en 2023, DÉVALER revient du 3 au 12 octobre 2025 avec une quarantaine d’artistes et une quinzaine de lieux patrimoniaux hors du commun ; chapelle médiévale, ancienne usine textile, piscine Art déco, maison Renaissance... Entre installations inédites, expositions collectives et résidences d’artistes, le public est invité à cheminer de site en site, d’émotion en découverte. En complicité avec le festival « C’est dans la Vallée » de Rodolphe Burger, DÉVALER promet dix jours intenses où se rencontrent culture, ruralité et poésie brute des Vosges. Un parcours gratuit, ouvert à tous, à vivre comme une plongée dans l’âme vibrante du territoire. Nous, on y sera ! l.h.
→ www.devaler.fr

La Fédération de charité Caritas Alsace accueille un nouveau visage à la tête de son pôle caritatif, Louis-Marie Perrin. Ingénieur de formation, riche d’une carrière internationale dans le conseil et la formation, il souhaite mettre son expérience au service d’une cause qui lui tient à cœur : moderniser et renforcer l’action solidaire de Caritas Alsace. Depuis plus de 120 ans, l’association est aux côtés de celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Familles, étudiants, retraités, personnes isolées, réfugiés ou détenus, chaque jour, grâce à l’engagement de 2 000 bénévoles et à ses 80 lieux d’accueil en Alsace, Caritas tend la main à toutes les vulnérabilités.
Face à la montée de nouvelles formes de précarité, l’association lance un appel fort à l’engagement bénévole, en particulier auprès des jeunes : « Le temps est un don. Chacun, à sa manière, peut contribuer à faire vivre la solidarité et à bâtir un monde plus juste et fraternel. » l.h.
→ caritas-alsace.org












































La Foire européenne d’art contemporain ST-ART revient pour sa 29e édition, du 14 au 16 novembre 2025 au Parc des Expositions de Strasbourg.
Premier rendez-vous français de la rentrée artistique, l’événement réunit chaque année des galeries venues de toute l’Europe et met à l’honneur la richesse et la diversité de la création contemporaine. Au programme : peinture, photographie, sculpture, design... autant de disciplines qui dialoguent pour offrir aux visiteurs un panorama vibrant de l’art d’aujourd’hui.
Le coup d’envoi sera donné le jeudi 13 novembre avec un vernissage sur invitation, avant trois jours ouverts au grand public. l.h. → st-art.com

Loin du luxe tapageur, les sacs signés
Céline Wach cultivent l’élégance sobre et la qualité rare. De quoi séduire une clientèle exigeante en quête de discrétion. Passionnée des accessoires et des sacs en particulier, « ces petits trésors capables de sublimer la plus simple des tenues », Céline se lance après des études de stylisme. La qualité du cuir Epsom des tanneries Haas la fascine, tout comme le savoir-faire artisanal des manufactures italiennes. En 2020, elle crée sa marque dans un contexte économique difficile. Cinq ans plus tard, ses créations parlent pour elles, reflets d’un travail méticuleux, exigeant, courageux, aussi. À découvrir, sur rendez-vous, dans son showroom à l’Orangerie. b.r.
→ ateliercelinewach.com – Insta : @Ateliercelinewach

Dix ans d’émotions, de créativité et d’excellence... Pour marquer cet anniversaire, la Villa René Lalique dévoile un menu d’exception signé Paul Stradner et Jonathan Bunel. Un parcours raffiné, pensé comme un hommage au lieu et à son histoire, où chaque plat devient une pièce d’art culinaire. À savourer en 6 plats ou en 8 plats jusqu’à la fin de l’année. l.h.
→ villarenelalique.com

C’est à la place du Transsibérien, ce restaurant russe que l’on aimait bien, qu’un nouveau bar agite la Krutenau : Les Opportunistes. Ici, comme à Wall Street, le prix des boissons fluctue toutes les 15 minutes, affiché en direct sur trois écrans. Cocktails, bières, vins et softs montent ou chutent selon un algorithme maison... et attention au krach : pendant quelques minutes, certains prix s’effondrent, pour le plaisir des clients ! Le tout accompagné d’une petite carte gourmande 100 % maison. l.h.
→ Insta : @opportunistes.strasbourg


FIBA, cabinet d’expertise comptable et de conseils en gestion d’entreprise, vous accompagne dans cette transition.





Concerts, clubbing, stand-up, spectacles vivants, débats, expos… Les bars ne se contentent plus de servir à boire, ils deviennent des scènes culturelles à part entière. Lieux de vie, de création et de rencontres, ils jouent un rôle clé dans la dynamique culturelle locale, et rassemblent toutes les générations. Tour d’horizon de ces bars de vie(s) qui font vibrer Strasbourg.
Rédaction : Barbara Romero
Photographie : Abdesslam Mirdass
↗
Au Blue Note, place à la world music.

Il est loin le temps de « Strasbourg, la belle endormie », que souhaitait réveiller Roland Ries. Du centre-ville aux Deux-Rives, en passant par le quartier Gare, de véritables poumons culturels font battre le cœur de Strasbourg. Des lieux hybrides animés par des passionnés pour qui la fête se vit au pluriel. Des lieux où l’on ne se contente pas de trinquer, mais où l’on est invité à se laisser surprendre. Avec en sus des tarifs ultra compétitifs ne dépassant pas les 10 €, hors tête d’affiche. « Quand nous avons repris le bar du Conservatoire en février 2022, nous avons été étonnés que personne n’ait jamais songé à en faire un lieu dédié à la danse, à la musique et à l’art, raconte Léo, co-gérant du Blue Note. Aujourd’hui, on est un club, une scène et un resto à part entière, avec une ambiance à notre image, hétéroclite, bazardeuse, comme tout souk parfaitement en désordre ! ». Un lieu inclassable, où l’on peut danser la salsa en terrasse, écouter du jazz, assister à un débat ou à une projection.
« Personne n’avait misé un kopeck sur cet établissement un peu excentré, mais aujourd’hui il a la couleur qu’on lui a donnée, poursuit Léo. Ces bars-restos sont importants pour professionnaliser la scène locale et consolider le lien des groupes en tournée avec leur public. »
Collectif, asso et création : le trio gagnant. Avec des jauges entre 150 et 300 personnes, ces scènes d’un nouveau genre ajoutent une touche d’intimité qui rend les moments encore plus puissants. À condition de faire bouger les foules. « Même Bob Sinclar se plaint des gens qui restent vissés sur leur téléphone » appuie Maria Garcia, alias Djette Analgesia. « Dans mon pays d’origine, l’Espagne, on a la culture de la danse, de profiter de la vie dehors, d’aller dans les bars et de parler à son voisin. Ici, je ne sais pas si c’est culturel ou si c’est lié à la digitalisation, mais parfois c’est frustrant pour nous artistes. En revanche quand ça prend, c’est de la bombe ! »
↓ Langue des signes française et spectacle à la Grenze.

Djette depuis plus de 20 ans, cette professeure en biologie moléculaire fourmille d’idées pour créer l’événement. Dernier en date : un cours de Pilates avec DJ en l’église Saint-Pierre-le-Vieux. « C’était plein ! Pendant que tu bouges, tu ressens la musique et laisses ton téléphone dans ton sac. », sourit-elle. Le 4 octobre, elle convie le public à une soirée techno et percussions live au Wagon souk. « Quand un danseur te prend la main, quand tu touches un instrument, ton esprit décroche et tu profites de l’instant. » Ce genre de soirée est possible grâce à la force du collectif en France. « En Espagne, on a les bars, mais ici vous avez les associations et ça change tout. Tous ces lieux comme la Grenze, le Phare Citadelle, l’Orée 85, le Wagon Souk, sont hyper ouverts pour accueillir des événements un peu hors norme. C’est nécessaire et ultra stimulant pour la scène locale. »
Des tremplins pour la scène émergente. Depuis cinq ans, Ève et Jean, propriétaires-gérants de La Péniche mécanique du côté de Rivetoile, l’ont bien compris. Tous deux issus du milieu
« La
billetterie n’est pas notre fonds de commerce, nous vivons par le bar. Notre objectif, c’est de diffuser la culture. »
associatif culturel et événementiel, ils ont imaginé un vrai lieu d’expression pour tous les genres en plus de leurs fameuses soirées clubbing. « La scène émergente a besoin de soutien, car si elle a énormément de volonté et d’énergie, elle n’a pas toujours les moyens. C’est compliqué aussi d’accéder à des scènes importantes » confient-ils. « Nous on est dans l’entre-deux, une vraie salle de spectacle avec régisseur, projecteurs, sono, lumières mais une jauge de 150 personnes plus accessible. » Chaque jour, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de mails d’artistes en quête de scène, stand-uppers, DJ, drag queens, danseurs... « On navigue entre tout cela ce qui nous permet d’offrir une programmation diversifiée à notre public. La billetterie n’est pas notre fonds de commerce, nous vivons par le bar. Notre objectif, c’est de diffuser la culture. » Et le public suit. « Au début, les gens venaient au Phare Citadelle pour boire une bière en terrasse, puis ils ont compris qu’on pouvait aussi bien manger, assister à un concert, à un spectacle ou participer à des ateliers en famille, observe Ksenia, associée de cette grosse machine d’une vingtaine de salariés, intermittents et artistes en résidence. Le Phare, c’est un lieu de destination, un peu excentré, nous avons étoffé la programmation, ☛

« Nous avons une programmation un max inclusive et représentant les minorités de genre. »

↗ La Grenze
← La compagnie La Bévue en résidence au Phare Citadelle durant quelques jours cet été en a profité pour tester son nouveau spectacle.
→ Drag Race et Drag Show chez Hey Mama !


Opéra
Le Triomphe du Temps et de la Désillusion
Georg Friedrich Haendel
Otello Giuseppe Verdi
Les Fantasticks Tom Jones & Harvey Schmidt
Hansel et Gretel Engelbert Humperdink
Le Miracle d’Héliane Erich Wolfgang Korngold
Les Mamelles de Tirésias Francis Poulenc
Le Roi d’Ys Édouard Lalo
Les Noces de Figaro Wolfgang Amadeus Mozart
Follies Stephen Sondheim & James Goldman
Danse
En regard Léo Lérus / Sharon Eyal
All Over Nymphéas Emmanuel Eggermont
Hamlet Brian Arias
Caravage Bruno Bouché
Danser Mozart au XXIe siècle
Rubén Julliard / Marwik Schmitt
Ballets russes
Tero Saarinen / Dominique Brun / François Chaignaud

Strasbourg (Opéra) 29 oct. - 9 nov. 2025
Direction musicale Speranza Scappucci
Chœur de l’OnR et de l’Opéra national de Lorraine
Mulhouse (La Filature) 16 & 18 nov. 2025
Mise en scène et décors Ted Huffman
Orchestre philharmonique de Strasbourg



↑ Au dessus : Blue Note
et progressivement, notre public de 7 à 77 ans s’est approprié notre espace événementiel. »
« Nous avons une programmation un max inclusive et représentant les minorités de genre » ajoute Maylis, en charge de la programmation musicale. « Nous avons une vraie couleur politique et festive. »
« Ces lieux hybrides redessinent peu à peu la carte culturelle de Strasbourg. »
Chaque jour, une nouvelle expérience. Même constat à La Grenze, désormais ouverte à l’année sur une ancienne friche ferroviaire : le public vient pour un concert, un cours de yoga, un atelier d’écriture ou une tarte flambée !
« On essaie de faire se rencontrer les publics en proposant des activités pluridisciplinaires », note François, son chargé de communication. À quelques rues, chez Hey Mama, l’ambiance est plus intimiste et plus pop. « C’est une safe place, un lieu où rien n’est figé, où tu peux chaque jour vivre une expérience différente », explique Sokhna, sa fondatrice. Coworking la journée, expo mensuelle, spectacles drag ou d’impro, soirées musicales « Mon’date »... « Je l’ai pensé comme un vrai lieu de vie. » Et ça matche avec le Graffalgar, voisin et complice, où se tient chaque mois de mars le très attendu « Gros Bordel », événement où chaque chambre devient une œuvre vivante entre expo, création et performances.
Au centre-ville cette fois, le Carton est devenu le repaire des 35 ans et plus, un peu oubliés des bars strasbourgeois. Ses soirées DJ « C’était mieux avant » font carton plein, mais son locataire-gérant, Valentin, ne se contente pas de soirées mix. « Comedy Club, concert de jazz, soirée tatoo ou défilé de mode, le Carton est une salle de jeux de 300 m2 en plein centre qui reste en perpétuel déménagement et ouvert à toutes les propositions », explique-t-il.
Ces lieux hybrides redessinent peu à peu la carte culturelle de Strasbourg. Portés par des collectifs, des associations ou de simples passionnés, ces bars affirment une chose : la culture peut – et doit – se vivre partout. Même autour d’un verre. ←
☛ bluenotecafe.fr
☛ lagrenze.eu
☛ phare-citadelle.eu
☛ oree85.org
☛ lewagonsouk.com
☛ penichemecanique.com
☛ heymama-restaurant.com
☛ graffalgar-hotel-strasbourg.com
☛ Insta : @lecarton.strasbourg


Réception pour un anniversaire, une communion, une occasion particulière ou un mariage...
Chez Soi est une entreprise familiale, à la cuisine authentique, généreuse et gourmande, à base de produits frais, locaux et de saison. Nos équipes sont passionnées, qu’il s’agisse de plats traditionnels du terroir alsacien ou de mets délicats, élaborés et inventifs.

Inauguration, lancement de produit, séminaire, congrès, assemblée générale ou repas d’affaires…


↑
Come Prima redonne aux femmes ce que la maladie a tenté d’effacer. comeprimalingerie.com
Ma grand-mère avait un peu moins de 50 ans lorsqu’on lui a retiré un sein. Pendant plus de vingt ans, elle a glissé des mouchoirs dans son soutien-gorge. Elle n’en parlait jamais.
Elle portait son vide comme une honte. Une blessure intime, dissimulée sous le tissu banal du quotidien, et un silence tenace. Comme elle, tant de femmes ont traversé le cancer du sein avec courage, mais sans consolation. Leur corps amputé, leur féminité silencieusement effacée. Elles ont vieilli sans miroir, sans regard tendre, avec le sentiment de ne plus jamais pouvoir être belles.
C’est à elles que pense Fanny Barro, 25 ans, lorsqu’elle coud dans son atelier niché dans la vallée de Munster. Avec Come Prima, qui signifie « comme avant » en italien, elle redonne forme à l’invisible. Sa lingerie est pensée pour toutes les femmes, mais surtout pour celles dont le corps a changé après une mastectomie ou une reconstruction. Chaque modèle peut être porté avec ou sans prothèse, chaque couture est pensée pour s’adapter, soulager, sublimer.
La jeune créatrice choisit des matières éthiques et durables, comme la dentelle de Calais, avec une exigence de confort qui ne sacrifie jamais l’esthétique. Parce que la beauté, ici, n’est pas vaine. Elle est un baume. Diplômée des métiers de l’art et du design
Dans son atelier de la Vallée de Munster, Fanny Barro confectionne avec passion une lingerie adaptée au corps des femmes qui ont dû subir une mastectomie ou une reconstruction mammaire. Avec une exigence de confort qui ne sacrifie jamais l’esthétique et ne fait pas l’économie de la séduction.
Rédaction : Hélène Edel
Photographie : Mégane Schultz
à Strasbourg, elle a consacré son mémoire aux contraintes vestimentaires imposées aux femmes occidentales. Ses recherches l’ont menée à la rencontre de celles qui allaient bouleverser son chemin : des femmes marquées, à la recherche d’un nouveau rapport à leur corps. De ce terrain d’écoute, elle a fait une mission. Come Prima, ce n’est pas qu’une marque.
C’est un engagement. Fanny Barro propose des essayages personnalisés, chez elle ou à domicile, en partenariat avec des associations comme Sélestat contre le cancer ou La Maison Rose. Elle oriente ses clientes vers des professionnelles capables de leur fournir des prothèses adaptées. Et elle aborde sans détour les sujets trop souvent passés sous silence : la sexualité pendant et après la maladie, la baisse de libido, la solitude. « Ce sont des femmes qui ont envie de vivre, dit-elle, elles ont une liberté folle. Je sens que j’ai un rôle à jouer ».
Aujourd’hui, elle vend une dizaine d’ensembles par mois, à 130 euros l’un, cousus à la main. Demain, elle envisage une production en petite série, en France, pour rester fidèle à ses valeurs. Mais l’essentiel est ailleurs : redonner aux femmes ce que la maladie a tenté d’effacer. Le droit au désir. Le droit d’être belle. Le droit de se sentir, come prima, comme avant. Et même un peu plus. ←

SAISON 2025/26
CLUBBING ANALGESIA • ZAATAR • MEHR IS MEHR THÉÂTRE / PERFORMANCE
GALA DE STAND-UP • CABARET DARONE NÖXÏMÄ DRAG QUEEN MARLEY SHOW
TANGUY PASTUREAU • GALA DU QUAI DU RIRE • COMPANHIA NOVA THÉÂTRE THOMAS POITEVIN • ANTONIA DE RENDINGER • ALEX VIZOREK
DANSE FREI ART FESTIVAL AVEC STUDIO PRO ART • CIE HORS CHAMP // FUERA DE CAMPO
MUSIQUE REMEMBERING LUCIANO… ENSEMBLE VERTEBRÆ • GROLEAU REUNION TRIO • « EMBER » DE NEW YORK EEUU • JAZZ VIOLIN NIGHT JAZZ MASTERS TRIBUTE 4TET INVITE ALBA OLBERT • TRINATIONAL MICROFEST 2025 COLLECTIF PIANO LATINO MARCELA LILLO TASTETS / ENSEMBLE VERTEBRÆ QUINTETO LIBERTAD HOMMAGE À ASTOR PIAZZOLLA • ENSEMBLE IMAGINAIRE
SANS OUBLIER TOUTES LES DEUX SEMAINES : LES MARDIS NID DU JAZZ • LES MERCREDIS LES ÉPHÉMÈRES (PERFORMANCES) • LES JEUDIS STAND-UP • LES VENDREDIS CONCERT LIVE SALSA SON DEL QUAI
DIRECTION ARTISTIQUE
EVELYN ZELADA B.
Né dans le terreau associatif, le réseau de micro-crèches
Krysalis s’apprête à souffler ses dix bougies. Une aventure humaine, engagée et joyeuse, portée par trois femmes aux parcours complémentaires.
Rédaction : Salomé Dollinger
Photographie : Laetitia Piccarreta
→ Britta Berndt, Aurélie Werler et Audrey Wittmer.

C’est dans le milieu associatif strasbourgeois que Britta, Audrey et Aurélie se sont croisées pour la première fois. Chacune évoluait dans l’univers des crèches parentales, là où les familles s’impliquent directement dans la vie de la structure. À la crèche La Souris Verte, Audrey côtoyait Aurélie, éducatrice de jeunes enfants en apprentissage. Puis, via l’école associative Mickelé, le trio se forme avec Britta. Pendant plusieurs années, elles acquièrent des compétences complémentaires, jusqu’à ce que germe l’envie de créer ensemble une crèche qui leur ressemble : à taille humaine, sociale et plurilingue.
Développement croissant. Le réseau Krysalis s’est développé à
un rythme soutenu. Dix crèches ont vu le jour en sept ans : sept dans l’Eurométropole, trois ailleurs dans le Bas-Rhin. Parmi elles, Tick-Tack, rue de Verdun à Strasbourg, accueille douze enfants et autant d’occasions de fêter les anniversaires avec les familles. Car chez Krysalis, chaque détail compte, des goûters partagés aux bottes de pluie alignées pour les sorties quotidiennes. Si la croissance a été rapide, elle n’a jamais été déconnectée du sens. « On ne voulait pas faire de structure capitaliste », sourit le trio de fondatrices. Aujourd’hui, plus question de développer pour développer. Krysalis reste volontairement à taille humaine – 70 personnes –et s’associe à des projets à impact : partenariat avec le Joie-Lieu à Haguenau,







Profitez gratuitement de l’accompagnement des experts ÉS en matière d’économie d’énergie
Analysez et optimisez vos consommations énergétiques
Évaluez les performances énergétiques de votre logement
Identifiez les aides financières auxquelles vous avez droit
Des artisans RGE vous accompagnent pour réaliser vos travaux.
rendez-vous sur
conseils.es.fr
relance d’un LAEP à l’Elsau... « L’important, c’est de connaître nos équipes, d’être à leur écoute. C’est comme ça qu’on reste fidèles à nos valeurs », rappelle Aurélie Werler. Chaque équipe comprend ainsi quatre professionnels diplômés, un volontaire allemand, un alternant et un stagiaire en insertion issue de l’INFA. « On tient à proposer un encadrement fort, car chaque matin, une balade est prévue. Parce que c’est important que les enfants passent un maximum de temps dehors », explique Britta Berndt.
Une pédagogie qui casse les codes. « On n’est pas pro-activités pour cocher des cases. Chaque directrice propose ce qu’elle aime, ce qui ressemble à son équipe », souligne Audrey Werler. L’autonomie est au cœur du projet : depuis peu, un buffet en libre-service a été installé dans chaque crèche. Les enfants se servent seuls, goûtent ce qu’ils souhaitent, débarrassent leur plateau... « J’ai remarqué que beaucoup de choses avaient disparu dans les crèches, notamment les carafes d’eau sur les tables. Pourquoi les adultes mettent un tel frein à l’autonomie alors que les enfants sont capables de faire seul ? On a donc fait un travail sur un an avec les
directrices et une psychomotricienne. Aujourd’hui, ça fonctionne super bien. Les enfants sont apaisés et plus débrouillards lorsqu’ils arrivent à l’école maternelle où, du jour au lendemain, ils doivent tout savoir faire tout seul », assure Aurélie Werler.
Labellisée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) depuis 2017, Krysalis coche toutes les cases d’une structure responsable : alimentation bio avec option végétarienne, partenariat avec un maraîcher local, produits d’entretien écoresponsables, couches lavables ou vosgiennes, déplacements à vélo ou en autopartage... même le matériel informatique est loué chez Commown, coopérative spécialisée dans le numérique durable. Le plurilinguisme est aussi un pilier. Si l’allemand reste une langue forte – notamment via les volontaires allemands – l’ouverture est bien plus large : roumain, arabe, ukrainien... « L’idée, c’est d’ouvrir les enfants au monde, pas de favoriser une langue en particulier », explique Britta Berndt, l’Allemande de la bande.
Depuis peu, une nouvelle valeur a été gravée dans l’ADN de Krysalis : la joie. « Parce que là où il y a de la joie, il y a de l’envie. Et les enfants, eux, l’ont naturellement ». ←
« L’idée, c’est d’ouvrir les enfants au monde, pas de favoriser une langue en particulier. »

www.krysalis.eu 03 67 10 33 39 info@krysalis.eu



↑ Evelyn Zelada
Evelyn Zelada se définit résolument comme une comédienne et une metteuse en scène.
« Je suis d’origine colombienne mais ma vie est à Strasbourg depuis 25 ans, c’est ici que je me suis mariée et que ma fille est née et c’est ici où je connais le plus de monde. Et j’ai toujours su qu’à ma quarantaine, j’aurais mon lieu à moi pour programmer des spectacles. En fait, c’est le Covid qui a été le déclencheur ; comme tout le monde je ne pouvais plus voyager alors que ma vie, auparavant, avait été remplie de tournées à travers tous les pays. J’ai survécu à cette période en produisant des vidéos, en donnant des conférences ou des cours à l’université de Bogota où n’importe où en Espagne... »
À la sortie de ces mois forcément difficiles, une évidence : le moment était venu de se lancer dans le projet d’ouvrir sa propre salle. « J’avais réuni un budget grâce au fruit de mon travail durant vingt ans et ça a facilité les choses quand je suis tombée sur cet endroit face à la Cité de la Musique et de la Danse (l’ancien Music Shop – ndlr). Nous avons ouvert après deux ans d’études et d’obtention du permis et un an de travaux... »
Le pari international
Le résultat est bluffant. Quai de Scène, c’est un espace de plus de 550 m2, modulable en trois salles de spectacles : salle Mistral, 136 places assises, salle Parra,
Lancé en janvier dernier, Quai de Scène est un concept de nouvelle salle de spectacle privée attendu de longue date à Strasbourg avec une « couleur » résolument internationale du côté de sa programmation et se voulant aussi comme « un lieu à vivre » selon sa fondatrice et directrice, Evelyn Zelada…
Rédaction : Jean-Luc Fournier
Photographie : Bartosch Salmanski – DR
70 places assises et salle Neruda, jusqu’à 375 places debout, incluant un large espace de bar et restauration, ainsi qu’une terrasse d’une centaine de places aux beaux jours.
À l’aube de sa première saison complète, Evelyn Zelada se veut résolument enthousiaste : « J’ai bâti cette saison grâce à mes nombreux liens à l’international, l’Allemagne avec l’Institut Goethe, la Suisse avec Berne et Bâle et, notamment, le studio Arte Pro à Freiburg. Nous programmerons de grands moments de musique contemporaine, avec un festival sur cette thématique en commun avec les trois pays. Parallèlement, j’ai mis sur pied un programme de théâtre contemporain international, ainsi que des soirées cabaret et je renouvelle les rendez-vous jazz, le mardi soir ainsi que les soirées “Son del Quai” le vendredi soir, sans oublier la fidèle Antonia de Redinger... »
Et quand on lui fait remarquer que la comédienne d’origine s’est muée en redoutable femme d’affaires, Evelyn Zelada ne dément pas : « Oui, il le faut. C’est comme quand Molière installait ses tréteaux dans les villes de France, tous les membres de la troupe étaient au four et au moulin. Mais tout ce qui se passe ici est créé sous l’auspice de la culture, pas de la finance » tient-elle néanmoins à préciser au final. ←
☛ Quai de Scène – www.quaidescene.fr



En plein cœur de Strasbourg - 4 espaces séminaires lumineux à composer à votre image - Jusqu’à 90 invités Réunion, séminaire résidentiel, workshop, cérémonie - Cocktail, afterwork, table de partage…
Réservation : 03 67 29 29 33 - seminaire@leonor-hotel.com - 11

Rien ne la prédestinait à diriger l’une des plus grandes salles de spectacles de France. Si la vie avait suivi une trajectoire logique, Sylvie Chauchoy serait peut-être restée au bord d’un bassin.
Rédaction : Hélène Edel Photographie : Tobias Canales
E[E]lle est de ceux qui apprennent tout par eux-mêmes et qui savent ce que vaut la place qu’ils occupent. Depuis 2010, Sylvie Chauchoy dirige le Zénith de Strasbourg, salle monumentale de douze mille places et écrin des plus grandes tournées, tant nationales qu’internationales.
Ce n’est pourtant que la partie la plus visible de son activité : Sylvie Chauchoy coordonne également 15 salles pour le groupe S-PASS TSE, filiale de GL Event, où elle fait le lien entre les directeurs de salle et la stratégie du groupe. Un poste exigeant, transversal, qui exige de savoir entendre, comprendre et trancher. À l’origine, cette autodidacte n’a ni réseau, ni diplôme. Une formation de secrétaire médicale, pas de bac et une première vie passée dans les couloirs chlorés d’un centre de natation de haut niveau à Lyon. C’est l’amour qui la conduit à Belfort et un concours de circonstances qui l’ancre pour de bon dans le monde du spectacle : « Quand je suis arrivée, la piscine de la ville était en travaux. Pas de job pour moi. J’ai fait des ménages, gardé des enfants… Puis j’ai entendu parler d’un poste de secrétaire pour organiser une fête musicale ». Ce sera la première édition du festival Le Ballon, qui deviendra l’année suivante les Eurockéennes de Belfort. Elle n’a jamais vu de concert live de sa vie, mais elle a envie d’en être. Elle postule. Elle est prise. Embauchée sur des contrats courts, elle prend en charge la logistique, la production, la coordination, jusqu’à devenir directrice générale adjointe. Elle apprend en marchant et devient « un pilier » à force de travail et de patience, dans un monde encore très masculin, où l’on gagne sa place par les actes et non par les titres.

Après vingt ans passés sur le terrain, une forme d’usure s’installe. Le besoin d’élargir ses horizons se fait sentir. Elle décide alors de reprendre ses études et s’inscrit à un master en management, qu’elle décroche « avec mention », dit-elle fièrement. « Ce diplôme venait enfin reconnaître ce que l’expérience seule m’avait appris à maîtriser ». Une reconnaissance tardive, mais précieuse. De nouvelles portes s’ouvrent. On lui propose la direction de plusieurs salles, mais elle préfère attendre le bon moment. Il survient en 2008, avec l’ouverture de l’Axone de Montbéliard : elle saisit l’opportunité. Deux ans plus tard, elle prend la barre du Zénith de Strasbourg. Cette salle, elle en parle avec une précision de mécanicienne. Quatre personnes y travaillent à temps plein : elle, un régisseur général, un responsable commercial et un responsable
administratif. La petite équipe est épaulée par une galaxie de prestataires : « On opère en continu, souvent 24h sur 24 ». Sylvie Chauchoy n’assiste jamais vraiment aux concerts. Quand le public applaudit, elle est à son bureau, à faire les comptes. Le métier veut cela. Le règlement se fait « au cul du camion », comme elle le dit avec cette franchise qu’on trouve chez les gens de terrain. On reçoit la recette, on édite la facture, on la discute avec le producteur. Le spectacle n’est jamais qu’une parenthèse faite pour ceux qui regardent. Le Zénith qu’elle dirige ne fonctionne pas comme une salle subventionnée. « C’est notre troisième contrat de délégation de service public signé avec la collectivité depuis 2008. Nous sommes actuellement dans notre troisième mandat de dix ans, qui s’achèvera en 2029 », précise-t-elle. Cette délégation s’accompagne d’une exigence claire : programmer largement, pour tous les publics. Accueillir les grandes tournées, bien sûr, mais aussi répondre aux sollicitations des associations locales, donner une place aux propositions plus fragiles. Sylvie Chauchoy veille à cet équilibre. À la fois gestionnaire rigoureuse, stratège et médiatrice, elle incarne une forme de culture populaire au sens noble : accessible, vivante, exigeante.


Après 35 années passées dans le spectacle, elle a vu le paysage culturel français se transformer : des gymnases bricolés des années 80 aux 17 Zéniths et quelques Arenas aujourd’hui. Elle a assisté à cette bascule, au moment où la musique est devenue une affaire d’équipement, de qualité et de confort. Décorée de la Légion d’honneur pour son parcours professionnel en 2014, elle pourrait raconter les passages de Beyoncé, Lady Gaga, Usher ou ce regard furtivement échangé avec David Bowie, un soir aux Eurockéennes. Mais ce n’est pas son genre. Elle ne frappe pas aux portes des loges. Elle ne cherche ni contact ni lumière. Ce qui l’anime, ce sont les rouages bien huilés, la précision du calendrier, le soin des équipes, la réussite de l’accueil. Elle reste en retrait, volontairement, avec cette sobriété qui fait sa signature. Mais c’est bien cette discrétion-là qui rend le reste possible. L’ombre qu’elle habite éclaire tout ce qui se joue devant. Et quand la salle s’éteint, quand les applaudissements s’évanouissent, elle est déjà ailleurs, à préparer le spectacle suivant. ←
← Sylvie Chauchoy et son équipe sont les seuls salariés à temps plein du Zénith de Strasbourg.
↙ Avec ses 12 000 places, le Zénith de Strasbourg est le plus grand de France.

Des profils en communication, digital marketing, journalisme, marketing sportif ou informatique, de bac à bac+5 en alternance ou en stage, pour compléter vos équipes.
strasbourg@mediaschool.eu tél : 03 88 36 37 81
Bien plus que de simples jardiniers, les Pitch managers du Racing Club de Strasbourg Alsace bichonnent 365 jours par an les pelouses de son centre de performance et du stade de la Meinau.
Rédaction : Olivier Métral
Photographie : Abdesslam Mirdass


L[L]’entretien des terrains, en dépit de leur rectangularité, c’est leur pré carré. Chaque jour, Pierre et Jean-Michel leur consacrent tout leur temps et toute leur énergie pour que les pros du Racing puissent évoluer sur de véritables « billards », que ce soit à l’entraînement ou les jours de match. « Dans ce métier, il n’y a pas de week-ends ni de jours fériés », assure Pierre. « On vit, on respire et on dort gazon toute l’année ».
Un suivi permanent
La mise au vert, qui concerne les joueurs à l’approche d’une rencontre, est pour eux quotidienne. Et rien n’est ici laissé au hasard : ni la hauteur de la pelouse de la Meinau, entre 24 et 28 mm, ni son taux d’humidité, sa température, le pH de son substrat sableux, sa conductivité électrique… Truffés de sondes pour mesurer en temps réel ces paramètres physico-chimiques, les terrains peuvent même être gérés à distance s’il y a lieu de rectifier, « le dimanche, à 23h », le chauffage ou l’arrosage, pour l’entraînement du lundi matin.
Pierre, de son côté, a exclusivement la charge des terrains d’entraînement. Son CV, long comme le bras, témoigne de sa volonté d’évoluer dans des environnements différents et d’apprendre les ficelles du métier dans toutes les situations budgétaires et climatiques possibles. Passé par Lille, Metz, Béziers, Nîmes et Nantes, ce grand gaillard originaire de Béthune est à Strasbourg depuis trois ans. « Le club est venu me chercher », précise-t-il. Dans le monde du foot, le mercato n’est donc pas réservé aux seuls artistes du ballon rond. Dès qu’il en a l’occasion, Pierre prend son bâton de pèlerin pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Il a foulé depuis longtemps déjà toutes les pelouses de France, mais aussi celles de Kaiserslautern, Bruges ou Arsenal. Il échange régulièrement avec Jim Buttar, le « jardinier » de Twickenham, ou Jorge Palma, le fondateur du Centre national du gazon (CENEC), en Espagne, pour gagner – toujours et encore – en compétences.
Pierre et Jean-Michel partagent au bout du compte les mêmes objectifs : satisfaire quotidiennement les exigences de l’entraîneur et de son équipe, mais aussi garantir coûte que coûte la praticabilité de la pelouse de la Meinau quelles que soient les conditions. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende minimale de 50 000 euros. Les jours de match, c’est certain, la pression est loin de reposer sur les seules épaules des Racingmen. ←
↗
Jean-Michel
Heintz au Centre de performance
Racing
Soprema Parc
→ Pierre Habourdin au Centre de performance
Racing
Soprema Parc
« Supporter de longue date du Racing », Jean-Michel est venu au métier sur le tard, après une carrière dédiée à la maintenance industrielle de l’usine BASF d’Obenheim. « Après sa fermeture, j’y suis allé au culot en écrivant en 2007 au directeur de stade, qui m’a ensuite orienté vers l’entreprise qui sous-traite la gestion des terrains. Et là, on m’a donné ma chance ». Depuis 2015, et « après avoir beaucoup appris des anciens et suivi des tas de séminaires », Jean-Michel est responsable, au sein de Racing Espace Vert, de la pelouse de la Meinau.


Élu président de la Cour européenne des droits de l’homme en avril dernier, Mattias Guyomar est le troisième Français après René Cassin et Jean-Paul Costa à occuper cette fonction prestigieuse, mais complexe à l’heure où des vents mauvais soufflent sur les droits humains.
Rédaction : Véronique Leblanc
Photographie : Tobias Canalès, ECHR-CEDH Conseil de l’Europe
N« [N] e me demandez pas d’avoir l’air trop cool ! », prévient Mattias Guyomar avant de se laisser photographier dans le grand escalier du Palais des droits de l’homme le 1er juillet dernier. Mais il sourit pour l’exercice, car le nouveau président de la Cour européenne des droits de l’homme est aussi chaleureux que dynamique. Lors de sa prise de parole en cette soirée d’été où était inaugurée une exposition consacrée au 30e anniversaire de ce bâtiment emblématique du quartier européen de Strasbourg, il en a rappelé la symbolique. Celle d’un paquebot amarré à la berge de la rivière dont il suit le bras et dont les matériaux ont été choisis avec discernement. L’aluminium gage d’indépendance et de neutralité, le verre signe de transparence et d’accessibilité ainsi que le béton qui traduit le caractère fonctionnel de la Cour.
Des murs qui ne sont pas des murs « Vu de face, détaille Mattias Guyomar, ce bâtiment inauguré en 1995 rappelle la balance de la justice avec ses deux salles d’audience cylindriques qui semblent suspendues dans les airs ». Pour reprendre les mots de lord Richard Rogers, son architecte qui œuvra également au Centre Pompidou de Paris : les deux grandes salles d’audience constituent la « tête » du bâtiment, les salles de délibérations son « cou », et les bureaux administratifs déroulent une traîne qui épouse la courbe de l’Ill. Richard Rogers est décédé en 2021, mais Ivan Harbour, membre de l’équipe d’architectes initiale, était présent à Strasbourg à l’occasion du vernissage. « Je suis heureux d’être dans ces murs, bien que je ne sois pas sûr que le mot “mur” convienne », a-t-il confié dans un clin d’œil. Évoquant l’esprit du bâtiment, il précise que « la Cour est l’antithèse d’une forteresse » et confie que, lors du concours, il avait fallu – pour la première fois – tenir compte du critère de durabilité.
Mattias Guyomar au micro avec à ses côtés Marialena Tsirli, greffière de la Cour européenne des droits de l’homme et Ivan Harbour qui fit partie de l’équipe d’architectes emmenée par Lord Richard Rogers. ↓

De « forteresse », Mattias Guyomar ne veut pas entendre parler, lui qui a fait de la visibilité l’un des axes forts de son mandat de trois ans entamé le 30 mai dernier.
Expliquer ce que nous faisons « Cette visibilité implique transparence et accessibilité, elle a trait à la Cour et à l’œuvre de justice. Il faut que les gens comprennent ce que la Convention européenne des droits de l’homme apporte à l’Europe. La justice est rendue par des personnes humaines pour des personnes humaines et il faut rendre visible cette dimension ». Autre thème structurant, l’efficacité, particulièrement en matière de délais de jugement, domaine « où des progrès restent à faire malgré les avancées déjà engrangées par des réformes successives ».
La responsabilité est le troisième point sur lequel il insiste. « La Cour est la gardienne de l’indépendance des juges et de l’institution, mais il n’y a pas d’indépendance sans responsabilité et nous devons être capables d’expliquer ce que nous faisons ».

Originaire de Nantes où son père était professeur de Lettres, Mattias Guyomar a suivi une formation exemplaire : licence de lettres, Sciences Po, École nationale d’administration avant d’intégrer le Conseil d’État où il a occupé presque tous les postes avant de devenir juge à la Cour européenne des droits de l’homme en 2020 et d’y être élu à la présidence en 2025. La défense des libertés fondamentales l’a toujours animé et aujourd’hui, face à « l’érosion croissante de l’adhésion aux droits humains et à l’État de droit en Europe », il refuse de baisser les bras. « Rien n’est jamais acquis, mais… rien n’est jamais perdu. Je reste confiant », dit-il. Revenant aux origines de la Convention européenne des droits de l’homme en 1950, il convoque le souvenir de Pierre-Henri Teitgen qui en fut l’un des rédacteurs avant de devenir juge français à la Cour. Pour cet éminent juriste, à l’époque, il s’agissait « d’éviter le retour de l’épouvante ».
« La vie a besoin du droit » « Aujourd’hui, poursuit le président de la Cour, nous devons livrer un récit collectif à l’échelle européenne pour que soit repartagée cette utopie nécessaire née après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous oppose. La Convention, traité de l’humanisme juridique, est l’instrument partagé qui permet de dégager les dénominateurs communs aux 46 États membres du Conseil de l’Europe. Reste que le droit ne permet pas de régler l’ensemble des comportements.
La vie est heureusement plus forte que
le droit, mais elle a besoin du droit qui est une forme de grammaire sociale. Si nous acceptons que les situations chaotiques, conflictuelles, tragiques, portent atteinte au plus profond des libertés qui découlent de nos valeurs européennes sans aucune intervention judiciaire, alors il n’y aura plus de place pour la vie ».
Une conviction qui résonne lorsque Mattias Guyomar commente la vue qui s’ouvre au regard à partir de la terrasse de son bureau. « L’eau m’évoque le cours de la vie que nous devons accompagner et celui de la jurisprudence de la Cour, le Palais de l’Europe et le Parlement européen signent les “deux Europe”, la Forêt noire au loin rappelle l’Allemagne, les conflits qui ont déchiré le continent et le prix de la paix. Quant à la cathédrale, elle symbolise le passé qui inspire. C’est tout cela notre métier à la Cour européenne des droits de l’homme. » ←
←
Inauguré en 1995, en présence notamment de Vaclav Havel, le Palais des droits de l’homme a obtenu en 2015 le label « Architecture contemporaine remarquable ».
Lord Richard Rogers a quant à lui reçu, en 2007, le Prix Pritzker considéré comme le « Nobel de l’architecture ».
Portes ouvertes aux Strasbourgeois Pour Mattias Guyomar, « L’accessibilité commence à l’échelle locale, ici à Strasbourg. Il est important de rencontrer le public. Le dimanche 21 septembre prochain, des portes ouvertes seront organisées au Palais des droits de l’homme. J’espère que les gens viendront nombreux ».

Entre nature & cœur de ville
3 gammes de prestations, forcément une faite pour vous.

www.quarto-immo.fr - 06 24 68 40 56
Et si nous nous rencontrions sur place ?


Les Mains vertes ce sont celles de Simon Le Mellec et celles de Strasbourgeoises et Strasbourgeois auxquels il transmet son expérience potagère. Ce peut être chez des particuliers, au sein des quartiers et, pourquoi pas, en entreprise.
Rédaction : Véronique Leblanc
Photographie : Alban Hefti
I[I]maginez cinq carrés d’un potager urbain niché au cœur de l’entreprise Loeber, quartier des Écrivains à Schiltigheim. Des petits pois, des haricots, du fenouil, des artichauts, etc. cultivés par des salariés conseillés une fois par mois et deux heures durant par Simon Le Mellec, leur jardinier en chef.
Le potager fut créé dans les années 1950 par la famille qui fonda cette société de génie électrique en 1934.
Il eut ses heures de gloire, mais fut abandonné « jusqu’à ce que nous décidions de le faire revivre pour les 120 employés de l’entreprise », raconte Maurice, comptable chez Loeber. « C’était il y a un peu plus de quatre ans et on a cherché quelqu’un pour nous coacher ». Simon Le Mellec qui avait créé

↗
Mireille, Simon, Maurice et Véronique à l’heure de la récolte.
Les Mains Vertes en 2020 fut choisi pour réveiller le potager endormi en formant une équipe composée de Maurice, Daniel, Mireille, Asma et Véronique, « petite-fille du fondateur, très liée à la maison où vit toujours sa maman nonagénaire, elle passe régulièrement au potager qu’elle arrose lorsqu’il le faut », précise Maurice si prolixe qu’il se fait gentiment charrier par Mireille et Véro en train de s’affairer à mains nues dans la terre. « Il y en a qui causent et d’autres qui travaillent », ironisent-elles. « Au début on est tous arrivés avec des gants », se souviennent-ils « mais Simon nous en a dissuadés, car la terre… il faut la sentir, la toucher ».

Avant de créer Les Mains vertes, Simon s’est formé à la géographie et est devenu hydromorphologue, métier passionnant, mais trop souvent réduit à un face à face avec l’ordinateur. Aspirant à du « concret », vers 2011, il s’est remis au jardinage qu’il pratiquait enfant chez ses grands-parents avant de faire du volontariat dans des fermes de maraîchages en Équateur et en Espagne. « À partir de 2016, j’ai visité des fermes en agroécologie ou en permaculture notamment celle de l’association Terre et Humanisme créée par Pierre Rahbi ».
Potagers d’entreprises « Les Mains vertes ont vu le jour en 2020 durant la pandémie, mais ce n’est pas un bébé Covid », précise Simon qui, à l’époque, a pris contact avec des entreprises, des institutions comme Arte ou bien encore l’Université où il anime un potager d’entreprise pour les employés tout en donnant des cours de jardinage à l’Université populaire. Il intervient aussi dans les quartiers auprès des écoles et des centres socio-culturels comme ce fut le cas à la Meinau où il a supervisé la création d’un « mini jardin-forêt ». Accompagnement de jardins collectifs, ateliers pour adultes ou enfants, coaching jardin pour particuliers…, aujourd’hui sa vie professionnelle est « tout à fait remplie » et il se réjouit de l’intérêt des Strasbourgeois pour le jardinage naturel. « L’activité est gratifiante et n’a rien d’une corvée », souligne-t-il. « Elle fait baisser les stress, resserre les liens, permet de se reconnecter à la nature et donne des résultats. »
Pour les jardiniers de Leober, ce sont ces paniers de fruits et légumes emportés chez eux ou mis à la disposition des autres salariés. « Tout part », disent-ils, car, rappelle Simon, fin gourmet, « l’aboutissement du potager c’est la cuisine ». ←
Il a fini par passer le cap. Alors que le théâtre et la comédie ont toujours accompagné sa vie, Frédéric North a décidé d’en faire son métier à plein temps.
Rédaction : Sébastien Ruffet
Photographie : Christophe Urbain

M« [M]on pied, c’est de faire rire les gens. »
C’était la phrase de conclusion de notre entretien, mais elle permet aussi de rapidement mettre du contexte. À 40 ans, Frédéric North, ex-boulanger, ex-vendeur dans l’immobilier, a décidé de vivre sa crise de la quarantaine du bon côté. « Je me suis posé des questions, et je me suis dit, quoi que je fasse, je reviens inexorablement vers le théâtre. »
Cet Obélix du café-théâtre a baigné dedans quand il était petit. Sa belle-mère était au théâtre alsacien de Schiltigheim, et le petit Frédéric assistait aux répétitions, représentations, sans comprendre le dialecte. « Je surinterprétais la dynamique, le jeu… »
←
Un comédien qui commence à prendre la lumière.
Avec la Boîte à Théâtre, qui a vu le jour en septembre 2023, Frédéric donne des cours, s’invite au sein des entreprises. Mais ce qui le porte, c’est aussi l’émanation comique du projet, la Boîte à Sketchs. « On se dit qu’on tient peut-être un truc », glisse-t-il dans un sourire. Dans la lignée de la Revue Scoute, la troupe propose chaque mois un spectacle différent, à l’abri du Petit Tigre et son caveau, partenaire bienveillant du projet. « J’aime bien cette promesse de proposer quelque chose de nouveau à chaque fois. On prend un risque chaque mois. Je me dis que c’est un spectacle que j’aimerais voir. »
Tout peut partir d’une idée « à la con » Ici, pas forcément d’accent alsacien, « ou alors il faut que ça serve le propos, pas que ce soit une solution de facilité ». Entouré d’une dizaine de comédiens – de l’amateur pur beurre au confirmé – Frédéric aime l’énergie qui se dégage. « Une idée à la con peut devenir hyper drôle », comme l’apparition du Master Mix A Capella Trio (qui sont quatre), née d’un délire lors de l’enregistrement d’une fausse publicité. Depuis les débuts de la Boîte à Sketchs, pas moins de 40 sketchs ont vu le jour : SAV du Père Noël, un réveillon qui tourne mal, deux commentateurs qui analysent un rendez-vous amoureux, les cardinaux qui cherchent un nouveau pape ou encore un ticket de péage qui sème la panique dans la voiture. « On a trouvé nos marques », estime Frédéric North. « Après, je sais aussi que j’ai des comédiens de fou qui peuvent sublimer un texte moyen. C’est une belle bande de potes qui savent travailler. On a trouvé un équilibre, il n’y a pas d’ego mal placé. » ←

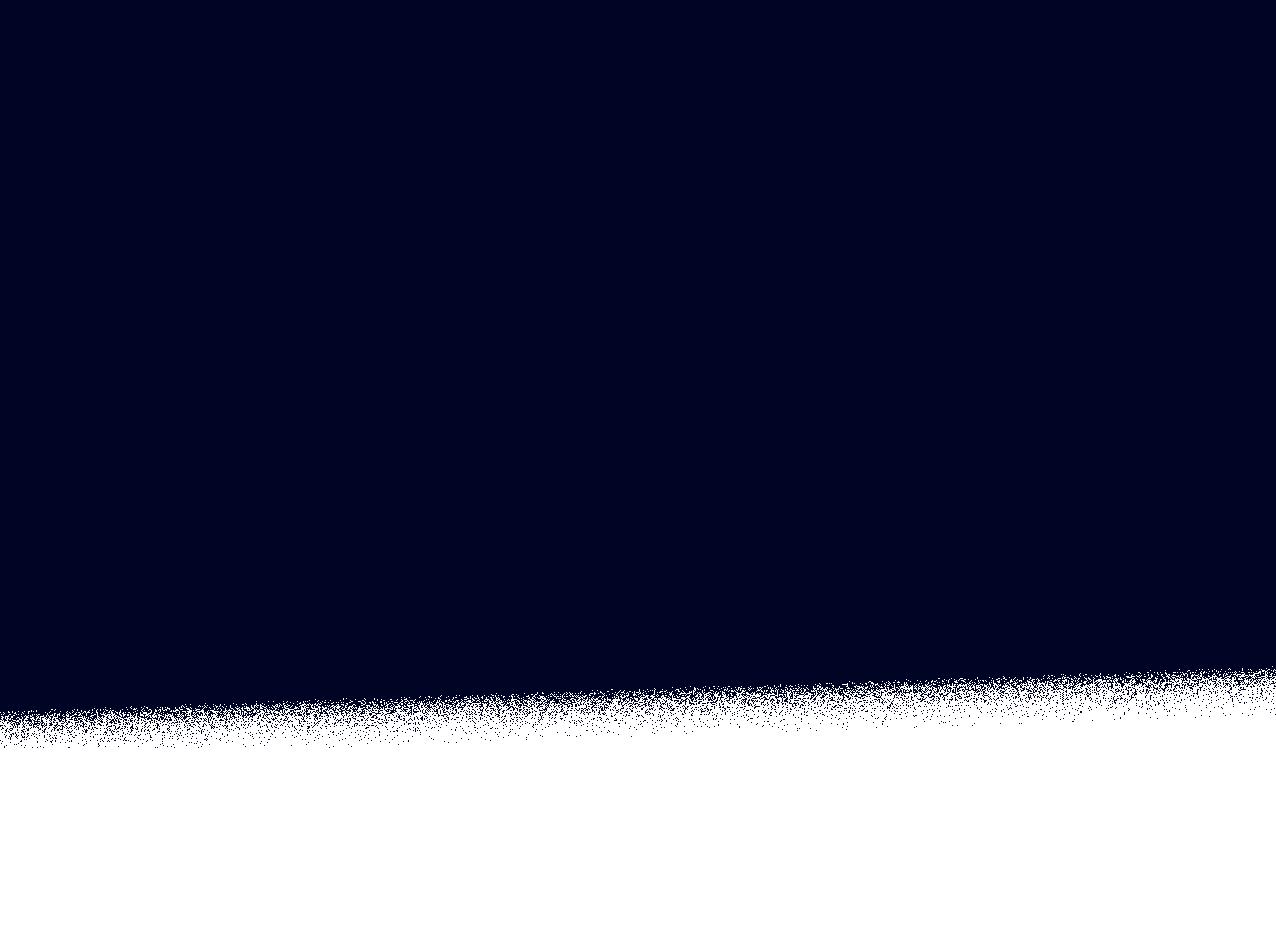

À seulement 26 ans, l’Alsacienne
Constance Schaerer est devenue, en mai dernier, la plus jeune Française à gravir l’Everest. Mais derrière cet exploit sportif se cache un cheminement intime, nourri par une histoire familiale marquée par le deuil, qu’elle raconte dans un livre à paraître à la rentrée.
Rédaction : Guylaine Gavroy
Photographie : Hugo Lorentz
S[S] ur le toit du monde, elle a pensé à lui. Malgré les températures glaciales, les nuages limitant l’horizon et la tempête qui fouettait la crête de l’Everest. « Il faisait extrêmement froid, le temps était très mauvais, j’étais plus en mode survie qu’autre chose. Avec de telles températures, c’était difficile de rester plus de dix minutes au sommet, livre Constance Schaerer. Mon père m’a accompagnée durant toute la montée. C’est lui qui a fait en sorte que j’arrive là-haut. »
L’Everest, sommet d’une histoire intime Le 19 mai 2025, à 6h10 du matin, l’Alsacienne de 26 ans est devenue la plus jeune Française à gravir les 8 848 mètres de la plus haute montagne du monde, aux côtés de son vidéaste savernois Hugo Lorentz, détrônant ainsi la Dijonnaise Hélène Drouin, âgée de 27 ans lorsqu’elle a atteint le sommet de l’Everest le 11 mai 2021. Quelques heures après son ascension, elle écrit sur ses réseaux sociaux : « Mon petit papa, ce lundi 19 mai 2025 à 6h10 du matin, tu reposeras à tout jamais sur le plus haut sommet du monde, l’Everest. »


Pour la jeune femme originaire d’Eschau, cette ascension n’est pas un simple exploit sportif. C’est l’une des étapes d’un projet bien plus vaste : gravir les sept plus hauts sommets des sept continents pour rendre hommage à son père, décédé d’un cancer du pancréas lorsqu’elle avait neuf ans. « J’ai commencé le ski en compétition quelques mois après sa disparition, parce que lui adorait ça. Il m’avait mise sur des skis quand j’avais deux ans et demi. »
La genèse de cette aventure remonte à 2021, lorsque sa grand-tante lui remet une lettre laissée par son père. Le pli renferme ses dernières volontés : « Il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les sept sommets. »
Depuis, Constance Schaerer s’est lancée dans une quête autant personnelle que collective. Le Kilimandjaro (5 891 m), en Tanzanie, tombe en juillet 2021, l’Aconcagua (6 962 m), en Argentine, en décembre 2022, le Denali (6 190 m) en Alaska en juin 2024, et enfin l’Everest au printemps dernier. « Chaque ascension prépare aux suivantes », résume-t-elle. La toute première a été faite sans préparation spécifique, mais pas sans bagage sportif. « Je faisais près de 35 heures de sport par semaine, depuis toute petite, j’évolue au haut niveau. »
Pour cette skieuse accomplie, ces défis ne sont toutefois pas une démonstration de performance. « J’adore la montagne, c’est un endroit où j’aime me recueillir et me retrouver face à moi-même. Pouvoir penser autrement et vivre à un autre rythme. À un moment, il faut des pauses, et je les trouve dans ces ascensions. »
La montagne lui offre un rare espace de déconnexion, un luxe dans une vie effrénée. De retour en Alsace, la pétillante brune jongle entre son activité professionnelle aux Internationaux de Strasbourg, les événements associatifs et ses engagements auprès des sponsors et autres partenaires. « Mes journées s’étirent de 8 heures à minuit, à peu près », raconte cette amatrice de piano avec un sourire lucide. L’entraînement, souvent cantonné aux fins de soirée, s’ajoute à un planning déjà bien rempli.


L’après-Everest a d’ailleurs marqué un basculement. Partie dans un relatif anonymat depuis l’aéroport de Bâle, le 10 avril, l’alpiniste a goûté à son retour, le 28 mai, à une effervescence médiatique qu’elle n’avait ni anticipée ni soupçonnée. « C’était un peu un deuxième Everest, aussi intense que le premier, mais avec beaucoup plus de monde. Beaucoup de messages, le retour du téléphone », sourit-elle. De nombreux plateaux télé et radios nationales lui ouvrent leurs portes, son récit touchant bien au-delà du monde sportif. Loin d’y rechercher la prouesse pure, elle revendique une approche sans arrogance des sommets : « Il ne faut jamais être trop sûre de soi, de manière générale déjà, et en montagne encore plus. Toujours faire de son mieux, mais aussi accepter que cela ne se passe pas comme prévu, donner le meilleur de soi-même, ce sont également des valeurs que m’ont transmises mes parents. »
L’association, un engagement au-delà du sport
L’échec fait partie du processus, comme elle l’a vécu sur le Denali, contrainte de redescendre lors d’une première tentative. Elle en a retiré une leçon d’humilité. Chaque sommet est aussi et surtout l’occasion de faire vivre la mémoire paternelle. « C’est le moment le plus marquant pour moi. Je prends le temps de disperser une partie de ses cendres. »
À travers cette odyssée, Constance embarque bien plus qu’un souvenir familial. Dès 2022, elle fonde l’association Les 7 Sommets, qui soutient les enfants dont un parent est atteint d’un cancer. Près de 500 personnes font désormais partie de cette aventure. Sur chaque sommet, elle
← À 24 ans, Constance Schaerer est venue à bout du sommet de l’Aconcagua (6 962 m) le 9 décembre 2022.
↗ Constance Schaerer en famille.
↙ Après un échec en 2023, Constance Schaerer atteint le Denali en Alaska, le 15 juin 2024.

emporte aussi les messages et les pensées des nombreux enfants qu’elle accompagne.
Dans son livre à paraître à la rentrée, la jeune femme retrace ce parcours hors normes « dans l’ordre chronologique, avec aussi la création de l’association et la façon dont tout cela s’est enchaîné : mon enfance, la maladie de mon père, son décès, la découverte de la lettre, et les ascensions jusqu’à l’Everest. »
Pour l’instant, le titre n’est pas encore validé par son éditrice. « Le titre du manuscrit, c’est Papa tu reposeras sur les plus hauts sommets du monde », souffle cette fille unique.
Trois sommets pour boucler la promesse
L’aventure est encore loin d’être terminée. Il lui reste trois sommets à gravir pour honorer sa promesse : l’Elbrouz (5 642 m) en Russie, le Vinson (4 892 m), point culminant de l’Antarctique, et la Pyramide Carstensz (4 884 m), en Nouvelle-Guinée indonésienne, réputée pour être l’un des plus techniques. L’infatigable baroudeuse envisage même un retour sur le Kilimandjaro, « parce qu’il n’a pas été filmé ». Elle s’était donné trois ans pour venir à bout des sept géants, il lui faudra un peu plus de temps. Qu’à cela ne tienne, elle n’est plus aussi pressée. L’année, elle, s’annonce toujours aussi dense, entre les projets associatifs avec les enfants – comme un week-end dans les Vosges, ou une rencontre avec le parrain de l’association Sébastien Loeb à Divonneles-Bains – les trails, dont l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) cet été, et la préparation des prochaines expéditions. Les dates de celles-ci ne sont pas gravées dans la roche : « Je vis au jour le jour. Je ne pense pas à demain. »
Constance Schaerer a peut-être déjà vaincu les plus hauts sommets du monde. Mais sa véritable force réside ailleurs : dans sa capacité à transformer le deuil en élan collectif, à transmettre son énergie. Une manière bien à elle de continuer, chaque jour, à déplacer les montagnes. ←
01 - 03 oct
LES GRANDES
ESPÉRANCES
Charles Dickens Laurent Fraunié
07 - 11 oct
DEUX OU TROIS CHOSES
DONT JE SUIS SÛRE
Dorothy Allison Manon Ayçoberry
15 - 17 oct
ARTHUR ET IBRAHIM
Amine Adjina
* JEUNE PUBLIC * 04 - 07 nov
CORTEX/ DIPTYQUE
Catherine Monin, Mélie Néel
Olivier Chapelet
13 - 14 nov
MÉDUSES
Mélie Néel
Noémie Schreiber, Cécile Roqué Alsina
18 - 21 nov
TOUS COUPABLES
SAUF THERMOS GRÖNN
Romane Nicolas Sacha Vilmar
25 - 28 nov
NOS JARDINS
Amine Adjina
Émilie Prévosteau 04 - 05 déc
TRAVERSER LA CENDRE
Michel Simonot
Nadège Coste
10 - 12 déc
DOMINIQUE
TOUTE SEULE
Marie Burki
* JEUNE PUBLIC * 17 - 19 déc
JÉRÉMY FISHER
Mohamed Rouabhi
Thomas Ress

TAPS Scala TAPS Laiterie


14 - 16 jan
GÉNÉRATION MITTERRAND
Léo Cohen-Paperman
Émilien Diard-Detoeuf
20 - 23 jan
LE SANCTUAIRE
Laurine Roux
Manuel Bertrand
27 - 30 jan
REVENIR
Guillaume Poix
Catherine Javaloyès
03 - 07 fév
CHAMBRE 129
Marie Schoenbock
Céline d’Aboukir
11 - 13 fév
LA PUCE ET L’OREILLE
Sarah Carré
Stéphane Boucherie
* JEUNE PUBLIC *
10 - 14 mars
ACTUELLES
28e édition
17 - 19 mars
TERRE-VILLE
Maud Galet Lalande
24 - 27 mars
VIVE
Joséphine Chaffin
Clément Carabédian
08 - 10 avr
BUNKER
Collectif Superamas
05 - 07 mai
DANUBIA
Miroir des eaux
Ramona Poenaru, Gaël Chaillat
* JEUNE PUBLIC *
19 - 22 mai
QUAND LA VILLE SE LÈVE
Charlotte Lagrange
27 - 29 mai
L’AMOUR
C’EST POUR DU BEURRE
Écriture collective
Éline Schumacher

taps.strasbourg.eu 03 68 98 52 02

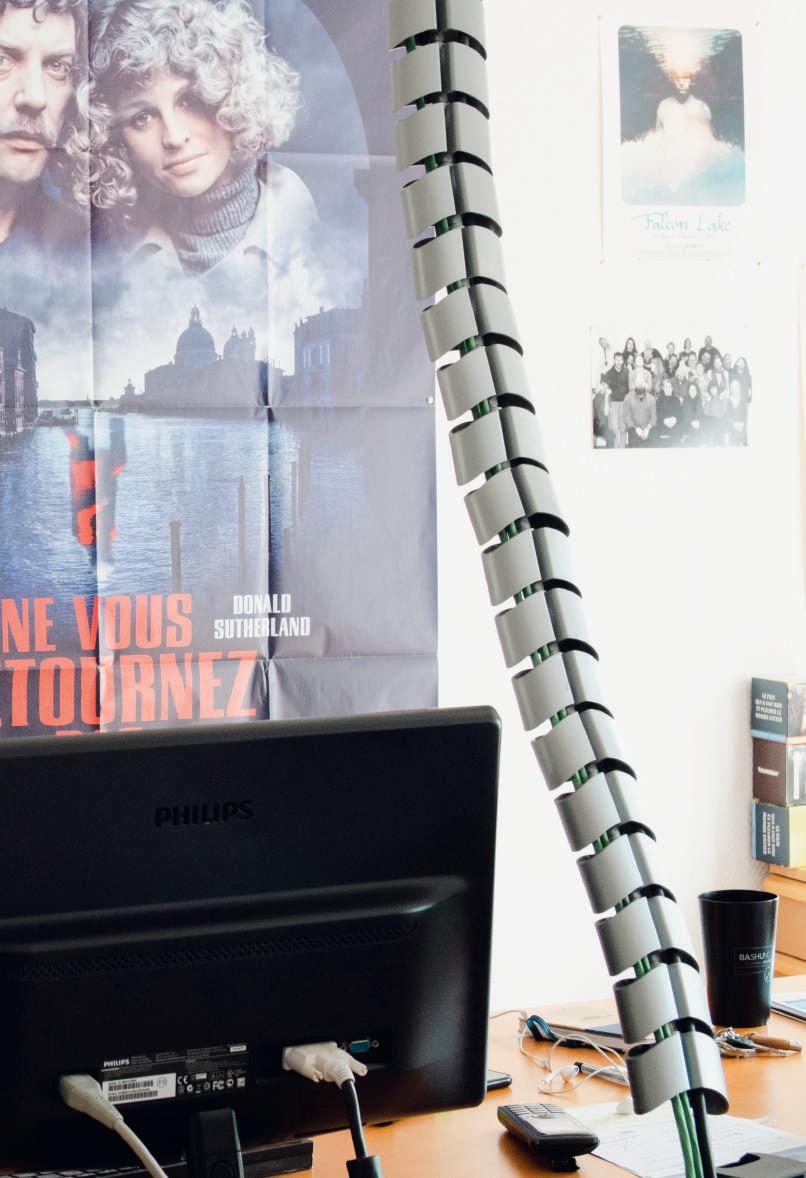
En ce début d’été 2025, la canicule précoce de juin est une vraie épreuve pour l’équipe du Star logée directement sous les toits du cinéma de la rue des Enfants. Bravant l’étuve, Stéphane Libs nous en dit plus sur l’avenir de ses deux établissements.
Rédaction : Jean-Luc Fournier
Photographie : Tobias Canales
La queue d’alien
« Je l’appelle la queue d’Alien… », rigole Stéphane Libs en parlant de cette imposante gaine de plastique gris qui enserre les câbles de l’informatique de son bureau pour les diriger vers le serveur, via les combles. La queue d’Alien est vraiment ce qui saute aux yeux en premier dans le bureau du directeur des Star.
L’affiche des auteurs américains
Créée par l’éditeur français
Gallmeister, cette affiche illustre les innombrables romans de la littérature américaine selon les États où se déroulent les histoires. Souvent ces œuvres ont été adaptées pour le cinéma indépendant américain, « moins vivace qu’autrefois » concède cependant Stéphane Libs.
Le trophée Europa Cinémas Il trône fièrement sur le bureau. Europa Cinémas est un très important réseau européen diffusant des films classés « Art et Essai ». Les cinémas Star ont obtenu le titre de « Meilleur cinéma de programmation européenne » en 2012…
La fermeture pour dix-huit mois de travaux des cinq salles du Star Saint-Exupéry en octobre est bien sûr le dossier incontournable sur lequel travaillent Stéphane Libs et son équipe. Nul besoin d’être plus explicite : les cinémas Star vont perdre ni plus ni moins que cinq salles sur les dix actuellement en exploitation. « Avant toute chose », intervient Stéphane Libs, « il faut souligner à quel point bénéficier d’un parc de dix salles consacrées aux films d’art et essai est un luxe pour une grande ville de France. Aussi je comprends les inquiétudes de notre public. Je veux tout de suite les rassurer : si ces travaux au Saint-Ex sont liés à la sécurité globale du bâtiment (propriété de la Ville de Strasbourg – ndlr), ils sont devenus impératifs au fil du temps, mais si on ferme ces cinq salles, c’est évidemment pour mieux rebondir… »
Une programmation
encore plus « art et essai »
On sait depuis plusieurs mois que le nouveau Saint-Ex verra son entrée principale se situer à l’arrière de l’immeuble actuel, près du restaurant La Fignette, une réalisation qui sera l’occasion de beaucoup mieux valoriser un endroit un peu glauque aujourd’hui. Une petite entrée subsistera néanmoins côté rue du 22 novembre dans le prolongement de l’actuel bar qui fera peau neuve lui aussi.


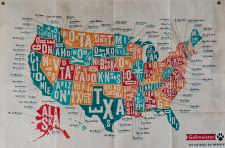
↑ Stéphane Libs et quelques objets présents dans son bureau.
Les cinq nouvelles salles bénéficieront d’un tout nouveau confort, « notamment grâce au gradinage et à un accès facilité via un ascenseur », tient à souligner son directeur. Mais c’est sur le terrain de la programmation pendant la fermeture du Saint-Ex que Stéphane Libs était attendu. « On a fini par s’orienter sur un renforcement encore plus prononcé des films art et essai. On les programmera par séquences de trois séances par jour, au lieu des cinq traditionnelles et on commencera nos projections plus tôt, dès 10h30 quelquefois. Avec ce système, on pourra donc accueillir un maximum de films sur nos cinq salles restantes. Le défi est que le Star fonctionne très bien, car son exploitation servira aussi à assurer nos engagements financiers sur le budget des travaux du Saint-Ex… »
Par ailleurs, Stéphane Libs se fait fort de pouvoir convaincre les distributeurs de persévérer dans leur volonté de programmer ces avant-premières qui font le succès de la programmation des cinémas strasbourgeois. Le directeur des Star, s’il ne l’évoque pas ouvertement, sait très bien que la concurrence sera toujours là pour programmer ces avant-premières si importantes pour « lancer » un film. « On a vraiment besoin de tous nos fidèles pour que vous acceptiez ces contraintes afin que nous vivions tous des moments formidables, dans un an et demi… » conclut-il. ←




OSEZ LA DIFFÉRENCE… ON S’OCCUPE DU RESTE.
Chez Creatio, nous avons des solutions originales et un savoir-faire unique pour optimiser vos espaces et vous offrir la singularité qui vous ressemble. Chaque projet est pensé comme une pièce unique, à la croisée de l’architecture d’intérieur, du design et de l’émotion. Du travail des matériaux nobles aux finitions soignées, des agencements sur mesure à la coordination des métiers d’art, Creatio donne vie à des atmosphères singulières, sophistiquées et résolument contemporaines.
Une société de KS groupe
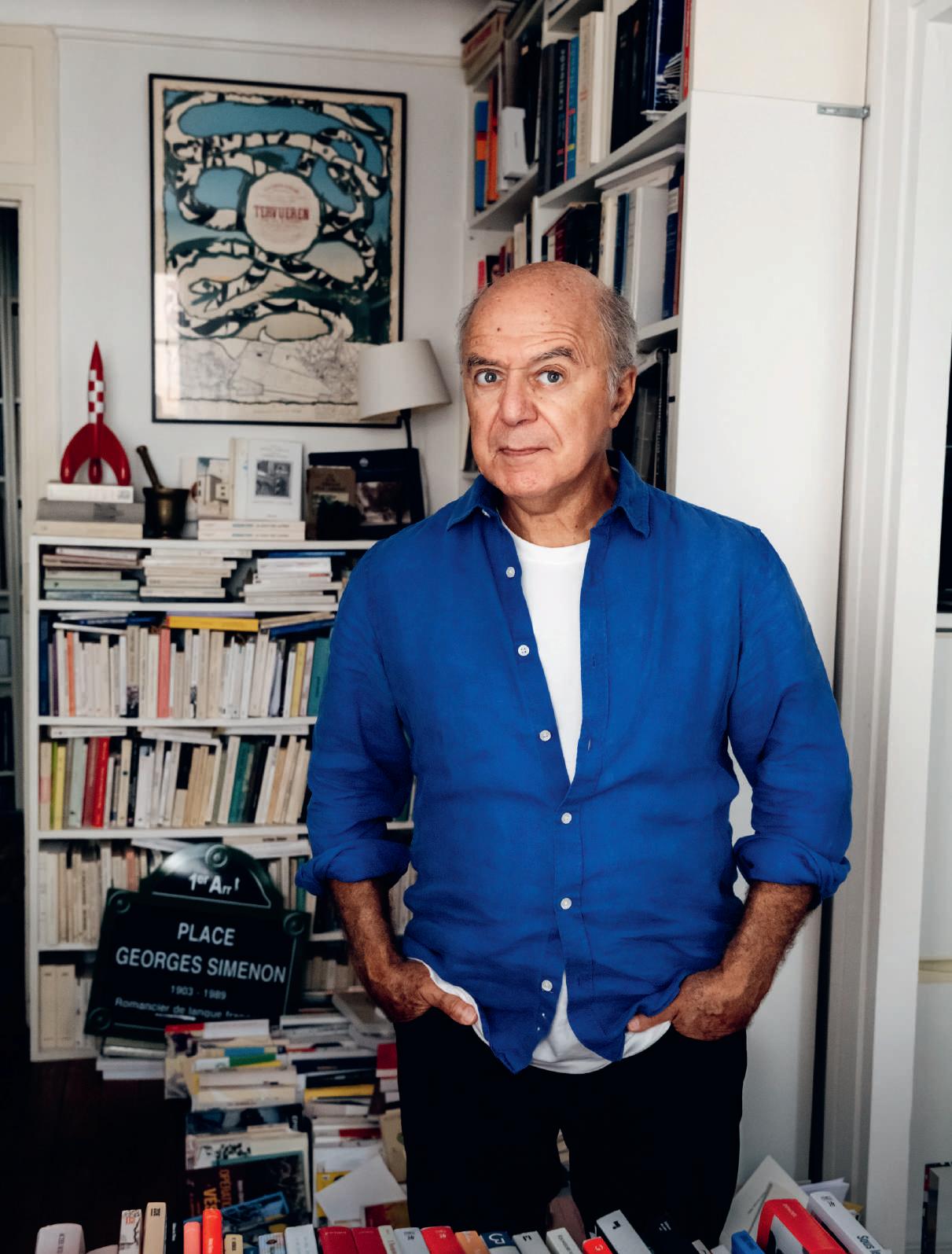
Plume majeure du journalisme littéraire, ancien directeur de Lire, romancier, biographe et juré du Prix Goncourt depuis 2012, Pierre Assouline sera des nôtres lors de cette nouvelle édition des Bibliothèques Idéales. Il présentera son Dictionnaire amoureux des livres et de la lecture (Plon) et cette correspondance forte avec Éric-Emmanuel Schmitt et Abdennour Bidar : Un juif, un chrétien, un musulman : Fraternels ou fratricides ? (Albin Michel). Avant sa venue à Strasbourg, c’est dans son bureau parisien chargé de mots et de mémoire que s’est tenue cette conversation entre livres, guerres et espérance.
Rédaction : Vanessa Chamszadeh Photographie : Line Brusegan
Depuis 28 ans, vous enseignez l’art d’écrire à Sciences Po. Après Comment écrire publié en 2024 chez Albin Michel, vous signez un nouveau dictionnaire amoureux, cette fois sur les livres et la lecture. Qu’est-ce qui reste mystérieux pour vous dans l’acte d’écrire et de lire ?
Tout est mystérieux. On n’en a jamais fait le tour. Dans Comment écrire, je me suis surtout attaché à comprendre les manières qu’ont les autres d’écrire. J’ai récolté des interviews en France et ailleurs, d’écrivains disparus et contemporains, chacun livrant sa façon de faire. Et je me suis aperçu qu’il n’existe ni règle ni recette, et qu’il ne faut surtout pas hésiter à apprendre des uns et des autres pour forger son propre style. Il faut inventer son ars poetica. Mais pas en vase clos. Pas sui generis. En s’ouvrant à l’expérience des autres, en laissant leurs pratiques nourrir la nôtre.
Avez-vous un rituel d’écriture ?
J’ai un rituel que je n’ai emprunté à personne. Il a été bouleversé en quarante ans par deux révolutions. La première fut celle du geste, du carnet au téléphone portable. Avant, je noircissais des pages entières en bibliothèque, en lisant, pour préparer mes biographies, jamais sur la machine à écrire. C’était forcément manuscrit. La seconde révolution fut celle de l’écriture avec l’apparition du traitement de texte, un vrai cap. Abandonner la machine à écrire que je trouvais pourtant extraordinaire fut une libération. On corrige, on enrichit, on taille, on recommence sans fin. Une seule version, oui, mais en chantier permanent. Un work in progress sans point final.
Qu’est-ce qui vous pousse encore à écrire ?
La curiosité m’anime dans mon métier de journaliste et de biographe. Et puis il y a la transmission. Même ma curiosité de romancier, enracinée dans l’Histoire, ma passion, obéit à ce double élan. M’intéresser à tout, oui, mais si je ne transmets pas, j’ai la sensation de quelque chose d’inabouti, d’un processus refoulé. C’est un binôme indissociable.
« LA PLUPART DES
PRESQUE TOUS, SONT D’ABORD DE GRANDS LECTEURS. »
Dans la préface de ce dictionnaire amoureux, vous écrivez qu’un livre, un chapitre, un paragraphe, une phrase au sein d’un livre suffisent à changer une vie. Est-ce qu’un livre peut aussi en faire naître un autre ? Et pour L’Annonce (Gallimard), y a-t-il eu un livre déclencheur ?
Aucun doute, des livres en font naître d’autres. Toute l’histoire de la littérature repose là-dessus. La plupart des écrivains, presque tous, sont d’abord de grands lecteurs. Ils écrivent parce qu’ils ont lu. Parfois, un livre en déclenche un autre directement. L’Annonce, par exemple, est né d’une double impulsion, l’envie d’accompagner le cinquantième anniversaire de la guerre de Kippour, et le souvenir d’un livre puissant, Une femme fuyant l’annonce de David Grossman. Les deux sont liés.
Écrire ce livre a-t-il été une souffrance exigeant du courage ?
Du courage ? Non, je ne le vois pas ainsi. C’était un plaisir de replonger dans mes vingt ans. Quand je me lance dans un livre, je collecte des tonnes de documents. Je les étale sur mon bureau. Cette fois, rien. Juste l’ordinateur. J’ai tiré un fil, simplement. Tout était en moi, intact, il suffisait de suivre la chronologie du jour de l’annonce de la guerre de Kippour. Ce qui a été douloureux, c’est de revivre cette scène, l’annonce de mon départ en Israël à ma famille, surtout à mon grand-père. J’ai écrit ces pages les larmes aux yeux. Et puis là-bas, aux côtés d’Esther, chargée d’apporter aux familles la nouvelle irréparable de la mort de leurs fils.
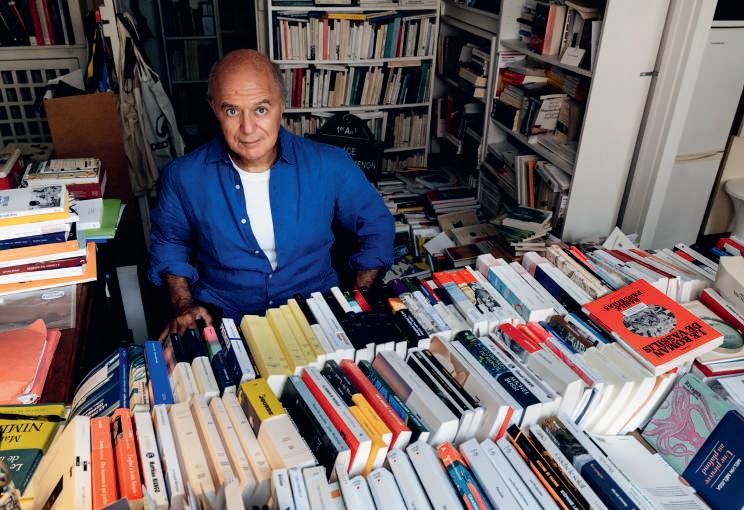



Et, dans la deuxième partie, auprès de ceux qui ont vécu le 7 octobre 2023, face au nombre sidérant d’otages et à l’onde de choc qui suivait. Impossible de rester indemne devant cette réalité.
La phrase de David Grossman posée en épigraphe donne la mesure du livre. Est-ce l’âme juive qui porte un exil éternel, ou l’attitude du monde qui maintient les juifs dans cette errance ? Ce mythe du juif errant inscrit dans l’inconscient collectif ?
Certains diront qu’il n’erre plus vraiment depuis qu’Israël lui a offert un ancrage, voilà soixante-quinze ans déjà. Mais est-ce l’âme qui reste inquiète par nature, ou le regard de l’autre, celui de l’antisémite, qui la rend ainsi ? Sans doute un peu des deux. Je suis habité par la phrase de David Grossman, ce désespoir qu’il porte depuis la mort de son fils. Je le partage. Je suis nostalgique d’un Israël qui n’existe plus, celui de Golda Meir, de Ben Gourion. Le pays a changé, la part du religieux s’est imposée, creusant un fossé avec les laïcs, jusqu’à menacer l’État de droit. La crainte d’une guerre civile plane. Et cette dérive vers une démocratie illibérale n’est pas qu’israélienne, c’est une réalité presque mondiale.
« CETTE DÉRIVE VERS UNE DÉMOCRATIE
À vingt ans, l’amour et la mort s’entremêlent dans votre livre. Quand on vit une guerre si jeune, l’on mûrit ou l’on se brise ? Qu’est-ce qui vous a le plus changé, la guerre elle-même ou l’indifférence du monde après ?
On mûrit vite, mais on ne choisit pas. Certains s’effondrent, d’autres grandissent d’un coup. Moi, tout m’a changé. Vivre la guerre là-bas, c’est une chose. La partager avec les Israéliens, marcher à leur rythme, parler avec eux chaque jour, les voir s’entraider. Dans cette tension quotidienne, quelque chose s’éclaire, l’humain, l’humanité brute, la solidarité qui devient instinct de survie. Et puis, une semaine après mon retour, assis dans un amphi, je n’avais déjà plus rien à dire, plus rien en commun. C’était irrémédiable.
Peut-on vraiment s’habituer à une tragédie collective ? Et cette résilience qu’on invoque sans cesse, qu’est-ce qu’elle dit de nous ?
La résilience, on en a fait un mot pratique, presque un réflexe, surtout quand il s’agit des Israéliens. Depuis soixante-quinze ans, on les plaint parce qu’ils vivent dans la guerre, puis on s’empresse d’admirer leur résilience. Comme si cela suffisait à rendre tout supportable. Elle existe, bien sûr, cette force-là. Mais là-bas, elle prend souvent des allures de fuite en avant. Pas par choix. Parce que chaque guerre est une guerre existentielle, perdre, ce serait disparaître. Alors on avance, on tient debout. Mais vivre ainsi, sans aucun droit à l’erreur, c’est terriblement lourd.
« J’étais Français le jour et juif la nuit », lorsque vous militiez à l’âge de vingt ans à Paris. Quand un événement comme ces deux guerres nous frappe, de quelle façon vient-il questionner notre identité ?
De plein fouet. Pas le temps de réfléchir. On obéit à sa conscience, un point c’est tout. Tout le reste, c’est se dérober. Ces deux guerres n’ont pas façonné mon identité, elle était déjà là, entière. Elles l’ont simplement bousculée, mise en débat. En 1973,


Nous confier votre terrain c’est :

Un prix attractif
Vendez votre terrain au meilleur prix avec Nexity et ses experts.
Des avantages fiscaux
Profitez d’un abattement fiscal sur la plus-value en zone tendue.
Une expertise et un accompagnement
Un expert local dédié à l’opération vous accompagne à chaque étape.
Contactez-nous pour valoriser votre terrain et développer notre région !
Yann SCHAFFNER
Responsable Développement yschaffner@nexity.fr 07 62 74 86 86
c’était une guerre classique. Le 7 octobre, c’est autre chose, un massacre terroriste qui a déchaîné, partout, une parole antisémite décomplexée. Dans les rues, sur les campus, une haine sans frein, reprise par les idéologues islamistes et amplifiée par leurs idiots utiles de l’extrême gauche. On reste sidérés devant ce torrent.
En 1973 déjà, vous sentiez l’écart entre ce que vous viviez en Israël et ce qu’en disait la presse. Cinquante ans plus tard, rien n’a changé. Votre héroïne avertit : « Parler d’Israël sans lui cracher à la figure, c’est s’exposer ». Vous vous êtes exposé en écrivant ce livre ? Exposé, oui. Qui expose s’expose. J’ai reçu surtout de l’intérêt et de la solidarité, des milieux chrétiens. Depuis le 7 octobre, côté juif, un besoin de se rassembler, pour se protéger, comprendre, mesurer ce basculement qui transforme les victimes en coupables. Et cette stupeur, voir des esprits affûtés, géopoliticiens et intellectuels, capables d’« oublier ». Oublier les milliards engloutis dans les tunnels plutôt que dans des abris. Oublier que l’Égypte garde sa frontière close. Oublier qu’aucun pays arabe n’accueille les Palestiniens. Le silence évite d’avoir à penser.
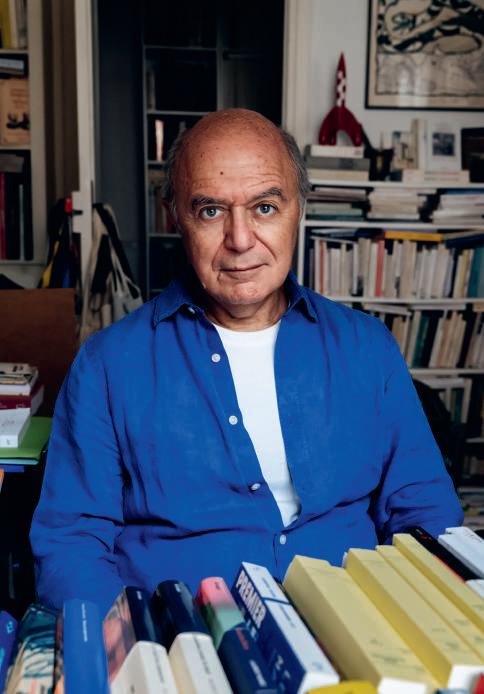
Ce livre porte un pessimisme rare chez vous, vous écrivez notamment que « l’antisémitisme a le sommeil léger ». Dans ce contexte, comment voyez-vous l’avenir ?
Optimiste de nature, plus depuis le 7 octobre. Trump, le climat, la guerre contre la connaissance. Mais surtout ce soir-là, le Hamas a gagné. Pas pour les Palestiniens, leur sort n’a jamais été son enjeu, mais contre Israël. Traumatisme profond, confiance dans l’armée brisée, économie à genoux, vingt ans de diplomatie effacés. Il a réussi à ce qu’une génération de jeunes Européens ne prononce jamais plus le mot « Israël » sans y associer « génocidaire ». Et le Hamas, toujours là, même en lambeaux. Plus que jamais, le cercle de la haine s’est refermé. Dans la presse arabe, on ne dit plus « Israéliens », on dit « Juifs ».
Quel est l’objectif de cet échange épistolaire entre vous, Éric-Emmanuel Schmitt et Abdennour Bidar, Un juif, un chrétien, un musulman : Fraternels ou fratricides. Pourquoi avoir choisi cette forme ? Et pensez-vous que ce livre puisse servir de support éducatif ? Il faut rendre grâce à Éric-Emmanuel Schmitt d’avoir lancé ce projet un peu fou et d’en avoir inventé la forme. Il nous a réunis, et nous nous sommes lancés. À y réfléchir, c’était parfait. Un support éducatif ? J’aimerais bien, surtout que je vais souvent dans les lycées parler de mon livre Le Nageur. La forme épistolaire est idéale, chacun garde sa voix, l’essentiel pour un écrivain. Éric-Emmanuel et Abdennour sont philosophes. Ça place l’échange haut, très haut. Tant mieux. Les lecteurs apprécient qu’on les élève. Ça oblige.
Et s’il ne restait qu’un mot, Pierre Assouline ? Lequel ? FRATERNITÉ. ←
« DANS LES RUES, SUR LES CAMPUS, UNE HAINE SANS FREIN, REPRISE PAR LES IDÉOLOGUES ISLAMISTES ET AMPLIFIÉE PAR LEURS IDIOTS
Pierre Assouline est l’invité des Bibliothèques idéales :
→ Dimanche 21 septembre à 15h30 au Parlement européen Lecture avec Éric-Emmanuel Schmitt et Abdennour Bidar.
→ Mercredi 24 septembre à 12h Déjeuner littéraire. Sur réservation (biblideales.fr)
L’histoire

Les Talents Sati : 12ème édition
Chaque année, Café Sati met en lumière un.e artiste à travers Les Talents Sati, un concours qui offre une visibilité unique dans l’espace public strasbourgeois.
L’oeuvre retenue est imprimée en grand format (120m²) et décore la façade de la torréfaction, en bordure du Rhin, pendant 1 an. Cette initiative, née de la volonté de soutenir la création contemporaine et les jeunes talents, fait le pont entre l’art, l’industrie et la ville.
Œuvre lauréate 2025 : «Baywatch Breakdown» par Sophia Lang
Pour cette 12ème édition, l’artiste réinvente l’imaginaire du «beach body» en brisant les codes du corps parfait popularisé par la série Alerte à Malibu.
Baywatch Breakdown célèbre les corps gros, queers, ridés ou jugés «trop» par la norme, et transforme la plage, lieu de désir mais aussi d’exclusion, en espace de réappropriation.
Installée en grand format sur la façade des Cafés Sati, l’oeuvre utilise les codes de la publicité pour mieux les détourner : esthétique kitsch, pop et punk, couleurs saturées, humour trash et revendiqué.
Le slogan «Want a beach body? Have a body and go to the beach!» s’impose comme un manifeste body positive, porté par une énergie joyeusement irrévérencieuse.
L’oeuvre se veut accessible à tous, sans filtre ni jargon, et cherche autant à faire sourire qu’à bousculer.
C’est une invitation à occuper l’espace public avec son corps, tel qu’il est, et à réinventer collectivement nos imaginaires corporels.


Àquelquesmoisdesélectionsmunicipalesquisetiendront les15et22mars2026,nouslançonsunesériedetroisdossiers, chacunconsacréàunenjeumajeur,àretrouverdansnosprochainsnuméros.
PhotographieparNis&For


ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dans moins de six mois, on connaitra les résultats des élections municipales. Parce que la culture a toujours été un budget essentiel pour la Ville de Strasbourg (à un certain moment, un euro dépensé sur quatre était consacré à ce secteur), il était intéressant de dresser un état des lieux aussi précis que possible (bien qu’à l’évidence non exhaustif), quatre saisons après le bouleversement de la crise sanitaire et l’arrivée du nouvel exécutif municipal. Et de tenter d’entrevoir l’avenir...
Rédaction : Jean-Luc Fournier
☛ Essayons tout d’abord de comprendre ce qui se passe au niveau national. Un peu partout, la question centrale est vite posée : soutenir ou ne pas soutenir la culture ? Et si oui, comment s’y prendre quand l’aisance budgétaire n’est de loin plus au rendez-vous ?
Il y a tout d’abord les sabreurs façon « exterminator » aux premiers rangs desquels se distingue Christelle Morançais, la présidente de la Région Pays-de-Loire. -62 % sur le budget culture, un véritable massacre à la tronçonneuse qui laisse exsangue le tissu associatif et artistique régional. Le tout soutenu par des déclarations grassement démagogiques où sont pointées du doigt « des associations culturelles politisées qui vivent de l’argent public ». Retour aux pires heures des années 70… sans que rien ne soit contrebalancé par l’intervention ou le soutien du ministère ! Silence total, assourdissant même, Mme Dati ayant d’autres chats à fouetter avec
la réforme de la gouvernance de l’audiovisuel public qu’elle est bien la seule à juger nécessaire au vu des excellents résultats d’audiences des chaines télé et radio publiques.
Heureusement, pour l’heure, le massacre de la culture dans les Pays-de-Loire reste un cas isolé, on relève même, et ce n’est pas rare, des collectivités locales (et pas uniquement de gauche) où les moyens publics se maintiennent voire même progressent. Le cordon sanitaire fonctionne encore.
Heureusement, à Strasbourg et en Alsace, on est loin de ces extrémités drastiques. Cependant, aucun de nos interlocuteurs n’a caché une inquiétude diffuse ; combien de fois avons-nous entendu l’expression « Ça peut se renverser très vite… »
Les grandes institutions… C’est sans doute ce biais qui permet le mieux de comprendre ce qui se passe dans une


ville où la culture a toujours (jusqu’à présent) été considérée comme essentielle.
C’est la directrice générale de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Marie Linden, qui l’exprime peut-être le plus clairement : « Comme pour toutes les grandes institutions strasbourgeoises, la Ville de Strasbourg nous a annoncé une baisse de 2,5 % de sa dotation globale, à compter de 2024, ce qui pour nous s’élevait à un manque à gagner de 147 000 €. Nous avons pu bénéficier d’une prestation compensatoire en raison de difficultés passagères, mais, désormais, cette baisse s’applique complètement. Cependant, je voudrais immédiatement relativiser… » tient à préciser la directrice générale de l’OPS, « nous sommes encore soutenus à hauteur de 9,5 millions d’euros, c’est une somme considérable en regard des soutiens dont bénéficient les autres grands orchestres régionaux du pays. On s’est adapté : nos concerts sont moins fréquemment
doublés, on a traqué toutes les dépenses un peu partout. Et nos recettes ont progressé de façon dynamique, l’apport de la billetterie correspondant désormais à plus de 10 % de notre budget… »
À l’Opéra national du Rhin, Alain Perroux, qui vit sa dernière saison de direction avant de rejoindre l’Opéra de Genève en juin prochain, confirme la baisse des subventions évoquée par sa consœur de l’OPS et regrette que, depuis, « le montant des dotations stagne en raison de la non-prise en compte de l’inflation. Au final, cela handicape fortement nos marges de manœuvre, car, rien qu’en 2022 et 2023, nous avons eu 20 % d’inflation cumulée. De plus, nous avons également dû assumer les hausses du point d’indice ainsi que notre mise en conformité avec les grilles de la fonction publique. La hausse de la masse salariale a donc été assez nette. Nous avons dû prendre des mesures quant à la programmation de
Marie Linden, directrice générale de l’OPS
« Nous sommes encore soutenus à hauteur de 9,5 millions d’euros, c’est une somme considérable en regard des soutiens dont bénéficient les autres grands orchestres régionaux du pays. »
« En fait, il n’y a pas de mystère, nous nous en sortons en produisant moins de spectacles, en jonglant avec les programmations. »
nos spectacles : nous avons renoncé à aller présenter un opéra à Mulhouse, lui substituant une version concert (les abonnés mulhousiens ont néanmoins pu assister aux représentations strasbourgeoises à des conditions préférentielles – ndlr). En fait, il n’y a pas de mystère, nous nous en sortons en produisant moins de spectacles, en jonglant avec les programmations, par exemple à Noël 2023, en reprenant un ballet sur Chaplin comme spectacle de fin d’année, beaucoup moins coûteux. Nous avons également fortement réduit nos commandes d’orchestres extérieurs et notamment d’ensembles baroques, ce qui fragilise évidemment ces structures indépendantes. Nous faisons parfois des arbitrages très compliqués en matière de cadrages des cachets des metteurs en scène et de leurs équipes, des chefs d’orchestre, des chanteurs… Sans parler de l’interne. »
Malgré les dotations aujourd’hui plafonnées des trois villes-piliers de l’OnR, Alain Perroux continue à saluer leur soutien résolu. Mais il s’étonne néanmoins du désengagement de la CEA, récemment appris. Bien sûr, « c’est une somme de 28 000 € dont il s’agit, c’est vraiment très peu vis-à-vis de notre budget. Mais je suis dans l’incompréhension totale par rapport à cette décision, car, depuis mon arrivée, nous n’avons eu de cesse que de multiplier les spectacles un peu partout, à Sarre-Union ou Mutzig par exemple… Il y a encore quinze ans, la subvention cumulée des deux départements alsaciens représentait 200 000 €… » Au contraire, la région Grand Est a légèrement augmenté son soutien. Elle joue le jeu, notamment en proposant des apports en termes d’investissement.
Du côté des Musées de Strasbourg, Émilie Girard, arrivée il y a à peine dix-huit mois en provenance de Marseille, s’est « attelée au
vaste chantier de la redéfinition des ambitions pour les musées de la ville et de la valorisation de leurs collections. Un bon exemple est la réouverture du musée zoologique, très attendue et nous recevrons à l’automne le célèbre photographe animalier, Vincent Munier… » L’attention de la directrice des Musées de Strasbourg se porte sur un gros dossier, les problématiques de fermetures de salles en raison de personnels non disponibles. « Nous travaillons pour début 2026 à une révision totale des plannings », poursuit-elle, « mais moi qui ai la notion de service public de la culture chevillé au corps, je me réjouis de constater la stabilité de la dotation globale. C’est une vraie chance même si la répartition est un exercice de haute volée, un vrai travail de dentellière. Un an et demi après ma prise de fonctions, je suis plus consciente de la diversité de mes fonctions et je cerne beaucoup mieux la nature de mes missions. Les difficultés ne me paraissent pas insurmontables, mais bien sûr, je n’ai pas de baguette magique à ma disposition », conclut-elle.
Du côté des structures plus petites…
Chez Pôle-Sud, qui est devenu Centre de Développement Chorégraphique National, aucune inquiétude. Sa directrice, Joëlle Smadja, précise que « nous n’avons pas eu à subir de baisses réelles. Mais je sais que la situation nationale et surtout certaines structures sont très impactées par des décisions de collectivités locales, je suis solidaire évidemment des luttes pour le maintien du service public de la culture… »
Au TAPS, dont la gestion est totalement intégrée au service Culture de la Ville de Strasbourg, le directeur, Olivier Chapelet, reconnait que son budget global « baisse de façon assez continue d’année en année puisqu’il
VOTRE ABONNEMENT AU WINSTUB CLUB :
Sièges centraux en tribune Nord, confortables avec vue panoramique unique
Accès au Winstub Club 2h avant, pendant la mi-temps et 2h après le match
Offre originale alliant libre-service gourmand et bières locales
En supplément : spécialités alsaciennes revisitées, vins et champagnes
Ouverture progressive en fonction de l’avancée des travaux

commercial@rcstrasbourg.eu
« Chaque saison, c’est donc une diminution quasi homéopathique des spectacles proposés qui est mise en œuvre.
Mais nous n’avons jamais eu à subir de coups de massue. »
Olivier Chapelet, directeur du TAPS
n’y a plus d’augmentation depuis quelques saisons. On nous demande clairement d’établir un budget à augmentation zéro. Notre statut de régie directe de la Ville est un statut rare en France. Nos problématiques de budget sont donc à l’égal de celles de la police municipale ou de la voirie, par exemple. Alors, ce manque à gagner puisque l’inflation grignote nos marges de manœuvre en matière de programmation, je le vis comme une forme de solidarité avec les finances de la Ville. Sur nos deux établissements (Laiterie et Scala-Neudorf – ndlr), nous disposons d’un budget de l’ordre de 1,5 M€. Chaque saison, c’est donc une diminution quasi homéopathique des spectacles proposés qui est mise en œuvre. Mais nous n’avons jamais eu à subir de coups de massue. Personnellement, je sais bien que nous sommes aussi au service de l’emploi culturel de la Ville : il s’agit de très nombreux intermittents techniques et de beaucoup de compagnies extérieures ou d’artistes que nous faisons régulièrement travailler. Ce n’est pas mon budget, ce n’est pas mon théâtre, je suis au service d’une cause qui est bien plus grande, la politique publique de la culture à laquelle le TAPS appartient. J’ai toujours été très fier de travailler pour le théâtre public. »
C’est un tout autre son de cloche qui émane de l’Espace K qui, s’il bénéficie d’une subvention de la Ville de Strasbourg, est néanmoins un établissement privé. Son directeur, Jean-Luc Falbriart, se souvient lui aussi de la baisse de la subvention municipale puis de son gel les saisons suivantes. « L’inflation produit immanquablement une baisse de fait de notre budget. Pour nous, la seule possibilité est donc de créer des sources de financement extérieures via des événements qu’on peut organiser dans la deuxième salle. Mais voilà : on nous a signifié que dans le futur, en raison de la délocalisation de La Laiterie pour cause de travaux de la
salle de concert, on ne pourrait plus disposer de notre deuxième salle. Bien sûr, on nous propose un lieu alternatif de transition (la salle des colonnes de la Fabrique de Théâtre voisine – ndlr), mais ce n’est que pour nous maintenir en place dans le quartier ou avoir une visibilité. Ce lieu n’est absolument pas l’outil dont nous avons besoin, on sera plus proche de ce qu’était l’ancien Kafteur, pour ceux qui s’en souviennent. La problématique est donc très simple à résumer : avec une plus petite jauge et des possibilités bien réduites en termes de programmation, l’impact financier sera considérable et l’actuelle subvention ne sera pas suffisante pour couvrir nos frais de fonctionnement. On arrive à un moment critique en ce qui concerne nos deux futures saisons, car nous avons le sentiment que va se jouer une partie pas du tout évidente, soit avec la présente municipalité si elle est reconduite soit avec celle qui lui succédera. Pour l’heure, le projet nous proposera un espace certes pourvu de toutes les nouvelles technologies techniques, mais bien trop petit et moins fonctionnel en termes d’accueil du public et de formats de spectacles tels que ceux que nous programmons depuis longtemps maintenant. Voilà, on va se faire plaisir encore une saison puis après, ce sera le grand saut dans l’inconnu. Nous sommes actuellement en pleine discussion avec la direction de la Culture ; ces gens-là nous connaissent bien, ils voient bien nos difficultés, mais ils ne peuvent que proposer des axes, c’est l’élue qui décide, au final… Mon sentiment est que nous ne sommes pas prioritaires, du moins je le ressens comme ça. Ainsi, la maire, Jeanne Barseghian a paru surprise, lors de la conférence de presse, quand je lui ai fait part des difficultés que nous allions avoir avec la nouvelle salle. Manifestement, ce n’étaient pas les échos qu’elle avait entendus jusque-là… » ☚

1Exemple pour une BMW 116 M Sport Design. 39 loyers linéaires : 390 €/mois. Location Longue Durée sur 39 mois et pour 30000 km incluant l’entretien* et l’extension de garantie. Assurance perte financière à souscrire par l’intermédiaire de BMW Finance ou auprès de l’assureur de votre choix, sous réserve d’en justifier auprès de BMW Finance. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’une BMW 116 M Sport Design dans les concessions participantes avant le 30/09/2025, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’acceptation par BMW Finance, SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, inscrit à l’ORIAS sous le n˚07 008 883. Depuis le 01/09/2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer Offre réservée aux particuliers dans la limite des véhicules en stock.
Modèle présenté : BMW 120 M Sport avec options à 505 €/mois sans apport. LLD 39 mois. 30 000 km.
« La culture reste le deuxième budget le plus important de Strasbourg, après celui de l’éducation. »
Subventions, redistribution, mécénat, mais aussi réussites et faux pas : la politique culturelle strasbourgeoise soulève de nombreuses questions. Nous en avons discuté avec l’adjointe à la culture, qui revient sur ses choix, ses priorités et ses perspectives.
Rédaction : Jean-Luc Fournier
Photographie : Tobias Canales

Les problématiques liées aux subventions, notamment municipales, ont tenu le haut du pavé durant nos conversations avec les différents acteurs culturels, petits ou grands, que nous avons rencontrés. Comment justifiez-vous la politique que vous avez initiée dans ce domaine ?
En 2021, nous avons décidé de réduire de 2,5 % les subventions consacrées aux dix institutions les plus dotées, lesquelles avaient, nous le savions, des finances saines. Nous avons longuement débattu avec elles de ce point. Cela nous a permis de dégager une masse budgétaire qui a immédiatement été injectée dans de nouvelles équipes proposant des projets culturels ainsi que dans des projets amateurs qu’on a donc fortement soutenus ainsi. Au global, l’enveloppe consacrée à la culture est restée la même, elle a simplement été redistribuée autrement. Cette redistribution s’est faite au nom d’une forme de solidarité des plus importantes des institutions en direction des plus modestes. Passée cette redistribution, nous n’avons plus rien touché aux subventions… Bien sûr, dès la saison suivante, nous avons été fortement handicapés par la violente inflation de l’énergie, notamment, ainsi que par l’augmentation du point d’indice des rémunérations des fonctionnaires : par exemple, le budget de la HEAR est constitué en très grande partie par la masse salariale. On a beaucoup travaillé avec les équipes des associations ou institutions culturelles et elles-mêmes se sont interrogées avec efficacité sur leur propre fonctionnement. Pour la plupart, elles ont essayé de trouver des solutions en interne, je leur tire mon chapeau ! Mais je suis bien consciente que le développement du mécénat, par exemple, ne peut être un objectif réaliste pour toutes… En tout cas, nous sommes ouverts à tous les dialogues et toutes les propositions. Je sais pouvoir m’appuyer sur une direction et un
service extrêmement performants, efficaces, réactifs et disponibles, à l’écoute. Je sais que je leur demande beaucoup…
La situation du budget culture est-elle restée la même ?
Elle est toujours de l’ordre de 20 % du budget global de la Ville. La culture reste le deuxième budget le plus important de Strasbourg, après celui de l’éducation. Il y a un classement qui ne trompe pas, c’est celui de la somme consacrée par habitant et par an. Strasbourg consacre 329 € par an et par habitant à la culture. La moyenne nationale des villes comparables, hors Paris, est de 100 €. Ce qui représente un budget d’environ 100 millions d’euros dans le cas de notre ville. Ce chiffre peut bien sûr varier en fonction des investissements, ce sera le cas par exemple quand la rénovation de l’Opéra, que nous avons actée après tant et tant d’années de tergiversation et d’immobilisme, sera dans sa phase opérationnelle.
Il faut aussi parler de ce qui a moins bien fonctionné. « Strasbourg, capitale mondiale du livre », par exemple. Si de très nombreux événements locaux à destination des scolaires ou des jeunes ont été organisés, il ne semble pas que l’image de marque de Strasbourg au niveau national et a fortiori international ait bénéficié de retombées notables… Nous avions pourtant mis en place des partenariats assez solides avec un certain nombre de médias nationaux importants. Mais j’avoue que j’avais espéré une couverture un peu plus importante, ce point fait partie d’une forme de surprise et de déception, en ce qui me concerne. Mais voilà, le label « Capitale mondiale du livre » est très loin des retombées offertes par celui de capitale européenne de la culture qui permet de mettre sur pied des événements de portée internationale. Pour le label
capitale mondiale du livre, l’UNESCO ne verse pas un euro, ses objectifs sont des objectifs de lutte contre l’illettrisme et l’offre de nouveaux accès au livre pour l’ensemble de la population. N’empêche : pour l’UNESCO, ce qui a été mis en place par Strasbourg est devenu une référence. Ce fut peut-être silencieux, sans grand impact médiatique quelquefois, mais c’est considéré comme l’étalon par l’institution organisatrice.
Et puis, il y a aussi ce que d’aucuns considèrent comme un véritable fiasco, les débuts assez calamiteux de la gestion du Cosmos par sa nouvelle équipe mandataire… Au départ, c’était un pari que de confier la gestion du Cosmos à une équipe jeune, dynamique et porteuse d’un projet intéressant. Nous tous, élus, mais aussi citoyens et habitants de la ville de Strasbourg, nous avons besoin que le Cosmos fonctionne bien. C’est notre cinéma municipal et on y tient tous, car c’est comme un vrai bijou. Si les dérapages avaient continué, ce serait devenu un vrai sujet politique, pour le coup. Alors nous avons signifié à l’équipe que les querelles de personnes devaient être mises au fond de la poche, en tout cas être réglées autrement et surtout pas au sein du cinéma. On vient de voter au conseil municipal une augmentation des tarifs et une subvention pouvant permettre de passer le cap de ce démarrage chaotique, mais il faut maintenant s’activer dans le bon sens. En tout cas, nous surveillons désormais tout cela comme le lait sur le feu…
Un dernier mot : vous avez envie de poursuivre votre engagement ?
Oui, dans la mesure où les objectifs initiaux ont quasiment tous été atteints et parce que cette aventure humaine a été assez incroyable, pour moi. Après, tout ne dépendra pas exclusivement de moi, mais oui, j’ai très envie de continuer…
« Strasbourg
consacre 329 € par an et par habitant à la culture. La moyenne nationale des villes comparables, hors Paris, est de 100 €. »
Alors qu’Anne Mistler, adjointe à la Culture, dresse un bilan globalement positif de son mandat malgré un contexte marqué par l’inflation, l’opposition livre une lecture bien différente. Budget, redistribution, Opéra du Rhin, occasions manquées, fermeture des musées... tour d’horizon de leurs critiques et points de tension.
Rédaction : Barbara Romero
Dessin : Yannick Lefrançois

☛ Un budget en trompe-l’œil ?
Les chiffres, on le sait, peuvent donner lieu à de multiples lectures. Si Anne Mistler évoque un budget culture à hauteur de 20 % des dépenses de la ville, Caroline Barrière, conseillère municipale aux côtés de Catherine Trautmann, tend à relativiser : « En 2019, le budget culture représentait 21 % de l’ensemble des dépenses, 19 % en 2020, et 17 % en 2024. Cela est d’autant plus vrai qu’entre 2019 et 2025, on a connu une inflation galopante. En tenant compte de ces éléments, les chiffres ne sont pas les mêmes et il y a même eu une diminution des dépenses. »
Un même son de cloche pour Pierre Jakubowicz, élu et candidat Horizons aux prochaines municipales. « La culture a servi de variable d’ajustement dans ce mandat, estimet-il. Cumulés, ce sont 2,2 M€ qui ont été retirés aux activités culturelles. Anne Mistler parle de redistribution d’une partie des subventions des institutions à d’autres structures culturelles. Peut-être une partie l’a été. Mais on ne retrouve pas ces 2,2 millions. »
Un avis partagé par Virginie Joron, candidate RN à Strasbourg. « On parle tout de même d’une réduction de deux millions d’euros. Pourquoi ? Quelles ont été les coupes ? L’Opéra, le Maillon, l’OPS, sont des projets prioritaires. Ce bilan appelle à un audit pour mieux participer au débat. À quels projets cet argent a-t-il été redistribué et à quelle hauteur ? »
Pour Jean-Philippe Vetter, candidat LR, c’est « un maintien du budget en trompe-l’œil, car les rentrées fiscales et les taxes locales ont augmenté de 23 % en cinq ans dans l’Eurométropole. Les baisses de subventions aux grandes institutions ont affaibli les structures. Or la culture n’est pas une dépense, mais un investissement. On sait que pour 1 € dépensé, ce sont de 4 à 8 € de retombées. Le monde culturel c’est surtout du lien social, de l’émancipation, du rêve. »
Des horaires qui ne passent pas
Voilà un point qui suscite la plus vive incompréhension de l’ensemble de l’opposition. « Notre ville est la seule en France à avoir fermé ses musées non seulement entre midi et deux, mais aussi une journée supplémentaire, dénonce Pierre Jakubowicz. Cela exclut ceux qui travaillent, ceux qui profitent de leur pause méridienne pour visiter une expo... »
Une décision qui n’est pas non plus sans conséquence pour Caroline Barrière : « Ils n’ont
pas réfléchi à ce que cela pouvait induire : l’Art café, la librairie et la salle de conférence du Musée d’art moderne et contemporain (MAMCS) vont moins bien... La population locale vient surtout pour les expositions temporaires. »
Pour Virginie Joron, cette décision reste indigne d’une capitale européenne. « Les musées font partie intégrante du rayonnement culturel de Strasbourg, décider de les fermer n’a pas de sens, c’est se couper l’herbe sous le pied. »
Jean-Philippe Vetter considère qu’il s’agit là de la « décision la plus marquante, justifiée comment ? Par des mesures de sobriété énergétique. Là encore, on met de l’idéologie et du dogmatisme dans la gestion de la politique culturelle strasbourgeoise. »
Des regrets...
Tout d’abord Capitale mondiale du livre, un échec malheureux pour l’opposition. « C’est triste, commente Caroline Barrière. Nous avons la ressource et elle n’a pas été mobilisée. Les retombées sont quasi nulles. » Pour Pierre Jakubowicz, « 95 % des Strasbourgeois sont passés à côté ! On n’enregistre aucun impact sur le renforcement de l’écosystème local, la lecture, et l’économie du livre. » Virginie Joron considère cet événement éphémère « comme trop cher pour un impact restreint. »
Jean-Philippe Vetter et Pierre Jakubowicz déplorent également trois occasions manquées. La première, la Fondation Gandur qui s’est finalement installée à Caen. « C’était un investissement de 60 millions d’euros, et la maire n’a même pas rencontré Jean-Claude Gandur, car il a fait fortune dans le pétrole. J’estime pour ma part que ce qui sert le rayonnement de Strasbourg, sert Strasbourg », commente Jean-Philippe Vetter. Les deux élus d’opposition dénoncent également le refus d’une subvention de 50 000 € pour soutenir l’Industrie Magnifique. Ou encore le retrait du leg de 5 M€ de Marie-Claire Ballabio, suite à la réduction des horaires d’ouverture des musées.
Des travaux « effet d’annonce » ?
Le serpent de mer qui continue de susciter beaucoup d’émotions... « J’entends qu’elle met en avant dans son bilan les travaux de l’Opéra... Ok, mais c’est en 2028 ! ironise Caroline Barrière. C’est bien d’avoir préparé les choses, mais cela n’a pas d’impact sur leur budget... » D’autant qu’elle émet des doutes sur le projet présenté : « Réduire la jauge en-dessous
Pierre Jakubowicz, Horizons
« La culture a servi de variable d’ajustement dans ce mandat. »
« Nous considérons que la culture n’a pas été le sujet de cette municipalité. On a été sur une politique de budget culturel plus que sur une politique culturelle qui utilise un budget. »
de 1000 places revient à ne plus être considéré comme un grand Opéra. Je reste aussi sceptique sur le tunnel souterrain sous le tram, entre son coût et les risques avec la nappe phréatique. Il y avait peut-être plus simple à proposer. » Pour Pierre Jakubowicz : « La maire s’était engagée à trouver une solution durant son mandat et ce n’est qu’à la fin qu’elle fait une grande annonce, non financée. Nous aurons de jolies images de synthèse en juin 2026, mais aucune décision n’est prise. »
Les baisses de subventions ont par ailleurs eu pour conséquences moins de spectacles, « environ 16 levées de rideaux en moins pour l’Opéra », estime-t-il. Ce qui ne va pas non plus dans le sens de ce qu’attend la députée européenne du Rassemblement national Virginie Joron : « Il est important de préserver le siège du Parlement européen à Strasbourg, et de faire en sorte que tout soit ouvert pour les Parlementaires, les délégations, les personnalités qui viennent lors des sessions, qu’ils puissent faire autre chose que de visiter la Petite France. L’Opéra est essentiel pour l’attractivité de la ville. »
Jean-Philippe Vetter a toujours fait savoir qu’il était contre la démolition de la salle qu’il considère comme un joyau patrimonial du XIXe siècle. « Il manque des garde-fous sur sa proposition. Par ailleurs, on sent une décision politique, voire électorale, lancée en fin de mandat. Personne ne peut aujourd’hui dire que cette enveloppe de 120 M€ sera respectée, quand de l’autre côté on est incapable de financer l’ouverture des musées six jours sur sept ! »
Leurs conclusions...
Pierre Jakubowicz : « Sur ce mandat, même la culture aura reculé comme rarement, estime-t-il. Je veux sanctuariser le budget
culture, revenir à l’ouverture antérieure des musées dans une bonne gestion des ressources humaines et du budget. Je veux remettre la culture populaire au centre, avec le retour de la Foire Saint-Jean, d’un vrai spectacle place de la Cathédrale, d’un grand carnaval rhénan. En temps de crise, il vaut mieux financer des projets artistiques pérennes et penser Strasbourg en grand. Sans oublier de renforcer le soutien au tissu associatif. On y arrivera en mettant fin aux dépenses éphémères et gadget de l’exécutif et à la mauvaise gestion des chantiers. »
Caroline Barrière : « Nous ne dévoilerons nos propositions qu’à l’automne. En revanche, avec Catherine Trautmann, nous considérons que la culture n’a pas été le sujet de cette municipalité. On a été sur une politique de budget culturel plus que sur une politique culturelle qui utilise un budget. »
Virginie Joron : « Il est essentiel de revaloriser le patrimoine alsacien, à travers le livre, la gastronomie, la langue, lors de toutes les manifestations comme le marché de Noël. Il faut par ailleurs œuvrer pour le rayonnement international de Strasbourg. Un des éléments choquants de ce mandat a aussi été d’éteindre la cathédrale. Il faut vraiment réaliser un audit pour définir ce qui était utile ou non dans les coupes budgétaires, voir quelles associations ont bénéficié de subventions, et reprioriser les projets. »
Jean-Philippe Vetter : « En cinq ans, c’est l’encéphalogramme plat, malgré des moyens conséquents. Il suffit de regarder le spectacle d’été... Comment accepter que Colmar ait un festival international et que Strasbourg en soit incapable ? Cette ville meurt par manque de démocratie locale. Je souhaite réunir les acteurs culturels et les artistes pour définir les priorités. » ☚
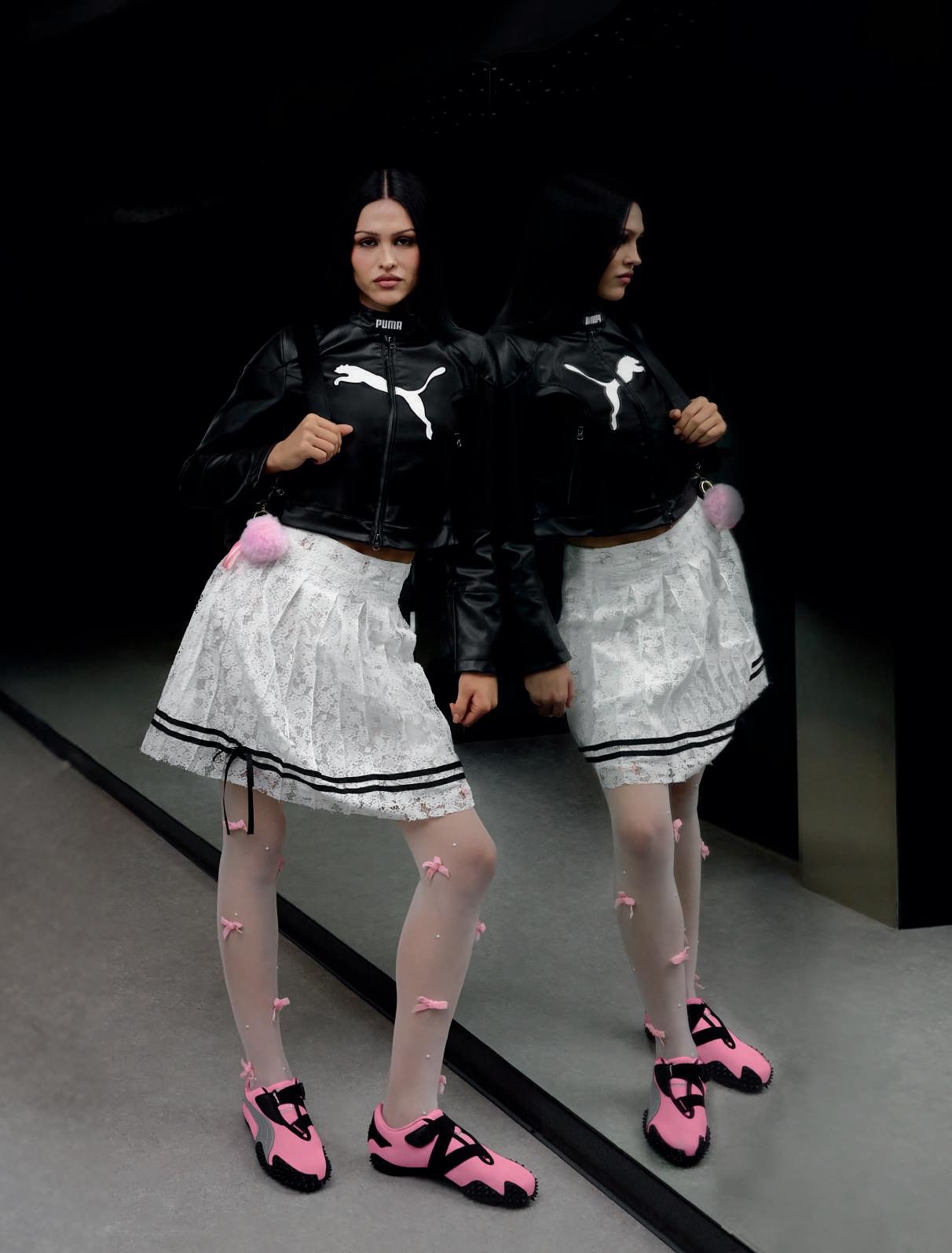
Depuis des décennies, la culture a toujours bénéficié d’importants moyens budgétaires publics à Strasbourg. Aujourd’hui encore, ce secteur représente le deuxième budget de la Ville. Voici quelques indicateurs notables...
Source : Ville de Strasbourg (Direction de la culture)
Datavisualisation : Cercle Studio
347,9€ /an /habitant
En 2025, le budget de la culture est le second budget de la Ville de Strasbourg qui est la ville de plus de 150 000 habitants qui investit le plus en termes culturels. structures subventionnées ou bénéficiant d’une contribution.
101,5 M€
826
C’est le nombre d’agents permanents de la Ville de Strasbourg dédiés à la culture.
C’est le budget global de la Direction de la Culture : en cumulant le fonctionnement, dont les subventions, l’investissement ainsi que la masse salariale.
152
60
12
écoles de musiques. structures de pratiques artistiques en amateur.
600 €
C’est le montant de la subvention la moins importante. Elle correspond à une des très nombreuses aides à projet.
9,7 M€
C’est le montant de la subvention la plus importante. Le bénéficiaire en est l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS).
C’est le nombre de musées régis par le Ville de Strasbourg, dont le musée zoologique qui rouvre ses portes lors de ce mois de septembre.
9
C'est le nombre de médiathèques gérés par la Ville de Strasbourg (dont 1 bibliobus).
S’y rajoutent une 10e qui ouvrira dans l’année à venir au Port du Rhin et bien sûr, la Médiathèque Malraux située en centre-ville mais gérée par l’Eurométropole de Strasbourg.
musée historique musée zoologique
musée de l’Œuvre Notre-Dame
musée alsacien
Aubette 1928
cabinet des estampes et des dessins musée d’art moderne et contemporain musée Tomi Ungerer
musée archéologique, musée des Beaux-Arts, musée des Arts décoratifs




1 Les coulisses du Maillon
2 Les coulisses de l’Opéra national du Rhin
3 Les coulisses de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg
4 Les coulisses de la paroisse protestante Saint-Guillaume
5 Les coulisses du Théatre national de Strasbourg
6 Les coulisses du Zénith de Strasbourg






































Avez-vous parfois la sensation que votre manière de vivre, de travailler, de consommer, n’est plus tout à fait alignée avec ce que vous croyez juste, ou bon, ou vrai ? Dans un monde qui va toujours plus vite, hyperconnecté, mais souvent déconnecté de l’essentiel, les Peuples Racines, qui tiennent Forum du 19 au 21 septembre à Strasbourg et à Oberhausbergen, nous rappellent, qu’il est encore possible de vivre autrement.

RÉAPPRENDRE À ÊTRE AU MONDE
Et si la modernité, dans sa frénésie de vitesse et de conquête, avait oublié de poser une question essentielle : comment voulons-nous habiter le monde ?
Rédaction : Hélène Edel
Photographie : Sabine Strensz
Des chasseurs-cueilleurs de la communauté San en Afrique australe transportant des bottes de végétaux secs, illustrant leur savoir-faire traditionnel et leur lien étroit avec leur environnement naturel.

Les Peuples Racines, qu’on appelle aussi autochtones, indigènes, premiers ou de Premières nations, eux, n’ont jamais cessé de se la poser. Non pas à travers des théories ou des grands discours, mais dans chaque geste du quotidien, chaque chant transmis, chaque rituel offert à la Terre. Leur philosophie n’est pas un concept figé : c’est une manière de vivre et d’être au monde.
De prime abord, leur mode de vie peut nous sembler désuet. Parce que nous avons grandi dans une culture de la rupture avec le vivant, où l’humain se pense supérieur à tout ce qui l’entoure. Cette vision structure nos institutions et nos économies. Dans ce cadre, considérer qu’une rivière est un être vivant, ou qu’un arbre peut être un ancêtre peut sembler incongru. S’y ajoute un héritage de mépris, hérité du colonialisme et d’un certain universalisme occidental. Longtemps qualifiés de primitifs ou d’arriérés, les Peuples Racines ont vu leur savoir folklorisé et détruit. Ce regard persiste, parfois à notre insu.
Mais sans tout quitter, sans renier la réalité de nos quotidiens ni nos besoins contemporains, il pourrait être salutaire de nous inspirer de leur regard sur le monde, en commençant par reconnaître que nos existences, aussi stables et confortables soient-elles, reposent souvent sur des logiques extractivistes et destructrices.
Les Peuples Racines perçoivent le monde comme un ensemble vivant, sensible et habité : arbres, pierres, vents, ancêtres… tout a une voix. La Terre n’est pas muette. Elle écoute et répond. Ils ne vivent pas dans la nature, ils sont la nature. Chez les Aborigènes d’Australie, chaque colline, chaque animal, chaque étoile est l’écho d’un rêve ancien. Les Mapuches parlent aux rivières. Les Maasaïs dansent pour la pluie. Leur rapport au vivant imprègne tout : les pratiques agricoles, les rituels de guérison,
les décisions collectives. On y prend le temps d’écouter vraiment, non seulement les mots, mais ce qu’ils portent de silences, de mémoire et d’invisible.
Dans ces sociétés, la richesse ne se mesure pas à l’avoir, mais à la qualité du lien.
À l’Occident, qui se demande souvent comment produire plus ou aller plus vite, ils opposent une autre boussole : comment vivre en paix avec soi, les autres et la Terre ? Comment maintenir l’harmonie plutôt que la performance ? Comment entendre ce qui ne fait pas de bruit ? Pendant ce temps, nous remplissons nos agendas. Nous scrollons des heures. Nous multiplions les urgences. Et dans ce trop-plein, parfois, une sensation sourde : celle d’avoir perdu l’essentiel. Nous avons appris à tout maîtriser, à tout comprendre, mais nous avons oublié comment ressentir.
Or, nous pouvons décider de faire des choix plus éthiques, plus justes, plus équitables. Nous pouvons décider de ralentir. De nous reconnecter. De retrouver de la joie dans ce qui, pour les Peuples Racines, a toujours été sacré : marcher, écouter, observer, cuisiner, veiller autour d’un feu, célébrer la pluie, dire merci. Leur sagesse ne nous dit pas de fuir le monde, mais de réapprendre à l’habiter. De le sentir. De le respecter. De ne plus vivre à côté de la Terre, mais avec elle et en elle.
Ce que nous appelons aujourd’hui décroissance, résilience ou transition écologique, eux l’appellent simplement vie. Et si nous trouvions, dans leurs gestes millénaires, des semences pour notre propre humanité fatiguée ? Et si, au milieu du vacarme du monde, leur voix posée nous rappelait ce que nous avons toujours su et oublié : que nous appartenons à quelque chose de plus vaste que nous.
« Comment
vivre en paix avec soi, les autres et la Terre ? Comment maintenir l’harmonie plutôt que la performance ? »
Né d’une intuition forte de Philippe Studer, le Forum des Peuples Racines s’est imposé en quelques années comme un lieu rare, presque unique, de dialogue entre les civilisations dites premières et notre modernité en quête de sens. La prochaine édition, qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2025 à Strasbourg, réunira une quinzaine de représentants de Peuples Racines venus de trois continents.
Rédaction : Hélène Edel
Photographie : Ligne Verte Terre de Paix

☛ Chaque édition de ce forum explore un fil conducteur. En 2025, le thème proposé est à la fois surprenant et essentiel : être en joie. Un choix audacieux, presque subversif dans un monde saturé d’alertes et de tragédies. Mais les Peuples Racines nous rappellent que la joie n’est pas l’oubli des douleurs du monde : c’est une posture vivante, un acte de résistance. Chez de nombreux peuples autochtones, la joie n’est pas un état individuel ou passager. Elle naît du lien restauré, du sentiment d’appartenance, de la gratitude pour ce qui est donné chaque jour. Danser, chanter, partager un repas, marcher pieds nus sur la terre humide : autant de gestes simples qui réaffirment que la vie, malgré ses fractures, mérite d’être célébrée. À travers des cercles de parole, des conférences,
des rituels et des ateliers partagés (danse, chant, etc.), le Forum cherchera à nous reconnecter à cette joie profonde. Non pas pour fuir la gravité du monde, mais pour enraciner nos engagements dans un terreau vivant.
L’événement est porté par l’association Ligne Verte Terre de Paix, fondée à Strasbourg. Engagée dans la préservation du vivant, dans le dialogue interculturel et dans le tissage de liens entre acteurs du changement, Ligne Verte œuvre pour que ces voix anciennes ne soient pas réduites au folklore, mais reconnues comme sources de sagesse pour un avenir à construire ensemble. Car dans une époque marquée par la sidération, peut-être avons-nous plus que jamais besoin de cette vérité simple : la joie est aussi un chemin de guérison. ☚
Philippe Studer, l’homme aux deux mondes

Aventurier dans l’âme, Philippe Studer a le goût de l’ailleurs. Enfant, il dévorait les récits d’explorateurs. Plus tard, c’est sac au dos et carte Interrail en poche qu’il traverse l’Europe. Mais c’est en Inde, il y a quarante ans, que se produit une bascule. Il part à la rencontre des Bishnoïs, un peuple qui vit en symbiose avec les animaux sauvages. Là-bas, il découvre une autre manière d’être au monde : « Les animaux venaient manger dans nos mains, les gens nous ont accueillis avec une douceur incroyable. Ce voyage m’a marqué à vie. »
Aujourd’hui, Philippe Studer accompagne la transformation managériale des entreprises, tout en restant habité par cette quête de lien profond. Il est membre fondateur de l’association Ligne Verte Terre de Paix, qui soutient les Peuples Racines dans la préservation de leurs territoires, de leurs rituels et de leurs savoirs. Ce pont entre deux mondes, il le traverse sans cesse. « Quand je suis avec eux, je me transforme. Je redeviens le jaguar que je suis au fond de moi. Je me sens pleinement vivant. »
À travers le Forum des Peuples Racines, qu’il a initié, Philippe assume une mission qu’il juge vitale : faire entendre ces voix longtemps marginalisées, qui portent pourtant une sagesse essentielle pour l’avenir.

Aujourd’hui réunis, wienerberger et Terreal en France conjuguent expertise, expérience et innovation pour vous offrir le meilleur de l’enveloppe du bâtiment. Notre capacité industrielle alliant savoir-faire ancestral et avancée technique nous permet de vous proposer des solutions adaptées à l’ensemble des besoins du marché.
Forts de ce rapprochement et animés par la passion et la créativité, nous proposons des solutions innovantes et durables au travers de nos quatre activités : toiture, solaire, structure, façade et décoration

wienerberger.fr
terreal.com


Lesabotsy Razafindravelo est l’un des gardiens de la réserve de Vohimana, sanctuaire forestier situé à l’est de Madagascar.
Dans la réserve de Vohimana, à l’est de Madagascar, la forêt est un sanctuaire. Et Lesabotsy Razafindravelo en est l’un des gardiens. Tradipraticien, distillateur et passeur de savoirs, il est l’un des représentants du peuple Betsimisaraka invités à la 4e édition du Forum des Peuples Racines.
Rédaction : Hélène Edel
Photographie : Day Nabih
Pour lui, la Terre n’est pas une ressource, c’est une mère. Et la préserver est un devoir sacré. À travers son engagement pour une préservation active de l’environnement, il incarne une manière d’habiter le monde, profondément enracinée et résolument tournée vers l’avenir.
Comment voyez-vous le rapport entre les humains et la Terre ?
Les humains et la Terre sont toujours étroitement liés. Nos modes de vie dépendent de ce qu’elle nous donne : la nourriture, les plantes, les lieux de vie. C’est un lien naturel, vital, que nous devons entretenir avec respect.
Quel est, selon vous, le rôle de l’être humain ? Il doit préserver et protéger la Terre ainsi que l’ensemble de ses richesses, qu’il s’agisse des ressources naturelles ou de la biodiversité. Il doit également savoir utiliser ce qu’elle nous offre, notamment les plantes, pour se soigner ou se nourrir, sans jamais épuiser ce qui nous est confié.
Comment votre peuple prend-il soin du vivant ?
Chez les Betsimisaraka, on vit avec la forêt, pas contre elle. On utilise les plantes médicinales comme nos ancêtres, à travers les raokandro . Ce sont des remèdes traditionnels, transmis de génération en génération. On ne prend jamais plus que ce dont on a besoin. Et on prend toujours le soin de remercier la nature.
Avez-vous peur que les savoirs de votre peuple disparaissent ?
Oui, j’ai peur qu’ils disparaissent, car aujourd’hui, les gens sont de plus en plus distraits par les réseaux sociaux et les nouvelles
technologies. Peu de jeunes s’intéressent encore à leurs coutumes et aux savoirs transmis par nos ancêtres.
Quel regard portez-vous sur le mode de vie occidental ?
Le monde occidental contribue largement à la pollution, en grande partie à cause de ses grandes industries. Son mode de vie me semble moins respectueux que le nôtre, car il repose sur une utilisation excessive de produits chimiques nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement. De plus, beaucoup d’Occidentaux ont tendance à dévaloriser notre mode de vie et nos cultures ancestrales.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que nous comprenions ou changions ?
Il faut que vous compreniez que chaque peuple et chaque nation a ses spécificités, ses potentialités et ses richesses. Vous devez changer de comportement, repenser votre manière de vivre, et surtout réduire la consommation de produits chimiques. Il est essentiel de trouver d’autres solutions, plus innovantes, pour préserver la nature et la santé humaine.
Pourquoi pensez-vous que votre message résonne ici, en France ?
Parce que les Occidentaux savent qu’ils sont allés trop loin. Je pense qu’ils sont conscients de la nécessité de changer. Je les sens à l’écoute.
Qu’aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations ?
Le respect. De soi, des autres, de la nature. Et l’amour. Sans respect et sans amour, il n’y a pas de paix possible. Il faut se soutenir, créer une vraie fraternité. ☚
« Ceux qui restent solidaires »
Sur la côte orientale de Madagascar, là où la forêt rejoint l’océan, vivent les Betsimisaraka, « ceux qui restent solidaires ». Leur nom témoigne de leur histoire de résistance face aux invasions. Longtemps, ce peuple a vécu tourné vers la mer, entre pêche et navigation, maîtrisant les courants et les vents, bâtissant des pirogues capables d’affronter les tempêtes. Lorsque les vagues de l’Histoire, et particulièrement de la colonisation, les ont poussés vers la terre, ils se sont ancrés dans l’agriculture, sans jamais rompre avec l’esprit du vivant. Chez les Betsimisaraka, chaque geste porte la mémoire des ancêtres. La forêt est une alliée et les plantes permettent de soigner les corps et les âmes. Leurs croyances animistes tissent un lien profond entre les vivants, les disparus et les forces invisibles qui régissent le monde.
Aujourd’hui, malgré la pression des temps modernes, ce Peuple Racine continue de transmettre son art de vivre : par la parole, la musique, les rituels, le soin, le tressage patient des fibres végétales et des liens humains. À travers des figures comme Lesabotsy Razafindravelo, qui fait vivre cette sagesse au cœur même de la réserve de Vohimana, les Betsimisaraka nous rappellent qu’une autre manière d’habiter le monde est non seulement possible, mais déjà là, à portée d’écoute.
« Je crois qu’on peut conquérir du sens. C’est une forme de croissance en soi. »
Les Peuples Racines n’apportent pas seulement un regard sur la nature ou la spiritualité : ils portent une vision du monde où l’acte de produire, de travailler, de créer, est profondément relié à l’équilibre global. Trois femmes cheffes d’entreprise se sont engagées dans cette voie et nous partagent leurs convictions.
Rédaction : Hélène Edel
Photographie : Alban Hefti

☛ Depuis quelques années, l’association
Amandine Aubert, Fanny Carbillet, Anne Leitzgen et Philippe Studer
Ligne Verte Terre de Paix a engagé un nouveau chantier, audacieux et encore largement inexploré : faire entrer cette sagesse millénaire dans les entreprises. Non pas sous forme de folklore ou d’outils exotiques, mais comme une invitation à repenser en profondeur nos manières de gouverner, d’innover, de collaborer. C’est dans ce contexte qu’est née une rencontre inattendue et lumineuse : celle de trois dirigeantes, Anne Leitzgen (présidente CEO Schmidt Groupe), Fanny Carbillet (cofondatrice & présidente Alara Group) et Amandine Aubert (cofondatrice EcoGreenEnergy), avec les enseignements des Peuples Racines. Par cette rencontre, quelque chose a basculé en elles. ↗
Il y a des mots qu’on ne s’attend pas à entendre entre les murs d’une entreprise. Des mots comme intuition, émotion, régénération. Des mots qu’on croyait réservés aux ouvrages de développement personnel. Et pourtant. Ces mots, aujourd’hui, traversent les couloirs du management. Mieux : ils y dessinent un futur. Mais ce futur émerge aussi sur les ruines d’un modèle à bout de souffle. Aujourd’hui, un salarié sur deux se dit en perte de sens dans son travail. Le burn-out , longtemps ignoré, devient systémique. Le lien de subordination, fondement juridique du contrat de travail, résonne comme une dissonance dans une époque qui réclame de l’autonomie, du soin et de la relation.
Les plus jeunes générations, elles, ne veulent plus sacrifier leur vie pour une fiche de poste. Le télétravail, les aspirations postCovid, les reconversions massives ne sont pas des accidents de parcours. Ils sont les symptômes d’une société en mutation, d’un monde du travail en perte de cohérence. Les espaces cloisonnés (travail d’un côté, vie privée de l’autre) ne tiennent plus. Les jeunes ne veulent plus seulement faire carrière, ils veulent aussi faire sens, se sentir alignés à leurs valeurs.
C’est dans ce contexte que la rencontre avec les Peuples Racines agit comme un miroir, parfois brutal, souvent libérateur. Chez eux, pas de séparation. Le travail, la vie, la relation à la terre, à l’invisible, au groupe : tout est lié. On construit un abri, on élève un enfant, on prépare un repas ou on tisse une corde avec la même conscience. Il n’y a pas de rôle à jouer, pas de costume à enfiler.
Ce que ces femmes ont voulu ramener dans leur entreprise, c’est cette cohérence radicale : entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’individuel et le collectif, entre le corps et l’esprit. Rien, a priori, ne destinait ces trois dirigeantes à se retrouver autour des sagesses autochtones. Et pourtant. Elles ont toutes ressenti à un moment un décalage profond entre ce qu’elles faisaient et ce qu’elles étaient. Une sorte de fracture intérieure, silencieuse, mais insistante. Le sentiment que quelque chose ne tournait plus rond. Que leur manière de faire, d’agir, de produire, ne suffisait plus. Que courir après des indicateurs était vain.
Amandine Aubert, cofondatrice d’EcoGreenEnergy, le dit sans détour : « J’ai été formatée à créer toujours plus de valeur, j’en voulais toujours plus. Quel sens est-ce que ça avait ? Amasser, amasser, alors qu’on avait bien assez pour payer nos charges et provisionner une sécurité. J’ai eu une crise de sens. » Ce qu’elle a découvert en écoutant les Peuples Racines,
c’est la possibilité d’un autre cap : faire de l’entreprise un espace régénératif. Un lieu qui ne se contente pas de limiter les dégâts, mais qui prend soin. Qui nourrit. Qui restaure. Qui relie. Anne Leitzgen, présidente et CEO du Groupe Schmidt, parle de joie contagieuse lors de sa rencontre avec les Peuples Racines. Une joie simple, naturelle, sans enjeu. Celle qui se dit « limite militante écolo » a voulu aller plus loin : et si on pouvait mettre du sourire dans l’entreprise ?
« Je me souviens avoir pensé que choisir d’avoir un regard positif sur les choses ne devait pas être si compliqué ». Depuis, les réunions commencent par des bonnes nouvelles. Les projets sont évalués non seulement sur leur performance, mais sur leur capacité à avoir un impact positif sur les humains et sur la Terre. « On parle beaucoup de conquête dans l’entreprise, dit-elle. Moi, je crois qu’on peut conquérir du sens. C’est une forme de croissance en soi. » Ce concept de joie dans l’entreprise, Amandine Aubert a aussi voulu l’implémenter chez EcoGreenEnergy. Mais la transformation ne va pas sans heurts. Elle le reconnaît : certains ateliers sur la joie ont été mal vécus. Certains y ont vu une injonction de plus. Une violence même. « On ne peut pas imposer la joie, mais on peut créer les conditions pour qu’elle réapparaisse. La proposer comme un droit, pas comme une norme. » Et cela suppose de déconstruire beaucoup de conditionnements. Celui qui fait du travail un lieu de subordination. Celui qui oppose l’efficacité à l’émotion. Celui qui sépare la tête du corps.
Fanny Carbillet, elle, parle d’expérimentation vivante. Au sein d’Alara Group, elle laisse les collaborateurs tester, ressentir, se tromper. Elle encourage l’intuition, cette intelligence autre, longtemps reléguée aux marges. « Chez les Peuples Racines, l’intuition est valorisée. En Occident, c’est un truc de bonne femme, on la moque, on la soupçonne d’irrationalité.
« On
ne peut pas imposer la joie, mais on peut créer les conditions pour qu’elle réapparaisse. »

↑ Amandine Aubert, cofondatrice d’EcoGreenEnergy

↑ Anne Leitzgen, présidente et CEO du

↑ Fanny Carbillet, cofondatrice et présidente d’Alara Group
« Ce que je cherche, c’est que l’entreprise soit un lieu où l’on puisse se sentir bien. Même si dehors tout va mal. »
Mais c’est une boussole puissante. Le corps ne ment pas. » Dans ses bureaux, un simple smiley triste sur une porte suffit à dire qu’on a besoin d’espace. Et cela change tout. Car cela crée un espace d’écoute, de non-jugement, de présence réelle.
Toutes trois racontent un retour au corps, à l’intime, au sensible. « Ce que je cherche, dit Fanny Carbillet, c’est que l’entreprise soit un lieu où l’on puisse se sentir bien. Même si dehors tout va mal. Un microcosme de soin, de solidité. Une famille professionnelle. »
Est-ce un hasard si ce sont trois femmes qui ont accepté de nous parler de leur engagement ? Sans doute pas. Si elles se sont retrouvées dans les enseignements des Peuples Racines et se sont engagées dans le changement, c’est parce que ces femmes ont fait le choix de remettre en question leur manière de diriger, de réviser leur posture. Une qualité somme toute très « féminine » dans nos sociétés où le masculin n’est pas éduqué à douter.
« Les femmes mettent moins de barrières entre le personnel et le professionnel, témoigne Fanny Carbillet. Elles ont cette capacité à relier les sphères, à décloisonner, à ressentir, qui, aujourd’hui, est un levier de transformation. » Chez les Peuples Racines aussi, cette fluidité est la norme. On ne passe pas d’un espace à l’autre, on est simplement là, pleinement. Dans l’acte, dans le lien, dans le moment. Ce que ces femmes ont retenu des Peuples Racines, ce ne sont pas des méthodes. Ce sont des manières d’habiter le temps, les autres et soi-même. Elles parlent d’un monde où l’on ne réussit pas contre les autres, mais avec eux. Un monde où l’on ne cherche pas à maximiser, mais à équilibrer. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? À qui cela sert-il ? Que cela nous coûte-t-il ? Quel monde cela produit-il ? Est-ce que j’agis au service du vivant ?
Et dans ce monde-là, l’entreprise devient un terreau fertile, un lieu de transformation. ☚


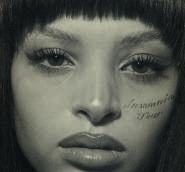

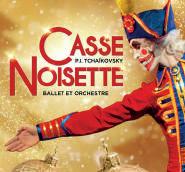
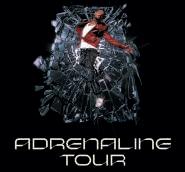

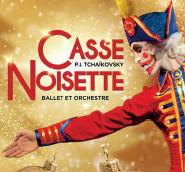



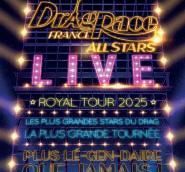

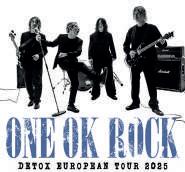
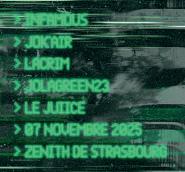

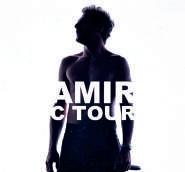
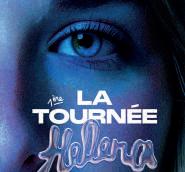

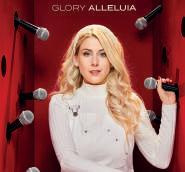


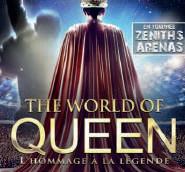






Manœuvrant dans les vents contraires, Isabelle Burget, directrice générale de Batorama, fait voguer l’entreprise et ses équipes vers l’innovation.
Rédaction : Marine Dumény
Photographie : Abdesslam Mirdass
Fiche technique
Filiale en SAS du Port Autonome de Strasbourg
CA 2024 : 10 millions d’euros
Effectif permanent : 49 salariés permanents
Effectif saisonnier : 30 saisonniers supplémentaires
Passagers annuels : 750 000 en moyenne
Formée au management à l’anglo-saxonne, Isabelle Burget est convaincue que la qualité de service dépend de la qualité de vie au travail de ses équipes.

La proue bien campée dans la modernité. Depuis le 2 avril 2025, la flotte de Batorama s’est enrichie d’un nouveau vaisseau amiral : le Strasbourg, bateau électrique dernière génération, s’inscrivant dans une ambition aussi technologique qu’écologique. Doté d’un écran multimédia embarqué, d’un système de traduction simultanée en 12 langues, d’un canal audio spécifique pour les enfants, d’une iconographie ludique pour accompagner les commentaires, et d’une vue directe sur la timonerie pour voir le capitaine opérer, il entend transformer le parcours patrimonial en une expérience immersive. Et ce n’est pas tout : un algorithme intelligent – qui devrait être prêt pour septembre – permettra, au moment de la réservation, de placer les groupes ensemble et d’optimiser l’accueil des familles avec poussettes ou enfants de moins de quatre ans. Trois places Personnes à mobilité réduite (PMR) sont également prévues à bord, tandis que l’accessibilité des pontons, en réfection début 2026, sera retravaillée. Une trajectoire qui traduit bien la volonté de Batorama d’embarquer tout le monde, au propre comme au figuré.
Le vent tourne. Mais avant de voguer avec autant d’assurance, il a fallu encaisser les vagues. L’été 2024, sur fond de Jeux olympiques, aura été l’un des plus éprouvants pour l’équipe. « La réduction drastique de la voilure économique et budgétaire a été une vraie déception », rappelle Isabelle Burget, directrice générale

↑
Bateaux et pontons : véritable vitrine sur l’eau de Strasbourg, les bateaux de tourisme sont en général réservés en dernière minute depuis la borne aux pontons, la boutique, ou la veille au soir sur le site internet.
« UNE TRAJECTOIRE QUI TRADUIT BIEN LA VOLONTÉ DE BATORAMA D’EMBARQUER TOUT LE MONDE, AU PROPRE COMME AU FIGURÉ. »


Côté coulisses : un management en navigation fine Depuis trois ans, Batorama sonde chaque année le climat interne avec un questionnaire anonyme, renforcé par des entretiens qualitatifs menés par un cabinet externe auprès d’un tiers des équipes tirées au sort. Ces retours ont permis la création d’une nouvelle salle de pause, la mise en place d’une hotline RH, ou encore l’instauration de réunions de fin de saison où chaque salarié peut exprimer ses observations. L’approche managériale s’est aussi dotée d’un outil de formation autour de la diversité et de la coopération, développé en lien avec Les Entreprises pour la Cité. Une veille active sur le bien-être au travail, rare dans un secteur soumis à de fortes amplitudes horaires. m.d.
Croisières à thème : pensées pour les Strasbourgeois
Tout au long de l’année, Batorama innove avec des croisières pensées pour séduire les Strasbourgeois autant que les visiteurs. Croisières cabaret avec La Cage aux Piafs, croisières Kids dès 4 ans, spectacles humoristiques avec des collectifs locaux comme les Jeannines, dégustations œnologiques ou brassicoles en partenariat avec des producteurs alsaciens, croisière céramique avec le Café des Bouleaux... La programmation se renouvelle chaque saison, assumant une approche culturelle et participative. S’y ajoutent des locations de bateaux électriques pour 11 personnes maximum, avec paniers gourmands à réserver, ou encore la privatisation mensuelle du Ledoux pour les événements plus intimistes. m.d.
Garage à bateaux et docks. Les vérifications de sécurité sont faites avant chaque départ sur les bateaux de la flotte, dont deux sont à batterie : au plomb pour Le Gustave Doré et au lithium pour Le Strasbourg.
de Batorama. Certains capitaines étaient prêts à lever l’ancre, les bateaux affectés, les plannings calés. Finalement, ils ont pu se rendre à Paris, mais sans pouvoir naviguer. Une frustration vive, suivie quelques mois plus tard par un épisode encore plus marquant : le 3 mai dernier, un départ de feu s’est déclaré sur le moteur du Gustave Doré, en pleine rotation au cœur de la Petite France « Une cinquantaine de passagers évacués, une grosse mobilisation des équipes, une réaction exemplaire de sang-froid », résume la directrice. « Cet événement a entraîné un renforcement immédiat des protocoles de vérification et des contrôles sécurité, déjà très solides. »
Résilience et amélioration continue
Face aux coups du sort, l’entreprise n’a pas pris l’eau. Au contraire. Isabelle Burget évoque une « philosophie du détail et du dépassement constant », portée par un collectif engagé. « Nous veillons à travailler avec rigueur, mais aussi avec plaisir. » Batorama mise désormais sur une approche fine du parcours client, une personnalisation accrue de l’accueil et une attention plus grande portée au confort. Un nouveau souffle, sans renier l’essentiel : « L’émotion de Strasbourg vue de l’eau », conclut la directrice. Par tous les temps. Ce cap est aussi technique. Alors que la flotte compte déjà un bateau hybride (l’Europa), Batorama trace une trajectoire maîtrisée vers une mobilité encore plus douce. Deux nouvelles unités à propulsion électrique sont attendues pour 2026. Quant au « Plan Caravelle » porté depuis 2018, l’entreprise a préféré ne pas précipiter son engagement. « Nous avons besoin d’une visibilité claire sur les choix technologiques, les impacts d’infrastructure, et surtout sur la fiabilité à long terme », justifie Isabelle Burget. Quitte à patienter un peu, pour mieux tenir la ligne. ←
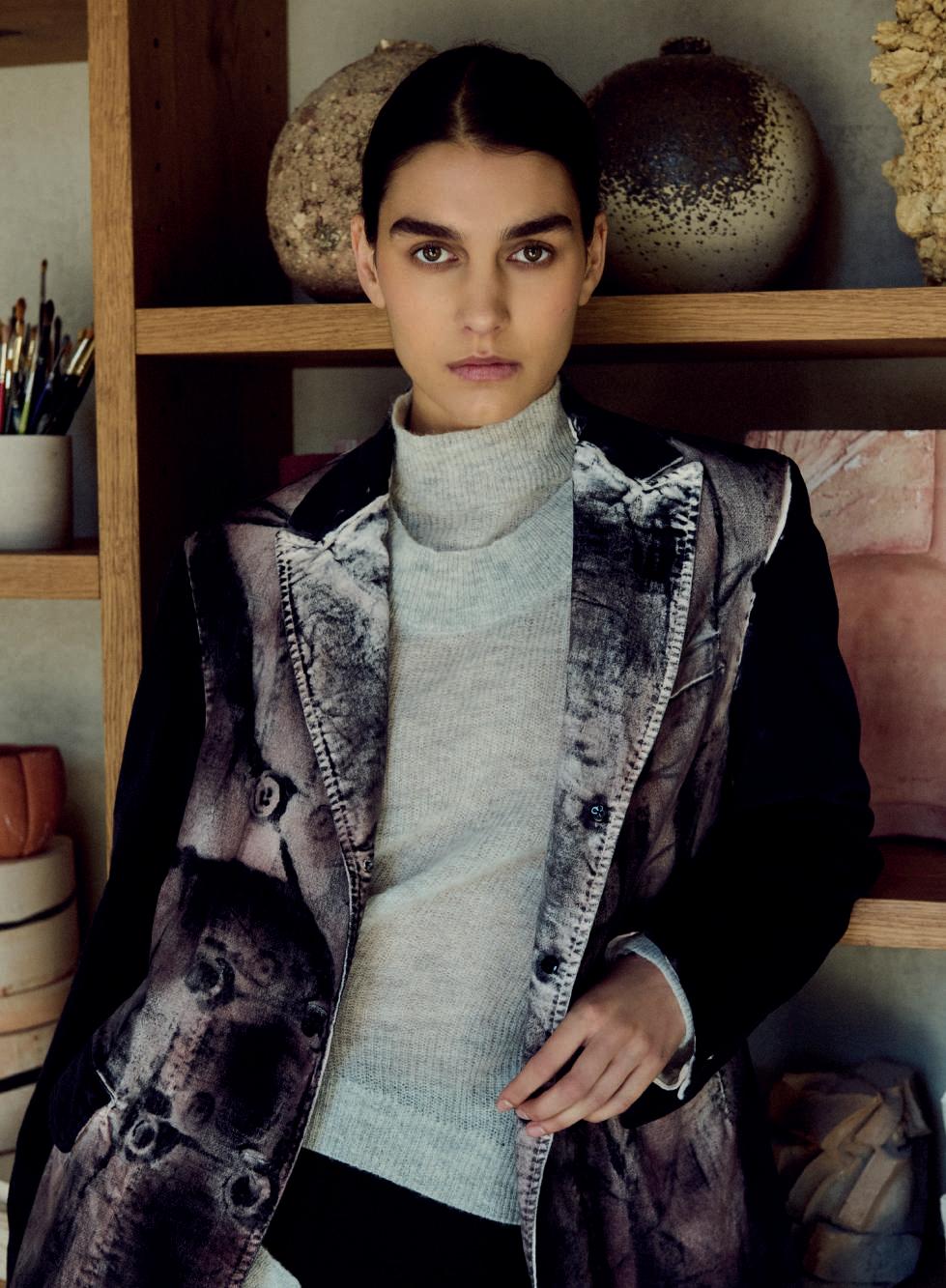
Illustrateur et graphiste français, Simon Bailly est diplômé de l’ESAL en 2015. Il débute sa carrière dans la presse avec Libération et Le 1, avant d’élargir son cxhamp de collaboration à des journaux internationaux (The New Yorker, New York Times, Los Angeles Times), à l’édition jeunesse, à la publicité et à de grandes institutions (Hermès, Paris 2024...). Ses dessins, à la fois narratifs et percutants, se retrouvent aussi bien dans la presse que sur les murs des galeries, témoignant d’un univers graphique singulier et reconnu.
www.simon-bailly.com
@simonbailly


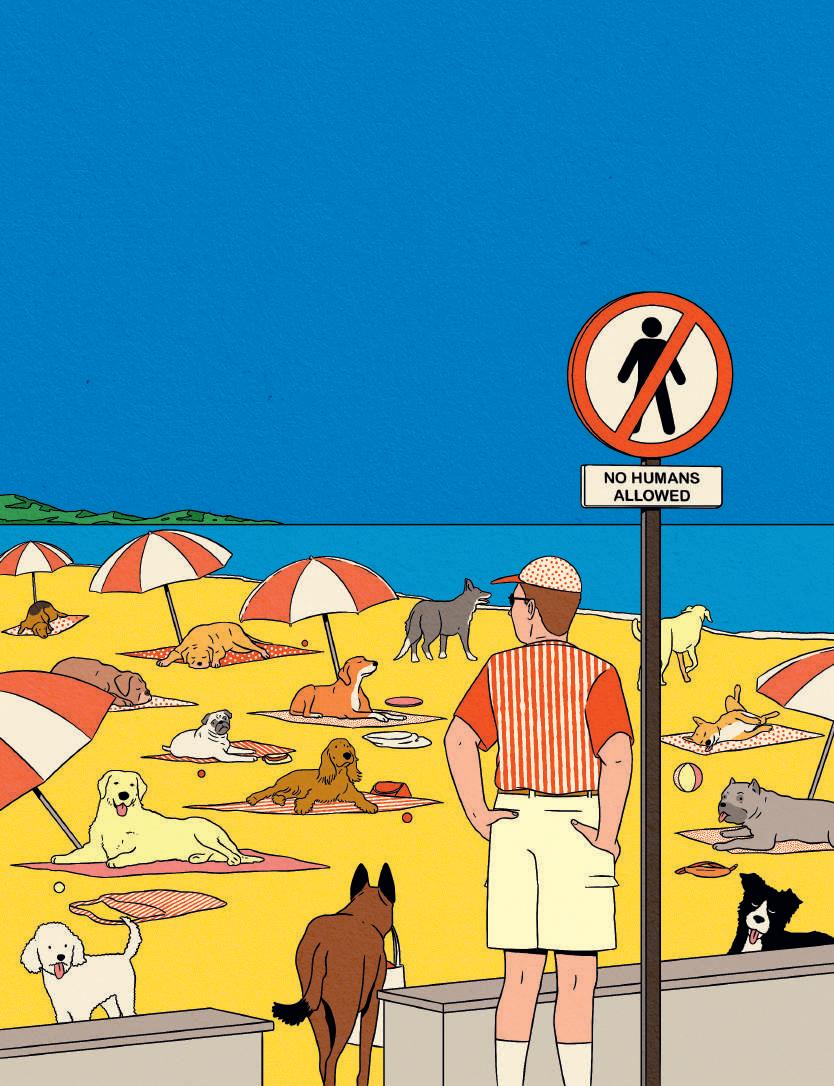

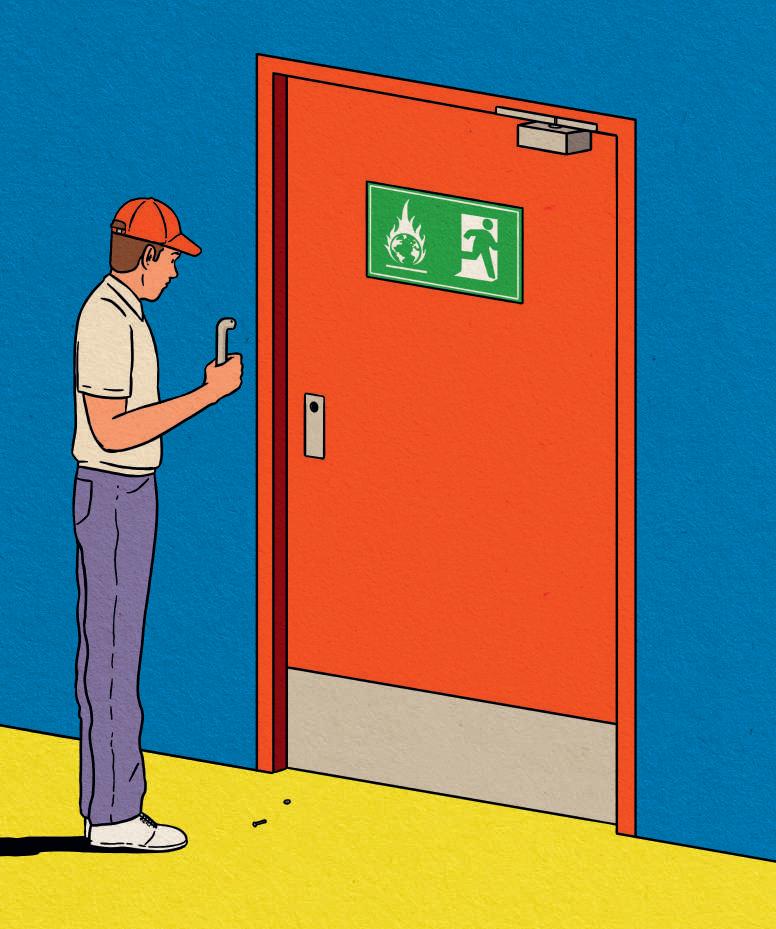

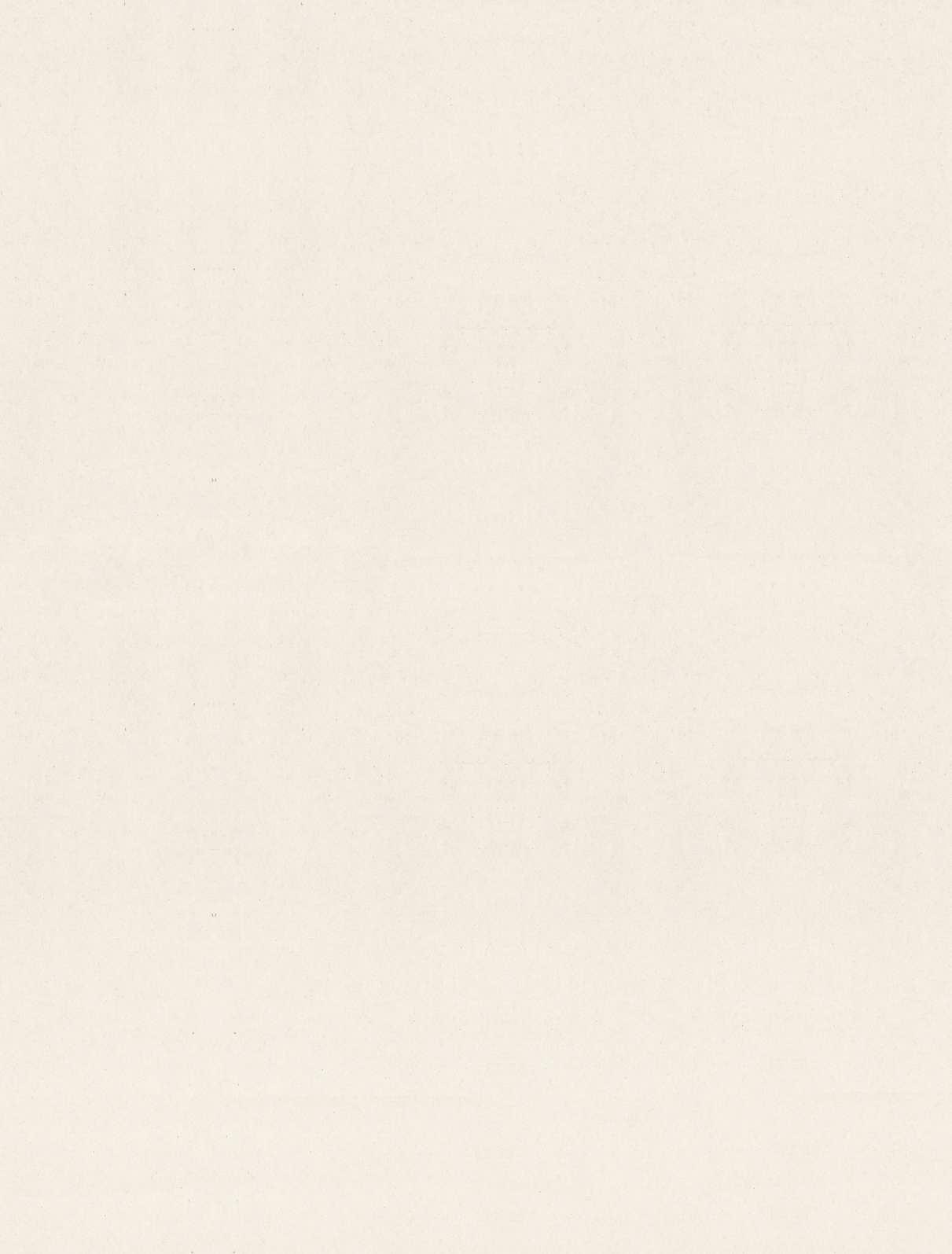
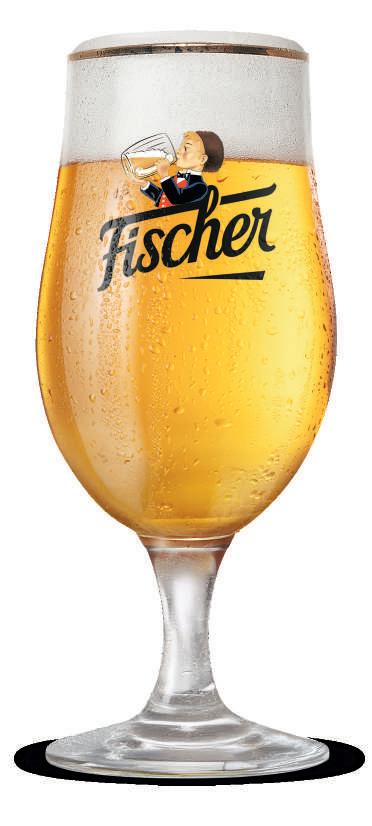
Par Alain Leroy ☛ Il y a soixante-dix ans cette année, le 25 octobre 1955 précisément, naissait à Strasbourg l’emblème de l’Union européenne tel qu’on le connaît : un drapeau azur orné de douze étoiles dorées dessiné par Arsène Heitz, employé au service courrier au Conseil de l’Europe. Mais pourquoi douze étoiles et non quinze, comme le nombre d’Etats membres à l’époque ?
L[L]a polémique remonte un peu, mais elle avait, en son temps, eu son petit succès. Alors grisé par les quelque 20 % de voix récoltées lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2017 et lancé à toute allure dans un combat poujadiste anti-Bruxelles, Jean-Luc Mélenchon avait fait resurgir des limbes l’origine du drapeau européen. Le leader de La France Insoumise s’indignait alors bruyamment que ledit drapeau se trouve aux côtés de celui de la France au sein de l’Assemblée nationale. « Franchement, on est obligé de supporter ça ? », vitupérait-il avec sa mesure légendaire. « C’est la République française ici, pas la Vierge Marie, ce truc est inconstitutionnel ! ».


Ce « truc », c’est le drapeau européen donc. Douze étoiles qui font cercle sur un fond bleu azur, fruit d’une volonté commune et de celle d’un homme.
La volonté commune, c’est d’abord celle des membres du tout nouveau Conseil de l’Europe créé en 1949 à Strasbourg et désireux de se doter d’un emblème spécifique et reconnaissable : on sait le poids des drapeaux dans l’histoire, c’est derrière eux que l’on se rallie, pour la guerre comme pour la paix. La volonté d’un homme ensuite : Paul Levy, originaire de Rixheim dans le Haut-Rhin, premier directeur de la presse et de l’information du Conseil de l’Europe. C’est lui qui sera l’élément moteur de cette création, qui ne lâchera jamais l’affaire quand elle menacera de s’enliser et proposera finalement à Arsène Heitz, autre Alsacien né à Huttenheim et embauché au service courrier du Conseil quelques mois plus tôt, de dessiner l’étendard d’une Europe nouvelle.
Si le projet de drapeau a finalement atterri entre les mains d’Arsène Heitz, c’est évidemment parce qu’aucune de la bonne centaine de propositions arrivées sur le bureau de la commission mise en place par l’Assemblée consultative et composée des représentants des quinze nations membres n’a vraiment convaincue et encore moins fait l’unanimité. Paul Levy s’est alors dit que tout ça était mal parti et que le plus simple, si on voulait que l’affaire aboutisse et lui le voulait plus que quiconque, était de de confier la réalisation de ce drapeau à une seule et même personne, Arsène Heitz donc. Simple membre du service courrier certes, mais ancien élève des BeauxArts à Rouen, Européen convaincu qui avait vécu dans sa chair les ravages de la guerre : engagée dans l’armée française en 1939, il avait rejoint la résistance et l’Intelligence Service avant de participer à la libération de l’Alsace avec la 1re Armée de De Lattre.
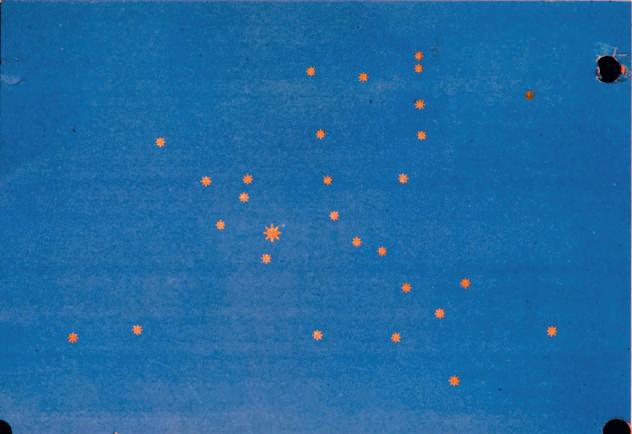


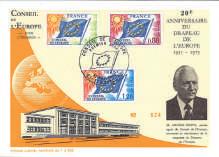
Ci-dessus, quelques exemples des propositions de drapeau européen qui ont été refusés par la Commission. Ils sont recensés dans un livre, Rejected – Designs for the European Flag À gauche, une carte éditée par le Conseil de l’Europe en tirage limité faisant figurer le portrait d’Arsène Heitz, co-auteur de la maquette du Drapeau de l’Europe.
Imaginer un homme comme lui, qui avait aussi connu très jeune la Première Guerre mondiale, travailler sur un projet aussi symbolique à quelques encablures de la retraite est un autre symbole.
Le cahier des charges ne comportait qu’une consigne, enfin deux : que ce drapeau transnational ne puisse être apparenté en aucune manière à une bannière déjà existante et n’induise pas une vision fédéraliste, sur le modèle américain par exemple. Pour le reste, tout était possible. Arsène Heitz s’employa à la tâche et livra plusieurs versions. L’Assemblée du Conseil de l’Europe en débattit longtemps, très longtemps. Trois ans furent ainsi nécessaires avant que ses membres ne s’accordent sur un emblème bleu orné de quinze étoiles d’or en cercle représentant les États membres. Problème, l’une de ces étoiles représentait de fait la Sarre, région frontalière alors sous tutelle française et membre associée du Conseil, que l’Allemagne de l’Ouest ne se résout alors pas à voir quitter son giron. Accepter que la Sarre soit officiellement représentée sur le drapeau européen en tant qu’État membre, donc possiblement indépendant ou partie de l’État français, en tout cas possiblement maitre de son destin, donc probablement perdu pour la patrie est intolérable pour Bonn qui s’y oppose fermement. Qu’à cela ne tienne, Alfred Heitz reprend son ouvrage, retravaille le projet en gardant le fond bleu qui fait l’unanimité et les étoiles en cercle qui la font aussi. Et il opte lui ou un autre l’histoire est assez floue à ce sujet pour un nombre d’étoiles porté à douze. Pourquoi douze ? Parce que c’est un chiffre parfait, symbolique et parce que Heitz n’est pas seulement un patriote, un Européen et un homme de paix, c’est aussi un fervent catholique. Comme il l’a confié longtemps plus tard, il a trouvé son inspiration dans sa foi et dans sa dévotion à la Vierge Marie dont une image l’a marqué à tout jamais. « On avait toujours invoqué cette “reine de la paix” à la maison et je pensais qu’elle était la parfaite garante et protectrice de cette paix fragile qui prenait naissance dans notre Europe meurtrie »1, dira-t-il.
1.
Dans Les Saisons d’Alsace, printemps 2018.
D’abord repris par le Parlement européen (le 11 avril 1983) puis par l’ensemble des institutions communautaires, il est devenu un symbole non seulement de cette Europe nouvelle alors en construction, mais de liberté et d’idéal. C’est lui que, de Tbilissi à Kyiv ou Bucarest, les manifestants brandissent quand il s’agit de lutter contre l’autoritarisme et les menaces totalitaires. Quel destin eut pu être plus extraordinaire, origine mariale ou pas. ←





Par Maria Pototskaya ☛ 20 Juillet 2025, Zaporijjia. Comme souvent, ma ville s’est réveillée après que les sirènes ont rythmé ses nuits, trop éclairées, trop bruyantes, trop courtes. Sommes-nous même encore en mesure de comptabiliser les frappes de ceux qui nous ont accrochés à leur tableau de chasse ?

[P]arfois je me le demande, quand le temps me laisse encore le temps de le prendre. Chose faite ce matin, à la vue de Valeri Zaloujny venu quelques heures, accompagné de près d’une centaine de diplomates, dont quatre-vingts chefs de missions diplomatiques. Tous se sont retrouvés ici, sous la houlette de notre ancien commandant en chef des forces armées, désormais ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni. Imperturbable, direct, le message aussi net que la ligne de front, située à moins de 30 kilomètres, 20 peut-être, depuis les dernières avancées estivales. Devant moi, cliché hautement symbolique : au premier plan, les visages de ces hommes et de ses femmes qui demain sillonneront le monde et au second, notre ville, chaque jour un peu plus meurtrie mais qui se refuse de céder à qui veut l’envahir. La ligne de front n’est plus proche, elle est désormais « nous ».
Certains habitants ironisent en observant la scène : « Et demain ? Ils seront où tous ces hauts fonctionnaires ? Manille, Brazzaville, Londres ? Ils sont venus voir la guerre… avant de repartir vers une autre, celle des nominations officielles ». Pas faux, mais ils sont venus. Rien ne les y obligeait. Le risque n’était pas anodin, pas plus que le symbole, la solidarité affichée, le message délivré ; celui de rappeler qu’ils restent à nos côtés et qu’ils travaillent à aider, à rallier, comme depuis la France, mon autre pays.
« Baskets anti-missiles » Là-bas, nombreux sont d’ailleurs ceux qui s’interrogent : une nouvelle guerre généralisée en Europe menace-telle vraiment ? 76 % des sondés sembleraient acquiescer, selon BFMTV. L’édition 2025 de la Revue Nationale Stratégique désigne également la Russie comme potentiellement capable « d’aller au-delà de l’Ukraine, vers le cœur de l’Europe d’ici à 2030 » et les liens militaires entre Paris et Kyiv ne cessent de se renforcer : formations d’unités, mirages, missiles SCALP, nouveaux investissements dans
l’industrie de la défense, dans les réservistes, les drones, le cyberespace, ou même l’espace. L’OTAN et l’UE développent le programme « Readiness 2030 » : 800 milliards d’euros à cet horizon pour réduire leur dépendance aux États-Unis. La Suède, la Finlande, la Pologne aussi, distribuent des informations écrites ou électroniques pour préparer leurs populations à l’impensable. Ironie de la chose, ces brochures je les avais aussi reçues avant la guerre. Pur fantasme, m’étais-je dit, avant de les mêler aux détritus ménagers... Aujourd’hui, ce sont mes escarpins que j’ai remisés pour mes baskets « anti-missiles », et mes salles de presse parlementaires de l’Allée du printemps et de l’Avenue de l’Europe qui relèvent de l’improbabilité.
« L’unité face à la lâcheté » Paradoxalement, je ne me suis sans doute jamais sentie autant européenne qu’aujourd’hui, au premier ou en arrière-plan de cette photo qui, peut-être, un jour, entrera dans l’histoire comme celle de l’unité de l’humanité face à la lâcheté d’escadrilles armées. Cela dure cinq minutes ou une journée entière, selon l’humeur du moment. N’y voyez là nulle métaphore ou exagération : juste une carte visuelle et visible de nos décombres et de ces fenêtres ouvertes sur une réalité crue qui ne pourra disparaître ni nous empêcher d’écrire le matin une chronique pour un magazine français d’amener l’aprèsmidi notre fidèle Renault chez son garagiste qui, régulièrement, lui déroule un tapis rouge sur une marche de Mendelssohn. Notre garagiste est à l’image de notre peuple : facétieux et inventif. Notre humour, lui, constant, presque vital ; nos sourires doux et respectueux, adressés à qui l’on croise. N’en déplaise aux « Orcs », aux Shahed ou à tout autre artifice funeste qui voudrait réduire notre liberté à bien moins qu’un bout de papier. Parce que ce cliché n’a rien d’anodin : il est une photo de cette unité étoilée qui nous ressemble et nous rassemble. ←

Mécéner les élèves de l’École du TnS, c’est leur offrir un appui, un élan, un remède à la précarité, afin qu’ils puissent étudier et créer le cœur plus léger. Pour donner en ligne : tns.fr/
Par E202 ☛ Envoyé sur Terre de la planète Versa (du versan Krapchoujk), E202 est chargé d’étudier les humains et d’établir des rapports réguliers au Haut Conseil en vue d’une éventuelle prise de contact officielle.
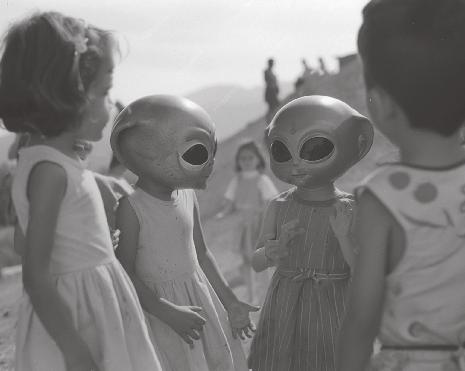
[À] l’attention du puissant Haut Conseil : Ô sublimes grandeurs au savoir sans pareil, je vous envoie ce message de la Terre où je poursuis mon enquête sur les humains. On peine à se rendre compte, nous qui nous créons par parthénogenèse à partir de la Mère, combien les humains sont différents de nous. On peine et ils me font de la peine. Comme ils sont embarrassés par leurs sentiments. Ils se font gloire de leur cerveau qui est sans doute plus gros que la plupart des autres espèces vivantes sur leur planète, mais à les observer on s’aperçoit que ce n’est pas cela qui gouverne leurs conduites. Il me semble que ça part d’un peu plus bas pour ne pas arriver bien haut.
Comme je me félicite que nous ne soyons pas empêtrés comme eux dans ces pulsions qui les orientent alors qu’ils habillent leurs actions de motifs très nobles et méritants. Je ne saurais dire si ils sont vraiment ignorants d’eux-mêmes ou bien vraiment hypocrites, mais l’un de leurs philosophes (qui sont tout de même bien moins crétins que la moyenne des humains, quoique parfois un peu imbus d’eux-mêmes) a dit qu’on ne savait pas si une seule de leurs actions avait été réellement morale.
Maintenant que je les pratique depuis quelque temps, si l’on ôte l’orgueil, la jalousie et la bêtise, je crois qu’il ne reste pas grandchose de leurs motivations. Mais cela sera sans doute l’objet d’un futur rapport, car il me semble qu’il y a là beaucoup à dire.
J’étais satisfait d’avoir réussi à établir une distinction majeure au sein des humains entre les maigres et les gros. Je dois à la vérité admettre que je me suis fourvoyé. Il y a des maigres qui deviennent gros et des gros qui deviennent maigres (mais ceux-ci souffrent beaucoup). Bien entendu la reproduction sexuée exige un mâle et une femelle. Mais la chose, outre qu’elle est fort rebutante (il y a par exemple des mélanges de liquides et je ne voudrais pas offusquer Vos Grandeurs)
est devenue beaucoup plus compliquée que pour les autres animaux.
Autre fourvoiement, j’ai momentanément pensé qu’une différence notable était celle entre petits humains et grands humains. Là encore la réalité s’est révélée plus complexe. Les spécimens les plus petits sont également les plus remarquables. Ils sont sales, bruyants et limités. Et pourtant, ô paradoxe supplémentaire des humains, ils sont entourés des plus grands soins. À l’inverse, les humains qui sont en phase finale et très vulnérables sont laissés dans des endroits tristes et coûteux ; nouveau paradoxe.
Les petits êtres dont je parle s’appellent des enfants. Mais quel ne fut pas mon étonnement de voir que ce n’est qu’un état transitoire. Les petits deviennent grands. Enfin, c’est une façon de parler trop superficielle. Il s’est avéré que beaucoup de grands restent petits. Et qu’on fait beaucoup pour cela. Ils sont maintenus dans une dépendance avec des objets lumineux sur lesquels ils passent des heures à faire des jeux de petits ou bien à regarder des images d’échanges de liquides. Leurs véhicules leur parlent ou font des bruits désagréables pour leur dire de fermer les portes, de s’attacher, de rouler droit et autres semblables choses. Mais surtout, bien des grands sont petits à l’intérieur, car ils jouent à se jalouser, à rivaliser afin d’être ce qu’ils appellent les meilleurs. Je crois que bien des meilleurs sont les pires.
Fait incompréhensible dont je serai amené à reparler plus longuement, je crois, ils ont besoin de chefs. C’est-à-dire d’humains qui leur disent ce qu’ils doivent faire et comment le faire. Paradoxe des paradoxes, loin de leur mettre un coup de pied au cul, ils les adorent. Les travers des humains ne cessent de me réjouir.
Je suis, puissant Haut Conseil, et pour toujours, votre humble et dévoué serviteur, E202. ←
Dans le cadre du Festival Plein Champ, la Gare SNCF du Mans s’est transformée en œuvre vivante. DS Impression est fière d’avoir accompagné l’artiste Stom500 pour donner vie à une installation grand format aussi poétique que technique.
Une œuvre pensée pour s’inscrire dans l’espace public sans jamais le contraindre.
Il aura fallu 5 mois de travail & 2 nuits pour tout installer. L’histoire commence bien avant l’impression. Elle débute sur le terrain, avec un travail de précision technique et une exigence : respecter le patrimoine sans le contraindre.
Chaque baie vitrée, chaque arcade, chaque relief de la Gare du Mans a été relevé avec une précision millimétrique, pour s’assurer que l’œuvre finale puisse épouser les volumes sans les masquer ni les endommager. Des gabarits sur mesure ont été conçus pour anticiper les contraintes architecturales : angles, épaisseurs, matériaux, exposition à la lumière, circulation de l’air…
La gare étant un lieu à très forte fréquentation, la sécurité était au cœur de nos priorités. DS Impression a mené une étude de faisabilité approfondie, pour garantir une pose :
Sans perçage, ni altération du bâti historique. Réversible, respectant les normes du patrimoine.
Ultra sécurisée, même en cas d’affluence ou de variation thermique.
Un système d’accroche intelligent a été imaginé :
Structure en aluminium sur-mesure, légère et résistante.
Fixations invisibles mais robustes, réparties en 5 points par vitrail.
Aucun contact direct avec les surfaces sensibles de la gare.
Ce travail préparatoire de fond a duré plusieurs semaines et permis de garantir un rendu final parfaitement intégré, en toute discrétion architecturale, fidèle à l’œuvre de l’artiste, et irréprochable sur le plan de la sécurité.

Le défi ? Réaliser toute la pose pendant 2 nuits, en seulement 9 heures, pour ne pas perturber le trafic ferroviaire. Une logistique millimétrée, rendue possible par l’expertise terrain des équipes de DS Impression.
Quatre arches monumentales accueillent 4 vitraux contemporains, chacun monté sur un châssis en aluminium aussi léger que résistant. Fixées en 5 points, les structures assurent une stabilité parfaite tout en préservant l’intégrité du bâti.

IMPRESSION XXL POUR LES MARQUES & LES RETAILERS : AFFICHE, PLV, SIGNALÉTIQUE, PACKAGING, THÉÂTRALISATION & ÉVÉNEMENTIEL




Au cœur du hall voyageurs de la Gare du Mans, la première œuvre que l’on découvre est monumentale, colorée, fluide : une mosaïque adhésive géante qui épouse les courbes de la grande façade vitrée comme une fresque vivante.
Cette installation spectaculaire recouvre un mur cintré composé de 72 vitres individuelles, chacune mesurant 1,5 mètre de large sur 1 mètre de haut. L’ensemble s’élève jusqu’à 12 mètres de hauteur, formant un écran de verre courbe qui capte immédiatement la lumière… et le regard.
Un résultat sans colle permanente ni altération.
Comme pour les vitraux, cette œuvre respecte l’intégrité du bâtiment : aucun perçage, aucun produit corrosif, aucune colle agressive. L’ensemble est réversible, démontable, propre.
Olivier Métral ☛ Depuis plus d’un an, la guide-conférencière et médiatrice culturelle
Bénédicte Gonnet propose de découvrir le patrimoine strasbourgeois au travers de visites faisant appel aux cinq sens.
P[P]eut-être l’avez-vous déjà croisée, au pied de la cathédrale, dans la cour d’honneur du Palais Rohan ou au beau milieu d’une ruelle du centre-ville à la tête d’un groupe de visiteurs ? Avec ses habits vert malachite, sa chevelure hérissée et sa voix haut perchée, Bénédicte Gonnet est loin de passer inaperçue. Depuis juin 2024, elle entraîne ses clients à la découverte du patrimoine alsacien, et notamment strasbourgeois, en sollicitant leurs cinq sens. La vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher au service de la compréhension de l’histoire locale, et en particulier celle qui touche au XvIII e siècle, « une période peu abordée par les guides, au contraire du Moyen Âge ».

Une pionnière en Alsace . Conçues à la manière d’un jeu de pistes immersif où les énigmes s’enchaînent, ses quatre visites sensorielles laissent une large place à la participation de son public. « Si tu ne fais que parler, tu perds tout le monde en moins de quinze minutes ». Equipés d’un sac à dos rempli d’objets « surprise », les visiteurs, répartis en petits groupes d’enquêteurs, avancent pas à pas le long du fil narratif que Bénédicte Gonnet tend autour d’eux. Du contenu exact de ces musettes, on ne saura rien. Pas question pour la guide d’en dévoiler la teneur, elle qui est aujourd’hui la seule à avoir développé ce concept en Alsace et qui, espère-t-elle, gardera secrète le plus longtemps possible la nature même de ses supports interactifs et ludiques.
Une intime conviction. L’origine de ce concept remonte à son passage à l’office de tourisme de Colmar, lorsqu’en 2021, elle monte de toutes pièces une visite sensorielle destinée aux déficients visuels. « Je me suis alors rendu compte qu’on pouvait l’adapter à tous les publics ». Alors dans l’incapacité d’en déployer les multiples possibilités, la médiatrice culturelle prend son indépendance en créant sa propre entreprise en octobre 2023. Un saut dans l’inconnu pour cette Alsacienne d’adoption, même si son imposant bagage professionnel lui offre l’assise nécessaire à l’exécution de son projet, elle qui est passée par Walt Disney, en Floride, plusieurs tour-operators, les châteaux de Blois et de Chambord, le Centre Pompidou, à Metz, ou encore le réseau des villes fortifiées de la Grande Région. Le « sensoriel », elle y croit dur comme fer. « Le public est plus que jamais en quête d’expériences à vivre, d’émotions à ressentir. Il a
besoin de participer activement à sa propre visite, d’interagir avec son guide, de jouer avec lui. Je reste également persuadée que le fait de mieux appréhender l’environnement dans lequel on évolue, au travers de son histoire, permet d’y vivre mieux, d’être en accord avec lui. Il y a là une forme d’alignement qui est essentiel pour chacun d’entre nous ».
Du sur-mesure. Bénédicte Gonnet veut s’adresser à tous et inclure tous les profils à sa démarche. « Les jeunes, les moins jeunes, les personnes en situation de handicap, quel qu’il soit, les entreprises, les collectivités, les familles, les scolaires… ». Au-delà des quatre visites clé-en-main qu’elle a imaginées sur Strasbourg, cette maman de quatre grands enfants crée des circuits sur mesure, en les adaptant à chaque territoire et à leur propre contexte historique. La préfecture basrhinoise n’est du coup pas son unique terrain de jeu. Loin de là. Ses mystérieux sacs à dos traversent toute l’Alsace. On les a ouverts l’an dernier à Wissembourg et cet été, ils ont été déballés à Barr et Hochfelden. Bénédicte est passée par ici et elle repassera par là. Avec, à chaque fois, « la volonté d’aiguiser la curiosité de chacun et de donner les clés pour mieux appréhender le patrimoine qui nous entoure, sans dissocier les différentes disciplines de l’Histoire. De l’histoire de l’art à celle de l’architecture, en passant par celles des hommes ou des conflits, tout est intimement lié ». Dans une histoire toujours en mouvement, le cerveau de Bénédicte Gonnet l’est aussi. Trois nouvelles visites sensorielles y sont en cours de gestation. Et avec elles, sans doute, de nouvelles surprises au fond du sac à dos. ←
Les quatre visites sensorielles de Bénédicte Gonnet à Strasbourg:
☛ L’Escroquerie au temps du cardinal de Rohan
☛ Les mascarons ont la parole !
☛ Le Code secret de Gretel
☛ Le Secret insolite des orfèvres
Visite de 1h30 à 2h de 4 à 15 personnes





Par Jessica Ouellet ☛ Au cours des derniers mois – et comme chaque année – j’ai observé le retour des orteils à l’air. Force est de constater que les Crocs gagnent le pied des Français. Symbole d’une mode décalée – ou d’une laideur confortable – elles ont été propulsées par une poignée de collaborations inattendues. Elles restent néanmoins peu flatteuses pour le pied.
P[P]rofessionnelle du vin – et fan de chaussures – je suis de plus en plus sidérée par la force d’un bon positionnement marketing. C’est que dans le monde du vin, une narration engageante – ou storytelling –contribue aussi à propulser la vente de bouteilles. Juste assez de paillettes pour flouter l’objectivité technique d’une dégustation. Longtemps attaché à une tradition de discrétion, le monde du vin adopte désormais de vraies méthodes marketing. Le storytelling est un ingrédient stratégique incroyable puisqu’il permet d’acheter une philosophie de vie ou un symbole de réussite sociale. C’est le cas de Petrus – un rouge de Bordeaux produit dans l’appellation Pomerol – qui est considéré comme un vin de luxe ultime. Sa rareté est particulièrement appréciée par les investisseurs et les célébrités. À l’instar de Rolex, Pomerol ne vend pas du vin, il vend un statut.
Les néophytes sont grandement influencés par l’étiquette, les histoires de famille, et les anecdotes. Ainsi, les discours jonglent avec les codes de la convivialité, du luxe et de l’écologie. Surtout de l’écologie. Le label Haute Valeur Environnementale (HVE), notamment, peut donner l’impression d’une

démarche écologique solide. Toutefois, cela n’apporte généralement aucun changement profond dans les pratiques viticoles.
Certains biais de représentation, telle que la mise en avant de la couleur verte pour donner une impression d’engagement écologique, fonctionnent. Les vérités partielles sont aussi exploitées afin de créer une perception favorable. C’est le cas d’un discours sur l’utilisation du verre recyclé omettant d’indiquer le poids final des bouteilles, ce dernier ayant une réelle empreinte carbone. Pour constater l’impact d’une stratégie marketing, achetez un cubi de 5 litres de « rosé piscine », puis conviez vos copains à l’apéritif. Si vous souhaitez pousser le vice, agrémentez la dégustation de Curly. Vous serez certainement affublé de l’étiquette de radin, les plus sympas diront que vous êtes une personne nostalgique. Imaginons le même vin présenté dans un contenant différent : un cubi plus petit – parce que tout ce qui est petit est mignon – et de forme carrée afin d’optimiser le stockage dans votre frigo. Assurez-vous que l’emballage soit composé de papier kraft, et le visuel de bon goût. À coup sûr, vos invités salueront votre souci écologique.
Dans un contexte où l’écologie et l’esthétisme prennent une place centrale dans les choix de consommation, les domaines viticoles s’adaptent. Sous des airs d’authenticité, une narration puissante – parfois embellie, douteuse, voire fausse – l’emporte sur la qualité réelle du vin puisqu’elle crée de l’émotion. Pourtant, un vigneron authentique dit ce qu’il fait, fait ce qu’il dit, et fait du vin qui lui ressemble.
Lorsque vous goûtez un vin en présence de professionnels du vin, prenez du recul en interrogeant vos propres impressions. Un esprit critique permet de garder une part d’objectivité, bien qu’elle ait ses limites puisqu’elle touche l’univers du goût. Restez curieux et cherchez la cohérence, ça vous évitera d’acheter des bouteilles au discours vide de sincérité. Ou des accessoires moches. ←








MAISON DE L’ALSACE
39, avenue des Champs-Élysées
75008 PARIS 01 53 83 10 10
resa@maisonalsace.paris www.maisonalsace.paris
D’ENTREPRISE AU COEUR DES
RÉUNION - FLEX BUREAU - COWORKING
FORMATION - RECRUTEMENTDÉJEUNER OU DÎNER D’AFFAIRESÉMINAIRE - ÉVÈNEMENT SUR-MESURE
L’ADRESSE DES ALSACIENS À PARIS
• - 15 % sur vos locations pour toute entreprise alsacienne
• L’adhésion à notre Club des 100 pour bénéficier de conditions privilégiées supplémentaires et pour développer votre réseau grâce à nos évènements networking
La Maison de l’Alsace vous accueille dans un bel immeuble haussmanien au 39, avenue des Champs Elysées, au centre du quartier des affaires parisien.
4 étages de bureaux, salles de réunion et salons d’exception à louer (à l’heure, la demi-journée ou à la journée).
Au dernier étage, un rooftop couvert d’une verrière offre une vue à 180° sur les toits de Paris, de l’Arc de Triomphe à la Tour Eiffel.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! resa@maisonalsace.paris ou 01 53 83 10 10
Par Thierry Jobard ☛ Quelle est la différence entre un idiot en voiture et un idiot à vélo ? Hormis le fait que le second pollue moins, il n’y en a pas. « Mais comment donc !? », se récriera-t-on. « Serait-ce une provocation, dans la ville même du vélo ? ». Que nenni. Il ne suffit pas de pédaler pour être vertueux.

E[E]n effet, en quoi le mode de transport modifierait-il notre nature ? Cela ne se peut, Aristote l’affirme. En voiture ou à vélo, quelle est la préoccupation majeure de l’humain ? Aller au plus rapide. On en constate les effets à chaque heure à Strasbourg. Les cyclistes roulent sur les trottoirs, vont à contresens, méprisent stops, sens interdits et feux rouges (« Oui, mais il y a une sorte de faux plat et alors si je m’arrête après c’est dur de repartir »), téléphonent en pédalant et autres joyeusetés. Strasbourg étant plus ou moins la capitale du vélo, on ferme les yeux. Ou bien on les garde bien ouverts et à l’affût, car la bicyclette est non seulement rapide, mais également silencieuse et je plains nos anciens qui, leurs sens déclinants avec l’âge, doivent endurer mille frayeurs au passage venteux des bolides furtifs. L’essor des plateformes humanistes que sont Uber, Deliveroo et autres exploiteurs au service de citadins paresseux n’arrange rien. Le but étant d’aller le plus rapidement possible d’un point A à un point B, tous les raccourcis sont permis. Et avezvous noté l’attitude de ces poursuiteurs affairés lorsqu’ils (ou elles) forcent mine de rien le passage, là où ils ne devraient pas se trouver ? Ils (et elles) regardent devant eux sans ciller afin d’éviter le regard réprobateur des piétons auxquels ils (ou elles, je pense qu’on a compris maintenant) grillent la politesse, s’imposant dans le flux par zigzags en supputant que chacun s’écartera devant eux. Dame, personne ne souhaite se faire percuter par un véhicule dont la vitesse peut sembler
relativement bénigne alors que les effets sont absolument affligeants.
Une légère mauvaise foi. Bien entendu, je ne généralise que pour les besoins de la démonstration et si l’on venait à me taxer d’une légère mauvaise foi je n’en disconviendrais pas. Il y a tout de même des exemples récurrents et l’on en vient à se demander si ces braves gens se rendent compte de ce que donnerait l’impact de leur personne contre une tonne de plastique et d’acier alors qu’elles filoutent une énième fois à un « Céder le passage ». Je ne m’appesantirais pas sur les vélos cargo qui s’apparentent davantage à des vélos bélier face auxquels tout doit s’effacer. Hé, les gars, c’est juste une caisse en bois ; n’importe quelle automobile en fera des copeaux. Sans parler de ce qui se trouve dans la caisse.
Car, nonobstant ses indiscutables qualités, le vélo prend place dans un système qui le précède et qui vient de loin. Celui des villes, progressivement faites pour les voitures, et plus encore celui des zones commerciales ; le tout-bagnole comme con le connaît. On a souvent moqué le comportement de certains conducteurs (pas de féminin ici) pour lesquels la voiture est le prolongement du corps qu’il ne faut pas même effleurer. Mais la susceptibilité est telle que, bien trop souvent, lorsque vous avez l’outrecuidance de tancer le fâcheux qui vous a touché au passage, vous risquez de vous attirer une volée d’amabilités digne du meilleur chauffard. Quand vous n’avez
Le but étant d’aller le plus rapidement possible d’un point A à un point B, tous les raccourcis sont permis.
pas droit au laïus confondant de bêtise sur la sacro-sainte Liberté qu’on voudrait étouffer. Avec un peu de chance, on vous jettera au visage l’épithète infamante entre toutes : « facho ! »
Pourquoi tout cela ? Parce que, plus que la liberté (qui est une chose bien plus complexe qu’il y paraît), vous avez entravé le flux, vous avez péché contre LA loi de notre temps : la vitesse. Plus exactement l’accélération. Certes le vélo est le mode de transport vert, vertueux et vernaculaire. Et l’on sait qu’il est bon de favoriser ce qu’on appelle les mobilités douces. Flâner la truffe en l’air et les cheveux dans le vent, c’est bien plaisant. Mais seulement le dimanche ; dès le jour suivant, il faudra accélérer et tout un chacun aura plus qu’à son tour pesté contre le mollasson qui déambule, indolent, sur la piste cyclable. Le mouvement, en pause un instant, a repris de plus belle et il faut s’y insérer sans écart.
Vélo, boulot, dodo. Pédale vite petit vélo, démène-toi, il faut aller gagner ta pitance. Vélo, boulot, dodo ça fonctionne aussi très bien. Il faut pédaler vite pour travailler vite, au moins plus intensément, pour produire vite (des objets, des chiffres, des idées), s’adapter vite aux nouveaux outils, aux nouveaux logiciels, aux nouveaux process, bientôt remplacés par d’autres, plus innovants, plus performants, plus « impactants » les uns que les autres. Et vite répondre aux 327 mails qui se sont accumulés. Vite finaliser son reporting. Vite réagir aux tendances du marché. Vite préparer la réunion à Paris où l’on ira vite en TGV s’arrêtant au milieu de nulle part dans des gares-cathédrales d’où l’on sort vite, qui pour le métro, qui pour le tram, qui pour un autre train. D’ailleurs on ne devrait plus parler de gare, ça c’est pour les caves. Désormais on parle de pôle d’échange multimodal. On concentre les modes de transport au même endroit pour… pour… aller plus vite pardi.
Toujours il faut gagner du temps. « Le temps c’est de l’argent » a-t-on dit. Je vous soumets un autre adage qui ne le contredit pas, mais sera plus instructif : « Le pouvoir est dans la vitesse ».1
Nous avons trop longtemps cru vivre avec l’héritage des Lumières. Il y a pourtant eu de sérieux coups de canifs dans le contrat. En détournant les yeux et avec quelques accommodements, on pouvait y croire. Bien des choses nous y incitaient et nous étions
lancés sans heurts, confiants, sur la route du Progrès. À quel moment cela a-t-il merdé ?
Un peu tout le temps, mais maintenant ça se voit. D’autant plus lorsqu’on a commencé à confondre progrès et innovation. Le progrès est moral, l’innovation est technique. Or nous avons une véritable frénésie de nouveau, savamment suscitée et entretenue par le complexe marketo-publicitaire dont l’objectif n’est pas de satisfaire des besoins, mais d’en créer artificiellement. Mais vous savez cela aussi bien que moi.
Il faut suivre, voire devancer, s’actualiser sans cesse sous peine d’être dépassé, relégué, exclu. Les salariés vont de plus en plus vite en ayant l’impression de faire du sur place. Jusqu’à l’arrêt soudain, brutal : burn out, dépression, chômage. Mis à l’arrêt, mis à l’écart, ceux qui sont touchés ne peuvent plus avancer alors que beaucoup d’autres courent sans savoir où ils vont. Il est vrai qu’un système économique qui privilégie de plus en plus le court terme de la financiarisation, le retour rapide sur investissement, ne peut guère que favoriser le phénomène. Le trading haute fréquence (THF), soit l’exécution des transactions financières par des algorithmes, a ainsi vu la vitesse de transaction passer de 20 millisecondes à 0,11 milliseconde en dix ans. Il semble que la crise de 2008 soit déjà bien oubliée alors qu’elle a montré combien la rapidité des échanges et l’interdépendance des secteurs pouvaient mener loin.
Désynchronisation. C’est finalement le découplage, la désynchronisation2 entre deux vitesses qui est à l’œuvre aujourd’hui. Découplage entre, d’une part, la vitesse informatique qui mène à l’automatisation et à la prévisibilité des comportements via le brassage des données et, d’autre part, nos capacités cognitives. Découplage entre les mensonges, fake news et autres manipulations et le temps de l’argumentation et de l’explication. Découplage entre la menace d’une crise écologique qui dépasse notre imagination et nos capacités d’action. Découplage entre les actes, décrets et autres oukases des régimes autoritaires et la durée de concertation et de délibération démocratiques.
Mais il faudra toujours neuf mois pour faire naître un enfant, toujours des années pour le rendre autonome, toujours une vie pour apprendre et découvrir. C’est sans doute cela le problème, nous avons perdu le rythme du monde. ←
Flâner la truffe en l’air et les cheveux dans le vent, c’est bien plaisant. Mais seulement le dimanche.
1. Paul Virilio, Entretien dans Le Monde du 7 septembre 1981, www.lemonde.fr/archives/ article/1981/09/07/paulvirilio-philosophe-de-lavitesse–2715328–1819218.html
2. Terme employé par Hartmut Rosa dans La modernité tardive en crise, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2024

Chaque trimestre, les membres de la rédaction de Or Norme ont lu, écouté, visionné l’essentiel de ce qu’on lui fait parvenir. Ces pages font part de leurs coups de cœur...

Jessica Ouellet ☛ Sommelière globetrotteuse d’origine québécoise, j’ai quitté l’effervescence de la restauration il y a quelques années. Je partage aujourd’hui ma passion du vin avec mon conjoint, en participant activement à la gestion du Domaine Wach, à Andlau. J’aime le flegme britannique, le pain à la banane et le café. Un test d’origines relève étonnamment la présence d’anglais dans mes ascendants.

La fatigue est un sujet tellement partagé qu’il nous unit, et l’essai poétique de Véronique Grenier en est une pertinente odyssée. À l’ère du numérique et de la quête de soi, cette enseignante et autrice dresse un portrait intime et social de nos épuisements collectifs. Avec un « je » vibrant d’authenticité, elle nomme avec justesse, et explore des solutions aux paradoxes du quotidien. Parce qu’être fatigué(e), c’est être occupé(e). Et c’est, quelque part, rester debout quand tout appelle au repli. ←

Jacqueline Queneau est historienne des arts de la table. Son ouvrage sur l’art de recevoir à la française est d’une grande richesse ; du plan de table en passant par les codes vestimentaires ou la conversation, tout y est. L’auteure adopte un ton humble et précis, privilégiant les astuces et les anecdotes historiques. Les rubriques sont faciles à retrouver et joliment mises en page. Un trésor à laisser traîner sur la table basse ou à offrir à une amie qui confond flacon vaporisateur et arrosoir. ←

Fondatrice de la marque de joaillerie Gemmyo, Pauline Laigneau cartonne (aussi) avec son podcast. Passionnée par le monde des affaires et le développement personnel, elle interviewe des personnalités issues d’univers variés et décrypte leur parcours. Les derniers épisodes regroupent, entre autres, les fondateurs de différentes marques françaises, un spécialiste de l’IA et une ex-ballerine professionnelle. Les discussions – sincères et bienveillantes – permettent de cultiver ses ambitions et invitent à questionner sa propre organisation. ←
PARU EN novembre 2022
AUX ÉDITIONS Atelier 10
COMBIEN 14,95 €
PAGES 92
PARU EN janvier 2024
AUX ÉDITIONS De la Martinière
COMBIEN 17,90 €
PAGES 352
À RETROUVER SUR Spotify, Apple Podcast et YouTube

Par Julie Daccache ☛ Future éditrice, j’aime les lectures qui font voyager et connectent les gens entre eux. J’envisage la littérature et la musique comme des vecteurs de partage qui portent nos convictions, à exploiter sans limites.

Dans les rues de Gaza, un photographe cherche la scène qui rendra compte de la réalité démembrée du conflit et de la vie qui subsiste pourtant. Sa rencontre avec un libraire palestinien lui apporte bien plus qu’un cliché. En lui confiant son histoire, le vieil homme tisse un récit de douleur et de résiliences, d’engagement et de résignations, d’amour, de rage et de peine. On est touchés par ce personnage dont la sincérité et l’espoir d’un monde différent ont su résister à la violence. À travers son récit déjà vieux de plusieurs générations résonne la question qui a rythmé la vie du libraire : que peuvent les livres et la littérature face à la violence absurde des hommes ? ←
PARU EN août 2025
AUX ÉDITIONS Julliard
COMBIEN 18 €
PAGES 128

2024. Anna, jeune pigiste, a vécu quatre belles années de colocation avec Madame Simone, une vieille dame juive assez secrète. À sa mort, bouleversée, Anna ne respecte pas sa dernière volonté d’être enterrée à Jérusalem. Un étrange coup de fil d’un proche de Madame Simone la conduit par la suite en Israël, en quête de rédemption, mais surtout de réponses. Ce qui rend ce roman unique à la lecture ? Il se déroule dans une zone de conflits acharnés, où il est rare que plusieurs points de vue se croisent. C’est pourtant ce que permettent l’histoire de Madame Simone et l’œil contemporain et inexpérimenté d’Anna. Avec un regard journaliste précis, Marie Semelin nous offre une occasion de réhumaniser des êtres massifiés par les médias, de questionner nos certitudes. Un premier roman bouleversant, plein de suspense, d’humanité et d’acuité. ←
PARU EN août 2025
AUX ÉDITIONS JC Lattès
COMBIEN 20,90 €
PAGES 342

Tobrouk est un duo de jazz ethno et de musique latine composé d’un piano et de percussions. Leurs rythmes endiablés mêlent librement des influences qui vont du Moyen-Orient aux Caraïbes, dans une grande complicité musicale. Cette alchimie est née de la rencontre de deux assistants d’éducation dans un lycée où ils utilisaient la salle de musique pour « jamer » ; elle a évolué vers trois morceaux originaux. Impossible de résister à l’envie de danser quand leurs instruments entament leur dialogue harmonieusement éclectique. Tobrouk est une invitation à vivre dans l’instant présent et à suivre la cadence. ←
À ÉCOUTER SUR www.open.spotify.com


Vanessa Chamszadeh ☛ Je vis entre encre et parfum, entre papier et rêve. J’écris à la main, un geste lent qui me ressemble. J’aime la reine Victoria, les têtes couronnées, l’élégance d’antan. Les livres sont mes refuges, Strasbourg mon berceau, l’histoire mon souffle.
LIVRE

J’ai aimé L’Intranquille pour sa sincérité brute, sa manière de dire la folie sans fard, de l’imbriquer à l’acte de peindre. Garouste ne triche pas. Il explore l’enfance brisée, la honte du père, l’errance psychiatrique et y puise une force vitale. J’ai été frappée par l’intensité du récit, la lucidité sans pathos et cette idée que l’art, loin d’apaiser, aide à tenir debout. Un livre qui marque, qui remue et qui reste. ←
PARU EN août 2009
AUX ÉDITIONS l’Iconoclaste
COMBIEN 7,90 €
PAGES 198
LIVRE

J’ai eu le privilège de lire en avant-première La vie a ses saisons. Clara, Sam et Marie, amies de toujours, traversent une année charnière où tout vacille. Trahison, vertige, renaissance. À travers les saisons, un seul fil, la liberté. Celle de s’écouter, de se réinventer, de se choisir. Un roman choral à l’écriture tranchante, sans effets inutiles, sur l’amitié, l’amour et ce moment subtil où l’on reprend possession de sa vie. ←
À PARAÎTRE EN janvier 2026
AUX ÉDITIONS Les Passagères
COMBIEN 12 €
PAGES 120
MUSIQUE

Je sais que c’est elle est sans doute l’une de mes chansons préférées de Julien Clerc. Elle dit l’amour avec des mots justes, loin des clichés. Elle parle de la peur de s’engager, de cette douleur qu’on garde en soi et de ce fragile équilibre entre le quotidien et l’absolu. La mélodie, simple et élégante, suit ces nuances sans jamais les forcer. La voix de Julien Clerc, à la fois sûre et tremblante, donne à chaque mot la force d’une confidence. ←
SORTIE EN 1973
ALBUM Julien Clerc Symphonique à l’Opéra National de Paris


Or Champ est une tribune libre confiée à une personnalité par la rédaction de Or Norme. Comme toute tribune libre, elle n’engage pas la responsabilité de la rédaction de la revue, mais la seule responsabilité de sa ou son signataire.
Photographie : DR
Les débats ont été riches autour de la loi relative au droit à l’aide à mourir. J’ai écouté, échangé, réfléchi, débattu, jamais dans une opposition stérile mais bien dans un esprit de partage. Mais une tribune publiée dans le Figaro et intitulée Notre rôle est d’enseigner le soin, pas d’apprendre à donner la mort1 m’a particulièrement interpellé, en tant qu’enseignant. Non pour contester la sincérité de ses auteurs ni la légitimité du débat, mais pour interroger la conception du soin qu’elle défend. Être médecin, ce n’est pas seulement soigner. C’est aussi apprendre à prendre soin. Soigner, c’est diagnostiquer, traiter, guérir. Mais prendre soin, c’est accompagner, soulager, écouter, être présent même quand il n’y a plus de réponse curative. Cette présence, cette attention, cette humanité font pleinement partie du soin.

La tribune évoque une opposition entre soin et mort. Mais ne confond-on pas « guérir » et « mort » ? Ne pas pouvoir sauver ne signifie pas abandonner. Accompagner la fin de vie, et parfois, à la demande explicite d’un patient, aider à mourir, ce n’est ni un échec ni une trahison. C’est parfois une forme ultime de soin.
L’aide à mourir soulève des questions éthiques légitimes. Mais peut-on y répondre par une lecture figée du serment d’Hippocrate ? Si l’on retient « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément », il faut aussi rappeler : « Je ferai tout pour soulager les souffrances » et « Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. » Prises ensemble, ces phrases rappellent que notre devoir est aussi de
1. www.lefigaro.fr, Notre rôle est d’enseigner le soin, pas d’apprendre à donner la mort, publié le 20 avril 2025.
préserver la dignité et la qualité de vie, jusqu’au bout. Dire que l’on fera « tout pour soulager les souffrances », c’est déjà reconnaître que notre devoir n’est pas seulement de prolonger la vie, mais de préserver sa qualité. Comme disait André Malraux : « Il faut ajouter de la vie aux années, pas des années à la vie ».
Aider à mourir dans un cadre strict, légal, à la demande réitérée d’un patient lucide, ce n’est pas provoquer la mort au sens que ce serment condamne. Ce n’est pas imposer, c’est écouter. Ce n’est pas renoncer, c’est répondre. Ce n’est pas trahir le soin, c’est parfois l’accomplir.
Le serment d’Hippocrate est ancien. Il condamnait aussi l’avortement ou la chirurgie. Nous ne l’avons pas trahi en les intégrant à notre pratique : nous l’avons fait évoluer avec la science et les valeurs de notre temps.
Il ne s’agit pas d’imposer une démarche à tous. La clause de conscience est indispensable. Mais il faut pouvoir enseigner – sans tabou – comment accompagner sans abandonner. Comment rester médecin jusqu’au dernier souffle, sans se réfugier derrière le silence ou le déni. Notre système de santé doit évoluer vers une vision plus humaine, plus globale, qui ne se limite pas à guérir mais qui prenne soin, vraiment, de la vie dans toutes ses dimensions – y compris la fin de vie.
Être médecin aujourd’hui, ce n’est pas seulement apprendre à guérir. C’est aussi savoir, humblement, comment prendre soin dignement jusqu’au bout. ←
2 PIÈCES - 39 M2
3 PIÈCES - 75 M2
4 PIÈCES - 88 M2
À PARTIR DE 239 400 €

VENDENHEIM
4 PIÈCES - 106 M2
5 PIÈCES - 116 M2
À PARTIR DE 447 000 €
LIVRAISON IMMÉDIATE

LA ROBERTSAU
4 PIÈCES - 86 M2
À 492 500 € Terrasses et garage
LIVRAISON 2026

