



































« Le plan a été développé grâce, notamment, à la contribution du Forum d’action sur l’eau. Ce forum est un comité de travail qui réunit une vingtaine de représentants des milieux municipal, agricole, industriel, scientifique, gouvernemental et de la société civile. »
— Caroline Robert, directrice générale à la Direction générale des politiques de l’eau au MELCCFP


Éditeur et rédacteur en chef
André Dumouchel adumouchel@maya.cc
Coordonnatrice à la direction de l’édition Eve Matte coordination@maya.cc
Direction artistique MAYA
Designer graphique
Sylvain Malbeuf (SymaPub)
Journaliste et rédactrice
Marie-France Létourneau
Chroniqueurs
Clément Cartier
Me Thibaud Daoust
Marc Didier Joseph Mathieu Laneuville
Photos de la page couverture et de l’entrevue iStock by Getty Images
Réviseures linguistiques
Emmie Garneau
Christine Paré


Espace publicitaire
André Dumouchel Téléphone : 450 508-1515 adumouchel@maya.cc
Abonnement et administration
MAYA communication et marketing 457, montée Lesage Rosemère (Québec) J7A 4S2 Téléphone : 450 508-1515 info@magazinesource.cc www.magazinesource.cc
Impression Héon et Nadeau
























Avec l’été qui s’installe et le retour de la chaleur, le nouveau Plan national de l’eau du gouvernement du Québec a quelque chose de rafraîchissant.
Rafraîchissant, parce qu’il est le fruit d’un travail d’équipe. Il est bien difficile, dans ce cas-ci, de reprocher au gouvernement d’avoir travaillé en vase clos, comme cela arrive trop souvent. Les représentants d’une vingtaine d’organismes de différents horizons et de trois ministères ont collaboré avec celui de l’Environnement pour cibler 40 mesures à réaliser et 7 orientations principales. Sachant combien il est difficile d’obtenir un consensus, on ne peut que saluer ce travail de concertation de haut niveau.
Cela démontre non seulement que toutes et tous sont prêts à ramer dans la même direction, mais également qu’il est possible de s’entendre et de parler d’une même voix. La campagne de sensibilisation Pensez bleu , l’une des mesures du Plan, en est d’ailleurs un bon exemple.
Mais, on s’en doute, protéger les ressources en eau est une tâche colossale. Il faut agir sur tellement de fronts à la fois! Lutter avec les effets des changements climatiques, neutraliser les contaminants nocifs non normés (comme les tristement célèbres PFAS) et réduire la pollution agricole diffuse ne sont que quelques exemples parmi la longue liste de priorités.
À eux seuls, le renouvellement et la mise à jour des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées nécessitent d’ailleurs des investissements monumentaux. Les sommes à investir se comptent en milliards, comme le souligne à juste titre le

Les besoins sont grands, reconnaît d’emblée Caroline Robert, directrice générale à la Direction générale des politiques de l’eau au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
À la lumière de ce constat, le budget de 500 millions de dollars alloué à la mise en œuvre des différentes mesures du Plan national de l’eau peut sembler une goutte d’eau dans l’océan. Le gouvernement reconnaît d’ailleurs que cette somme ne permettra pas de répondre à tous les enjeux.
Et cette lucidité a, elle aussi, quelque chose de rafraîchissant. Voyons donc comment le Plan pourra se déployer, fournir les outils, les connaissances et les solutions nécessaires aux enjeux ciblés. Mais il faudra inévitablement que les investissements – et peut-être des mesures coercitives ayant un peu plus de mordant – suivent pour permettre d’aller plus loin dans l’atteinte des objectifs.
La création du Fonds bleu, en 2024, dans la foulée de la hausse de la redevance imposée aux entreprises qui prélèvent de grandes quantités d’eau au Québec, constitue d’ailleurs un pas dans la bonne direction. Il faut saluer l’initiative, mais il ne faut surtout pas s’arrêter là.
Tôt ou tard, il faudra sérieusement envisager l’installation élargie de compteurs d’eau. C’est assurément une partie de la solution, ne serait-ce que pour suivre le parcours de l’eau. Je suis convaincu que, sans ce précieux outil, il est bien difficile de protéger la ressource, comme le vise le Plan national de l’eau.
André Dumouchel adumouchel@maya.cc
Si on veut inciter les citoyens et les entreprises à changer leurs comportements, encore faut-il que leur consommation d’eau soit rendue concrète et mesurable. Et les coûts astronomiques liés à la production d’eau potable doivent y être associés.
Il est plus que temps de cesser de croire, collectivement, que l’eau est une ressource abondante, inépuisable et, surtout, gratuite. Certaines municipalités qui connaissent des pénuries d’eau le savent déjà trop bien. Leurs citoyens aussi.
Même si leur efficacité n’est plus à démontrer, les compteurs d’eau continuent de se heurter à une résistance sur le plan de l’acceptabilité sociale. Les réticences demeurent fortes, comme l’a rapporté La Presse dans une série de reportages parus en avril dernier. Le fameux scandale des compteurs d’eau, survenu à Montréal dans les années 2000, a laissé des traces. L’outil est devenu un triste symbole de corruption qui semble refroidir certains élus.
L’organisme Réseau Environnement y voit pour sa part une solution rapide et peu coûteuse pour réduire la consommation d’eau. Un point de vue que nous partageons et que nous encourageons.
Il y aura toujours des citoyens qui adopteront des comportements irresponsables face à l’eau. Mais on peut croire qu’ils seraient peut-être moins nombreux à nettoyer leur entrée de cour ou leur stationnement au boyau si leur consommation d’eau était mesurée par un compteur. n
Sur ce, allons nous baigner. Bon été !











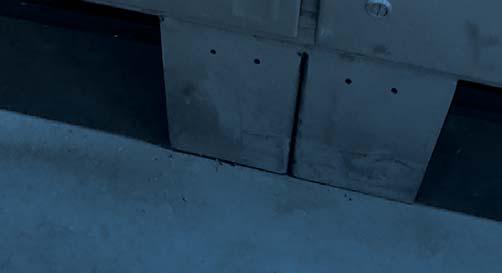

Cette année, le magazine Source célèbre ses 20 ans. Je profite de cette occasion pour souligner le travail remarquable des nombreux spécialistes qui œuvrent à la gestion de l’eau potable et au traitement des eaux usées partout au Québec. Je salue particulièrement tous les innovateurs qui contribuent à faire évoluer les savoirs et les pratiques dans ces domaines prioritaires, notamment en partageant leur expertise par l’entremise de cette publication unique.
C’est en améliorant continuellement nos connaissances et nos façons de faire que nous pouvons renforcer notre pouvoir d’agir pour protéger l’eau, collectivement et individuellement. C’est d’ailleurs l’un des objectifs phares du Plan national de l’eau, lancé à l’automne 2024, qui vise également à ce que tout le Québec se mobilise pour préserver cette richesse collective. Avec ce plan, notre gouvernement met de l’avant plusieurs mesures concrètes pour outiller davantage tous les acteurs de l’eau afin qu’ils puissent mieux jouer leur rôle.
Dans le contexte des changements climatiques, les défis liés à l’eau sont de plus en plus nombreux, complexes et variés, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité. Ces défis nécessitent une adaptation rapide et le déploiement de solutions toujours plus innovantes, qui reposent sur des savoir-faire de pointe et des technologies d’avant-garde. Je pense, entre autres, aux enjeux émergents associés à la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA) et des microplastiques dans l’eau, qui impliquent l’acquisition de nouvelles connaissances.
Dans les dernières années, nous avons fait de grandes avancées, notamment en matière de surveillance et de traitement des eaux usées. Par exemple, notre gouvernement a travaillé intensément pour mettre à niveau les infrastructures et optimiser les systèmes de gestion des eaux, dont les eaux pluviales. Ces efforts permettent aujourd’hui de mieux prévoir et gérer les risques liés à l’eau.
Grâce aux programmes financiers gouvernementaux et à la mobilisation de plusieurs partenaires, nous avons aussi déployé des efforts importants pour réduire les répercussions de certaines activités sur les écosystèmes aquatiques. Ces interventions ont ciblé en priorité les secteurs à fort impact et les principales menaces qui pèsent sur nos milieux humides et hydriques, dont les espèces exotiques envahissantes.
Je tiens à remercier, entre autres, les villes et les municipalités, qui sont de véritables piliers pour une gestion intégrée et durable de l’eau au Québec. Je suis également très fier de pouvoir compter sur des alliés, comme les membres du Forum d’action sur l’eau, qui contribuent à façonner et à faire rayonner les initiatives porteuses dans ce domaine.
La crise mondiale de l’eau nous rappelle aujourd’hui à quel point le Québec est une nation riche en ressources hydriques, mais, surtout, que nous avons le devoir de les préserver, maintenant et pour les générations futures. C’est pourquoi, avec le Fonds bleu, le gouvernement s’est doté d’un nouveau levier pour assurer le financement pérenne des actions qui permettent de protéger l’eau, tout en favorisant l’accès à une eau potable de qualité pour l’ensemble de la population québécoise.
Avec les investissements majeurs prévus d’ici 2028 pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de l’eau, nous comptons bonifier les initiatives à succès et encourager l’innovation et l’adoption de nouvelles approches qui favorisent une utilisation durable de l’eau sur tout le territoire québécois. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les contributions possibles et de tous les outils, comme le magazine Source, qui est LA référence dans ce domaine depuis plus de 20 ans au Québec. n


Par Marie-France Létourneau Collaboration spéciale

Le nouveau Plan national de l’eau (PNE) du gouvernement du Québec est ambitieux. Son objectif : protéger, moderniser, restaurer, soutenir, améliorer et optimiser les ressources en eau. Un défi de taille, surtout en contexte de changements climatiques. Mais, pour le PNE, on estime avoir les moyens de nos ambitions.
« Le travail d’équipe réalisé pour élaborer le PNE est l’une des pierres angulaires de cet imposant chantier,» soutient Caroline Robert, directrice générale à la Direction générale des politiques de l’eau au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).
Dévoilé à l’automne 2024, le Plan national de l’eau : une richesse collective à préserver est accompagné, pour son déploiement, d’un budget de 500 millions de dollars, provenant en partie du nouveau Fonds bleu. Près de 40 priorités d’action et 7 orientations principales ont été établies.
« Le plan a été développé grâce, notamment, à la contribution du Forum d’action sur l’eau, explique Mme Robert. Ce forum est un comité de travail qui réunit une vingtaine de représentants des milieux municipal, agricole, industriel, scientifique, gouvernemental et de la société civile. »


« Il y a une bonne représentativité des acteurs à l’œuvre sur le terrain pour faire face aux enjeux liés à la protection des ressources en eau, précise-t-elle. Ils nous ont alimentés dans les réflexions, les priorités et les moyens d’action. »
Bref, dit la directrice générale, ce nouveau plan d’action, le deuxième de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, est le fruit d’un travail de « co-construction ». Trois ministères – Agriculture, Pêcheries et Alimentation ; Ressources naturelles
et Forêts ; Affaires municipales et Habitation – y ont également contribué.
« Cet aspect, de travailler main dans la main pour faire quelque chose de structurant pour le Québec, c’est vraiment bien, réagit Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement, l’un des organismes membres du Forum. On le dit souvent : "Seul, on va vite, et ensemble, on va plus loin". Je pense que c’en est un bon exemple. »
Selon lui, le gouvernement a par ailleurs fait preuve d’écoute dans le cadre de l’élaboration du PNE. Par exemple, plusieurs recommandations formulées sur la gestion de l’eau dans le rapport Assainissement 2.0., préparé par le regroupement de spécialistes en environnement qu’il préside, ont été retenues.
« On s’entend, les défis sont grands pour la gestion des eaux usées, souligne-t-il. Et le Ministère a donné suite à la vaste majorité des recommandations. »
Selon Caroline Robert, les attentes sont élevées à l’endroit du PNE. « On peut avoir l’impression que 500 millions de dollars [le budget alloué au Plan], c’est énorme, dit-elle. Mais les besoins sont grands. Un travail a été fait pour trouver un équilibre à travers toutes les priorités. »
À cet effet, la diversité des expertises réunies au Forum d’action sur l’eau a permis de concilier les besoins, estime M me Robert. « On a voulu se donner des priorités d’action, les structurer et se donner des cibles pour mesurer les résultats sur le terrain », dit-elle.
Une part importante est notamment accordée à l’acquisition de connaissances, en collaboration avec divers partenaires, surtout dans un contexte de changements climatiques accélérés. Plusieurs projets de recherche seront réalisés, dont certains sont présentés plus loin, pour approfondir les données sur la disponibilité en eau et l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable.
Plus largement, certaines mesures du Plan visent à améliorer les pratiques agroenvironnementales sur les terres cultivées en zone littoral, à soutenir la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques ou encore à réduire les risques de sinistres liés aux inondations.
Tout ce travail est essentiel, et les actions doivent suivre, confirme Pierre Baril. Celui qui a occupé tour à tour les fonctions de sous-ministre adjoint aux politiques au ministère de l’Environnement, de directeur général du consortium Ouranos et de président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pose un regard éclairé sur la situation.
« J’ai l’impression que nos capacités d’adaptation ne suffisent plus à suivre la progression des changements climatiques, qui avance plus vite que ce que nous avions anticipé, dit celui qui agit actuellement à titre de commissaire et de coprésident de la Commission mixte internationale, chargée de veiller sur les eaux limitrophes entre le Canada et les États-Unis. On est à l’aube de conflits d’usages importants. »
« Ça a déjà commencé dans certaines villes de la couronne nord de Montréal et de la plaine du SaintLaurent, ajoute-t-il. L’été, elles commencent à manquer d’eau. Les étiages sont plus graves. Il faut nettement accélérer l’adaptation à ce phénomène. »
Pierre Baril était d’ailleurs aux premières loges, à titre de sous-ministre, lorsque les premières politiques de l’eau ont été mises en place au Québec à la fin des années 1990 et au début des années 2000. « Un travail de longue haleine, qui a permis des avancées certaines, » dit-il.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger l’or bleu. Les Québécois figurent parmi les plus grands consommateurs d’eau potable, avec 253 litres par personne par jour en 2022, rappellet-il. À titre de comparaison, la consommation quotidienne moyenne par personne est de 184 litres en Ontario et de 220 litres dans l’ensemble du Canada. Tout le monde doit participer aux efforts.
À cet effet, le gouvernement du Québec a lancé, l’an dernier, la campagne de sensibilisation Pensez Bleu, qui a fait l’objet d’un reportage dans la récente édition printanière de Source Financée par le Fonds bleu, lequel est alimenté en partie par la redevance sur l’utilisation de
l’eau, et propulsée par Réseau Environnement, la campagne doit se déployer jusqu’en 2026. Elle vise à éduquer les citoyens aux conséquences de leurs gestes sur la disponibilité et la qualité de l’eau.
De façon complémentaire, le PNE prévoit différentes actions pour mieux protéger les ressources en eau. Les experts de Réseau Environnement sont entre autres mis à contribution pour analyser et encadrer plus efficacement le problème des contaminants nocifs non normés, dont les « fameux PFAS », illustre Mathieu Laneuville.
Dans ce contexte, et pour optimiser les retombées du PNE, des investissements seront inévitables pour remettre à niveau les infrastructures d’eaux usées, dit-il. « C’est essentiel de rappeler qu’il y a un important déficit de maintien d’actifs, soit 19,3 milliards de dollars, soutient M. Laneuville. On a des infrastructures qui ont grandement besoin d’amour et d’investissements. »
« On n’a pas ce genre de moyens avec les 500 millions de dollars du PNE, fait valoir Caroline Robert. Mais, avec le Plan, on concrétise toutes sortes d’initiatives qui ne sont pas couvertes par les programmes d’infrastructures, lesquels financent surtout la conception des plans et la réalisation des travaux sur le terrain. En d’autres mots, dit-elle, le Plan national de l’eau agit de manière complémentaire aux différents programmes d’infrastructures. »
Autre exemple de complémentarité : le PNE ne résoudra pas les problèmes d’approvisionnement en eau potable qui touchent certains villages du Nunavik. Néanmoins, il pourrait contribuer à l’identification de solutions, estime Mme Robert. Un budget de 30 millions de dollars est alloué aux Premières Nations et Inuit pour réaliser des projets répondant aux enjeux prioritaires qu'ils identifieront.

« On a voulu se donner des priorités d’action, les structurer et se donner des cibles pour mesurer les résultats sur le terrain. »
— Caroline Robert, directrice générale à la Direction générale des politiques de l’eau au MELCCFP
« Dans une administration publique, on a tendance à travailler en silo. Mais cette fois, on a une stratégie qui nous oblige à nous coordonner, parce que l’eau relève de plusieurs ministères. Et ça, c’est très bien : au lieu de s’obstiner et de dédoubler les actions, on travaille ensemble. »
— Pierre Baril, commissaire et de coprésident de la Commission

à poursuivre
Caroline Robert souligne que le nouveau PNE s’inscrit dans la continuité du précédent, qui a permis la mise en place de plusieurs mécanismes, notamment pour mieux encadrer les rejets d’eaux usées des municipalités.
« Un cadre réglementaire a été instauré et de nouveaux outils ont été déployés, précise-t-elle. On a maintenant, par exemple, un mécanisme d’attestation d'assainissement qui permet de cibler les améliorations que chacune des

municipalités doit apporter pour le traitement de ses eaux usées. »
Si la partie n’est pas gagnée en matière de gestion et de protection des ressources en eau, les choses évoluent, estime l’ex-sous-ministre de l’Environnement, Pierre Baril. Selon lui, la responsabilisation des acteurs de l’eau s’est accrue, et la concertation est plus que jamais au cœur des actions.
« Dans une administration publique, on a tendance à travailler en silo, dit M. Baril. Mais cette fois, on a
une stratégie qui nous oblige à nous coordonner, parce que l’eau relève de plusieurs ministères. Et ça, c’est très bien : au lieu de s’obstiner et de dédoubler les actions, on travaille ensemble. »
Le Québec compte des dizaines de milliers de rivières et plus de trois millions de plans d’eau. Une abondance trompeuse puisque cette ressource n’est pas pour autant inépuisable. Au contraire, elle est plus menacée que jamais. Le PNE vise justement à mieux outiller le Québec pour faire face à ces enjeux.

Notre stratégie repose sur la présence de services d’AERZEN dans le monde entier
Depuis plus de 160 ans, nous cherchons à atteindre la perfection




À partir d'une seule source : l'inspection, la maintenance, la mise en service, la réparation et les pièces de rechange
Service rapide sur site, grâce aux centres de service dans le monde entier
Sécurité et fiabilité maximales avec les pièces


Évaluation et recommandations pour maximiser l'efficacité et prolonger la durée de vie




service-ca@aerzen.com Tél: +1 (450) 424-3966 www.aerzen.com/service






Représenté par:
Voici quelques-unes des mesures phares du Plan national de l’eau qui permettront de répondre à différents enjeux.
Depuis 2008, les connaissances sur la disponibilité et la vulnérabilité des eaux souterraines dans différentes régions du Québec ont progressé. Ce travail est appelé à se poursuivre dans le cadre du Plan national de l’eau (PNE). Trois nouveaux secteurs font l’objet de projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES).
Les données recueillies du côté de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Gaspésie-Matapédia et de Chisasibi enrichiront le portrait hydrogéologique de la province. Un travail qui vise, ultimement, à protéger les sources d’eau potable et à assurer une saine gestion de la ressource.
Ce type d’exercice a déjà été mené dans les autres régions du Québec méridional, et notamment aux Îles-de-la-Madeleine, rappelle Édith Bourque, ingénieure en hydrogéologie au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). « Il y avait une crainte particulière aux Îles, parce que c’est très touristique l’été », explique-t-elle.
Les données recueillies sur place ont permis de déterminer quelle quantité d’eau souterraine peut être exploitée, et à quels puits, pour éviter d’éventuels problèmes. Contrairement à d’autres localités québécoises, les Îles-de-laMadeleine n’ont que l’eau souterraine pour unique source d’eau potable.
À l’inverse, l’eau potable de la Communauté métropolitaine de Montréal provient surtout du fleuve Saint-Laurent. Certaines données y ont déjà été colligées, mais elles seront mises à jour dans le cadre des nouveaux PACES, explique Nadine Roy, également ingénieure en hydrogéologie au MELCCFP.
Le Réseau québécois sur les eaux souterraines veille par ailleurs à ce qu’un transfert des connaissances issues des données des PACES soit effectué vers les intervenants des municipalités, des organismes de bassins versants et autres acteurs de la filière eau.
Les municipalités disposent d’un tout nouvel outil pour favoriser la mise aux normes des installations d’eaux usées des résidences isolées : le Programme d’unités individuelles de traitement de l’eau (PUIT), lancé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
« C’est la première intervention du ministère pour des infrastructures qui ne sont pas municipales, donc directement chez les citoyens », souligne Catherine Verge-Ostiguy, directrice des infrastructures aux collectivités au MAMH.
Le PUIT vise à réduire la contamination de différentes sources d’eau potable à la fois de lacs, de rivières et d'eaux souterraines, souligne la cheffe d’équipe et responsable du programme, Anne-Lise Tremblay. « À la fois de lacs, de rivières et d’eaux souterraine », précise-t-elle.
Grâce au PUIT, les administrations municipales peuvent profiter d’une aide financière pour la réalisation de travaux de mise aux normes. Un premier appel de projets est d’ailleurs en cours. Les organismes municipaux ont jusqu’au 4 septembre 2025 pour déposer une demande dans l’un des deux volets prévus.
Annoncé avec un budget global de 80 millions de dollars, le programme suscite déjà un vif intérêt. « Les municipalités demandaient un programme d'aide depuis longtemps », note Mme Verge-Ostiguy.
Quelle sera la disponibilité de l’eau dans un climat appelé à changer ? Le MELCCFP collabore avec le Consortium Ouranos et des chercheurs universitaires, dans le cadre du projet QClim’Eau. L’objectif : documenter cet enjeu afin de concevoir de nouveaux outils pour adapter la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire aux réalités climatiques futures.
« Il y a déjà des endroits, des bassins versants, où on observe des enjeux de disponibilité, quand on compare les débits en rivière aux prélèvements effectués », Mme Roy.
Selon elle, le projet QClim’Eau et les autres mandats confiés à différentes universités permettront notamment de raffiner les indicateurs de disponibilité, y compris ceux liés aux eaux souterraines. Ces données sont précieuses, tant pour le ministère, lors de l’analyse des demandes d’autorisation de prélèvement d’eau, que pour les usagers, qui doivent planifier leur approvisionnement en eau dont les municipalités, les industries, la population et les producteurs agricoles, dit-elle.
« L’aménagement du territoire doit être cohérent avec la disponibilité des ressources en eau. Il s'agit par ailleurs d'une exigence des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, en vigueur depuis le 1er décembre dernier », fait valoir Mme Roy.
Figurant parmi les dix plus grands consommateurs d’eau au Québec, les papetières peuvent depuis peu profiter d’une aide financière du gouvernement pour adopter des moyens visant à réduire le volume d’eau utilisé dans leurs procédés industriels.
Lancé en mai 2025 par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), le Programme de réduction d’eau des papetières, une mesure inscrite dans le Plan national de l’eau, jouit d’un budget de 15 millions de dollars et s’échelonnera sur 3 ans.
L’aide peut se déployer en deux volets : réalisation d’études et mise en œuvre de projets d’investissement, tels que l’implantation de procédés ou de technologies et la mise en place de projets pilotes en usine. Le programme





piscines olympiques d’eau douce protégée.




Imaginez une piscine. Maintenant, multipliez-la par 38 000 — c’est le volume d’eau qu’AquaAction et les innovateurs en technologie de l’eau que nous avons lancés ont sauvé du gaspillage et de la pollution.

d’eau de lacs et rivières préservés du ruissellement de sel de voirie sauvée — grâce à la plateforme IA de Clean Nature.

d’eau de pluie et d’eau grise récupérées dans les bâtiments — grâce aux unités de recyclage d’eau d’Ecotime.

Nous donnons les moyens à une nouvelle génération d’innovateurs de transformer les idées en espoir. Aidez-nous à construire un avenir où l’eau est sécurisée

bit.ly/rejoindre-aquaaction





couvre 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le premier volet et d’un million de dollars pour le deuxième.
« Pour être admissibles, les projets doivent présenter un potentiel de réduction d’au moins 5 % de la consommation d’eau », souligne Maxime Arseneault, conseiller en développement industriel au MRNF.
« Ce pourcentage peut sembler faible, mais il représente quand même plusieurs millions de gallons par année, précise André Auger, spécialiste sectoriel pour les pâtes, papiers et dérivés au MRNF. Des gestes sont déjà posés par les papetières. Ça permet de continuer les efforts, d’aller plus loin. »
Ce programme s’inscrit dans la foulée de la hausse du taux de la redevance versée par les papetières pour l’utilisation de l’eau, souligne M. Auger. Le soutien financier offert vise à préserver leur compétitivité.
Les projets soumis seront analysés par un comité dès leur réception, selon les critères établis, laisse savoir Maxime Arseneault. n
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PLAN NATIONAL DE L’EAU
= Assurer une eau de qualité à la population
= Protéger et restaurer les milieux aquatiques
= Prévenir et gérer les risques liés à l’eau
= Miser sur le potentiel économique de l’eau
= Promouvoir une utilisation durable de l’eau
= Acquérir et partager les meilleures pratiques
= Assurer et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau
= Ensemble d'actions à l'intention des Premières Nations et Inuit

Le Plan national de l’eau : une richesse collective à préserver est accompagné, pour son déploiement, d’un budget de 500 millions de dollars, provenant en partie du nouveau Fonds bleu.
Reprenez le contrôle avec Nerri. i z Si Reprene e co li trôôle a ev ôle ont ec c N Ne t rri. ec Ner ti S d mp es s e
Nerri municipa e a z v eaux u us s e est t u p rééeel t appppliccati i l s ty mps réel tous les type
N de ri m muunnicci r e d t p de gérer en te
al est une application
fleexxibble e q e s syst voous s m es de systèmes
flexible qui vous perm ioon n st et met se ti érreer ques r réssid
Au b buurre e septiques résid
Au burea ps s r ntieelles s lees v vootre j u c coomme s suur r dentielles sous votre j au s d de ridicttion mes le e t teer in n e elll l juridiction. elle e v voou u us vous
comme sur le terrain, la vie.


FAAC C CIL L ACILIITE
CENTRALISE OPTIMISE



















Mathieu Laneuville Ing., M. Sc. A. Président-directeur général Réseau Environnement mlaneuville@reseau-environnement.com
Pratiques, les lingettes dites « jetables » sont de plus en plus présentes sur les tablettes des magasins. Derrière leur usage anodin se cachent pourtant de sérieuses conséquences pour nos infrastructures d’eau et nos écosystèmes.
Jetées dans les toilettes, les lingettes s’agglutinent, obstruent les pompes, bloquent les canalisations et finissent par faire déborder les égouts. Chaque année, elles causent pour 250 millions de dollars de dommages aux réseaux municipaux canadiens.
En plus de provoquer des déversements d’eaux usées dans l’environnement, ces lingettes contiennent du plastique et des agents chimiques qui laissent des traces durables dans les milieux aquatiques, contribuant à la pollution de l’eau par les microplastiques.
L’enjeu n’est pas seulement technique ou environnemental. Il est aussi sémantique : le flou entourant le mot « jetable » laisse place à des appellations trompeuses, laissant croire qu’on peut « flusher » la lingette souillée. Résultat : des produits sont commercialisés comme étant compatibles avec nos toilettes, alors que c’est tout le contraire.




Pour endiguer le problème, Réseau Environnement propose une démarche claire, fondée sur une logique de responsabilité collective et alignée sur les meilleures pratiques internationales.
Bien que l’abandon des lingettes jetables demeure l’option à privilégier, une solution de rechange peut être envisagée : l’adoption du principe des 4P – Pee, Poo, Paper et Proof. Ainsi, dans l’éventualité où des personnes souhaiteraient continuer d’en utiliser, seules les lingettes dont la capacité à se désintégrer de façon sécuritaire dans les systèmes d’égout a été démontrée devraient porter la mention « jetable dans la toilette ».
1.RECONNAISSANCE DES LOGOS DE L’IWSFG
Il est primordial d’établir un mode de financement qui prend en compte le coût intégral des services d’eau, incluant la maintenance et le renouvellement des infrastructures. Nous recommandons que les municipalités mettent en place des réserves financières consacrées aux infrastructures d’eau et des seuils minimums d’investissement pour financer le maintien d’actifs. Ainsi, on pourrait éviter les déficits à long terme et les paiements d’intérêts sur la dette contractée, lisser les revenus pour faire face aux pointes d’investissement sans surcharger les contribuables et garantir un financement prévisible et stable.
2.RÈGLEMENT QUÉBÉCOIS SUR L’ÉTIQUETAGE DES LINGETTES
Un encadrement normatif est proposé pour rendre obligatoire l’apposition de ces logos sur tous les paquets de lingettes vendus au Québec. Cette mesure viserait à mettre fin à la confusion actuelle et à offrir aux consommateurs une information fiable et clairement présentée.










3.MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Réseau Environnement recommande aux municipalités de modifier les règlements types sur l’assainissement afin qu’ils s’arriment avec la nouvelle réglementation québécoise. Étant les premières concernées, elles seraient ainsi mieux outillées pour prévenir les dommages.
4.CAMPAGNE D’ÉDUCATION NATIONALE
Le changement de comportement passe aussi par la sensibilisation. La campagne Pensez Bleu pourrait être bonifiée pour intégrer les logos de l’IWSFG, promouvoir l’approche des 4P et valoriser des solutions de rechange aux lingettes jetables dans le quotidien.
5.SOUTIEN À L’ÉLABORATION D’UNE NORME CANADIENNE DE « FLUSHABILITÉ »
Enfin, Réseau Environnement appuie la campagne de financement menée par l’Association canadienne des eaux potables et usées (ACEPU) pour élaborer une norme reconnue à l’échelle canadienne, assurant que seuls les produits réellement désintégrables puissent être commercialisés comme tels.
UN QUÉBEC PRÉCURSEUR
En misant sur l’adoption de la norme IWSFG et sur l’instauration d’un étiquetage réglementé, le Québec pourrait jouer un rôle de chef de file en Amérique du Nord. Ce serait une réponse pragmatique à un enjeu qui touche à la fois les finances municipales, la protection de l’environnement et la santé publique.


d’emploi

Cette initiative rejoindrait d’ailleurs les engagements du gouvernement québécois en matière de gouvernance de l’eau, notamment ceux du Plan national de l’eau. Elle s’inscrit également dans une logique d’équité : celle du principe du « pollueur-payeur », selon lequel les coûts liés à la gestion des nuisances devraient incomber aux producteurs, et non aux municipalités ou aux citoyens.
Les municipalités ne peuvent plus assumer seules les conséquences de l’élimination inadéquate de ces déchets issus de produits pourtant commercialisés librement. Nous devons mettre fin à une confusion nuisible qui persiste depuis trop longtemps. La norme et les recommandations proposées par Réseau Environnement sont à la fois réalistes, rigoureuses et porteuses de solutions concrètes à un problème dont les coûts financiers et environnementaux sont démesurés. Surtout, elles nous rappellent que chaque geste compte… jusqu’à celui, qu’on croit anodin, de tirer la chasse. n




60 000 visiteurs annuellement

RENTABILISEZ VOS INVESTISSEMENTS EN RECRUTEMENT



50 % moins cher que les sites généralistes
illimité
CONTACTEZ-NOUS %




Marc Didier Joseph Ing., DESS, M. Ing.
Directeur de projets
Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ)
CERIU
marc.didier.joseph@ceriu.qc.ca
Les infrastructures en eau représentent l’un des piliers essentiels du service public dans nos municipalités. Or, le plus récent bilan réalisé par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 1 met en évidence l’ampleur des travaux nécessaires pour maintenir ces réseaux en bon état. Entre vieillissement accéléré, pressions liées à l’urbanisation et effets des changements climatiques, la question de leur pérennité devient urgente et appelle une approche proactive.
UN IMPOSANT ACTIF À PRÉSERVER
Le Québec compte plus de 101 060 km de conduites souterraines destinées à l’eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales. À elles seules, les conduites d’eau potable représentent 57,7 milliards de dollars répartis sur 44 559 km, et celles destinées aux eaux usées totalisent 61 milliards pour 36 746 km. Le bilan du CERIU met en exergue l’existence de milliers d’ouvrages, tant pour l’eau potable (4 500 ouvrages) que pour les eaux usées et pluviales (5 982 ouvrages). Ces chiffres témoignent non seulement de l’envergure du réseau, mais aussi des investissements colossaux qui ont été consentis historiquement et qui doivent désormais être préservés pour les décennies à venir.
Le constat technique nous interpelle : avec un âge moyen de 42 ans, représentant 46 % de la durée de vie moyenne estimée à 92 ans, la majorité des infrastructures en eau se trouve dans une phase où l’entretien et le renouvellement s’avèrent indispensables. Le bilan révèle que la valeur totale de remplacement des infrastructures en eau atteint des montants impressionnants, soit près de 188,5 milliards de dollars en 2024. Le remplacement immédiat de l’ensemble des installations à risque élevé ou très élevé de défaillance demanderait un investissement de l’ordre de 19,3 milliards de dollars. Ces dernières, qui concernent en grande partie les conduites souterraines, nécessiteront une attention particulière de la part des gestionnaires municipaux.
Ces investissements massifs doivent être planifiés, ce qui implique la prise en compte de plusieurs paramètres : la disponibilité des ressources, la répartition géographique des actifs ainsi que la synchronisation nécessaire entre les différents intervenants, et ce, du niveau municipal aux instances provinciales. Le bilan 2024 nous rappelle que le temps presse et que seule une approche coordonnée, transparente et préventive permettra de garantir la capacité des municipalités de maintenir un service de qualité, aujourd’hui et pour les générations futures.
POURQUOI UNE PLANIFICATION À LONG TERME ?
Face à cet enjeu d’un réseau de plus en plus vétuste, mais aussi sollicité par l’urbanisation et les phénomènes climatiques extrêmes, il apparaît plus que jamais urgent de se positionner sur une voie proactive. L’entretien préventif, la priorisation des investissements en maintien d’actifs et le financement durable sont autant de leviers pour assurer la pérennité du service de l’eau. La mise en place d’un plan de gestion des actifs (PGA) s’impose donc comme un outil stratégique indispensable. Le guide du CERIU sur l’élaboration d’un plan de gestion d’actifs municipaux 2 montre que le PGA n’est pas simplement une formalité administrative ; il constitue la pierre

angulaire d’une démarche de gestion proactive, intégrée et fondée sur des données fiables. L’adoption d’un tel plan représente non seulement une réponse adaptée aux défis actuels, mais aussi un engagement pour une planification durable du maintien et du développement des infrastructures en eau pour satisfaire les besoins d’une population en constante évolution.
Compte tenu de l’ampleur des investissements requis, qu’il s’agisse de remplacer des infrastructures jugées en mauvais ou en très mauvais état ou de pallier des enjeux de performance, le PGA fournit un cadre méthodologique qui aide la municipalité à planifier et à budgétiser ses interventions de façon réaliste. Par exemple, en déterminant des coûts prévisionnels par phase du cycle de vie (acquisition, exploitation, entretien, renouvellement, disposition), la municipalité est en mesure de comparer ces dépenses aux budgets actuels et planifiés et, ainsi, de déceler rapidement les éventuels écarts. Ce constat permet de mieux communiquer ces enjeux aux décideurs et aux citoyens, d’ajuster la stratégie d’investissement ou de prioriser certaines interventions.
Au-delà des impératifs financiers et techniques, le PGA s’inscrit dans une vision plus large de durabilité et d’efficience. En traitant l’entretien et le renouvellement de manière systématique et en intégrant les variables du contexte (changements démographiques, évolutions technologiques, aléas climatiques), il permet d’éviter une dégradation accélérée des infrastructures, qui entraînerait des répercussions directes tant sur la qualité de service que sur la sécurité publique. Dans ce sens, la démarche promue par le guide du CERIU est un levier pour transformer une contrainte – celle d’un patrimoine vieillissant – en une occasion de modernisation et d’optimisation des investissements publics.
L’avenir des infrastructures en eau du Québec repose sur la capacité des municipalités à anticiper les défaillances et à investir intelligemment dans l’entretien et le renouvellement de leur réseau. En adoptant des plans de gestion d’actifs, elles se donnent les moyens de transformer un constat préoccupant en une avenue de modernisation durable et sécurisée.
Au-delà des chiffres et des outils, la gestion des infrastructures en eau relève d’un engagement collectif qui doit impliquer l’ensemble des acteurs concernés : administrations municipales, instances provinciales, organismes de financement et citoyens. La publication vulgarisée de plans de gestion d’actifs en eau ou, à plus haut niveau, d’un portrait des infrastructures municipales en eau, contribue à sensibiliser l’opinion publique à l’urgence des investissements préventifs. Cela permet également d’instaurer un dialogue entre les décideurs et les experts techniques pour définir des stratégies adaptées aux réalités locales. n
1 Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) (2024). Bilan 2024 du Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec (PIEMQ)
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/bilan-2024-du-portrait-infrastructures-eau-municipalites-duquebec-piemq
2 Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) (2024). Guide d'élaboration d'un plan de gestion d'actifs municipaux. https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/guide-elaboration-plan-gestion-actifs-municipaux

Installations au Québec : Sherbrooke, Mascouche-Terrebonne, Repentigny, Le Gardeur, Prévost, Ste-Marianne, L’Assomption, Magog, Ste-Sophie, L’Epiphanie, Asbestos, Ste-Julienne, St-Zotique, Valleyfield, RAEVR, St-Placid. + de 2 000 installations à travers le monde.

LClément Cartier Ing., Ph. D. Directeur des ventes
chez Brault Maxtech inc. clement.cartier@braultmaxtech.com

a filtration sur média filtrant est une étape essentielle dans la plupart des chaînes de traitement de l’eau potable. Elle réduit la turbidité en retenant les particules en suspension, comme les flocs résiduels après la décantation. C’est aussi une barrière importante contre les microorganismes, en particulier contre les protozoaires, dans une approche de barrières multiples.
FONCTIONNEMENT DES FILTRES À MATÉRIAUX GRANULAIRES
Dans un filtre gravitaire typique, la filtration s’effectue en faisant passer l’eau à travers une hauteur de média filtrant variant généralement entre 0,6 et 1,5 m, selon l’application. Le fond du filtre est équipé d’un système permettant de retenir le média tout en laissant passer l’eau. Il doit garantir une distribution uniforme de l’eau, tant en mode filtration qu’en mode lavage, et ce, en minimisant la perte de charge. Différentes approches sont utilisées, y compris le faux plancher avec buselures, ou encore des drains perforés déposés directement sur le plancher de béton. Ceux-ci ont comme avantage d’augmenter la hauteur disponible pour le média. Ils sont généralement fabriqués en acier inoxydable, un matériau plus résistant et durable.
La majorité des filtres à matériau granulaire fonctionnent selon un cycle standard, alternant une phase de filtration et un lavage du média filtrant. Ce processus cyclique est régi par différents paramètres, comme la perte de charge, la durée des cycles et la turbidité de l’eau filtrée.
LES DIFFÉRENTS MÉDIAS UTILISÉS POUR LA FILTRATION
Différents médias peuvent être utilisés dans le traitement de l’eau potable : le sable, l’anthracite, le grenat ou l’ilménite, le charbon actif en grain (CAG) et l'argile expansée. Le choix du média dépend de plusieurs critères : densité, dureté, diamètre des grains et fonction visée.
MÉDIA FILTRANT CARACTÉRISTIQUES ET FONCTION
Sable
Anthracite
Grenat ou ilménite
Charbon actif en grain
Argile expansée
• Le plus courant • Efficace et économique
• Surface poreuse • Bon rendement en surface
•Utilisés en fond de filtre pour leur grande densité
• Très poreux •Favorise la biomasse
•Capture les fines particules responsables des goûts et des odeurs et certains contaminants (ex. PFAS)
• Très poreux • Capture les fines particules
• Différentes applications possibles
LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
On distingue trois principaux types de configurations dans les systèmes de filtration :
= Les filtres à sable traditionnels utilisent un matériau à granulométrie uniforme. Ce type de filtre est généralement précédé d’une étape de floculation/décantation qui en évite le colmatage.
= Les filtres bicouches combinent une couche d’anthracite audessus d’une couche de sable. Très efficaces et compacts, ils permettent un taux de filtration élevé tout en assurant une bonne qualité de l’eau filtrée grâce au sable fin. Ces filtres sont très populaires au Québec. Une troisième couche composée de grenat ou d’ilménite peut aussi être ajoutée.
= Les filtres biologiques sont une variante des filtres bicouches utilisée en mode « biologique » dans laquelle l’anthracite est remplacé par du CAG. L’ajout d’ozone en amont du filtre rend la matière organique biodégradable accessible. Il est requis de prévoir un temps de contact suffisant dans le CAG pour que les bactéries s’y développent et consomment la matière organique, ce qui nécessite, dans certains cas, jusqu’à 1,2 m de hauteur de charbon.
LA FILTRATION 2.0
Afin d’améliorer les performances de filtration, différentes approches sont maintenant étudiées. Voici un aperçu de deux d’entre elles qui semblent prometteuses.
L’utilisation de l’argile expansée comme média filtrant
Déjà utilisée depuis des décennies en biofiltration, l’argile expansée gagne du terrain dans le domaine de l’eau potable en raison de sa grande porosité, qui augmente la surface de contact. Avec une dureté de 5,5 sur l’échelle de Mohs, elle offre une durée de vie pouvant atteindre 30 ans, supérieure à celle de l’anthracite.
Ce média permet de traiter de plus grands volumes d’eau à travers un même filtre, retenant plus de matières dans ses pores sans pour autant se colmater. Cet avantage peut être mis à profit de deux façons : en augmentant la vitesse de filtration ou en réduisant la fréquence de lavage. Dans les deux cas, la productivité est accrue.
Les usines remplaçant leurs médias filtrants par de l’argile expansée peuvent ainsi augmenter leur production sans avoir à agrandir leurs installations existantes. L’argile expansée peut aussi être utilisée en filtration biologique, sa porosité étant adaptée à la croissance de la biomasse nécessaire à la biodégradation de la matière organique.
La modification des médias pour en améliorer la capacité d’adsorption
Une approche au stade expérimental consiste à transformer des médias inertes, comme le sable, pour améliorer la capacité d’adsorption de composantes très spécifiques, comme les PFAS ou les pesticides.
Cette application est prometteuse, parce que peu de procédés actuels peuvent être utilisés pour traiter efficacement ces contaminants. Ceux qui le permettent nécessitent des technologies coûteuses, comme l’adsorption avec charbon actif ou l’oxydation avancée. Toutefois, ces médias modifiés doivent encore faire leurs preuves à long terme sur le plan de la durabilité.
DES INNOVATIONS À SURVEILLER
La filtration de l’eau sur média granulaire est un traitement fiable reconnu depuis des millénaires. Grâce aux nouvelles technologies, de nouveaux médias permettent d’augmenter les performances des filtres, tout en réduisant les coûts en infrastructures. D’autres percées dans le domaine sont également à venir. Reste à voir à quel rythme ces innovations seront considérées au Québec. n


LMe Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com
e 17 septembre 2024, à l’occasion du Forum d’action sur l’eau, le gouvernement du Québec a rendu public son Plan national de l’eau (ci-après le « Plan national »), qui vise notamment à maintenir une eau de qualité, à protéger et à restaurer les milieux aquatiques ainsi qu’à mieux prévenir les risques liés à l’eau 1. Nous soulignons, dans le présent texte, les principales modifications réglementaires annoncées dans ce plan.
Afin d’assurer une eau potable de meilleure qualité pour la population, le Plan national souligne que l’assainissement des eaux usées et le contrôle des contaminants provenant des activités agricoles et industrielles doivent être améliorés. La mesure 1.5 du Plan national annonce déjà la modernisation à venir du Règlement sur les exploitations agricoles2
Entré en vigueur le 15 juin 2002, ce règlement « a pour objet d’assurer la protection de l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités agricoles 3 ». Plus particulièrement, il cherche à prévenir la contamination des eaux par les éléments fertilisants et les pathogènes pouvant se trouver sur les terres agricoles.
Le Plan national prévoit la tenue d’ateliers de cocréation réunissant des représentantes et représentants des milieux agricole, municipal et environnemental ainsi que des communautés autochtones afin de contribuer à cette modernisation. Des tournées d’information, la diffusion de contenus explicatifs et l’élaboration d’un guide de référence sont déjà prévues pour que les entreprises agricoles, agronomes et autres parties prenantes soient informés des changements à venir.
Aucune modification précise du Règlement sur les exploitations agricoles n’a été annoncée, si ce n’est qu’il devra tenir compte des nouvelles activités agricoles et des pratiques agroenvironnementales modernes. Sans plus d’information, on peut tout de même avancer l’hypothèse que les modifications cibleront principalement la gestion des distances minimales et des interfaces entre les activités agricoles et les cours d’eau ou les ouvrages de prélèvement de l’eau ainsi que l’encadrement des pratiques d’entreposage et d’épandage, susceptibles de libérer d’importantes quantités de nutriments (phosphore, azote, etc.) vers les cours d’eau.
Ces modifications seront complémentaires à la nouvelle exigence introduite par le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications
apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, qui interdit la culture dans un cours d’eau et dans une bande de trois mètres autour de celui-ci 4
Depuis le dévoilement du Plan national, quelques modifications ciblées ont été apportées au Règlement sur les exploitations agricoles5, mais les travaux de modernisation dont il fera l’objet devraient plutôt se terminer en 2026, puisqu’ils impliquent une large concertation et un exercice de cocréation exhaustif 6 .
LA GESTION DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES
Une modernisation de l’encadrement réglementaire relatif à la gestion des eaux usées des résidences isolées est également prévue à la mesure 1.3 du Plan national, dans le but d’améliorer la qualité des eaux usées domestiques issues de ces résidences et déversées dans l’environnement.
Le principal outil réglementaire sur ce sujet est le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 7 (ci-après « RETEURI »), qui établit les normes applicables aux systèmes de traitement, éléments épurateurs et autres ouvrages permettant le traitement des eaux usées domestiques provenant de ces résidences. On comprend que de nouvelles modifications seront apportées, en concertation avec le milieu municipal. Rappelons en effet que l’application de ce règlement relève à la fois des municipalités et du gouvernement provincial.
Depuis son adoption en 1981, le RETEURI a été modifié à maintes reprises, notamment en 2014, afin d’introduire de nouvelles normes de localisation des systèmes de traitement des eaux par rapport aux installations de prélèvement d’eau 8. Le type de modification aujourd’hui prévu par le Plan national n’est pas précisé. Toutefois, nous pouvons anticiper qu’elles viseront à renforcer le contrôle de l’application du règlement, à améliorer les performances des techniques d’épuration et, possiblement, à revoir les distances minimales à respecter entre les systèmes de traitement et les installations de prélèvement d’eau ou les cours d’eau.
UN CHANGEMENT D’APPROCHE POUR UNE
ACTION ÉLARGIE
À travers les modifications réglementaires annoncées, on voit une intention du gouvernement d’élargir son champ d’intervention à l’ensemble des sources de contamination des eaux. Alors qu’il s’est longtemps concentré sur les grands émetteurs municipaux et industriels, notamment par l’entremise de règlements sectoriels et du programme d’attestation d’assainissement des usines de traitement des eaux municipales, le nouveau Plan national marque un tournant. Il affirme que le maintien de la qualité de l’eau au Québec repose désormais sur les actions concertées de tous les acteurs, à toutes les échelles : l’agriculteur, le propriétaire d’une résidence, la grande industrie et la municipalité. n
1 Cabinet du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. (2024, 17 septembre). Dévoilement du Plan national de l’eau : une richesse collective à préserver – 500 M$ pour protéger notre eau au Québec https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/devoilement-du-plan-national-de-leau-une-richesse-collective-a-preserver-500-m-pour-proteger-notre-eau-au-quebec-58291
2 RLRQ, c. Q-2, r. 26.
3 Id., art. 1.
4 RLRQ, c. Q-2, r. 32.2, art. 82 à 92.
5 Décrets 190-2025 et 472-2025.
6 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. (2025). Plan national de l’eau : une richesse collective à préserver – Reddition de comptes annuelle – Bilan 2023-2024. https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/reddition-comptes-2023-2024-plan-action-SQE.pdf
7 RLRQ, c. Q-2, r. 22.
8 Règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Décret 698-2014, Gazette officielle du Québec. II, 30 juillet 2014, p. 2760.
magazinesource.cc




Pour la réalisation de toutes vos vidéos
