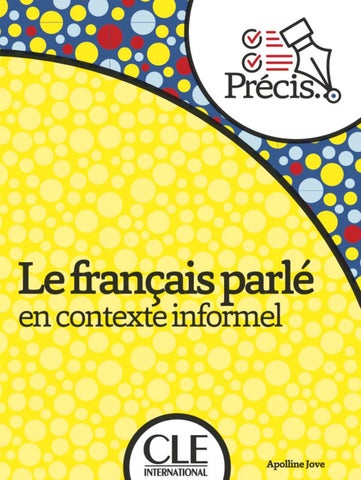Le françaisparlé
Apolline Jove
Les anglicismes : l’anglais, mais à la française
Directrice éditoriale : Béatrice Rego
Édition : Virginie Poitrasson
Marketing : Thierry Lucas
Conception et réalisation couverture : Miz’enpage
Conception maquette : Dagmar Starhinger
Mise en pages : Domino
© CLE International, SEJER, dépôt légal : juin 2025
ISBN : 9782090398267
AVANT–PROPOS
Le français parlé, c’est un truc de ouf* !
Le Précis du Français Parlé est tout particulièrement destiné aux étudiants de français langue étrangère. C’est un petit guide pratique (un bouquin* !) pour les étrangers qui veulent comprendre un peu mieux les Français quand ils parlent, car sinon il faut bien admettre que c’est compliqué (c’est galère* !).
L’objectif de ce précis est de leur faire découvrir, comprendre et apprendre les mots et expressions que les Français utilisent dans leurs conversations quotidiennes, ces mots et expressions de tous les jours, courantes et familières, d’un registre de langue informel, qui, justement, ne sont pas enseignés dans les manuels de français langue étrangère.
Cet ouvrage réunit plus de 1600 mots et expressions du français parlé les plus fréquentes. Ces mots sont ceux qu’on entend dans la rue, dans les trains, dans les conversations entre amis, au bureau entre collègues, dans la bouche des jeunes et des moins jeunes. Pour que ce Précis soit le plus utile et efficace possible, et compte tenu de l’inventivité constante des Français dans ce domaine, il a fallu opérer une sélection et seules les expressions les plus installées ont été retenues.
La première partie du Français parlé consiste en une présentation de certaines formes du français parlé : les contractions à l’oral, les sigles, acronymes et abréviations, les anglicismes, le verlan, les insultes et le langage sexuel, non pas pour réutiliser tous ces mots, mais pour les comprendre, car ils sont souvent présents dans les échanges à l’oral.
Dans la deuxième partie, les mots et expressions sont classés par thèmes (parler de soi, décrire quelqu’un, le monde extérieur, etc.) pour en faciliter le repérage et la mémorisation. Chaque thème propose plusieurs expressions, un exemple en contexte et, si né cessaire, une note explicative apportant pré cisions et nuances.
Les expressions peuvent être accompagnées des précisions suivantes :
• (abréviation) : pour les mots raccourcis , les sigles ou les acronymes.. Par exemple « hosto » pour « hôpital » ou « impec » pour « impeccable ».
• (jeune) : pour les expressions récentes, employées surtout par les plus jeunes.
• (vulgaire) : pour les expressions grossières, choquantes et parfois obscènes qu’il peut être utile de comprendre mais qu’il est conseillé de ne pas utiliser. Ces expressions ne se trouvent généralement pas à l’écrit.
• (anglicisme) : pour les mots tirés de la langue anglaise repris en français ou un peu modifiés pour créer un verbe ou un nouveau mot. La prononciation est généralement la même que le mot anglais.
• (verlan) : pour les mots appartenant au langage « verlan », c’est–à–dire un langage qui inverse les syllabes d’un mot pour en créer un nouveau, qui semblera alors plus moderne ou qui prendra parfois un sens différent (par exemple « chanmé », verlan du mot « méchant », qui prendra le sens de « bien », « incroyable »).
• (prononcé « …. ») : pour indiquer la prononciation de certaines expressions, quand celle–ci ne semble pas évidente, notamment pour les termes en verlan.
L’orthographe de certains mots est variable. En effet, ces mots ne sont pas tous rentrés dans le dictionnaire et ils sont essentiellement utilisés à l’oral et non à l’écrit. Par exemple, on peut trouver : « une tafe de cigarette », « une taf de cigarette » ou encore « une taffe de cigarette » (= une bouffée de cigarette).
Enfin, un index répertorie par ordre alphabétique les mots présentés dans cet ouvrage, ainsi que les expressions qui leur sont liées. Par exemple, sous le mot « photo » classé à P, on trouvera l’expression « y a pas photo ».
q À savoir avant de parler comme un(e) Français(e) ! q
Ce Précis du Français Parlé est un outil conçu pour comprendre le langage utilisé dans des contextes informels entre amis, collègues, en famille, dans la rue, au café, ou à la maison. Il vous permettra de décoder les échanges entre Français dans leurs moments de détente et de convivialité !
Cependant, ce n’est pas un vocabulaire à utiliser lors d’un entretien d’embauche, pour une démarche administrative, ou lorsque vous vous adressez à quelqu’un que vous ne connaissez pas ou dans des situations formelles. En bref, c’est du français de la vraie vie… mais pas pour les situations « sérieuses » !
L’ART
DE LA
CONVERSATION EN FRANÇAIS : ENTRE HUMOUR, DÉBAT ET SPECTACLE
En France, les conversations de groupe sont dynamiques et rapides. Les Français aiment rebondir sur ce que disent les autres et se couper la parole. Cela peut être difficile à suivre pour un étranger, et parfois même sembler fatiguant et agressif. Il s’agit en fait d’une sorte de jeu où chacun peut participer et trouver sa place.
L’humour dans les conversations
Les Français adorent l’humour. Ils font souvent des blagues rapides ou des jeux de mots.
Exemple : — J’ai fait du sport ce matin… — Ah, la sieste, c’est du sport maintenant ?
Les débats
Les Français aiment discuter et se contredire. Ils apprécient échanger des idées, enrichir la conversation et entendre différents points de vue.
— De toute façon, le cinéma, c’était mieux avant. — Ah non, tu rigoles ? On n’a jamais eu autant de diversité dans les films ! — Justement, trop de choix tue le choix.
Le débat n’a pas besoin de conclusion, il est un jeu en soi, et tout le monde peut intervenir à n’importe quel moment.
Des conversations rapides et rythmées
Les conversations sont rapides. Les gens se coupent souvent la parole. Ce n’est pas impoli, c’est juste le rythme naturel de la discussion. Il faut être réactif et garder la conversation vivante. Le mot “D’ailleurs…” sert souvent à garder le fil d’un sujet dans une conversation.
Exemple : — Tu sais, l’autre jour, j’ai vu un truc dingue… — Attends, en parlant de dingue, vous avez vu cette vidéo sur les robots ? — Ah ouais, et d’ailleurs, l’intelligence artificielle, ça me fait flipper !
En tête–à–tête : plus calme
Quand les Français parlent en tête à tête, ils sont plus calmes et parlent de sujets personnels ou de leurs émotions, sans chercher à faire rire. Ces moments sont souvent plus sérieux et permettent de mieux se connaître.
Parler de soi et de ses émotions
Les Français aiment partager leurs émotions. Parler de ses sentiments est un bon moyen de commencer une conversation et de se connecter avec les autres. C’est aussi un moyen de se montrer humain et sincère. Par exemple, dire « Je suis vraiment stressé en ce moment » peut ouvrir la porte à une discussion plus profonde.
Le langage familier
Les Français utilisent un vocabulaire très familier, voire vulgaire, uniquement entre eux, avec leurs amis ou proches. Par exemple, ils peuvent dire « c’est chiant » ou « arrête de déconner » dans des conversations informelles. Cependant, avec des inconnus, ils sont paradoxalement très polis. Si quelqu’un coupe dans une file d’attente, au lieu de dire « Arrête de gruger toi ! », un Français dira plutôt « Excusez–moi, la queue est là, nous étions avant vous, je crois ». Cette politesse avec les inconnus contraste fortement avec la manière plus directe et décontractée de s’exprimer entre amis.
LES CONTRACTIONS EN FRANÇAIS : PARLER VITE, PARLER FLUIDE !
Si le français écrit suit des règles bien définies, le français parlé, lui, prend des raccourcis. Et ces raccourcis, ce sont les contractions ! Elles permettent d’accélérer le rythme, d’enchaîner les idées sans ralentir, et surtout, de rendre la conversation plus naturelle et vivante.
1. Le «e» muet : La première victime !
Le premier élément qui disparaît dans une phrase, c’est souvent le son « e ». Il est supprimé lorsqu’il est entouré de sons plus forts, ce qui accélère la parole et évite les pauses inutiles.
Quelques cas courants :
• Je veux g « J’veux »
• Je sais g « J’sais » (prononcé « chais »)
• Je suis g « J’suis » (prononcé « chui »)
• Tu fais quoi ce soir ? g « Tu fais quoi c’soir ? »
• Tout de suite g « Tout’d’suite ! »
• Tu vas venir ce week–end ? g « Tu vas v’nir c’week–end ? »
• Je peux enlever ce truc ? g « J’peux enl’ver c’truc ? »
P Règle à retenir : On peut enlever le « e » dans presque tous les cas, sauf s’il est entouré de trois consonnes, car cela rendrait la prononciation trop difficile. Exemple : dans vendredi, le « e » est entouré de « d, r, d », donc on ne peut pas dire « vendr’di ».
2. Les mots supprimés : « Ne »
En plus des contractions, les Français suppriment souvent certains mots, jugés trop longs ou inutiles à l’oral.
Le « ne » disparaît presque toujours dans la négation :
• Je ne sais pas g « J’sais pas »
• Il ne veut pas venir g « Y veut pas venir »
• Ça ne va pas g « Ça va pas »
3. Les sons qui disparaissent
« Il » et « Elle » sont souvent réduits à « Y » et « E »
• Il y a du monde g « Y a du monde »
• Il m’a vu g « Y m’a vu »
• Elle m’a dit au revoir g « E m’a dit au revoir »
• Ils m’en veulent g « I m’en veulent »
• Elles sont là g « E sont là »
Autres sons qui disparaissent :
• Si tu veux g « S’tu veux »
• S’il te plaît g « S’te plaît »
• Peut–être g « P’tète »
• Il va venir ce week–end g « Y va v’nir ce week–end »
• C’est votre chien ? g « C’est vot’ chien ? »
• On va où déjà ? g « On va où d’jà ? »
• C’est ton frère ? g « C’ton frère ? »
• Tu es d’accord ? g « T’es d’accord ? »
4. Exemple de conversation ultra–naturelle ! Voici un petit dialogue où les contractions sont omniprésentes. Essayez de le lire à voix haute pour capter le rythme naturel du français parlé !
— T’as vu Léo récemment ? (Tu as vu Léo récemment ?)
— Ouais, j’l’ai croisé hier, y bossait c’soir. (Oui, je l’ai croisé hier, il travaille ce soir.)
— Ah ouais ? Y fait quoi d’jà ? (Ah oui ? Il fait quoi déjà ?)
— J’sais pas trop, un truc en informatique j’crois. (Je ne sais pas trop, un truc en informatique, je crois.)
— D’ailleurs, t’as vu y a Claire qui fête son anniv c’weekend ! (D’ailleurs, tu as vu, il y a Claire qui fête son anniversaire ce weekend !)
— Ouais mais j’suis pas sûr de v’nir, faut qu’j’voie... J’suis claqué en c’moment. (Oui mais je ne suis pas sûr de venir, il faut que je voie... Je suis fatigué en ce moment.)
— Oh ce s’rait nul si t’es pas là ! Ça s’ra cool j’pense ! (Oh, ce serait nul si tu n’es pas là ! Ça sera cool je pense !)
— Ouais, vas–y, j’te dirai ! (Oui, vas–y, je te dirai !)
5. Pourquoi toutes ces contractions ?
Les Français aiment une conversation fluide et dynamique. Supprimer certains sons ou mots permet d’accélérer le rythme et de garder un échange vivant, sans pause ni hésitation. C’est une adaptation naturelle de la langue à l’oral, qui favorise la spontanéité.
P Astuce pour mieux comprendre : Écoutez attentivement les phrases et entraînez–vous à repérer ces contractions. Une fois qu’on les connaît, elles deviennent beaucoup plus faciles à suivre !
SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS :
L’ART DE RACCOURCIR LES MOTS !
Les Français adorent raccourcir leurs mots. Que ce soit par flemme, par habitude ou pour rendre la conversation plus fluide, ils utilisent en permanence des sigles, des acronymes et des abréviations. Et si tu veux comprendre leurs messages (surtout les textos !), mieux vaut t’y habituer !
1. Les sigles : chaque lettre compte
Les sigles sont des abréviations formées par les initiales de plusieurs mots. Mais attention, ils se prononcent lettre par lettre !
Quelques sigles courants :
• SVP (S’il vous plaît) g prononcé « S–V–P »
• VO (Version originale) g « V–O »
• MDR (Mort de rire) g « M–D–R »
• BG (Beau gosse) g « B–G »
• CV (Curriculum vitae) g “ C–V”
• DUT (Diplôme universitaire de technologie) g « D–U–T »
2. Les acronymes : des sigles qui deviennent des mots
Contrairement aux sigles, les acronymes se lisent comme un mot normal. On ne prononce pas chaque lettre séparément.
Quelques acronymes :
• La CAF (Caisse d’allocations familiales) g prononcé « kaf »
• Le SAMU (Service d’aide médicale urgente) g prononcé « samu »
• Un IBAN (International Bank Account Number) g prononcé « ibane »
P Astuce : En général, si un sigle peut être lu comme un mot, il devient un acronyme !
3. Les abréviations : quand les mots se raccourcissent
Les Français adorent couper les mots pour aller plus vite. On garde souvent la première syllabe ou les premières lettres, et le sens reste parfaitement clair !
Quelques incontournables :
• Perso (Personnellement)
• Sympa (Sympathique)
• Un coloc (Un colocataire)
• La déco (La décoration)
• Dispo (Disponible)
• Dégueu (Dégueulasse)
• L’exam (L’examen)
• Le prof (Le professeur)
• Le p’tit déj (Le petit déjeuner)
• Le ciné (Le cinéma)
• La pub (La publicité)
• La muscu (La musculation)
• L’anniv (L’anniversaire)
• Les infos (Les informations)
• La télé (La télévision)
• L’ordi (L’ordinateur)
P Bon à savoir : Ce phénomène est très courant à l’oral et dans les conversations informelles.
4. Les abréviations avec une touche en plus !
Certains mots raccourcis prennent un suffixe, souvent en «–os », pour ajouter une nuance péjorative ou amplificatrice
Quelques mots en -os :
• Gratos (Gratuit) g Cela amplifie l’idée de la gratuité et montre l’enthousiasme ou l’excitation liée à quelque chose qui est offert sans contrepartie.
• Calmos (Calme) g Une façon plus douce et plus gentille de dire à quelqu’un de se calmer, comme un petit rappel mignon sans trop de pression.
• Rapidos (Rapide) g L’ajout du suffixe donne une dimension plus légère et amusante au mot, comme pour rendre la rapidité moins stressante.
LES ANGLICISMES : L’ANGLAIS, MAIS À LA FRANÇAISE !
Les Français aiment les mots anglais, et ça se ressent dans leur quotidien. Que ce soit à travers les films, la musique, les jeux vidéo ou même l’actualité, l’anglais est omniprésent. Résultat ? Les Français se l’approprient à leur manière, avec parfois une petite touche personnelle.
1. Des mots anglais devenus presque français
Certains mots anglais sont tellement utilisés qu’ils font désormais partie intégrante de la langue française.
Quelques mots intégrés :
• Un burn–out
• Les fake news
• Un feedback
• Un flirt
• Un date
• Yolo (You Only Live Once)
• La Fomo (Fear Of Missing Out)
• Un sex friend
• Easy
2. Quand les anglicismes deviennent des verbes et des adjectifs
Les Français adorent aussi transformer des mots anglais en verbes ou en adjectifs, ce qui donne des expressions assez… créatives !
Quelques verbes et adjectifs anglophones :
• Dater (de « to date »)
• Flirter (de « to flirt »)
• Overbooké (de « overbooked »)
• Bader (de « bad »)
• Switcher (de « to switch »)
• Bugger (de « to bug »)
• Troller (de « to troll »)
• Clasher (de « to clash »)
• Se fighter (de “to fight”)
• Racketter (de « to racket »)
• Speeder (de « to speed »)
3. Des expressions anglo–françaises un peu détournées
Les expressions anglaises se faufilent aussi dans le vocabulaire français, parfois en prenant un sens un peu différent de l’original. Elles sont parfaites pour exprimer une idée de façon plus fun ou décalée !
Quelques expressions populaires avec leur sens :
• Allez go = Allez, on y va
• C’est hardcore = C’est difficile
• Je suis dead = Je suis fatigué
• Random = Au hasard
• Partir en live = Dégénérer
• Faire un before = Faire une soirée d’avant–soirée
4. La prononciation : un anglais francisé
La prononciation des anglicismes peut varier. Mais généralement ils sont prononcés dans un anglais francisé.
Quelques mots très fréquents :
• Un hot–dog : prononcé « ote–dogue » (à la française)
• Le web : prononcé « ouèbe » (à la française)
• Un week–end : prononcé « ouikènde » (à la française)
• Un smartphone : prononcé « smartfone » (à la française)
• Un date : prononcé « dèyt » (à l’anglaise)
• Un feedback : prononcé « fide–back » (à la française)
• Un hamburger : prononcé « am–beur–gueur » (à la française)
LE VERLAN : L’INVERSION QUI FAIT FUREUR !
Le verlan, c’est un peu l’art de jouer avec les mots en les retournant à l’envers ! Né dans les années 1960 dans les milieux populaires et ouvriers, il puise ses racines dans les prisons du 19e siècle. Mais c’est surtout à partir des années 2000, avec l’explosion du rap, de la pop et du cinéma, que le verlan a conquis toutes les couches sociales en France. Aujourd’hui, c’est un véritable phénomène de langage utilisé par tous, souvent sans même s’en rendre compte. Des mots comme « ouf », « meuf », « relou », « chelou », et « véner » font désormais partie du vocabulaire courant.
1. Comment on fait du verlan ?
L’idée est simple : on inverse les syllabes des mots !
Quelques mots courants :
• Perdu g Duper (on inverse les syllabes « per » et « du »)
• Femme g Meuf (on décompose le mot « femme » en deux syllabes : « fa » et « meu » qui deviennent « meufa » puis « meuf »)
• Mère g Reum (encore une inversion de syllabes : « mè–reu » devient « reu–mè » puis « reum »)
P Le verlan permet donc de simplifier des mots à une seule syllabe, s’inscrivant dans cette volonté typiquement française de raccourcir et fluidifier les échanges.
2. Le verlan à l’oral et à l’écrit
Le verlan est un langage avant tout parlé. Mais à l’écrit, il est souvent simplifié pour ne garder que l’essentiel, c’est–à–dire les sons ! Parfois, le mot en verlan est écrit de différentes manières selon les gens, et sa prononciation peut être assez différente de l’orthographe.
Quelques différences :
• Duper (prononcé : « dupère »)
• Véner / vener / vénère (prononcé : « vénère »)
• Oim / wam (prononcé : « oime »)
• Sonneper / sonne–per (prononcé : « sonne–père »)
3. Une conversation naturelle en verlan :
— Tu sais comment monter ce meuble ? (Tu sais comment monter ce meuble ?)
— Non, j’sais ap ! Y a pas une notice ? (Non, je ne sais pas ! Il n’y a pas une notice ?)
— Bah... j’crois pas ! (Bah... je ne crois pas !)
— Ça va être auch... (Ça va être chaud...)
— Ouais, j’suis duper ! J’vais appeler mon reup sinon, p’tète qu’il pourra m’aider ! (Oui, je suis perdu ! Je vais appeler mon père sinon, peut–être qu’il pourra m’aider !)
— Ah ouais de ouf, fais ça comme aç ! (Ah ouais de fou, fais ça comme ça !)
— En tout cas il est chanmé ce meuble, tu trouves pas ? (En tout cas, ce meuble est méchant (stylé), tu ne trouves pas ?)
— Ouais grave ! J’kiffe ! (Oui, carrément ! J’adore !)
Le verlan, c’est bien plus qu’un simple jeu de mots. C’est un moyen d’expression populaire, ludique et un peu rebelle, qui a traversé les générations et reste super vivant dans le langage quotidien des Français. Alors, prêt à inverser un peu les règles du langage ?
LES INSULTES EN FRANÇAIS : DE LA MOQUERIE LÉGÈRE À LA VULGARITÉ TOTALE
L’insulte fait partie du langage, mais bien sûr, elle ne doit jamais être utilisée pour blesser. L’important ici, c’est de comprendre les niveaux d’intensité des insultes en français, car ça peut être utile si vous en entendez. À partir du niveau 2 et 3, on tombe dans le très vulgaire, à éviter si vous ne voulez pas créer de conflits !
Niveau 1 : Insultes légères (pas vulgaire, mais embêtantes)
Ces insultes sont surtout utilisées pour embêter quelqu’un de manière légère, sans être vraiment méchant. Plutôt à prendre à la rigolade !
• Banane / Patate / Andouille : pour quelqu’un qui n’a pas compris, qui a fait une erreur ou agi de façon stupide.
• Mauviette : pour qualifier quelqu’un qui manque de courage.
• Zigoto : pour quelqu’un qui a fait une ânerie.
• Saligaud : pour un homme qui a fait quelque chose de répréhensible.
• Tête de nœud : pour une personne que l’on trouve particulièrement bête.
Niveau 2 : Insultes vulgaires (un peu plus salées)
Là, ça commence à être plus sérieux. Ce sont des insultes qui peuvent vraiment être blessantes, et on les utilise souvent pour exprimer une certaine frustration. À éviter dans les discussions amicales !
• Abruti ! / Abrutie ! / Imbécile ! : Insultes classiques pour traiter quelqu’un de stupide.
• Cassos ! : Utilisé pour qualifier quelqu’un qui est un peu à l’écart ou qui n’a pas une vie très active.
• Bouffon ! / Bouffonne ! : Pour qualifier quelqu’un de ridicule ou qui fait des bêtises.
• Tocard ! / Tocarde ! : Désigne une personne maladroite, souvent utilisée pour rabaisser quelqu’un.
Si quelqu’un a agi de façon détestable :
• Enfoiré ! / Enfoirée ! : Qualifie une personne malhonnête, méchante.
• Petit merdeux ! Petite merdeuse ! / Petit con ! / Petite conne ! : Pour désigner quelqu’un de détestable, souvent utilisé pour un jeune qui fait des bêtises.
• Emmerdeur ! / Emmerdeuse ! : Une personne qui complique la vie des autres ou qui embête.
• Pétasse : Similaire à « emmerdeuse », mais encore plus vulgaire.
• Grognasse : Pour une femme bête, énervante ou pénible.
• Fumier ! : Pour un homme qui a agi de façon détestable.
Niveau 3 : Très vulgaire (attention ça peut vraiment blesser)
Ici, ça fait mal. Ces insultes sont extrêmement offensantes et sont à utiliser avec précaution, sinon vous risquez de créer de gros problèmes. Le genre de mots à éviter absolument, sauf si vous avez une grosse dispute (mais même dans ce cas, réfléchissez à deux fois).
• Sale con ! / Sale conne ! : Pour quelqu’un qu’on déteste après une grosse dispute.
• Connard ! / Connasse ! : Pour un homme qu’on déteste ou qui nous a manqué de respect.
• Gros con ! / Grosse conne ! : Idem, mais encore plus lourd.
• Petite merde ! : Pour rabaisser une personne qu’on déteste.
• Crevard ! / Crevarde ! : Qualifie une personne qui n’a pas la réaction attendue, qui montre un point de vue opposé au nôtre, qui nous énerve.
• Bâtard ! / Bâtarde ! : Très offensant, à dire seulement si vous voulez vraiment envenimer les choses.
• Salaud ! /Salope ! : Pour quelqu’un qui nous a beaucoup énervé, insulte utilisée dans des situations très intenses.
• Biatch ! (anglicisme) : Souvent utilisée pour traiter une femme de manière vulgaire.
• Enculé (de ta mère) ! : Très vulgaire et offensant, à dire seulement si vous voulez vraiment envenimer les choses.
Les expressions vulgaires amplifiées
Pour insulter plus fort, les Français utilisent des expressions amplifiées. Cela ajoute une dimension plus agressive à l’insulte, et certaines phrases peuvent être vraiment violentes. On peut utiliser des mots comme « espèce de », « sale », « bande de », ou même ajouter « va » à la fin pour accentuer l’agression.
Voici quelques exemples :
• Sale + insulte :
Sale con Sale merde Sale enfoiré
• Espèce de + insulte : Espèce de petit con Espèce de salaud Espèce de bâtard
• Bande de + insulte :
Bande de cons
Bande de salauds
Bande de fumiers
• Ajout de « va » à la fin de l’insulte : Bâtard va Enfoiré va
Les phrases d’insulte extrêmement vulgaires :
• Ferme ta gueule
• Ta gueule
• J’t’emmerde
• Tu m’emmerdes
• Va te faire foutre
• Va chier
• Va te faire voir
DIRE BONJOUR, AU REVOIR
• Coucou / salut : bonjour
« Salut ! Tu t’appelles comment ? »
• Wesh ! (jeune) : Salut ! Hey !
« Wesh, ça va bien ? »
• Yo ! (jeune) : salut ! bonjour !
« Yo ! Comment ça va ? »
• Ça va ou quoi ? : ça va bien ?
« Hey, ça va ou quoi ? – Ça va, ça va ! Et toi, quoi de neuf ? »
• La forme ? : ça va bien ?

« La forme ? – Écoute, on fait aller* ! Et toi ? » (*ça pourrait être mieux mais ça va)
• Ça roule ? : ça va ?
« – Tu vas bien ? – Oui, ça roule, et toi ? »
• Ça baigne ? : ça va ?
« – Ça baigne, t’es sûr ? Tu n’as pas l’air d’aller bien. – Non non tout baigne. »
• Tranquille ! : ça va bien !
« – Wesh salut, ça va ? – Ouais tranquille et toi ? »
• Check / check ça ! (jeune) : se taper la main pour se saluer ou pour célébrer quelque chose.
« On fait un check ? »
• Oh le vent ! : exprime une surprise ou agacement quand une personne ne répond pas à notre salut, comme un geste de bonjour ou un signe de tête
« – J’ai fait un signe de main à Marc, il m’a même pas répondu ! – Oh le vent ! Il t’a carrément ignoré ! »
• À toute ! (abréviation) : à tout à l’heure !
« – Bon, je dois y aller, à toute ! – À toute ! On se reparle plus tard ! »
• À t’à l’heure ! (abréviation) : à tout à l’heure !, à bientôt !
« Ouais salut, à t’à l’heure dans le train ! »
• Tchao ! : au revoir !
« – Bon, je dois filer, j’ai un rendez–vous ! On se voit demain ? – Oui, pas de souci ! Tchao ! »
• À un de ces quatre ! : on se voit bientôt !
« – Bon, ben on se voit bientôt ! – Oui, à un de ces quatre ! »
• À plus dans l’bus ! : au revoir ! (c’est une blague que l’on dit pour la rime entre « plus » et « bus »)
« Allez j’y vais. À plus dans l’bus ! »
DEMANDER DES NOUVELLES
• Quoi de beau ? : quelles sont les nouvelles dans ta vie ?
« – Quoi de beau en ce moment ? – Ben... je viens de booker* mes vacances au Danemark ! » (*réserver)
• Quoi de neuf ? : quelles sont les nouvelles dans ta vie ?
« – Alors, quoi de neuf ? – Pas grand–chose... toujours les mêmes problèmes au taf*… la routine quoi ! » (*au travail)
• C’est quoi les news ? : quelles sont les nouvelles dans ta vie ?
« – C’est quoi les news de ton côté ? – Ma fille est partie en Allemagne pour un mois pour son travail ! »
• Qu’est–ce que tu racontes (de beau) ? : quelles sont les nouvelles dans ta vie ?
« Bah dis donc, ça faisait longtemps !
Qu’est–ce que tu racontes de beau ?
– Oh tu sais, la vie… le boulot, les sorties... La base quoi ! »
• T’en es où ? : tu es à quelle étape de ta vie, de ton projet, de ta situation ?

« Alors, t’en es où avec ton projet ? – Pff, j’avance doucement, mais y’a encore du taf*… » (*travail)
• Comment ça se passe ? : ça se passe bien ? c’est comment ?
« Alors, ton nouveau taf, comment ça se passe ? – Franchement, c’est cool ! Bonne ambiance et pas trop de stress. J’ai du bol* ! » (*chance)
• C’était bien ? : comment c’était ? (concerne une activité qui est potentiellement positive)
« – Je suis allée voir un concert au Zénith samedi dernier. – C’était bien ? »
• Ça a été ? : ça s’est bien passé ? (concerne une activité qui est plutôt stressante ; marque un souci, une inquiétude pour l’autre)
« – J’ai eu une opération pour mes dents la semaine dernière. – Ça a été ? »
• Ça fait un bail ! : ça fait longtemps !
« Ça fait un bail que je t’ai pas vu dans le quartier ! Qu’est–ce que tu deviens ? »
• C’est quoi les bails ? (jeune) : quoi de neuf ? quels sont les projets, les plans ?
« Bon alors, c’est quoi les bails avec Caroline ? J’ai entendu dire qu’il y avait quelque chose entre vous. »
• Ça dit quoi ? (jeune) : comment ça va ? quoi de neuf ?
« – Hey, ça dit quoi ? – Ça dit que ça va bien ! Il fait beau, il fait chaud. »
• Être à la ramasse / à la masse : être en retard, être dépassé(e), être perdu(e)
« Je suis à la ramasse moi ! Je pensais que t’avais changé de travail mais en fait pas du tout ! »
• Être déphasé(e) : être déconnecté(e) de l’actualité, être un peu dérouté(e)
« Je suis déphasée, je ne regarde plus du tout les actualités depuis une semaine. »
PROPOSER UNE SORTIE
• Ça te dit ? : tu as envie ?
« – Ça te dit de venir au ciné avec moi ? – Oui avec plaisir ! » »
• Ça te branche ? : tu as envie ?
« – Est–ce que ça te branche de partir en Italie pour les vacances ? »
• T’es chaud(e) ? : tu es motivé(e) ? tu as envie ?
« T’es chaud d’aller à la piscine avec moi cet aprem ? »
• Vas–y on fait ça ! : ok d’accord, ça marche, faisons ça !
« – Ça te dit qu’on se fasse un petit resto ce soir ?
– Vas–y, on fait ça ! »
• J’ai hâte ! : je me réjouis !, je suis pressé(e) !
« J’ai hâte de te voir demain ! »
• Je suis trop pressé(e) ! : je me réjouis !,
je ne peux pas attendre !
« Je suis trop pressée d’être à noël ! »
• J’suis pas dispo (abréviation) : je ne suis pas disponible
« J’aimerais bien venir mais je suis pas dispo. »

• Je suis pris(e) : j’ai beaucoup de choses à faire, je suis occupé(e)
« Je suis prise lundi et mardi. »
• Tenir au courant : tenir informé
« Tu me tiendras au courant pour me dire si tu as eu le poste ou pas ! »
• Tenir au jus : tenir au courant, tenir informé
« On se tient au jus pour cette aprem ! Tu me diras à quelle heure tu es disponible pour un café ! »
• Se capter : s’appeler, prendre contact, se voir
« On se capte dans l’après–midi ou même plus tard ! »
• Se goupiller : s’organiser, se concevoir, se planifier
« Comment ça se goupille alors pour ce soir ? Quels sont les plans ? »
SITUER DANS LE TEMPS
• Le time (anglicisme) : le temps
« J’ai pas le time, je dois aller chez le médecin puis ramener mon fils de l’école. »
• Du mat’ (abréviation, prononcé « mate ») : du matin
« Je me suis réveillé à 4 h du mat’ pour aller à l’aéroport »
• La grasse mat’ (prononcé « mate ») : la grasse matinée
« Ce dimanche j’ai fait une sacrée grasse mat’ ! »
• L’aprèm (abréviation, prononcé « aprème ») : l’après–midi
« Je vais à mon cours de dessin cette aprèm. »
• Une plombe : une heure, longtemps, beaucoup de temps
« Putain je suis là depuis des plombes et ils m’ont toujours pas appelé ! C’est vraiment nul les urgences ! »
PRENDRE LA PAROLE
• Moi : personnellement
« – Je pense que je vais annuler ma réservation pour ce week–end. – Moi je ferais pas ça à ta place ! »
• Perso : personnellement
« – Perso, j’ai jamais aimé les films d’horreur. – Moi non plus. »
• D’ailleurs : en parlant de ça, au fait, sur le même sujet

« D’ailleurs en parlant de bouffe, on n’a pas réfléchi à notre menu encore ! »
• Tiens ! : introduit une pensée ou une envie qui vient d’émerger
« Tiens, je prendrais bien un café moi ! »
• Tu sais : moyen de créer une connexion ou de renforcer l’idée que ce qui va être dit est important ou personnel
« Attends je fais quoi là ? Je valide mon ticket ? Tu sais, moi j’ai jamais pris le bus !
– Ah c’est vrai ? Bah ouais tu valides ici. »
• Viens / Venez ! : utilisé comme une invitation ou une incitation à se joindre à l’action proposée
« – Tu sais où est son téléphone ? – Oui, mais viens on lui dit pas et on attend qu’il trouve ! »
• On dirait que : il semble que
« On dirait que le magasin n’est pas ouvert aujourd’hui ! »
• Wesh ! : Hé ! Mais !
« Wesh, tu fais quoi là ? »
MONTRER, ATTIRER L’ATTENTION
• Viens voir ! : viens, je vais te montrer quelque chose ! « Eh, viens voir ! – Quoi ? Qu’est–ce qu’il y a ? »
• Mate un peu ! / Mate ça ! : regarde ça !
« Mate un peu cette voiture de fou ! Elle doit coûter une fortune ! »
• Téma ! (jeune, verlan de « mate ») : regarde ça !
« Téma ! Elle a changé sa photo de profil sur Facebook ! »
• Askip (jeune, abréviation) : à ce qu’il parait
« Askip Brad Pitt il est à nouveau célib’*. » (*célibataire)


Le français parlé en contexte informel
Un guide malin pour les étudiants en français langue étrangère qui veulent enfin comprendre le français… comme il se parle vraiment . Parce que oui, entre contractions, verlan, et mots jamais vus dans les manuels, c’est souvent difficile (la galère !) de suivre une conversation !
Un précis utile et 100 % terrain pour survivre à la vraie vie en français et découvrir plus de 1600 mots et expressions courants du français parléceux qu’on entend partout : dans la rue, au travail (au taf), entre amis (entre potes), jeunes comme moins jeunes.
Première partie :
Décrypte les bases du français de tous les jours :
• contractions (« T’inquiète »)
• mots raccourcis (« anniv »)
• acronymes (« MDR », « SVP »)
• anglicismes (« cool », « fun »),
• verlan (« relou », « meuf »),
• insultes et langage cru (à comprendre, pas forcément à répéter).
Code éditeur : 225213
ISBN : 9782090398267
Apolline Jove 9 782090 398267
Deuxième partie :
Expressions classées par thème (se présenter, décrire quelqu’un, etc.), avec exemples, contextes et explications pour tout comprendre (piger) et mieux mémoriser.
Des petits bonus pour s’y retrouver :
• (abréviation): pour les mots raccourcis (« clim » pour « climatisation »)
• (jeune) : pour les expressions tendance
• (vulgaire) : à ne pas dire partout… mais utiles à comprendre