

BLUELINE



INTERVIEW VINCENT GABRIEL
Un monde incertain, avec Vincent Gabriel
DOSSIER
UNE DOSE D'OPTIMISME EN 2024
EURéparé
L'âge exponentiel : Une fenêtre d'opportunité pour les jeunes
Un régime fiscal et social avantageux pour le statut d'artiste
En 2024, vers un avenir prometteur pour la lutte contre les cancers du côlon et du pancréas
Constitutionnalisation de l'IVG : Un pas en avant qui en appelle d'autres
23
Dans un monde idéal, les animaux pourraient voter !


D'autres fenêtres
CARTE BLANCHE
Le système électoral belge vue par le Président
DÉRISION
ED MARLAIS REMPORTE LE PROCÈS POUR PLAGIAT Mais qui est le dindon ? Et où est la farce ?

ÉDITO
Cher lecteur, Chère lectrice,
Depuis le début de l’année 2024, l’actualité semble se répéter, et ce, encore plus qu’avant. Les mauvaises nouvelles s’enchaînent et se ressemblent inlassablement. Le pessimisme paraît être la marque de fabrique des « news » qui scandent le rythme de l’actualité nationale et internationale. Sous les auspices des conflits, des épidémies, de la crise climatique, des inégalités économiques et sociales, l’avenir semble des plus moroses, particulièrement pour la jeune génération.
De « bonnes nouvelles » arrivent pourtant tous les jours ; des avancées scientifiques, des progressions sociales, des accords et collaborations novatrices et vertueuses. Si rappeler ces bonnes nouvelles peut déjà simplement nous remonter le moral, j’estime que parler des heureux événements du quotidien permet également de rendre hommage aux personnes qui ont contribué à leur conception. De plus, cela nous rappelle l’impact que nous pouvons avoir via l’implication et le travail que nous mettons dans chacun de nos projets.
C’est dans cette lignée que nous avons voulu concevoir le dossier central : à l’aune d’un optimisme simple. Ainsi, au sein de ce dossier, nous te proposons d’égayer ta lecture avec une série de bonnes nouvelles : des victoires dans la lutte contre le cancer au bien-être animal, en passant par le droit à la réparation et la constitutionnalisation de l’IVG en France.
Hors dossier, nous débuterons par l’interview de Vincent Gabriel, chercheur et géopolitilogue à l’UCLouvain, abordant plusieurs grands enjeux du 21e siècle. Viendra ensuite une carte blanche de notre président au sujet du système électoral belge. Enfin, nous terminerons ce hors-dossier par la traditionnelle dérision de notre détachée pédagogique, véritable satire sur les droits d’auteur à l’heure de l’intelligence artificielle.
avec

avec Vincent Gabriel Un monde incertain,

Des conflits qui traversent le monde aux attaques faites à la démocratie en passant par le phénomène du réchauffement climatique et des immenses conséquences qui en découlent, l’état du monde est particulièrement préoccupant. Face à ces phénomènes, il convient d’opter pour un discours clair, cohérent et appuyé sur des faits. Pour cette raison, nous avons décidé de questionner Vincent Gabriel, géopolitologue et chercheur à l’UCLouvain, sur divers grands enjeux du 21e siècle : la dénucléarisation armée, le désenchantement des démocraties libérales, les enjeux liés à la faim et aux migrations de masse.
Vincent Gabriel est doctorant à l’École de sciences politiques de l’UCLouvain, membre du centre d’étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) et consultant auprès du European Council on Foreign Relations.

En 2024, le président américain Eisenhower essayait de convaincre les Nations-Unies que l’atome œuvrait à la paix. Néanmoins, entre arsenaux nucléaires de plus en plus fournis, programmes d’enrichissement dans différents pays, voire menaces de guerre nucléaire, le « Minuit moins une » semble proche et la dénucléarisation lointaine. Pourquoi est-ce difficile d’envisager un monde dépourvu d’armes nucléaires ?
Il n’est pas difficile pour tout le monde d’envisager un monde dépourvu d’armes nucléaires. En 2017, c’est la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires qui a reçu le prix Nobel de la paix. Il existe donc encore des gens qui rêvent de ça. Il y a eu un texte à l’ONU en 2017 qui plaidait pour ce désarmement nucléaire. Les rêveurs, ça existe. Pourquoi est-il difficile de se joindre à eux ?
Il y a deux raisons : la première, c’est qu’on a la conviction, au sein des gouvernements, que l’arme nucléaire fonctionne. Elle fonctionne parce qu’elle n’a jamais été utilisée et c’est pour cela même qu’elle a été créée. C’est le principe même de la dissuasion. Elle a été créée pour qu’on n’ait pas à s’en servir. Raymond Aron écrivait que l’arme nucléaire contient l’apocalypse, dans tous les sens du mot « contient » : elle la retient, mais a aussi le potentiel de la créer.
Quant à la deuxième raison, il faut être peut-être un peu pragmatique ou honnête. Il y a probablement des régimes, notamment les démocraties libérales, qui pourraient être en faveur d’un désarmement nucléaire, parce que c’est dangereux, cette histoire. Maintenant,

est-ce qu’on peut le faire en face de régimes comme le régime russe ? Est-ce qu’on peut avoir confiance dans le fait qu’eux aussi démantèleront leurs arsenaux ? Si je me retrouve sans armes nucléaires, mais que le camp d’en face en a une, je suis de facto plus vulnérable. Rappelons ici que ce fut le cas de l’Ukraine, qui accepta de restituer l’arsenal nucléaire soviétique qui stationnait sur son territoire à la fin de la Guerre froide. Ce précédent n’encourage pas de nouveaux gouvernements à suivre un tel chemin.
On peut postuler que, peut-être, la France, le RoyaumeUni voire les États-Unis accepteraient, en ayant conscience du danger, un tel désarmement. Mais cela me paraît fort peu probable si, en face, Kim Jong-Un a toujours ses missiles. C’est la raison pour laquelle c’est possible sur le papier. Il suffirait de les démanteler tous jusqu’au dernier. Mais tant qu’il y en a un qui l’a, un deuxième se sent obligé de l’avoir. C’est le principe de la dissuasion. C’est comme ça que cela a été pensé.
Selon un rapport de l’ONU, entre 700 et 800 millions d’individus souffrent aujourd’hui de la faim, soit 11 % de la population mondiale. On le sait, la faim peut être utilisée comme arme de guerre, comme moyen de pression. Aujourd’hui, comment et dans quelles mesures la faim est-elle utilisée à des fins politiques ?
C’est une bonne question. Elle permet de mettre en lumière un élément : en 2020, le programme alimentaire mondial a reçu un prix Nobel de la paix. Cela permet de souligner qu’il y a un problème structurel du système international aujourd’hui : les gens meurent de faim,

mais on produit de trop. Donc, le premier élément à avoir en tête avant de répondre vraiment à la question, c’est qu’il y a systémiquement quelque chose qui ne va pas. C’est que, même si les gens meurent de faim, on a assez de ressources pour nourrir tout le monde. Le problème est un problème de distribution d’un point de vue international.
Et puis, il y a un problème au niveau de l’instrumentalisation de la faim. Il faut savoir que c’est illégal. La résolution 2417 du Conseil de Sécurité des Nations Unies interdit formellement l'instrumentalisation de la faim. Mais, haute surprise, elle n’est bien entendu pas respectée…
Comment est-ce qu’on fait pour créer de la faim ? Il existe toute une série de mesures, toute une série de leviers que prennent certains régimes, ou plutôt certains belligérants. Ce peut être un blocage de l’aide humanitaire, par exemple : les convois arrivent et ils sont bloqués, ne peuvent pas entrer dans le pays. On a vu de tels exemples dans le cadre de la guerre dans le Tigré, qui est terminée maintenant, mais qui a eu lieu jusque l’an passé. On peut aussi avoir une instrumentalisation de l’aide : « Regardez, moi, je laisse entrer les convois donc c’est de moi dont vous avez besoin pour gérer une communauté locale, voire un pays. C’est moi qui vous nourris ». C’est une autre situation. On peut également avoir des guerres très sales, où on détruit des puits ou bien on jette des corps dedans pour en polluer l’eau.
Et puis il y a d’autres manières d’utiliser la faim et on fait là le lien entre le comment et le pourquoi. C’est la spéculation. C’est-à-dire qu’on va se faire de l’argent sur les ressources qu’on peut vendre. Ici, on peut très clairement parler de la guerre en Ukraine et du bombardement du port d’Odessa. L’Ukraine était avant la guerre une importante exportatrice de blé. Depuis l’invasion généralisée du territoire ukrainien, il y a moins de blé vendu, donc on a besoin du blé russe. Il y a moins d’offre, la demande est toujours aussi haute, donc ils se font plus d’argent.
Il y a aussi, c’est souvent souligné, des raisons plus structurelles ou en tout cas indirectes, c’est par exemple le biocarburant. Peu ou prou, on va prendre du blé pour en faire de l’essence. À titre indicatif, un tiers du blé

étasunien n’est pas mangé, mais transformé pour en faire du carburant.
Les études et les sondages s’accumulent sur le sujet et le constat est sans appel : la démocratie dans le monde recule, elle est contestée, elle attire moins. Un Belge sur deux se dit d’ailleurs en faveur d’un régime plus autoritaire. Selon vous, la démocratie libérale fait-elle encore rêver ?
En effet, les enquêtes sont assez unanimes. Les résultats électoraux un peu partout dans le monde indiquent clairement un mouvement, dans ce qu’on peut considérer comme l’Occident, aux États-Unis, dans l’Union européenne en général. La réponse à votre question est une réponse de Normand : OUI et NON.
NON, il y a des endroits où elle ne fait plus rêver. C’est simple, il ne faut jamais généraliser, mais on rêve rarement de ce qu’on a, on rêve toujours de ce qu’on n’a pas. La démocratie libérale, dans l’Europe, dans l’Union européenne, c’est, pour beaucoup, un acquis. Donc, on ne se rend pas toujours compte du fait que ça existe et du fait que peut-être qu’ailleurs ce n’est pas si terrible. C’est une première chose.
Une autre chose qui fait qu’elle fait moins rêver, c’est que tout n’est pas parfait : elle ne fonctionne pas toujours, pas très bien. Il y a des inégalités de revenus, des inégalités qui sont perçues, qui sont ressenties. On a l’impression que la démocratie ne solutionne pas ces inégalités et qu’il faudrait peut-être un homme ou une femme forte, qui va prendre le problème à bras-le-corps et qui va tout changer. En plus de ça, ils ont un côté un peu « cool », ces leaders forts. La démocratie, c’est des avis qui sont différents, donc de la nuance. Les leaders des régimes qui ne sont pas démocratiques pratiquent rarement l’art de la nuance.
Et puis, il y a aussi évidemment la désinformation : des petits récits, des petits narratifs qui viennent saper l’esprit de la démocratie. On parle de complots : on dit que les personnalités politiques sont d’odieux violeurs d’enfants, comme QAnon aux États-Unis.
La démocratie libérale, dans l’Europe, dans l’Union européenne, c’est, pour beaucoup, un acquis. Donc, on ne se rend pas toujours compte du fait que ça existe et du fait que peut-être qu’ailleurs ce n’est pas si terrible. » >>
« On ne parlera jamais de migration, on parlera désormais toujours de crise migratoire. C’est intéressant de voir la manière dont on construit une réalité, de voir que la migration est toujours considérée comme un danger
Mais OUI, elle fait encore rêver. Pourquoi est-ce qu’on meurt en Ukraine ? Pour défendre le modèle de la démocratie libérale, entre autres. Oui, elle fait encore rêver. Peut-être pas un modèle européen. Mais les raisons pour lesquelles les femmes, mais aussi les hommes manifestent en Iran, c’est notamment pour respirer, pour avoir un peu de démocratie. Mais en Europe même, on trouve de tels mouvements : il suffit de regarder les dernières élections en Pologne, qui ont indiqué clairement un mouvement d’adhésion envers le modèle de la démocratie libérale, que l’on sentait menacée par le régime du parti Droit et Justice.
J’ai rencontré Federica Mogherini il y a quelques années qui a eu une phrase que je trouve très bien : « En fait, la démocratie libérale est le modèle que l’on pourrait considérer comme un modèle européen, il fait rêver partout ailleurs qu’en Europe ».
En 2023, pour des raisons de violences, de persécutions, de pauvreté ou de catastrophes climatiques, on compte déjà plus de 110 millions de déplacés de force. Avec une crise climatique toujours plus critique, il est difficile de croire que ce chiffre diminuera, on parle même de plusieurs centaines de millions de réfugiés d’ici 2050. Quels sont les enjeux de ces migrations massives, actuelles et futures ?
Vous le dites bien, l’émigration est un enjeu. On ne va pas faire beaucoup de théorie des relations internationales ici, mais il y a un concept que je trouve très intéressant, c’est le concept de « sécuritisation » : on prend un sujet et on le transforme comme un enjeu, un problème de sécurité. On ne parlera jamais de migration, on parlera désormais toujours de crise migratoire. C’est intéressant de voir la manière dont on construit une réalité, de voir que la migration est toujours considérée comme un danger.
Rappelons-nous notre histoire récente : on est un pays qui a eu besoin de la migration pour le redémarrage économique après la Deuxième Guerre mondiale. Force est de constater, par exemple, que cette main d’œuvre italienne s’est relativement bien intégrée. Donc, on parle rarement de succès de la migration, on va toujours parler de danger.
Les enjeux de cette migration ? On a besoin d’immigrations d’un point de vue démographique. La balance démographique en Europe n’est pas bonne. La population vieillit. Quel est le problème ? Les pensions. Regardons ce qui se passe en France cette année, regardons le système en Belgique. Ils sont à bout de souffle. C’est l’une des raisons du Wir Schaffen Das d’Angela Merkel, mais il y a aussi le fait qu’on a besoin de jeunes pour bosser, pour payer des impôts, pour cotiser, pour à long terme assurer la viabilité de ce système de pension.

Puis, il y a des enjeux qui font que ça pose problème, en tout cas aux dirigeants. Pourquoi ? On le sait tous, dans l’opinion publique, il y a toujours eu une peur de l’autre. Le « eux » contre « nous ». Plus cette personne qui vient est différente de moi, plus l’accueil va être difficile. Ça, ce sont des réflexes humains. Ces réflexes humains sont instrumentalisés par des politiques. Instrumentalisés ou portés parce que les politiques peuvent peut-être aussi y croire. On en revient aussi à la question de la démocratie libérale qui est menacée, pas uniquement par l’extrême droite, mais il est bien connu qu’elle surfe sur cette crainte migratoire.
Il faut le voir, un des enjeux de la migration, ce sont ces dizaines de milliers de migrants sur l’île de Lampedusa. Comment est-ce qu’on gère ça ? C’est un enjeu d’éthique, de politique, d’administration publique. Comment estce qu’on gère ces masses ? Est-ce qu’on les accueille ? Est- ce qu’on a la place ? Il y a toute une série d’éléments qui font que ce sujet est un sujet politique qu’on sert un peu comme explosif. Par exemple, l’Allemagne ellemême est obligée de redurcir ces flux migratoires, cette politique d’accueil, parce que ce n’est pas populaire.
Les enjeux de la migration sont ceux-ci : on a une réalité qui va s’exacerber, par les réfugiés climatiques surtout. L’enjeu principal, c’est qu’on n’a pas de solutions à long terme, autre que vendre des éléments qui sont plutôt de l’idéologie. On va dire des phrases comme « On ne peut pas accepter toute la misère du monde » comme « Il faut accepter tout le monde, parce que c’est une nécessité humaine ». Ces deux postures, que je caricature, simplifient les enjeux d’une question difficile et que nous aurons à relever du fait notamment, comme vous le demandiez, du réchauffement climatique.

Rédacteur en chef


DOSSIER Une dose d'optimisme pour 2024
Dans un monde où l’Union européenne promeut le droit à la réparation, la France inscrit l’IVG dans sa constitution, le Portugal bannit les animaux sauvages des cirques, et où la Belgique renforce le milieu artistique, combat les cancers du côlon et de pancréas, fait fleurir les initiatives entrepreneuriales, le tableau ne peut pas être si noir…
Nous sommes tous, probablement, vaguement au courant de ces nouvelles. Certaines d'entre elles semblaient inimaginables il y a peu. D'autres ont été trop longtemps négligées, comme la question du bien-être animal ou les réformes pour améliorer le statut des artistes. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Qui en est responsable ? Sommes-nous confrontés à des défis particuliers ? Pourquoi certaines de ces nouvelles sont si cruciales ?
En voilà des questions qui méritent une réflexion plus critique et poussée sur ces bonnes nouvelles pour lesquelles nous nous réjouissons. Car incontestablement, cette édition du Blue Line éveillera en vous le sourire !
Il est souvent plus simple de critiquer ce qui reste à accomplir plutôt que de reconnaître ce qui a déjà été réalisé. Surtout dans un contexte électoral où le pessimisme règne en maitre. Ainsi, nos rédacteurs et rédactrices ont décidé, dans ce dossier central, d'explorer les rayons des bonnes nouvelles au sein de cette année pleine de surprises et de rebondissements.


BONNE NOUVELLE
FINI LE GASPILLAGE, L'EUROPE IMPLÉMENTE (PRESQUE) LE DROIT À LA RÉPARATION !

EURéparé
Le 11 décembre 2019 a marqué un tournant dans l’histoire de l’Union européenne, avec le lancement de l’un des projets les plus ambitieux de ces dernières décennies : le Green Deal. Avec pour objectif de réduire les émissions de carbone de 55 % d’ici 2030 (par rapport aux niveaux de 1990) et de devenir neutre en carbone d’ici 2050, l’Europe s’est annoncée comme un leader mondial de la transition. Pour y parvenir, l’UE s’est lancée dans un vaste programme de réformes, allant du marché de l’énergie (avec le plan REPowerEU) à l’approvisionnement en matières premières critiques (avec le Critical raw materials Act), en passant par la question du recyclage/de la réparation. C’est à ce dernier volet, indispensable à la réalisation du Green Deal, à savoir le droit à la réparation, que la Commission a commencé à s’attaquer le 22 mars 2023.
PAR NOHA DEVILLERS
RÉPARER, une nécessité
« La réparation est essentielle pour mettre fin au modèle "prendre, faire, casser et jeter" qui est si néfaste pour notre planète, notre santé et notre économie. Il n’y a aucune raison pour qu’un cordon défectueux ou un ventilateur cassé vous oblige à acheter un produit entièrement neuf. » Le ton a été donné dès le départ par Frans Timmermans, ancien vice-président exécutif du Green Deal européen. Une approche affirmée qui néanmoins semble adaptée à l’ampleur du problème. En effet, selon le Droit à la réparation de 2023 :


La non-réparation de biens encore viables entraîne, pour vous donner un ordre d’idée, la création de 35 millions de tonnes de déchets, le gaspillage de 30 millions de tonnes de ressources et l’émission de près de 261 millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année dans l’Union européenne.

iOutre l’impact écologique, la non-réparation des biens entraîne un manque à gagner important pour les consommateurs chiffrés à près de 12 milliards d’euros par an.

iDe plus, une initiative dans le secteur de la réparation semble être dans l’intérêt économique de la Commission, étant donné qu’une action dans ce domaine pourrait apporter près de 4,8 milliards d’euros de croissance et d’investissement au vieux continent.
Compte tenu de l’ampleur du problème, et dans un effort de complétion des objectifs de durabilité définis dans son Green Deal, il semblait donc inévitable que la Commission prenne des mesures sur la question de la réparation.
Une évidence
C’est ainsi qu’en mars de l’année dernière, la Commission européenne a dévoilé sa proposition de directive sur les règles communes visant à promouvoir la réparation des biens. En d’autres termes, il y a près d’un an désormais, la Commission a dévoilé son outil législatif à même de créer un véritable droit à la réparation. Une directive dont l’objectif, en résumé, était de permettre aux consommateurs de faire des économies, tout
en permettant à l’économie européenne, elle, de se développer dans ce secteur, et ce, tout en protégeant mieux l’environnement. Tout un programme… Un texte qui, assez singulièrement, a fait l’unanimité quant à sa qualité. À cet effet, il a d’abord été débattu par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) qui a adopté le texte le 25 octobre 2023 avec une majorité confortable de 38 voix pour, 2 contre et aucune abstention. Ensuite, la proposition a poursuivi son parcours législatif et a été débattue en plénière le 21 novembre 2023 où elle a de nouveau été adoptée à une large majorité de 590 voix pour, 15 contre et 15 abstentions. Le Conseil, lui, est également intervenu en manifestant son soutien général pour la proposition. Aujourd’hui, cette directive en est arrivée au moment peut-être le plus important de son parcours législatif, les trilogues…
Un progrès majeur
La section précédente vous l’aura au moins partiellement démontré, ce texte est bon. Il vient répondre à un véritable problème, en ajoutant un volet plus que nécessaire de régulation au Green Deal. On ne le dit pas assez à mon goût, mais à ce sujet, le travail a été fait et bien fait par la Commission. Cependant, il serait de facto faux de prétendre que cette proposition est parfaite. En effet, le texte aurait certainement pu plus se mettre du côté des consommateurs en s’axant notamment sur l’accessibilité et donc la faisabilité économique du dit droit à la réparation. Évidemment que la directive telle qu’elle est aujourd’hui manque d’un vrai volet communicationnel à même d’accroitre la conscience des consommateurs quant à leurs comportements néfastes en la matière. Néanmoins, sachons faire la part des choses car, in fine, ce texte est bon et représente un équilibre qui, cette fois-ci, pourrait presque être qualifié de parfait. Le droit à la réparation arrive très prochainement en Europe et ça ne peut être qu’une bonne nouvelle.

BONNE NOUVELLE
L'ÂGE EXPONENTIEL OUVRE DES PORTES ENTREPRENEURIALES !

L'âge exponentiel
Une fenêtre d'opportunité pour les jeunes
Dans un paysage économique en constante transformation, l’innovation et l’entrepreneuriat sont désormais essentiels pour stimuler la croissance. Dans cet âge exponentiel, caractérisé par une accélération sans précédent des avancées technologiques, les jeunes entrepreneurs sont confrontés à un terreau fertile de possibilités. Cette période offre une toile de fond dynamique où les esprits visionnaires peuvent saisir de nouvelles opportunités et redéfinir les normes établies.
PAR COLIN GILSON

L’émergence d’un nouveau paradigme entrepreneurial
L’âge exponentiel est un concept qui décrit la phase actuelle de notre développement économique, caractérisée par une croissance technologique exponentielle. Les progrès dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la biotechnologie, les cryptomonnaies et l’Internet des objets ont ouvert la voie à un éventail de possibilités sans précédent pour les entrepreneurs de tous horizons. Ce concept a gagné en popularité, notamment grâce à des figures comme Raoul Pal, ancien cadre de la banque Goldman Sachs et entrepreneur.
Dans le sillage de l’âge exponentiel, les barrières à l’entrée sur le marché se dissolvent, ouvrant ainsi la voie à une pléthore de possibilités pour les jeunes entrepreneurs. Jadis, les ressources nécessaires à la création d’une entreprise étaient limitées, mais aujourd'hui, grâce à
la démocratisation des outils technologiques et à l’accès facilité au financement, lancer une startup est à la portée de chacun.
Des opportunités pour les jeunes entrepreneurs
Les jeunes entrepreneurs sont particulièrement bien placés pour tirer parti de l’âge exponentiel. Avec l’accessibilité croissante des ressources en ligne et le développement du financement participatif, le lancement d’une startup est devenu plus accessible que jamais. De plus, la nature disruptive de nombreuses technologies émergentes crée de nouveaux marchés et perturbe les industries établies, offrant ainsi des opportunités de croissance rapide aux entrepreneurs audacieux.
SOURCE : INASTI, CALCULS OBSERVATOIRE DES PME SPF ÉCONOMIE

En outre, en Wallonie, des initiatives telles que Digital Wallonia offrent un soutien précieux aux jeunes entrepreneurs. Digital Wallonia 4 Trust, mené par Agoria, est un exemple concret de programme visant à encourager l’innovation et l’entrepreneuriat dans la région. Ces programmes fournissent des ressources, des conseils et des opportunités de réseautage pour aider les jeunes entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises prospères dans l’économie numérique en plein essor.
Les domaines clés de l’innovation
Dans l’âge exponentiel, certains domaines se distinguent par leur potentiel d’innovation et de croissance. Les technologies de pointe telles que la blockchain, la réalité virtuelle et la biotechnologie ouvrent de nouvelles perspectives dans des domaines aussi variés que la santé, les finances et le divertissement. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui osent s’aventurer sur ces territoires inexplorés et qui sont prêts à remettre en question le statu quo.
Les défis et risques
Bien que l’âge exponentiel offre un large éventail d’opportunités, il n’est pas dépourvu de défis. La compétition est intense dans de nombreux secteurs, et la rapidité des évolutions technologiques peut rendre obsolètes les entreprises qui ne parviennent pas à s’adapter. De plus, la volatilité de nombreux marchés expose les entrepreneurs à des risques, les incitant à faire preuve d’agilité et à anticiper les changements à venir. Cette situation est d’autant plus favorable pour
les jeunes générations, qui assimilent rapidement les nouvelles technologies.
Cependant, la jeunesse peut également être perçue comme un obstacle, avec le risque de faillite pour les entrepreneurs trop jeunes. De plus, la complexité administrative et les exigences telles que les trois ans d’expérience préalable dans certains domaines avant de pouvoir se lancer en tant qu’indépendant, comme j’ai pu l’expérimenter au Luxembourg, peuvent constituer des barrières frustrantes et décourageantes pour les jeunes aspirants entrepreneurs. Ajoutons à cela le défi que cela représente pour les entrepreneurs d’origine étrangère qui rencontrent souvent des obstacles supplémentaires lorsqu’ils entreprennent en Belgique, une réalité qui rend l’accès au marché et la réussite entrepreneuriale encore plus complexes.
L'avenir appartient à ceux qui innovent
En conclusion, l’âge exponentiel offre un terrain fertile pour l’entrepreneuriat et l’innovation. Les jeunes entrepreneurs qui saisissent avec audace les opportunités offertes par ce nouvel élan technologique sont en mesure de façonner l’avenir économique et de créer un impact durable dans le monde. Malgré les défis rencontrés, tels que la concurrence intense et les obstacles administratifs, les jeunes talents qui persévèrent et s’adaptent sont promis à un succès florissant. En embrassant l’âge exponentiel avec optimisme et détermination, ils peuvent transformer leurs rêves en réalité et contribuer à édifier un avenir empreint d’innovation et de prospérité pour les générations à venir.

Colin Étudiant, CEL Namur
BONNE NOUVELLE
PLUS DE FLOU ARTISTIQUE, LA RÉFORME DESSINE UN MEILLEUR STATUT POUR LES ARTISTES !

Singers
& UN RÉGIME fiscal social AVANTAGEUX
pour le statut d'artiste
Bonne nouvelle ! Depuis le 1e janvier 2024, le secteur des travailleurs du monde culturel et artistique connait des changements intéressants. Pouvoir bénéficier d’une situation stable est en effet primordial pour faire place à une pleine créativité dans le chef de nos artistes. D’ailleurs, nous avons la chance, notamment à Bruxelles, d’avoir un vivier de talents issus d’une diversité que beaucoup de villes nous envient, comme la commune de Molenbeek-Saint-Jean dans laquelle les Échevines libérales, Françoise Schepmans et Gloria Garcia Fernandez, mettent à l’honneur la culture ! Ainsi, cette commune bourrée de talents nous prouve que l’art dans son ensemble est un vecteur de la cohésion sociale.
PAR NASSIM SABIBI
SingersDancersArtists
Soupir de soulagement pour le secteur
Comme pour beaucoup d’artistes, Inès est soulagée de pouvoir bénéficier de la réforme : « On a enfin l’impression d’être entendu par le monde politique. En général, les thèmes de l’opinion publique tournent autour du pouvoir d’achat ou encore de la sécurité. Je me sentirai bien plus à l’aise dans mes projets artistiques ! » La plupart de ses collègues du monde de l’art sont soulagés selon elle.
Vous l’aurez compris, ce changement vient donner un coup de boost à un univers souvent oublié. Découvrons maintenant les points qui bénéficient d’une meilleure situation.
Notion d’artiste élargie
Deux catégories se dessinent : le travailleur des arts et l’artiste amateur. Le travailleur des arts est une personne agissant dans le domaine des arts (activité artistique, artistique-technique ou artiste de soutien) et doit prouver son activité à la Commission du travail des arts. De son côté, l’artiste amateur est une personne produisant des prestations ou des œuvres artistiques moyennant une indemnité sans contrat de travail. Les notions étant définies, voyons les principaux points de la réforme qui leur sont applicables.
Protection sociale
renforcée
Comme dit précédemment, on note une amélioration significative de la protection sociale des artistes. Désormais, ces derniers bénéficieront d’un accès élargi à la sécurité sociale, comprenant notamment une couverture plus étendue en matière d’assurance maladie, d’assurance chômage et de retraite. Cette mesure vise à prévenir la précarité économique souvent associée au secteur culturel. La pandémie et ses effets ont mis en exergue cette précarité ainsi que le caractère incontournable de ce secteur.
Rémunération équitable
La réforme introduit également des dispositions visant à garantir une rémunération équitable pour les artistes, notamment en renforçant les droits d’auteur et en régulant drastiquement les conditions de travail dans le secteur artistique. Ces mesures visent à reconnaître la valeur du travail créatif et à combattre les pratiques d’exploitation économique.
Promotion de la diversité culturelle
La nouvelle législation a également pour ambition d’encourager la participation des artistes issus de milieux trop peu représentés, tels que les communautés minoritaires et les personnes en situation de handicap. Des mesures incitatives sont mises en place pour favoriser l’accès à la formation, au financement et aux opportunités professionnelles pour ces artistes. Cette partie de la réforme se veut donc inclusive.
Soutien à la création artistique
Le dernier pilier de la réforme prévoit un soutien plus important à la création artistique, notamment à travers le renforcement des dispositifs de financement public et la simplification des démarches administratives pour les artistes. Des programmes de résidences d’artistes (comme la célèbre Villa Médicis à Rome, appartenant à l’Académie de France) et de coopération internationale sont également développés pour encourager les échanges culturels et la collaboration entre artistes belges et étrangers.
En somme, la réforme semble témoigner de la rencontre de beaucoup de demandes de la part du secteur, ce qui n’a pas toujours été le cas. Espérons que le pays du surréalisme développera et produira des œuvres marquantes pour l’éternité ! Nassim

Étudiant, CEL ULB
En 2024 #4
BONNE NOUVELLE
LA MÉDECINE BELGE AVANCE DANS LE TRAITEMENT DE CANCERS !

, vers un avenir prometteur pour la lutte contre LES CANCERS DU CÔLON ET DU PANCRÉAS
La Belgique se positionne comme un acteur incontournable dans le domaine de la médecine. L’espoir d’un avenir où les maladies les plus redoutées ne seront plus qu’un lointain souvenir est alimenté par des avancées révolutionnaires dans des domaines tels que la biotechnologie, l’intelligence artificielle et la thérapie génique.
Une nouvelle thérapie cellulaire a été créée par une équipe de recherche de l’Université d’Anvers qui s’attaque au mécanisme de défense des tumeurs. Cette méthode de traitement constituerait une avancée significative dans la lutte contre les cancers du côlon et du pancréas, qui sont tous deux difficiles à traiter. Bien que les essais sur les souris et les cellules humaines soient prometteurs, la nouvelle thérapie doit encore être testée chez l’être humain.
PAR SARAH SCIARRABBA
Concrètement comment ça marche ?
Comme défini par la Fondation contre le cancer, « un cancer du pancréas est composé d’une masse de cellules anormales (tumeur) qui se multiplient de façon anarchique. En grossissant, la tumeur peut perturber le fonctionnement du pancréas, comprimer les organes voisins (voies biliaires), envahir les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que les organes avoisinants comme le foie. Des cellules cancéreuses peuvent s’échapper de la tumeur d’origine. Elles vont alors coloniser d’autres organes à distance (foie, péritoine…) pour y former des métastases. Ces métastases sont constituées de cellules cancéreuses venant de la tumeur pancréatique.

Elles doivent donc être traitées comme un cancer du pancréas. »
C’est ce tissu conjonctif qui crée une barrière protectrice autour des tumeurs pancréatiques et coliques qui rend la radiothérapie inefficace. L’équipe de recherche de l’Université d’Anvers a trouvé la solution pour surmonter ce défi grâce à la nouvelle thérapie cellulaire qui désagrège à la fois les cellules cancéreuses et les cellules du tissu conjonctif.
Un regard vers demain !
Selon une étude réalisée par la fondation contre le cancer, le cancer du pancréas est un cancer redoutable (premier tableau), avec une mortalité très élevée. En ce qui concerne le cancer du côlon, il fait
partie des 3 types de cancers les plus dépistés grâce au programme de dépistage mis en place. Ainsi, en Belgique, en 2018, un cancer du sein avait été diagnostiqué chez 10.905 femmes, un cancer du col de l’utérus chez 634 femmes et un cancer colorectal, chez 7860 hommes et femmes (second tableau).
Cette nouvelle thérapie cellulaire créée par les chercheurs de l’Université d’Anvers est donc révolutionnaire et ouvre une porte vers l’espoir. Cette avancée représente beaucoup pour ceux qui luttent contre les cancers du côlon et du pancréas mais pas uniquement, car l’équipe de chercheurs voudraient à l’avenir tester la nouvelle thérapie cellulaire sur d’autres types de cancers.



#5

BONNE NOUVELLE
LA FRANCE PROGRESSE VERS DAVANTAGE DE PROTECTION DE L'IVG
IVG CONSTITUTIONNALISATION DE L'

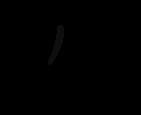
Un pas en avant qui en appelle d'autres
Le 4 mars 2024, près de cinquante ans après la loi Veil de 1975 dépénalisant l’avortement, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Le vote
Pour comprendre l’inscription de l’IVG dans la Constitution française, il faut a minima remonter au 24 juin 2022, date à laquelle la très conservatrice Cour Suprême des États-Unis supprime l’arrêt Roe v. Wade (1973) qui garantissait le respect à la vie privée, dont la liberté d’avorter. Avec cette abrogation, les états fédérés sont désormais maîtres de choisir les conditions de la pratique de l’IVG sur leur territoire. Aujourd’hui, plus de la moitié d’entre eux l’ont totalement interdit ou le restreignent très fortement. Une véritable claque
pour le droit à l’avortement dans le monde. En réaction, en septembre 2022, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, dépose une première proposition de révision constitutionnelle pour y inscrire que « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». À la suite de plusieurs amendements proposés par le Sénat, le projet de loi sera laissé de côté. Plus tard, le 8 mars 2023, le Président de la République, Emmanuel Macron, propose à son tour de constitutionaliser l’IVG « pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ni défaire ce qui sera ainsi irréversible ». De
cette volonté présidentielle émanera un texte, celui-là même qui sera débattu et adopté successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat. In fine, le texte sera voté à Versailles, lors d’une réunion des deux assemblées réunies en Congrès le 4 mars 2024. Le résultat est sans appel : sur 852 suffrages exprimés, 780 sont en faveur de la Constitutionnalisation de l’IVG. Historique, ce résultat positionne la France comme championne mondiale de la protection du droit à l’avortement. Or, bien que nous puissions nous réjouir de cette avancée, il semble essentiel de se réjouir davantage des avancées que cette constitutionnalisation appelle. >>
PAR ARTHUR WATILLON

Les limites de cette liberte
Pour comprendre ces limites, partons de la loi ellemême. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 tient en un unique article, qui modifie l’article 34 de la Constitution, pour y inscrire que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Ici, le terme « liberté garantie » et non « droit » est utilisé. Or, la « liberté garantie » ne permet pas d’obtenir un droit opposable, c’est-à-dire un droit qui permet aux citoyens et citoyennes de disposer de voies de recours pour la mise en œuvre de ce droit, obligeant ainsi l’État.
Ensuite, en théorie, bien que la liberté à l’interruption volontaire de grossesse soit garantie, en pratique, son accès peut être fortement restreint. C’est particulièrement le cas en France, où le droit à l’IVG est de moins en moins accessible. En quinze ans, 130 centres le pratiquant ont fermés. Dans les déserts médicaux, les femmes désirant recourir à l’IVG sont contraintes de se déplacer en dehors de leur région ou de le pratiquer par voie médicamenteuse. De plus, le nombre de praticiens diminue fortement, la première génération de praticiens militants arrivant au terme de sa carrière. En Belgique également, il est urgent de sensibiliser les médecins et les étudiants en médecine afin de pallier cette pénurie.
Ensuite, le texte prévoit simplement que la loi doit déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui le souhaitent peuvent recourir à l’IVG. Par conséquent, la loi pouvant être modifiée, rien n’empêche une future composition parlementaire de restreindre considérablement l’accès à ce droit.
Un petit rappel
Les mouvements anti-avortement disséminent également de nombreuses FAUSSES INFORMATIONS. Celles-ci sont présentes sur les réseaux sociaux, surtout via des « lignes d’écoute » qui font concurrence à une information claire et objective, s’attardant sur l’angle de la souffrance, sur un supposé « syndrome post-ivg »,

une intox récurrente dans ces milieux. Ainsi, il suffit de taper « IVG » dans un moteur de recherche pour faire remonter des sites anti-avortement qui diffusent des informations erronées sur cet acte médical.
Faut-il le rappeler, le nombre d’avortements ne diminue JAMAIS lorsqu’il est interdit. D’après l’Institut Guttmacher1, dans les pays qui autorisent largement l’avortement, on estime le nombre de recours à l’IVG à 34 pour 1000 personnes. Dans les pays qui interdisent entièrement l’avortement ou ne l’autorisent que dans certaines conditions précises, le taux d’avortement s’élève à 37 pour 1000, soit une différence statistique négligeable.
Les gouvernements restreignant l’accès aux avortements contraignent les personnes désireuses d’y avoir recours de manière clandestine et donc exposent cellesci à des avortements dangereux, qui peuvent avoir des conséquences mortelles. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les avortements dangereux représentent la troisième cause de mortalité maternelle à travers le monde et entraînent annuellement cinq millions de handicaps facilement évitables.
Et maintenant

L’inscription de l’interruption volontaire de grossesse dans un texte constitutionnel est un moment historique, fruit de décennies de luttes. Nous saluons les parlementaires français pour cette avancée considérable. Toutefois, cette inscription ne doit pas être vue comme un but, mais un marchepied sur lequel s’appuyer. En tant que rédacteur en chef de la Fédération des étudiants libéraux, j’aspire à ce que la Chambre des Représentants de Belgique s’empare de la question en s’inspirant de la proposition initiale de Mathilde Panot, qui vise à « garantir l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Si nous baissons notre garde, si nous ne défendons pas les droits acquis par les luttes, récentes ou anciennes, ces droits régresseront.

N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. – Simone de Beauvoir.
1 L’institut Guutmacher est un institut de recherche américain réalisant des statistiques sur la réalité de l’avortement à travers le monde.

#6

Dans son engagement en faveur du bien-être animal, la Belgique aspire à élever ses normes vers l’exemplarité. Après avoir inscrit le bien-être animal dans sa constitution, la Belgique vise-t-elle à atteindre l’excellence dans ce domaine ?
PAR LARA ZENGINOGLU



Bien que les animaux ne participent ni à la politique ni à la législation, cela n’amoindrit en rien l’impératif de les protéger. Récemment, la législation belge a enfin reconnu leur sensibilité, les érigeant de simples biens à des êtres sensibles. À Bruxelles, des progrès sont notables, avec une réduction de 40 % du nombre d’animaux dans les refuges depuis 2019, l’application de lois sur la stérilisation et l’interdiction des colliers électriques. Ces avancées sont prometteuses, gageons que notre pays continue sur sa lancée et affiche bientôt un niveau d’excellence en matière de bien-être animal.
En effet, plus de six Belges sur dix sont prêts à investir davantage pour des normes plus strictes dans l’élevage, tandis que sept sur dix estiment être insuffisamment informés sur la question. Une pétition signée par 20.000 Belges demande l’intégration du bien-être animal dans l’éducation. Cette thématique alimente de nombreux débats politiques, allant de l’abattage rituel à la maltraitance animale en passant par les refuges et les abandons. Alors que certaines associations, comme PETA, réclament l’interdiction des chevaux en bois dans les manèges, d’autres, telles que GAIA, estiment que d’autres priorités méritent davantage d’attention.
Cependant, avant d’exiger des changements, saluons ce qui a déjà été accompli. Cette année a apporté quelques bonnes nouvelles, avec l’allongement de la période de garantie pour les animaux adoptés, l’interdiction de la vente d’animaux vivants sur les marchés en Belgique, et, en France, la cessation de la vente de chiens et chats en animalerie depuis janvier 2024.


Au Portugal, l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques est une avancée notable, tout comme l’imminente interdiction des produits nuisant à la biodiversité en Europe.
Le bien-être animal est également mis en avant dans les médias, que ce soit à travers des émissions telles que « Animaux à adopter », qui dévoile les coulisses de la SPA, ou « Une saison au zoo », qui plonge dans le quotidien des soigneurs animaliers et vétérinaires, ou encore « Notre nature, la Belgique sauvage », qui explore la faune sauvage belge. Ainsi, la cause animale est de plus en plus présente à l’écran, sensibilisant le public à cette question.
Toutes ces nouvelles lueurs d’espoir pour les années à venir ne doivent pas occulter la réalité : le combat persiste, et le chemin vers un changement durable est encore parsemé d’obstacles. Qu’en est-il de l’élevage intensif, des conditions dans les refuges, des abandons, de la maltraitance, de l’exploitation et de l’abattage ? Il y a vingt ans à peine, l’idée même d’un échevinat dédié au bien-être animal aurait semblé inconcevable. Pourtant, aujourd’hui, de nombreux défenseurs se mobilisent ardemment pour nos compagnons à quatre pattes !
Pour ces compagnons fidèles qui sont privés de voix et incapables d’assurer leur propre protection, il est de notre devoir en tant que citoyens et humains, de prendre position et de parler en leur nom. Ce combat noble mérite une attention accrue. Agissons au nom de ceux qui ne peuvent pas défendre leurs propres droits.
Si vous envisagez d’adopter un compagnon à quatre pattes, n’hésitez pas à visiter nos refuges locaux. Voici une petite liste de refuges où des animaux n’attendent que d’être accueillis dans votre foyer.
#1 LE REFUGE VEEWEYDE
#2 LA SPA LOUVIÈRE
#3 HELP ANIMALS ASBL
#4 L’ARCHE DE NOÉ ASBL
#5 LES PETITS VIEUX ASBL
#6 SANS COLLIER ASBL
#7 LE REFUGE CROIX BLEUE
#8 LE REFUGE FÉLIN POUR L’AUTRE
#9 LE REFUGE WAHF
#10 AU BONHEUR ANIMAL ASBL


D’AUTRES FENÊTRES…
Conflits, crises en tout genre, recul des droits et libertés… les informations qui inondent l’actualité noient la société dans un pessimisme excessif. Pourtant, les événements qui inspirent l’espoir sont nombreux. Alors, si la morosité te gagne, quoi de mieux que d’ouvrir la fenêtre de l’optimisme et d’en inspirer un grand bol d’air frais. Parce que oui, on en parle peu, mais qu’est-ce qu’il est bon de se rappeler que l’optimisme est à portée de main !
LITTÉRATURE
« Humanité : Une histoire optimiste »
Dans son ouvrage Humanité : Une histoire optimiste, édité chez Seuil en 2020, pour Rutger Bregman, le cynisme ne fait définitivement pas partie de la nature humaine ! C’est ce qu’il montre dans son livre, où il expose une idée simple : la plupart des gens sont bons. À travers des exemples historiques, des témoignages, des anecdotes, l’auteur bat en brèche l’idée que l’Homme serait mauvais par nature, en dévoilant toute la bonté dont celui-ci peut faire preuve. Historien et journaliste, Rutger Bregman est également l’auteur d’Utopies réalistes, véritable best-seller, traduit dans plusieurs dizaines de pays !
La preuve par A+B que nous pouvons tant accomplir en ayant du cœur !

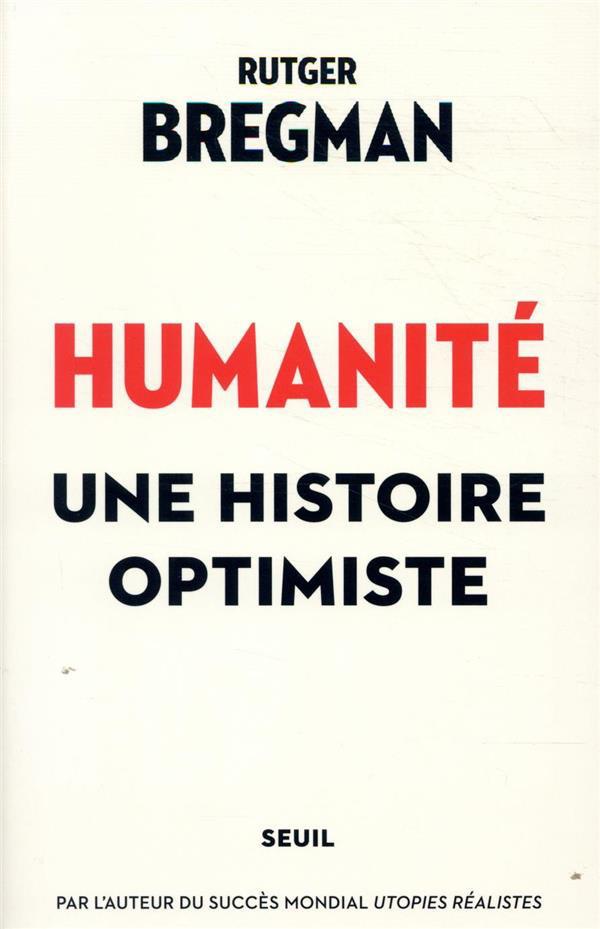
« Green Book : Sur les routes du Sud »
Sorti en 2018, le film biographique de Peter Farrelly, Green Book, retrace une tournée réalisée dans les États ségrégationnistes du sud des États-Unis par le pianiste afro-américain Don Shirley, accompagné de son chauffeur et garde du corps blanc, Tony Vallelonga. Durant leur périple dans une Amérique marquée par les débuts du mouvement des droits civiques, les deux hommes sont confrontés aux humiliations xénophobes et aux persécutions. À force de résilience, d’entraide et d’humour, les deux comparses dépassent leurs différences et posent les bases d’une amitié réelle et durable.
Un fauteuil, un plaid, un chocolat chaud et tu es prêt à visionner Green Book
RÉCOMPENSE
Prix Gisèle Halimi
Décerné par la Fondation des Femmes depuis 2017, le prix Gisèle Halimi récompense la candidate effectuant la meilleure prestation lors d’un concours d’éloquence dédié aux droits des femmes. Lors de l’édition 2023, le prix a été attribué à Anna Roy et son discours : « IVG, serons-nous un jour fondamentalement libres ? ». La Fondation des Femmes est une structure de référence en France pour les droits et la liberté des femmes et contre les violences dont elles sont victimes.
Pssst, le concours est accessible à prix réduit si tu es étudiant…

ARTISTE
Banksy

RÉSEAUX SOCIAUX
Les Belles Nouvelles
Les Belles Nouvelles, sur https://www.instagram.com/lesbellesnouvelles, c’est un média positif et engagé qui publie chaque jour une bonne nouvelle pour la planète ! Créée en 2018 par Yannis Richardt, auteur de L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, Les Belles Nouvelles regroupe aujourd’hui une impressionnante communauté de 113 000 followers. Qu’est-ce que tu attends pour les rejoindre ?
Jamais vu mais mondialement célèbre, Banksy est un street-artiste contemporain aux très nombreuses œuvres. Présentes dans les rues, sur les bâtiments, dans les lieux publics, ses œuvres prennent le plus souvent pour thèmes la lutte contre la répression, le pacifisme ou dénonce le capitalisme à outrance. En 2018, Banksy créé un énorme coup médiatique avec la Petite fille au ballon, œuvre qui s’autodétruit dans son cadre juste après avoir été vendue pour la somme d’1,2 million d’euros.
Un conseil ? Un musée sur l’art de Banksy se trouve à Bruxelles, alors vas-y !

LA CARTE BLANCHE
LE SYSTÈME ÉLECTORAL BELGE VU PAR LE PRÉSIDENT
PAR DIEGO D'ADDATO
Les élections chez nous sont souvent vues comme inutiles puisque les coalitions viennent casser la dynamique des programmes des partis. Ce fonctionnement n’entretient-il pas une forme de biaisement de l’avis donné par le citoyen via les élections ?
Les Belges vont voter prochainement. En juin, nous aurons l’occasion de désigner le modèle de société que nous souhaitons pour les 5 années à venir. Pour le citoyen, ce système est assez simple : il se rend au bureau de vote dans sa commune et fait un choix tant pour les personnalités qu’il désire voir représenter ses intérêts, que pour les grandes lignes idéologiques des mouvements politiques.
Ceci dit, nous ne sommes pas couverts par un fonctionnement dit « majoritaire », comme nos voisins français. Effectivement, le découpage parlementaire belge est, lui, appelé « proportionnel ». Cette méthode électorale spécifique donne un nombre de sièges aux partis en fonction de la quantité de population par région et bien évidemment, en fonction du nombre de voix qui leur est donné.
La Belgique bénéficie d’un système électoral qui garantit une forme de stabilité politique puisqu’il n’est pas possible chez nous que le parti ayant eu le plus de votes gouverne seul, ni même à deux ou trois. Les partenariats, que l’on appelle généralement « coalitions », forcent les différents mouvements à trouver des accords et définir une « déclaration de politique générale » à chaque niveau de pouvoir. On remarque donc d’année en année que les orientations données aux politiques publiques dans les différents exécutifs du pays sont au final assez semblables à quelques détails près. D’où la désignation de l’ennemi politique commun : le statu quo.
Arrêtons-nous un instant sur le dernier gouvernement à l'échelon fédéral. La Vivaldi, en référence à l’œuvre musicale des « Quatre saisons », est composée de sept partenaires : le PS, Vooruit, le MR, l’Open VLD, Ecolo, Groen et le CD&V. Chacun d’eux rejoint une
ligne idéologique précise : le socialisme, le libéralisme, l’écologisme ou le centrisme.
Le symptôme criant de cette réalité institutionnelle est une forme d’inactivité. Sur les réformes du travail, on observe des blocages systématiques venant des socialistes, principalement wallons. Le MR a pour sa part enrayé la dernière proposition de réforme fiscale dénonçant une supercherie qui visait à donner d’une main et à reprendre de l’autre. Sur les réformes institutionnelles, c’est « chou-vert et vert-chou ».
Il apparaît donc compliqué de donner une vraie direction aux enjeux politiques du pays. Notons d’ailleurs que l’ensemble de ce fonctionnement engendre une problématique : lorsque nous devons partager un avis à l’échelle européenne ou internationale, nous sommes souvent fort peu soulagés de constater qu’aucune position ne peut être dégagée à la suite des différends qui tiraillent nos partenaires de gouvernement. Dès lors, que faire ?
Ce magnifique système à la belge nous contraint donc à accepter que nous n’aurons probablement, dans notre petit pays, jamais de grandes réformes en profondeur sur les problèmes dont pâtit la population.
Cependant, il convient de soulever un élément important. Comme dans d’autres pays d’Europe et d’ailleurs, la montée des mouvements catalogués « d'extrême » dans notre pays, pose une réelle question de stabilité dans les gouvernements et pour les décideurs en matière publique. Si la Belgique était soumise au régime du scrutin majoritaire, nous serions en passe d’avoir tant au régional qu’au fédéral des partis populistes au pouvoir, ce qui n’est évidemment pas souhaitable et nous mettrait dans une position bien délicate et très inquiétante, pour les libéraux que nous sommes.
Ce système nous garantit donc une forme de sûreté face à la menace du parti de Raoul Hedebouw, notamment, qui polarise le débat sur les questions de gestion intérieure,
de liberté d’entreprendre, de politique internationale et de neutralité de l’état.
Au lendemain des élections, en espérant que les acteurs politiques arrivent à trouver un accord rapidement, ce qui n’est pas sûr, nous serons donc probablement encore dans une situation qui aboutira à une coalition entre différents partis qui, pour être honnête, ne partagent que très peu de points de convergence. La preuve, les présidents du PS et d’Ecolo ferment déjà la porte à un partenariat avec le MR, Défi s'effondre dans les sondages, Les Engagés ne ferment ni n’ouvrent la porte à personne et le PTB refuse toujours de prendre ses responsabilités en entrant dans un gouvernement. C’est un peu trop facile car nous devrons malgré tout faire des sacrifices afin de ne pas paralyser le pays et battre le record de 589 jours sans gouvernement… Ce qui, pour rappel, handicape l’état puisqu’aucune affectation financière ne peut se faire ni d’un côté, ni de l’autre. Bref, ce n’est souhaitable pour personne.
Par conséquent, le système belge est à ce point imparfait qu’il en est presque problématique. Il serait opportun que l’on réfléchisse à un nouveau mode de scrutin et de formation de gouvernement en vue d’opérer un réel basculement positif. L’équilibre politique d’un pays est bien évidemment primordial, mais doit-on conserver ce modèle en dépit de l’intérêt de la Belgique ? Doit-on maintenir un fonctionnement qui bloque systématiquement les réformes à cause des caprices des présidents de parti, justifiés ou non ?
L’idée d’une assemblée citoyenne ou d’un référendum en la matière semble être une piste de réflexion à approfondir et qui sait, peut-être verrons-nous, avant notre retraite, un changement qui irait, pour une fois, dans le bon sens.
Mais pour finir sur une note positive, restons optimistes puisque, comme dit le dicton : « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » !


Diego
Président de la FEL
/ DÉRISI N /

Le Jour
Accueil > Actus > Culture > Musique

ED MARLAIS REMPORTE LE PROCÈS POUR PLAGIAT
M ais qui est le dindon ? Et où est la farce ?
En cette veille de printemps musical, la nouvelle est tombée pour l’auteur-compositeur-interprète-star-du-net Ed Marlais. Le musicien wallon de 33 ans a gagné son procès au civil à Bruxelles. Il y était poursuivi pour plagiat par un mastodonte multinational influent dans de nombreux secteurs. Encore une affaire qui braque les projecteurs sur la protection des droits d’auteurs.
PAR CORALIE BOTERDAEL
Publié le 19/03/31 à 19h53
Temps de lecture : 3 min.
Ed Marlais, le duc de la pop belge, a remporté hier après-midi son procès au civil où il était poursuivi pour plagiat. Son album « World in drache », gros succès de 2030, était accusé d’être dans sa quasi intégralité – textes, sons, illustrations et vidéoclips – une contrefaçon. Vingt-cinq millions d’euros de dommages et intérêts lui étaient réclamés pour violation de droits d’auteur. Bien plus, le plaignant désirait qu’Ed soit rayé de l’industrie musicale et que lui soit rendue la paternité de cette œuvre à succès. Le label discographique ne serait pas en reste, avait avancé le plaignant, sa liberté créative étant, selon ses propres dires, sans borne. Du jamais vu !
Largement plébiscité par la génération alpha, l’album d’Ed Marlais s’est vendu – format physique compris –à 987.654.321 exemplaires. Il cumule plus de 2 milliards d’écoutes rien que sur la jeune plateforme belge Spotifrite et est certifié double album de platane en France. Son titre « Volle elektriciteit » est rapidement monté dans les charts, il est resté n°1 pendant 9 semaines, 2 jours et 7 heures. Le jour de sa sortie, son clip vidéo – où on le voit en plein exercice de plongée sous-marine, une Casio au poignet, un Cola dans une main et un Oppo dans l’autre – atteint le million de visionnages sur YouPube.
Mais il semble que son succès planétaire ait fait des envieux. Et au lendemain des D6bels Music Cés’art, le mis en cause avait reçu une mise en demeure pour violation de droit intellectuel. À l’instar de son public, ce dernier y était resté sourd, mais son adversaire ne l’entendait pas de cette oreille et l’avait attaqué en justice. Car s’il est clair et net que les productions d’Ed Marlais sont loin d’être des œuvres de l’esprit, il s’agissait surtout de distinguer si elles venaient du sien ou non. Un verdict en faveur du musicien a été rendu hier par le juge Itsu après de longs mois d’un duel judiciaire et médiatique inédit.
Pendant le procès, Ed Marlais ne cessait de se défendre : « C’est quand même bien moi – et personne d’autre – qui ai eu l’idée de faire sortir mon album sous 51 pochettes différentes, 13 disques spéciaux et 4 éditions de vinyles colorés. » Il arguait à qui mieux mieux que multiplier les versions de son disque pour en influencer les ventes était la preuve irréfutable de son génie. Il n’empêche qu’avoir du talent pour l’argent est une chose, avoir le don de création en est une autre. Malheureusement, le tribunal ne s’est pas prononcé sur les conditions d’originalité de l’album, il a surtout établi que la qualité du plaignant pesait dans la décision.
Et de fait, l’absence répétée de ce dernier n’a pas plaidé en sa faveur. Nonobstant son apparent don d’ubiquité, il était difficile pour lui d’apparaitre en chair et en os devant le juge. Sans cesse sollicité par le monde entier, il tardait même parfois à répondre aux mails de son propre avocat. Tant et si bien que le procès s’est éternisé et que toutes les parties impliquées ont perdu patience. Ce n’était pourtant pas la première fois que ChatGPT-5 se plaignait que tout un chacun usurpait sa créativité. Il y a trois mois à peine, d’intelligence avec le générateur d’images DALL-E4, il s’était attaqué au graffeur de renom Bankja, mais l’affaire s’était soldée par un Non-fieu !
Tel l’arroseur arrosé, ChatGPT-5 récolte aujourd’hui les fruits pourris de sa propre arrogance et écope d’une double peine. D’une part, en soulignant que « sa personnalité ne transparait pas dans ses écrits », le tribunal lui a enlevé tout espoir d’être un jour considéré comme un artiste à part entière. D’autre part, en arguant qu’il est « le plus grand voleur d’idées et de style que le monde ait jamais connu », il a ouvert le débat de sa stérilité d’esprit. « Loin de sa prétendue créativité, ses paraphrases internetminables n’inventent rien et plagient servilement la parole humaine » en conclut le prononcé. Tel le copiste qu’il est, ChatGPT-5 a par suite été condamné par la justice à citer toutes ses sources, l’obligeant à produire des listes infiniment plus longues que les textes qu’il génère lui-même.
Mais l’affaire ne s’arrête pas là ! Si le tribunal bruxellois n’a pas puni Ed Marlais, ses fans, eux, s’en sont chargés. Un mouvement sans précédent sur les réseaux sociaux lui reproche son imposture. De par le monde, ses plus grands fans, devenus ses pires haters, changent leur photo de profil pour la remplacer par la tête du musicien arborant en commentaire le slogan : « Quén’ biesse, ce Ed ! » Parce qu’il a généré les paroles, les mélodies et les images de son album grâce à l’Intelligence Artificielle, son public l’accuse de ne pas avoir repris l’idée d’une seule personne, mais bien de plein d’autres. Une pétition en ligne tourne en ce moment pour l’obliger à faire don de 650.000 euros aux AA – l’association des Artistes Anonymes – et à présenter des excuses publiques. La justice populaire obtiendra-t-elle gain de cause ? L’Avenir le dira.
Les implications de ce procès chamboulent l’industrie musicale du web et la guilde des générateurs par IA… Les adeptes du copiercoller ne semblent plus avoir le vent en poupe. L’ère de l’authenticité reprendrait-elle son envol ?
À LIRE AUSSI

Ed Marlais veut raconter sa vie au cinéma
PUBLIÉ LE 08/03/31 À 15H21
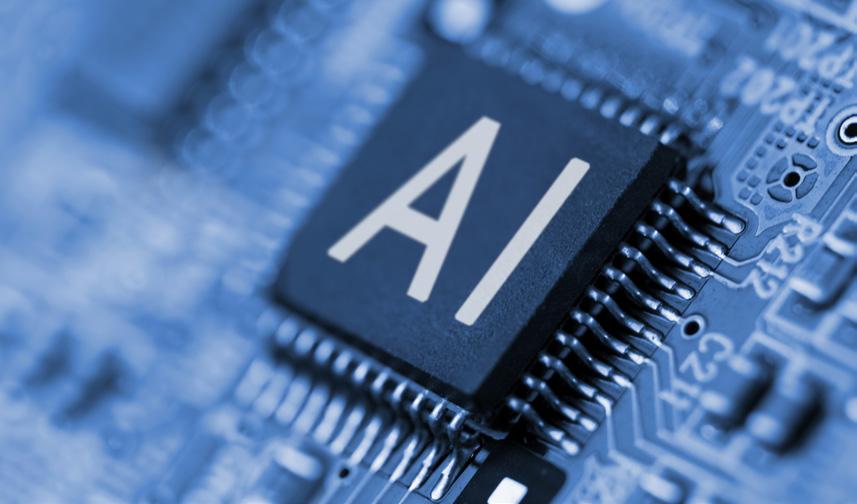
Les secrets d’une machine à voix humaine
PUBLIÉ LE 12/03/31 À 8H35

/ BIBLIOGRAPHIE /
EURéparé par Noha Devillers
CLASEN A., « Droit à la réparation : La proposition de la Commission pour réduire le gaspillage », 23 mars 2023, sur https://www.euractiv.fr/ section/economie/news/droit-a-la-reparation-la-proposition-de-la-commission-pour-reduire-le-gaspillage, consulté le 19 février 2024.
CLASEN A., « Directive sur le droit à la réparation : La commission du Marché intérieur du Parlement européen adopte sa position », 26 octobre 2023, sur https://www.euractiv.fr/section/economie/news/directive-sur-le-droit-a-la-reparation-la-commission-du-marche-interieur-du-parlement-europeen-adopte-sa-position, consulté le 19 février 2024.
CLASEN A. (2023, novembre 22). « Droit à la réparation : Le Parlement européen adopte sa position de négociation », 22 novembre 2022, sur https://www.euractiv.fr/section/economie-circulaire/news/droit-a-la-reparation-le-parlement-europeen-adopte-sa-position-de-negociation, consulté le 19 février 2024.
Représentation en France, « Droit à la réparation : La Commission introduit de nouveaux droits pour les consommateurs en vue de faciliter et de favoriser les réparations - Commission européenne », 22 mars 2023, sur https://france.representation.ec.europa.eu/informations/droit-la-reparation-la-commission-introduit-de-nouveaux-droits-pour-les-consommateurs-en-vue-de-2023-03-22_fr, consulté le 20 février 2024.
L'âge exponentiel : Une fenêtre d’opportunité pour les jeunes par Colin Gilson
MORREN N., « Il n’y a pas d’âge pour devenir indépendant », Acerta, 16 mars 2022, sur https://www.acerta.be/fr/insights/blog/starters/il-ny-apas-dage-pour-devenir-independant, consulté le 20 février 2024.
LOUIS P., « Les créateurs d’entreprises sont de plus en plus jeunes », BFM BUSINESS, 3 février 2021, sur https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/les-createurs-d-entreprises-sont-de-plus-en-plus-jeunes_AN-202102030347.html, consulté le 20 février 2024.
Institut national de la statistique et des études économiques, « Créateurs d’entreprises selon l’âge et le sexe », Insee, sur https://www.insee.fr/ fr/statistiques/2015206, consulté le 20 février 2024.
SPF Economie, « Les travailleurs indépendants selon l’âge et l’origine », economie.fgov.be, 13 février 2023, sur https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/entrepreneuriat-et-diversite/les-travailleurs-independants-1, consulté le 20 février 2024.
SPF Economie, « Profil des travailleurs indépendants », economie.fgov.be, 17 août 2023, sur https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/ pme-et-independants-en/les-travailleurs-independants/profil-des-travailleurs, consulté le 20 février 2024.
MATTIN D. et PAL R., « The Exponential Age Series : Part 1 », Real Vision.com, 23 octobre 2023, sur https://www.realvision.com/shows/the-exponential-age/videos/the-exponential-age-series-part-1-Eao1?tab=details, consulté le 20 février 2024.
JULY B. « Entreprendre en Belgique : un défi d’autant plus grand quand on est d’origine étrangère », Le Soir, 13 mars 2023, sur https://www. lesoir.be/500698/article/2023-03-13/entreprendre-en-belgique-un-defi-dautant-plus-grand-quand-est-dorigine-etrangere, consulté le 20 février 2024.
En 2024, vers un avenir prometteur pour la lutte contre les cancers du côlon et du pancréas par Sarah Sciarrabba
FRANÇOIS A., « L’Université d’Anvers développe un nouveau traitement contre les cancers du pancréas et du côlon », Belga, VRT NWS, 11 février 2024 , sur https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2024/02/12/l_universite-d_anvers-developpe-un-nouveau-traitement-contre-les/#:~:text=Une%20 %C3%A9quipe%20de%20recherche%20de,qui%20sont%20difficiles%20%C3%A0%20traiter, consulté le 28 février 2024.
Fondation contre le cancer, Informations sur le cancer du pancréas, sur https://cancer.be/cancer/cancer-du-pancreas, consulté le 28 février 2024.
Fondation contre le Cancer, Brochure « Baromètre belge du cancer », édition 2021, sur https://cancer.be/brochure/barometrecancer, consulté le 28 février 2024.
Le statut d’artiste : Un régime fiscal et social avantageux par Nassim Sabibi
PINTIAUX A., « Quel est le nouveau statut d’artiste ? », Le Soir, 06 février 2024, consulté le 28 février 2024.
Académie AMPLO, « Tout savoir sur le statut d’artiste », sur www.amplo.be, consulté le 28 février 2024.
Constitutionnalisation de l’IVG : Un pas en avant qui en appelle d’autres par Arthur Watillon
APPAERTS B., « Réflexions sur la possibilité et les effets de l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution belge », lesoir.be, 07 mars 2024, sur https://www.lesoir.be/573000/article/2024-03-07/reflexions-sur-la-possibilite-et-les-effets-de-linscription-du-droit-lavortement, consulté le 16 mars 2024.
AMNESTY, « Éléments clés sur l’avortement », amnesty.org, s.d., sur https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts, consulté le 16 mars 2024.
BOEVER E., CARLIER B. et POLLARD A., « Sans médecins formés aux IVG, l’accès à l’avortement est menacé », rtbf.be, 28 septembre 2023, sur https://www.rtbf.be/article/sans-medecins-formes-aux-ivg-lacces-a-lavortement-est-menace-11263108, consulté le 16 mars 2024.
BOLSSENS J., GARDIOL D., « Droit à l’IVG en Belgique : décryptage des menaces et des pièges dissimulés », ccfb.be, 04 février 2021, sur https:// www.cffb.be/droit-a-livg-en-belgique-decryptage-des-menaces-et-des-pieges-dissimules, consulté le 16 mars 2024.
LEHUFFPOST, « Pourquoi le vote de l’IVG dans la Constitution est une victoire "imparfaite" pour ces féministes », youtube.com, 05 mars 2024, sur https://www.youtube.com/watch?v=u8VvudtIBaE&t=13s, consulté le 16 mars 2024.
MAZUIR V., « IVG dans la Constitution : ce qu’il faut savoir », lesechos.fr, 04 mars 2024, sur https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ ivg-dans-la-constitution-ce-quil-faut-savoir-2072211#:~:text=La%20France%20est%20devenue%20le,parlementaire%20de%20cette%20 r%C3%A9vision%20constitutionnelle, consulté le 16 mars 2024.
Composition cover : Shutterstock
Images d’illustration : Shutterstock
© Fédération des Étudiants Libéraux
BLUELINE
PRÉSIDENT ET ÉDITEUR RESPONSABLE :
Diego D'ADDATO
Avenue de la Toison d’or, 84 - 86 1060 Bruxelles
CONTACT :
Tél : +32 2 500 50 55 info@etudiantsliberaux.be
RÉDACTEUR EN CHEF :
Arthur WATILLON
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE :
Lara ZENGINOGLU
ASSISTANTS DE RÉDACTION :
Coralie BOTERDAEL - Louis MARESCHAL
RÉDACTION :
Coralie Boterdael, Diego D’Addato, Noha Devillers, Colin Gilson, Nassim Sabibi, Sarah Sciarrabba, Arthur Watillon, Lara Zenginoglu
DIRECTION ARTISTIQUE :
Gaëlle FRANÇOIS
AVEC LE SOUTIEN :


