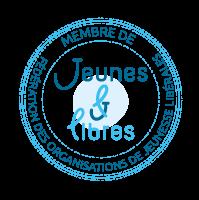BLUELINE



VALEUR ÉGALITÉ DES CHANCES
L'égalité des chances, le jeu en vaut la chandelle !
DOSSIER
LE MONDE FACE À L'URGENCE
DÉMOGRAPHIE EN HAUSSE
Un enjeu planétaire et global
DÉCARBONISATION ET ÉNERGIE VERTE
L'intelligence humaine face au réchauffement climatique
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Entre abondance et faim, l'envers de l'assiette
LA TENTATION DE L'AUTORITARISME
NOVEMBRE 2023


NAVIGUER DANS LA TEMPÊTE
La hausse des taux d'intérêt et ses répercussions sur la récession de 2023
24 D'autres fenêtres
26 INTERVIEW FRANÇOISE BERTIEAUX
Quoi de neuf dans le supérieur ?
DÉRISION
NOSTALGIE, PASSÉISME ET CONTAGION
Sortez vos cagoules et pulls en laine chinée pour vous protéger
BIBLIOGRAPHIE
Solution blâmable sur fond de problèmes durables
20 LA COURSE À L'ARMEMENT
N'y en a-t-il jamais assez ?!...

ÉDITO
Cher lecteur, Chère lectrice,
Nouvelle année académique rime généralement avec nouveaux enjeux, nouveaux défis. Ceux-ci, parfois conséquents, souvent nombreux, définiront en grande partie les conditions d’avenir de chacun et chacune d’entre nous.
Semblablement, à l’échelle planétaire, d’abondantes gageures, presque toujours considérables et systématiquement urgentes, détermineront les conditions de notre existence commune sur Terre. Sécurité alimentaire, crise climatique, explosion démographique, autant de défis communs qui exigent du genre humain des réponses universelles. À l’heure où ces enjeux mondiaux frappent ardemment à la porte de notre maison commune, nous avons décidé de consacrer le dossier central de ce seizième Blue Line à leur étude. C’est ainsi qu’au sein de ce dossier, nous dépeindrons les enjeux démographiques, alimentaires et économiques, en passant par le réchauffement climatique et la tentation de l’autoritarisme.
Hors dossier, d’une part, nous vous proposons une interview de Françoise Bertieaux, remplaçante de Valérie Glatigny, sur la brûlante actualité de l’enseignement supérieur. D’autre part, une métaphore, particulièrement bien amenée, sur l’égalité des chances. Enfin, notre seizième trimestriel se clôturera par notre désormais traditionnelle dérision, sur le thème du passéisme.
Cher lecteur, chère lectrice, je te souhaite une agréable lecture,


L'égalité des chances, le jeu en vaut la chandelle !
Depuis la nuit des temps, les philosophes dissertent sur la notion d’égalité et son application concrète dans notre société. Ainsi, certains considèrent qu’une société composée d’individus égaux n’est atteinte que dans le cas où chacun possède objectivement les mêmes biens, résultats ou grades. Quant aux autres, ils déplorent la concrétisation d’une valeur dont l’existence même leur paraît devoir être niée : la société s'accommodant mal avec un principe peu corrélé à la multiplicité de nos individualités.
PAR NATHAN VOKAR

Derrière cette controverse axiologique se cache en réalité deux points de vue divergents : d’un côté, certains envisagent l'égalité dans une perspective finaliste tandis que les autres la considèrent dans une perspective initiale. Cette opposition est parfaitement illustrée dans le domaine idéologique et politique. Ainsi, on peut largement inférer que les finalistes sont en réalité socialistes ou marxistes, là où les initiateurs sont sûrement libéraux.
Les libéraux, héritiers des Lumières, placent leur foi en l’Homme. Ainsi, pour eux, l’Homme est capable du meilleur dès l’instant où il a appris à exploiter toutes ses potentialités. Le développement de ses aptitudes n’est aucunement inné, celui-ci suppose en réalité travail et vertu. Et puisque, comme tout pédagogue se plait à le dire, une bonne illustration vaut toujours plus que de longues et fastidieuses explications, voici une métaphore exemplative pour tenter d’expliciter l’égalité à travers le prisme philosophique libéral.
Lorsqu’il naît, chaque individu reçoit des cartes. Ces cartes peuvent être plus ou moins fortes ou faibles en fonction du domaine considéré, celles-ci représentent les qualités et les fragilités innées de chacun. Il y a autant de combinaisons différentes de cartes que d’individus au caractère singulier, chaque joueur a donc des atouts et des faiblesses qui lui sont intrinsèques et particuliers. En sus de cette dévolution naturelle d’aptitudes bonnes ou moins bonnes, chaque individu est amené tout au long de son existence à apprendre les règles du jeu de cartes.
C’est précisément lors de l’apprentissage de ces règles qu’une répartition artificielle et inique s’opère entre les individus. Ainsi, suivant le milieu social de chacun, certains vont bénéficier d’une initiation plus ou moins perfectionnée aux règles du jeu de cartes. En effet, en prime de ce qu’il a déjà dans sa main, l’un va pouvoir acquérir plus facilement des compétences compatibles avec ses cartes tandis que l’autre, moins chanceux, aura beaucoup plus difficile à développer son jeu. C’est donc l’apprentissage des règles du jeu de cartes qui paraît injuste. De cette façon, un individu naturellement stratège à l’esprit aiguisé mais qui n’a pas été suffisamment formé au déroulement du jeu risquera davantage de perdre la partie face à un joueur dont la logique et la réflexion ne sont pas des qualités propres mais qui a reçu l’enseignement du champion du monde.
Concrètement, il n’est pas requis que tous les joueurs gagnent : cette solution serait d’ailleurs contraire aux règles du jeu de cartes et briserait la saveur de la partie. S’il est effectivement logique que le meilleur joueur se voit attribuer la qualité extrinsèque de gagnant, il est parfaitement compréhensible que le joueur qui a su moins bien manier ses cartes se voit qualifier de perdant. Cependant, il est fondamental que les deux joueurs se voient conférer un traitement égalitaire au début du jeu : ainsi, il est exigé que le croupier n’ait pas influencé favorablement ou défavorablement un des joueurs lors de la distribution des cartes. Il est en outre important que les deux joueurs jouissent d’un niveau de connaissance égal des règles du jeu avant le début de celui-ci.
Parallèlement, il est important que chaque individu naissant dans notre société puisse bénéficier des mêmes chances, ceci dans une pluralité de domaines sociaux. Ainsi, il me paraît totalement inéquitable qu’un nouveauné ne se voit pas attribuer les mêmes possibilités que son semblable. Il est donc du ressort des pouvoirs publics de faire en sorte que l’ensemble des Belges puissent jouir des mêmes conditions d’apprentissage. Effectivement, il apparait primordial que chaque enfant naissant dans notre État se voit conférer le droit de suivre une instruction de qualité, sans distinctions liées à l’indice socio-économique de sa localité ou autre critère idoine. On constate ici pleinement le rôle de l’école et de ses enseignants, valablement institués de missions sociétales de premier plan. L’école est le terreau fertile nécessaire à l’épanouissement de chacun : grâce au concours du personnel éducatif, les plus jeunes ont la chance d’acquérir de nombreuses connaissances, non seulement théoriques et intellectuelles mais également pratiques et sociétales. Une société dans laquelle l’égalité des chances est réellement mise en œuvre est une société dans laquelle la pierre angulaire est l’école : chaque enfant y trouvant un lieu propice à la découverte du monde qui l’entoure et des possibilités y afférant. De manière plus prosaïque, l’école est un grand trampoline Park permettant à chaque enfant de sauter pour pallier les inégalités apparues à la naissance et remettre chacun au même niveau. En somme, il me paraît fondamental d’offrir un large champ des possibles à l’ensemble de la population. Chacun étant ensuite libre de l’élargir ou le restreindre suivant ses aspirations personnelles, on mérite et son travail. Chacun étant ensuite libre de déployer peu ou prou tel ou tel atout de sa combinaison de cartes.
Au-delà de la question égalitaire pouvant se poser au début du jeu, il en est une autre que tout entraîneur doit >>

se poser. Cette dernière étant de savoir comment influencer favorablement le joueur afin que celui-ci gagne plus facilement ? La solution paraît aller de soi : il suffit de dispenser les meilleurs conseils possibles au joueur afin qu’il améliore sa technique et se voit plus facilement attribuer la victoire. Mais là encore, il est utile de garder à l’esprit que les conseils ne font pas tout !
Certains joueurs moins malins ne saisiront peut-être pas directement les règles du jeu, tandis que les autres bénéficieront d’un apprentissage plus rapide grâce à leurs capacités cognitives. Aussi, certains plus fainéants pourraient préférer la distraction à l’apprentissage intensif des techniques dispensées, là où d’autres pourraient se surpasser et réitérer encore et encore les parties de jeu, ce qui entraînerait inévitablement une augmentation des capacités du joueur.
Malgré cette apparente dualité, la vérité est toute autre : là encore, la société ne s'accommode pas avec la fatalité !
S’il est vrai que malgré des efforts importants, certains joueurs moins vifs ne pourront rivaliser avec des joueurs doués d’une logique inébranlable mais peu entraînés, personne n’est doté de facultés amoindries, cellesci ne demandent en réalité qu’à être dévoilées. Ainsi, un piètre joueur de carte peut en réalité constituer un très bon musicien, danseur ou encore écrivain. Pareillement, le meilleur joueur de cartes peut s’avérer être
extrêmement mauvais dans la sphère artistique, musicale ou littéraire.
Quant à l’opposition résultant de l'entraînement intensif d’un des joueurs face à l’oisiveté de son adversaire, aucun sentiment d’inégalité ne peut en être conclu. En effet, l’Homme ne peut uniquement se baser sur l’inné en se désintéressant de l’acquis. Un tel comportement serait totalement inique car il supposerait que seuls les individus dotés de cartes assez fortes lors de la distribution pourraient avoir une chance de gagner là où l’acquis des joueurs ayant travaillé à l’accroissement de la technique ne pourrait de facto s’avérer payant. À dire vrai, ce scénario serait formellement illibéral car il conjurait l’émancipation par le travail au profit d’une fatalité déplacée !
En conclusion et comme dit précédemment, il y a deux façons de concevoir l’égalité : les conceptions initiales et finalistes s’opposent drastiquement. D’un côté, on peut envisager l’égalité sous sa facette initiale et converger vers une pensée optimiste : celle d’un individu au jeu de carte unique mais qui reçoit un enseignement qualitatif et commun à ses semblables afin de tendre vers une égalité des chances. Cette dévolution initiale, bien sûr artificielle, permet ensuite à chacun d’entre nous de mener sa vie comme il l’entend en gardant en tête les principes de liberté, de travail et de mérite. De l’autre côté, il est également possible d’envisager
l’égalité sous l’angle final et donc de considérer qu’à tout instant, chacun doit posséder les mêmes biens, résultats ou grades. Cette vision de prime abord alléchante n’est en réalité qu’un trompe l'œil ! En effet, comment tendre vers davantage de bien-être et de progrès si chaque acte de labeur, de bravoure ou mérite se voit minoré par une compensation automatique des possessions gagnées à l’ensemble de la population ? Quelle serait la motivation de chacun à se donner tout entier à l’amélioration de ses conditions de vie si celles-ci ne s’avèrent n’avoir qu’un effet compensatoire ?
Considérer l’égalité sous l’angle final n’est en réalité qu’un moyen de saper nos valeurs sociales de liberté, de travail ou de mérite. Qui se targuera encore d’être libre lorsque ses seules aspirations seront uniquement constituées par la volonté parallèle de l’ensemble de la population ? Qui voudra encore se lever tôt le matin pour aller travailler quand il apprendra que son labeur ne saurait le récompenser ? Enfin, qui ferait encore preuve de résilience et continuerait à se battre pour offrir davantage de bienêtre et de confort à la population s’il apprend que la reconnaissance sociale n’existe plus ?
Le combat en faveur de l’égalité des chances n’est donc pas un fantasme idéologique, mais bien un véritable combat en faveur du progrès, de l’émancipation et de la liberté !


Nathan Étudiant, FELU

DOSSIER Le monde face à l'urgence
Évoluer d’une population de 7 à 8 milliards en à peine douze ans, ce n’est pas seulement une simple statistique, c’est une épopée en perpétuelle expansion. La croissance démographique embrasse sans relâche notre planète, en particulier dans les pays en développement. Ces temps de changements profonds ne s’arrêtent évidemment pas qu'à la croissance démographique.
N’avons-nous pas non plus tous été témoins par exemple de l’ascension implacable du coût de la vie ? Un monde où même nos besoins primaires ne sont plus satisfaits, où la qualité de l’alimentation échappe à ceux qui vivent d’un revenu modeste. Un monde où les doléances quant à l’injustice grondent, et les citoyens se demandent pourquoi il est si difficile de freiner le trafic des armes et les fusillades. Sans même savoir que le conflit russo-ukrainien a été un des facteurs ayant notamment facilité le commerce des armes, une réalité sombre à peine évoquée.
Face à ces défis titanesques ou encore à ces récits alarmants sur le réchauffement climatique, sommes-nous condamnés à retourner à une vie plus rudimentaire et moins énergivore, voire à abandonner nos aspirations à façonner un avenir ?
Devant les défis auxquels fait face la démocratie contemporaine, certains optent même en faveur d’un système plus autoritaire, un revirement pourtant longtemps condamné. Mais comment définirions-nous ces enjeux et ces évolutions extraordinaires ? Sont-ils le reflet d’une décomposition, d’un basculement ou d’une crise de la démocratie ? S’agit-il d’une continuité ou d’une véritable rupture ? La société moderne s’est-elle en effet retournée contre elle-même ?
C’est ainsi que nos rédacteurs et rédactrices ont choisi, dans ce dossier central, d’aborder ces questions et réalités qui mettent notre monde face à l’urgence.
démographie en hausse
Un enjeu planétaire et global

Le 15 novembre 2022, notre planète Terre s’est certainement trouvée plus lourde, plus encombrée que la veille. À cette date, le compteur de la population mondiale annonçait le dépassement des huit milliards d’habitants. Il aura suffi de douze petites années pour passer ce cap, de sept à huit milliards d’êtres humains, de quoi réveiller les vieilles peurs suscitées par un accroissement rapide de la population. Devant cette démographie en hausse, la question semble légitime : dans quelle mesure l’humanité est-elle capable de faire face à l’explosion démographique mondiale annoncée ?

C’est
quoi la démographie aujourd’hui ?
Appréhendons notre sujet : la démographie est l’étude des populations et, notamment, de leurs variations. La croissance démographique se définit donc comme la hausse de la population mondiale. Cette hausse se mesure au moyen du taux d’accroissement naturel, qui correspond à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Ainsi, à l’échelle mondiale, deux facteurs influencent considérablement la démographie : l’espérance de vie et le taux de fécondité.
La pyramide des âges a marqué une évolution majeure en l’espace d’un siècle. En effet, l’espérance de vie mondiale s’est envolée, passant de 34 ans en 1913 à 72 ans en 2022. En matière d’espérance de vie, malgré des progrès enregistrés, il demeure des inégalités entre les pays. À la naissance, l’espérance de vie dans les pays les moins avancés accuse un retard de 7,4 ans par rapport à la moyenne mondiale. Ce retard est essentiellement causé par une forte mortalité infantile et maternelle, la violence des conflits ou la présence du VIH.
Concernant le taux de fécondité, malgré une hausse démographique sans précédent au cours de ces dernières décennies, dans le même temps, entre 1970 et 2020, la fécondité a chuté dans tous les pays sans exception. Selon les prévisions, le taux de fécondité mondial devrait passer de 2,5 à 2,2 enfants par femme en moyenne d’ici à 2050. Ces estimations permettent ainsi d’affirmer que l’humanité devrait atteindre son apex démographique d’ici à la fin du siècle avant de connaître une baisse démographique généralisée.
Un enjeu démographique différent selon la zone géographique
Aujourd’hui, nous sommes huit milliards sur Terre, ce chiffre tendra à augmenter considérablement d’ici les prochaines décennies. Selon des estimations réalisées par les Nations unies, nous pourrions atteindre les 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050, 10,4 milliards en 2080 et 11,2 milliards d’individus en l’an 2100.
Face à cette hausse, un constat s’impose : le taux d’accroissement de la population varie considérablement en fonction des régions géographiques et des revenus. Ainsi, dans les pays à faible revenu et particulièrement en Afrique, le rythme est disproportionnellement élevé, là où dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé, particulièrement en Europe, le rythme est disproportionnellement bas. D’ici à 2050, plus de la moitié de la croissance démographique se fera en Afrique, avec notamment une Afrique subsaharienne >>

dont la population devrait doubler, pour atteindre 2,4 milliards d’habitants. Exemple extrême, le Niger, aujourd’hui peuplé d’un peu plus de 22 millions d’habitants, pourrait voir sa population passer à 167 millions d’ici 2100, devenant ainsi le douzième pays le plus peuplé au monde. Ce boum démographique africain est, entre autres, permis par un grand nombre de jeunes qui atteindront, dans les prochaines années, un âge où ils seront en capacité de procréer.
Inversement, d’ici à 2050, la population de 55 pays devrait diminuer, dont 26 pays d’au moins 10 %. En Europe, les régions les plus marquées par cette baisse sont les pays d’Europe de l’Est, telles que la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie ou encore la République de Moldavie, avec une démographie diminuant de 15 % sur la même période. Le reste de l’Europe n’est pas épargné par ce phénomène, l’ensemble du Vieux continent ayant un taux de fécondité inférieur à celui nécessaire pour parvenir à un seuil de renouvellement de la population à long terme, soit une moyenne de 2,1 enfants par femme.
Ces variations démographiques engendrent des conséquences importantes pour nos sociétés. Détaillons en quatre : l’enjeu des ressources, la question de l’urbanisation, les phénomènes migratoires et l’impact socio-économique.ggggggggggggggg
Les tensions autour des ressources
La hausse de la population mondiale conduit à la nécessité de nourrir un nombre grandissant d’êtres humains. Or, aujourd’hui, environ 800 millions de personnes souffrent déjà de la faim. L’augmentation des « bouches à nourrir » fait donc craindre des tensions grandissantes autour de l’accès aux ressources alimentaires et particulièrement à l’eau. Les exemples de tension font pléthore. La Syrie et l’Irak sont tous deux à la merci de leur grand voisin turc, chez lequel le Tigre et l’Euphrate, essentiels aux cultures, prend sa source. L’eau de l’Euphrate a d’ailleurs
souvent servi de moyen de pression brandi par Ankara dans les rapports avec ses homologues arabes. Dans le Golfe persique, sur fond de tensions entre sunnites et chiites, l’Arabie Saoudite est dépendante des usines de dessalement d’eau de mer de son voisin l’Iran, poussant Riyad à construire d’immenses réserves d’eau afin de parer à une éventuelle attaque de Téhéran. D’ici à 2030, soit dans moins de dix ans, les pénuries d’eau douce toucheront près de 40 % de la population mondiale et pourraient exposer jusqu’à 700 millions d’individus à un potentiel déplacement.
De plus, la nécessité de nourrir une population grandissante a un coût environnemental fort. Aujourd’hui, plus de 30 % de la surface terrestre émergée est dédiée à l’agriculture. Ce chiffre devrait augmenter, avec une destruction accrue de savanes, de prairies et de forêts nouvellement mises en culture. Cette dégradation massive de l’environnement et de la biodiversité toucherait aujourd’hui 23 % des sols mondiaux.
Le problème de l’urbanisation
Aujourd’hui, d’après les Nations unies, 57 % de la population mondiale vit en ville. Ce chiffre pourrait grimper à 68 % d’ici à 2050, avec une croissance urbaine particulièrement forte sur les continents africain et asiatique. Bémol, dans ces régions du monde, la croissance urbaine se fait bien souvent sans véritable planification, engendrant des infrastructures inadaptées ou défaillantes, donnant elles-mêmes naissance à de véritables bidonvilles. Les régions les plus exposées à ces habitats insalubres et où sévit une grande pauvreté sont l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, où environ 50 % de la population vit dans des bidonvilles, contre 24 % à l’échelle mondiale. Dans certains pays, la situation s’avère catastrophique : 74 % au Soudan, 78 % en République démocratique du Congo et 82 % des citadins du Tchad vivent dans des bidonvilles.
Outre la lutte contre des conditions de vie délétères, les autorités nationales et locales doivent gérer efficacement l’urbanisation. Actuellement, bien qu’elles n’occupent que 2 % du territoire mondial, les villes produisent 80 % du produit intérieur brut mondial et plus de 70 % des émissions de carbone.
Des millions de déplacés
En 2019, on chiffrait le nombre de migrants internationaux, c’est-à-dire les personnes vivant en dehors de leur pays d’origine, à près de 272 millions. Cela représente 3,5 % de la population mondiale. Les motifs de migration sont variés, ils peuvent être liés au travail, à la famille ou à l’éducation. Néanmoins, un nombre croissant de personnes émigrent de leur région d’origine pour des raisons de violence, de persécutions, de pauvreté ou de catastrophes climatiques. En 2018, ces motifs ont poussé 70 millions de personnes à se déplacer de force. En 2023, ceux-ci sont déjà 110 millions… Une immigration de nécessité qui se renforce sous l’effet des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement. Les conséquences de ces déplacements sont désastreuses. Tout d’abord, le nombre grandissant de réfugiés impacte lourdement le financement des plans d’aide. Au Kenya, là où se trouve l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, le camp abrite trois fois plus de personne que prévu. En raison des réductions de financement, chaque réfugié ne reçoit plus que 80 % des rations alimentaires recommandées. Faute de moyens, celles-ci pourraient encore diminuer. De plus, ces mouvements ne sont pas sans risques. Les femmes et les enfants, représentant la majorité des personnes déplacées, s’exposent à des risques élevés lors de leur déplacement : violence sexiste, traite, exploitation et abus en tout genre. Enfin, ces migrations sont particulièrement défavorables pour les pays d’immigration, dans le sens où ce sont majoritairement des pays pauvres ou en voie de développement qui doivent assurer la charge de l’accueil.
L’impact socio-économique
Sur le plan socio-économique, la démographie fait question. Alors que certaines régions souffriront d’un cruel manque de main d’œuvre, d’autres devraient bénéficier d’une importante quantité de bras, nécessaire à une production plus importante. En effet, l’accroissement de la population risque de faire exploser la demande en besoins et en produits nouveaux. À titre d’exemple, l’Afrique pourrait devenir le nouvel eldorado de la mondialisation, avec une main d’œuvre pléthorique à bas coûts qui pourrait pousser de très nombreuses
entreprises à y délocaliser leurs productions. Néanmoins, cette assimilation d’une population conséquente en main d’œuvre abondante ne pourra se faire que si les États ont la capacité de former celle-ci au travail et à faire montre de leur stabilité afin d’attirer les investisseurs étrangers. À l’opposé, l’Allemagne connaît déjà une pénurie de personnes actives, la poussant à se tourner vers la migration pour remédier à son problème de main d’œuvre. Dans cet objectif, en 2015, l’Allemagne avait accueilli 800 000 migrants.
Autre impact, en Europe, le déséquilibre des âges pose l’épineuse question du financement de la protection sociale, particulièrement des retraites, dans la mesure où le nombre d’inactifs ne cesse d’augmenter. Cette réalité pousse de nombreux pays à reculer l’âge de la pension. D’ici à 2030, dans de nombreux pays comme la Belgique, l’Allemagne ou les Pays-Bas, l’âge légal de la pension passera à 67 ans. Au Danemark, en 2040, cet âge légal pourrait être poussé à 70 ans, de quoi faire pâlir nos voisins français.
Quelle issue ?
Face à ces conséquences, difficile de se réjouir. Néanmoins, gardons-nous d’un excès de pessimisme malthusien et prenons nos responsabilités. Bien entendu, l’humanité n’échappera pas à un surcroît démographique de plusieurs milliards d’individus. Néanmoins, cette tendance n’est pas immuable, puisque la population mondiale décroîtra fortement à partir de 2100. De plus, selon de nombreux experts, l’humanité est parfaitement capable de faire face à cette augmentation exponentielle et polarisée de la population mondiale. En effet, nous sommes en mesure de produire suffisamment de ressources et de créer des conditions de vie décentes pour l’ensemble de la population. Par exemple, aujourd’hui, nous produisons déjà assez de calories pour nourrir l’ensemble de la population terrestre. Toutefois, l’enjeu de la lutte contre le gaspillage et de la modification des modes de consommation est essentiel afin de nourrir la population de façon saine, équitable et durable. Ainsi, la soutenabilité démographique nécessite un véritable changement de modèle que « la croissance démographique appelle de ses vœux, plus en lien avec le respect de l’environnement et le développement durable ». Face à cela, nous ne sommes pas tous armés de la même manière et les luttes sont nombreuses : il est donc essentiel que l’aide publique au développement soit augmentée afin que les pays les plus riches aident les plus pauvres à se développer afin de relever le défi démographique.

Rédacteur en chef
décarbonation et énergie verte L'intelligence humaine face au réchauffement climatique
Le réchauffement climatique s’annonce comme le fléau des années à venir. Au-delà des constats alarmants et des défis que nous devrons surmonter, de nombreuses solutions existent. L’une des plus prometteuses est sans nul doute celle des carburants synthétiques, ou e-fuels, produits en partie depuis le CO².
Les émissions et leurs effets
Chaque année, l’humanité émet plus de 40 giga tonnes de dioxyde de carbone, ou CO². Comme il n’est pas le seul gaz à effet de serre, par facilité, nous parlerons systématiquement d’équivalent d’émissions de CO², ou CO²eq. En moyenne, un citoyen belge émet une douzaine de tonnes d’équivalent CO² dont la majorité est issue des transports, du chauffage et de l’industrie (alimentaire et tertiaire).
En continuant à ce rythme et sans changement, il apparaît clairement que nous fonçons droit dans le mur, les chiffres sont sans appel !
Le premier impact direct de ces émissions est le réchauffement global de la planète causé par l’effet de serre. Ce phénomène initialement naturel permet de conserver une partie des ondes électromagnétiques du soleil (principalement les UV et la lumière visible) et de disposer d’une température sur Terre permettant la vie telle que nous la connaissons. Sans lui, la température de la Terre serait de -18°. Fort heureusement, Dame Nature fait bien les choses et une « couche », nommée
« effet de serre naturel » et composée de plusieurs gaz naturellement présents, laisse passer les ondes dans un sens, mais en retient une portion dans l’autre. L’équilibre parfait a perduré jusqu’à l’ère industrielle, il a été rompu quand l’espèce humaine s’est mise à produire ces gaz en excédent. Petit à petit, nous avons émis davantage que la Terre n’était capable d’en absorber et la « couche » a commencé à s’épaissir : c’est alors qu’apparaît l’effet de serre anthropique. Il entre dans notre atmosphère autant de chaleur solaire qu’auparavant, mais une quantité plus grande de chaleur est retenue car l’effet de serre est renforcé par l’activité humaine. Au rythme auquel nous vivons actuellement, la température moyenne mondiale devrait augmenter de 2 à 5° d’ici à 2100, ce qui changerait considérablement nos modes de vie.
Les impacts du réchauffement climatique seront nombreux : la montée du niveau de la mer, la pénurie d’eau douce, la perte de la biodiversité, l’insécurité alimentaire… Ce qui entrainera, entre autres, les vagues migratoires les plus importantes de l’histoire. Tout cela sera lié de près ou de loin au réchauffement global de la planète : 2° peuvent sembler peu, mais il s’agit d’une moyenne et cela causera des effets que nous sommes loin d’être prêts à surmonter.
PAR BENJAMIN REULAND

Quelles solutions ?
Il existe deux grandes écoles : ceux qui trouvent la solution dans la régression et ceux qui pensent que la technologie et le progrès nous sauveront.
En régressant, nous retrouverions un mode de vie proche de celui connu par le passé, sans avions, sans voitures, sans appareils électriques gourmands en énergie, sans le confort que nous connaissons aujourd’hui.
Concrètement, il s’agit d’arrêter de consommer pour arrêter d’émettre.
La technologie nous apporte pourtant déjà de nombreuses pistes pour éviter d’en arriver là. En effet, nous savons désormais produire de l’électricité dite « bas carbone », qui ne fait plus appel aux énergies fossiles et n’émet que peu de CO², grâce à l’énergie renouvelable, au nucléaire, ou encore aux biomasses, qui sont directement issues de la vie végétale et animale.
Par ailleurs, nous sommes également capables de capter du CO² par différents moyens techniques tels que la DAC (Direct Air Capture) ou la CCS (Carbon Capture and Storage). La première technique permet d’extraire le CO2 présent directement dans l’air et la seconde, grâce à des dispositifs installés à la sortie des usines, permet de capturer le CO2 avant qu’il ne rentre dans l’atmosphère. Le dioxyde de carbone ainsi capté et stocké peut ensuite être utiliser à des fins industrielles pour fabriquer des produits tels que les e-fuels. Ces carburants synthétiques sont produits de manière artificielle par différents processus chimiques. À grande échelle, cela permet donc de capter le CO² qui contribue à l’effet de serre
et de limiter son action, tout en créant du carburant utile à toutes les applications qu’on lui connaît. D’ailleurs, ces carburants alternatifs permettent de conserver les moteurs thermiques, et donc tous les véhicules existants puisqu’il s’agit, au final, des mêmes composés chimiques.
Il est important de noter qu’il est aujourd’hui très compliqué et cher de stocker de l’énergie en grande quantité (c’est par exemple ce que font les installations hydroélectriques). Ces carburants permettent de pallier ce problème puisque, lorsque les énergies renouvelables fournissent trop d’électricité, cette dernière peut être valorisée en production de carburant. Leur dernier gros atout est qu’ils sont d’une flexibilité redoutable. Avec le temps, il est tout à fait imaginable de voir les processus améliorés et la molécule adaptée afin de réduire au maximum les polluants produits par la combustion.
Les carburants synthétiques représentent selon moi la meilleure perspective d’avenir concernant le besoin d’énergie et la crise climatique qui sévit depuis quelques décennies, puisqu’ils englobent la plupart des avantages, en une solution. Aussi, il est plus que temps d’engager une vraie politique d’investissement dans le futur, d’arrêter de se limiter à la gestion « au jour le jour » pour une gestion « un coup d’avance ». L’adhésion du citoyen face à la gestion actuelle est en décroissance totale. Le passage à l’électrique, la fermeture des centrales bas carbone pour favoriser celles à gaz – qui émettent bien plus de CO2 –, les différentes taxations environnementales… posent question. Pourtant, il y a des possibilités d’innovation technologique qui permettraient de ne pas chambouler nos vies. Il ne reste plus que la volonté pour y arriver.

Étudiant, FELU
Usine de captage de dioxyde de carbone dans l'air, par Climeworks.
L'(in)sécurité
alimentaire

Entre abondance et faim, l'envers de l'assiette
Peut-on parler de sécurité alimentaire dans un contexte où des millions de personnes endurent encore la faim, où les coûts des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter, où la qualité des produits se dégrade de jour en jour ? De plus, l’emploi fréquent d’additif, de pesticide et l’industrialisation de la production alimentaire rendent-ils ce sujet encore pertinent ?
PAR LARA ZENGINOGLU
Mais alors, qu’entend-t-on par sécurité alimentaire ? Citons ici une définition donnée lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
Quelques chiffres clés :

LE VÉRITABLE PÉCHÉ CAPITAL
La gourmandise a souvent été présentée comme un péché mignon, mais n’avons-nous pas franchi une limite dans notre société axée sur la consommation ? N’avons-nous pas surestimé nos besoins alimentaires ? Cependant, peut-on vraiment nous blâmer ?
Il est indéniable que lorsque l’on sait que 28 millions d’enfants en Europe sont touchés par l’obésité et que 148 millions d’enfants en Afrique souffrent de retard de croissance dû à l’insécurité alimentaire, le contraste est frappant. Pourtant, les deux sont victimes d’excès, principalement dus à une société de consommation
de masse. L’obésité, souvent perçue comme le résultat d’un abus d’abondance et donc associée à la sécurité alimentaire, se révèle en réalité être le revers caché de l’insécurité alimentaire. Même si la dimension psychologique demeure le facteur prédominant, il est manifeste que la consommation de produits de moindre qualité en est également une des causes significatives.
Dans une société où la publicité a su habilement camoufler les problèmes de malnutrition, il n’est pas surprenant de constater cette situation. Et même lorsque nous sommes informés de la composition médiocre de nos produits, certains additifs incorporés ont le pouvoir de nous rendre dépendants, causant ainsi un cercle vicieux. >>
* Connaissez-vous le E621, communément appelé « Glutamate de Sodium ». Cet exhausteur de goût synthétique permet de relever le goût de vos aliments. Il peut se retrouver dans vos chips préférées, votre soupe en sachet, vos nouilles ou encore dans certains produits de régime. Il perturbe les hormones qui régulent votre appétit et serait une des principales causes de l’obésité.
Le
dilemme des produits biologiques : une solution salutaire, mais à quel prix ?
Alors, dans le but d’améliorer leur qualité de consommation certains se tournent vers le fameux label bio. En Europe, en effet, les produits biologiques sont soumis à un contrôle strict et régulier, ce qui les exempte de certains pesticides et additifs interdits pour ces produits. Bien entendu, la préservation de votre santé à un prix. Par exemple, lorsque l’on compare le prix au kilo d’une poule standard à celui de son homologue étiqueté bio dans un même supermarché, on constate une différence de 4€/kg à 12,65€/kg.
Et puis, le label bio comporte un coût, plus positif cette fois-ci, qui ne se mesure pas seulement en termes financiers ; il apporte également sa contribution, d’une certaine manière, à la lutte contre le réchauffement climatique. D'une part, il limite les émissions de polluants, et d'autre part, il favorise le stockage accru de CO2 dans le sol.
L’industrialisation et l’essor de l’agriculture intensive
Toutefois, l’agriculture biologique n’est pas un mode de production conventionnel. En effet, dans les pays industrialisés, l’objectif commun est d’atteindre une autosuffisance alimentaire pour réduire leur dépendance à l’égard d’autres pays. Pour ce faire, ils privilégient généralement un système agricole intensif. Cependant, cette orientation confronte ces nations à des défis majeurs tels que la déforestation, la pollution des sols, la désertification, la diminution de la biodiversité ou encore la pollution des eaux, qui sont tous étroitement liés à la santé publique. Par exemple, l’utilisation intensive de pesticides affecte la qualité de nos fruits et légumes, nos poissons sont contaminés de microplastiques, et nos animaux d’élevage sont exposés à des hormones et des antibiotiques.
En outre, l’importance de l’agriculture dans le développement national est bien comprise. L'amélioration de la productivité agricole peut réduire les coûts de production agricole, mais cela ne suffit pas en soi. Il est donc impératif de favoriser l’essor du secteur agricole,
ce qui nécessite des investissements en capital humain pour stimuler les capacités d’innovation et d’adaptation des travailleurs agricoles. Cela pourrait également ouvrir des opportunités dans des secteurs rémunérateurs pour la main-d’œuvre agricole active.
Cependant, il est important de noter que, dans un contexte d’industrialisation rapide de la société et d'accentuation de l’individualisme, il peut sembler difficile de se projeter vers une société davantage axée sur l’agriculture. L’automatisation croissante menace nos emplois, et l’individualisme prévaut, créant un sentiment de déconnexion sociale. Dans une société où la paresse semble devenir de plus en plus présente, où les salaires ne reflètent pas toujours les efforts déployés, où les repas sont livrés à domicile, et où le travail est souvent motivé par des objectifs personnels plutôt que par des convictions profondes, il est compliqué de se projeter vers une société davantage orientée vers l’agriculture.
En temps de crise, l’alimentation en première ligne
Comme nous l’avons compris, l’agriculture revêt une grande importance au niveau national pour le développement d’un pays. Cependant, comment se positionne-t-elle en période de crise ? Qu’en est-il de la relation entre le secteur agroalimentaire et les citoyens en situation d’urgence ?
N’a-t-on pas déjà tous observé les étagères de nos supermarchés se vider au cours de la pandémie de COVID-19 ? L’approvisionnement alimentaire s’est avéré être la principale préoccupation en période de crise.
En réalité, bien avant l’avènement de la pandémie, les systèmes alimentaires étaient déjà confrontés à de grandes difficultés. La prévalence de la faim augmentait depuis plusieurs années, touchant 811 millions de personnes en 2020 tandis que plus de trois milliards d’individus n’avaient pas accès à une alimentation. La pandémie a amplifié ces problèmes en perturbant considérablement le système des transports, y compris les transports internationaux, ce qui a eu un impact significatif sur de nombreux pays dépendant de ces réseaux. Ainsi, la pandémie a ajouté une couche de stress supplémentaire, particulièrement dans les pays

où l’insécurité alimentaire était une préoccupation constante.
Pourtant, des axes d’intervention se dessinent pour éclairer les voies essentielles de la transformation des systèmes alimentaires. Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a été désigné par les Nations Unies comme entité leader de l’axe d’intervention numéro 4, intitulé : « Promouvoir des moyens de subsistance équitables ».
L’objectif principal du FIDA lors de ce sommet est de premièrement, « mettre les petits exploitants agricoles et la population rurale au cœur de la transformation des systèmes alimentaires et des efforts visant à atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) », et deuxièmement, « Utiliser son expertise spécialisée et ses connaissances pour stimuler le dialogue et contribuer à l'adoption d'engagements concrets à l'échelle mondiale en faveur de la transformation durable des systèmes alimentaires ».
Le lobby agroalimentaire, après nos assiettes ?
Comme c’est le cas dans tous les domaines, il existe des petits secrets que l’on cache au grand public. Ces informations sont parfois mises en lumière par quelques esprits critiques. Et souvent, il ne faut pas toujours aller bien loin. Alors que les autorités publiques s’efforcent avec détermination d’informer les citoyens sur les produits qu’ils consomment et s’emploient à promouvoir une meilleure sensibilisation nutritionnelle,
un obstacle majeur se dresse sur leur chemin : les lobbies agroalimentaires. Prenons, par exemple, la loi française du 10 janvier 1992, qui vise à lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme, connue sous le nom de loi Évin. Cette loi comprend plusieurs mesures, notamment l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de l’alcool, l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ainsi que l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs. Cependant, cette loi n’est pas passé inaperçue aux yeux des lobbies agroalimentaires qui ont mené une contre-campagne, notamment avec l’introduction de l’amendement buvette. Cet amendement permettait aux groupements sportifs de vendre de l’alcool. De plus, en 2005, la loi a été modifiée pour autoriser l’inclusion de références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine, ainsi que des références objectives relatives sur la couleur et les caractéristiques olfactives et gustatives du produit dans les publicités pour l’alcool.
Actuellement, nous pouvons également constater la persistance de cette contre-campagne, où le lobby agroalimentaire finance le domaine publicitaire, le marketing et les stratégies d’influence, jouant ainsi un rôle décisif dans la psychologie des citoyens en matière de nutrition. Combien d’entre nous ont déjà jeté un coup d’œil aux dessous de nos publicités, où l’objectif semblait davantage être la vente plutôt que l’information. Une autre stratégie employée par ce lobby consiste à semer le doute en promouvant par exemple, de fausses études sans fondement prétendument favorables à la santé. Il est donc essentiel de développer un esprit critique pour ne pas tomber dans ces pièges si aisément tendus.
Vous l’aurez donc compris, votre assiette est un enjeu mondial qui peut revêtir plusieurs rôles : elle est à la fois un levier économique, un moyen d’influence ou encore une méthode de contrôle. En fin de compte, elle représente bien plus que de simples aliments. Votre assiette a des implications politiques, une réalisation que les plus vulnérables ont déjà depuis longtemps intégrée. C’est pourquoi la sécurité alimentaire demeure un défi complexe à l’échelle mondiale, exigeant des actions concertées à l’échelle internationale, des choix individuels éclairés, ainsi qu’une réflexion continue sur la façon dont nous produisons et consommons nos aliments.

Rédactrice en chef adjointe
LA TENTATION
SOLUTION BLÂMABLE SUR FOND DE PROBLÈMES
DURABLES
AUTORITAIRE

Indépendamment des études et sondages consultés, le constat est sans appel : la démocratie dans le monde recule, est contestée, ne fait plus rêver. À cet égard, un Belge sur deux se dit en faveur d’un régime plus autoritaire. Mais comment donc notre démocratie libérale en est-elle arrivée là ? L'espoir en la matière n’est-il plus permis ? Tentons ensemble de dessiner quelques éléments de réponse.
La démocratie libérale, une histoire, une fin ?
Le modèle dit de démocratie libérale – entendu comme la conjonction des principes d’État de droit, de libertés individuelles/politiques, de séparation des pouvoirs – s’est peu à peu imposé chez nous au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Prospérant sur fond de croissance économique pendant près de 4 décennies, cette organisation étatique syncrétisme du concept de démocratie représentative et de l’idéologie libérale connaît son paroxysme début des années 90. Certains se risquant même à proclamer à l’époque, « la fin de l’histoire », le triomphe mondial et irréversible de la pensée libérale. L'euphorie, cependant, ne fut que de courte durée…
« L'âge des espérances perdues »
Le mode de pensée néolibéral avait vaincu son dernier adversaire, en 1991, il en était fini de l’URSS. La mondialisation débutée dans les années 70 allait désormais pouvoir finir de recouvrir le globe. Les promesses de « lendemain qui chantent » pleuvaient, la théorie du ruissellement faisait consensus, « tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Du
moins jusqu'à ce que la réalité batte en brèche l’espoir de milliers de citoyens… En premier lieu, les gages économiques donnés à la population ne tardèrent pas à voler en éclat. Certes le « gâteau » économique avait grossit, cependant, le « ruissellement » qui devait lui être assorti, lui, n’occurra pas. La compétition de tous contre tous avait bénéficié aux plus riches, le peuple, lui, était entré dans « une lutte des places ». Un sentiment de déclassement parcourait désormais de larges parts de la population, le voisin était devenu un adversaire en lieu et place d’un compagnon. Les espoirs d’une société tendant vers plus de prospérité pour tous étaient désormais vains. Concomitamment, la démocratie représentative entra, elle aussi, en crise. La défiance déjà créée par les non résultats économiques, s’amplifia à l’aune d’un fait : la mondialisation dérégulée avait privé les États-nations d’outils nécessaires à la défense de leurs travailleurs. La classe politique était perçue de plus en plus comme déconnectée, les citoyens perdaient confiance…
Un ennemi :
LE NÉOLIBÉRALISME
La perte de confiance citoyenne, la crise de la démocratie libérale, vous l’aurez compris, est multifactorielle. Nonobstant, l’origine de ces crises est selon moi aisément désignable : le néolibéralisme. « Changer l'âme et le cœur des hommes », voilà comment Margaret Thatcher décrivait l’objectif du néolibéralisme. Aujourd’hui, à posteriori, il apparaît clairement que cette idéologie les aura pervertis. Le néolibéralisme, je le pense sincèrement, est une pensée extrémiste. À ce titre, elle a mis en danger notre démocratie ; en désinvestissant complètement l’état de l’économie ; en instrumentalisant une compétition économique mondiale défavorable aux peuples et à la planète ; en se faisant le chantre d’un individualisme débridé… Néanmoins, ce que cette pensée aura certainement fait de plus mal à notre système, c’est de le bouleverser, de le détruire, sans jamais proposer d’alternative.
L'apparition d’une non solution
Ainsi, l’espace était là. La conjonction de ces crises était violente, des solutions étaient réclamées, les mesures proposées, elles, insuffisantes. Partant, au tournant des années 2000, une forme politique que l’on pensait disparue à jamais en Europe reparut : le populisme autoritaire. Appuyant sur le sentiment de déclassement vécu par une large partie de la population, antagonisant les êtres humains, faisant des immigrés des boucs émissaires, ces mouvances s’imposèrent peu à peu,
d’abord dans les sondages, ensuite dans les parlements et désormais même dans les gouvernements. Pour nombre de citoyens, ces mouvements aux finalités autoritaires apparurent comme la seule alternative viable à un système qui leur avait beaucoup promis mais encore plus pris. Si les raisons qui ont conduit ces personnes à voter pour ces formations sont concevables, le choix de l’autoritarisme ne peut être louable. À cet effet, un rappel s'impose. Bien que les formes de populisme auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés ne sont pas celles des années trente (elles ne sont plus aussi frontalement anti-démocratiques), leur dangerosité et les similarités entre leurs programmes ne peuvent être négligées. De fait, les projets sont en cela comparables qu’ils prônent semblablement la « régénération de la nation (considérée en déclin), [...] la refondation de l’unité ethnoculturelle du corps social (menacé par les migrations), [...] l’incarnation du pouvoir dans la figure d’un leader détenant le monopole moral et politique de la représentation populaire (contre un establishment ne représentant que ses propres intérêts), [...] la survalorisation de la souveraineté du peuple via des formes de démocratie plébiscitaire et référendaire (contre les corps intermédiaires et les structures parlementaires parasitant l’expression de la volonté générale) et [...] la promotion de la force et de la brutalité dans la rhétorique et l’action politique ». Les ambitions politiques analogues de ces deux modèles de pensée, nous mènent d'emblée à une interrogation glaçante : l’histoire est-elle en train de se répéter ?
Le libéralisme CONTRE le
néolibéralisme
La tentation autoritaire existe, elle s'intensifie même. Trop longtemps, nous l’avons ignorée. Trop longtemps, nous avons cru qu’elle n’était que la résultante d’un cycle politique immuable. Trop longtemps, nous l’avons sousestimée… Aujourd’hui, tous les démocrates devraient s'atteler à priver les mouvements autoritaires de leur fuel. Aujourd’hui, tous les démocrates devraient s'atteler à régler les problèmes d’inégalités, de manquements démocratiques, d’éthique en politique. Aujourd’hui, tous les démocrates devraient s'atteler à mettre en place des institutions proprement libérales. En revalorisant le travail comme créateur de richesse. En revalorisant l'État comme acteur économique légitime. En s'attaquant aux inégalités qui ne seraient pas effacées mais raisonnées.
La tentation autoritaire existe, elle s'intensifie même. Face aux dégâts causés par le néolibéralisme, nous nous devons de réhabiliter un libéralisme progressiste, social, écologiste !

Course à l'armement
N'y en a-t-il jamais assez !?...

D’après un certain nombre de sources, les premières armes à feu ont vu le jour aux alentours du 14e siècle. Cependant, le besoin de sécurité est un besoin vieux comme le monde. Déjà au temps des premiers hommes, le sentiment d’insécurité et l’envie de se sentir en capacité de se défendre étaient bien présents. On a vu apparaître des armes en tout genre et ce, de tout temps. Ceci dit, comment expliquer l’escalade toujours grandissante de la fabrication et du commerce d’armes ? Comment ne pas s’inquiéter de cette soif d’artillerie jamais assouvie ? Décortiquons ces questions au regard de deux grands évènements.
Un premier fait historique, souvent cité lorsqu’on évoque l’industrie de l’armement, est la célèbre guerre froide, qui s’est étendue de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin de l’an 1991. Le sentiment d’insécurité d’après-guerre a alors fermenté tout au long de cette période de discorde et de menaces de conflits. C’est à ce moment-là qu’on a assisté à l’essor de l’industrie des armes, à
la course effrénée vers davantage d’armes, toujours plus puissantes et destructrices. L’ensemble des États du monde se trouvait dans la crainte d’un éclatement de la tension régnant dans l’air à l’époque. Les deux acteurs de ces hostilités étant les premières puissances militaires, à savoir les États-Unis et l’URSS, la situation demeurait source d’inquiétude pour la planète dans sa globalité. Comme l’histoire l’a montré, ce conflit s’est éteint avec la démission de Gorbatchev et la dislocation de la grande Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Ce dernier événement fut vécu par les glorificateurs d’une URSS forte comme une véritable trahison de la part de l’ancien dirigeant soviétique. On pourrait presque dire, comme une humiliation
PAR DIEGO D'ADDATO

publique puisque visible par le monde entier. C’est entre autres à cause de ce sentiment que survient le second évènement.
Le second phénomène, et non des moindres au vu de sa place dans l’actualité mondiale depuis près d’un an et demi, est le conflit russo-ukrainien. Ce conflit, débuté par une offensive militaire russe lancée le 24 février 2022, trouve ses origines bien plus tôt. Il remonte à la dissolution de l’Union soviétique et la reprise de son indépendance par l’Ukraine. De nombreux observateurs avaient d’ailleurs déjà alerté l’Europe et averti celle-ci d’une invasion potentielle de l’Ukraine par le régime de Poutine. Aujourd’hui, ce qui semblait être une tentative désespérée d’annexer ce territoire, tourne vraisemblablement à un massacre en bonne et due forme. Indépendamment de la complexité entourant cette lutte entre deux pays aux portes de l’Europe, il est clair que cette guerre a ébranlé les rapports de forces. Devant ce conflit de haute intensité, les armées de par le monde mobilisent de gros investissements dans le secteur des armes, qui se porte aujourd’hui à merveille.
Un vieil adage précise ceci : « La guerre est le meilleur moyen pour relancer l’économie ». À priori ces conflits ne font que des perdants, les victimes et, dans une certaine mesure, l’agresseur. Cependant, un secteur sort du lot de part un maintien ou, dans certains cas, une augmentation de son chiffre d'affaires, il s’agit du marché de l’armement. En 2009, débutait le conflit de Boko Haram dans le Sahel ; en 2012 et 2014, commençaient la guerre du Mali et le premier conflit Ukraine-Russie. Le point commun entre ces divers évènements est assez évident : là où une guerre éclate, le marché des armes, notamment celui des États-Unis qui en détiennent le monopole, explose.
Tout comme les guerres favorisent l’industrie de l’armement, les fusillades font augmenter la vente d’armes aux particuliers. Même malgré des accidents récurrents impliquant des armes à feu, ce commerce ne cesse de tourner. Est-il encore normal que près d’une dizaine d'États autorisent leurs citoyens à détenir des armes sans aucune restriction ? Les USA en chantre de la moralité occidentale auraient pu déjà statuer sur cette question en s’inspirant de l’Europe. Prenons l’exemple
belge, depuis 2006 la loi sur les armes règlemente leur détention pour les particuliers. Depuis, à moins d’avoir un permis spécial, il est totalement interdit de détenir des armes à feu. Ainsi, à l’image du contrôle qui a été mis en place pour les particuliers en Belgique et des mesures similaires prises par de nombreux pays, ne devrait-ton pas appliquer le même genre de mécanisme à échelle mondiale ?
Malheureusement, si pour les particuliers le système du refus catégorique du port d’armes prévaut majoritairement, pour les États, c’est une autre dynamique. Pour eux, tout est possible. Les États peuvent largement développer et fabriquer des armes de plus en plus puissantes et dévastatrices. Cette course à l’armement coûte des milliards d’euros qui, d’une part, sont perdus pour le contribuable, et qui d’autre part, profitent essentiellement à l’économie américaine.
Précisons qu’au niveau des grandes économies, c’est l’escalade. La course à l’armement se transforme en une course au nucléaire. Face à cette situation d’accroissement d’ogives nucléaires, il est bon de se questionner. L’ICAN, la Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires, ONG lauréate du Prix Nobel de la paix en 2017, annonce que seules 1.000 missiles nucléaires seraient nécessaires afin de rendre notre planète totalement inhabitable. Ce nombre représente seulement 5% du stock mondial à l’heure actuelle. Dès lors, deux questions se posent : À quoi cela sert-il de continuer à accumuler de plus en plus d’armes de ce genre ? Et, ce constat ne serait-il pas un bon point de départ afin de lancer une grande campagne de désarmement nucléaire à l’échelle mondiale ?
Comme on peut le remarquer, l’industrie de l’armement rappelle le mouvement d’un boomerang revenant en boucle continue, comme s’il subissait la première loi du mouvement selon Newton, mais au sein de la société. Vraisemblablement, jamais aucun évènement ne pourra mettre un frein sur la production, la vente et le développement des armes. Le marché de ce qu’on peut considérer comme des outils de mort et de destruction ne subit jamais aucune friction. Cela est plus qu’inquiétant. Il est donc grand temps de se poser les bonnes questions et de mettre en place les mesures adéquates.

Diego
Président de la FEL
Naviguer dans la tempête
LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT
SES RÉPERCUSSIONS SUR LA RÉCESSION EN 2023&

En 2023, une récession dévastatrice, principalement déclenchée par une hausse significative des taux d'intérêt, a secoué le monde. Cette situation a exacerbé les pressions sur le coût de la vie et le marché du travail, laissant de nombreuses personnes dans l'incertitude et la précarité. Cet article, s'appuyant sur des sources diversifiées, explore les mécanismes sous-jacents de cette crise, les répercussions sur les individus et les entreprises, et envisage des solutions pour surmonter les défis et bâtir un avenir économique plus robuste et équitable.
Cette année, le monde a été confronté à une récession économique profonde engendrée, pour l’essentiel, par la hausse des taux d’intérêt des banques centrales mondiales. Cette mesure, bien que destinée à contrôler l'inflation, a eu des répercussions considérables sur le coût de la vie et le marché du travail. Les conséquences de cette décision ont été ressenties bien au-delà des salles de conférence des banques centrales, touchant les ménages, les entreprises et les gouvernements du monde entier. Les difficultés économiques pour des millions de personnes ont mis en lumière les vulnérabilités inhérentes de l'économie mondiale, nécessitant
une introspection approfondie et des solutions innovantes.
Cause de la Récession : Hausse des Taux d'Intérêt
La décision des banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, d'augmenter les taux d'intérêt a été un élément déclencheur majeur de la récession. Comme le souligne Xinnan Wang dans son article sur l’impact de la hausse des taux fédéraux, cette hausse a non seulement affecté les marchés financiers et des matières premières, mais a également mis sous pression les économies émergentes et développées. L'accès au crédit est
devenu plus coûteux, réduisant la consommation et l'investissement, et entravant ainsi la croissance économique. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent l'épine dorsale de nombreuses économies, ont été particulièrement touchées, faisant face à des coûts d'emprunt accrus et à une demande en berne. Cette conjoncture a entraîné des licenciements, une réduction des heures de travail et une stagnation des salaires, contribuant à un climat économique incertain et précaire. De plus, la confiance des investisseurs a été ébranlée, entraînant des retraits massifs de capitaux des marchés émergents, exacerbant encore la crise.
PAR NATHAN BERCKMANS
Impacts de la Récession : Coût de la Vie et Marché du Travail
La récession induite par la hausse des taux d'intérêt a eu un impact dévastateur sur le coût de la vie et le marché du travail. Les ménages ont vu leurs dépenses quotidiennes augmenter, tandis que leurs revenus stagnaient ou diminuaient. Les prix des biens et services essentiels, tels que l'alimentation, le logement et les soins de santé, ont grimpé, érodant le pouvoir d'achat des consommateurs et augmentant la précarité financière. Les familles à faible revenu et les travailleurs à revenu fixe ont été particulièrement vulnérables, faisant face à des choix difficiles entre nourriture, logement et santé. Sur le marché du travail, la situation était tout aussi sombre. Les entreprises, confrontées à des coûts d'emprunt élevés et à une demande réduite, ont été contraintes de réduire leurs effectifs, augmentant ainsi le taux de chômage. Les travailleurs restants ont dû faire face à une insécurité d'emploi accrue, à des réductions de salaire et à des conditions de travail précaires. Les jeunes et les travailleurs peu qualifiés ont été particulièrement touchés, se retrouvant souvent au chômage ou sous-employés, avec peu de perspectives d'amélioration. De plus, la mobilité professionnelle a été entravée, limitant les opportunités pour les travailleurs de changer d'emploi ou de secteur.
Solutions Possibles : Concertation et entraide
Face à ces difficultés, la coopération internationale et l'adoption de politiques économiques adaptatives
sont essentielles. Les gouvernements et les institutions financières doivent travailler de concert pour stabiliser les marchés, soutenir les entreprises et les travailleurs affectés, et promouvoir des solutions durables pour l'avenir. Celles-ci sont nombreuses, en voici certaines.
PROGRAMMES DE SOUTIEN AU REVENU : Inspirés des mesures prises lors de la crise financière de 2008, des programmes tels que les allocations de chômage, les subventions directes ou les crédits d'impôt pour les ménages à faible revenu ont été réintroduits dans de nombreux pays, comme les ÉtatsUnis avec leur American Rescue Plan
INCITATIONS À L'EMPLOI : En s'inspirant des politiques post-crise de 2008, des gouvernements comme celui de la France ont offert des incitations fiscales aux entreprises pour encourager l'embauche et la formation, contribuant ainsi à réduire le taux de chômage.
INITIATIVES DE FORMATION : Des pays comme l'Allemagne ont renforcé leurs programmes de formation professionnelle, préparant les travailleurs à des emplois dans des secteurs en croissance, tels que la technologie ou les énergies renouvelables.
POLITIQUES MONÉTAIRES ET FISCALES : Les banques centrales, s'inspirant des leçons de la Grande Récession, ont adopté des politiques monétaires v accommodantes, avec des taux d'intérêt bas et des programmes d'achat d'actifs pour soutenir l'économie.
COOPÉRATION INTERNATIONALE :
Le G20, qui avait joué un rôle crucial lors de la crise financière de 2008, a continué à promouvoir la coopération économique et financière entre les principales économies pour répondre aux défis mondiaux.
En somme, la récession de 2023, tout comme la crise financière de 2008, a mis en évidence les fragilités de l'économie mondiale. Cependant, en tirant des leçons du passé et en s'adaptant aux enjeux actuels, il est possible de forger un avenir économique plus résilient. Les crises économiques, bien que dévastatrices, offrent également l'opportunité de repenser et remodeler l'ordre économique mondial. Les leçons tirées de cette récession, combinées à celles de crises antérieures, peuvent guider les décideurs dans la formulation de politiques plus robustes.
Il est également essentiel de reconnaître que la prospérité économique ne peut être durable que si elle est inclusive. Les politiques doivent veiller à ce que les bénéfices de la croissance soient largement partagés et que les populations vulnérables soient protégées.
En faisant preuve de résilience, d'innovation et de coopération, la communauté mondiale a la capacité de surmonter les défis actuels. En regardant vers l’horizon, il est essentiel de bâtir un avenir économique plus stable et prospère, où le bien-être des individus est au cœur des préoccupations et où la prospérité est partagée équitablement. Nathan Étudiant, ADEL

D’AUTRES FENÊTRES…
PAR LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS LIBÉRAUX
Les défis de notre époque sont colossaux. Face à cela, nous devons être armés ! Ainsi, développer nos connaissances, élargir nos horizons et aiguiser notre esprit critique nous semblent incontournables. Si les grands enjeux du monde vous passionnent, quoi de mieux que d’en apprendre davantage à travers des supports variés, accessibles et divertissants ? Bien que non-exhaustives, ces quelques pistes pourraient alors vous intéresser.
FILM
La Vague de Dennis Gansel, 2008.
En Allemagne, un professeur de lycée propose à ses élèves d’animer une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d’un régime totalitaire. Sous forme de jeu de rôle grandeur nature, les élèves obéissent désormais à des règles strictes et se reconnaissent à travers un uniforme, un salut et un cri, le professeur jouant le rôle du meneur autoritaire. Galvanisés, de plus en plus d’élèves prennent goût à l’expérience et rejoignent le mouvement de « La Vague » (Die Welle). Néanmoins, ceux-ci oublient peu à peu qu’il s’agit d’une activité éducative et transforment le groupe en une véritable communauté néo-fasciste. Désormais, la guerre est déclarée entre « La Vague » et ses adversaires, jusqu’à une fin tragique… Ce film bien mené pose un questionnement crucial qui nous tient à cœur dans ce dossier : Sommes-nous capables de combattre l’éventuel retour de toute forme d’autoritarisme ou de dictature et sommes-nous prêts à nous protéger de toutes les atrocités qui pourraient en découler ?
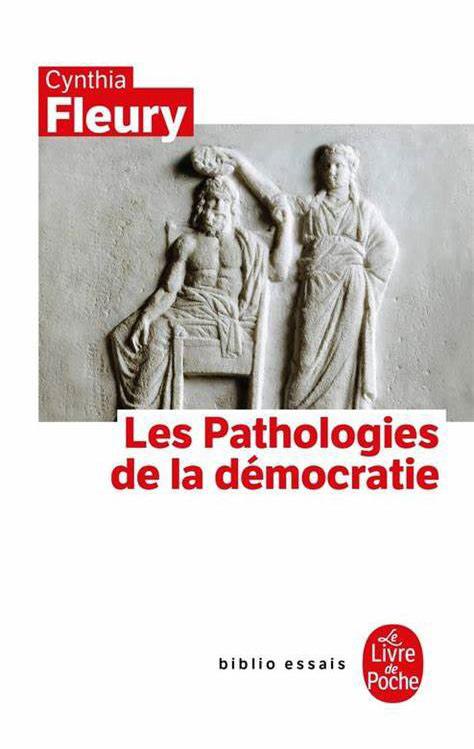
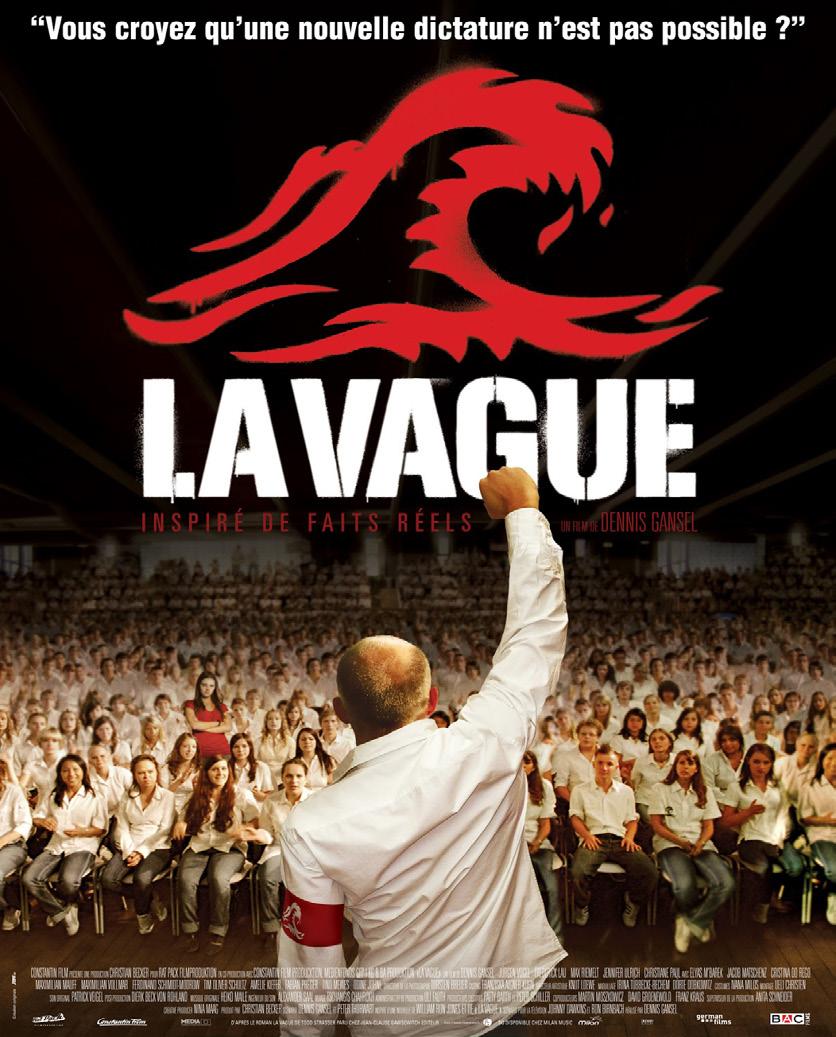
LIVRE
Les Pathologies de la démocratie de Cynthia Fleury, 2009.
Dans cet essai, Cynthia Fleury nous emmène au fin fond de la démocratie française. Explorant les faiblesses et les enjeux de la démocratie contemporaine, la philosophe entreprend une analyse des divers maux qui affectent la démocratie, tels que la montée de l’individualisme ou encore l’apathie politique. Elle suggère des approches pour tenter de remédier à ces pathologies ou pour tout simplement conduire la démocratie à l’âge dit « adulte ».
En bref, ce livre offre une analyse pertinente d’une problématique largement présente dans nos démocraties imparfaites, le tout, en restant accessible.
ASSOCIATION
Club Demeter
siège : Paris, création : 1987.

Non seulement l’impact de l’agriculture sur les transitions climatiques et énergétiques est capital, mais l’équilibre alimentaire s’avère fondamental pour le bien-être humain, animal ou végétal. C’est dans cette optique que le Club Demeter a été fondé en 1987, regroupant de nombreuses entreprises et structures professionnelles autour des questions alimentaires, principalement agricoles.
Le Club Demeter se veut « l’écosystème du secteur agricole et agroalimentaire dont les réflexions prospectives sont tournées vers les enjeux mondiaux, les dynamiques d’innovation et les expériences intersectorielles ».

DOCUMENTAIRE
The Carbon Crooks de Tom Heinemann, 2014.
DOCUMENTAIRE
7,7 Billion People and Counting de Chris Packham, 2020.
Alors que la population mondiale ne cesse de croître et devrait atteindre les dix milliards d’individus à l’horizon 2050, Chris Packam questionne l’impact d’une population toujours croissante et de notre espèce sur le monde.
À travers de multiples décors naturels, suivez le naturaliste dans son enquête, autour de questions essentiels pour une humanité en constante expansion, à la lumière d’une sensibilisation environnementale croissante.
Ce captivant documentaire danois, réalisé par le journaliste Tom Heinemann, nous entraîne dans un voyage aux origines des émissions de carbone. L’épopée de la carbonisation en Europe débute en 2005, avec l’avènement du tout premier crédit carbone de l’Union Européenne. Cependant, cette histoire s’emballe rapidement, donnant naissance à une multitude d’escroqueries et de tromperies liées à ces crédits carbones. C’est précisément ce récit palpitant que ce documentaire nous dévoile, nous maintenant en haleine tout le long du récit.



Quoi de neuf pour l’enseignement supérieur ?
INTERVIEW DE
Françoise Bertieaux
par la Fédération des Étudiants Libéraux
En poste depuis le 19 juillet 2023, Françoise Bertieaux est officiellement devenue la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur au sein du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rythmes scolaires, aides aux étudiants, rémunération des stages, les dossiers à traiter sont nombreux et chauds pour celle qui succède à Valérie Glatigny ! La FEL était désireuse de soulever ces questions dans le cadre d’une interview écrite.
Le 11 septembre 2023, au micro de LN24, PierreYves Jeholet déclarait qu'il fallait forcer les étudiants étrangers à contribuer davantage avec un minerval plus élevé. Est-il vraiment possible de faire payer davantage ces étudiants ?
Le Ministre-Président Pierre-Yves Jeholet s’est en effet exprimé sur le sujet dans Le Soir. Il s’y disait « ouvert à ce qu’on limite davantage (l’accès aux études aux ressortissants étrangers NDLR) ou en les invitant – et non forçant – à contribuer davantage avec un minerval plus important que les étudiants francophones ».
Je pense aussi qu’il serait normal de mener une réflexion sur le fait que les étudiants non-résidents participent plus au coût de leurs études en Belgique, sachant qu’ils n’y paient pas d’impôts et, donc, ne contribuent pas au financement public de notre enseignement supérieur. Cependant, il faut se montrer prudent et respecter les règles de droit international et s’assurer des possibilités dans ce cadre.
La mobilité étudiante sera d’ailleurs à l’ordre du jour de la Présidence belge de l’Union européenne, à partir de ce 1er janvier 2024.
En réaction à la demande du milieu associatif – notamment la FEF – de rehausser les aides aux étudiants, (Madame la Ministre) vous aviez déclaré sur la RTBF qu'une amélioration globale du système d'allocation d'étude était en cours. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Un budget de 6,4 millions supplémentaires pour 2024 a bel et bien été confirmé lors du conclave budgétaire de la FWB. Ce sont ainsi 96,4 millions qui seront alloués aux allocations d’études en 2024. Sur base de ce montant, je mettrai sur la table du Gouvernement les hypothèses qui m’apparaitront les plus favorables pour les étudiants. Par ailleurs, il s’agit là d’un projet inscrit dans la Déclaration de politique communautaire et non un « projet-réaction » à une quelconque demande du milieu associatif.
Seriez-vous favorable à une réforme des rythmes scolaires, comme avancé en amont de cette rentrée académique par l'ARES, quand bien même aucun accord n'a été trouvé sur le sujet ?
Fin septembre, le conseil d’administration de l’ARES a constaté qu’il n’existait pas d’accord entre les différents types d’établissements de l’enseignement supérieur sur une réforme des rythmes académiques. En l’absence d’avis de l’ARES, je ne prendrai aucune décision qui
risquerait seulement d’opposer les établissements entre eux. Ce serait contre-productif ! J’attends dès lors que le CA de l’ARES trouve un consensus.
Une pétition circule actuellement – à l'initiative des Jeunes FGTB et de l'Union Syndicale Étudiante – sur la rémunération des stages avec comme slogan « Pas de salaire, pas de stagiaire ». En effet, pour reprendre leurs mots « Les stages se retrouvent dans la plupart des cursus d'enseignement professionnel ou supérieur et demandent un investissement considérable de la part des stagiaires. Ces stages ne sont pas rémunérés et constituent une forme de travail gratuit ». Qu'en pensez-vous ?
En ce qui me concerne, si les stages ont une réelle valeur ajoutée et font partie intégrante d’une formation, en permettant de renforcer la partie théorique du cursus par une mise en situation réelle, ils n’appellent pas une rémunération. Il ne s’agit en effet pas « d’une forme de travail gratuit », car cela a un coût pour les entreprises qui accueillent des stagiaires. Les entreprises doivent en effet consacrer du temps et mettre du personnel à disposition pour former, encadrer et accompagner ces étudiants…. Et plus on mettra ce genre de pression sur les entreprises, plus l’offre de stage risque de diminuer.
Toujours à la RTBF, vous aviez déclaré que « les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas à prendre à leur charge les problèmes de santé mentale rencontrés par les étudiants ». Pourquoi le préciser ? Est-ce que les établissements et leur mode de fonctionnement ne jouent pas malgré tout un rôle dans la santé mentale des étudiants ? À qui cela appartient-il de s'en charger ?
Chaque niveau de pouvoir doit pouvoir prendre en charge ce qui relève de ses propres compétences. La santé mentale relève ainsi des compétences du ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke. Il a d’ailleurs, suite au Covid, quadruplé les montants consacrés à la Santé mentale de première ligne. Et il est évident que cela inclut aussi la santé mentale des étudiants. Cependant, il semblerait que ces montants n’atteignent pas encore pleinement leurs objectifs. Dès lors, nous pouvons évidemment réfléchir à une meilleure coordination pour que ce financement de soins psychologiques de première ligne remplisse bel et bien ses effets auprès des jeunes.
Mais il n’appartient pas à la FWB – et le budget ne le permet pas – de dédoubler des compétences d’autres niveaux de pouvoir. Par ailleurs, les services sociaux de certains établissements ont également ouvert des antennes « santé mentale » pour aider au mieux les étudiants.
La gauche étudiante reprend actuellement une phrase que vous auriez dit, à savoir « Les études, ce n'est pas fait pour tout le monde ». Évidemment vos détracteurs y voient une forme d'élitisme et de rabaissement d'une frange de la population étudiante. Qu'avez-vous voulu dire par là ?
La massification de l’enseignement supérieur témoigne d’un accès plus large pour tous les publics. Et c’est une bonne nouvelle ! Mais nier le fait que le système de l’enseignement supérieur ne convient pas ou ne répond pas aux aspirations de certains jeunes, serait mentir. Par ailleurs, j’ai des difficultés à entendre de la part d’une « certaine gauche étudiante » que certaines formations seraient plus respectables que d’autres. Notre société a besoin de tous les profils et il m’est insupportable que l’on dénigre certaines formations alors qu’elles sont indispensables, en pénurie et totalement honorables !
Depuis la réforme du calendrier de l'enseignement obligatoire, beaucoup de familles ont du mal à s'adapter en période de congés scolaires. Un foyer comprenant deux enfants inscrits dans deux cycles d'études différents (le premier en supérieur et le second en secondaire par exemple) se trouve dans une situation fort délicate. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus intéressant de modifier la répartition des compétences de l'enseignement afin d'avoir un seul bloc sur cette thématique et d'harmoniser les prises de décisions dans ce domaine. De plus, avoir deux postes distincts avec deux ministres d'appartenance politique bien différente ne complique-t-il pas ce phénomène ?
La répartition des compétences entre membres d’un Gouvernement se négocie, en début de législature, sur base du poids respectif de chaque composante politique. Ce Gouvernement constitue ensuite un programme pour toute la durée de la législature, en respectant les équilibres ainsi trouvés lors de la négociation.
Avant, une place de ciné ne coûtait pas 13€50, même pas pour un film de 3h14. Avant, on avait la cabine téléphonique, à présent, on met son Smartphone sur
/ DÉRISION /

NOSTALGIE, PASSÉISME ET CONTAGION
Sortez vos cagoules et pulls en laine chinée pour vous protéger
Croyez-moi, jeunes gens, la nostalgie, ce n’est plus ce que c’était… Même sur les ondes FM ! Pourtant, ce refrain à la gloire du « c’était mieux avant » seriné par chaque génération, cette malédiction des ondes courtes vantant les mérites d’un temps révolu, est difficile à supprimer de nos playlists. Cette conviction passéiste, qui nous pousse à penser avec langueur et amertume à ce qui fût, ne sera plus et est à jamais disparu, a la vie dure. Aussi dure qu’une pierre qui amasse moult mousse et ne s’émousse.
Alors pourquoi encombrons-nous nos âmes de ce qui est passé ? Pourquoi le passéisme a-t-il encore la cote chez les seniors, mais aussi de plus en plus auprès de la nouvelle génération ?
LE PASSÉISME EST UNE ATTITUDE DE REPLI SUR UN PASSÉ FAMILIER.
Alors que le futur nous inquiète, ce que nous avons déjà vécu nous rassure. Plus nous sommes confrontés à une situation, moins elle nous fait peur. Ainsi, nous sommes étrangement plus sereins face à un patron connu au sourire de Joker qu’à un tout nouveau boss à l’air bonhomme. De même, nous préférons les anomalies orthographiques de notre enfance et nous obstinons à écrire « clef » plutôt que
« clé » ou « oignon » au lieu d’« ognon ». Mais la célébration du passé ne s’arrête pas là, elle s’illustre d’ailleurs parfaitement dans la « rétromania » qui rend le vieux si tendance auprès des jeunes. Mais la formidable table en formica vintage était-elle plus utile que la table Laneberg de chez Ikea ? Les robes pin-up à petits pois étaient-elles plus seyantes que les slip dress satinées ? Le Thomas de « 21 Jump Street » était-il plus hot que celui des « Peaky Blinders » ? En somme, ce qui est ancien est-il forcément plus beau, plus smart, plus top ?
LE PASSÉISME CONSISTE À REGRETTER UN ÉTAT DE NATURE TOUJOURS DÉJÀ PERDU.
Nous nous mourrons tous un peu de ce qui était mieux naguère et jadis. Mais rien ne sert de nous apitoyer sur notre époque, car tout revers à sa médaille. Et celui qui ne le voit pas est encore plus myope qu’une taupe qui se fourre le doigt dans l’œil. Pour preuves… Si aujourd’hui, il parait plus difficile de passer son permis de conduire, l’Europe possède les routes les plus sûres du monde. Si le prix des matières premières a augmenté, les biens de seconde nécessité sont plus accessibles. Si l’Intelligence Artificielle peut devenir un outil
entendait les voitures arriver, désormais, elles font un bruit de frigo défectueux. Avant, on louait un film au vidéoclub, ça faisait un peu de marche avant la glande dans le canapé. Avant, on ne comprenait rien aux paroles des Las Ketchup, maintenant, on a Aya Nakamura. Avant, Claire Chazal nous présentait les dernières infos, à la place, on a Tik Tok, X et Insta. Avant, on achetait nos décos de Noël en décembre, bientôt, on devra s’y prendre en aout. Avant, Engie s’appelait GDF-Suez-Electrabel, c’était long mais
continent une fois dans sa vie, on ne prenait pas l’avion juste pour du shopping aux USA. Avant, on avait une bonne mémoire et le sens de l’orientation, dorénavant on a Wikipédia et Waze. Avant, Dieudonné et Palmade étaient des humoristes, pas des sujets du JT. Avant, on portait des bottines Dr. Martens en toute circonstance, aujourd’hui, aussi !
PAR CORALIE BOTERDAEL
dangereux, elle permet aussi de grandes avancées médicales. Et si nous assistons hélas encore à des situations de discrimination et de harcèlement, avant, même en Occident, les personnes fragiles ou handicapées étaient abandonnées, les homosexuels persécutés, les jeunes filles mariées de force. Force donc est de constater, qu’autrefois, ce n’était pas si bien que ça.
LE PASSÉISME PRÔNE UN DISCOURS DE RUPTURE QUI TEND À REJETER LES VALEURS ACTUELLES.
Mais si nous nous remémorons le passé souvent avec un certain plaisir, c’est que notre cerveau est programmé pour savourer les souvenirs agréables et oublier beaucoup plus rapidement ceux qui sont ennuyeux, gênants ou douloureux. Heureusement d’ailleurs. Cependant, critiquer les mœurs contemporaines est aussi aberrant qu’exiger d’un marteau qu’il flotte. Et si nous lisons les auteurs et la presse des décennies passées, nous nous rendons vite compte qu’ils s’indignaient des mêmes sujets que nous. Aussi vrai que la terre n’est pas plate, de tous temps nous avons envié le passé. Peutêtre, pour satisfaire ce sentiment passéiste tout en honorant notre présent, devrions-nous nous amuser à mélanger l’ancien et le nouveau. Imaginez Quick et Flupke jouant aux Pokémon, Orelsan featuring Måneskin « Sur un prélude de Bach », les tableaux de Vermeer sous la bombe de Banksy ou Coluche se mariant en grandes pompes avec Paul Mirabel.
LE PASSÉISME REPOSE SUR UNE IDÉALISATION DE CE QUI A ÉTÉ.
Sans doute par peur de l’horizon. De la sorte, les jeunes craignent l’avenir, ils ont l’impression de ne pas pouvoir maitriser leur destin. Et comment ne pas
être abattus quand les médias nous abreuvent sans cesse de mauvaises nouvelles, de calamités tellement plus spectaculaires, d’articles mortifères fleurtant avec la thanatophilie ! La négativité s’empare de nous et nous pleurons un paradis perdu qui n’a en réalité jamais existé. Nous vénérons le mode de vie simple de Charles Ingalls dans sa prairie qui ne souffrait pas des problématiques d’aujourd’hui. Nous parvenons même à regretter des choses que nous n’avons pas connues. Mais nous avons la mémoire courte, ce temps sans souci du lendemain n’a jamais eu cours ! Nos manuels d’Histoire nous l’ont pourtant rappelé : quand ce n’était pas l’esclavage, c’était la colonisation ; quand ce n’était pas la peste noire, c’était la grippe espagnole ; quand ce n’était pas l’inquisition, c’était le fascisme… En réalité, la plupart du temps, on ne pensait même pas à demain, on se demandait surtout comment on allait faire pour s’en sortir aujourd’hui… L’avenir par définition est insaisissable. Et jamais personne, quelle que soit l’époque, n’a pu se targuer d’avoir pu maitriser son destin, n’en déplaise à Marty McFly !
L’âge d’or est un mythe. Il est vrai que sublimer le passé parait sécurisant, il est pourtant bien risqué de contempler ce qui est derrière nous et de vivre de regrets et d’eau fraiche. Le futur quant à lui semble bien effrayant, il est intangible, instable et incontournable. Alors chère jeune génération, non, ce n’était pas mieux avant, ce ne sera pas mieux plus tard, c’est mieux maintenant. Puisque le passé est nostalgie et le futur, incertitude ; vivez l’instant présent ! Et si tout ça ne vous convainc pas… L’étymologie vous rappellera que les « -ismes », suffixes de « passéisme » et compagnie, sont au cerveau ce que les « -ites » sont au reste de l’organisme, des infections contre lesquelles il est bon de se défendre, sauf peut-être pour le cyclisme ! Coralie

sur haut-parleur dans le métro. Avant, on vendait des fraises de saison, ces dernières années, elles goutent l’eau 9 mois sur 12. Avant, Bigflo et Oli ne chantaient pas « C’était mieux avant ». Avant, les cris de l’âge bête étaient des mots existants et non des Quoicoubeh ou Heinpayaye . Avant, quand on ratait une photo, on ratait une photo, on n'avait pas de filtre pour faire croire qu’on est beau. Avant, aux toilettes, on remplissait des grilles de mots croisés au lieu de répondre à nos textos. Avant, on entendait les mais c’était moins cher. Avant, il y avait le bidet pour les parties intimes après la commission, de nos jours, il n’y a plus de bidet… Avant, « Inspecteur Derrick » passait à la télé tard le soir, on n’avait pas besoin de somnifères pour s'endrormir. Avant, les enfants mangeaient des cigarettes en chocolat, depuis leur censure, il faut se rabattre sur les russes. Avant, « Take on me » était diffusé en boucle à la radio et pas seulement dans les soirées karaoké. Avant, on partait visiter un autre continent une
DP de la FEL
/ BIBLIOGRAPHIE /
DÉMOGRAPHIE EN HAUSSE : Un enjeu planétaire et global par Arthur Watillon
BASSARSKY L. et al., « Alors que la population mondiale dépasse les 8 milliards d’habitants, quelles sont les incidences sur la santé et la durabilité de la planète », un.org., 11 juillet 2023, sur https://www.un.org/fr/cr%C3%B3nica-onu/alors-que-la-population-mondiale-d%C3%A9passeles-8-milliards-d%E2%80%99habitants-quelles-sont-les, consulté le 25 septembre 2023.
BLOOM E.D., ZUCKER L., « Le vieillissement, véritable bombe démographique », imf.org., juin 2023, sur https://www.imf.org/fr/Publications/ fandd/issues/Series/Analytical-Series/aging-is-the-real-population-bomb-bloom-zucker, consulté le 25 septembre 2023.
CALAUZENES J., « Les enjeux de la croissance démographique », prepa-isp.fr, 2020, sur https://www.prepa-isp.fr/wp-content/uploads/2018/10/ Annales-2020-Douanes-Les-enjeux-de-la-croissance-d%C3%A9mographique-mondiale.pdf, consulté le 25 septembre 2023.
CARE, « Déplacement des populations : l’année 2023 bat un autre recourd », carefrance.org, 20 juin 2023, sur https://www.carefrance.org/ actualites/deplacement-des-populations-lannee-2023-bat-un-autre-record/, consulté le 08 octobre 2023.
CNRS, « Situation mondiale. L’eau, une source de conflits entre nations, cnrs.fr., s.d., sur https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/mondial/05_eau.htm, consulté le 05 octobre 2023.
DIVERRES H., « Au Danemark, l’âge de départ à la retraite pourrait atteindre… 70 ans ! », hellowork.com, 20 mars 2023, sur https://www. hellowork.com/fr-fr/medias/retraite-age-depart-danemark-france-europe.html, consulté le 05 octobre 2023.
FRÉMONT A.-L., « Démographie : la population mondiale pourrait entamer son déclin dès la seconde moitié du siècle », lefigaro.fr., 27 mars 2023, sur https://www.lefigaro.fr/sciences/la-population-mondiale-pourrait-entamer-son-declin-des-la-seconde-moitie-du-siecle-20230327, consulté le 28 septembre 2023.
GAUDIAUT T., « Plus d’un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles », statista.com, 21 septembre 2023, sur https://fr.statista.com/infographie/30885/part-de-la-population-urbaine-vivant-dans-des-bidonvilles-pays-les-plus-touches/, consulté le 28 septembre 2023.
GUIBERT C., « Infographie. Les conflits liés à l’eau se multiplient partout dans le monde, voici pourquoi. », ouest-France.fr, 22 mars 2023, sur https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-03-22/infographie-les-conflits-lies-a-l-eau-se-multiplient-partout-dans-le-mondevoici-pourquoi-c8d6259c-e5fd-4da4-8864-c84d42f877e8#:~:text=Les%20conflits%20autour%20de%20l,nord%20de%20l'actuel%20 Irak%E2%80%A6, consulté le 05 octobre 2023.
HALLET E., « Coup d’État au Niger : sept enfants par femme en moyenne, la junte au pouvoir aggravera-t-elle la problématique démographique ? », rtbf.be., 22 août 2023, sur https://www.rtbf.be/article/coup-detat-au-niger-sept-enfants-par-femme-en-moyenne-la-junte-au-pouvoir-aggravera-t-elle-la-problematique-demographique-11239519, consulté le 29 septembre 2023.
HIAULT R., « Ces « guerres de l’eau » qui nous menacent », lesechos.fr, 30 août 2016, sur https://www.lesechos.fr/2016/08/ces-guerres-deleau-qui-nous-menacent-1112386, consulté le 05 octobre 2023.
NATIONS UNIES, « L’évolution démographique », un.org, s.d., sur https://www.un.org/fr/un75/shifting-demographics, consulté le 29 septembre 2023.
ROSINA A., « Déjuvenescence : l’Italie face au problème structurel de sa démographie », dans Le Grand Continent, 18 septembre 2023, sur https://legrandcontinent.eu/fr/2023/09/18/dejuvenescence-litalie-face-a-au-probleme-structurel-de-sa-demographie/, consulté le 29 septembre 2023.
L'(IN)SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : Entre abondance et faim, l'envers de l'assiette par Lara Zenginoglu
GOUGET C., « Additifs alimentaires dangers ! Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner », Dangles, 2017.
ACTION CONTRE LA FAIM, « La faim continue d’augmenter dans la plupart des régions du monde », Actioncontrelafaim.org, 3 août 2023, sur https://www.actioncontrelafaim.org/presse/la-faim-continue-daugmenter-dans-la-plupart-des-regions-du-monde/, consulté le 28 septembre 2023.
CARE FRANCE, « Faim dans le monde : il n’y a jamais eu autant de personnes qui souffrent de la faim ! », carefrance.org, 4 mai 2023, sur https://www.carefrance.org/actualites/faim-dans-le-monde-2023-devrait-etablir-un-triste-record/, consulté le 28 septembre 2023.
LE VIF, « Le nombre d’exploitations agricoles continue de baisser en Belgique », trends.levif.be, 18 avril 2021, sur https://trends.levif.be/a-la-une/ politique-economique/le-nombre-dexploitations-agricoles-continue-de-baisser-en-belgique-infographie/, consulté le 29 septembre 2023.
PENELLE Z., « Des chiffres alarmants », Le Soir, 12 mai 2023, sur https://www.lesoir.be/512922/article/2023-05-12/des-chiffres-alarmants-les-previsions-pour-lobesite-en-belgique-et-dans-le-monde, consulté le 29 septembre 2023.
KETTANI E., « Les risques de l’agriculture intensive : comment les éviter ? », 10 octobre 2022, sur https://echooomagazine.com/ les-risques-de-lagriculture-intensive, consulté le 29 septembre 2023.
RIVERAIN C., « Au fait, c’est quoi la loi Evin ? », 1 novembre 2022, sur https://www.lejdd.fr/Societe/au-fait-cest-quoi-la-loi-evin4144493#:~:text=Entrée%20en%20vigueur%20le%201er,aux%20moins%20de%2018%20ans., consulté le 1 octobre 2023.
BOURDILLON F., « Les lobbies agroalimentaires contre la santé publique », dans Santé Publique, vol.17, 2005, p.515-516.
BERTHELIER P., « Quel rôle joue l’agriculture dans la croissance et le développement ? », dans Revue Tiers Monde, n°183, 2005, pp. 603-624.
NEVEU A., « Sécurité alimentaire : objectif majeur de l’après Covid », dans Paysans et Société n°383, 2020, pp. 22-27.
LA TENTATION AUTORITAIRE : Solution blâmable sur fond de problèmes durables par Noha Devillers
FOKOU É., « De l’idéal démocratique de l’équilibre à la réalité politique du déséquilibre des pouvoirs », dans Les Annales de droit, 14, Article 14, 2020, sur https://doi.org/10.4000/add.1807, consulté le 20 octobre 2023.
IVALDI G., « La montée du populisme autoritaire. Ce qu’en disent les enquêtes Valeurs ». Futuribles, 443(4), 25-38, 2021, sur https://doi. org/10.3917/futur.443.0025, consulté le 20 octobre 2023.
LIGOT F., « Populisme et crise de la démocratie : Les racines du mal. Revue Démocratie », 2019, sur http://www.revue-democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1350:populisme-et-crise-de-la-democratie-les-racines-du-mal&catid=63&Itemid=201, consulté le 21 octobre 2023.
RTBF, « Noir Jaune Blues, cinq ans après : Un Belge sur deux souhaite une gouvernance autoritaire », 2023, sur https://www.rtbf.be/article/noirjaune-blues-cinq-ans-apres-un-belge-sur-deux-souhaite-une-gouvernance-autoritaire-11139090, consulté le 21 octobre 2023.
ÖNIŞ Z., « The Age of Anxiety : The Crisis of Liberal Democracy in a Post-Hegemonic Global Order », 2017, sur https://www.tandfonline.com/doi/ full/10.1080/03932729.2017.1325133?casa_token=hCropPPyGo4AAAAA%3AWiWAMtjlZ_sxB7ZmmwKY2mqu0nzgccXsOYKBrMG8vTzASj-mZdX8PA82yKLgKV4-H0ulKJJ--6Hxdi0, consulté le 21 octobre 2023.
NAVIGUER DANS LA TEMPÊTE : La hausse des taux d'intérêt et ses répercussions sur la récession de 2023 par Nathan Berckmans
DAVOS 23, « Recession in 2023? That depends on where you are in the world », sur weforum.org, 16 janvier 2023, sur https://www.weforum.org/ agenda/2023/01/global-recession-economic-outlook-2023/, consulté le 23 septembre 2023.
GUENETTE J.D., KOSE A., SUGAWARA N., « Risk of Global Recession in 2023 Rises Amid Simultaneous Rate Hikes », sur worldbank.org, 15 septembre 2022, sur https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes, consulté le 23 septembre 2023.
THE NEW YORK TIMES, « U.S. Government Shutdown Is Unlikely to Cause an Immediate Recession », sur nytimes.com, 27 septembre 2023, sur https://www.nytimes.com/2023/09/27/us/politics/us-government-shutdown-recession.html, consulté le 29 septembre 2023 .
SINGARRIMBUN LAS., « The Looming Threat of Global Recession in 2023, What Are the Causes ? », sur UGM, 21 octobre 2022, sur https://cwts. ugm.ac.id/en/2022/10/21/the-looming-threat-of-global-recession-in-2023-what-are-the-causes/, consulté le 25 septembre 2023.
WANG X., « The Economic and Financial Impacts of Fed’s Rate Hikes : Emerging Economy, Financial and Commodity Markets », dans EWA publishing, p. 1-9, septembre 2023.
Composition cover : Shutterstock
Images d’illustration : Shutterstock, National Geography FR et La Libre BE
© Fédération des Étudiants Libéraux
BLUELINE
PRÉSIDENT ET ÉDITEUR RESPONSABLE :
Diego D'ADDATO
Avenue de la Toison d’or, 84 - 86 1060 Bruxelles
CONTACT :
Tél : +32 2 500 50 55 info@etudiantsliberaux.be
RÉDACTEUR EN CHEF :
Arthur WATILLON
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE :
Lara ZENGINOGLU
ASSISTANTS DE RÉDACTION :
Coralie BOTERDAEL - Louis MARESCHAL
RÉDACTION :
Nathan Berckmans, Coralie Boterdael, Diego D’Addato, Noha Devillers, Benjamin Reuland, Nathan Vokar, Arthur Watillon, Lara Zenginoglu
DIRECTION ARTISTIQUE :
Gaëlle FRANÇOIS
AVEC LE SOUTIEN :