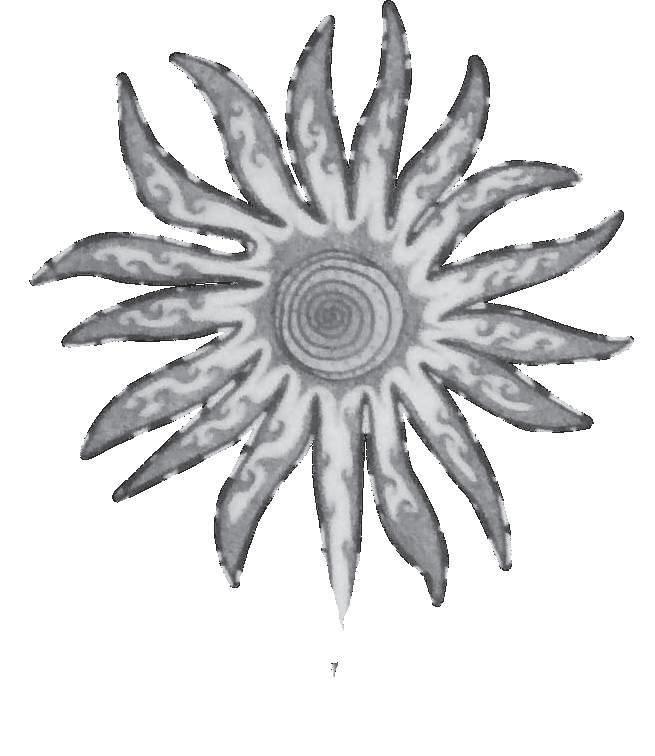3 minute read
Histoire et sens
Le mot «transport» fait son apparition dans la langue française au début du XIVe siècle. Le Larousse le définit comme le fait de porter pour faire parvenir en un autre lieu; manière de déplacer ou de faire parvenir par un procédé particulier (véhicule, récipient, etc.). Depuis la nuit des temps, l’être humain se déplace pour se nourrir et se vêtir, ce qui l’a amené à se transporter partout sur la planète, avec tout son attirail et ses connaissances. Les premières tentatives de déplacement furent de domestiquer des bêtes pour faire avancer des chariots sur lesquels on plaçait différentes marchandises. Peu importaient les intempéries et malgré l’aspect rudimentaire des premiers moyens de transport, il fallait avancer, gagner du terrain, ou mieux du territoire. Des clans et des groupes se formèrent pour occuper et définir leurs emplacements. Entre ses groupes, des échanges de marchandises demandaient des transports. Ou si on le veut, les premiers échanges commerciaux.
LA CONQUÊTE DES OCÉANS
Advertisement
Les siècles passant, les bateaux et navires, au lieu de faire du cabotinage en suivant les rivages côtiers, se lancèrent à la conquête des océans. Christophe Colomb, en 1492, marque un grand tournant dans l’histoire en faisant connaître l’Amérique à l’Europe. D’autant plus qu’il a découvert que certains peuples qui habitent ce territoire ont de l’or en grande quantité. Non seulement les aventuriers sont intéressés par les dires de Christophe Colomb, mais les drapeaux noirs de la flibusterie s’organisent aussi. Les batailles navales, transportant des trésors, sont souvent la proie de naufrages redonnant ainsi les trésors à la planète que nous habitons. Le transport des trésors est toujours à cette époque assez périlleux. Mais rien ne peut freiner le rêve des explorateurs. Les terres nouvelles et pleines de promesses en Amérique ne manquent pas de susciter l’envie d’un grand nombre d’aventuriers. Certains d’entre eux n ’hésiteront pas à organiser des navires remplis d’esclaves pour extraire le précieux minerai qui fait rêver. Tous les moyens sont bons pour atteindre le but d’extraire cette richesse sur les terres nouvelles. Les humains de cette période sont souvent considérés comme une marchandise nécessaire.
LA MULTIPLICATION DES MODES DE TRANSPORT
Le temps faisant son œuvre, il n’y a plus de limites pour les transports, car ces derniers s’adaptent aux siècles et aux inventions des hommes. Le transport aérien peut déplacer des êtres humains en peu de temps et acheminer du courrier. Le ferroviaire pour les voyageurs et la marchandise. Le ferroviaire urbain nommé tramway déplace quotidiennement de nombreuses personnes qui vont à leur travail. De plus, le transport routier se divise en deux, auto de toutes sortes, autobus pour les humains et camions pour les marchandises. Les sportifs et sportives opteront pour la bicyclette. Pour ce qui est du transport maritime, il sert aussi bien les humains que la marchandise. Je passerai ici sous silence les voyages en ballon et le «R100» qui à mon sens relèvent beaucoup plus du sport que du transport. D’autre part, l’acheminement du courrier et les timbres sont en train de disparaitre pour faire place aux courriels et à l’ordinateur.
C ourtoisie : Philippe Bouchard
ÉMOTION INTENSE
Il est assez intéressant que la langue française adapte souvent les mots à un autre fait. Ainsi en est-il de l’expression «transports de colère» (Lar.ill.Ed.2022 p.1166). Ainsi, la personne peut être transportée par une émotion vive, un sentiment passionné qui émeut en entraînant l’esprit de ses interlocuteurs. Ce transport qui agite la personne, qui l’éprouve dans un élan d’enthousiasme, d’ivresse et d’exaltation. Claudel s’exprime ainsi: «L’orateur est celui qui sait se mettre à volonté dans un état de transport, et le poète aussi.» Ces transports peuvent se transformer par un emportement de colère, être un transport de joies, un transport amoureux, sensuel ou une ivresse sentimentale. Je ne peux terminer ce texte sans donner un exemple de transport assez extraordinaire d’Édith Piaf dans l’interprétation des paroles de «La foule». Le temps d’une chanson, elle se transporte de l’amour à la haine, de la joie à la colère, l’émotion atteint les sommets, suivie de la chute et la détresse. Ce transport focalisant sur les deux côtés du balancier.
«Je me souviens.»