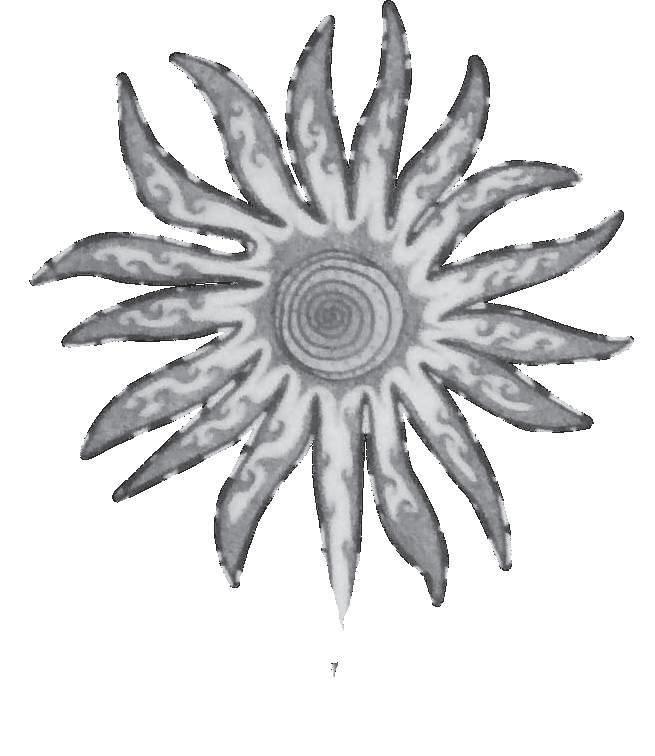3 minute read
FIXIE : contestation de la culture automobile
LE FIXIE
CONTESTATION DE LA CULTURE AUTOMOBILE
Advertisement
Je souhaite dédier ce texte à tou.te.s les personnes décédées sur les routes de la Ville de Québec. Encore aujourd’hui, ces homicides involontaires sont traités comme des accidents.
Tous les types de vélo incarnent la liberté. En étant affranchi.e.s du carburant, les cyclistes peuvent atteindre des lieux lointains, pour autant qu’ils se situent sur un même continent. De nombreux. ses voyageur.se.s ont parcouru le monde à l’aide de leur deux roues. L’histoire du vélo illustre également son caractère politique. Ce véhicule a permis la libération, au XXe siècle, des classes ouvrières des pays du Sud comme du Nord, ainsi que des femmes.
ANATOMIE DU VÉLO À PIGNON FIXE
Le vélo à pignon fixe, aussi appelé fixie, se distingue des autres bicyclettes par sa mécanique minimaliste. Dégarni de roue libre et de vitesse, ce véhicule oblige le.la cycliste à pédaler en permanence. L’absence de frein est compensée par la capacité du conducteur. trice à ralentir la roue arrière en bloquant son mouvement en exerçant une force contraire. Cette technique, nommée le skid, nécessite une semaine ou deux d’entraînement. Ces caractéristiques entraînent, en plus d’une vitesse importante, un sentiment d’union entre la personne et son vélo à pignon fixe. L’hybridation entre le corps et la machine se manifeste par la possibilité de la contrôler entièrement à partir de ses capacités physiques. De par les caractéristiques du fixie, mais aussi les compétences du cycliste, cette pratique se veut utilitaire, où l’objectif est de se rendre le plus rapidement possible du point A au point B, en utilisant autant les pistes cyclables que les rues ou les grandes artères.
LE FIXIE, UN MODE DE VIE?
Le mode de vie développé par les cyclistes utilitaires et de vélo à pignon fixe entraîne une subversion des normes liées à la route et à son utilisation. Ces cyclistes ultra rapides prennent les artères traditionnellement occupées par les automobilistes, et grâce à leurs fixies, réussissent même à les dépasser en vitesse. Au déplaisir de certains animateurs de radio, tels que Denis Gravel et Jérôme Landry, sur les ondes de Radio X, le 6 mai 2013: «Qu’est-ce que vous faites les cyclistes, à vouloir prouver que vous êtes meilleurs que nous autres? (…) La réalité, elle ne changera pas. La réalité c’est que la route appartient (…) aux automobilistes. Pour eux autres, c’est égal, d’égal à égal! C’est complètement fou. (…) Le moustique ce n’est pas l’égal de l’humain». C’est cette idée répandue et presque naturalisée qui est ici contestée, celle proposant que la route appartienne aux automobilistes. Pour le faire, ces cyclistes prennent les espaces laissés vacants par le trafic. Dans le documentaire Line of Sight, le cycliste et caméraman, Lucas Brunelle explique que la place de ces cyclistes est «entre les voitures, les camions et les autobus. [Ces cyclistes] pren [nent] ces espaces; ces ouvertures, ces opportunités, ces angles morts. Ce sont les espaces où [ils.elles] existent et où [ils.elles] font la course».
: Wikimedia Commons Crédit photo
ET SI ON FIXAIT LE RÉSEAU ROUTIER?
Faire la course sur le réseau routier, percevoir les véhicules motorisés, mais aussi les piétons et les autres utilisateur.trice.s actif.ve.s de la route comme des obstacles devant être franchis, n’est-ce pas là une attitude méprisable? Là où les non-initiés voient un manque de respect, les initiés y saisissent une lutte politique. Ce qui y est négocié est le droit d’utiliser les routes autrement qu’avec un véhicule motorisé, selon une culture, des capacités individuelles et des normes différentes. Ces cyclistes ne sont ni suicidaires ni dénudés de bon sens. Ils et elles font confiance en leur capacité à maintenir et à anticiper le mouvement du trafic, à prévoir le changement des feux de signalisation, à visualiser les espaces vacants afin d’atteindre sa ligne d’arrivée. Cette confiance en ses apprentissages participe à la réappropriation du pouvoir d’agir d’un groupe.