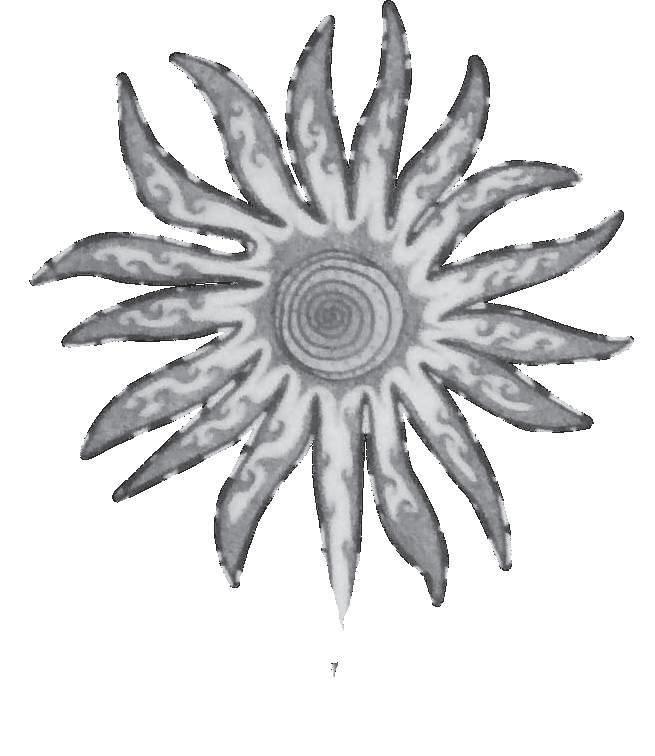4 minute read
Gratuité des transports
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ ?
Les modes de transports constituent un enjeu pour les villes. Que ce soit pour faciliter le déplacement de la population ou pour les inscrire dans une démarche écologique, il faut considérer le service collectif comme un réel outil. Entre volonté politique et configuration géographique, la gratuité est-elle possible?
Advertisement
: Montage de Perrine Pinel Crédit photo
Depuis juillet 2021, les tarifs réguliers du Réseau de transport de la Capitale ont atteint 89,75$ pour un laissez-passer mensuel, 3,25$ pour un billet unique, et 3,75$ pour un passage payé en argent comptant. Le transport sans contreparties financières deviendrait un moyen d’offrir une équité sociale et, par la même occasion, de réussir une transition écologique nécessaire dans un contexte d’urgence climatique. Néanmoins, à Québec, il existe une contrainte physique : la réalité est que la ville est construite de manière linéaire. Le réseau structurant de 870 km offre ainsi un service qui suit cette construction. En effet, la desserte qui est favorisée suit le fleuve et les endroits qui s’en éloignent se voient offrir une desserte moins avantageuse. Le développement d’un transport efficace est « essentiel dans une ville comme Québec si elle veut grandir », estime Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé en urbanisme à l’Université de Montréal, mais pour cela « un plan d’aménagement du territoire est nécessaire et une réévaluation des besoins en termes de desserte l’est aussi », affirme-t-il.
TOUT À L’AUTO ?
La « construction même de la ville permet une cohabitation entre les voitures et les autobus », poursuit le directeur de la maîtrise en urbanisme. Il se base sur l’exemple de l’Estonie. Ce pays d’Europe du Nord était le premier à proposer une gratuité sur son territoire. D’après le professeur, cette initiative « ne peut fonctionner que lorsqu’il y a une forte demande ». Il ajoute que Québec « se trouve sur la frange, entre un besoin réel et une habitude d’utiliser l’auto ». Malgré tout, le résultat après cinq ans d’implantation dans le pays balte est mitigé. M. Meloche pense que l’exemple de l’Estonie est applicable ici. D’après lui, malgré une urgence climatique indéniable, l’automobile occupe encore une place importante, ce qui ne facilite pas l’implantation d’un transport gratuit. De plus, si gratuité il y a, il faut que les arrêts et les lignes répondent aux besoins de la population. Au-delà de l’aspect géographique, le transport collectif offre une mobilité et participe aussi à la réduction de la congestion routière. Malgré tout, le prix du ticket vient créer une scission entre les différents usagers qui ne possèdent pas tous la capacité de payer un billet à 3,25$ ou plus. Le rôle de lien social qu’entretient le bus doit être au cœur de la réflexion, estime Émilie Frémont-Cloutier, animatrice sociale au TRAAQ, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec. Elle ajoute que « le fait de défendre le transport en commun doit être considéré pour les personnes dans le besoin ». Même si le collectif ne se positionne pas ouvertement pour la gratuité des transports, inclure l’idée et en faire un débat de société est important. « Il faut penser la mobilité comme un droit et certaines personnes n’ont pas le droit de l’exercer », vient nuancer l’animatrice.
UN DEVOIR POLITIQUE
Le fonctionnement du RTC est assumé à environ 54 % par l’agglomération de Québec. Dans les autres sources de revenus de la société, 27 % reviennent aux usagers. Le reste est partagé à hauteur de 8 % et 11 % par le financement provincial et l’aide d’urgence en raison de la pandémie. En ce qui concerne une potentielle gratuité, puisque comme le dit Jean-Philippe Meloche, « elle n’existe pas, il y a toujours quelqu’un qui paie à la fin », une solution doit être trouvée. Ainsi, le financement de cette installation proviendrait de « taxes sur l’essence ou encore d’installations de péages et d’un financement provincial », confie Jackie Smith, rencontrée par La Quête dans le quartier Limoilou où elle est conseillère municipale, mais également membre du conseil d’administration du RTC. Pour elle, le bus gratuit est avant tout « un croisement entre la justice sociale et environnementale ». De plus, la nouvelle administration envisage de mettre en place un moyen d’arriver pas à pas à cette gratuité avec la tarification sociale. Celle-ci est basée sur le revenu que perçoit un usager. Ainsi, en fonction de ses ressources, l’individu pourrait potentiellement profiter de la gratuité. D’après l’animatrice du TRAAQ, « c’est une stratégie pour aider les personnes en mode survie». Un désir d’inclusivité et une prise en compte des personnes dans le besoin sont donc attendus de la part des administrations et des politiques pour faire de la gratuité des transports une réalité et ainsi offrir une réponse concrète aux besoins des usagers que doit servir le réseau structurant.