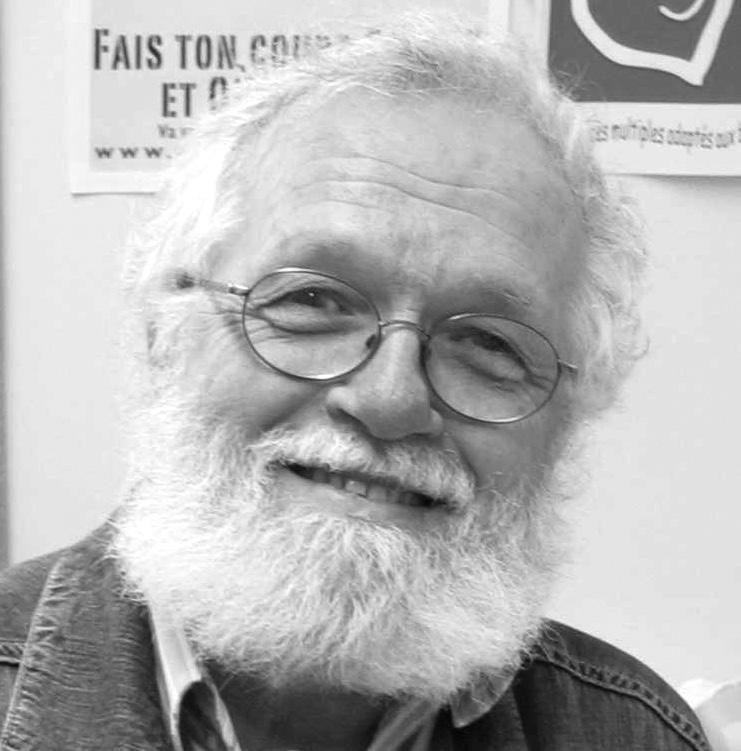
3 minute read
Nuit et brouillard
C ourtoi sie: Claude Cossette
La première fois que j’ai été confronté à l’expression Nuit et brouillard, j’avais 19 ans. J’avais assisté à la projection du court documentaire d’Alain Resnais dont j’étais sorti terrifié. C’était la première fois que l’on montrait des piles de cadavres nus, squelettiques, poussés par des bulldozers dans une fosse commune: on nettoyait un camp d’extermination nazi.
Advertisement
LES PAYS DE LA NUIT
« Nuit et brouillard » est la traduction de l’expression allemande Nacht und Nebel qui est le nom de code d’une directive nazie de 1941 visant à appréhender tous les opposants au régime, à créer un brouillard sur leur sort et finalement à les faire disparaître dans une nuit d’incertitude et d’effroi puis, éventuellement, de mort. C’était là un exemple de la « volonté de puissance » décrite par le philosophe allemand Nietzsche, un trait de la psychosociologie qui se manifeste autant chez les nations que chez les individus. Certains affirment que la Chine, avec ses camps de rééducation des Ouïghours, vise aujourd’hui un but semblable à celui des nazis: aux deux endroits, on prive des personnes de leur liberté pour des raisons incertaines. La religion joue-t-elle un rôle là-dedans? Le fait est que dans la région du Xinjiang, la majorité Han est taoïste alors que les Ouïghours sont musulmans. Confrontation! Les croyances jouent en effet souvent le rôle de détonateur dans les conflits ethniques. Ainsi en 1918, les 15 % de la population de l’Irlande (catholique) ont fait sécession pour former l’Irlande du Nord (anglicane). Dans l’Allemagne de 1933, c’était les Juifs qui attiraient la haine des goyim. En Birmanie, selon les journaux de l’heure, la majorité bouddhiste rejette la minorité musulmane des Rohingyas. D’une certaine façon, ici même dans les siècles passés, c’est la religion (avec la langue!) qui, selon l’expression de Hugh MacLennan, a engendré les deux solitudes que constituent les Québécois catholiques et les Canadians anglicans. Religion et langue sont définitivement les principaux aspects qui définissent les nations et créent les clivages les plus marquants entre populations.
LE BROUILLARD SE DISSIPE
Les réflexions des philosophes des Lumières vers 1700 changent la perspective des leaders sur l’organisation politique. Puis l’instruction se répandant, cela réveille au sein du peuple l’envie de prendre en main son destin si bien que, désormais, c’est la démocratie qui règle les relations entre citoyens, ce qui se produit d’abord en France et aux États-Unis dans les quelques décennies précédant 1800. Dans nos pays, la religion et la langue occupent désormais une place inverse de celle que ces qualités occupaient dans les sociétés traditionnelles. Dans celles-ci, la croyance et la foi constituaient le premier critère d’identité: on était d’abord protestant et ensuite sujet particulier. On était protestant anglais ou catholique canadien: l’étiquette « canadien » n’était qu’une des qualités des Canadiens-français qui se considéraient avant tout catholiques et fidèles au Pape. Il semble bien que, même les fidèles d’une religion dite universelle, se percevaient comme très différents de leurs concitoyens d’une autre religion. Cela a produit en France, ce que l’on appelle les Guerres de religion, une série de huit guerres civiles entre catholiques et protestants, guerres qui ont duré 200 ans jusqu’à ce que la Révolution française énonce les droits du citoyen et proclame en 1789 l’état démocratique et laïque. Aujourd’hui, dans notre pays, la religion ne constitue heureusement qu’un aspect secondaire de l’identité nationale. On est d’abord Québécois et, ensuite, on est adepte (ou non!) d’une religion: on est Québécois protestant ou Québécois catholique, juif, musulman, athée ou autre. Du moins vise-t-on que ce soit ainsi! Mais pour cela, il est nécessaire que la volonté de vivre ensemble soit fortement imprimée dans la tête de chacun(e) d’entre nous. L’écrivain Jean Cayrol, qui a rédigé le commentaire de Nuit et brouillard, conclut le film par ces mots: « Nous qui feignons de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays, nous ne pensons pas à regarder autour de nous, et n’entendons pas qu’on crie sans fin ». Eh bien, ce « nous », c’est également nous, les Québécois.










