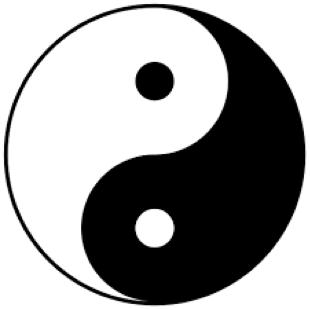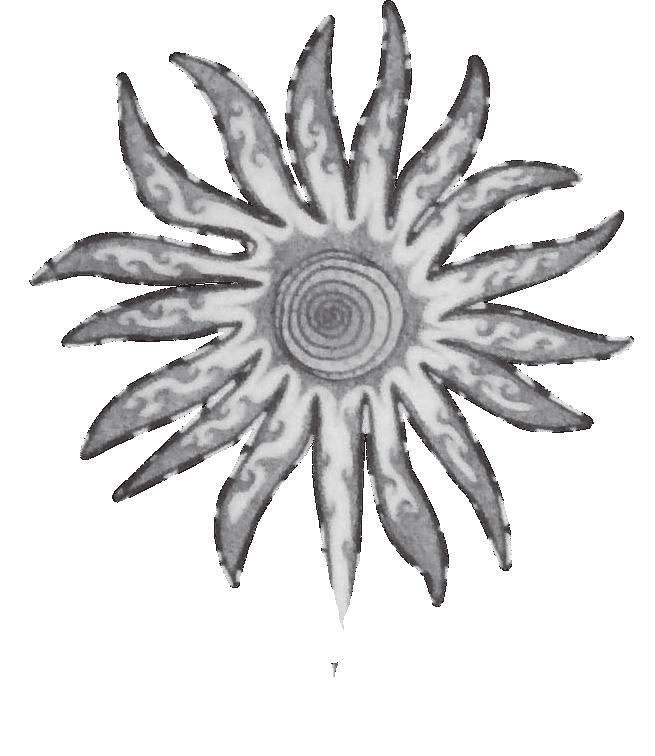3 minute read
Oui à la discrimination
C ourtoi sie: Claude Cossette
La personne qui est capable de discriminer est avantagée par rapport à celle qui en est incapable. Discriminer est signe d’intelligence, de culture, d’instruction.
Advertisement
DISCRIMINER, C’EST DISTINGUER
Distinguer une patate d’une carotte est un signe de jugement élémentaire, enfantin. Cependant, pour pouvoir distinguer une patate (douce) d’une pomme de terre, il faut qu’on l’ait appris; c’est signe de culture — sans jeu de mots. Et distinguer une patate d’un rutabaga et d’un topinambour exige une certaine instruction; il faut, au moins sommairement, avoir étudié l’horticulture. Le célèbre psychopédagogue Benjamin Bloom a bien montré que l’aptitude mentale d’un jeune humain va de la simple possibilité de répéter ce que l’on sait jusqu’à l’éventualité de jongler avec des idées abstraites, comme le permettent seules les capacités cognitives supérieures. Au plus simple stade du développement de l’intelligence, une personne peut répéter. Comprendre est plus difficile, car on doit alors pouvoir distinguer et surtout choisir. Analyser et synthétiser exigent encore davantage, car on doit pouvoir comparer, résumer, expliquer, reformuler, réarranger et peut-être même créer. C’est l’ensemble de ces aptitudes qui permet à des êtres humains de pratiquer un métier complexe comme celui de grutière, de boucher ou de chauffeuse de poids lourd. Ou à d’autres de remplacer un cœur, de planifier un pont ou de créer une symphonie. Dans chacun des métiers mentionnés, le talent exige au premier chef de pouvoir discriminer entre deux choses ou deux options, d’être capable d’exercer sa capacité de différencier, de distinguer, de discerner. D’évaluer donc puis de choisir. L’aptitude à discriminer joue un rôle essentiel dans la vie. C’est une éblouissante aptitude de l’être humain.
DISCRIMINER, C’EST REJETER
C’est un talent précieux de savoir discriminer entre deux objets, deux idées ou deux actions, mais c’est une autre affaire que de discriminer entre deux personnes seulement sur les apparences ou les préjugés. Bien sûr, l’égalité était plus facile quand tous les citoyens de Québec étaient blancs, francophones, catholiques et pauvres. Mais aujourd’hui? Eh bien! aujourd’hui, ce genre de discrimination est illégal et criminel. La Charte des droits et libertés de la personne de 1975 définit la discrimination comme « une distinction, une exclusion ou une préférence qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l’égalité ». Sont donc interdits, sexisme, âgisme, homophobie, grossophobie, racisme, et autres.
La Commission des droits de la personne explique que « la discrimination est en général alimentée par des stéréotypes et des préjugés, conscients ou non ». Naguère encore, un anglophone était présumé riche et appelé bloke d’un ton méprisant, un Juif était présumé commerçant et qualifié de baise-la-piastre. L’égalité, c’est beau en principe, mais dans la vie de tous les jours, sur la place publique ou dans la tête de la majorité des Québécois, est-ce que ça se passe comme l’exige la loi? Les Québécois se prétendent ouverts, recevants, inclusifs. Ils clament qu’ils ne sont pas racistes. Peut-être sont-ils plus hypocrites que d’autres, car sous leurs dehors affables, ils ou elles éprouvent des poussées d’urticaire simplement à croiser sur le trottoir une femme voilée, à partager l’ascenseur avec un Africain parfumé aux épices, à passer devant une boucherie cachère. Ou à côtoyer un autochtone de nos Premières Nations. Tous les pays sont confrontés à une discrimination systématique rarement avouée: une personne dérange quand elle n’est pas comme la majorité. Avec la mondialisation, les moyens de transport faciles, l’inégalité des ressources, les famines, les conflits internes, de plus en plus de « personnes différentes » viendront nous rejoindre pour élever leurs enfants dans notre « plus meilleur pays du monde ». Nous avons, en 1975, démocratiquement décidé que tous les citoyens bénéficieraient des mêmes droits, peu importe la couleur de leur peau, leur allure ou leur appartenance à un groupe particulier, qu’il soit religieux, politique, économique ou social. C’est à nous, Québécois, de nous comporter conformément à notre décision — sinon, on nous traitera de « gros parleurs, p’tits faiseurs ».