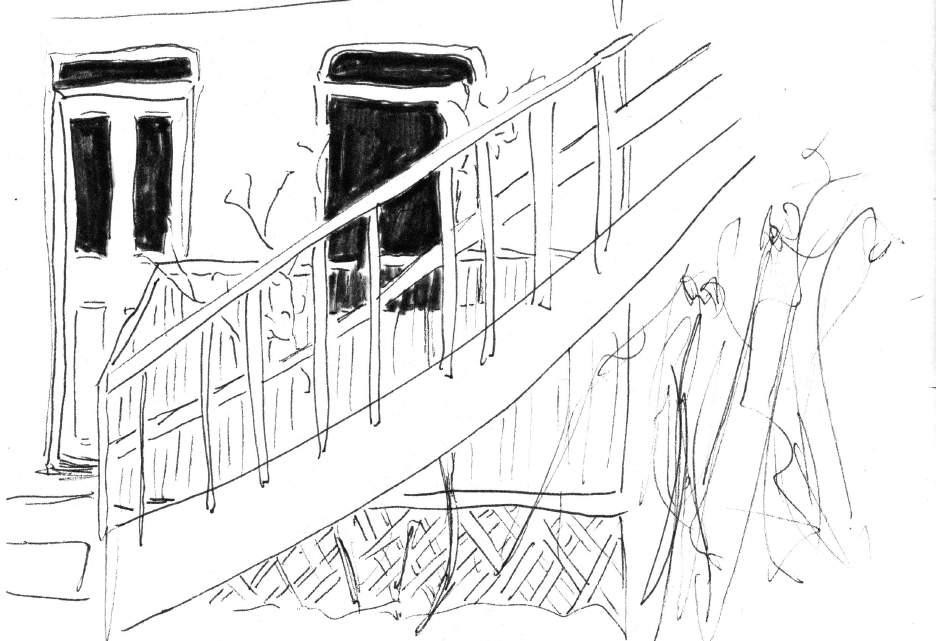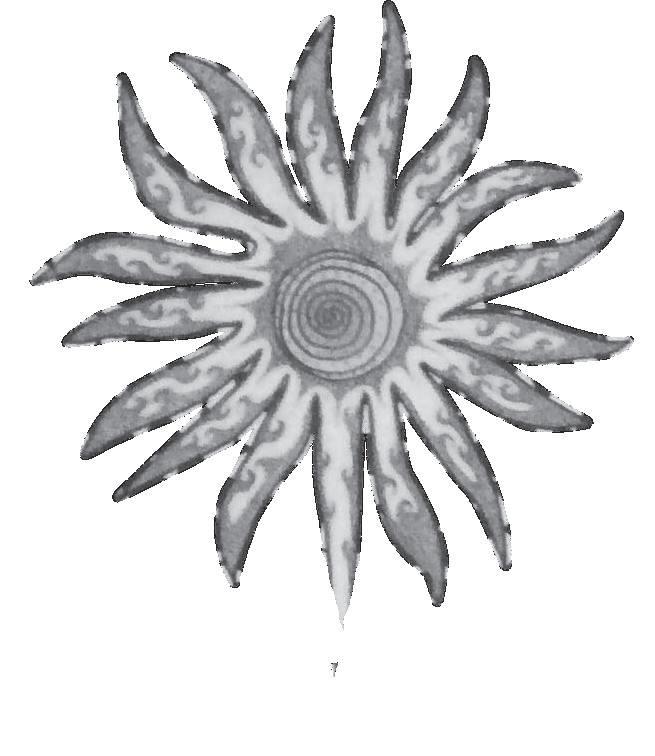3 minute read
Loi 54 : un bilan bien incertain
En décembre 2015, le Québec s’est doté d’une loi reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles. Dans les faits, qu’est-ce que cela a changé? La Quête s’est entretenue avec un expert du bien-être animal qui relève la difficulté de dresser un bilan, trois ans plus tard.
avaient déjà commencé à légiférer pour interdire des pratiques en agriculture, mais l’idée de déterminer la façon dont les animaux doivent être traités est une « approche très européenne », soutient l’expert.
Advertisement
TRISTE RÉPUTATION
La loi 54 visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en décembre 2015. L’objectif était alors de reconnaitre l’animal comme un être sensible, « et non plus comme un bien ou un meuble », explique le professeur adjoint en comportement et bien être en production animale de l’Université Laval, Jamie Ahloy-Dallaire. « C’est assez rare dans le monde, détaille l’expert. Il y a quelques autres pays seulement qui ont adopté une telle législation. Même si ce peut être symbolique à un certain point, pour l’instant, c’est quand même un grand pas qui est fait. » La loi 54 oblige ainsi les propriétaires à subvenir aux besoins essentiels des animaux, c’est-à-dire aux impératifs physiques, physiologiques et comportementaux. « Au niveau physique et physiologique, on a déjà des lois au fédéral qui s’adressent à ces problèmes potentiels, souligne Jamie Ahloy-Dallaire, c’est-à-dire qu’on peut déjà punir quelqu’un qui ne nourrit pas convenablement son animal, par exemple. Les impératifs comportementaux, l’idée que l’animal peut avoir à exprimer un certain comportement, c’est quelque chose qu’on ne retrouvait pas dans les lois auparavant ». Selon le professeur, l’approche québécoise est pratiquement unique en Amérique du Nord. Quelques États américains, la Californie notamment, Le Québec a longtemps traîné la réputation d’être la capitale canadienne des usines à chiots. Certaines industries en agriculture qui ont plutôt mauvaise réputation (le veau de lait ou le foie gras, par exemple) sont aussi plus importantes au Québec qu’ailleurs au Canada. « Par rapport aux usines à chiots, c’est encore trop tôt pour connaître les effets de la loi, croit le professeur en bien-être animal. On voit que de plus en plus de plaintes sont portées et que beaucoup d’inspections sont faites. À quel point ça incite les éleveurs de chiots à changer leur pratique? C’est difficile à dire. C’est de l’information qui n’est pas encore disponible. » Difficile également de faire le bilan de la situation chez les éleveurs, qui font l’objet d’exemptions dans la loi, notamment sur les interdictions de causer de la détresse et sur l’obligation de survenir aux besoins, tant et aussi longtemps que leur traitement est fait selon les pratiques généralement reconnues dans l’industrie. Même chose du côté de la recherche pour les animaux de laboratoire.
ALLER PLUS LOIN?
Si la loi était nécessaire, il est complexe d’en faire le bilan. « J’ai de la difficulté à dire comment on pourrait aller plus loin sans savoir exactement où on est », admet Jamie Ahloy-Dallaire. Avec de la volonté politique, l’expert croit toutefois que le gouvernement
« Par rapport aux usines à chiots, c’est encore trop tôt pour connaître les effets de la loi... » ~ Jamie Ahloy-Dallaire
Trois ans après l’adoption de la loi 54, le professeur adjoint en comportement et bien être en production animale de l’Université Laval, Jamie Ahloy-Dallaire, éprouve de la difficulté à dresser un bilan.
pourrait mieux encadrer les pratiques en agriculture et en laboratoire, qui sont soumises à l’heure actuelle aux codes de pratiques. Ces codes sont établis par les industries pour déterminer par exemple la grandeur des enclos, les techniques à utiliser pour manipuler les animaux, la nourriture à leur donner, l’éclairage, et autres. Ce sont des pratiques auxquelles les éleveurs choisissent volontairement de se conformer.
« Cette loi donne tout de même des dents *(sic)* aux codes de pratique des industries. Depuis que la loi est entrée en vigueur, on pourrait avoir une plainte portée à l’endroit d’un agriculteur qui pourrait alors soit modifier son comportement, soit être en contravention avec la loi. On ajoute donc une partie légale aux codes de pratique. »
L’expert rappelle que le Québec compte davantage d’animaux de ferme et de recherche (poules, vaches, souris de laboratoire, etc.) que d’animaux de compagnie.