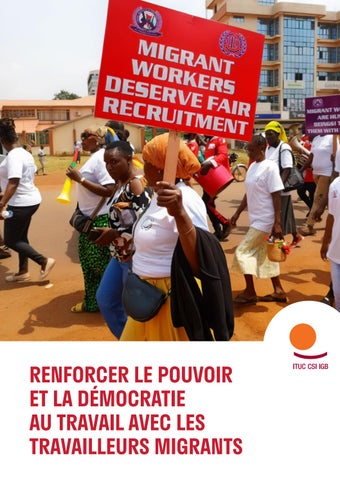INTRODUCTION: TRAVAILLEURS MIGRANTS, DROITS DÉMOCRATIQUES ET AVENIR DU TRAVAIL
Les travailleurs et travailleuses migrants sont indispensables au fonctionnement de l’économie mondiale actuelle. Ils jouent un rôle capital dans l’organisation des sociétés, notamment dans le domaine de la livraison de produits alimentaires, des soins, du bâtiment et des services essentiels. Alors que le monde fait face à des changements démographiques, au vieillissement des populations, à des pénuries de maind’œuvre et à une augmentation des inégalités, la demande de travailleurs migrants ne cesse de croître. D’après l’OIT, il y a plus de 167 millions de travailleurs migrants internationaux sur la planète, ce qui représente quasiment 5% de la main-d’œuvre mondiale1.
Les travailleurs migrants se concentrent dans des secteurs figurant parmi les plus essentiels – et pourtant sous-évalués et vulnérables – comme le travail domestique, la construction, l’agriculture, l’industrie manufacturière, les soins, les transports et l’hôtellerie2
Or, même si le travail des migrants fait vivre des nations entières, il arrive souvent que leurs droits ne soient pas respectés ou qu’ils leur soient délibérément refusés, ce qui se produit de plus en plus souvent. Les travailleurs migrants sont confrontés à des niveaux élevés d’emploi précaire, d’exploitation et de discrimination et sont exclus des protections sociales et des protections
inhérentes au travail. Leur statut de travailleurs sans papiers, la barrière de la langue, les visas liés à l’employeur, le racisme, la xénophobie et des cadres juridiques trop fragiles ne font qu’aggraver leur vulnérabilité3
Les travailleuses migrantes, en particulier dans le domaine du travail domestique ou des soins et services à la personne, rencontrent plusieurs types de difficultés interconnectées: discrimination sexuelle, isolement et risque accru de violence et de harcèlement4.
Ce document de sensibilisation défend le droit de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs migrants. Ces droits fondamentaux, inscrits dans les conventions de l’OIT et la législation internationale relative aux droits humains, restent toutefois hors d’atteinte pour des millions de migrants5. La capacité de constituer des syndicats et de s’y affilier et de mener des négociations collectives n’est pas seulement un outil de protection des travailleurs, mais aussi une voie d’accès à l’égalité, à l’intégration et à l’autonomisation.
Permettre aux travailleurs et travailleuses migrants de s’organiser bénéficie à tout le monde car cela améliore les normes du travail pour tous les travailleurs, en empêchant un nivellement par le bas en termes de salaires et de conditions de travail. La syndicalisation des travailleurs migrants favorise la cohésion sur le lieu de travail, réduit l’exploitation et rend les marchés du travail et les démocraties plus équitables et plus stables. Pour les employeurs, elle se traduit par une diminution de la rotation
1 Organisation internationale du Travail, Estimations mondiales de l’OIT concernant les travailleurs migrants. Quatrième édition, 2024
2 Estimations mondiales de l’OIT concernant les travailleurs migrants, 2024
3 Confédération syndicale internationale, Dossier politique de la CSI: Un nouveau contrat social pour les travailleurs migrants, 2023
4 Estimations mondiales de l’OIT concernant les travailleurs migrants, 2024
5 Organisation internationale du Travail, Liberté syndicale et négociation collective: quels droits pour les travailleurs migrants?, 2023
du personnel, une meilleure communication et des pratiques commerciales plus durables6 Pour la société, elle renforce la cohésion sociale, l’intégration et la participation démocratique.
La garantie de ces droits nécessite une action de la part de tous les acteurs. Les gouvernements doivent créer des environnements juridiques propices qui protègent les droits de tous les travailleurs, quel que soit leur statut, et aligner les politiques de migration et de travail sur les normes et le droit internationaux. Les employeurs doivent respecter et mettre en œuvre le droit des travailleurs migrants de s’organiser et de mener des négociations collectives, non seulement en paroles, mais aussi à travers des cultures d’entreprise inclusives, un recrutement équitable et des pratiques responsables tout au long des chaînes d’approvisionnement.
Les syndicats, qui constituent le plus grand mouvement démocratique au monde, jouent un rôle central pour instaurer la démocratie sur le
lieu de travail et défendre les droits de tous les travailleurs. Dans le cadre de sa campagne « Pour la démocratie »7, la CSI affirme que les droits démocratiques commencent au travail. C’est l’exploitation – et non la migration – qui est la véritable cause de la crise. Lorsque les droits syndicaux sont bafoués, l’espace civique se rétrécit et l’État de droit s’affaiblit. Dans de telles conditions, l’exploitation prospère. Le respect des droits syndicaux des travailleurs migrants est essentiel pour leur dignité et leur protection, et également pour bâtir des sociétés plus fortes, plus justes et plus démocratiques.
Cette note d’information a pour objectif d’apporter aux syndicats, aux responsables politiques et à leurs alliées les indications et les outils nécessaires pour lever les obstacles à la syndicalisation et veiller à ce que les travailleurs migrants puissent exercer pleinement et librement leurs droits.
PLUS FORTS ENSEMBLE: POURQUOI LES
DROITS SYNDICAUX DES TRAVAILLEURS MIGRANTS SONT IMPORTANTS
POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS EUX-MÊMES
Garantir aux travailleurs et travailleuses migrants le droit de liberté syndicale est primordial pour leur assurer dignité, sécurité et égalité. Souvent, les travailleurs migrants sont plus exposés que les autres travailleurs au risque d’exploitation, en raison de l’insécurité liée à leur statut migratoire, d’une connaissance limitée de leurs droits et de barrières linguistiques ou culturelles. Les syndicats sont indispensables
pour permettre aux travailleurs d’accéder à des informations précises sur leurs droits et protections, et de revendiquer collectivement des salaires équitables, des conditions de travail sûres, des horaires raisonnables, ainsi que la santé et la sécurité sur le lieu de travail, entre autres droits.
En outre, en adhérant à un syndicat, les travailleurs migrants peuvent bénéficier d’une assistance juridique et de la force collective nécessaire pour lutter contre la discrimination, le harcèlement, le vol de salaire ou les licenciements abusifs. Les syndicats apportent
un soutien crucial aux travailleurs migrants pour les aider à s’orienter dans des systèmes juridiques complexes et à faire face aux abus.
Il est important de noter que la capacité à s’organiser donne aux travailleurs migrants une voix collective et renforce leurs relations avec leurs collègues et voisins non migrants, sur leur lieu de travail, dans leur secteur d’activité, au sein de leur communauté et dans la vie publique; ils ne sont pas considérés comme de simples sujets de politique, mais comme des personnes qui participent activement à la définition de leurs conditions de travail et de vie.
La syndicalisation leur permet d’acquérir une expérience concrète de la démocratie en action et soutient leur intégration plus générale dans la communauté et sur le marché du travail, en facilitant l’inclusion et la poursuite d’un objectif commun.
POUR L’ENSEMBLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Lorsque les travailleurs et travailleuses migrants sont exclus de la syndicalisation, ils ne sont pas les seuls à en souffrir: tous les travailleurs en subissent les conséquences. Les employeurs peuvent exploiter cette exclusion pour maintenir de faibles salaires et fragiliser les normes de travail et les conventions collectives, ce qui entraîne un « nivellement par le bas ».
L’intégration des travailleurs migrants dans les syndicats contribue à améliorer la situation à tous les niveaux en faisant respecter les salaires minimums, les conditions de travail et des droits qui profitent à tous.
Les syndicats qui accueillent des travailleurs migrants sont mieux armés pour renforcer la solidarité sur le lieu de travail, encourager la compréhension et défendre les droits de tous les travailleurs, quelle que soit leur origine. En revanche, la division et la concurrence entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants alimentent le ressentiment, compromettent la
négociation collective et affaiblissent le pouvoir global de la main-d’œuvre.
La syndicalisation inclusive réduit les tensions en traitant les différends de manière transparente et équitable. Elle valorise l’unité dans la diversité, en reconnaissant que tous les travailleurs – indépendamment de leur nationalité – méritent la dignité, la sécurité et le respect.
POUR LES EMPLOYEURS
Certains employeurs peuvent considérer la syndicalisation des travailleurs et travailleuses migrants comme une menace mais, bien au contraire, les travailleurs organisés ont davantage de moyens d’agir et sont plus engagés. Quand les travailleurs migrants sont autorisés à s’organiser et à formuler leurs préoccupations collectivement, il en résulte un climat de confiance, de respect et de collaboration. La représentation syndicale permet aux travailleurs migrants de se faire entendre et, par conséquent, d’améliorer leur moral et d’atténuer leur isolement. Ainsi, le taux de rotation diminue, car les travailleurs qui se sentent écoutés et protégés sont plus enclins à rester à leur poste8, ce qui fait baisser les coûts de recrutement et de formation. Une main-d’œuvre stable et expérimentée contribue directement à l’augmentation de la productivité, au renforcement du travail d’équipe et à l’amélioration des performances9
En soutenant le droit des travailleurs migrants à s’organiser, les employeurs affichent leur engagement vis-à-vis des normes internationales du travail. Les entreprises qui respectent ces droits sont moins exposées aux risques juridiques, aux atteintes à la réputation et aux perturbations dans leurs chaînes d’approvisionnement. Une solide réputation en matière de pratiques de travail éthiques renforce les relations avec les partenaires de
la chaîne d’approvisionnement mondiale, les acheteurs, les clients et les investisseurs qui privilégient la responsabilité sociale.
Les syndicats offrent par ailleurs un mécanisme de dialogue structuré entre les travailleurs et la direction. Ils aident à identifier et à résoudre les problèmes – tels que les conditions de travail dangereuses, les conflits salariaux et les violations de contrat – avant qu’ils ne s’aggravent. Grâce à un engagement syndical fort, les employeurs peuvent traiter les problèmes à un stade précoce, maintenir les activités et instaurer une culture de règlement des différends.
Enfin, les syndicats peuvent aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences et à relever les défis spécifiques à leur secteur; ils encouragent des politiques qui profitent à la fois aux employeurs et aux travailleurs, telles que l’amélioration des infrastructures, la formation, ainsi que des politiques et des systèmes de migration équitables et fondés sur le respect des droits.
POUR LA SOCIÉTÉ
Les sociétés qui protègent les droits des travailleurs migrants favorisent la cohésion sociale. Lorsque les migrants sont intégrés en tant que membres à part entière de la population active, avec les mêmes droits et responsabilités, ils sont plus à même de participer activement à la vie civique et de jouer un rôle dans leur communauté.
Cette intégration permet de faire reculer la xénophobie, la marginalisation et les divisions.
Donner aux travailleurs et travailleuses migrants la possibilité de se syndiquer est également un moyen efficace de lutter contre les pratiques de
travail informelles et l’exploitation10. Quand les migrants sont exclus des protections formelles du travail, ils sont souvent contraints d’accepter des emplois non réglementés, peu sûrs et sous-payés qui faussent les marchés du travail, les régimes fiscaux et l’accès à la protection sociale. Garantir leur inclusion renforce l’emploi formel et l’intégrité du marché du travail.
Lorsque les syndicats, plus forts de l’intégration des travailleurs migrants, font pression pour l’égalité de traitement, la formalisation du travail, la création d’emplois décents et l’accès à la sécurité sociale pour tous les travailleurs, les effets sont bénéfiques pour la société tout entière. Par exemple, si les travailleurs migrants ont la possibilité d’occuper des emplois dans l’économie formelle et de cotiser aux systèmes de protection sociale, la base de financement de ces systèmes s’élargit et le nombre de cotisants et de bénéficiaires s’accroît, ce qui permet un partage plus important des risques. De plus, les contributions des migrants aux systèmes de protection sociale et aux services publics par le biais des cotisations de sécurité sociale et des impôts11 peuvent alléger la pression sur les finances publiques et améliorer la viabilité à long terme des systèmes de protection sociale dans les pays dont la population vieillit12.
En outre, des protections solides pour tous les travailleurs – migrants compris – génèrent une croissance économique durable et inclusive. Les pratiques de travail équitables augmentent la productivité13, réduisent la rotation du personnel14, et favorisent la stabilité et la prospérité des communautés.
Au final, garantir la liberté syndicale aux travailleurs migrants n’est pas seulement une solution juste pour eux, c’est aussi une mesure qui bénéficie à l’ensemble de la société.
10 Serrano, M. & Xhafa, E., From ‘precarious informal employment’ to ‘protected employment’: the ‘positive transitioning effect’ of trade unions, 2016 et Organisation internationale du Travail, Organizing Informal Economy Workers into Trade Unions: A trade union guide, 2019
11 Tax Payments by Undocumented Immigrants – ITEP
12 Dossier économique de la CSI: Ensuring Migrants’ Access to Social Protection – Confédération syndicale internationale, 2021
13 Bryson, A. & Forth, J., The added value of trade unions: a review of existing evidence, 2017
14 Khan, M.T. & Khan, N.A., Role of labor unions beneficial for employer, 2011
OBSTACLES À LA SYNDICALISATION
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Malgré l’absence de données détaillées, les informations disponibles montrent que les taux de syndicalisation des travailleurs et travailleuses migrants sont inférieurs à ceux des travailleurs non migrants. Par exemple, une étude portant sur 14 pays européens révèle que le taux de syndicalisation des travailleurs migrants est environ 1,3 fois inférieur à celui des travailleurs non migrants15. Cependant, une autre étude européenne indique que les travailleurs migrants, en moyenne, arborent une attitude plus positive à l’égard des syndicats et font davantage confiance aux syndicats que leurs homologues non migrants16.
Les taux de syndicalisation plus faibles s’expliquent en partie par la ségrégation du marché du travail, c’est-à-dire la surreprésentation des travailleurs migrants dans des secteurs où la présence syndicale est traditionnellement peu élevée, comme l’agriculture, le travail domestique et certains secteurs des services17. Il existe néanmoins d’autres difficultés découlant du statut de migrant.
Bien que la liberté syndicale et la négociation collective soient des droits fondamentaux des travailleurs, et malgré le rôle croissant des travailleurs migrants dans le fonctionnement de nombreuses économies, organiser les
migrants en syndicats reste un défi de taille pour le mouvement syndical. Les travailleurs migrants se heurtent souvent à un ensemble d’obstacles juridiques, institutionnels et pratiques qui limitent leur capacité à adhérer à des syndicats, à participer à des actions collectives et à se faire représenter18. Ces difficultés sont systémiques, se superposent et sont particulièrement graves pour les migrants qui travaillent dans l’économie informelle, ou qui occupent des emplois temporaires ou faiblement rémunérés. Les femmes rencontrent des obstacles supplémentaires en raison des normes de genre et de la ségrégation professionnelle.
Selon une enquête réalisée en 2022 par la CSI auprès de 52 centrales syndicales dans 44 pays, les restrictions législatives sont l’obstacle le plus souvent cité pour organiser les travailleurs migrants, avant le manque de sensibilisation des travailleurs migrants, la peur des représailles, les barrières linguistiques, la difficulté à entrer physiquement en contact avec les travailleurs migrants et l’insuffisance des ressources syndicales19
Ces réponses reflètent une réalité dans laquelle les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs migrants sont souvent bafoués dans la pratique – même lorsqu’ils sont théoriquement protégés par la loi. Selon l’Indice CSI des droits dans le monde 2025, dans trois pays sur quatre les travailleurs se sont vu refuser le droit de liberté syndicale et de négociation collective20
15 Gorodzeisky, A. y Richards, A. (2013). “Trade unions and migrant workers in Western Europe”. European Journal of Industrial Relations, 19 (3): 239–54. Concernant le taux plus faible de syndicalisation des travailleurs migrants, voir également: Cools, A., Finseraas, H. and Rasmussen, M. B., The Immigrant-Native Gap in Union Membership: A Question of Time, Sorting, or Culture?, 2021
16 Gorodzeisky, A., & Richards, A. (2020). Do Immigrants Trust Trade Unions? A Study of 18 European Countries. British Journal of Industrial Relations, 58(1), 3-26.
17 Organisation internationale du Travail, Liberté syndicale et négociation collective: quels droits pour les travailleurs migrants?, 2023
18 Liberté syndicale et négociation collective: quels droits pour les travailleurs migrants? – Organisation internationale du Travail, 2023
19 Les résultats de l’enquête sont disponibles auprès de la CSI (non publiés)
20 Indice CSI des droits dans le monde – Confédération syndicale internationale, 2025
OBSTACLES À LA SYNDICALISATION
L’exclusion juridique reste un obstacle très répandu. Dans de nombreux pays, les lois nationales interdisent à certaines catégories de travailleurs migrants de constituer des syndicats ou de s’y affilier. Ces exclusions s’appliquent souvent aux travailleurs sans papiers, aux travailleurs munis de visas précaires ou de courte durée, et aux travailleurs des secteurs du travail domestique, de l’agriculture ou des zones franches d’exportation. Même lorsque les travailleurs migrants sont autorisés à adhérer à un syndicat, il peut leur être interdit d’occuper des postes de direction ou de participer à des négociations collectives, ce qui limite leur capacité à représenter leurs propres intérêts. Ces entraves juridiques sont souvent aggravées par des restrictions plus larges qui touchent tous les travailleurs, telles que les conditions fastidieuses d’enregistrement des syndicats et les lois qui limitent la capacité des syndicats à agir de manière indépendante ou à s’organiser à différents niveaux.
Les politiques migratoires constituent également des freins structurels à la syndicalisation. Dans de nombreux contextes, le statut juridique d’un travailleur dépend directement de son employeur du fait de systèmes de parrainage ou de visas liés à l’employeur. Cette dépendance confère aux employeurs un pouvoir disproportionné sur les travailleurs migrants, qui peuvent craindre des représailles, la perte de leur emploi, la détention ou l’expulsion s’ils tentent de s’organiser ou de prendre part à une activité syndicale. Ces craintes sont totalement fondées. L’enquête 2022 de la CSI a révélé que 14 % des personnes interrogées ont cité la peur des représailles comme l’un des principaux obstacles à la syndicalisation des travailleurs migrants. L’Indice CSI des droits dans le monde fait état de menaces croissantes à l’encontre des syndicalistes sur toute la planète – harcèlement, intimidation, arrestations arbitraires, assassinats – ce qui met en évidence les risques que courent de plus en plus fréquemment les personnes qui défendent les droits des travailleurs21.
L’accès à la justice est lui aussi un obstacle majeur. Les travailleurs migrants qui subissent des violations de leurs droits – notamment sous la forme d’actes antisyndicaux – n’ont souvent pas accès à des voies de recours efficaces. L’aide juridique est rarement disponible, les procédures sont complexes et les barrières de la langue peuvent rendre la compréhension du système judiciaire extrêmement difficile. Dans de nombreux cas, les migrants ne connaissent pas leurs droits ou se méfient des institutions officielles de par leur expérience passée de la discrimination ou de l’exclusion. Cette situation, conjuguée à la menace de détention ou d’expulsion, dissuade un peu plus les travailleurs de dénoncer les injustices, de s’organiser ou de mener des actions collectives.
Même lorsque des droits légaux existent, les difficultés pratiques compliquent souvent la syndicalisation. Les travailleurs migrants sont régulièrement employés dans des lieux isolés ou informels, tels que des maisons privées, des exploitations agricoles rurales ou des installations offshore, où l’accès aux syndicats est restreint ou inexistant. Les employés domestiques logés chez leur employeur, par exemple, ne sont pas toujours autorisés à quitter le domicile de l’employeur, ce qui limite les contacts avec les autres travailleurs et les représentants syndicaux. Les horaires irréguliers, les longues heures de travail et l’absence de jours de repos compromettent également la participation aux réunions syndicales et aux activités de syndicalisation.
D’autre part, les problèmes de communication sont importants. Les barrières linguistiques, le manque d’informations culturelles pertinentes et la méconnaissance des droits du travail sont autant de facteurs qui expliquent la difficulté d’établir un lien entre les travailleurs migrants et les syndicats. Pour les syndicats, atteindre les travailleurs migrants nécessite souvent des ressources supplémentaires et de nouvelles stratégies, en particulier pour organiser des travailleurs dans plusieurs langues ou nationalités. Selon l’enquête 2022 de la CSI, 12% des personnes interrogées ont déclaré que le manque de ressources syndicales constituait un frein majeur, tandis que 14 % ont indiqué que la langue était un obstacle spécifique22.
La discrimination sociale et culturelle complexifie un peu plus encore les activités de
syndicalisation. Il arrive que les migrants soient confrontés au racisme, à la xénophobie ou à la discrimination fondée sur le genre sur le lieu de travail. L’isolement culturel peut amoindrir la confiance et la volonté de participer à des activités collectives. Les travailleuses migrantes rencontrent des difficultés supplémentaires dues aux responsabilités familiales, aux restrictions imposées par l’employeur et à l’exposition à la violence sexiste – ce qui limite leur capacité à s’organiser.
Enfin, des cadres de dialogue social fragiles ou qui excluent certaines catégories de travailleurs empêchent souvent d’aborder au niveau politique les questions relatives aux travailleurs migrants. Même dans les pays dotés d’institutions tripartites ou de systèmes de dialogue nationaux sur les questions de travail, la représentation des travailleurs migrants fait souvent défaut. De même, les accords bilatéraux et les cadres régionaux sur la migration de main-d’œuvre ont tendance à écarter les dispositions en faveur de la liberté syndicale et de la négociation collective pour les migrants, entraînant de graves lacunes en matière de protection des migrants et d’application des mesures.
Ensemble, ces obstacles juridiques et pratiques expliquent la persistance de faibles taux de syndicalisation parmi les travailleurs migrants. De surcroît, ils soulignent la nécessité de déployer des efforts délibérés et soutenus pour lever ces barrières et créer les conditions nécessaires pour que les travailleurs migrants puissent exercer leurs droits librement et en toute sécurité.
ÉTUDES DE CAS DE SYNDICATS
QUI ORGANISENT LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
En dépit des difficultés décrites dans la section précédente, les syndicats de différents pays et secteurs recourent à des approches différentes pour atteindre les travailleurs et travailleuses migrants, les soutenir et leur donner les moyens d’agir. Nombre de ces efforts commencent par l’instauration d’un climat de confiance à travers l’organisation des travailleurs au niveau local, en partenariat avec des associations dirigées par des migrants, des organisations de la société civile et des réseaux religieux ou culturels. D’autres syndicats se rapprochent des communautés de migrants pour recruter des organisateurs et organisatrices qui soient capables de surmonter les différences linguistiques et culturelles et de faire office d’intermédiaires de confiance.
L’autonomisation juridique constitue également une pierre angulaire de la stratégie syndicale. Le fait d’apporter une aide juridique et une représentation – par exemple dans les cas de vol de salaire – est un point d’entrée efficace pour engager le dialogue. En parallèle, les syndicats plaident pour des réformes politiques visant à supprimer les obstacles juridiques qui empêchent les travailleurs migrants de s’organiser ou d’accéder à la justice.
L’éducation et la formation demeurent essentielles. De nombreux syndicats proposent des ateliers sur la connaissance des droits, ainsi que des formations sur l’aptitude à diriger et le développement des compétences,
souvent adaptés aux besoins et aux horaires spécifiques des travailleurs migrants. En même temps, les syndicats prennent des mesures pour garantir l’inclusion structurelle; par exemple, ils créent des comités de travailleurs migrants, réservent des rôles dirigeants aux migrants et adaptent les services syndicaux pour les rendre accessibles d’un point de vue linguistique et culturel.
D’un autre côté, de nouvelles problématiques peuvent aussi générer l’innovation. Des outils numériques, des applications mobiles et des campagnes de médias sociaux sont déployés pour entrer en contact avec les travailleurs dans des secteurs difficiles à atteindre – tels que le travail domestique et l’économie des plateformes – dans lesquels les méthodes de syndicalisation traditionnelles sont souvent insuffisantes.
Les études de cas suivantes présentent des exemples concrets de la manière dont les syndicats du monde entier parviennent à organiser les travailleurs. Elles montrent qu’avec des stratégies appropriées, la syndicalisation des travailleurs migrants n’est pas seulement possible, mais qu’elle est puissante, porteuse de transformations et essentielle à un avenir du travail juste et inclusif.
RÉPUBLIQUE DE CORÉE: CRÉER UN SYNDICAT DIRIGÉ PAR LES MIGRANTS, ENVERS ET CONTRE TOUT
En 2025, la confédération syndicale Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) et le syndicat de migrants de Séoul-Gyeonggi Migrants Trade Union (MTU) ont célébré les
20 ans du MTU – un exemple encourageant de travailleurs et travailleuses migrants qui s’organisent eux-mêmes pour revendiquer droits, reconnaissance et dignité. Ce mouvement a vu le jour au début des années 2000, lorsque les travailleurs migrants en situation précaire se sont mobilisés auprès du Syndicat de l’égalité de la KCTU dans l’objectif de résister aux expulsions forcées et d’obtenir leur régularisation.
À l’époque, les politiques de l’emploi néolibérales de la République de Corée avaient aggravé les inégalités et l’instabilité de la main-d’œuvre. Les travailleurs temporaires et précaires, dont de nombreux migrants, ont commencé à se syndiquer pour demander des protections. La création du Syndicat de l’égalité en tant que syndicat local sous l’égide de la KCTU a rassemblé ces groupes marginalisés et leur a servi de plateforme pour faire campagne en faveur de l’égalité des droits. Face à l’escalade de la répression gouvernementale à l’encontre des travailleurs sans papiers en 2003, la communauté des migrants, soutenue par la KCTU, a appelé à des manifestations de masse et a organisé un sit-in de 380 jours à la cathédrale Myeongdong, à Séoul.
Bien que le gouvernement ait initialement refusé de reconnaître le MTU, au motif que les travailleurs sans papiers ne disposaient pas du droit de liberté syndicale, un arrêt de la Cour suprême de 2015 a annulé cette décision. L’arrêt affirmait que tous les travailleurs, quel que soit leur statut migratoire, avaient le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en vertu du droit du travail coréen. À la suite de cet arrêt, le MTU a été légalement reconnu, ce qui a marqué un tournant dans l’histoire des droits du travail en République de Corée.
Depuis qu’ils sont reconnus, le MTU et la KCTU ont élargi leur champ d’action aux travailleurs migrants en proposant du matériel éducatif multilingue, des événements communautaires,
des actions de syndicalisation dans les complexes industriels où les migrants travaillent dans des micro-entreprises, et des formations sur l’aptitude à diriger. Ces activités ont permis de renforcer les protections juridiques, de mieux faire connaître les problèmes des travailleurs migrants et de mieux les intégrer dans les débats nationaux sur le travail.
PÉROU: INSTITUTIONNALISER
L’INCLUSION DES MIGRANTS DANS LES STRUCTURES SYNDICALES
En réponse à l’évolution du paysage migratoire péruvien, la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) a entrepris un changement institutionnel majeur en 2024 en modifiant ses statuts afin de créer un Secrétariat national pour les travailleurs migrants. Cette décision représente une étape décisive dans l’approche de la Confédération en matière d’inclusion et témoigne de sa volonté d’intégrer les travailleurs et travailleuses migrants dans tous les aspects de la vie syndicale.
Le Secrétariat a été créé pour renforcer la capacité des syndicats à répondre aux besoins des travailleurs migrants, à sensibiliser les travailleurs locaux aux droits des migrants et à promouvoir des réformes structurelles destinées à lever les barrières juridiques à l’emploi formel. En partenariat avec l’OIT, la CATP a élaboré un Plan syndical global sur la migration de la main-d’œuvre et la mobilité humaine, qui recense les principaux enjeux et définit un cadre pour les activités de plaidoyer et de syndicalisation menées par les syndicats.
Le regroupement de chauffeurs Organización de Conductores Profesionales y Autónomos (OSCPA), affilié à la CATP, illustre la syndicalisation de la base dirigée par des migrants. Fondée et gérée principalement par des ouvriers du transport migrants, l’OSCPA
a mobilisé des travailleurs de l’économie informelle et de l’économie des plateformes pour exiger des protections contre les contrats injustes, l’absence d’assurance et l’exclusion administrative. En établissant un lien entre l’adhésion à un syndicat et l’autonomisation juridique, l’OSCPA aide les travailleurs migrants à faire valoir leurs droits, y compris dans l’économie informelle.
La CATP et l’OSCPA continuent de proposer des formations sur les droits, de soutenir les travailleurs dans les procédures judiciaires et de participer activement au dialogue national sur la migration et la politique de l’emploi. Leur expérience montre que le changement institutionnel, mené par les dirigeants migrants, peut transformer les stratégies syndicales et veiller à ce que tous les travailleurs soient représentés et protégés.
ITALIE: ATTEINDRE LES TRAVAILLEURS MARGINALISÉS AVEC L’AIDE DU SINDACATO DI STRADA
En Italie, la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL) a élaboré une stratégie ciblée pour faire participer les travailleurs et travailleuses migrants employés dans des secteurs parmi les plus précaires du pays, notamment l’agriculture, la construction, la logistique et le travail domestique. Grâce à son initiative Sindacato di Strada (syndicat de rue), la CGIL rapproche la syndicalisation directement des personnes qui travaillent dans les fermes, sur les chantiers et dans les installations informelles, en leur offrant une assistance juridique, des possibilités d’adhésion et un soutien direct.
Reconnaissant que les travailleurs migrants sont souvent physiquement isolés, mal informés sur leurs droits et qu’ils hésitent à s’adresser aux bureaux des syndicats traditionnels, la stratégie mobile de la CGIL consistant à venir
à la rencontre des travailleurs migrants s’est montrée efficace pour établir un climat de confiance et de dialogue. Les organisateurs et organisatrices utilisent des supports multilingues, s’associent aux dirigeants des communautés et fournissent des conseils juridiques immédiats sur des questions relatives à la violation des contrats, au statut migratoire et aux conditions de travail dangereuses.
En 2024, la CGIL comptait près de 490 000 membres migrants, soit 18 % de l’ensemble de ses membres23. Des migrants originaires de pays de l’UE et hors UE ont adhéré à la CGIL, ce qui témoigne du succès des stratégies de syndicalisation inclusives et accessibles. Le travail de la CGIL permet non seulement d’étendre le champ d’action du syndicat, mais aussi de renforcer son pouvoir de négociation en garantissant l’inclusion de tous les segments de la main-d’œuvre.
GHANA: RELEVER LE DÉFI DE L’INFORMALITÉ
Au Ghana, où de nombreux migrants et migrantes travaillent dans le secteur informel, la confédération syndicale Trade Union Congress (TUC) a pris des mesures concrètes pour améliorer leur visibilité et leur inclusion. Compte tenu des obstacles structurels auxquels ces travailleurs sont confrontés – à savoir l’insécurité juridique, les représailles des employeurs et la difficulté d’atteindre les travailleurs à travers les structures syndicales traditionnelles –, le TUC a créé une organisation pour les travailleurs informels, Union of Informal Workers Association (UNIWA). Cette plateforme permet aux travailleurs migrants de participer aux activités syndicales et de faire part de leurs préoccupations spécifiques.
Malgré ces initiatives, les difficultés persistent. Les syndicats actifs dans les secteurs à
forte proportion de migrants rencontrent de sérieuses contraintes financières. De nombreux migrants ont un statut irrégulier ou temporaire, ce qui les dissuade de participer à l’action des syndicats, tandis que d’autres restent invisibles du fait de leur environnement de travail isolé ou de la crainte de représailles de la part de leur employeur.
Pour remédier à ces problèmes, le TUC Ghana a adopté plusieurs initiatives:
• Ateliers de renforcement des capacités pour les associations de migrants, tel que l’événement organisé conjointement avec la CSI-Afrique en 2024 pour mettre en avant les droits des migrants d’Afrique de l’Ouest par le biais de la mobilisation politique et du dialogue avec les responsables.
• Évaluations des besoins sectoriels et formation sur le suivi pour les syndicats dans les secteurs de la construction, des transports, de l’agriculture et de l’éducation, dans le cadre du Programme intégré de l’OIT pour le recrutement équitable (FAIR III).
• Sensibilisation des communautés à l’aide de la plateforme Recruitment Advisor de la CSI, en particulier dans le secteur halieutique et maritime, afin de sensibiliser et de promouvoir le recrutement équitable.
• Efforts continus pour intégrer et affilier les associations de migrants en dehors du TUC, en organisant des activités de soutien et de mobilisation communes.
Par ces mesures, le TUC Ghana prépare le terrain pour l’inclusion à long terme et le renouveau syndical, en particulier dans les secteurs historiquement sous-représentés du mouvement syndical.
KENYA: SOLIDARITÉ SYNDICALE AUDELÀ DES FRONTIÈRES ET ENTRE LES SECTEURS
Au Kenya, la centrale syndicale Central Organization of Trade Unions (COTU-K) a élargi son champ d’action pour inclure à la fois les migrants et migrantes internationaux travaillant dans le pays et les travailleurs migrants kenyans à l’étranger. Par ailleurs, avec plus d’un million de migrants internationaux24, le Kenya compte une importante diaspora de plus de quatre millions de citoyens25, dont une grande partie travaille dans des conditions précaires dans les pays du Golfe.
Au Kenya, les migrants travaillent souvent de manière informelle dans des secteurs tels que l’agriculture, le travail domestique et la construction. Conscientes de leur vulnérabilité, la COTU-K et ses affiliées déploient des efforts ciblés pour organiser et soutenir ces travailleurs, comme par exemple:
• Des campagnes de sensibilisation aux droits du travail, à la migration sûre et au recrutement éthique, avec le soutien de la CSI et de l’OIT.
• Le contact avec la communauté et le dialogue direct avec des groupes de travailleurs migrants, en particulier en provenance d’Ouganda et de Tanzanie, dans les secteurs de l’hôtellerie et du travail domestique.
• La création de réseaux de travailleurs migrants dans différents comtés du Kenya caractérisés par des taux de migration élevés, afin de les rapprocher de réseaux du même type dans les pays de destination pour mieux faire entendre les voix des migrants et les intégrer dans les structures syndicales nationales.
En 2023, une initiative déterminante a donné lieu à la création d’un centre de ressources pour les migrants, Migrant Resource Centre (MRC), au siège de la COTU-K à Nairobi, avec l’assistance de l’OIT et de l’organisation britannique UK Aid. Le MRC peut se définir comme suit:
• Centre d’information, d’aide psychosociale et de services spécifiques précédant le départ et suivant le retour des migrants.
• Espace participatif dans lequel les migrants peuvent partager leurs expériences et signaler des abus.
• Plateforme destinée au dialogue pour permettre aux migrants de participer à la réforme politique au travers de structures en réseau.
La COTU-K a également étendu la solidarité internationale en signant des mémorandums d’accord avec des fédérations syndicales du Liban (FENASOL) et du Koweït (KTUF) en vue d’améliorer la protection des travailleurs domestiques migrants originaires du Kenya. Ces partenariats reflètent une tendance croissante à la collaboration syndicale transfrontalière axée sur les droits des migrants, et renforcent l’importance des stratégies communes et de la solidarité au-delà des frontières nationales.
En associant des structures de soutien locales à des activités de plaidoyer au niveau mondial, la COTU-K donne un exemple de double approche de la syndicalisation des travailleurs migrants: elle s’attaque à l’exploitation au Kenya tout en défendant les droits des travailleurs kenyans à l’étranger.
MODÈLES DE SYNDICALISATION
FÉMINISTES, DIRIGÉS PAR DES
TRAVAILLEURS ET CONNECTÉS
NUMÉRIQUEMENT: COMMENT LES
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
DOMESTIQUES PHILIPPINS
TRANSFORMENT LE SYNDICALISME
TRANSNATIONAL
Le travail domestique comporte des obstacles à la syndicalisation extrêmement tenaces, en particulier pour les migrants. Les lieux de travail isolés, les horaires excessifs et la dépendance à l’égard des employeurs en raison du statut migratoire ont pour conséquence d’exclure de nombreux travailleurs et travailleuses domestiques migrants des protections du droit du travail et de la représentation syndicale. Cependant, avec l’aide de la Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD), les travailleurs domestiques migrants sont devenus des organisateurs de premier plan dans le mouvement mondial.
Créée en 2013, la FITD est la seule fédération mondiale dirigée par des travailleuses domestiques. Elle représente aujourd’hui plus de 670 000 domestiques membres de 88 affiliées dans plus de 68 pays26. Les travailleurs domestiques migrants forment le noyau dur de ce mouvement.
La FITD organise des activités de syndicalisation pour les travailleurs domestiques dans des environnements très restrictifs de la planète. Dans les pays du Golfe, où les barrières juridiques et le système de la kafala restreignent considérablement l’organisation des travailleurs, la Fédération a facilité la formation de groupes de travailleurs domestiques de la base en Jordanie, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn et au Liban. En Malaisie et à Taïwan, elle a contribué à la création d’affiliées dirigées par des migrants, telles que PERTIMIG (travailleurs domestiques indonésiens) et AMMPO (travailleurs domestiques philippins), et continue à les soutenir, en mettant en place des systèmes d’assistance, en menant des campagnes et en faisant pression pour obtenir une réforme
de la législation. La FITD et ses affiliées font campagne contre les frais de recrutement, pour des jours de congé réguliers et pour l’application des lois sur le salaire minimum, ce qui influence les politiques à la fois dans les pays d’origine et dans les pays de destination.
Dans de nombreux pays de destination tels que Hong-kong, la Malaisie, Taïwan, Macao, la Jordanie, Bahreïn, le Qatar et le Koweït, les travailleurs domestiques philippins ont créé des syndicats et des associations dirigés par des travailleurs dans le but d’atteindre les travailleurs isolés, de renforcer la communauté, de réagir collectivement aux abus et d’offrir une aide mutuelle et des formations sur les droits. Reconnaissant la nécessité d’une coordination et d’une représentation à un niveau transnational, ces groupes – soutenus par la FITD et la centrale syndicale nationale des Philippines SENTRO (Centrale des travailleurs progressistes unis) – se sont réunis en 2022 pour former PIN@Y Care Workers Transnational. Établie aux Philippines, l’organisation PIN@Y compte actuellement parmi ses membres l’organisation United Domestic Workers (UNITED) aux Philippines, AMMPO en Malaisie, Progressive Labor Union of Domestic Workers (PLU) à Hong-kong, PLU à Macao, Domestic Caretaker Union (DCU) à Taïwan, Sandigan Kuwait Domestic Workers Association (SKDWA) au Koweït, Sandigan Bahrain Domestic Workers Association (SBDWA) au Bahreïn et la Federation of Filipino Association in Amman (FEFAA) en Jordanie.
PIN@Y propose aux affiliées des formations sur mesure concernant les droits du travail, l’organisation collective et les compétences pour diriger un syndicat. Elle organise des rassemblements transfrontaliers et des initiatives visant à atteindre le public dans les pays d’origine et de destination afin d’étendre la syndicalisation aux travailleurs domestiques et aux travailleurs du soin et des services à la personne aux Philippines. La mobilisation numérique est une composante majeure de la
stratégie de PIN@Y: en utilisant Facebook et les groupes WhatsApp, les affiliées partagent des informations juridiques, des outils de plaidoyer, des documents traduits et des alertes sur les employeurs abusifs. En outre, ces espaces en ligne offrent un soutien psychologique et contribuent à rompre l’isolement des travailleurs qui vivent et travaillent chez des particuliers.
Aux Philippines, PIN@Y représente ses membres dans les espaces politiques nationaux, notamment le Département des travailleurs migrants (DMW) et le Conseil consultatif tripartite basé à l’étranger. Elle interpelle sur des cas individuels urgents et fait campagne pour des réformes plus générales, telles que l’application du salaire minimum, la réglementation des agences de recrutement et l’accès à la protection sociale. PIN@Y surveille également les initiatives pilotes en matière de migration, comme le programme consistant à envoyer des travailleurs et travailleuses du soin philippins en République de Corée dans le cadre du système de permis de travail.
Le modèle de syndicalisation transnational de PIN@Y montre comment les mouvements dirigés par les travailleurs migrants peuvent exercer une influence au-delà des frontières, ce qui permet de combler le fossé entre les pays d’origine et de destination, de mieux faire entendre la voix des travailleurs et de créer des voies d’accès à la justice et à la représentation. Ce modèle est un complément puissant au travail de syndicalisation plus général de la FITD, dont le soutien a été crucial pour aider ces réseaux à se développer, malgré les mesures restrictives qui leur ont été imposées.
Ensemble, la FITD et PIN@Y témoignent du potentiel des modèles de syndicalisation féministes, dirigés par des travailleurs et connectés numériquement, pour autonomiser au moins une partie des travailleurs les plus marginalisés de l’économie mondiale.
CONCLUSION: ORGANISER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS POUR LES DROITS, LA JUSTICE ET LA DÉMOCRATIE
Les travailleurs et travailleuses migrants sont essentiels au fonctionnement des économies et des sociétés partout dans le monde. Des soins de santé et de la construction à l’agriculture, en passant par le transport et le travail domestique, les migrants contribuent à la productivité, au bien-être et à la résilience des communautés à travers les frontières. Or, en dépit de leur rôle indispensable, ils sont souvent traités comme des êtres remplaçables, invisibles, sans protection, ou même dangereux; ils sont privés de protections juridiques et de la capacité de faire entendre leur voix sur leur lieu de travail.
Ce rapport attire l’attention sur les barrières structurelles auxquelles se heurtent les migrants pour s’organiser et exercer leurs droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective. Il apporte des indications sur les stratégies innovantes qu’utilisent les syndicats pour surmonter ces obstacles grâce à la solidarité, à la détermination et à l’inclusion. Ces efforts font ressortir une vérité fondamentale: la syndicalisation des travailleurs migrants n’est pas seulement une question de justice pour eux, mais elle permet aussi de créer une force collective, d’améliorer la situation de tous les travailleurs, et de faire progresser les droits démocratiques au travail et dans la société.
Lorsque les travailleurs migrants peuvent constituer des syndicats et s’y affilier, ils sont mieux protégés, mieux informés et mieux armés pour agir. Leur participation donne plus de poids au mouvement syndical, fait reculer l’exploitation et favorise un développement inclusif et durable. En protégeant la liberté des travailleurs migrants de s’organiser, nous améliorons leur vie et, de surcroît, nous renforçons la démocratie au travail et les droits humains, et nous participons à la construction d’un avenir du travail équitable pour tous. Le respect des droits des travailleurs migrants est une responsabilité commune, qui nécessite la volonté et l’action des gouvernements, des employeurs et des syndicats.
DEMANDES DE LA CSI AUX GOUVERNEMENTS:
• Garantir aux travailleurs et travailleuses migrants les droits de liberté syndicale et de négociation collective dans le droit national – quels que soient le statut migratoire, le statut professionnel ou le secteur.
• Lever les barrières juridiques et administratives qui empêchent les travailleurs migrants de constituer des syndicats ou de s’y affilier, d’occuper des postes de direction ou de participer à des négociations collectives.
• Aligner les politiques du travail et les politiques migratoires sur les normes internationales du travail, notamment les conventions 87 et 98 de l’OIT.
• Mettre fin aux systèmes de parrainage et aux régimes de visas liés aux employeurs, qui limitent la liberté des travailleurs migrants et augmentent leur dépendance et leur vulnérabilité.
• Assurer l’accès à la justice, à l’assistance juridique et aux recours efficaces pour tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs sans papiers.
• Promouvoir la participation des travailleurs migrants au dialogue social et aux processus d’élaboration de politiques, et veiller à ce qu’ils soient représentés dans les cadres de gouvernance relatifs au travail.
• Créer et mettre en œuvre des politiques migratoires fondées sur les droits en s’appuyant sur le dialogue social, et les harmoniser avec d’autres domaines connexes comme l’emploi et les politiques industrielles et sociales, pour garantir l’égalité et une prospérité partagée.
DEMANDES DE LA CSI AUX
EMPLOYEURS:
• Respecter et défendre les droits des travailleurs et travailleuses migrants de s’organiser et de négocier collectivement au titre des droits humains fondamentaux et des responsabilités de diligence raisonnable.
• Garantir des pratiques inclusives sur le lieu de travail qui éliminent la discrimination, privilégient la communication en plusieurs langues et aident les travailleurs migrants à prendre part aux activités syndicales sans craindre de représailles.
• Établir un dialogue de bonne foi avec les syndicats pour améliorer les conditions de travail et régler les différends de manière constructive.
• Superviser et perfectionner les pratiques de recrutement pour prévenir l’exploitation et collaborer uniquement avec les agences de recrutement qui respectent les normes de recrutement équitables.
• Utiliser les chaînes d’approvisionnement pour faire appliquer les normes internationales du travail et veiller à ce que tous les fournisseurs respectent les droits syndicaux de tous les travailleurs, y compris des travailleurs migrants.
• Soutenir les initiatives de coopération qui renforcent le pouvoir d’organisation des travailleurs migrants, tels que les programmes d’éducation, les formations préparées en collaboration avec les syndicats, et les conventions collectives inclusives.
ANNEXE: OPTIONS D’ACTION STRATÉGIQUE POUR LES SYNDICATS
Pour les syndicats, un travailleur est un travailleur, quel que soit son statut migratoire. Toutefois, pour que les actions de syndicalisation n’excluent pas les travailleurs et travailleuses migrants, des mesures spécifiques sont souvent nécessaires, comme en témoigne la grande diversité d’approches adoptées par les syndicats pour atteindre, aider et autonomiser les travailleurs migrants (voir la section 4 de ce rapport).
Quand les syndicats adaptent leurs structures et leurs activités pour mieux intégrer les travailleurs migrants, cela permet d’accroître le nombre de membres et l’influence des syndicats, de fortifier la négociation collective, de diversifier les postes de direction de sorte à représenter plus fidèlement la main-d’œuvre, et de renforcer la capacité des syndicats à résoudre les problèmes que rencontrent actuellement les travailleurs.
Voici une liste de mesures que les syndicats peuvent prendre pour faciliter l’intégration des travailleurs migrants dans le mouvement syndical:
▶ Connaître les communautés de migrants: recenser les nationalités, le nombre de migrants, la concentration de migrants par secteur, le genre, les langues parlées, l’âge et les besoins spécifiques.
• Identifier et consulter les acteurs de la société civile qui dispensent des services aux communautés de migrants.
• Consulter le(s) syndicat(s) des pays d’origine (la CSI peut apporter son aide).
• Organiser une/des réunion(s) ou des activités culturelles avec les communautés de migrants.
▶ Connaître les lois et les politiques relatives à la migration: relever la législation concernée et se renseigner auprès des experts juridiques ou des acteurs de la société civile qui travaillent sur les questions de migration.
▶ Identifier de potentiels points focaux ou organisateurs et organisatrices au sein des communautés de migrants.
▶ Proposer des formations et des outils aux points focaux/organisateurs migrants.
▶ Instaurer des structures formelles ou informelles dans les syndicats pour permettre aux travailleurs migrants de discuter et d’aborder leurs préoccupations spécifiques avec les camarades travailleurs et les dirigeants syndicaux.
• Étendre les services existants afin d’inclure les travailleurs migrants.
• Mettre en place des mécanismes de renvoi vers les services existants (dispensés par le secteur public, les ONG ou les organisations internationales mondiales).
• Donner des informations sur les services sociaux ou les services de soins, le soutien juridique, par exemple les procédures de renvoi et/ou l’accompagnement et l’interprétation.
• Fournir des services d’interprétation et de traduction.
• Renseigner les travailleurs migrants sur les droits du travail et la manière de se protéger.
• Prévoir des espaces sûrs pour se réunir, organiser des événements et des activités.
• Préparer des sessions de formation et d’information reposant sur les besoins spécifiques des travailleurs migrants.
• Collaborer avec les syndicats des pays d’origine pour mettre au point et fournir des services ensemble.
▶ Recommander aux gouvernements, aux employeurs et aux agences de recrutement d’adopter des mesures visant à protéger les droits des travailleurs migrants et à permettre aux travailleurs d’exercer ces droits.
▶ Organiser des campagnes sur les questions collectives ayant un impact direct sur les travailleurs migrants.
▶ Créer des alliances syndicales au-delà des frontières pour coordonner les actions dans les différents corridors migratoires: partager les informations, dénoncer les recruteurs peu scrupuleux et mener des campagnes conjointement en faveur de réformes juridiques et politiques.
CSI
Confédération syndicale internationale
info@ituc-csi.org
www.ituc-csi.org
Téléphone: +32 (0)2 224 02 11
Boulevard du Jardin Botanique, 20
1000 Bruxelles - Belgique
Éditeur légalement responsable: Luc Triangle, secrétaire général