Déconstruction graphique
de campements et de cabanes toundriques de la région de Salluit
Intégral des dessins, des analyses et des résultats de la recherche intitulée :
Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra
Pierre-Olivier Demeule
Partenariat Habiter le Nord québécois / Living in Northern Quebec partnership Printemps 2021

annexe 01
Mémoire en sciences de l’architecture
École
-
d’architecture de l’Université Laval
Déconstruction graphique
de campements et de cabanes toundriques de la région de Salluit
Intégral des dessins, des analyses et des résultats de la recherche intitulée :
Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra
Pierre-Olivier Demeule
Partenariat Habiter le Nord québécois / Living in Northern Quebec partnership Printemps 2021


Note à l’intention des lecteurs
Pour faciliter une lecture numérique de cette annexe, il est recommandé d’afficher deux pages à la fois en placant les pages paires à gauche et les pages impaires à droite de l’écran.
Si vous désirez consulter ce mémoire en version papier, prière d’imprimer uniquement les pages qui doivent être consultées.
Numéro de référence au Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 2018-170 / 05-07-2018

annexe 01
Aux bâtisseurs de cabanes toundriques,
merci de m’avoir présenté ce territoire magnifique à travers vos constructions.
Nakurmiik
235 Entre Ilijjaaqait et Kisarvik - cabanes 65 à 69 207 213 219 227 Sajuvvik - Sajuvvialuk - cabanes 42 à 44 Kiassautialuk (1/2) - cabanes 45 à 49 Kiassautialuk (2/2) - cabanes 50 à 61 .................................................................................................................... Entre Pattavik et Kisarvik (1/2) - cabane 62 Entre Pattavik et Kisarvik (2/2) - cabanes 63 à 64 Kisarvik et Qikirtaq - cabane 70 Tuapaaluit - cabanes 71 à 77 ................................................................................................................................ II. ANALYSE DE LA CONFIGURATION DES CAMPEMENTS ..................................................................................... I. ANALYSE TERRITORIALE DU FJORD DE SALLUIT Introduction au contexte de la recherche .................................................................................................................. Environnement et morphologie des campements Méthode d’analyse du fjord ....................................................................................................................................... Parcours, zones d’implantation et emprise des campements du fjord ...................................................................... Méthode d’analyse des campements ........................................................................................................................ 135 127 129 131 122 137 139 145 151 157 161 169 187 175 193 181 199 Igajialuk (1/2) - cabanes 1 à 5 ............................................................................................................................... Igajialuk (2/2) - cabane 6 Mivvik - cabanes 7 à 10 Qarqaluarjutuaq - cabanes 11 à 19 ....................................................................................................................... Ruisseau Tasikululiariaq - cabanes 20 à 25 ........................................................................................................... Sittuuniit - cabanes 26 à 36 Aupartuapik - cabane 37 ....................................................................................................................................... Ruisseau Aupartuapiup - cabanes 38 à 41 .............................................................................................................
Table des matières
III.
position et orientation des
IV. ANALYSE DE LA TECTONIQUE DES CABANES ET SUGGESTION DE MODÈLES TYPES
257 263 269 243 275 277 281 287 291 297 303 309 313 315 351 251 Kikkaluk - cabanes 78 à 84 Les cabanes de Kikkaluk - cabanes 78 à 84 Qikkigiaq - cabane 85 Les cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk - cabane 85 à 87 .......................................................................... Kikkalualuk (1/2) - cabane 86 Kikkalualuk (2/2) - cabane 87 Niaqunnguut - cabane 88 ................................................................................................................................
ANALYSE DES
SITE ......................................................................... Volumétrie,
Méthode d’analyse des cabanes ...............................................................................................................................
cabanes
cabanes
cabanes
cabanes
...................................................................................... Les cabanes de Sittuuniit - cabanes 26 à 36 Tectonique des cabanes Liste des fgures de l’annexe 1 ................................................................................................................................ 325 345 357 359 317 331 337 Les cabanes en mouvement Les cabanes qui observent - type a ................................................................................................................. Les cabanes qui observent - type b Les cabanes immobilisées Les cabanes fxes et déployées
CABANES ET DE LEURS RELATIONS AU
cabanes
Les cabanes d’Igajialuk - cabanes 1 à 6 Les
de Mivvik -
7 à 10 Les
de Qarqaluarjutuaq -
11 à 19
Méthode d’analyse de la tectonique des cabanes .................................................................................................... Analyses globales et corrélations des modèles ........................................................................................................ Médiagraphie de l’annexe 1 ......................................................................................................................................

INTRODUCTION AU CONTEXTE DE LA RECHERCHE

Introduction
Le présent document intègre tous les dessins et toutes les analyses produits dans le cadre du travail de mémoire intitulé : Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra.
Pour orienter la consultation de cette annexe et en permettre une lecture autonome, celle-ci est organisée en quatre sections (lesquelles suivent l’ordre et les étapes clés de la méthodologie de l’étude). Des résumés des objectifs et des exercices d’analyse propres à chaque étape accompagnent également le début des sections. Cela dit, pour bien comprendre les subtilités de l’approche entreprise par la recherche et surtout pour connaître les interprétations et les réfexions qui découlent du travail d’analyse, il est souhaitable de consulter l’intégralité du mémoire ou de minimalement lire l’article scientifque : Savoir-faire locaux et autoconstruction dans la toundra, une lecture des cabanes du fjord de Salluit (Études Inuit StudiesConstruire et habiter l’Inuit Nunangat / Building and Dwelling in Inuit Nunangat - vol. 44, 1-2).
La recherche en quelques mots
Pour les Inuit et les habitants du Nunavik, la vie dans la toundra et la pratique d’activités traditionnelles notamment liées à la chasse ou la pêche contribuent au soutien et au développement d’un « sens » proprement inuit (NVision 2018, Société Makivik et al. 2014, Havelka 2018, Holmes 2013, Searles 2010). Depuis à peine soixante-dix ans, l’avènement de villages et de logements sociaux empreint d’une logique organisationnelle occidentale a bouleversé les
modes de vie et a progressivement imposé de nouvelles dynamiques dans les rapports que les Nunavimmiut entretiennent avec leur territoire (Duhaime 1985-2019, Groupe Habitats et Cultures 2017-19).
En ce sens, l’autoconstruction de cabanes dans la toundra est devenue au fl du temps un moyen d’afrmer une identité nordique tout en assurant la continuité d’un habiter en dialogue avec la toundra (Brière et Laugrand 2017, Havelka 2018). Construites à partir de matériaux pour la plupart récupérés ou transformés, ces cabanes cachent derrière leur apparence informelle des confgurations aussi ingénieuses que poétiques ou efcaces. Dans ce contexte modulé par les contraintes de la nature et de la culture, l’originalité créative des bâtisseurs s’appuie sur les savoir-faire locaux et la tradition pour continuellement imaginer et réimaginer des solutions de design adaptées aux besoins évolutifs des Nunavimmiut.
Aux égards de l’architecture et de l’aménagement, bien peu d’informations documentent les cabanes toundriques, et ce, alors même que de nombreuses recherches collaboratives tentent de développer des milieux de vie plus signifcatifs et mieux adaptés aux besoins des communautés. Pour alimenter le dialogue au coeur de ces études et reconnaître les enseignements que portent les cabanes à la notion d’habiter le Nord, il apparait important de questionner et de rechercher ce qui les caractérise.
Suivant cette prémisse, la présente étude s’est intéressée à une centaine de cabanes regroupées en une vingtaine de campements dans la région du fjord
Annexe 1 - page 122
Eeyouistchee
Nitassinan
Annexe 1 - page 123
Umiujaq Kuujjuarapik Pessamit Uashat Mani-utenam Ekuanitshit Nutuashkuan Unamen Shipu Pakua Shipu Tshishe-shastshit Amadjuak Kimmiriut Iqaluit Kikiaq Agvituk Natuashish Nain Kangiqsualujjuaq Kuujjuaq Tasiujaq Aupaluk Kangirsuk Quaqtaq Kangiqsujuaq Salluit Ivujivik Akulivik Puvirnituq Inukjuak Essipit Mashteuiatsh Québec Montréal Matimekush-Lac John Qipuqqaq Maquuvik
Nunatsiavut Nunavik
Figure 1. Le Nunavik au nord du 55e parallèle et ses quatorze communautés (Habiter le Nord québécois 2019).
de Salluit (Nunavik). Par la déconstruction graphique de leur contexte, de leur forme, de leur orientation et de leur composition matérielle, la recherche s’est inspirée de méthodes de lecture de l’architecture au travers desquelles l’analyse des confgurations formelles et spatiales permet de relever et de caractériser les processus de formation et de transformation du bâti (Caniggia et Mafei 1979, Habraken 1988 et 1998, Brand 1994, Dipasquale et al. 2014, Magnaghi 2014, Lévesque 2019).
À la manière d’un travail d’archéologie active, les théories derrière ce type d’approche suggèrent l’existence de conditions implicites au milieu infuençant les processus qui confgurent toutes constructions. En isolant les éléments qui composent la confguration des cabanes, puis en comparant les correspondances, une part de leur histoire peut être retracée et ainsi traduire les mécanismes qui les ont mis en place. De là, la lecture des cabanes par déconstruction graphique consiste en une fragmentation méthodique et imagée des espaces comme des assemblages de matériaux dont elles sont issues.
Lors d’un terrain d’études tenu à l’été et à l’automne 2018, des entretiens avec des bâtisseurs locaux ainsi que l’observation in situ de campements et de cabanes ont permis de collecter un ensemble de notes, d’esquisses, de mesures et de photographies. Jointes à une collection d’images satellites du fjord et à quelques photos aériennes des côtes, ces données ont servi de point de départ aux diférentes analyses présentées dans cette annexe. Pour ordonner la déconstruction
graphique, quatre échelles spatiales correspondant aux quatre sections de cette annexe ont ensuite été retenues. Chacune de ces échelles est décomposée à la lumière des informations révélées par celle(s) qui la précède(ent) et la méthode développe par là l’avantage de progressivement regrouper des ensembles de caractéristiques parentes.
Une première échelle s’intéresse à l’importance des campements dans le fjord de Salluit ainsi qu’aux parcours qui lient ces derniers avec le village et l’intérieur du territoire.
Une seconde échelle s’intéresse à l’organisation des campements par un regard sur l’implantation des cabanes, sur les séquences et les relations de proximité de ces implantations, et sur les caractéristiques morphologiques des sites d’établissement.
Une troisième échelle s’intéresse à la géométrie des cabanes ainsi qu’à leur position et leur orientation par rapport au site, au fjord et au territoire.
Une quatrième échelle traite de la tectonique des cabanes, soit des matériaux et des diférentes stratégies d’assemblages, et illustre enfn les usages et les approches constructives. Cette dernière échelle suggère d’ailleurs quatre modèles typologiques retrouvés au sein des cabanes du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 124
Annexe 1 - page 125
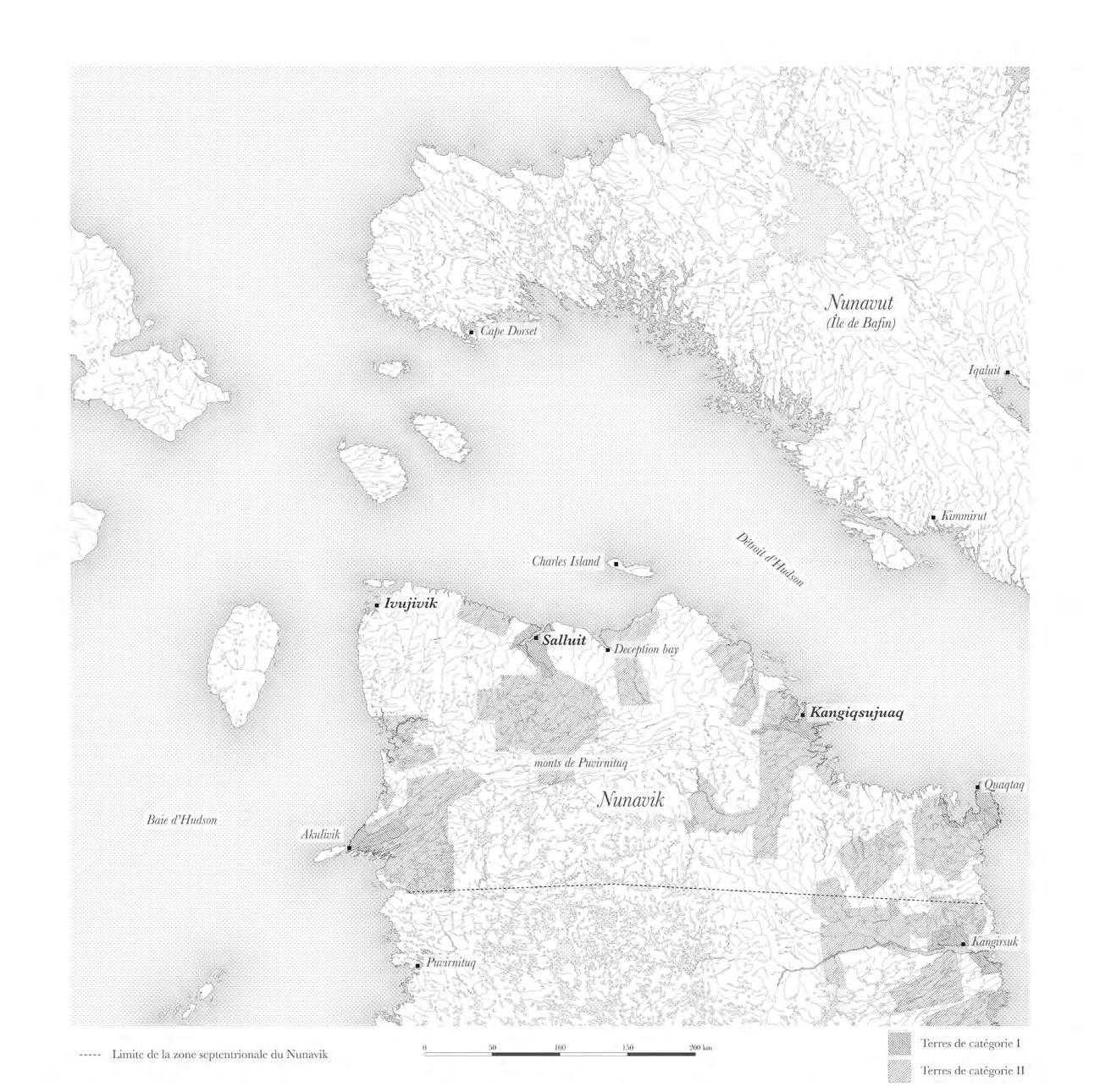 Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.
Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.

IANALYSE TERRITORIALE DU FJORD DE SALLUIT

Méthode d’analyse du fjord de Salluit
Dans le fjord de Salluit, près de cent cabanes réparties en une vingtaine de campements ont été recensées (Figure 3). Pour faciliter le référencement de chacun des campements, une grille dont les cases mesurent environ 1 km sur 1km a été superposée au territoire étudié (Figure 4).
Naturellement, les campements recensés ne comptent pas tous le même nombre de cabanes. Certains sont plus importants que d’autres et le nombre de cabanes par campement comme la position des campements dans le fjord ont défini les premiers champs d’analyse de l’échelle territoriale.
En se référant à des cartes toponymiques ainsi qu’aux informations recueillies lors des entretiens avec les autoconstructeurs locaux, quelques points d’intérêts du fjord, notamment pour la chasse, la pêche ou la cueillette, ont également pu être repérés.
En ce qui a trait aux voies de passage entre le village, les campements et le territoire, différentes possibilités de parcours aperçus sur le terrain et
discutés lors des entretiens ont pu être identifiées, puis retracées à partir d’indices transparaissant sur les images satellites du fjord (Google Earth Pro s.d., ArcGIS Online s.d., MacOs Plans s.d.). À cette échelle, la distance depuis le village, la solidité et la persistance des glaces à travers l’année, le degré des pentes et la nature des sols à franchir, la turbulence ou la profondeur des eaux du fjord, l’importance des corridors de vents et même l’étendue des ombres projetées par les montagnes sont aussi des facteurs qui ont été considérés pour estimer au mieux l’accessibilité des divers sites d’établissement.
En somme, il s’est avéré utile de croiser l’ensemble de ces observations pour dénicher la concomitance d’indices permettant d’entamer une explication de la répartition des campements. Pour ce faire, les différentes données ont été regroupées, puis analysées sur une même carte couvrant tout le territoire étudié (Figure 4).
Annexe 1 - page 128
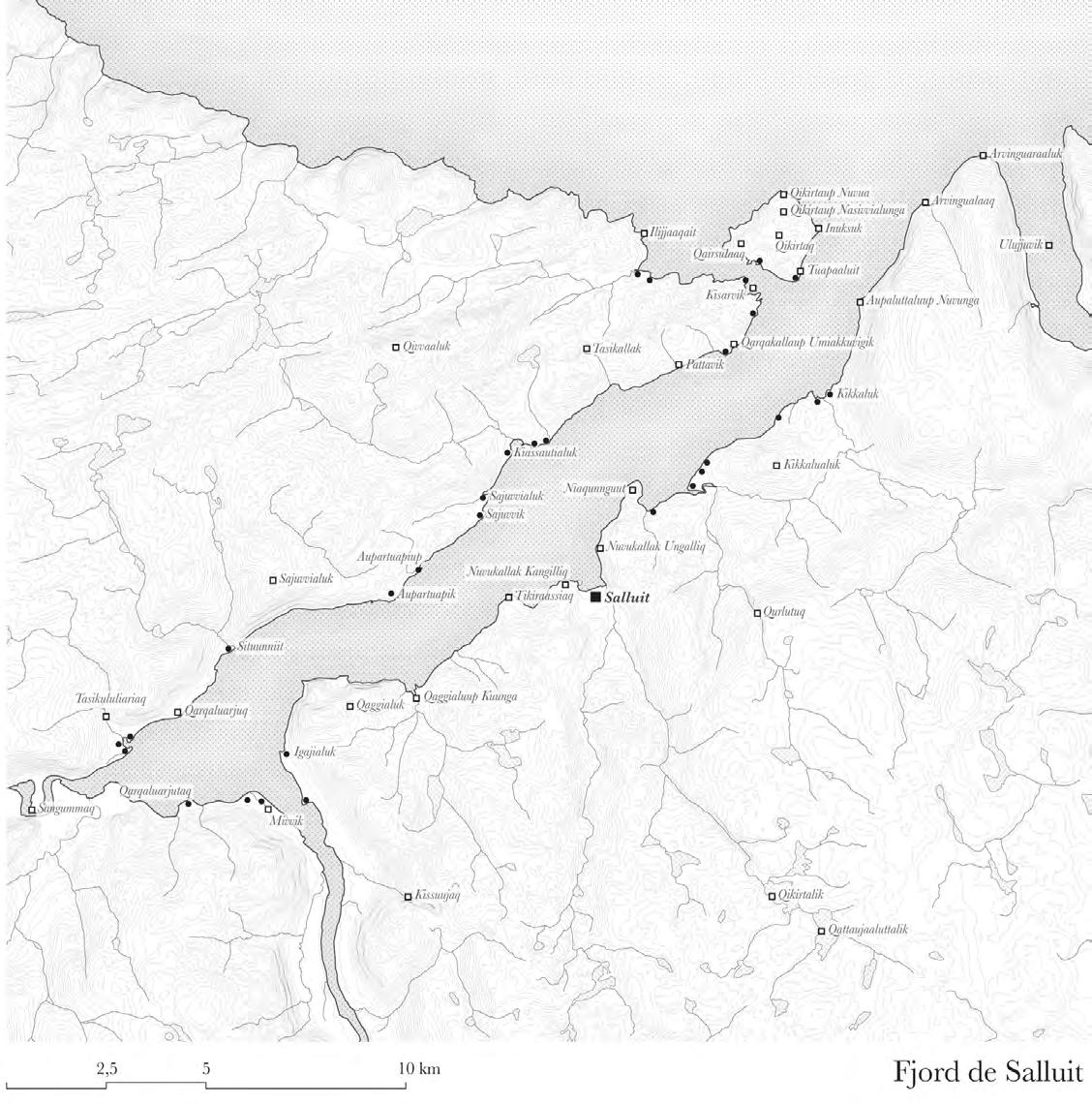
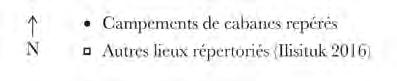 Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 129
Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 129
Parcours, zones d’implantation et emprise des campements du fjord
Le texte qui suit constitue un extrait du chapitre 6 du mémoire.
En observant la répartition des campements dans le fjord de Salluit, la rive nord opposée au village apparaît tout de suite plus occupée. Une orientation préférable des cabanes vers le soleil du sud ou une implantation au-delà d’une certaine distance de Salluit pourrait ainsi correspondre à deux critères recherchés par les autoconstructeurs (Figure 3. Campements et lieux du fjord

de Salluit). Cependant, la topographie du territoire, l’importance des campements (en fonction du nombre de cabanes qu’ils comportent) et la nature des parcours qui lient le village, les campements et l’intérieur des terres permettent de distinguer plus spécifquement quatre zones où le tracer du fjord et de ses afuents regroupe un ensemble des caractéristiques susceptibles d’avoir infuencé le développement des sites d’établissement (Figure 4. Zones d’implantation du fjord de Salluit et importance relative des campements).
Annexe 1 - page 130
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
D’abord, il semble que la présence de baies, de cours d’eau et de vallées remontant doucement vers les plateaux rocheux de l’intérieur des terres constitue l’un des principaux traits communs à la majorité des sites d’établissement. En plus d’ofrir un chemin naturel pour rejoindre le territoire, ces lieux ofrent une meilleure protection contre les vents, de l’eau douce, une plage pour accoster en sécurité et un substrat relativement stable et plat qui facilite la construction. Un chenal naturel permettant de rejoindre la rive à marée basse apparaît aussi être une caractéristique décisive dans le choix des emplacements. Par conséquent, les lieux bénéfciant de la conjoncture des caractéristiques les plus favorables sont naturellement ceux où se rassemblent le plus de cabanes. De plus, même si les campements de moindre importance se situent en des sites plus petits, plus éloignés, ou plus difcilement constructibles, leur implantation n’apparaît pas moins stratégique puisque ceux-ci entretiennent généralement un lien de proximité avec les campements importants. Enfn, c’est précisément en fonction de telles interrelations entre les sites d’établissement et le territoire que se distinguent quatre zones d’implantation :
La zone A : inclut sept campements, 39 cabanes et est caractérisée par sa proximité avec les principaux afuents du fjord, les rivières Foucault et Guichaud. Selon les Salluimmiut rencontrés, l’omble de l’Arctique est pêché dans ces rivières et les vallées qu’elles forment donnent accès à des territoires de chasse situés au sud et à l’ouest. Parmi les campements de cette zone, ceux de Qarqaluarjutuaq
(d18) 1 et de Sittuuniit (e15) sont plus importants et comportent chacun 10 et 13 cabanes. Les deux campements bénéfcient d’un large horizon sur le fjord, d’un accès en eau profonde et se situent en un point de pivotement entre l’embouchure des rivières et les cinq autres campements environnants.
La zone B : inclut sept campements, 40 cabanes et est caractérisée à la fois par sa position centrale dans le fjord et par son rapport privilégié avec le nord du territoire depuis les nombreux cours d’eau qui la traversent. Les campements qui s’y trouvent sont parmi les plus près du village et, mis à part Sittuuniit qui est difcilement accessible par voie terrestre, ceux-ci sont reliés entre eux par des sentiers. Situé en face du village de Salluit, le campement le plus important est celui de Kiassautialuk (k10 – k11) avec 19 cabanes.
La zone C : inclut neuf campements, 29 cabanes et est caractérisée par sa position englobant l’entrée du fjord. Depuis les campements de cette zone, les rives du détroit d’Hudson et des fjords avoisinants sont plus facilement accessibles, tandis que les vallées et les cours d’eau qui s’y trouvent ofrent des accès aux portions nord et sud du territoire. Totalisant huit cabanes, le campement le plus important de cette zone est celui de Kikkaluk (q9 – q10). Avec Qikkigiaq
Annexe 1 - page 131
1. Chaque campement se repère sur la carte de la fgure 3 en y associant la case de localisation correspondante. (lettre = colonne / numéro = ligne)
(p10), il s’agit d’un des rares campements accessibles par voie terrestre depuis le village.
La zone D : inclut 13 cabanes, six campements et est caractérisée à la fois par sa proximité au village et par le chemin terrestre qui la traverse. Mis à part Kikkaluk, les campements de cette zone comportent tous une seule cabane et regroupent ainsi un minimum de caractéristiques favorables à l’implantation des campements plus importants.
En résumé, les constats à l’échelle du territoire indiquent que les cabanes du fjord de Salluit semblent s’implanter en des zones et en des sites favorisant une certaine perméabilité des parcours entre les divers attraits du territoire et le village. À partir d’ici, précisions les critères d’implantation des campements et défnissons-les localement afn de comprendre, sur une base multifactorielle, comment ces campements tendent à être confgurés.
Annexe 1 - page 132
Annexe
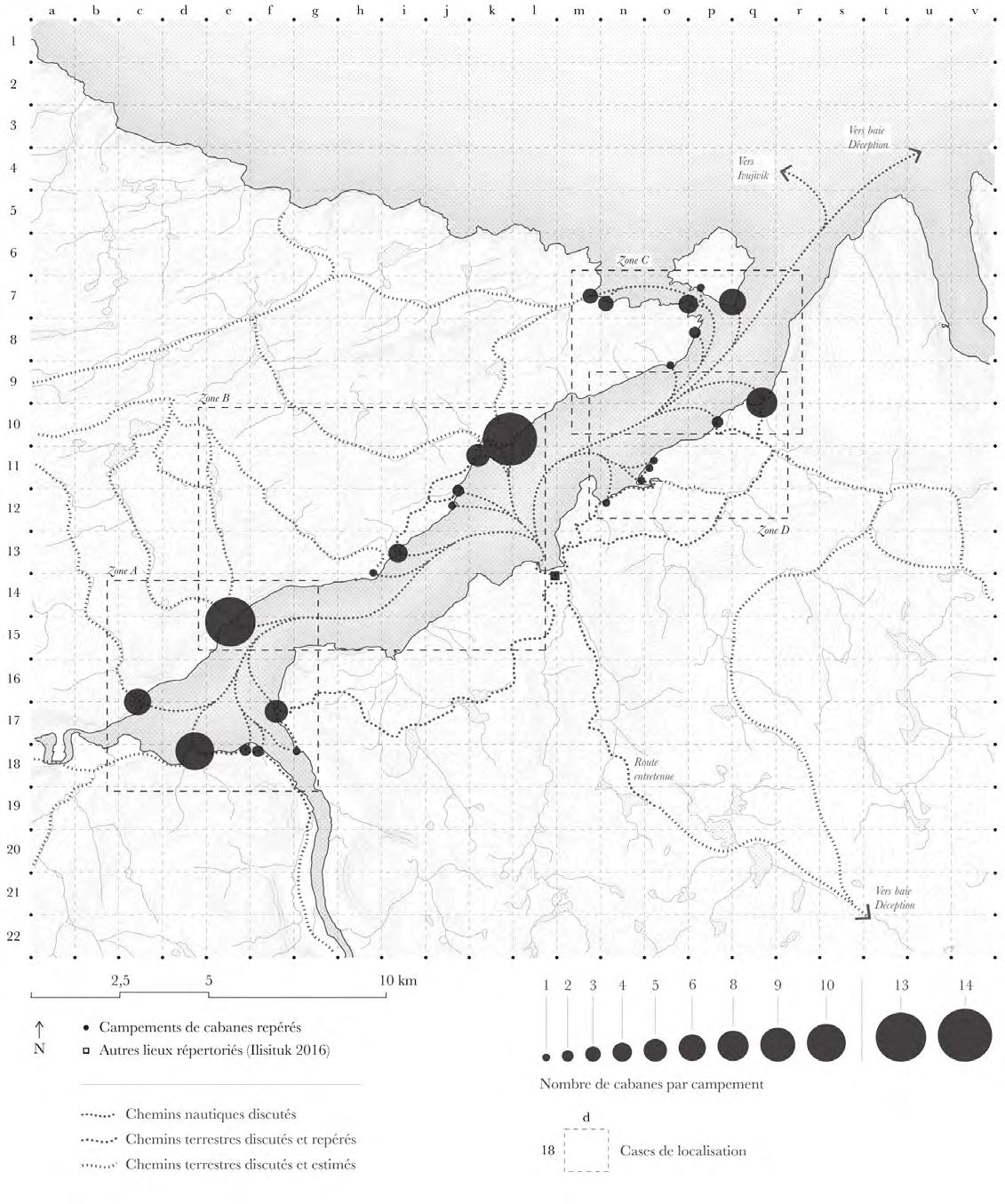 Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.
1 - page 133
Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.
1 - page 133

II
ANALYSE DE LA CONFIGURATION DES CAMPEMENTS

Méthode d’analyse des campements
Pour étudier les caractéristiques de l’environnement immédiat des cabanes et en venir à proposer une meilleure compréhension des facteurs qui régulent leur implantation, la recherche s’est intéressée à un ensemble de variables perceptibles à l’échelle des campements.
Dans un premier temps, des séries de cartes couvrant une superfcie d’environ 1 km2 et présentant chacun des vingt campements ont été dessinées (Figure 5). Chaque cabane observée a pu y être numérotée pour fn de référence et, tandis que les cabanes présentes au moment du terrain d’études (construites avant 2018) ont obtenu un numéro standard (1, 2, 3, etc.), les cabanes repérées ultérieurement par images satellites ont obtenu une nomenclature distincte (N-1, N-2, N-3, etc.).
Ensuite, en se référant aux informations collectées lors des entretiens avec les bâtisseurs locaux, une liste de critères préférentiels dans le choix d’un bon site de campement a ensuite été établie. Sans se prétendre exhaustive, et sans présumer un ordre d’importance, cet exercice a permis la distinction de huit critères :
a) Le rapport à un site traditionnel ou à un lieu dont la fréquentation ancienne suggère une importance particulière ;
b) La présence d’un élément distinctif dans le paysage permettant de reconnaître la position du campement ;
c) La présence d’un palier d’observation naturel ofrant des vues plongeantes sur le fjord, sur les activités qui s’y déroulent et sur les animaux qui y transitent ;
d) Un accès facilité à marée basse par la présence d’un chenal profond ou d’une batture limitée en longueur et en obstacles ;
e) La présence d’une protection naturelle des vents dominants ;
f) L’appui sur un sol relativement stable, plat et bien drainé par la présence d’afeurement rocheux ou de minces dépôts graveleux ou sableux ;
g) L’accès à une source d’eau douce potable ;
h) La présence d’une plage facilitant les accostages ou l’acheminement des matériaux.
La reconnaissance de ces critères autour des campements s’est efectuée en inscrivant des marques sur les cartes aux divers endroits où il est possible de les retrouver. Pour ce faire, une observation attentive de la topographie, des photographies de terrain, des images satellites ainsi que des données de catégorisation des dépôts de surface a été nécessaire.
Parallèlement et sur une période d’environ vingt ans, la morphogénèse des cabanes de chaque campement a été estimée à partir d’images satellites prises à diférents moments. Cela a permis d’estimer quelques tendances dans l’évolution du bâti, puis d’explorer les corrélations possibles entre l’âge des cabanes et la mise en oeuvre de confgurations caractéristiques de campements plus récents et plus anciens. Enfn, la distance relative entre chaque cabane a été analysée par une série de halos circulaires (rayons de 10 à 40 mètres). En les superposant, l’opacité de ces halos s’intensife et permet de comparer la géométrie globale des campements. L’orientation générale des cabanes a simultanément été comparée par la réinterprétation de deux traits servant à exprimer le sens du faîte principal et l’orientation de l’aire d’activité extérieure (espace extérieur où se rassemble le plus de matériel et qui est vraisemblablement le plus habité en dehors de la cabane).
Les pages suivantes illustrent ces analyses et résument les constats ayant servi aux analyses présentées dans le mémoire.
Annexe 1 - page 136
Annexe 1 - page 137

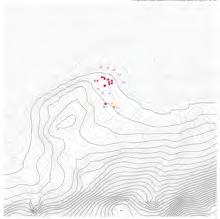
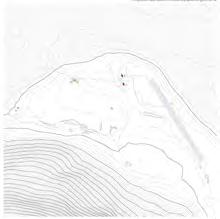

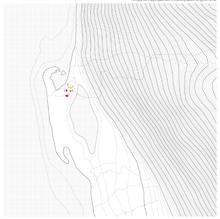

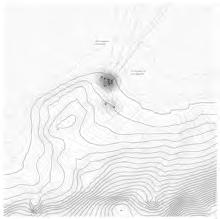


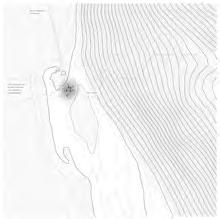



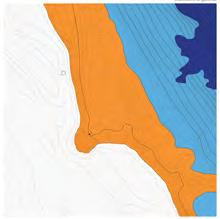

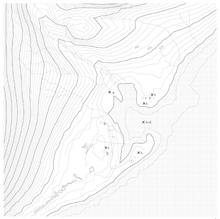
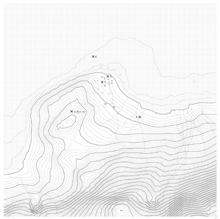


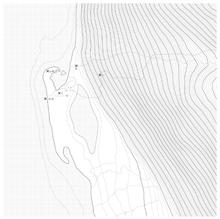
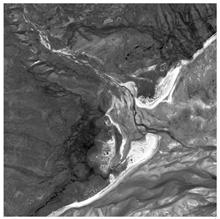

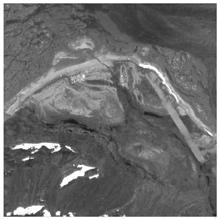
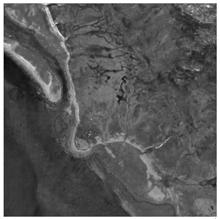

satellite [...] [...] [...] [...] [...]
préférentiels Dépôts de surface
relatives Morphogénèse
Image
Critères
Distances
Figure 5. Exemples de quelques séries d’analyses apportées à chacun des campements recensés dans le fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 138
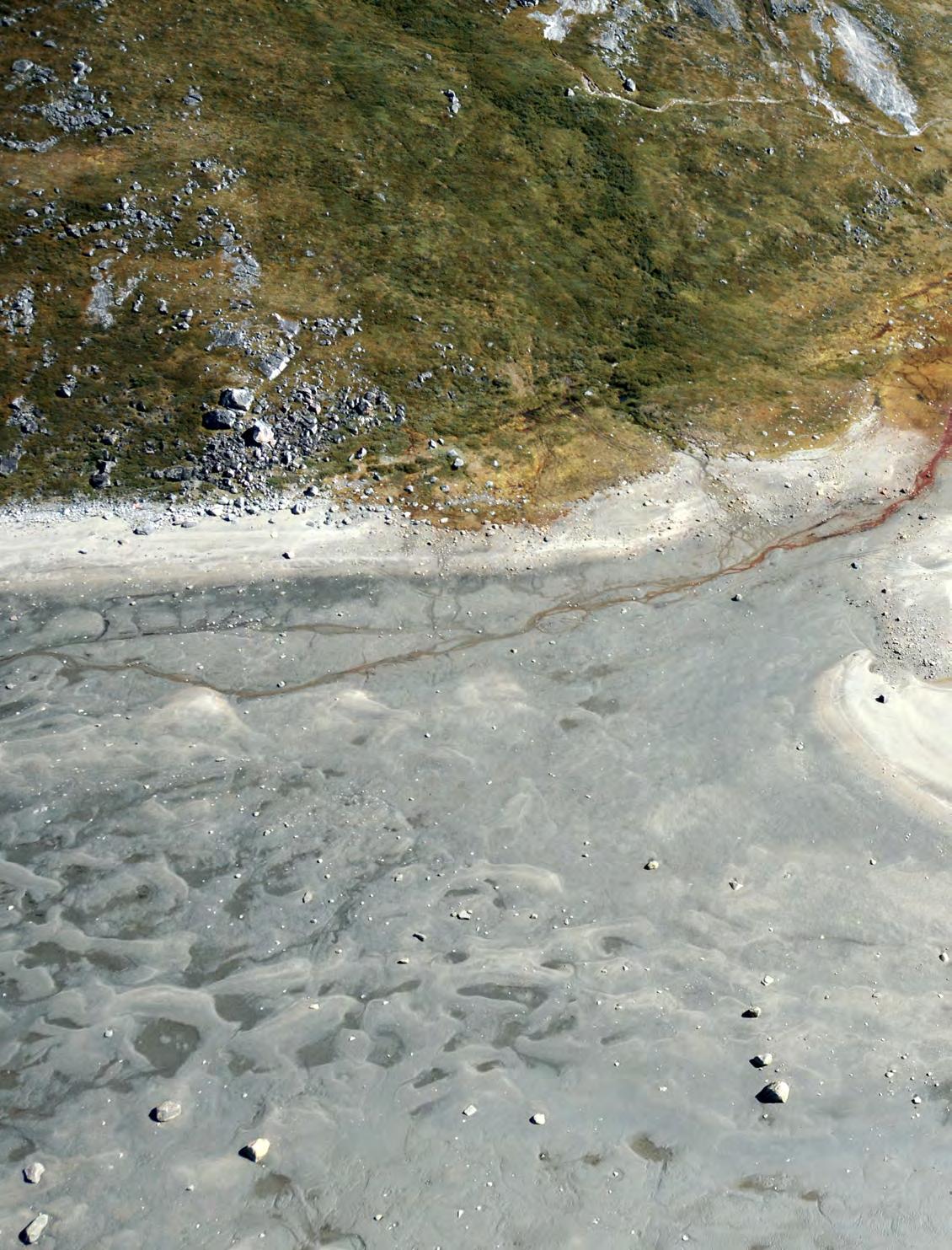 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Igajialuk (1/2) - f17
Le campement d’Igajialuk comporte cinq cabanes de dimensions variables, regroupées en une forme oblongue qui suit sommairement la côte. En se trouvant à l’embouchure de la rivière Foucault (sur sa rive nord-est), le site comporte un sol sablonneux et plat. Vers le fjord, une large batture s’étend, tandis qu’à l’opposé, les berges de la rivière se déploient en de longs contreforts où s’appuient les premières collines de la vallée Narsajuaq.
Lorsque le fjord n’est pas gelé, l’approche du campement est facilitée par un chenal tracé par la rivière. Un sentier abrupt qui passe à travers les collines et qui rejoint les lacs Tasiruluuk ainsi que la route de l’aéroport de Salluit est également accessible à l’est

du campement. Les collines qui bordent le site ofrent une certaine protection des vents en provenance du nord. En contrepartie, aucun obstacle ne freine les vents dominants du sud-ouest ou du sud-est provenant de la vallée. Autrement, l’ensemble des autres critères préférentiels dans le choix d’un campement semblent se retrouver à Igajialuk.
Selon la morphogénèse du campement et la nature des matériaux employés, les cabanes semblent avoir été bâties avant 2002 (3/5) ou peu après (2/5). Les diférentes orientations des faîtes correspondent à ces phases d’édifcations et pointent (dans les trois premiers cas) le fjord et l’axe de la vallée, puis (dans les deux autres cas) la rive opposée de la rivière.
Annexe 1 - page 139
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 140
1. Image satellite du campement
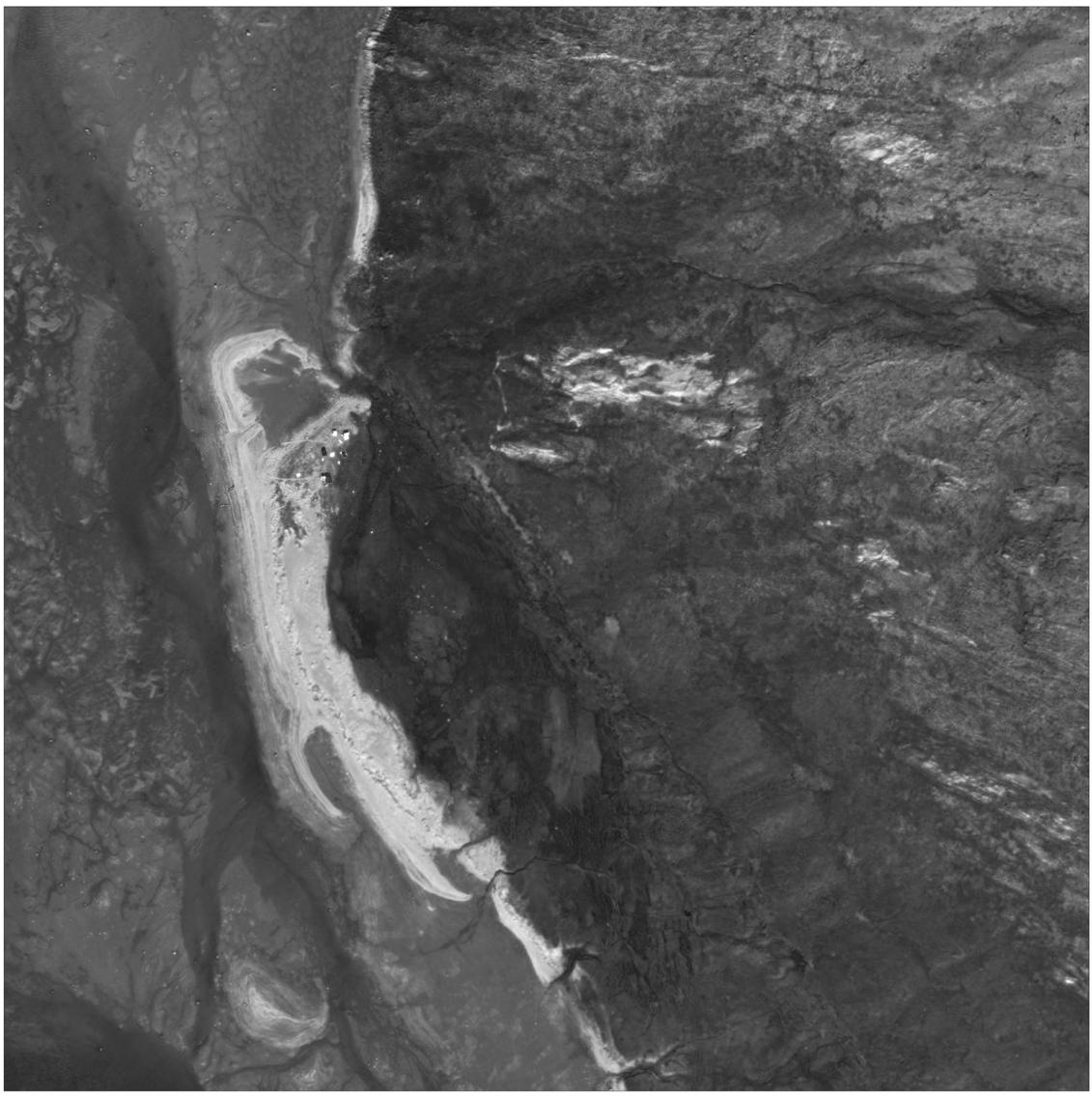
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 141



Cours d’eau
2.
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires





Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 142
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



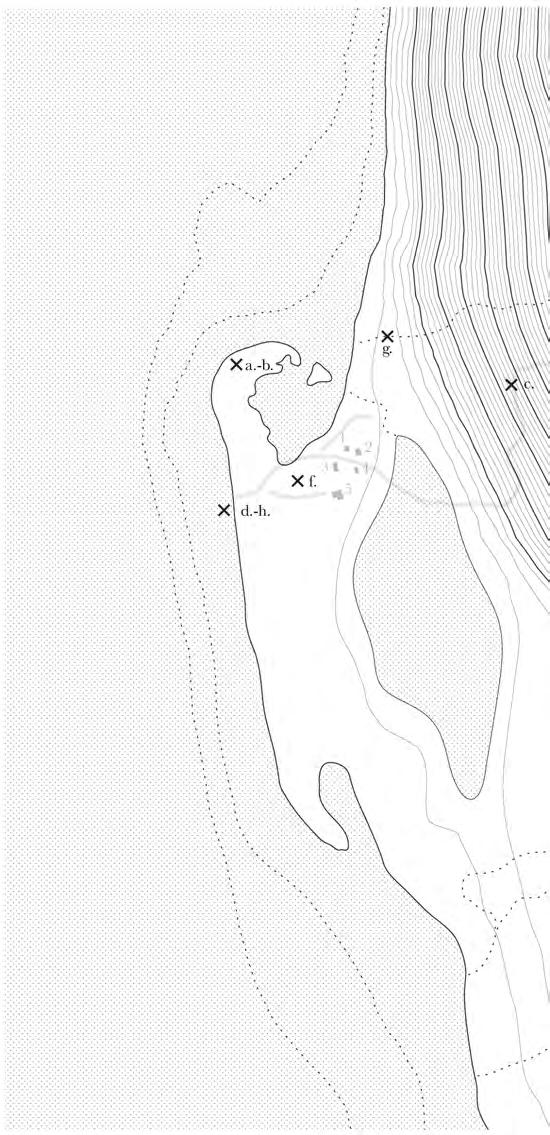
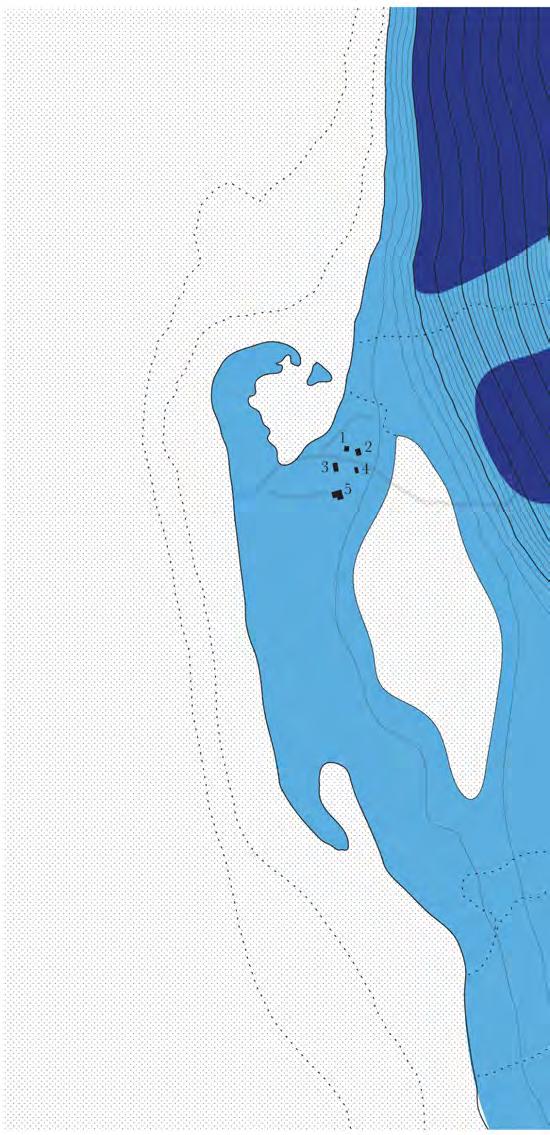
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4. 3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative

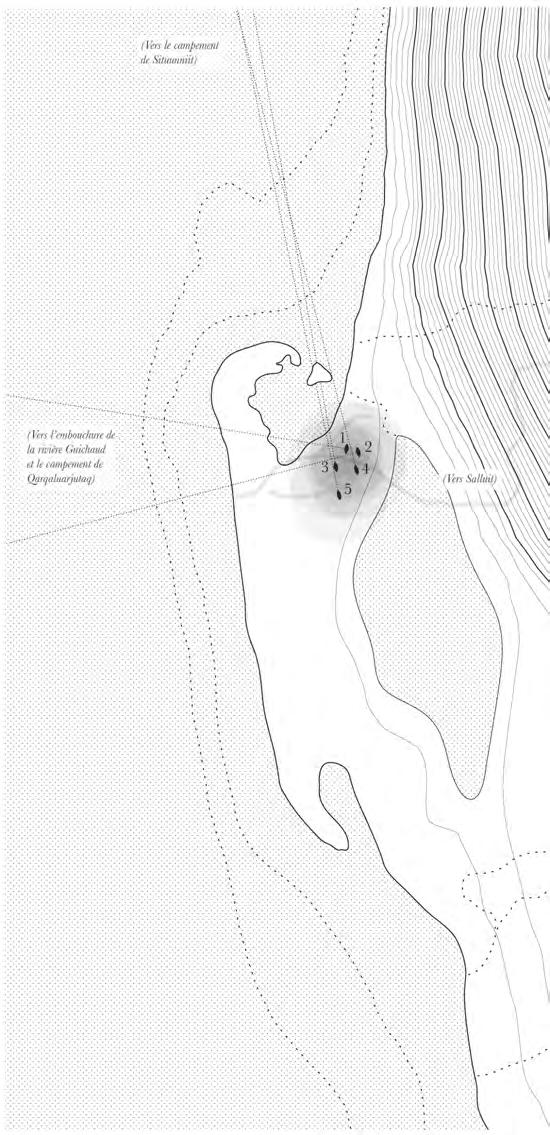
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 143
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 144

Demeule, août 2018
Igajialuk (2/2) - g18
En remontant légèrement le cours de la rivière Foucault, un autre campement se déploie sur une pointe située à l’extrémité sud de la plaine d’Igajialuk. Ce campement plus restreint en superfcie et composé d’une seule cabane de grosseur moyenne (voir chapitre 6 - analyse de la volumétrie des cabanes) occupe un site surélevé à quelques mètres au-dessus des eaux.

Les images satellites situent la construction de cette cabane entre 2003 et 2015. Toutefois, et bien qu’elle partage une même période d’édifcation que certaines autres cabanes d’Igajialuk, la nature plus récente et uniforme de ses matériaux laisse croire qu’elle est issue d’une époque postérieure, ou d’une mise en oeuvre plus fortunée. Le type sol et la présence d’éléments grossiers
comme des pierres et du gravier indiquent quant à eux un substrat plus stable que celui retrouvé plus bas.
En ce qui concerne l’infuence des vents dominants, il semble logique de croire que ceux-ci sont localement déviés par l’axe de la vallée. En ce sens, si la cabane adopte un alignement conséquent (son côté court étant minimalement exposé aux vents), la présence d’un button tout juste au sud-ouest du site ofre une protection non négligeable. Ce button forme un point d’observation intéressant, tandis que la présence d’une plage en contrebas suggère que la cabane a peutêtre été tractée sur la glace avant d’être hissée à son emplacement actuel. En somme, la plupart des critères préférentiels semblent se retrouver sur le site.
Annexe 1 - page 145
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 146
1. Image satellite du campement
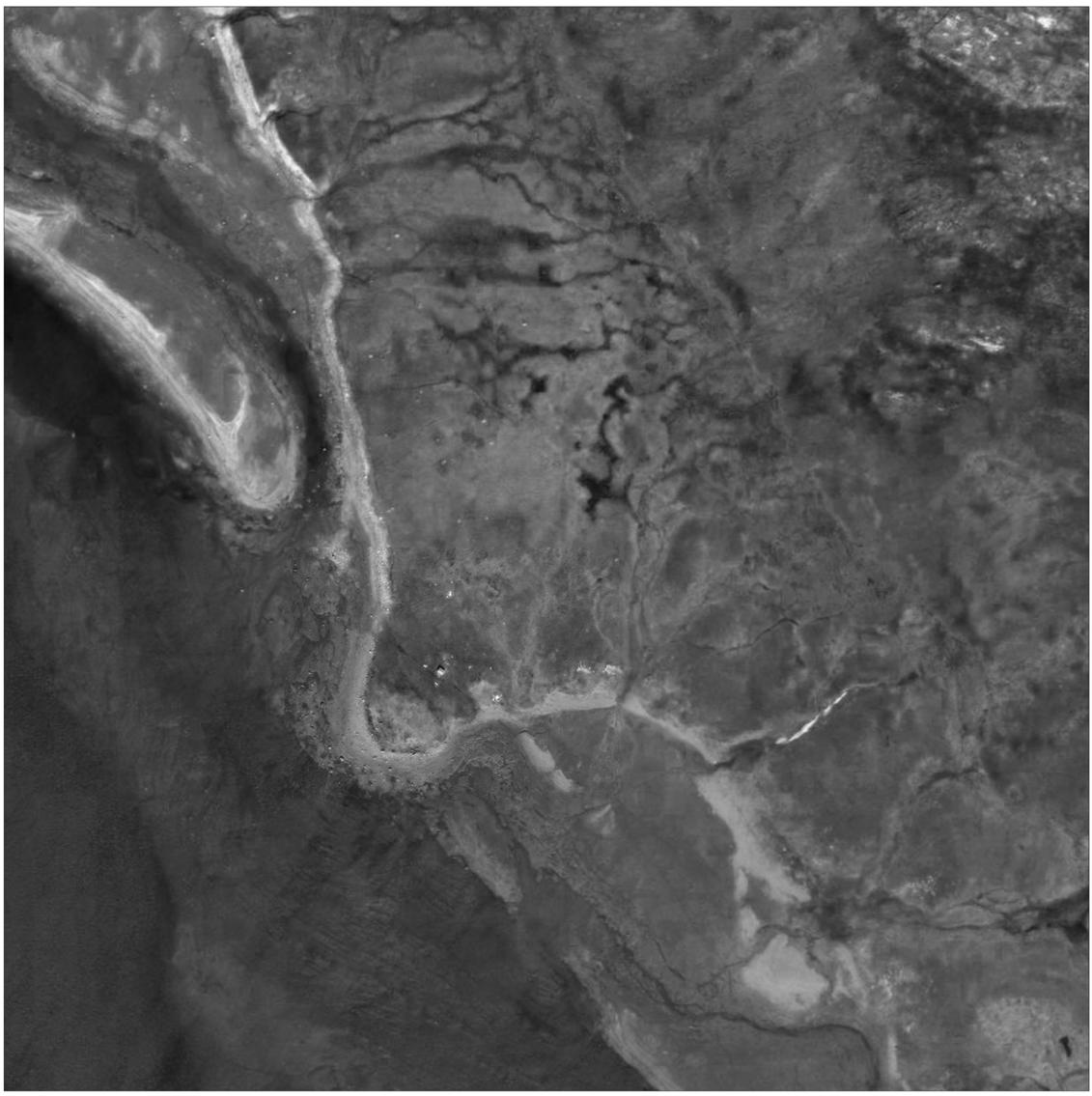
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 147


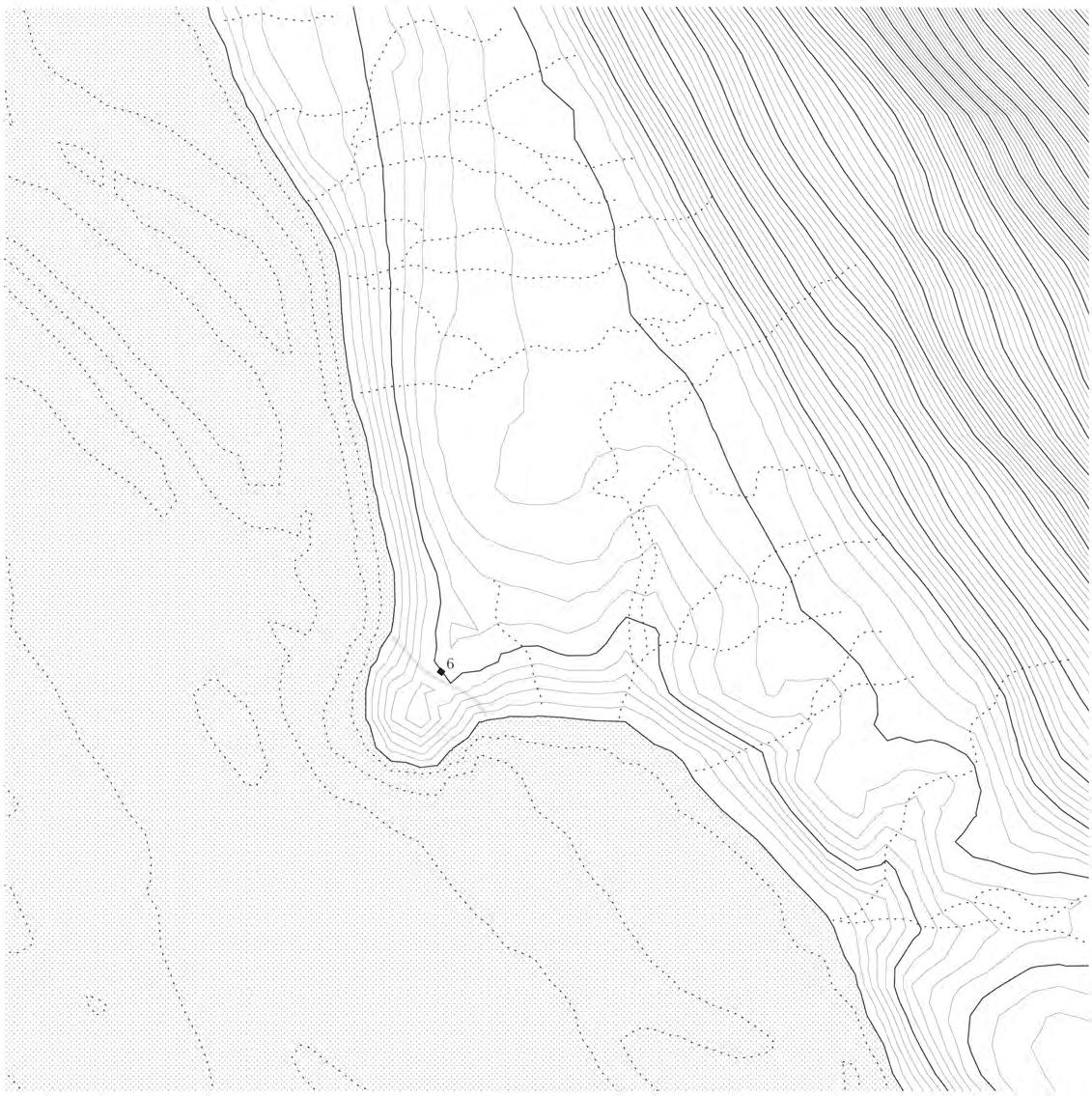 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 148
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



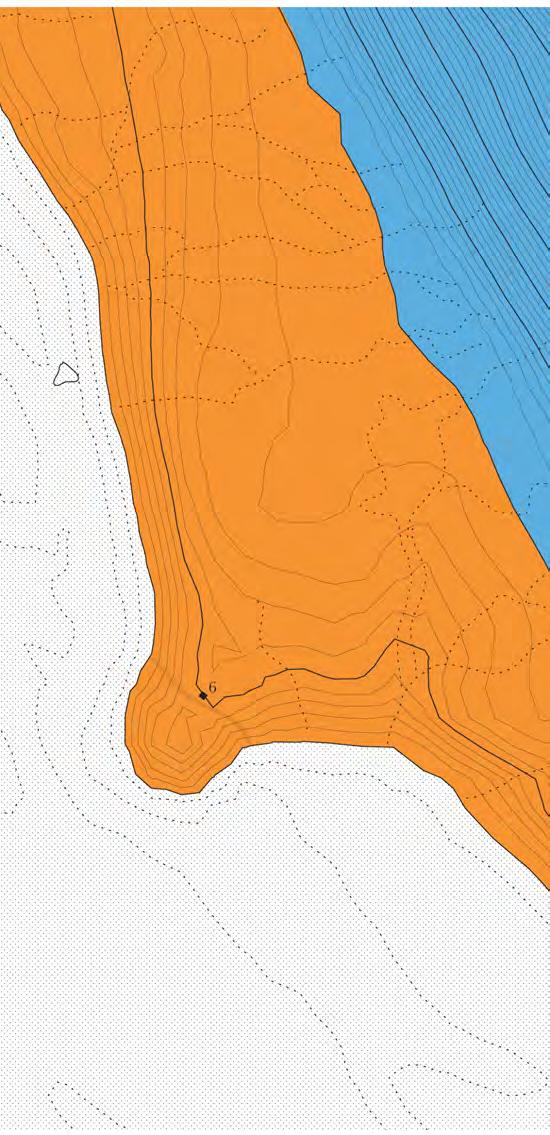
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
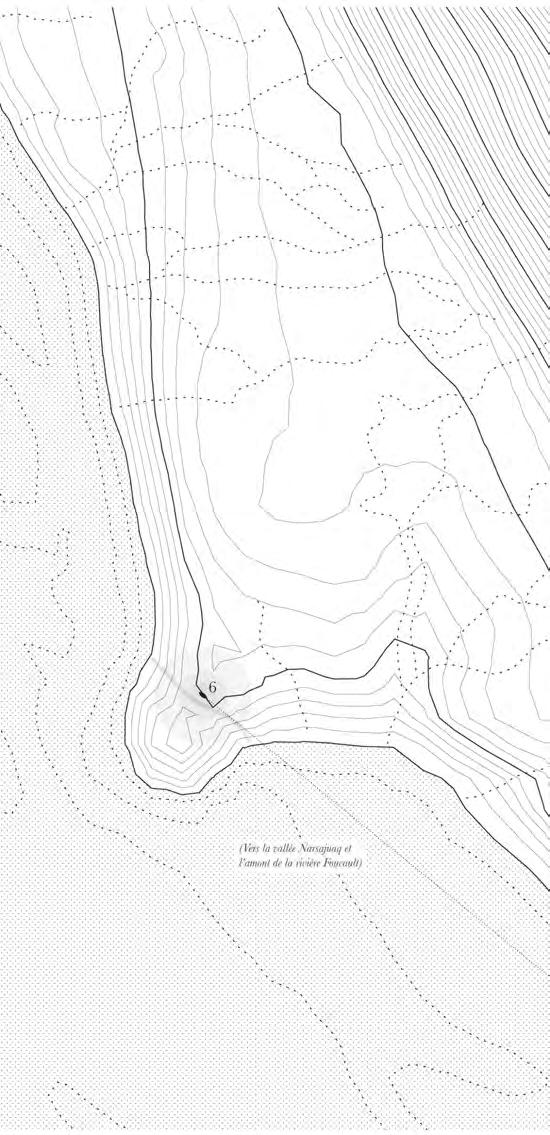

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 149
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 150

2018
Demeule, août
Mivvik - e18 - f18
Le campement de Mivvik compte quatre cabanes de petites dimensions déposées sur un sol plat mélangé de gravier et de sable. Une ancienne piste d’atterrissage est perceptible à l’est du campement, alors qu’en face, soit de l’autre côté de la rivière Foucault, il est possible d’apercevoir les campements d’Igajialuk. Du côté sud de la rivière, les berges se prolongent là encore sous la forme d’un long plateau qu’il est possible de suivre vers l’intérieur du territoire en remontant le sens du courant.
Épargnée des vents dominants du sud-ouest par des montagnes, la position du campement ofre une certaine protection. Cependant, le milieu ouvert qui caractérise le site n’ofre pas d’abri face aux vents provenant du
sud-est et l’orientation des cabanes parallèle à l’axe de la vallée Narsajuaq semble réféchie en conséquence.

Les implantations distendues des cabanes permettent de distinguer deux regroupements dont les accès s’efectuent depuis une longue batture située au nord. Les diférentes caractéristiques préférentielles reconnaissables au site de Mivvik apparaissent éparpillées et par le fait même moins avantageuses (a.b.-d.-e.-f.-g.-h.). Les deux regroupements semblent enfn correspondre à des phases d’édifcation diférentes, l’une plus ancienne (avant 2002 ou peu après) et l’autre toute récente (avec l’apparition entre 2017 et 2018 d’une nouvelle cabane très diférente et dont le faîte est placé dans le sens opposé à celui des autres cabanes).
Annexe 1 - page 151
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 152
1. Image satellite du campement
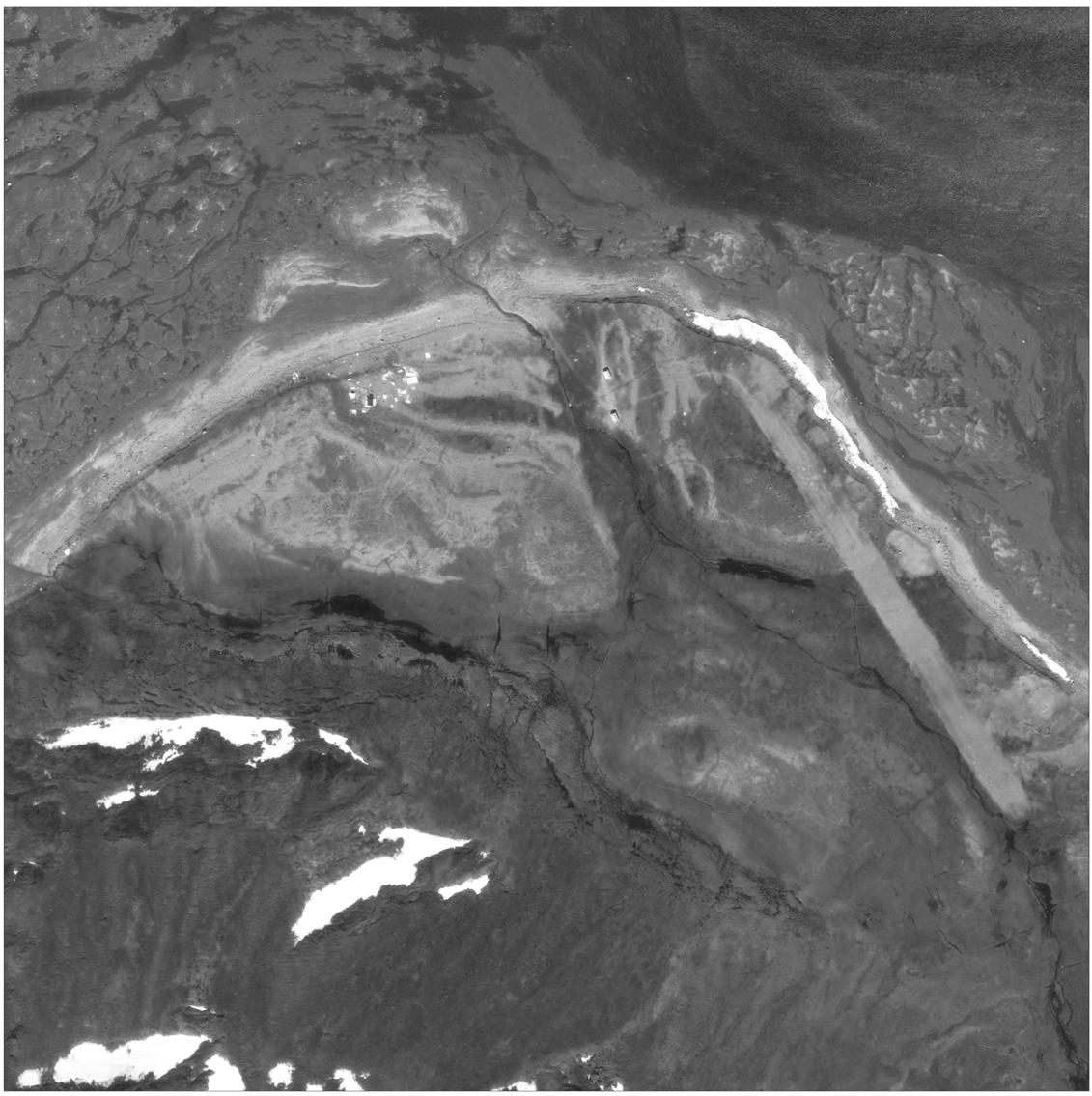
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 153


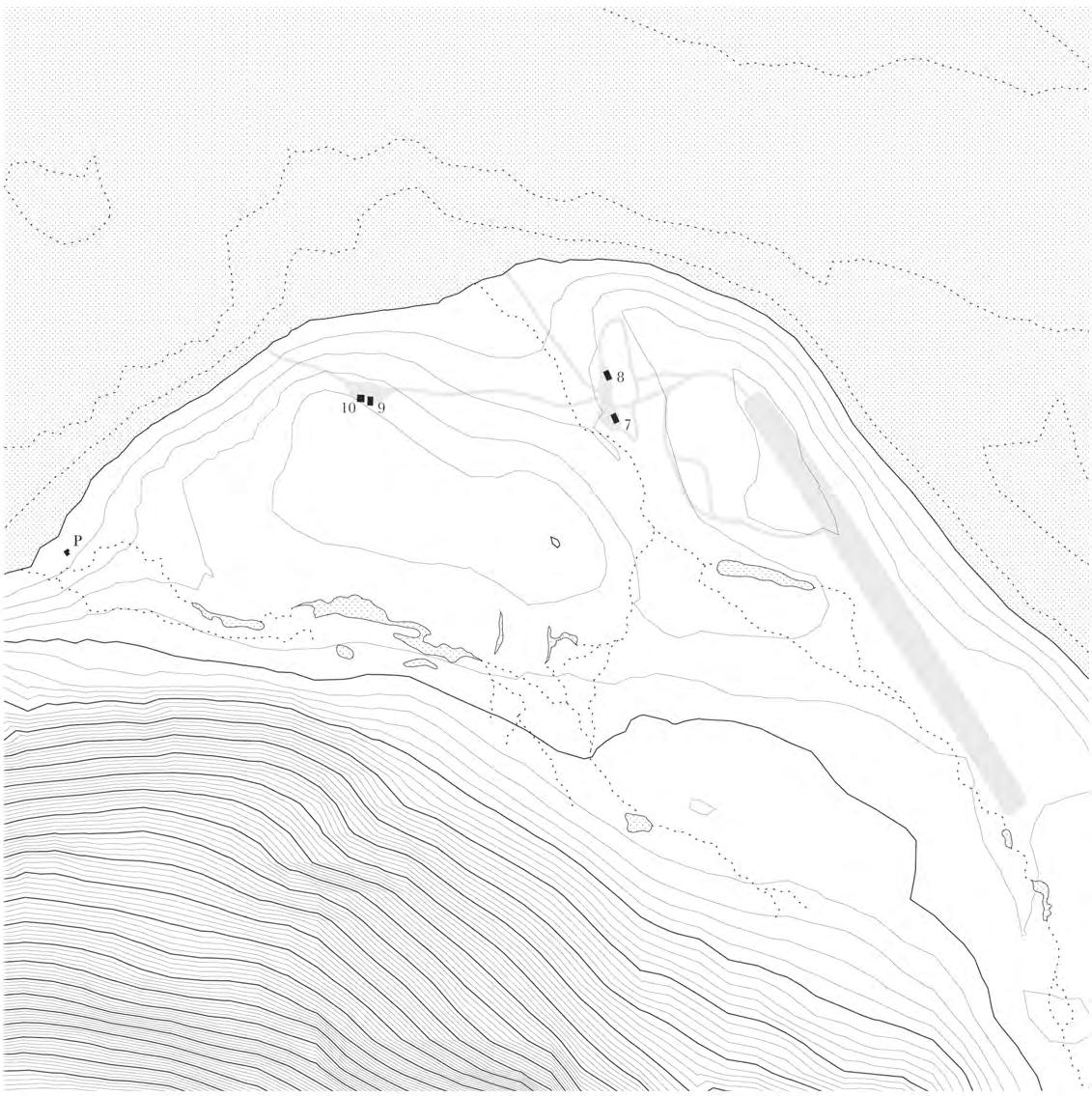
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 154
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



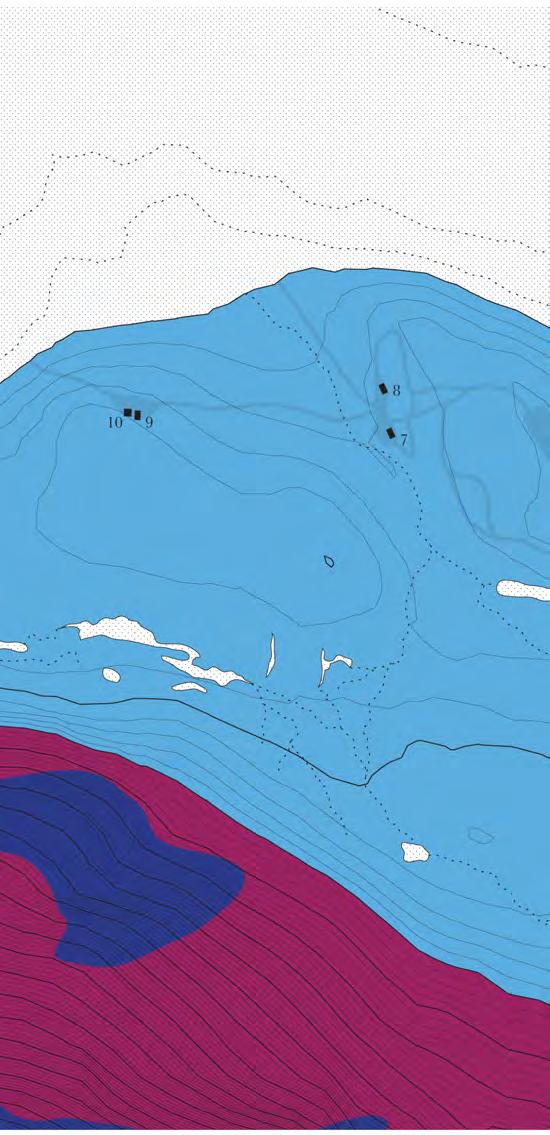
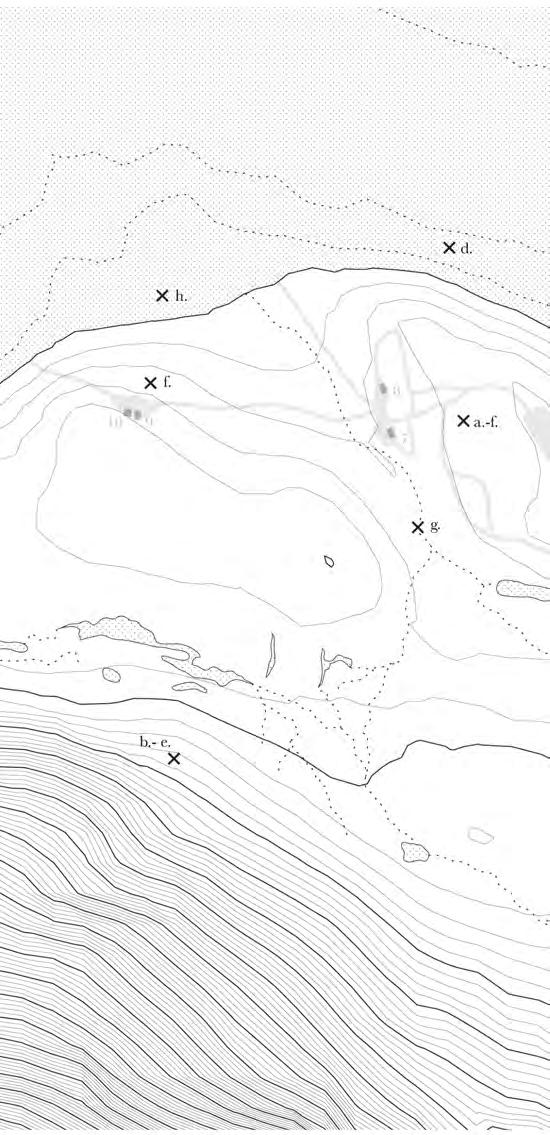
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
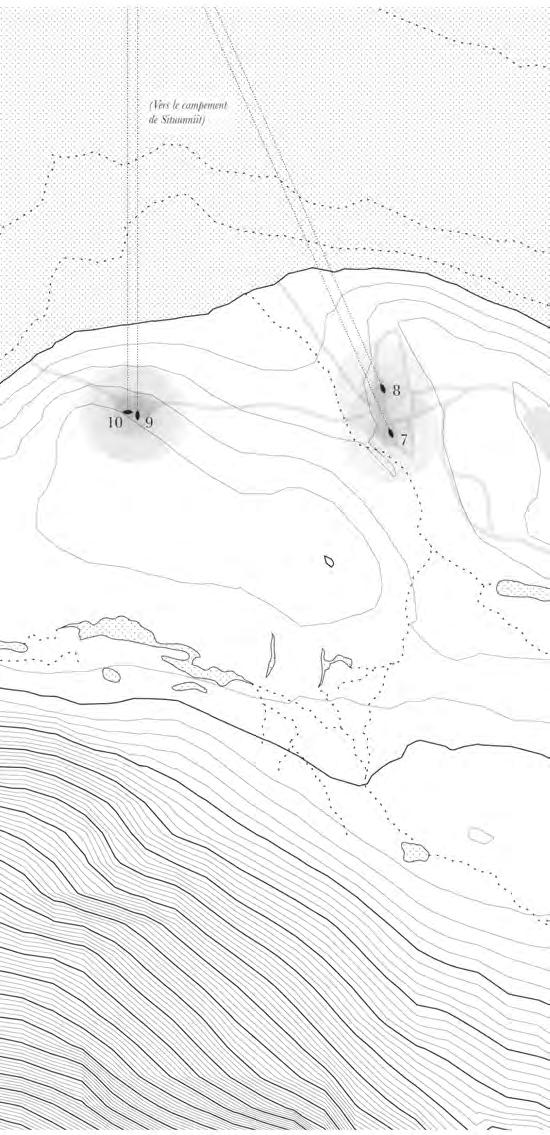
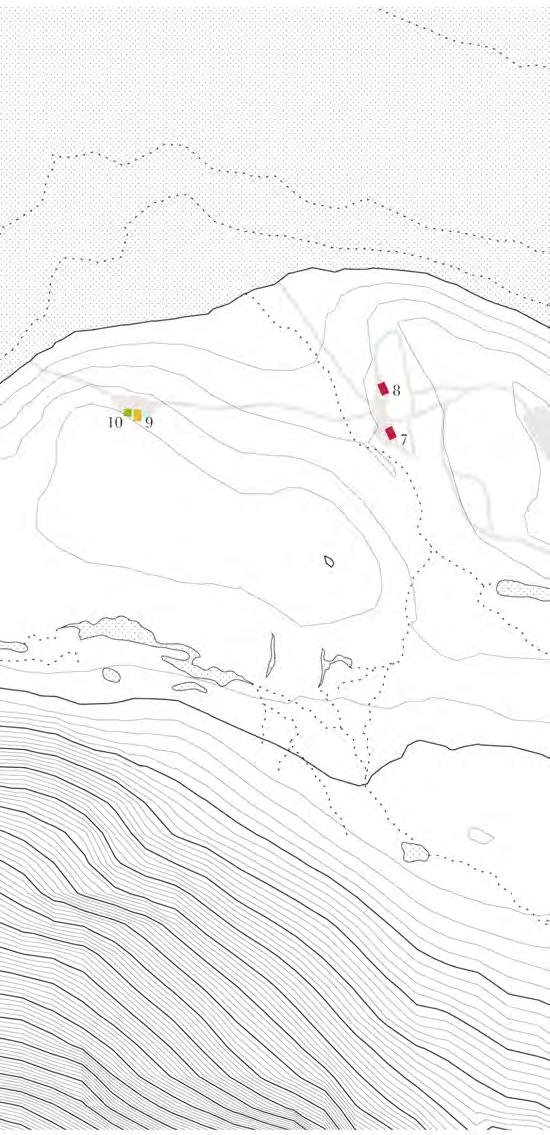
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 155
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 156

2018
Demeule, août
Qarqaluarjutuaq - d18
Le campement de Qarqaluarjutuaq compte dix cabanes et se situe à l’extrémité sud du fjord de Salluit. C’est à cet endroit que les rivières Foucault et Guichaud « se rencontrent ». La majorité des cabanes y sont petites et densément implantées sur une plage de gravier. Deux cabanes plus récentes et plus imposantes font exception puisqu’elles se retrouvent en des emplacements plus reculées dans la baie. L’une d’elles a d’ailleurs été construite après les relevés de terrain de 2018 et a été repérée sur les plus récentes photos satellites (N-1).

Selon les plus anciennes photos satellites disponibles, l’apparition des huit cabanes positionnées les plus près de l’eau remonte à l’an 2002 au plus tard. De façon générale, ces cabanes ont visiblement subi l’épreuve
du temps et si leurs matériaux semblent abimés, la confguration de ceux-ci expose également les traces de nombreuses transformations. Ici encore, l’orientation du faîte difère entre les cabanes anciennes et récentes : les premières étant dirigées vers le fjord et les dernières étant dirigées de façon parallèle à la rive.
Derrière le campement, une colline au roc afeurant ofre un large panorama des environs. Cette colline et la montagne à laquelle elle est rattachée protègent aussi le campement des vents dominants. Enfn, si l’ensemble des caractéristiques préférentielles semblent se retrouver à Qarqaluarjutuaq, l’importance des sources d’eau douce identifées près du site apparaît néanmoins minimale compte tenu du nombre de cabanes qui s’y trouvent.
Annexe 1 - page 157
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 158
1. Image satellite du campement
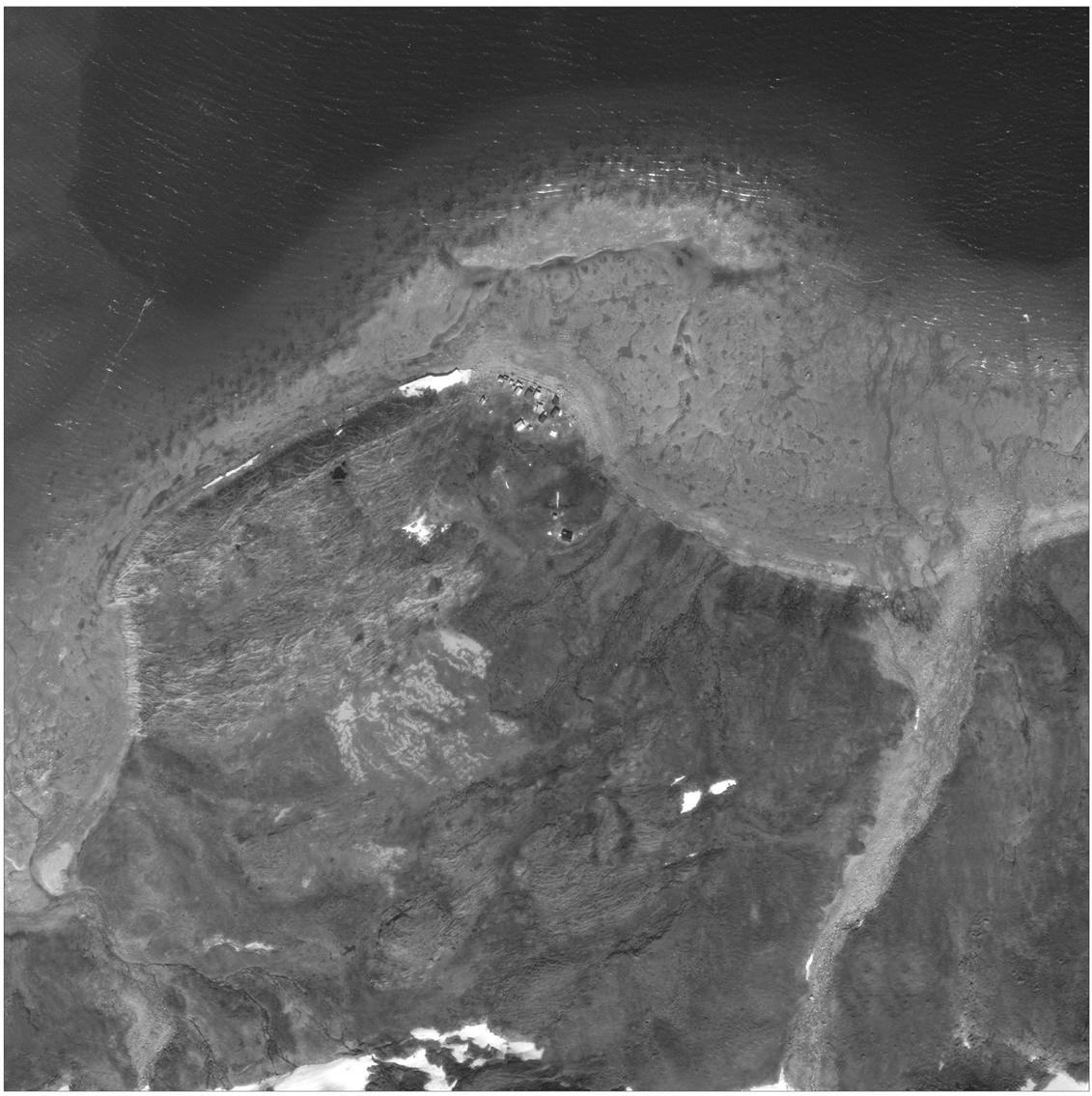
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 159


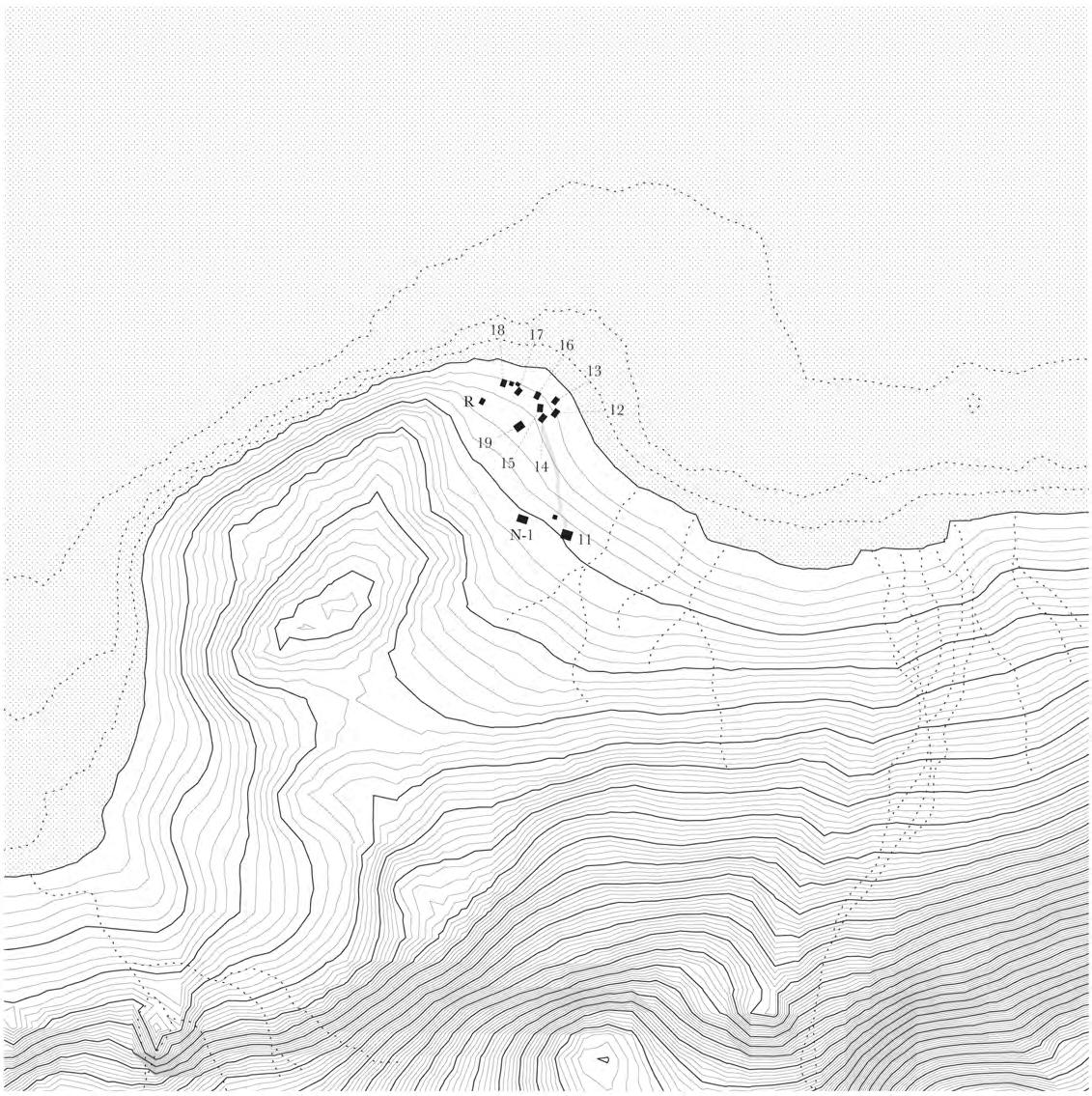 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 160
Dépôts de surface

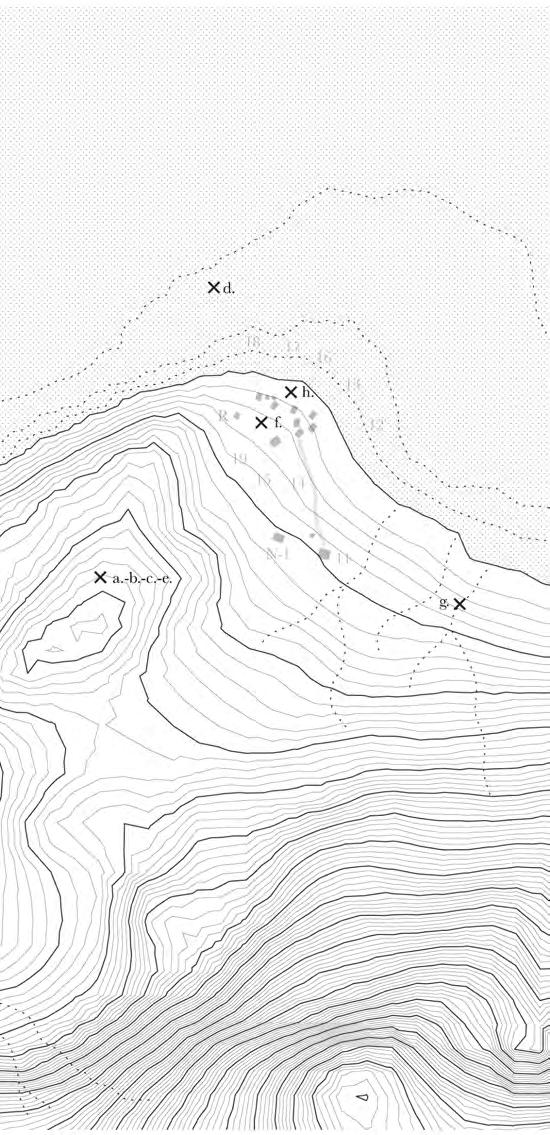
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



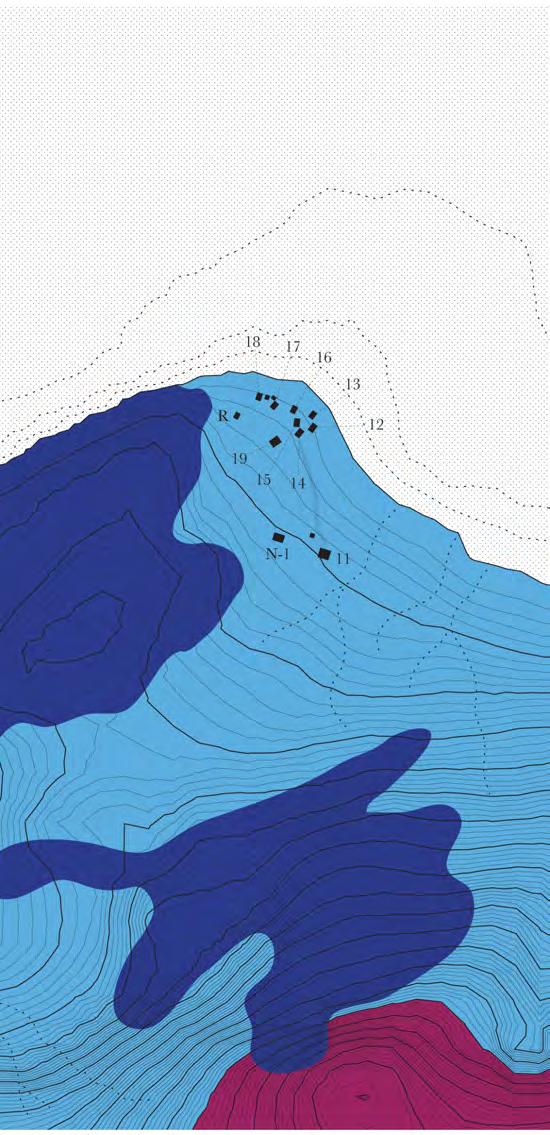
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
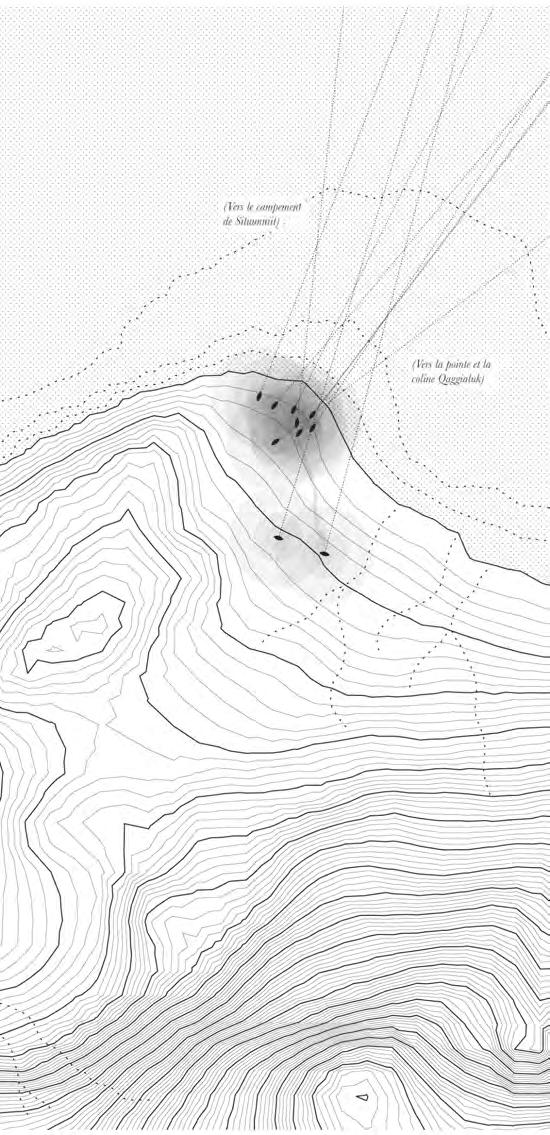
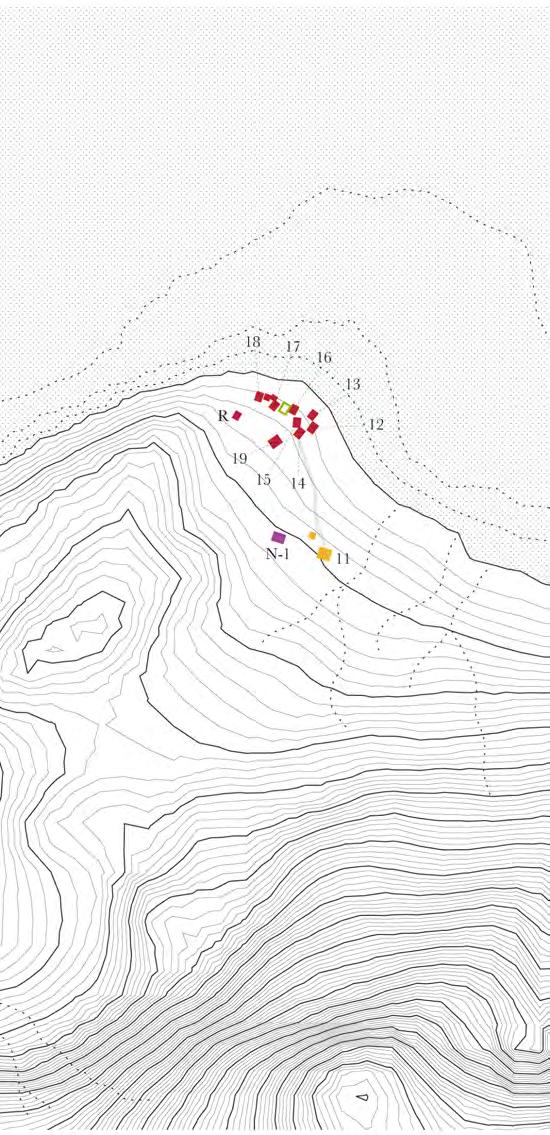
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 161
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 162
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Ruisseau Tasikululiariaq - c16-17
Le campement Tasikululiariaq situé à l’embouchure du ruisseau du même nom compte six cabanes de dimensions moyennes à grandes. Elles sont construites à environ cent mètres les unes des autres, et à même une langue de sable où une grande batture rythme l’accès du campement au gré des marées.

Située à la rencontre de deux vallées, soit celle de la rivière Guichaud et celle du ruisseau Tasikululiariaq, la position de ce campement permet de facilement rejoindre l’ouest ou le nord du territoire. Dans son ensemble, le campement ne regroupe pas tous les critères préférentiels, mais ceux qu’il présente sont du moins complémentaires et franchement perceptibles (b.-d.-f.-g.-h.). Parallèlement, et outre la présence de montagnes vers l’ouest et vers le sud, le site ne semble
pas bénéfcier de protection particulière face aux vents. Selon l’orientation des cabanes, il pourrait d’ailleurs être logique de supposer que les vents les plus importants du secteur proviennent de la vallée creusée par le ruisseau. Toutefois, cette orientation s’avère aussi favorable à une plus large observation du fjord depuis l’intérieur des cabanes et il peut donc être supposé que ce facteur ait pu infuencer leur orientation également.
Enfn, l’apparition des cabanes sur ce site serait survenue relativement rapidement, soit entre 2003 et 2015 selon l’étude de la morphogénèse. Depuis cette période, peu d’indices laissent croire que les constructions de Tasikululiariaq ont subi des transformations importantes ou que d’autres cabanes se sont ajoutées dans les environs du campement.
Annexe 1 - page 163
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 164
1. Image satellite du campement
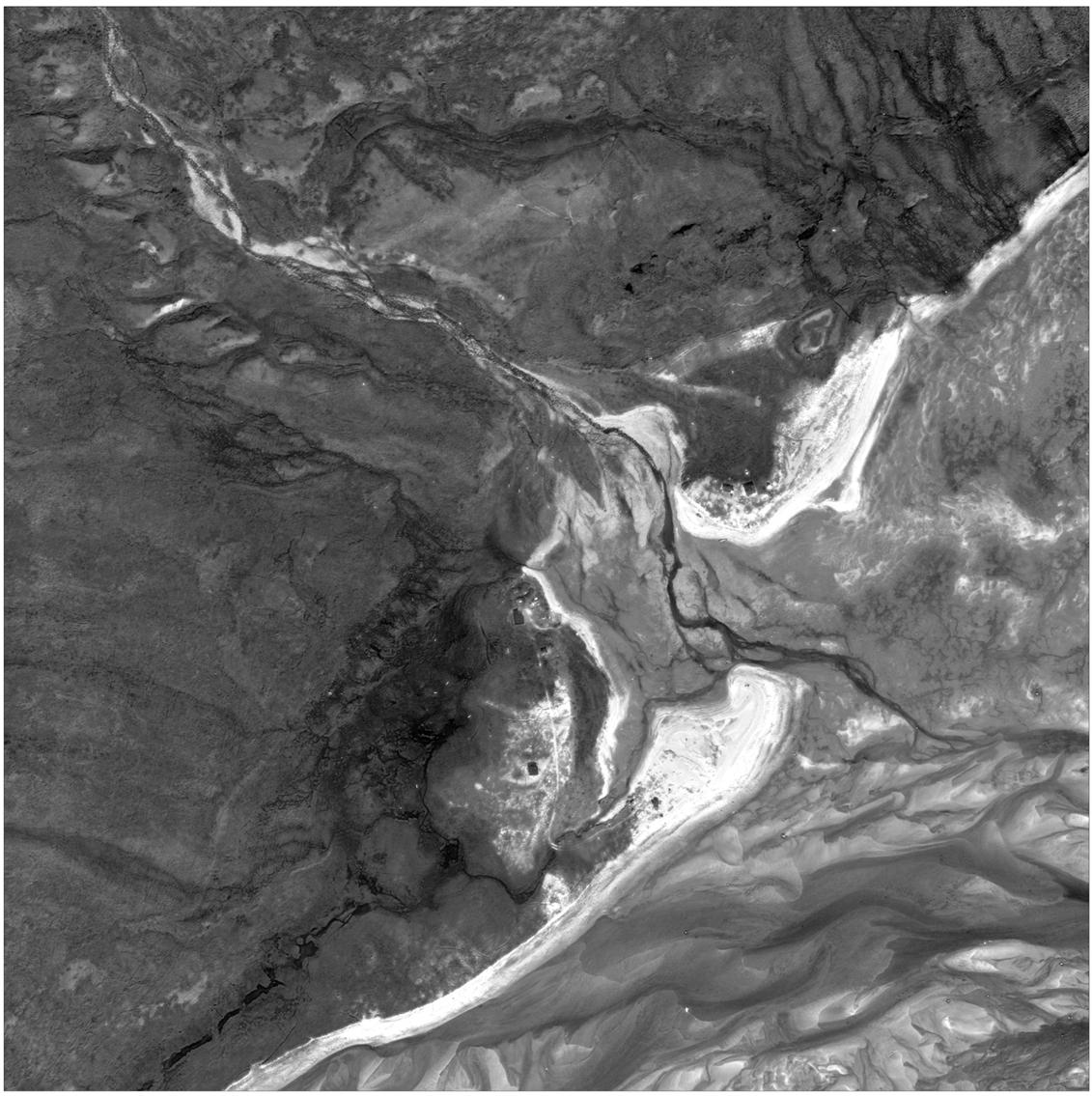
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 165


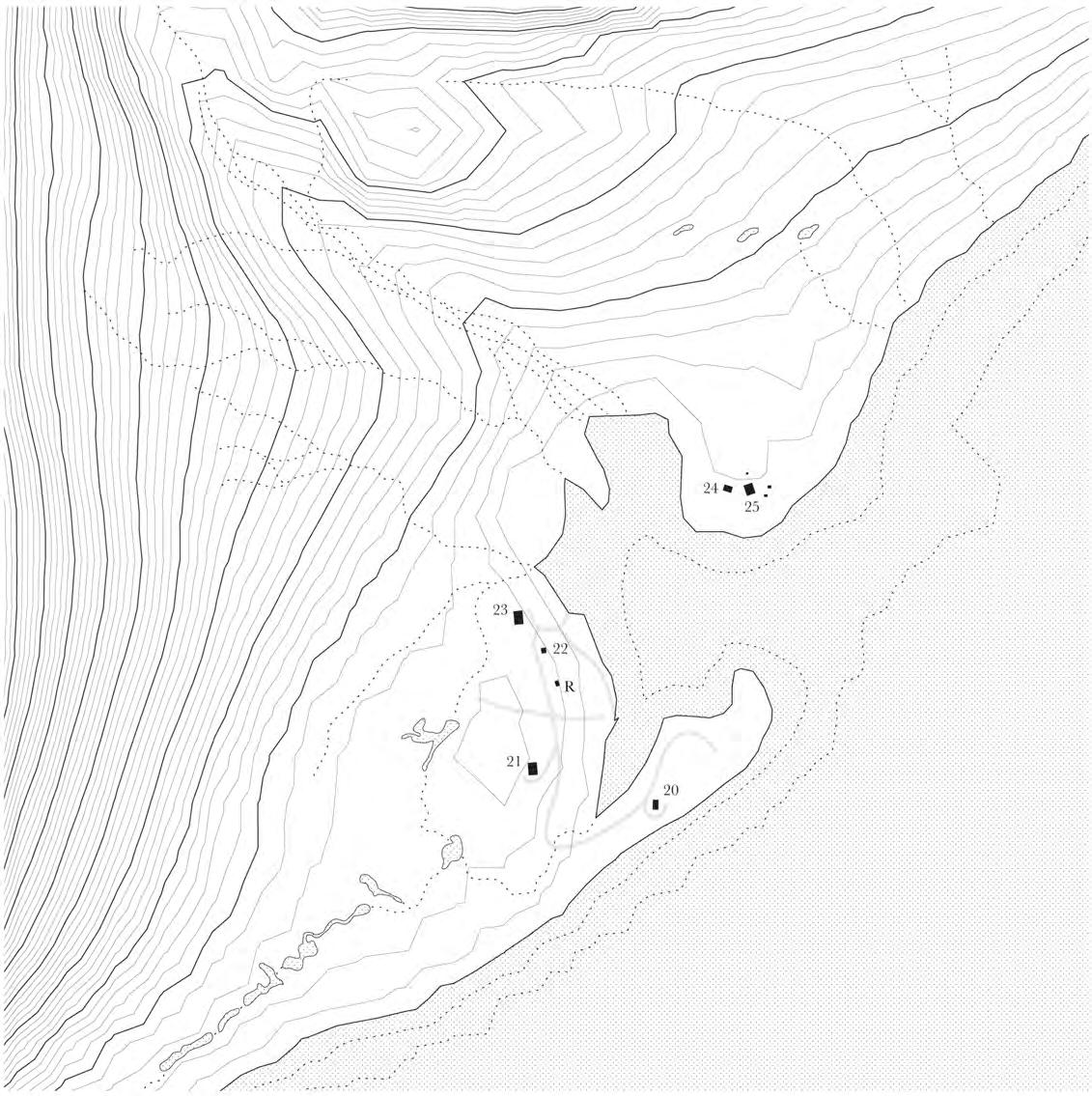
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 166
Dépôts de surface


Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
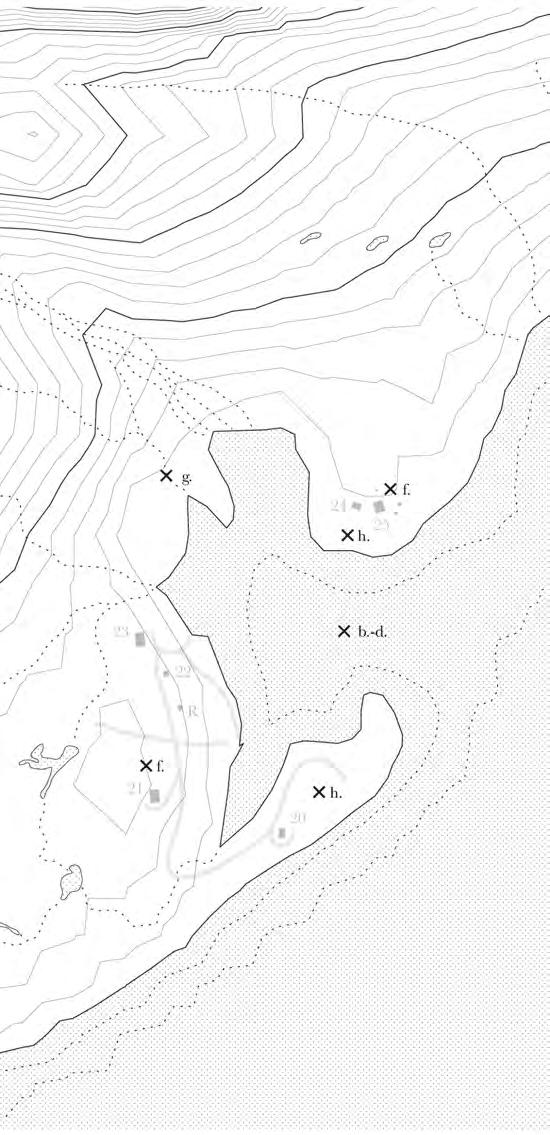 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
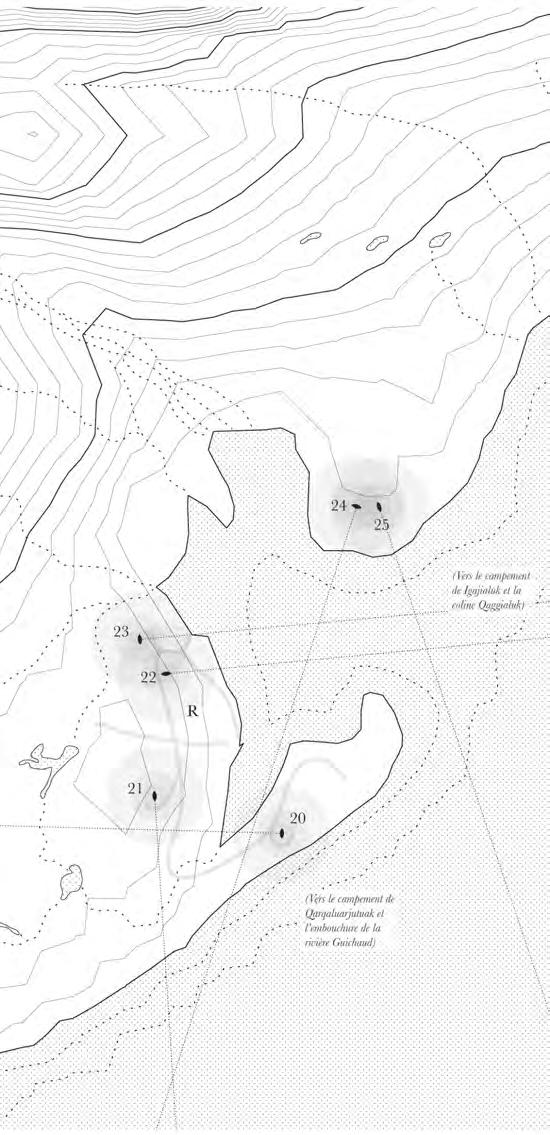
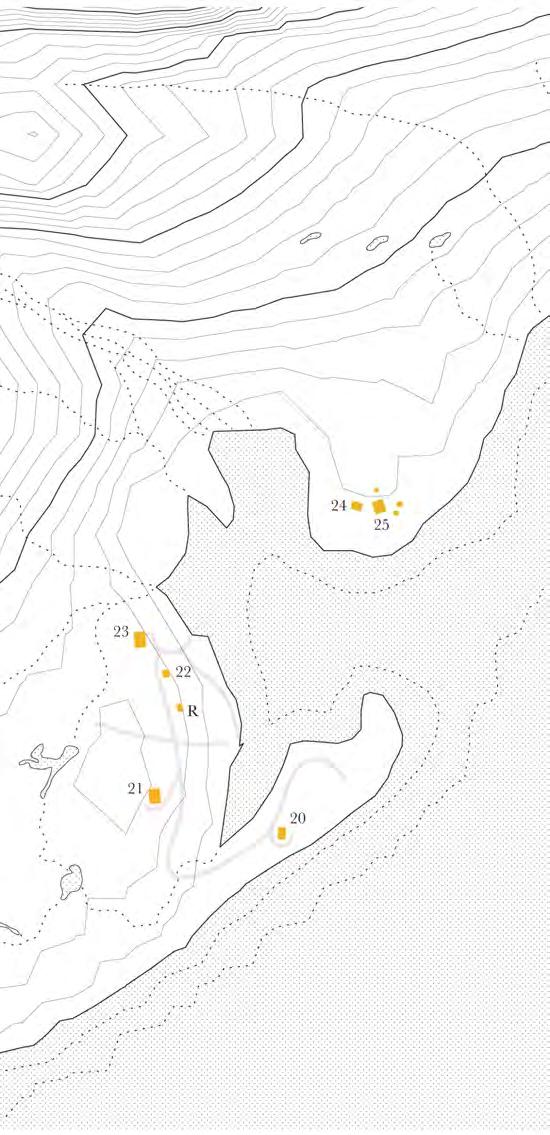
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 167
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 168
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Sittuuniit - e15
Avec ses treize cabanes (dont deux nouvellement construites en 2018 et en 2019), le campement de Sittuuniit est l’un des plus importants de la région du fjord de Salluit. Les cabanes y sont grandes et ont visiblement été transformées à de multiples reprises au fl des ans. L’orientation du faîte des cabanes les plus à l’ouest est parallèle au fjord et au sens des vents. Cet alignement occasionne des confgurations où les côtés longs des cabanes bénéfcient de plus larges panoramas sur le fjord. Les cabanes plus à l’est se regroupent pour leur part derrière un talus qui les protège partiellement des vents. Leur faîte emprunte un axe perpendiculaire au fjord et leur implantation comme leur forme reprend des confgurations plus semblables à celles des premiers campements.
L’accès à Sittuuniit s’efectue par le fjord puisque ce campement se situe sur la rive nord et qu’il se trouve enclavé dans une baie aux pentes abruptes. La plage et le talus qui composent le site sont essentiellement composés de sable. Au nord, un large ruisseau ofre de l’eau douce et s’écoule depuis une vallée qui permet d’accéder au territoire. Une telle morphologie semble occasionner de nombreux avantages pour l’établissement des cabanes puisque la grande majorité des critères préférentiels s’y identifent facilement (a.-b.-c.-d.-f.-g.-h.). Toutefois, l’érosion des berges du ruisseau couplée à la fonte accélérée du pergélisol fragilise la structure des dépôts de surface et, si le site apparait à première vue stable et propice à la construction, des traces de glissement de terrain comme celles tout juste au nord du talus laissent présager le contraire.
Annexe 1 - page 169
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 170
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 171


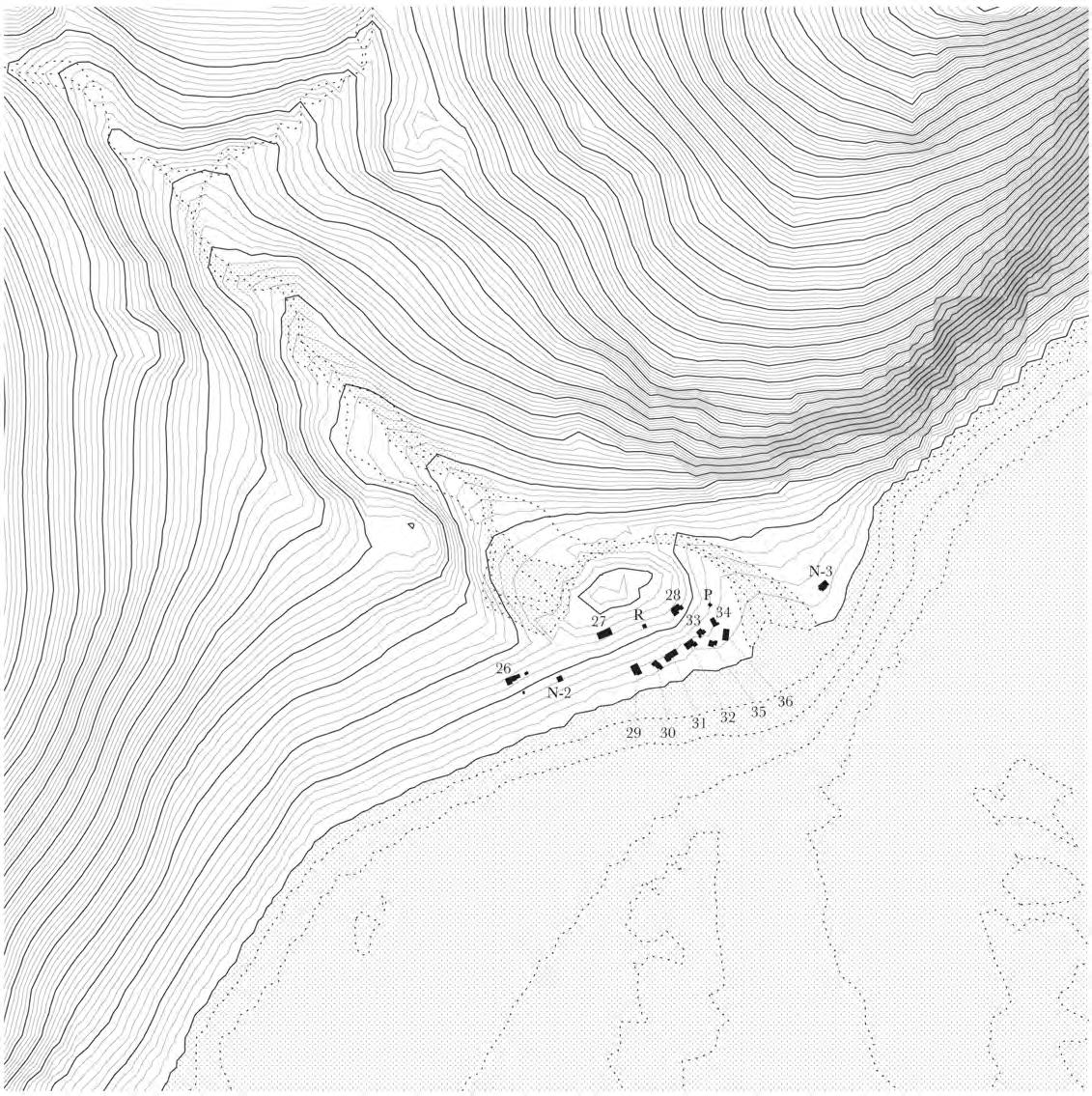 2.
2.
Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 172
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



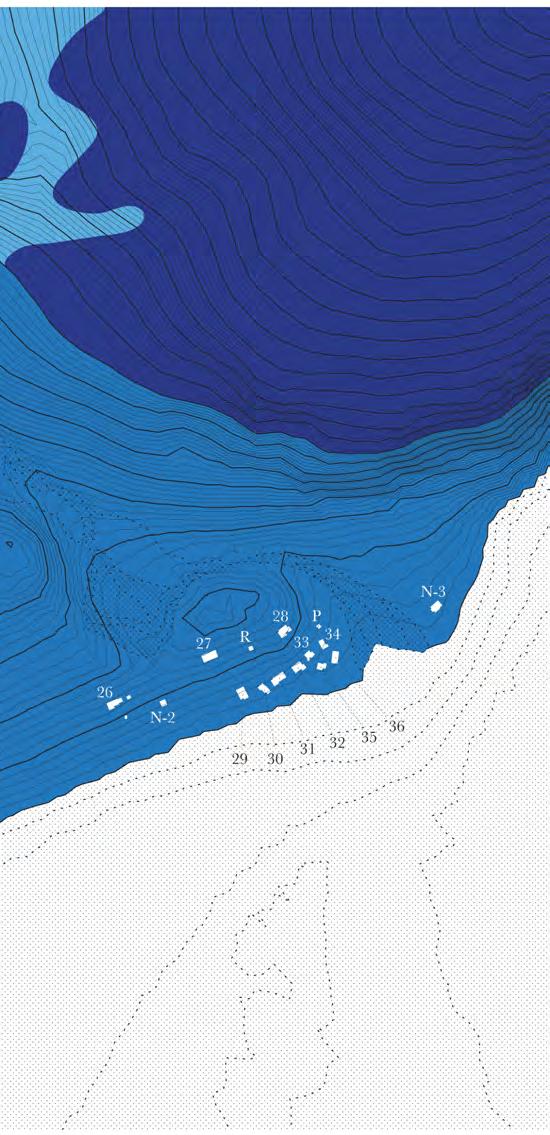
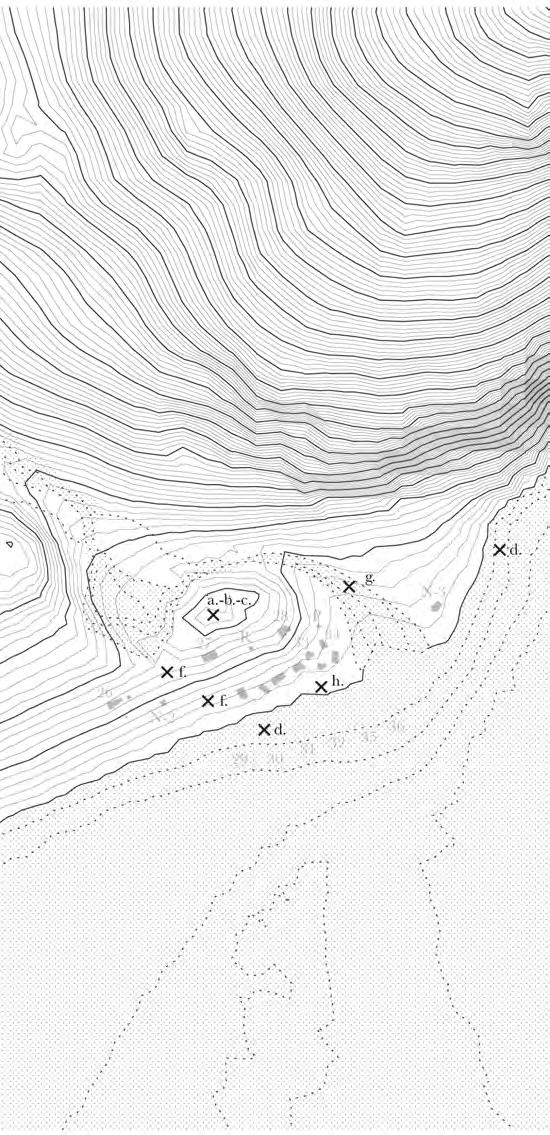
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
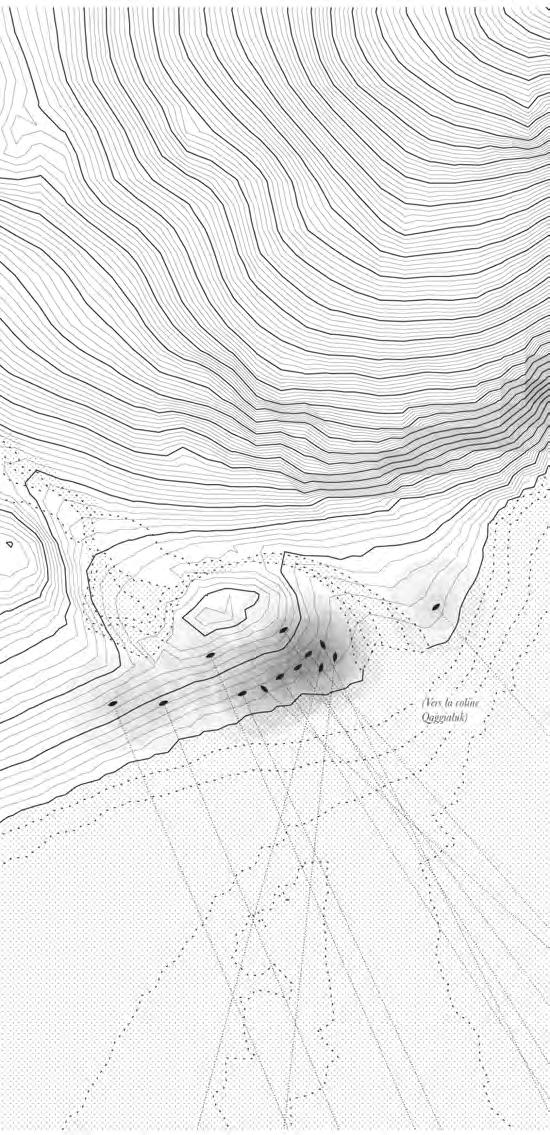
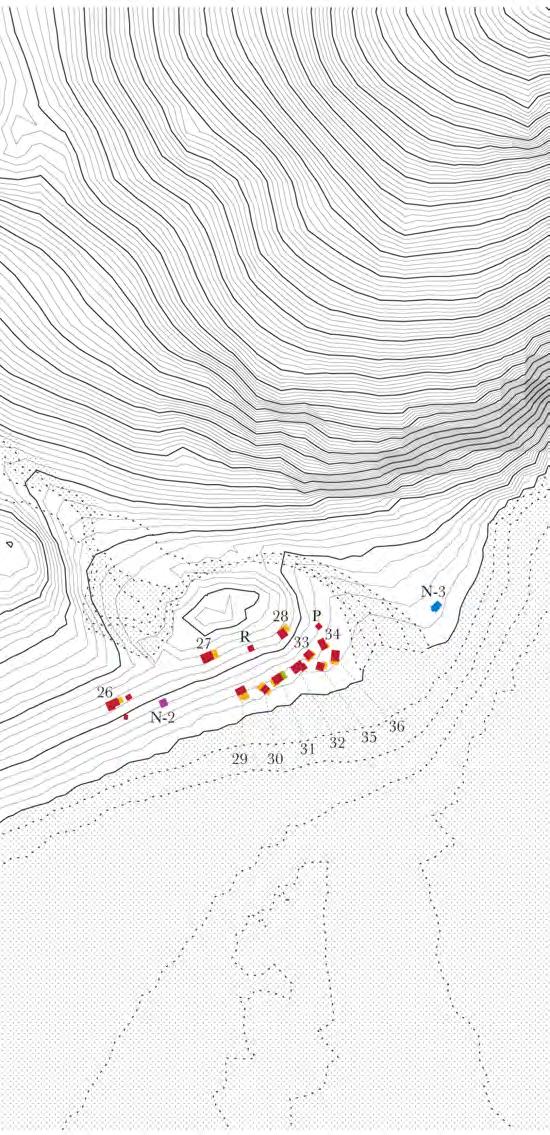
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 173
m
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.

Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 174
Aupartuapik - h13 - h14
Le campement Aupartuapik est particulier puisqu’il ne comporte qu’une seule cabane. Celle-ci est bâtie sur un promontoire rocheux très élevé à partir duquel l’axe fjord change de quelques degrés. Ce site regroupe également un minimum de trois critères préférentiels (b.-c.-f.).
En observant la morphologie du site, l’accès au campement depuis la rive semble des plus fastidieux et l’absence de plage, d’eau douce ou de protection des vents à proximité laisse supposer que cette construction répond à des considérations autres que celles adressées à travers la construction des
cabanes observées jusqu’à présent. Par le fait même, la cabane d’Aupartuapik semble être la seule de tout le fjord de Salluit à avoir deux niveaux.

Enfin et sans grande surprise, les entretiens avec les bâtisseurs locaux ont révélé que cette cabane aurait été construite par un groupe de qallunaat (gens du sud) il y a plusieurs années et qu’elle a été abandonnée depuis. Les bâtisseurs locaux ont notamment déploré le fait que cette cabane est difficilement habitable en raison de sa position dans un milieu défavorable.
Annexe 1 - page 175
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 176
1. Image satellite du campement
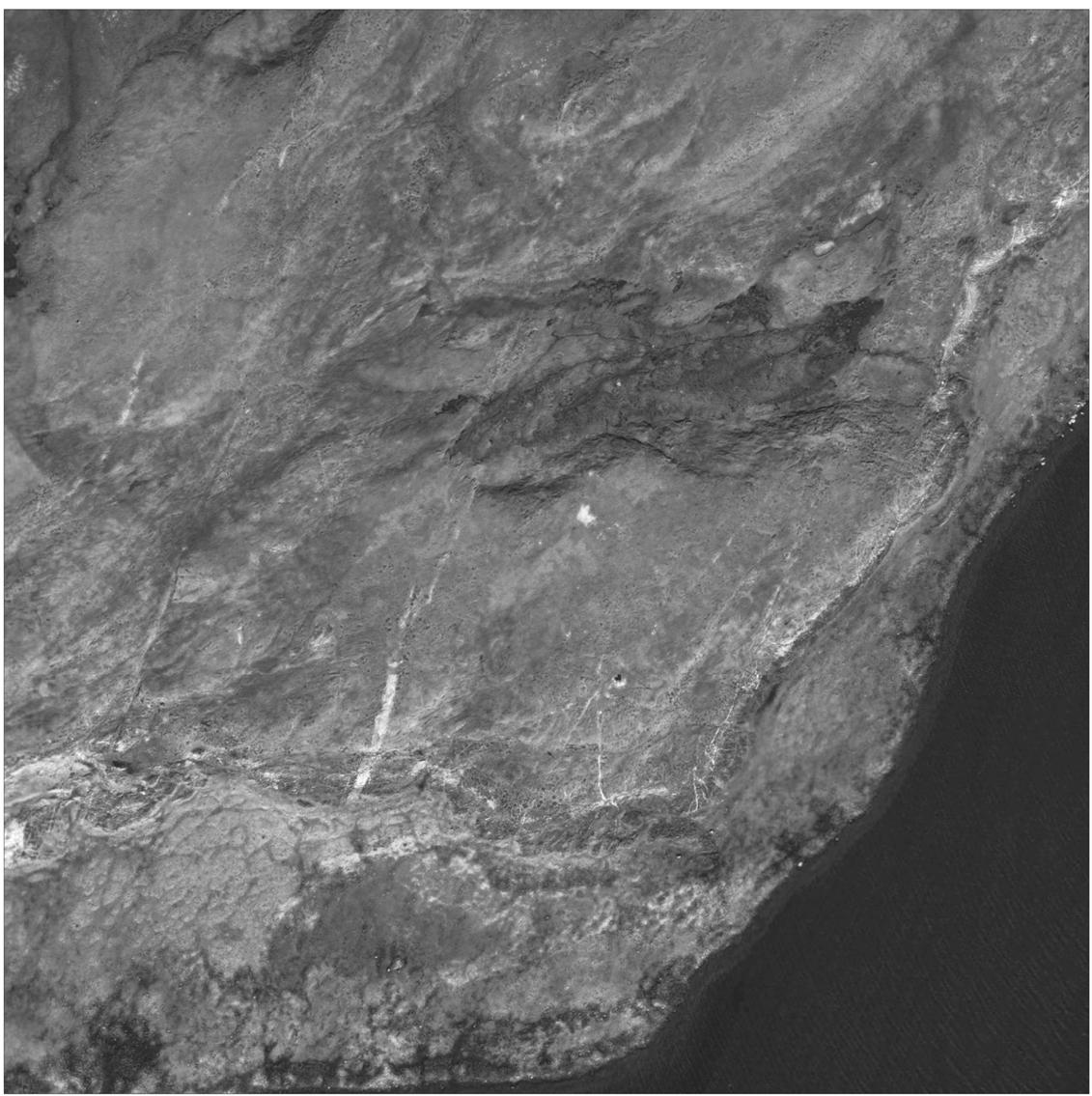
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 177


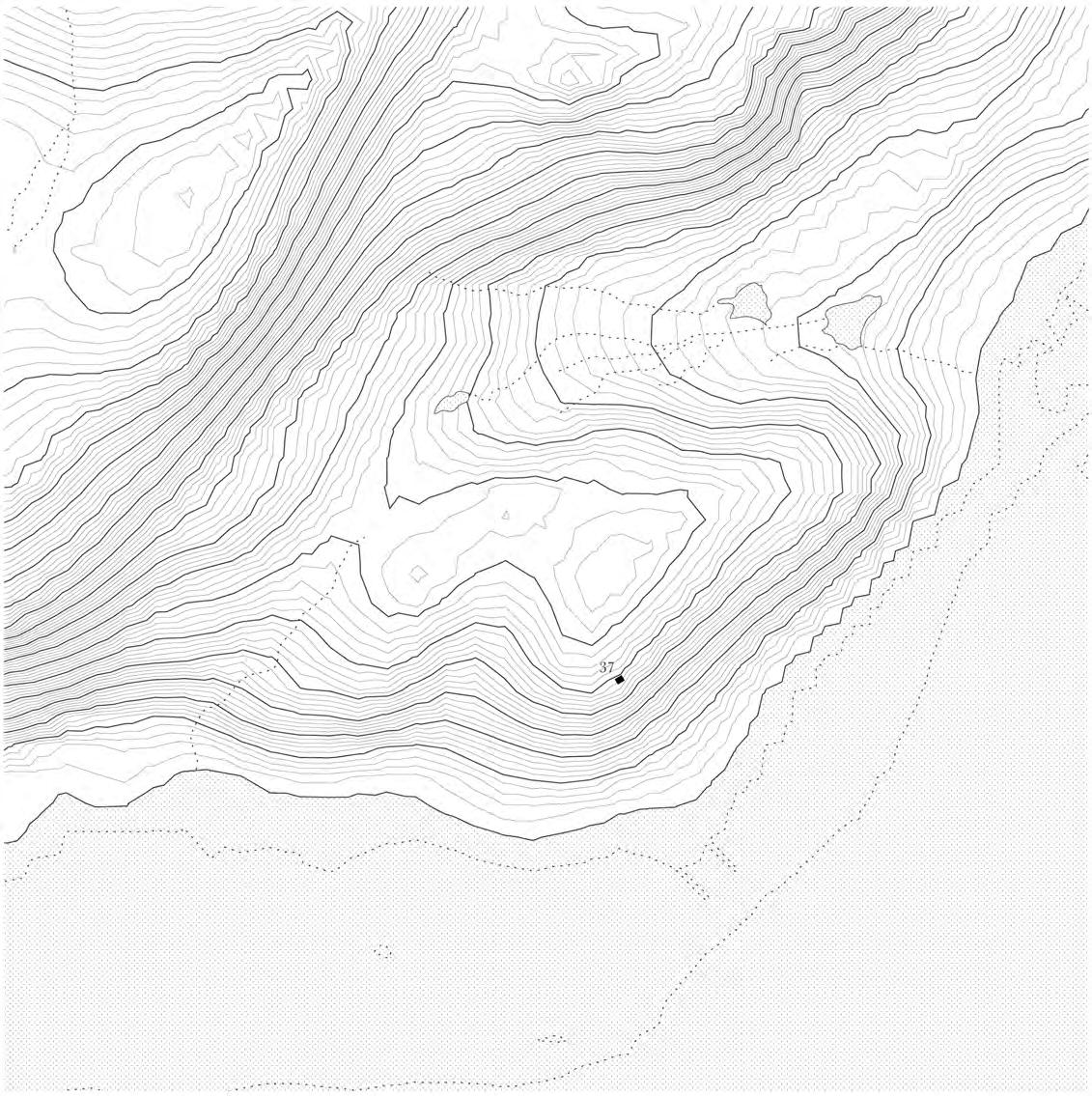
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 178
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



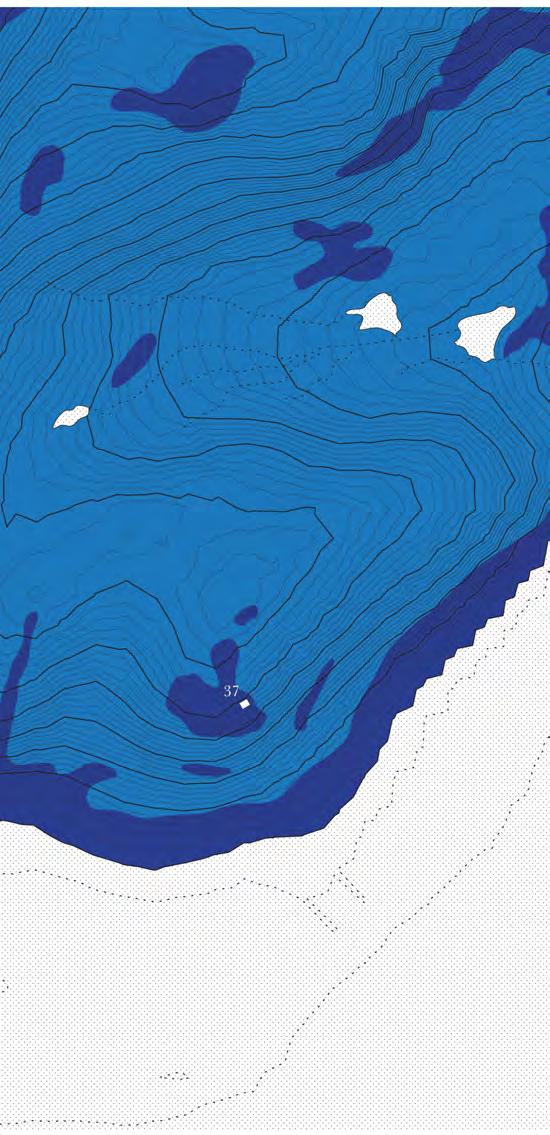
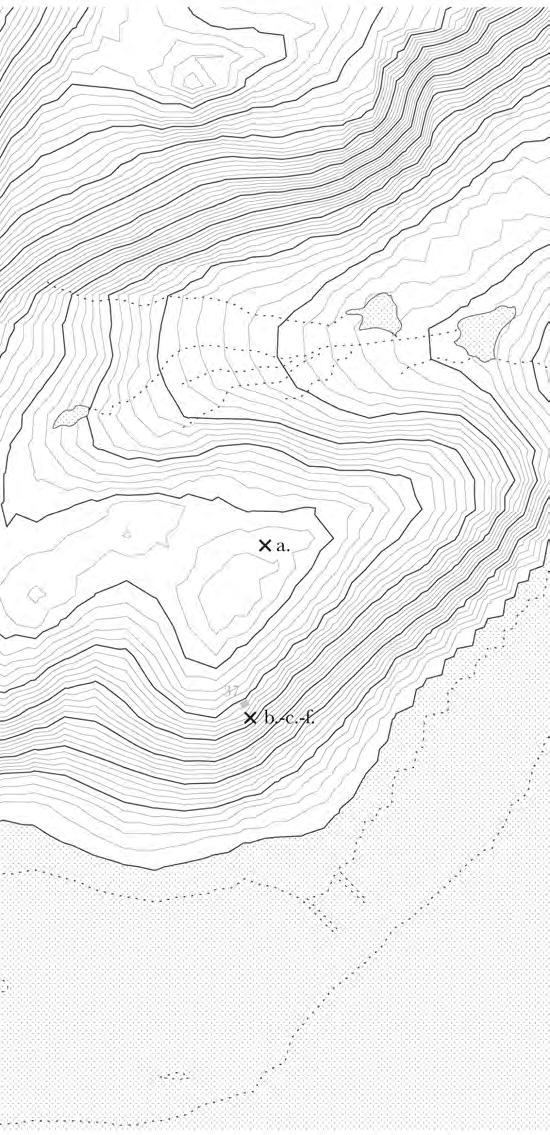
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
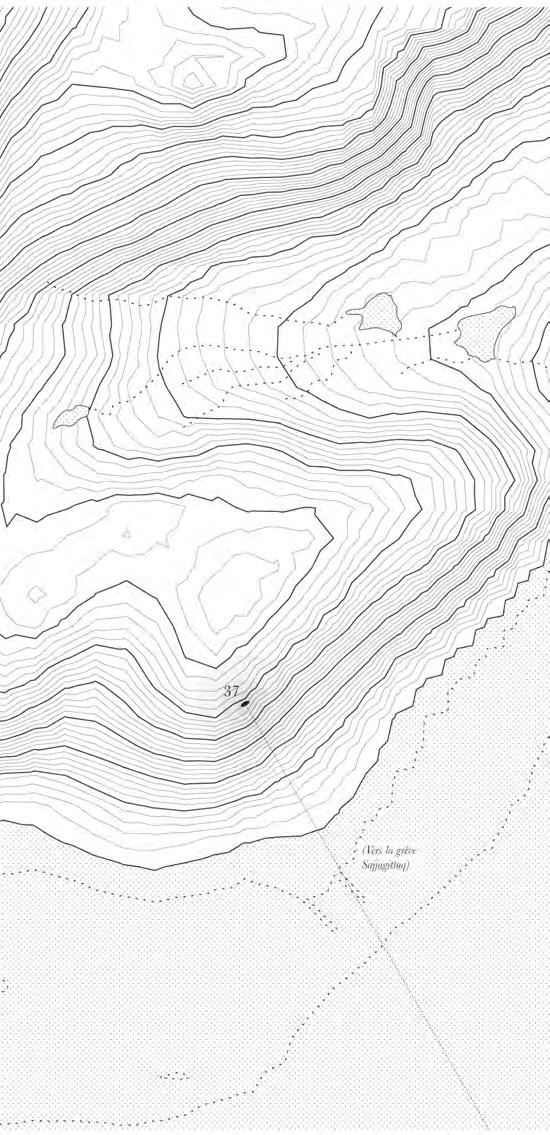
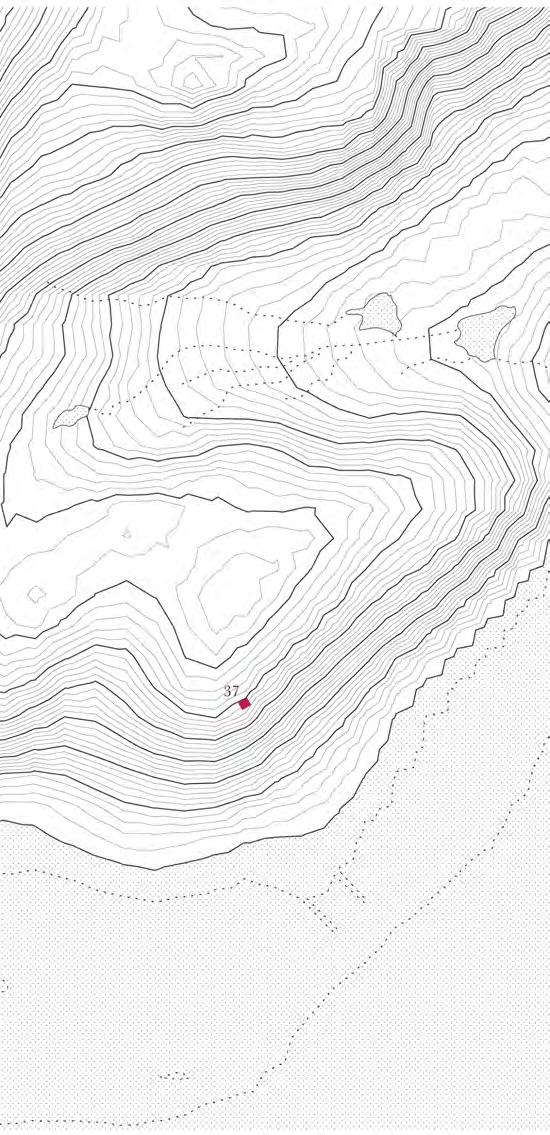
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 179
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m

Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 180
Ruisseau Aupartuapiup - i13
Le campement du ruisseau Aupartuapiup compte quatre cabanes de petites et de moyennes dimensions. Elles sont implantées sur un sol sablonneux et le faîte de leur toiture est pour la plupart orienté de façon parallèle au fjord (3/4). Ici encore, une telle orientation ofre l’opportunité de maximiser les ouvertures des façades vers le fjord et permet une exposition minimale aux vents dominants du sud-ouest.

La position du campement rassemble de nombreux critères préférentiels (a.-b.-c.-d.-f.-g.-h.). La présence du ruisseau et de la vallée ofre notamment une voie d’accès vers le nord et vers l’intérieur du territoire.
En ce qui a trait à l’âge des cabanes, elles semblent avoir été construites durant deux périodes distinctes puisque celles se trouvant plus près de l’eau datent de 2002 ou avant, tandis que celles légèrement plus hautes et éloignées de la berge semblent être apparues entre 2003 et 2015.
Annexe 1 - page 181
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 182
1. Image satellite du campement
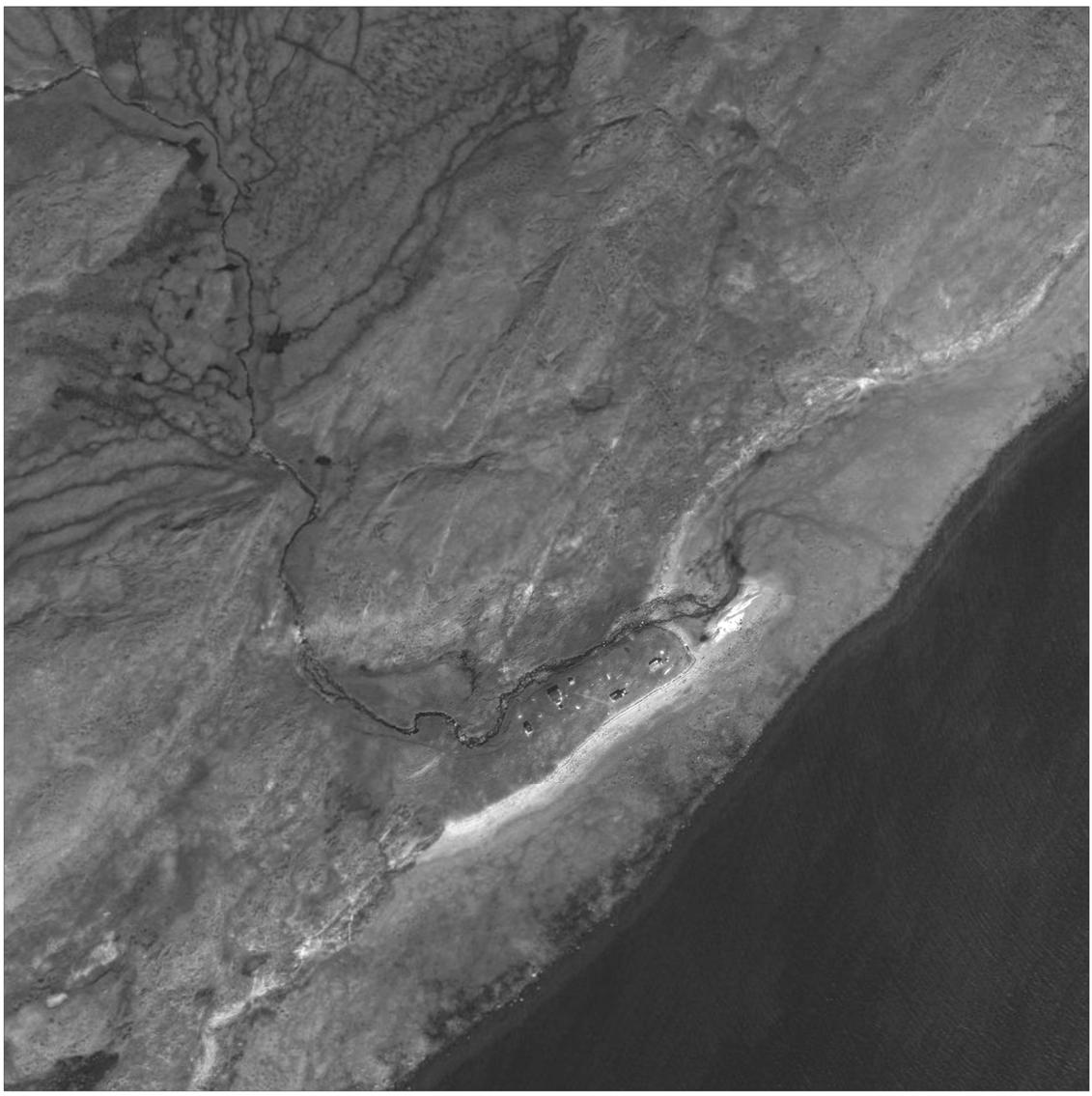
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 183


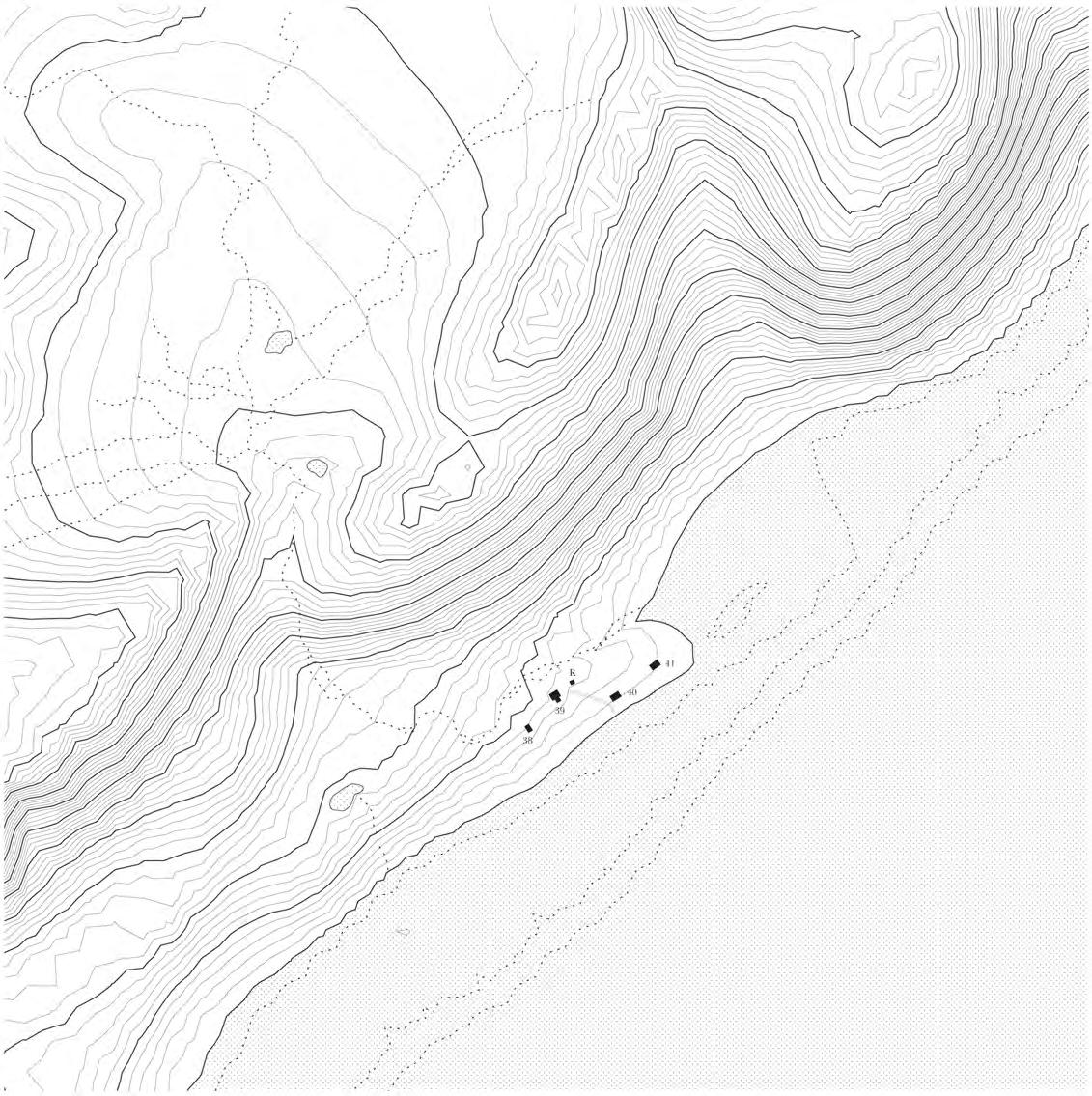
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 184
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde




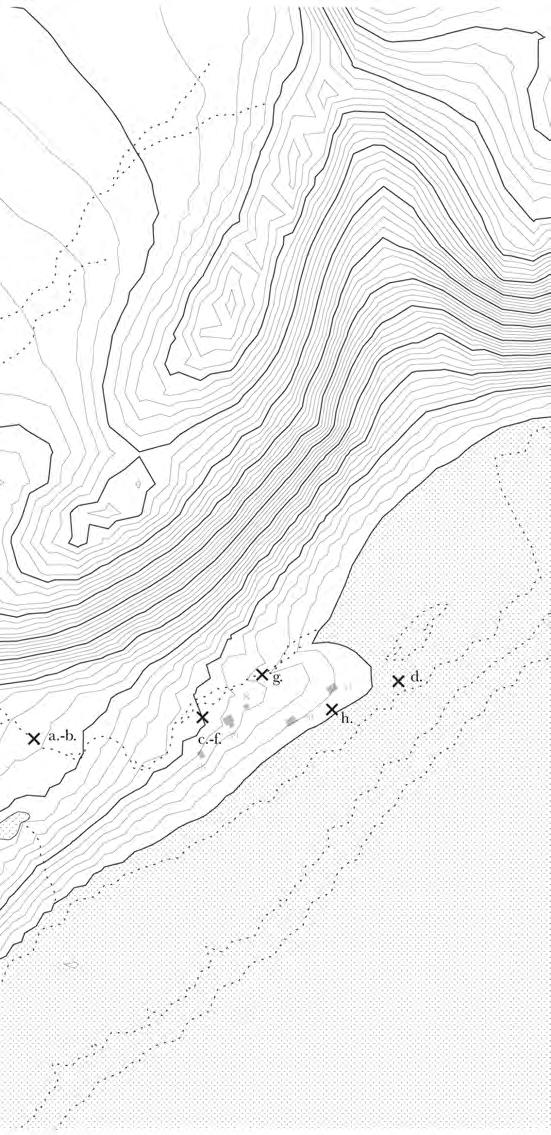
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative

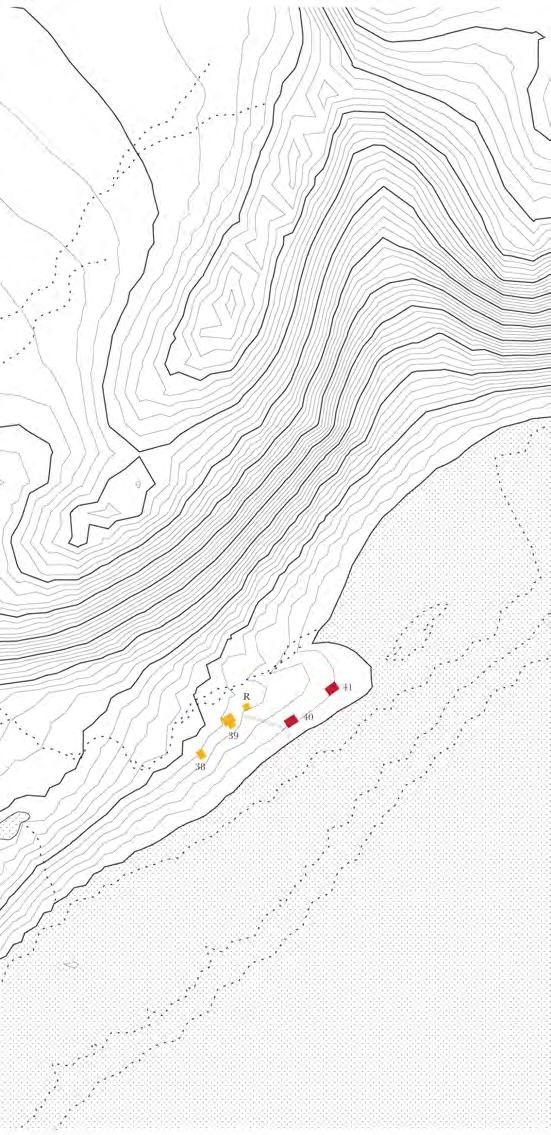
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 185
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 186

44 43 42
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Sajuvvik - Sajuvvialuk - j12
Mis à part quelques photographies prises depuis le côté opposé du fjord, aucune observation directe n’a pu être effectuée aux campements des pointes de Sajuvvik et de Sajuvvialuk. Malgré cette difficulté, il est possible de déduire que les cabanes 42 et 43 (construites en 2002 ou avant) sont relativement petites, tandis que la cabane 44 (construite entre 2003 et 2015) semble être de taille moyenne.
Les cabanes sont distancées les unes des autres et, bien que chacun de leur secteur semble bénéficier d’un maximum de critères préférentiels, l’irrégularité du terrain (perceptible à partir des images satellites)
laisse croire que le sol n’y est pas uniforme ou plat. D’ailleurs, la nature des dépôts de surface de Sajuvvik et de Sajuvvialuk est différente de celle des sites précédents et à défaut de retrouver des dépôts marins, du roc (affleurant à moins de 50% de la surface) et des dépôts fluviatiles y sont présents en majorité. Cela pourrait expliquer le faible nombre de cabanes dans ces campements puisque ces dépôts peuvent présenter une surface plus irrégulière et donc plus difficilement constructible.
Annexe 1 - page 187

42 43 44
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 188
1. Image satellite du campement
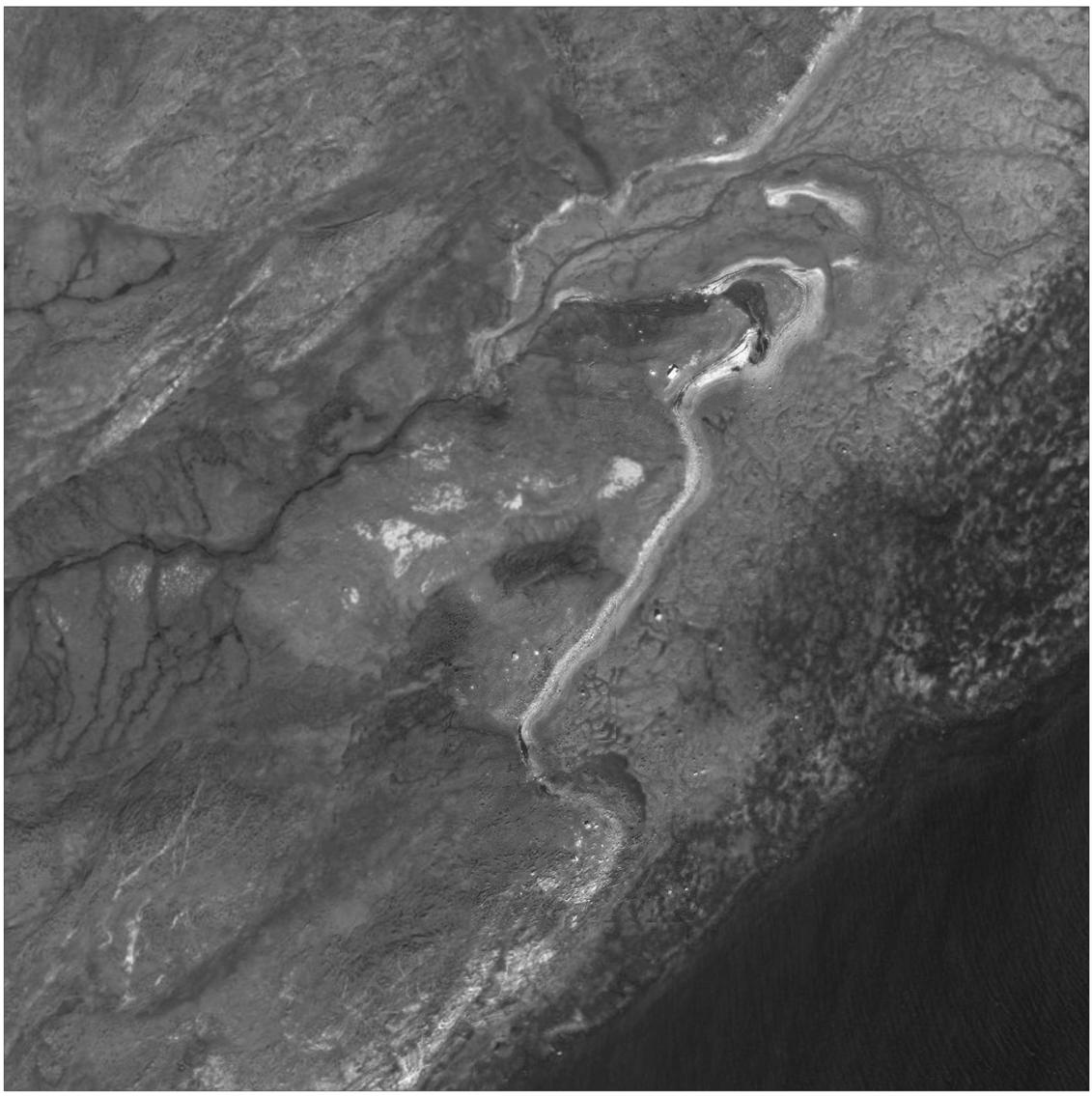
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 189


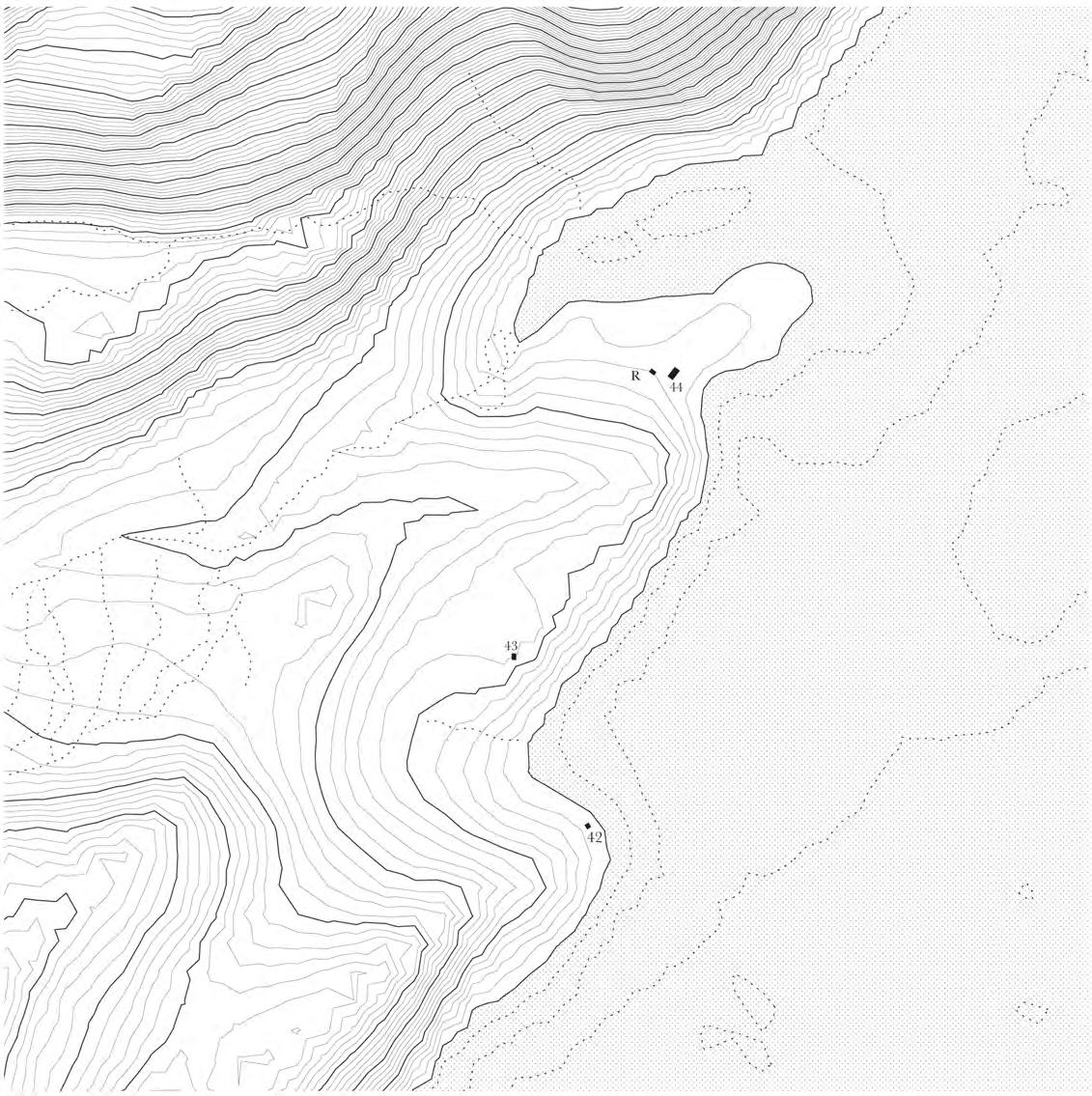 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




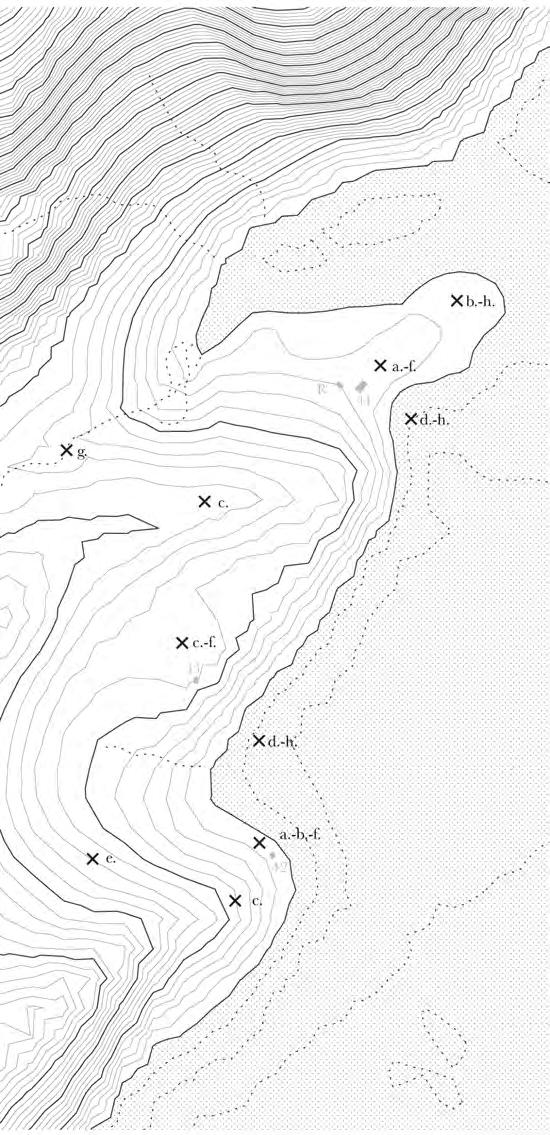
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 190
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde




Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative


Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 191
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 192

Demeule, août 2018
Kiassautialuk (1/2)
- k11
La première partie du campement de Kiassautialuk compte cinq cabanes de moyennes dimensions dont la plupart sont construites sur un sol où le roc affleure sur une portion considérable du site (seule exception, la cabane 45 est construite sur un dépôt marin).

Situé près du village de Salluit, soit directement de l’autre côté du fjord, l’accès au campement s’effectue relativement facilement. Toutefois cela dit, l’importance de la batture et l’absence d’un chenal près du site complexifient son accessibilité à marée basse.
L’étendue de la vallée derrière le campement permet quant à elle de rejoindre aisément l’intérieur des terres. En somme, le site comporte de nombreux critères préférentiels (a.-b.-c.-f.-g.-h.) et bénéficie d’une protection des vents dominants par sa position enclavée dans la baie de Kiassautialuk.
L’orientation du faîte des cabanes pointe ici encore des directions soit parallèles, soit perpendiculaires à la rive. Plus précisément, les cabanes qui semblent être plus récentes suivent un axe parallèle au fjord, tandis que celles qui semblent plus anciennes adoptent un alignement contraire.
Annexe 1 - page 193
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 194
1. Image satellite du campement
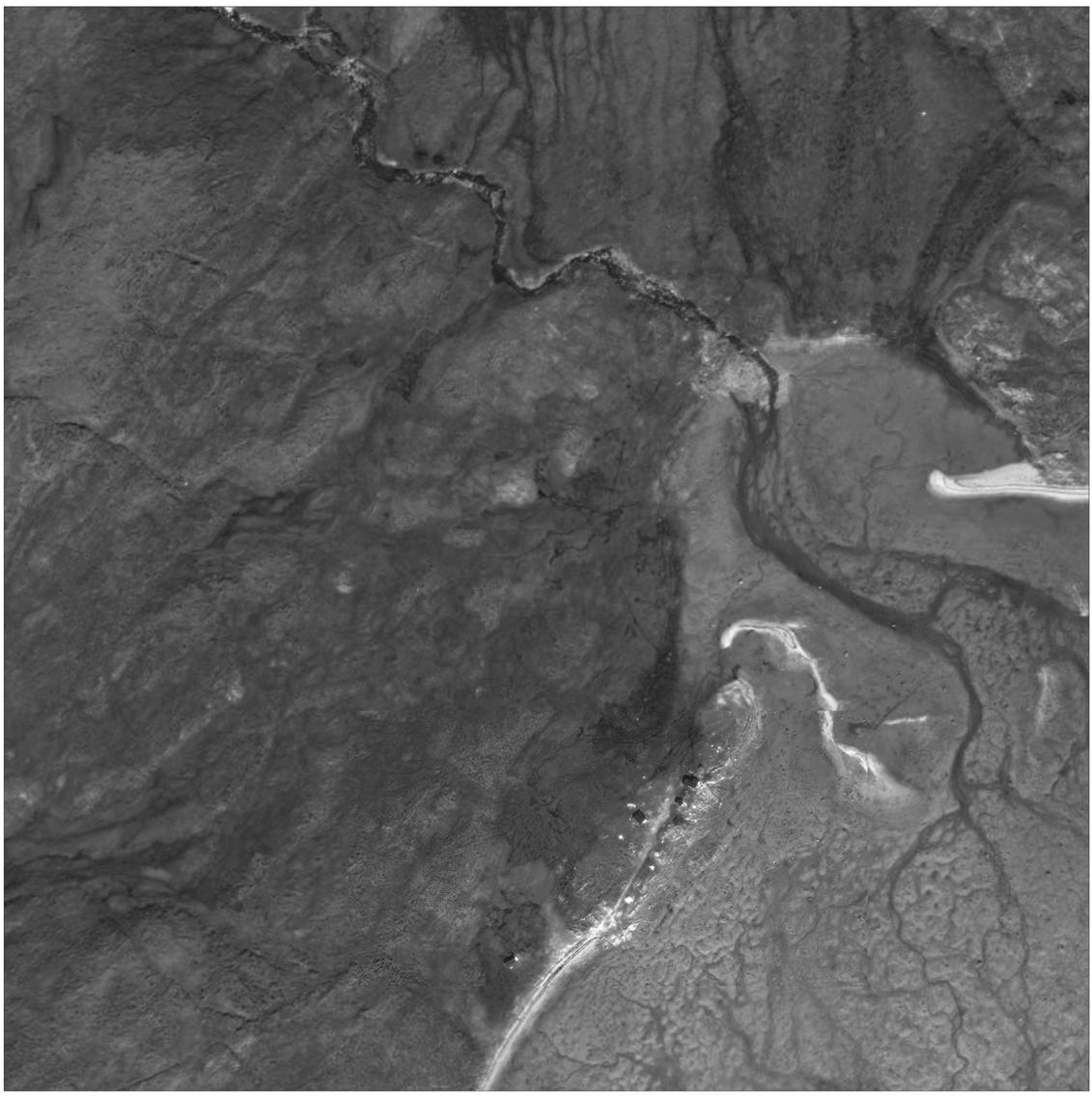
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 195


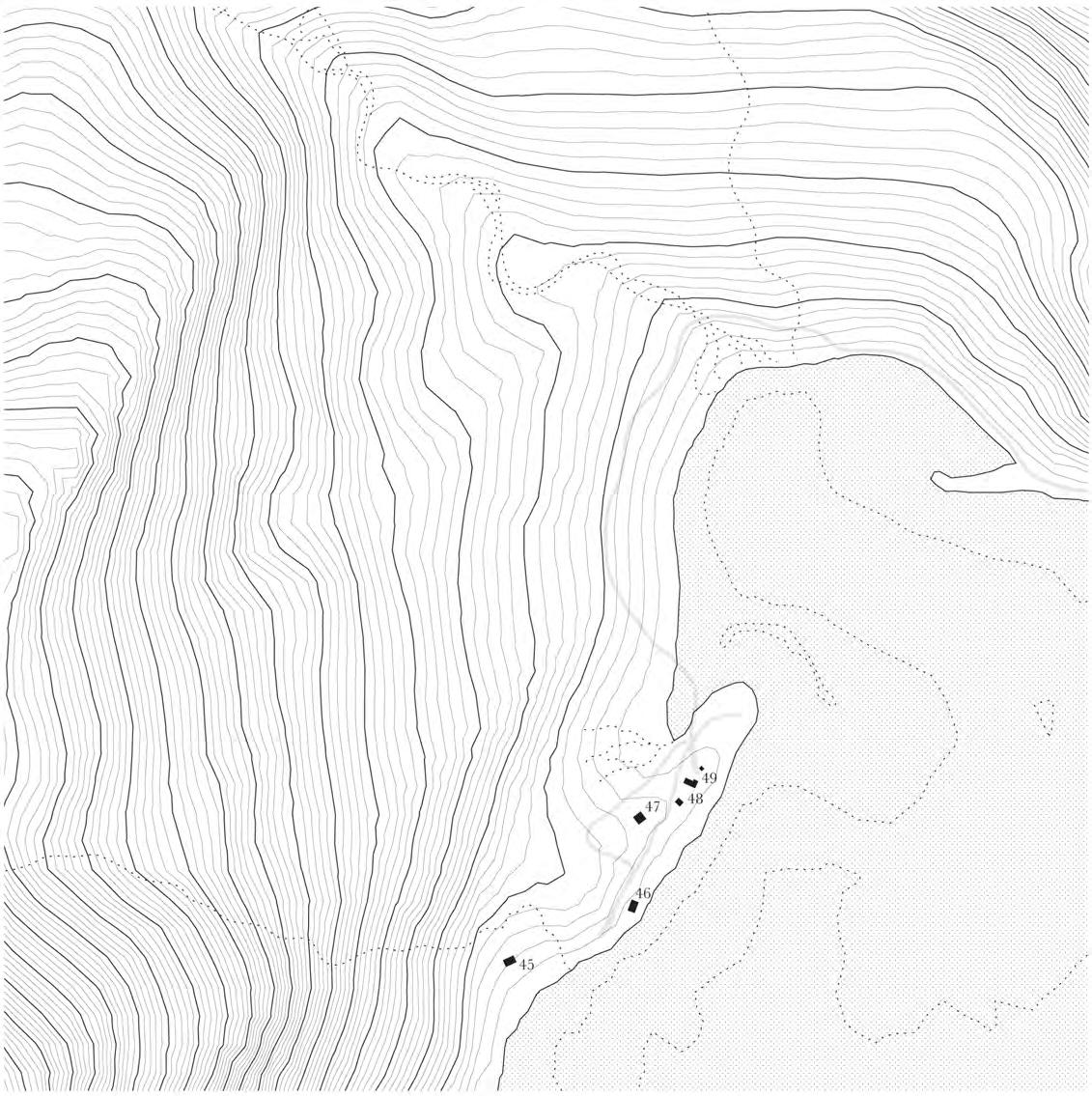
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




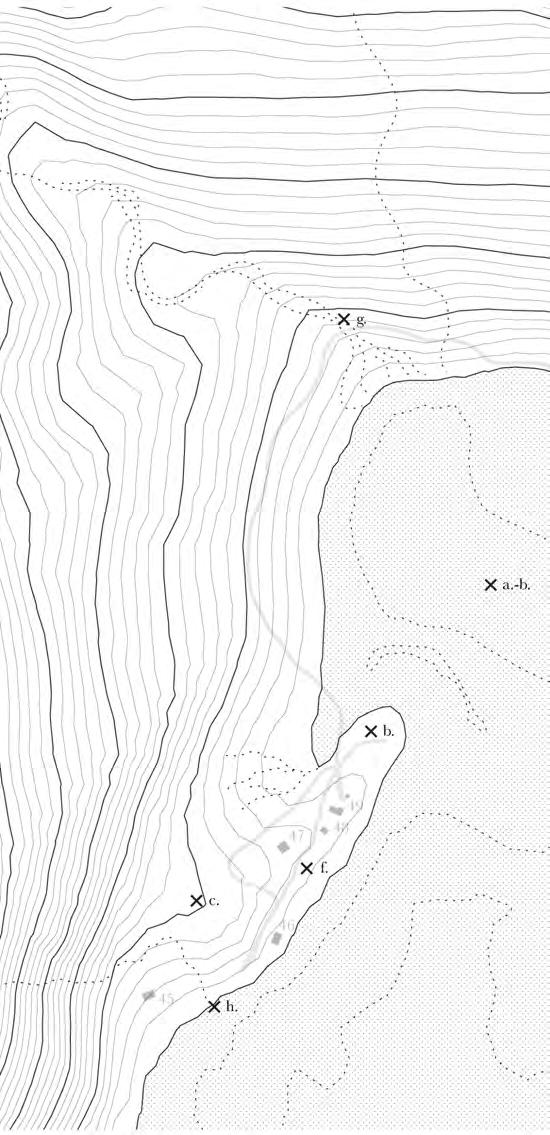
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 196
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde




Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
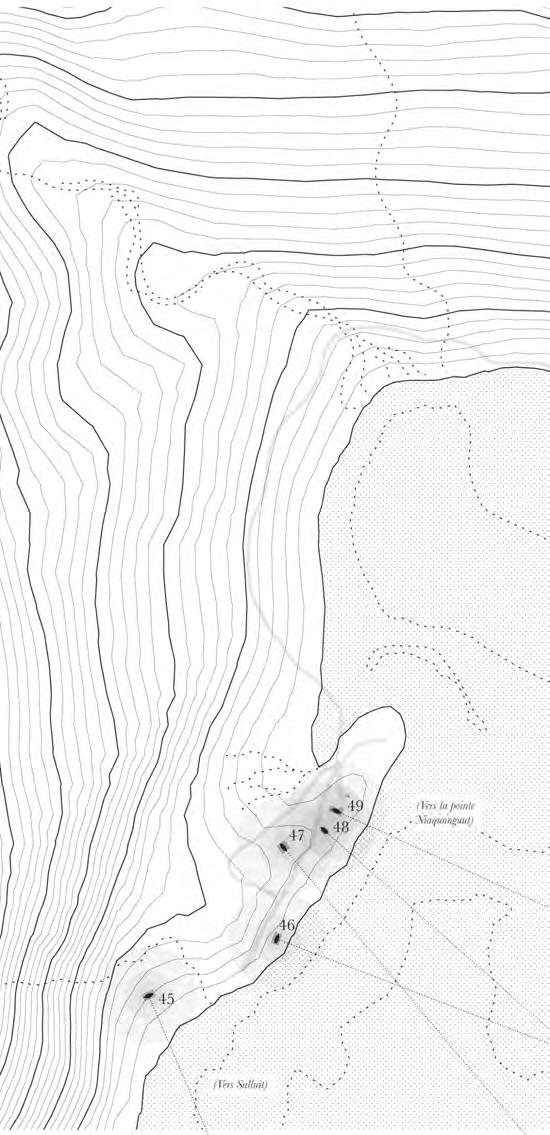
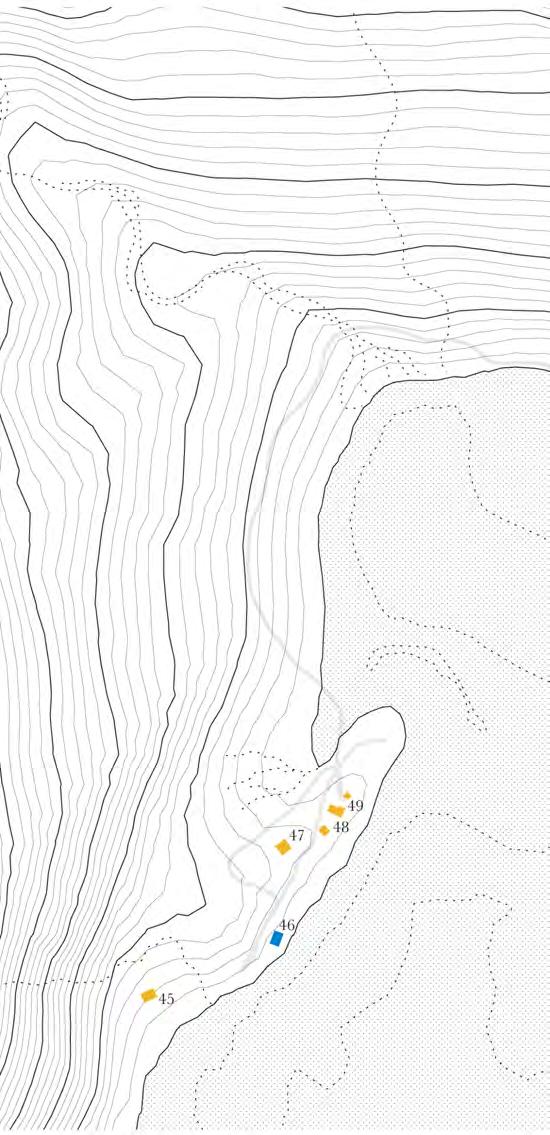
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 197
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20 m
5.
Annexe 1 - page 198
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Kiassautialuk (2/2) - k10
La deuxième partie du campement de Kiassautialuk se situe dans la portion nord-est de la baie du même nom. Ici, les quatorze cabanes recensées se rassemblent en trois secteurs, soit un noyau dense ainsi que deux aires périphériques plus distendues. Deux cabanes nouvellement construites sont situées à environ 200 et 300 mètres au nord-est du noyau, tandis que deux autres (environ à la même distance) occupent une pointe au sudouest.

Les cabanes y sont de tailles moyennes ou grandes dimensions et leurs assises semblent prioriser les sols où le roc afeure.
Le noyau du campement correspond à un endroit plus facilement accessible à marée basse, tandis que les cabanes construites à l’écart se rapprochent d’autres critères préférentiels comme l’accès à de plus grandes plages ou à de meilleurs points de vue du fjord. En considérant la section ouest du campement, soit celle de l’autre côté de la baie, un maximum de critères préférentiels se retrouve à Kiassautialuk.
Aussi, il semble que la majorité des cabanes de cette partie du campement de Kiassautialuk aient été construites entre 2003 et 2015. L’orientation du faîte de la majorité des cabanes est pour sa part parallèle à la rive du fjord.
Annexe 1 - page 199
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 200
1. Image satellite du campement
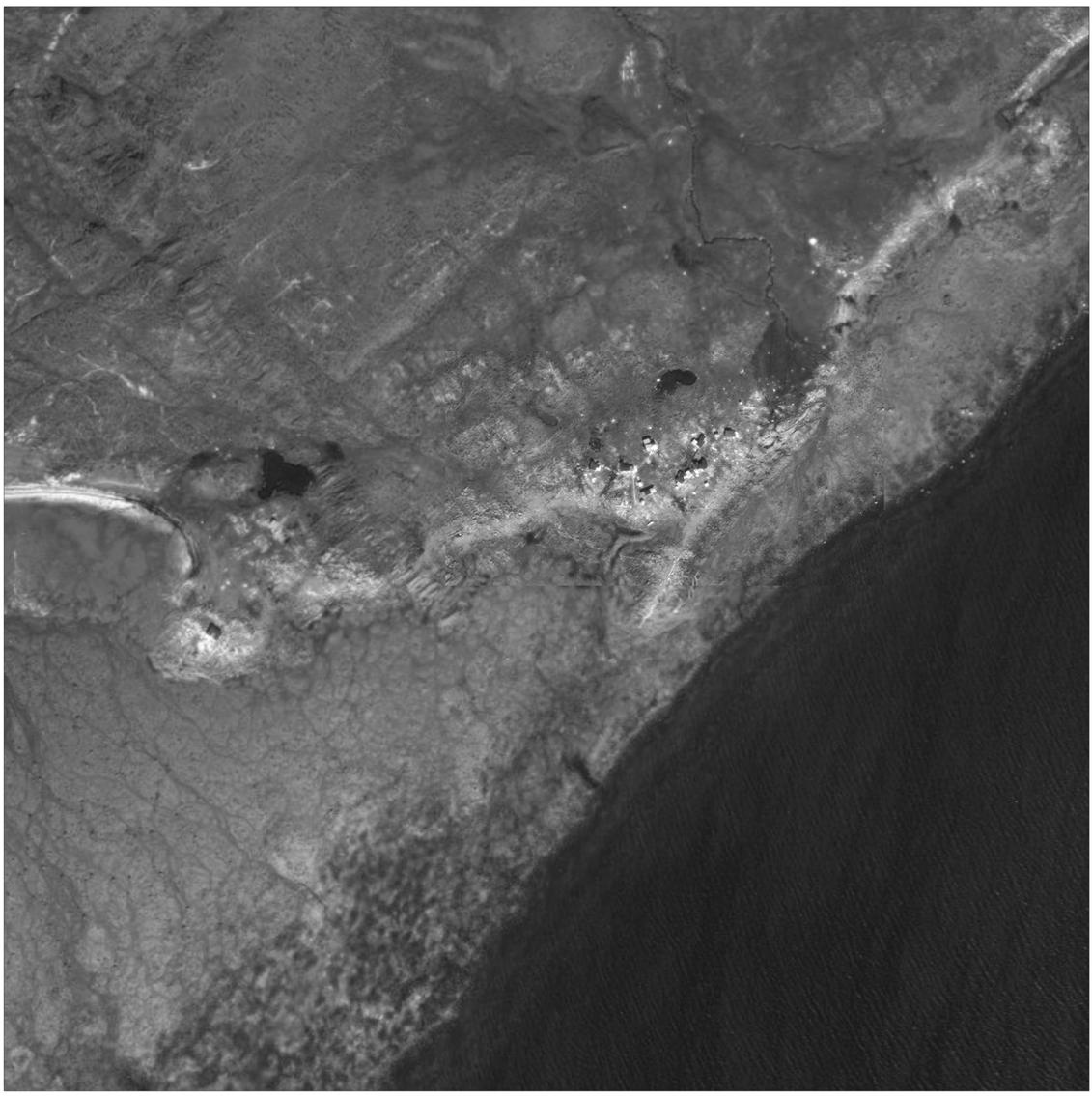
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 201


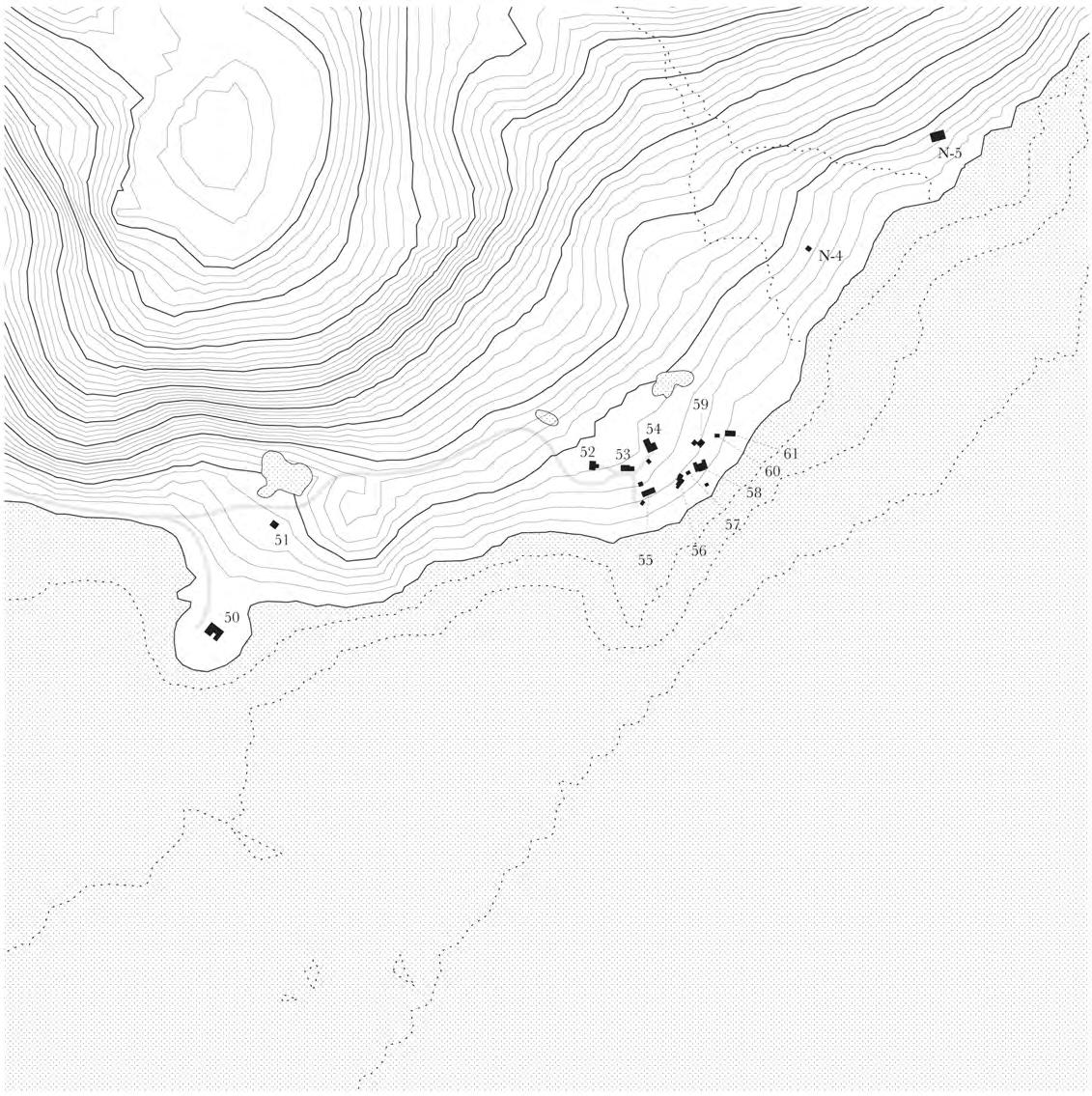
2. Cours d’eau
Annexe 1 - page 202








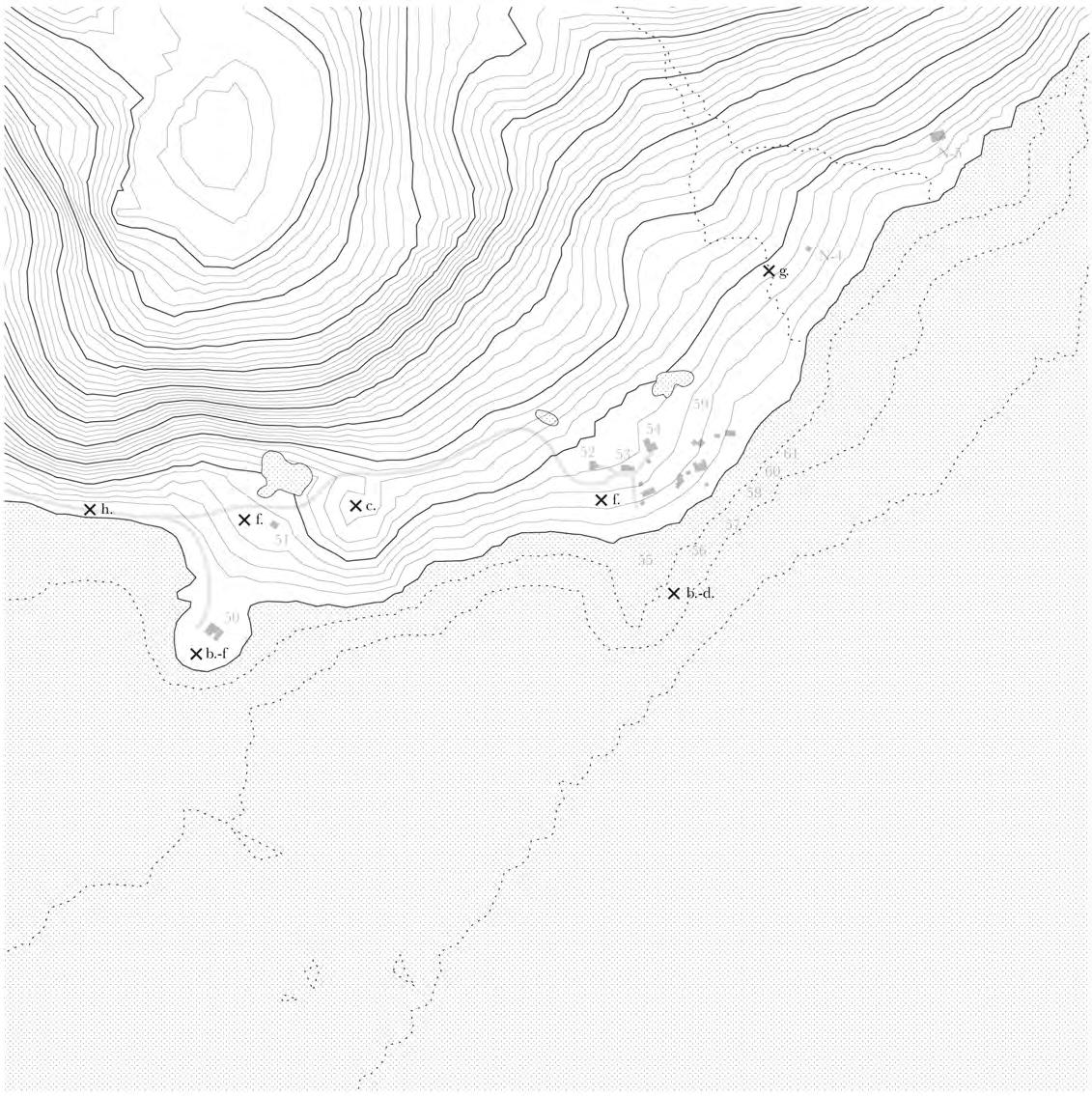 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 203
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
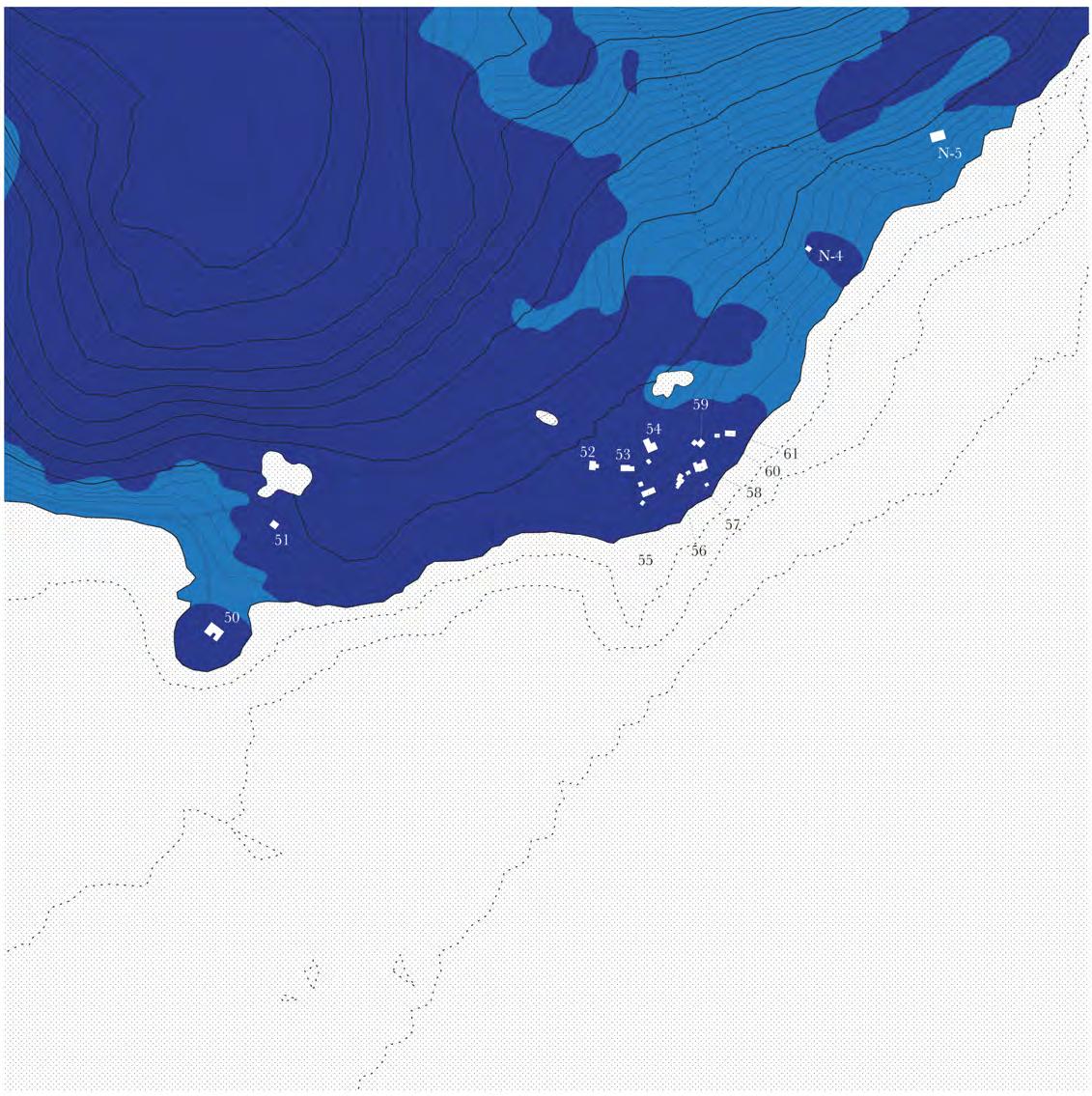 4.
4.
Annexe 1 - page 204
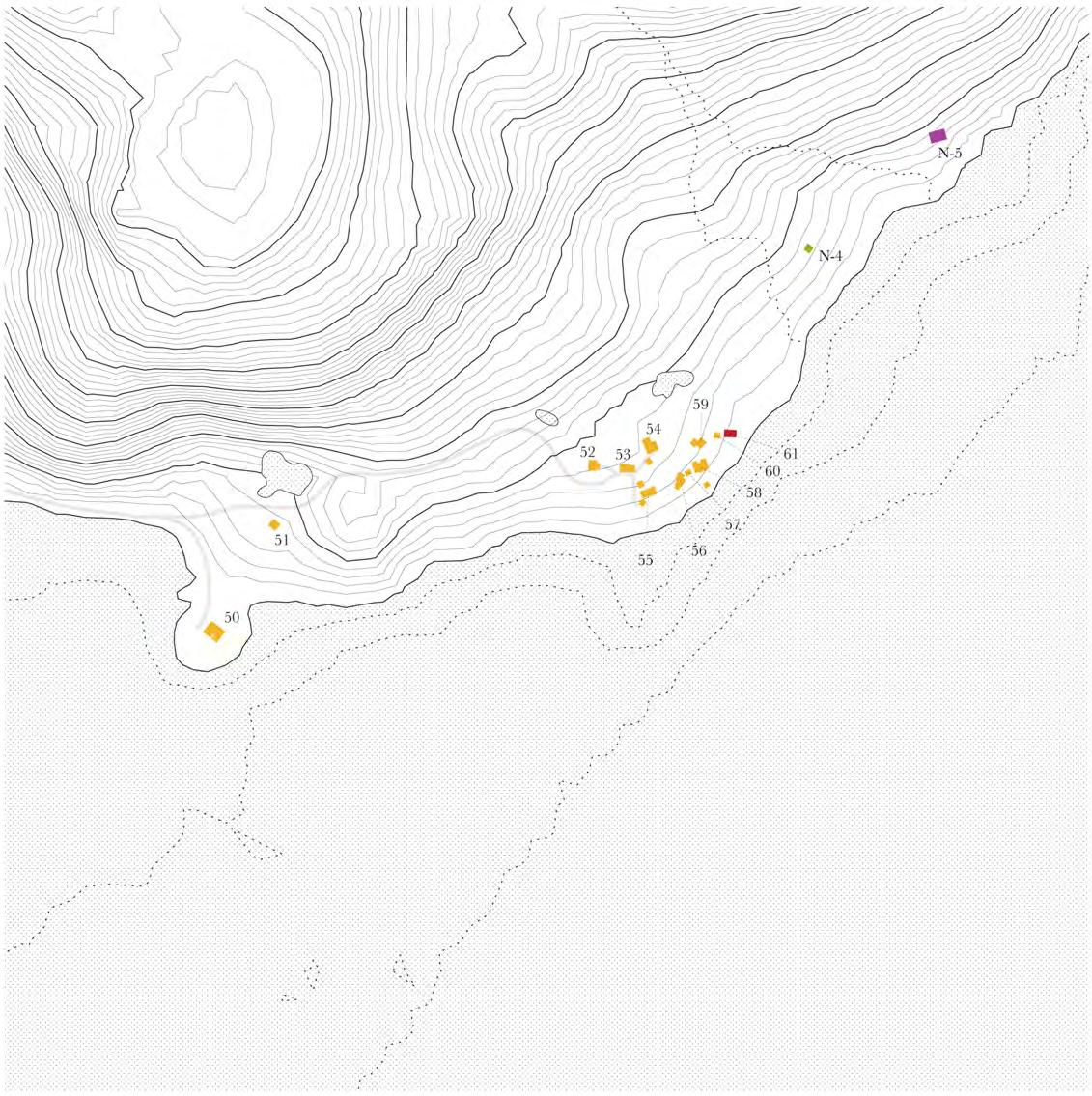
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
5.
Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
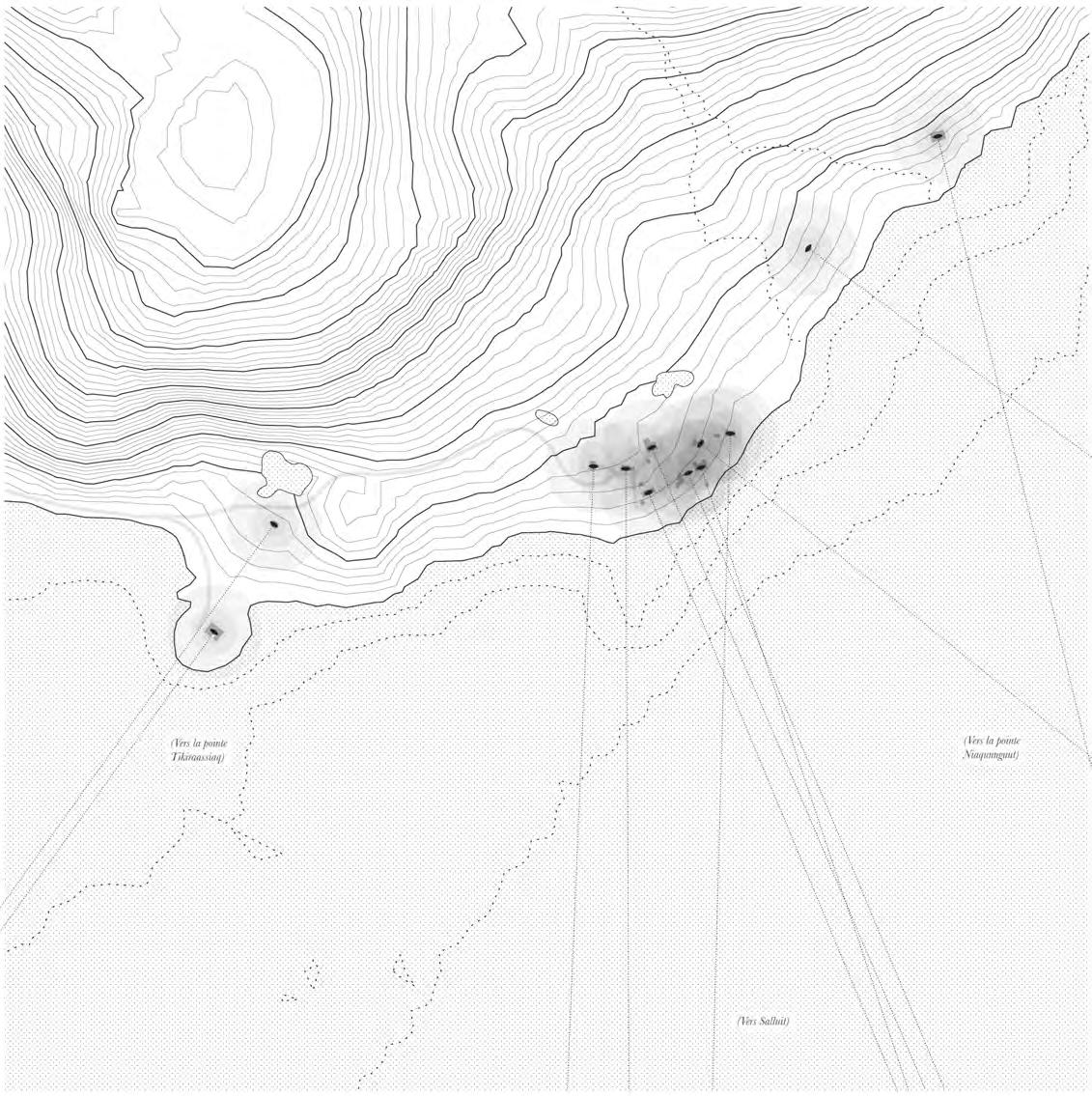
m
m
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 205
6. 40
20
Annexe 1 - page 206
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Entre Pattavik et Kisarvik 1/2 - o9
Le premier campement situé entre Pattavik et Kisarvik est composé d’une seule cabane de grande dimension (construite entre 2003 et 2015). Située sur une pointe, l’orientation de la cabane est à la fois parallèle au fjord et au sens des vents dominants.

Ce site (qui n’a pas pu être observé directement) semble relativement limité en superfcies constructibles. Même s’il s’y trouve beaucoup d’afeurements rocheux stables, ceux-ci présentent également des pentes importantes. Néanmoins, cette confguration ofre l’avantage pour la cabane qui s’y trouve de bénéfcier d’un promontoire facilement repérable au loin et sufsamment élevé pour bien observer le territoire. Il est possible par ailleurs qu’en raison
de la grande profondeur des eaux près de la côte, les animaux marins viennent à passer plus près du campement. Cela constitue un autre avantage pour les chasseurs qui ont alors de meilleures chances de les apercevoir et de les rejoindre.
L’accès au campement semble s’efectuer depuis une petite crique située légèrement à l’ouest de la cabane. Une plage d’apparence rocailleuse semble aussi praticable un peu plus loin à l’ouest. Mis à part un cours d’eau qui s’écoule au creux de baie, la présence d’une source d’eau douce à proximité du campement n’a pas été repérée. En somme, le campement regroupe quatre critères préférentiels (b.-c.-d.-f.).
Annexe 1 - page 207
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 208
1. Image satellite du campement
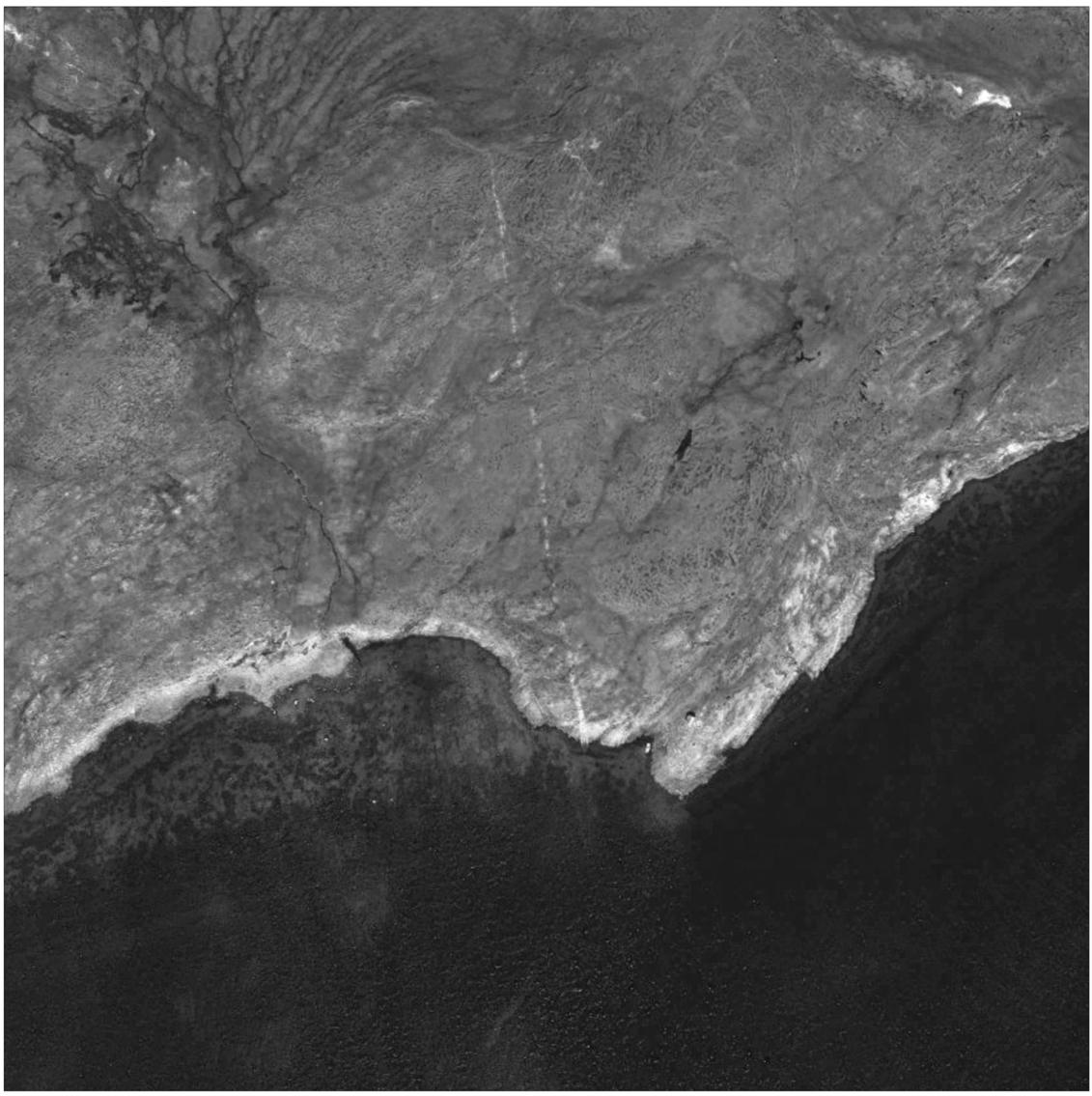
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 209


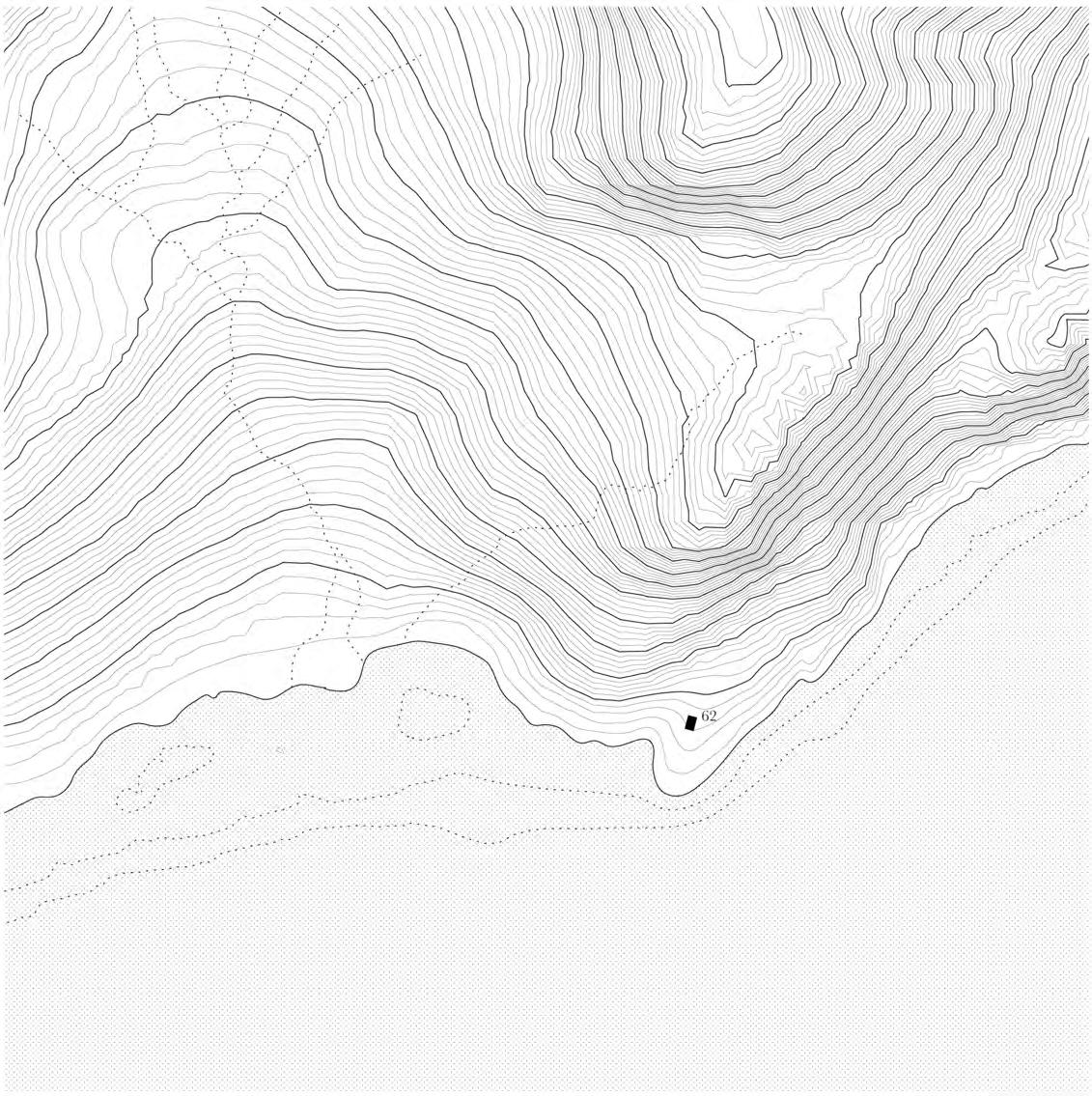
2. Cours d’eau
Annexe 1 - page 210
Instable
Classes de dépôts Dépôts de surface
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde


Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires



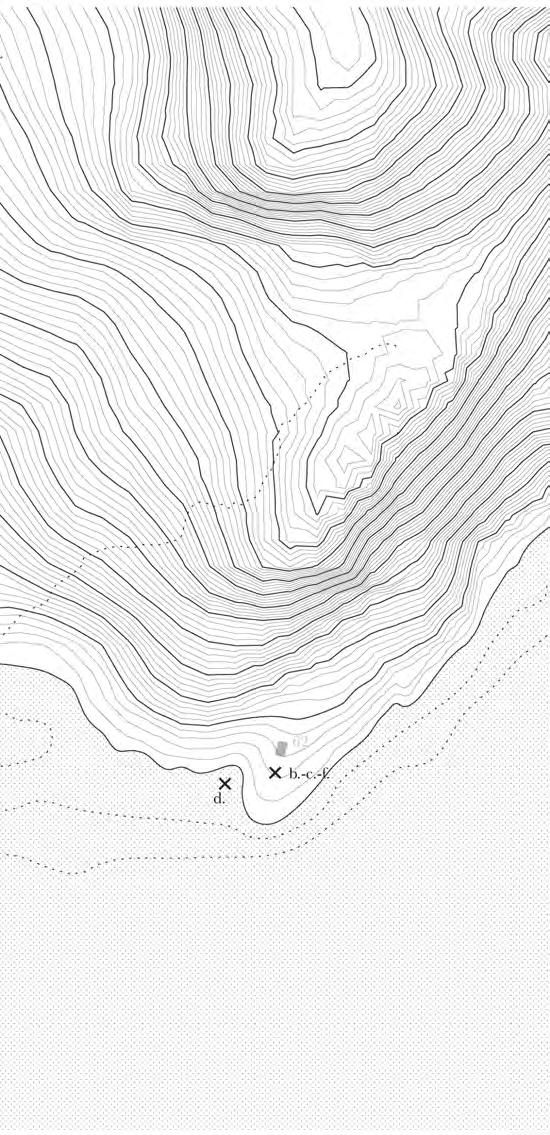
Marins Substrat rocheux Stable




Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4. 3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
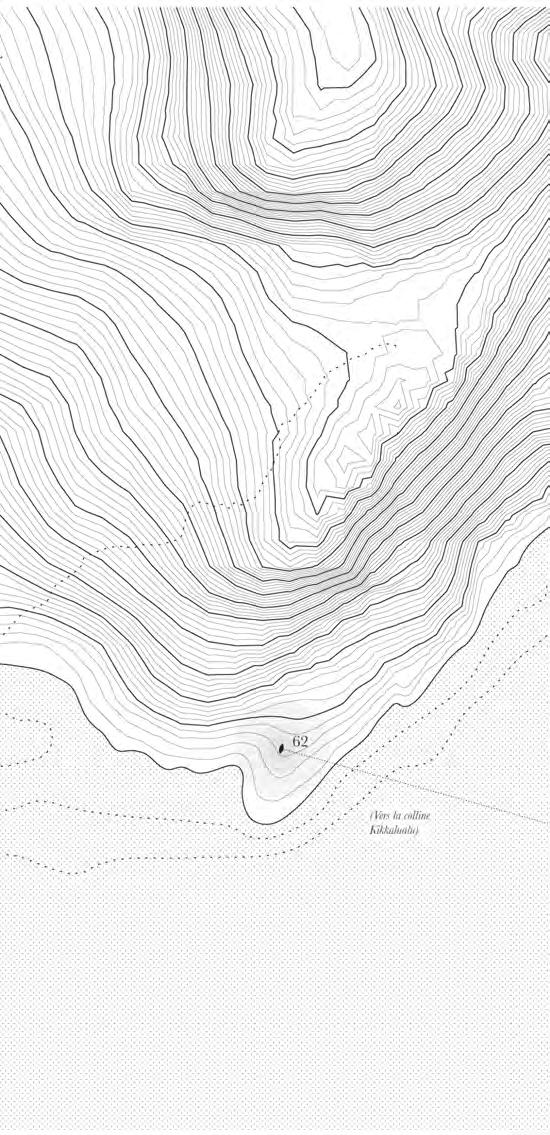
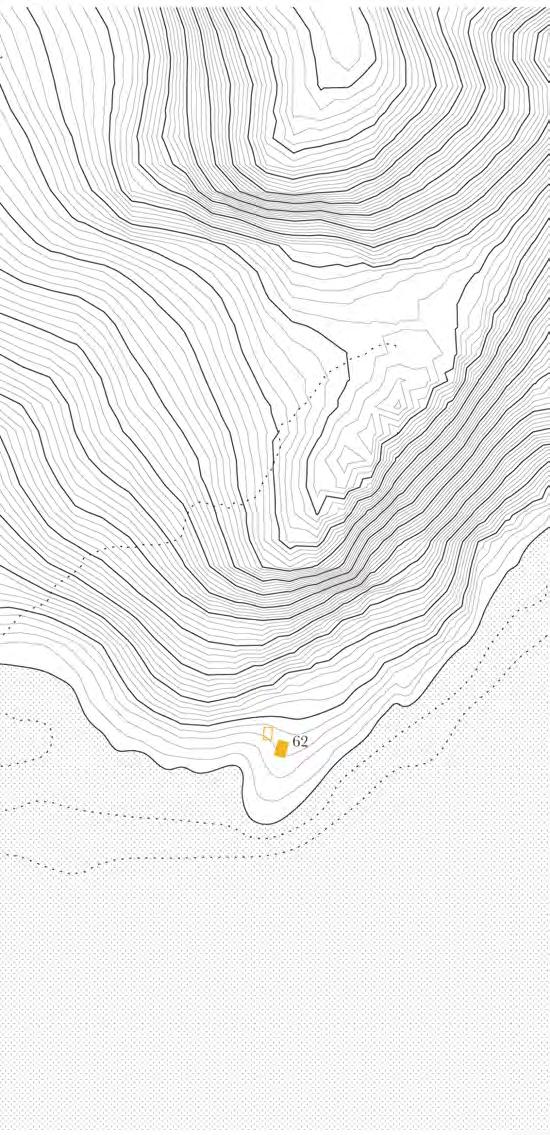
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 211
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 212
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 212
Entre Pattavik et Kisarvik (2/2) - p8
Le deuxième campement situé entre Pattavik et Kisarvik se trouve à environ un kilomètre au nord-est du premier. Deux cabanes de petite et de moyennes dimensions s’y regroupent. Elles sont bâties sur un sol essentiellement constitué d’affleurements rocheux et leur position bénéficie de points de vue privilégiés sur l’entrée du fjord de Salluit et le détroit d’Hudson. Cette position, bien que peut-être préférable pour la pratique d’activités se déroulant sur le fjord ou en mer, ne permet pas de rejoindre l’intérieur des terres facilement puisqu’une large et abrupte montagne coupe l’accès.
Depuis le fjord, le campement est accessible par une crique. En tout, seulement quatre critères préférentiels ont pu être identifiés sur ce site (b.-c.d.-f.) et il ne semble pas y avoir de plage à proximité ou de source d’eau douce.
Enfin, malgré l’absence de protection directe, les cabanes sont encore une fois orientées de façon parallèle au fjord et au sens des vents dominants du sud-ouest. Rappelons que cette orientation offre également un maximum de vues vers le large.
Annexe 1 - page 213
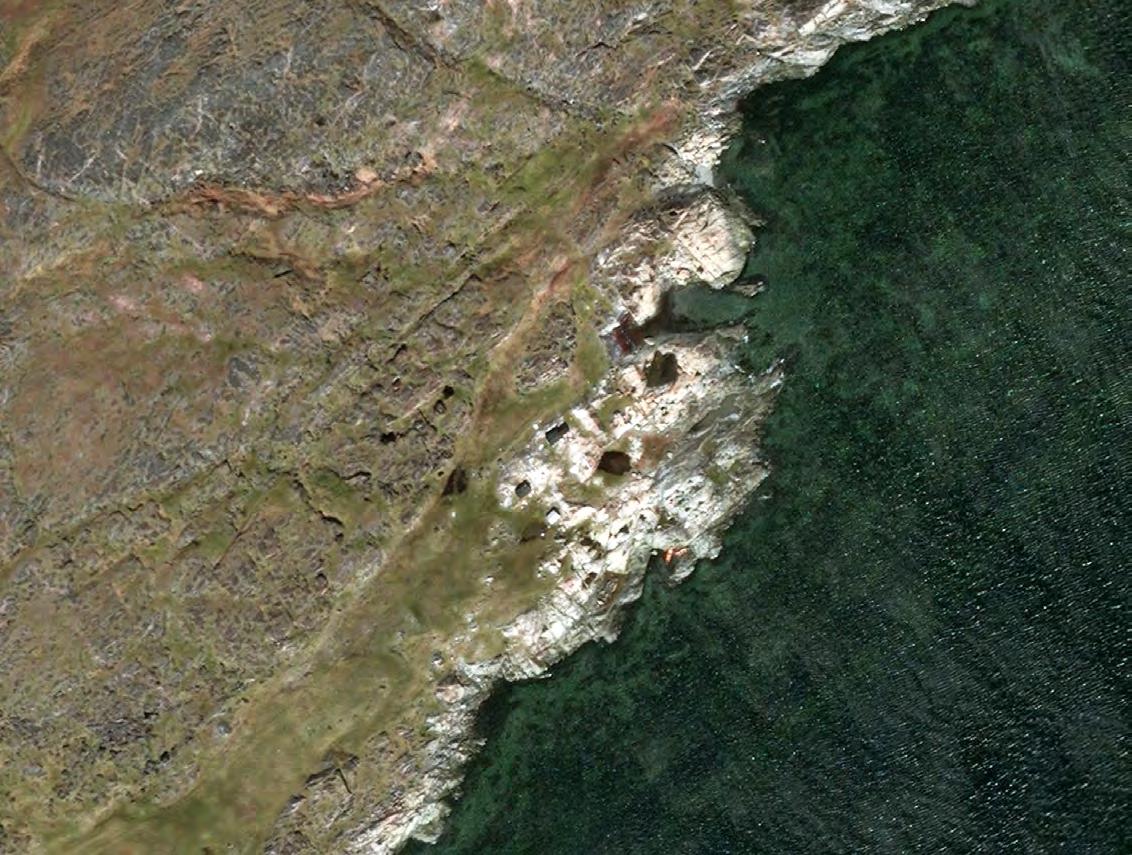 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 214
1. Image satellite du campement
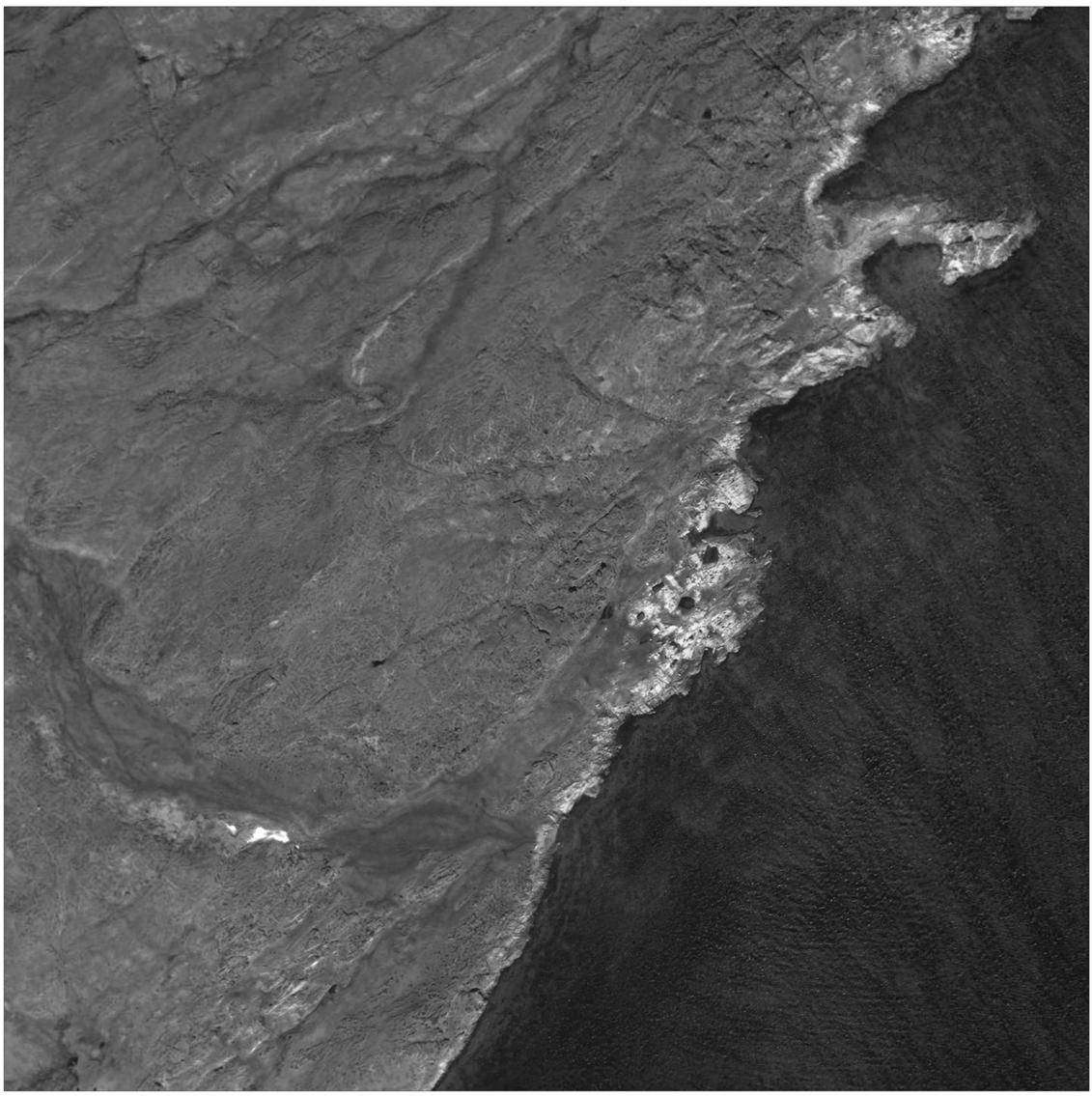
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 215


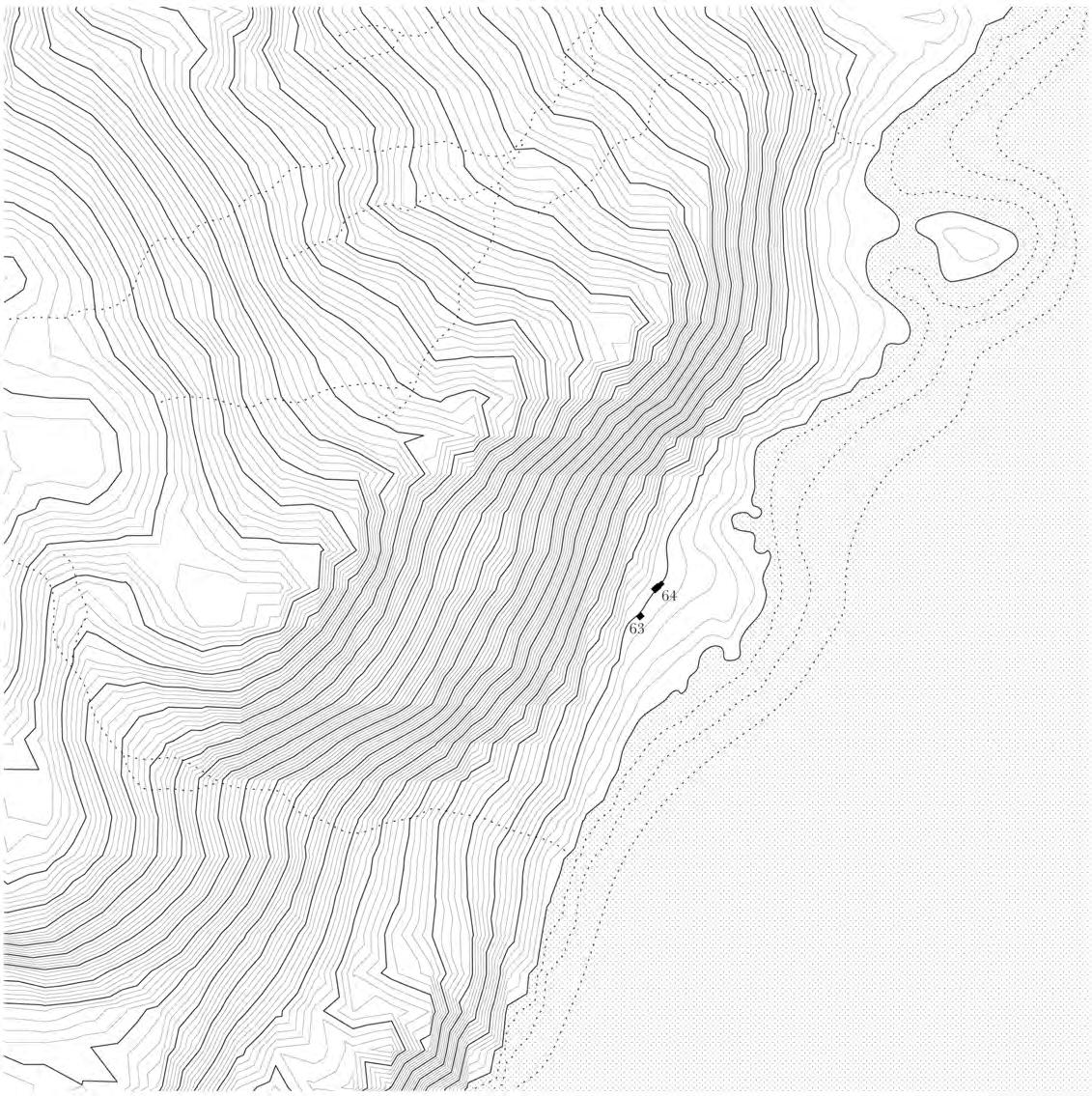
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 216
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde




Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
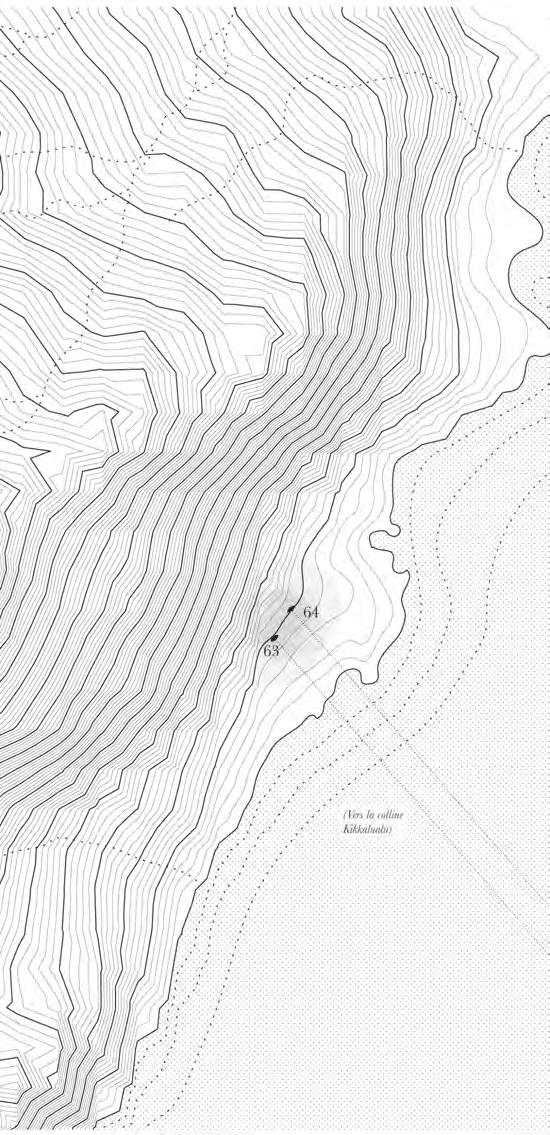

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 217
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 218
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 218
Tuapaaluit - p7
Le campement de Tuapaaluit se trouve sur la pointe sud de l’île Qikirtaq, elle-même située à l’entrée du fjord de Salluit. Quatre petites cabanes et une moyenne cabane disposées sur un sol rocheux se regroupent près de l’accès qu’ofre une petite plage. Un peu plus au nord, une autre petite cabane semble profter d’un autre point d’accès un peu plus large, mais plus exposé aux vagues en provenance du détroit d’Hudson.
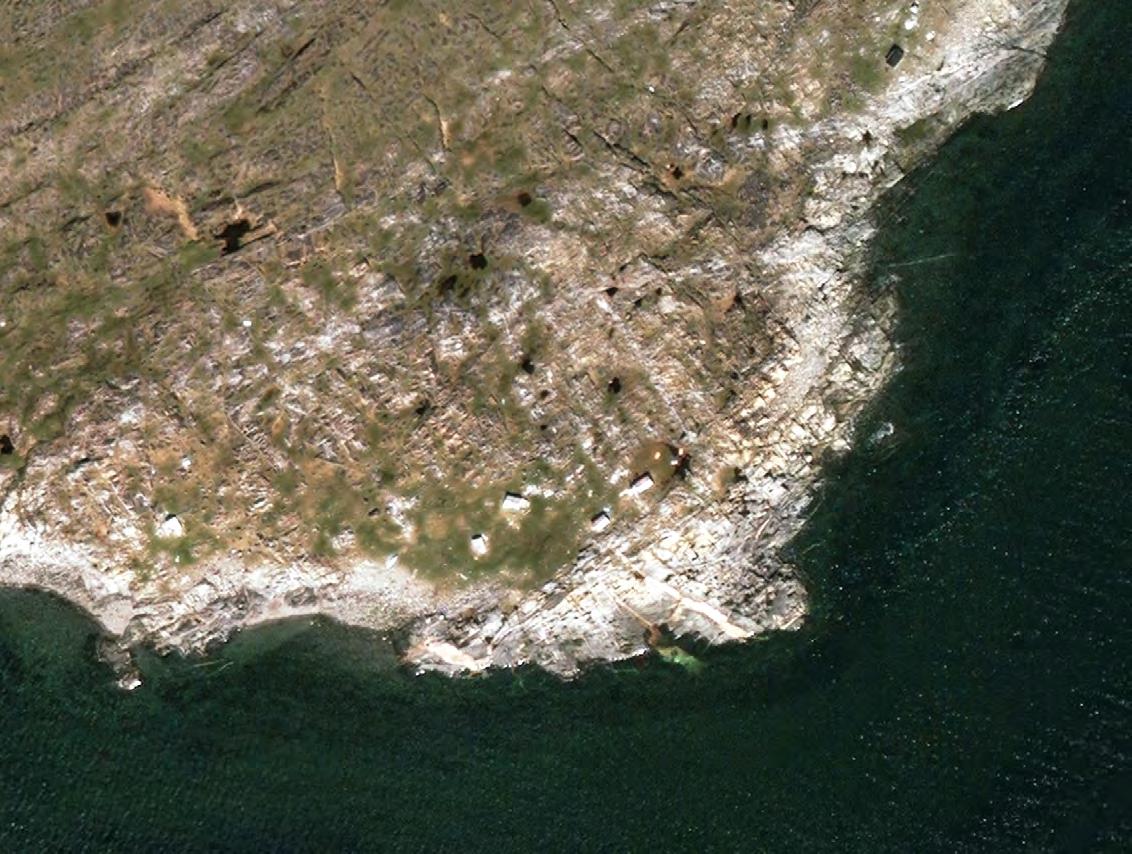
Les cabanes respectent ici encore une orientation somme toute cohérente avec l’orientation des vents qui balaient le fjord. Leur position permet également à chacune de profter de points de vue intéressants.
Comme chez les deux campements précédents, les critères préférentiels repérés sur ce site excluent une protection directe des vents ainsi que la présence d’une source d’eau douce.
Enfn, les cabanes de Tuapaaluit semblent être en place depuis plus de vingt ans. Si des rénovations ou des transformations ont pu avoir lieu, l’étroitesse du site explique peut-être pourquoi l’ajout de nouvelles cabanes n’a pas eu lieu.
Annexe 1 - page 219
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 220
1. Image satellite du campement
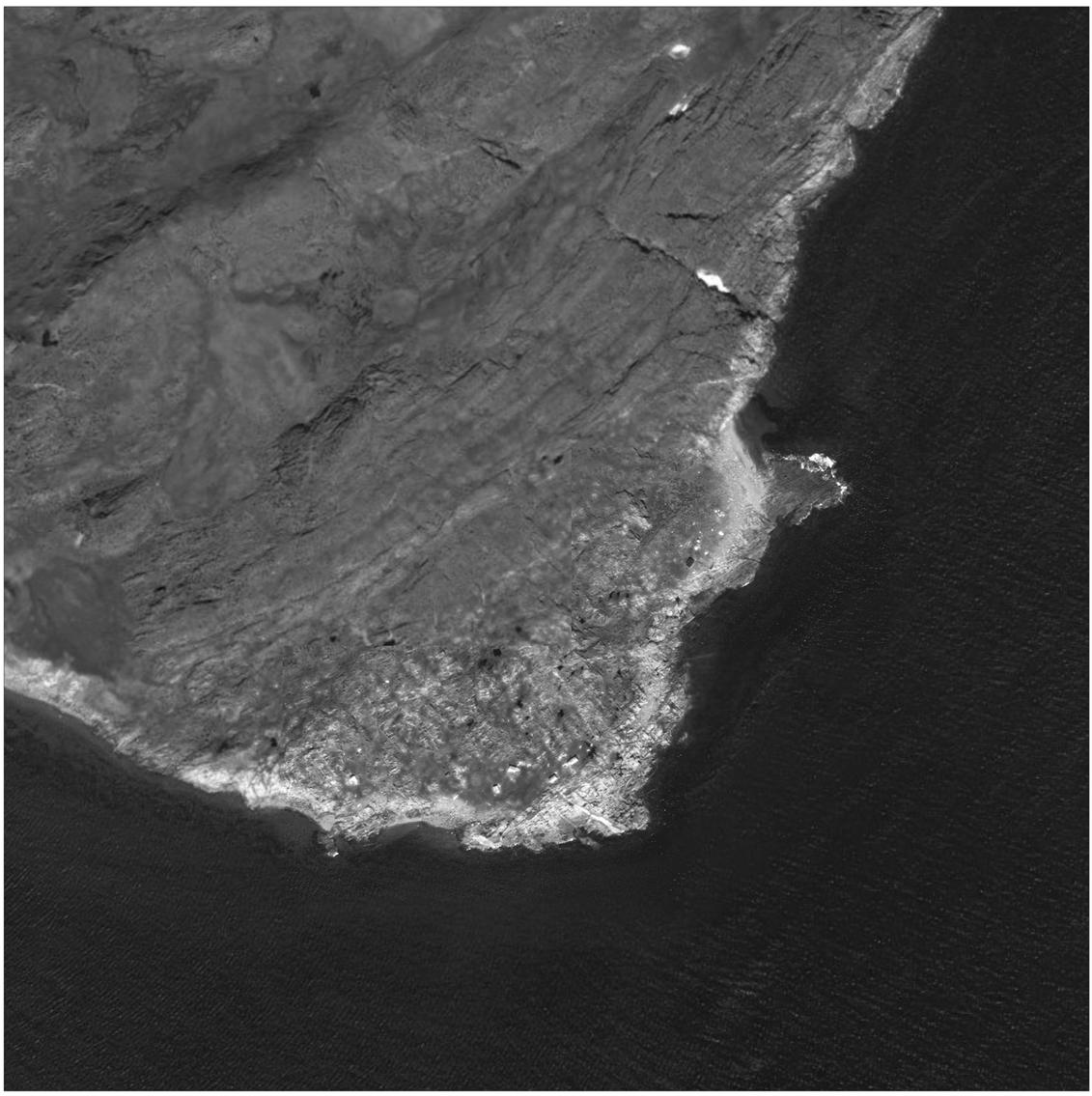
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 221


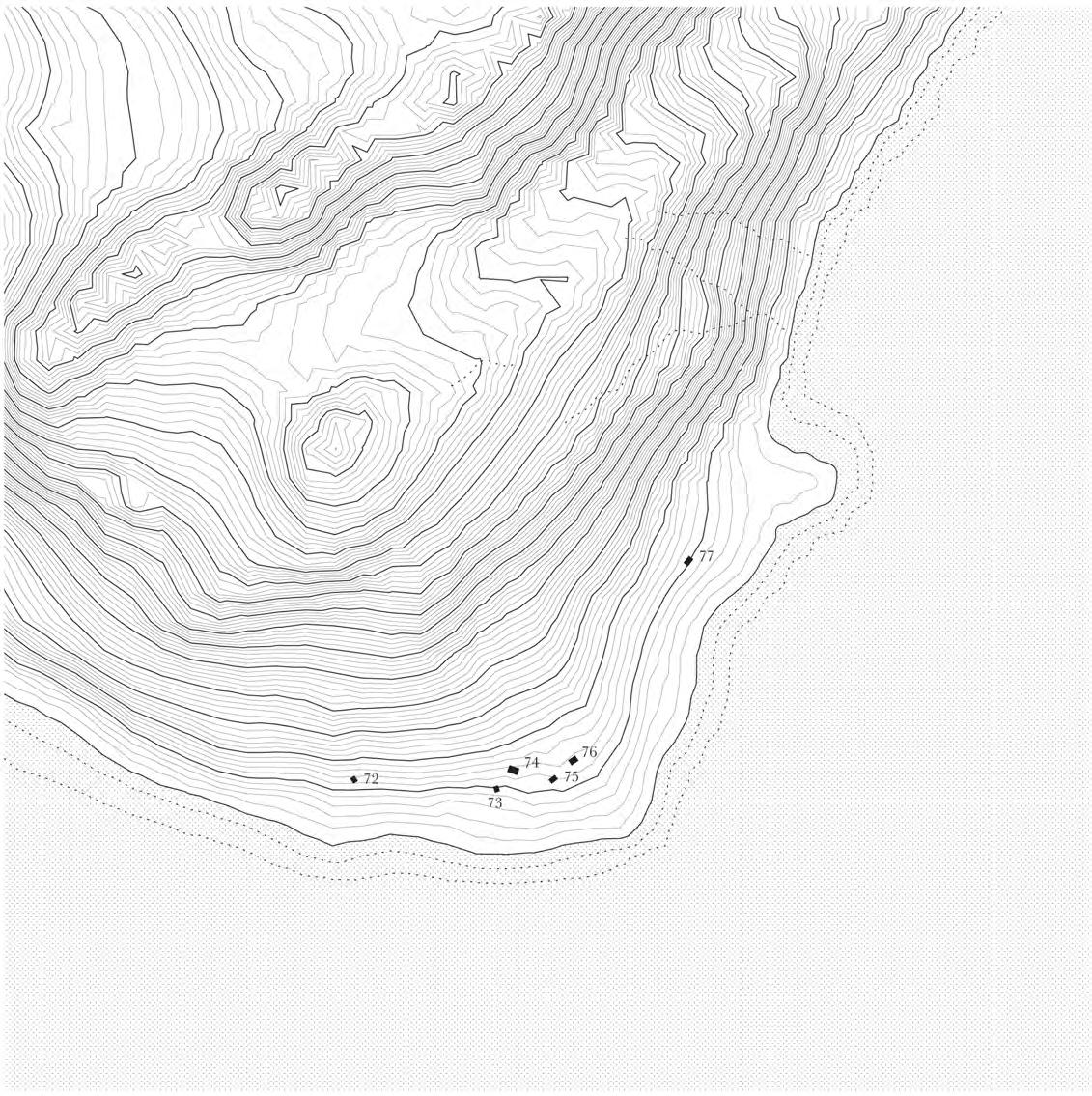
2. Cours d’eau
Annexe 1 - page 222








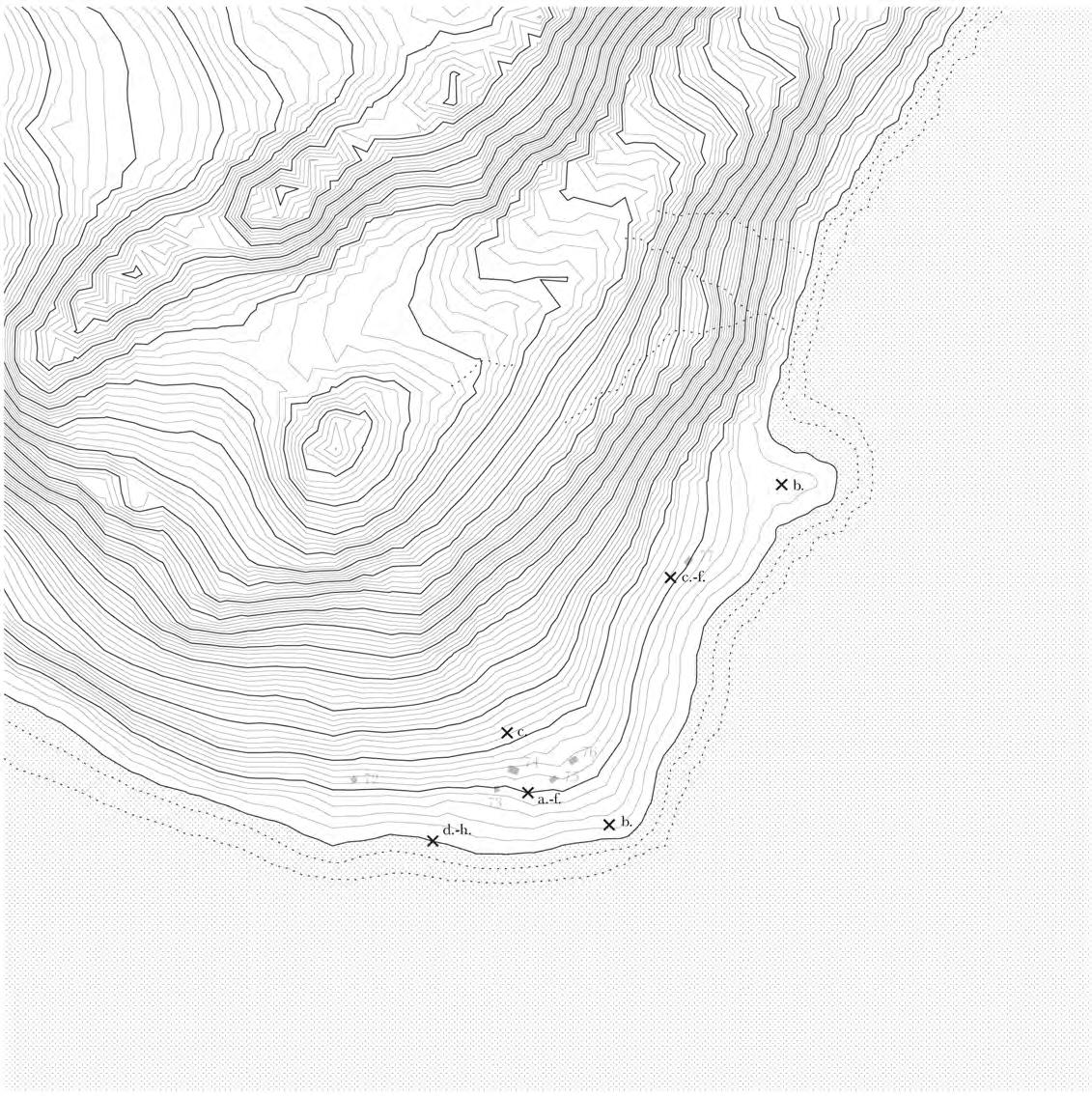 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 223
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde
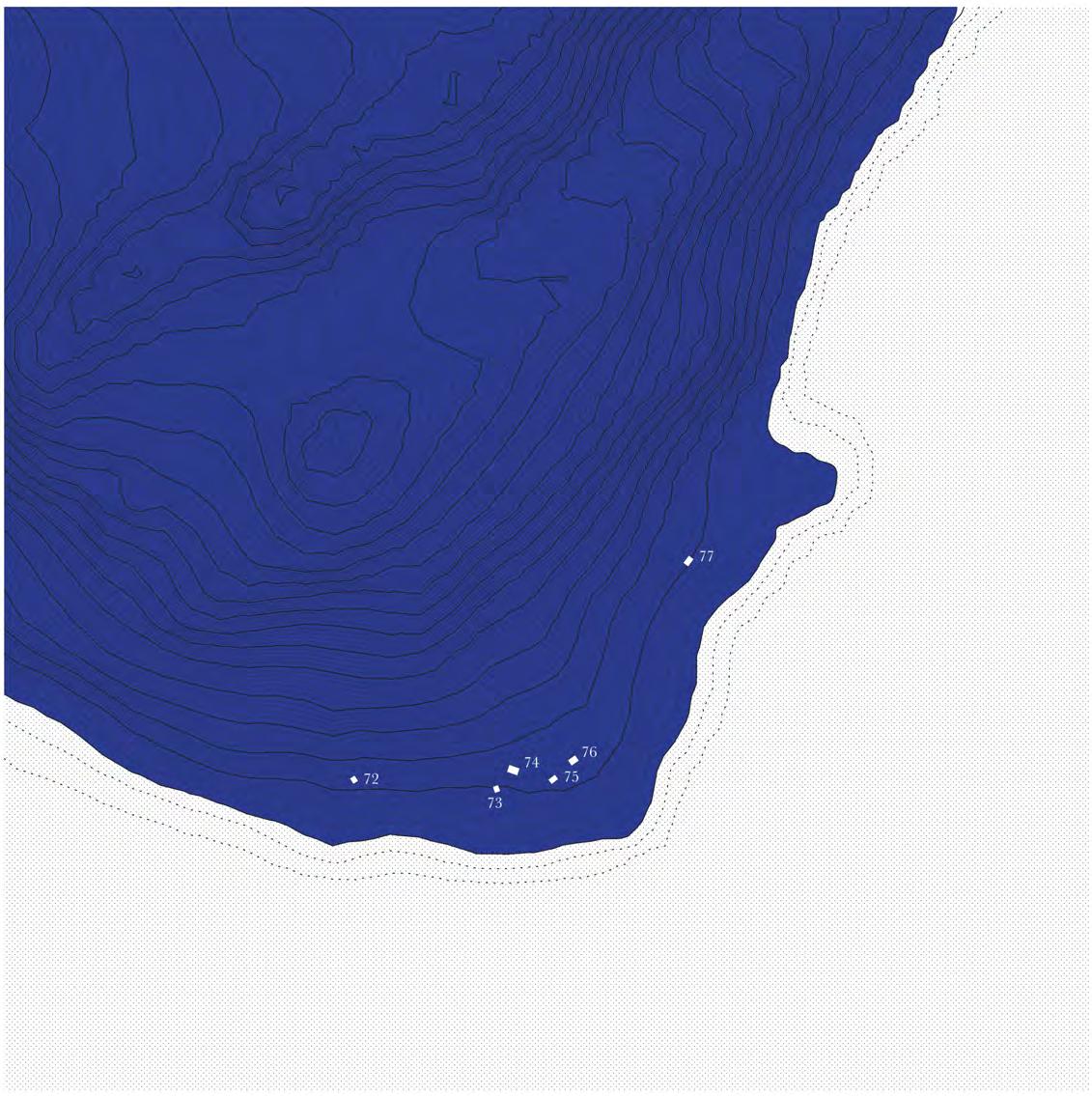
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
Annexe 1 - page 224
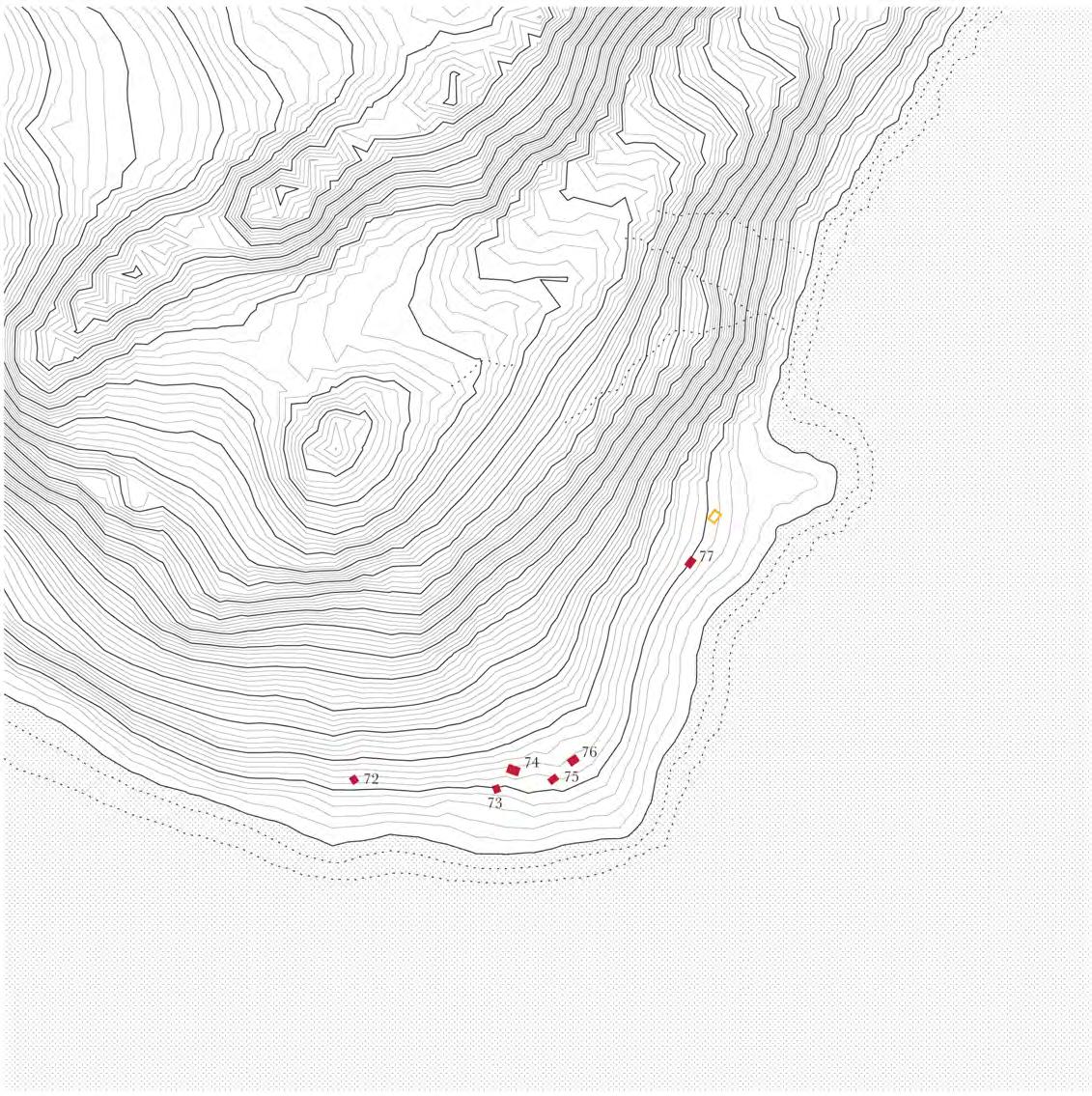
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
5.
Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
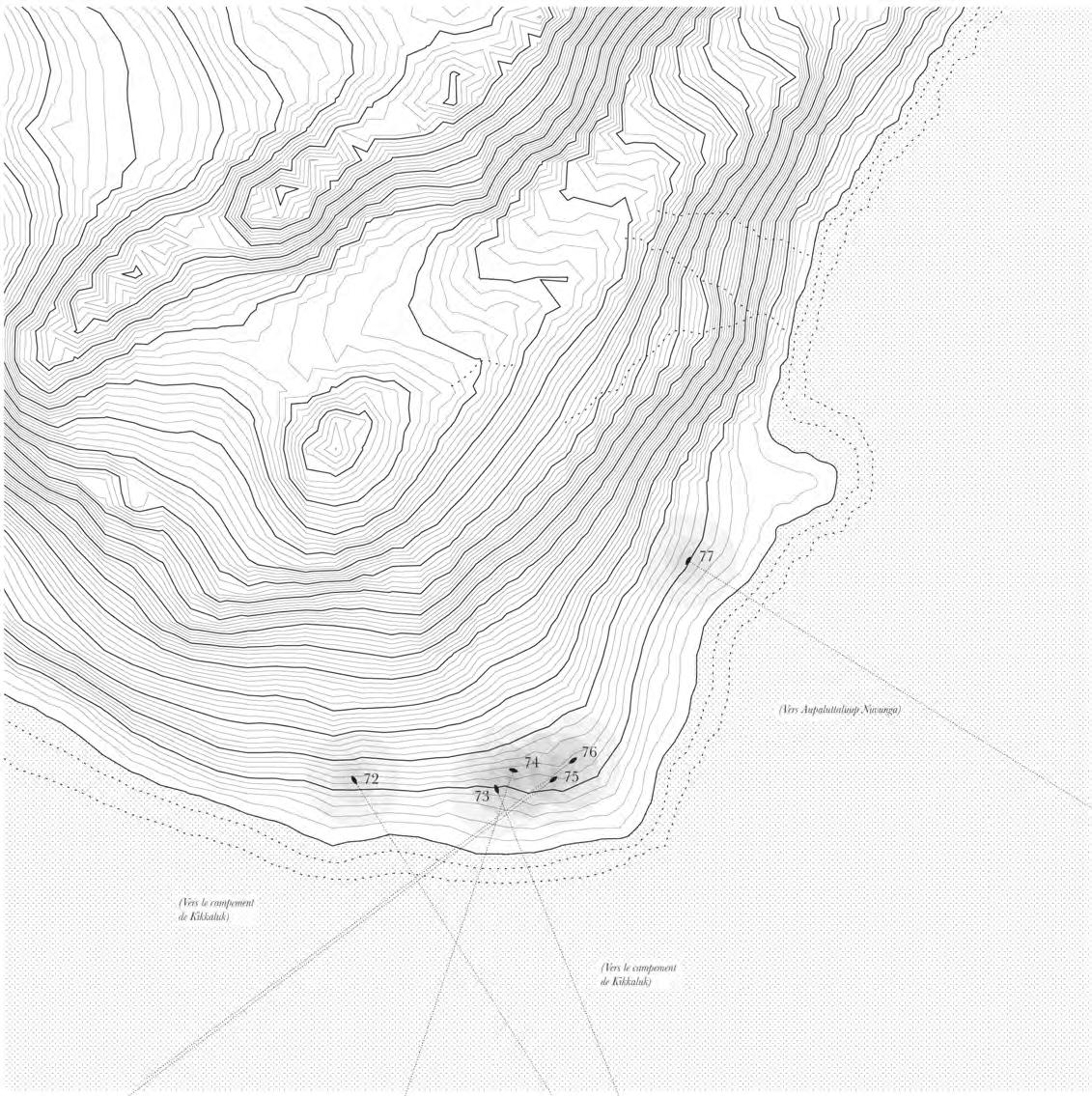
m
m
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 225
6. 40
20
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 226
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 226
Kisarvik et Qikirtaq - o7
Deux campements situés de part et d’autre de la passe Ford occupent une pointe sud de l’île Qikirtaq ainsi qu’une autre pointe à l’ouest d’un lieu de mouillage nommé Kisarvik. Bien que tous les deux situés près de l’entrée du fjord, ces campements en sont à l’extérieur et bénéfcient d’une orientation diférente de celle des autres campements étudiés jusqu’à présent.

Les quatre cabanes près de Kisarvik observent la rive dans un axe nord-est, tandis que la cabane leur faisant face sur l’île Qikirtaq regarde la rive dans un axe ouest-sud-ouest. En considérant que les vents dominants soufent toujours du sud-ouest, ces visées ainsi que l’orientation de la plupart des côtés courts des cabanes apparaissent logiques. Toutefois, l’orientation perpendiculaire à la rive du faîte de deux cabanes suggère peut-être qu’une partie des vents s’engoufre dans la passe Ford ou que (compte tenu des conditions locales) les vents
ne sont pas le facteur le plus décisif dans le positionnement des cabanes.
L’idée selon laquelle un certain rapport à la rive infuence l’orientation des cabanes semble ici prendre une plus grande importance. Cela apparait d’autant plus évident du fait que les espaces d’activités extérieures qui se rattachent aux quatre cabanes situées près de Kisarvik sont tous tournés vers le fjord, et non pas vers une quelconque forme de noyau communautaire.
Autres faits intéressants, le campement près de Kisarvik s’est agrandi de trois cabanes entre 2016 et 2017 et celui en face sur l’île de Qikirtaq semble être occupé à l’occasion par de nombreuses tentes octogonales. En somme, les deux campements présentent une majorité de critères préférentiels.
Annexe 1 - page 227
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 228
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 229


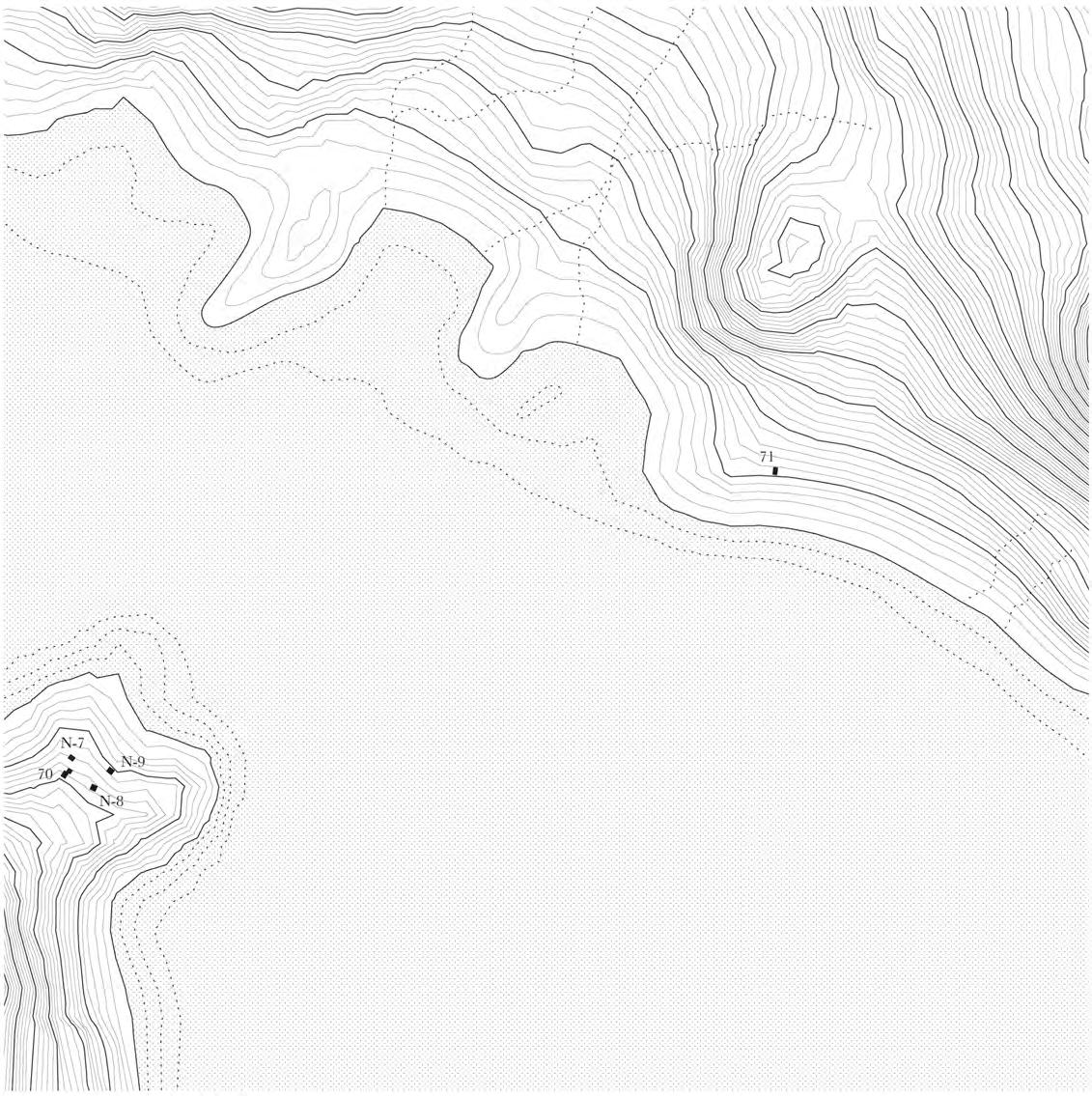 2.
Cours d’eau
Passe Ford
Fjord de Salluit
2.
Cours d’eau
Passe Ford
Fjord de Salluit
Annexe 1 - page 230


Fjord de Salluit






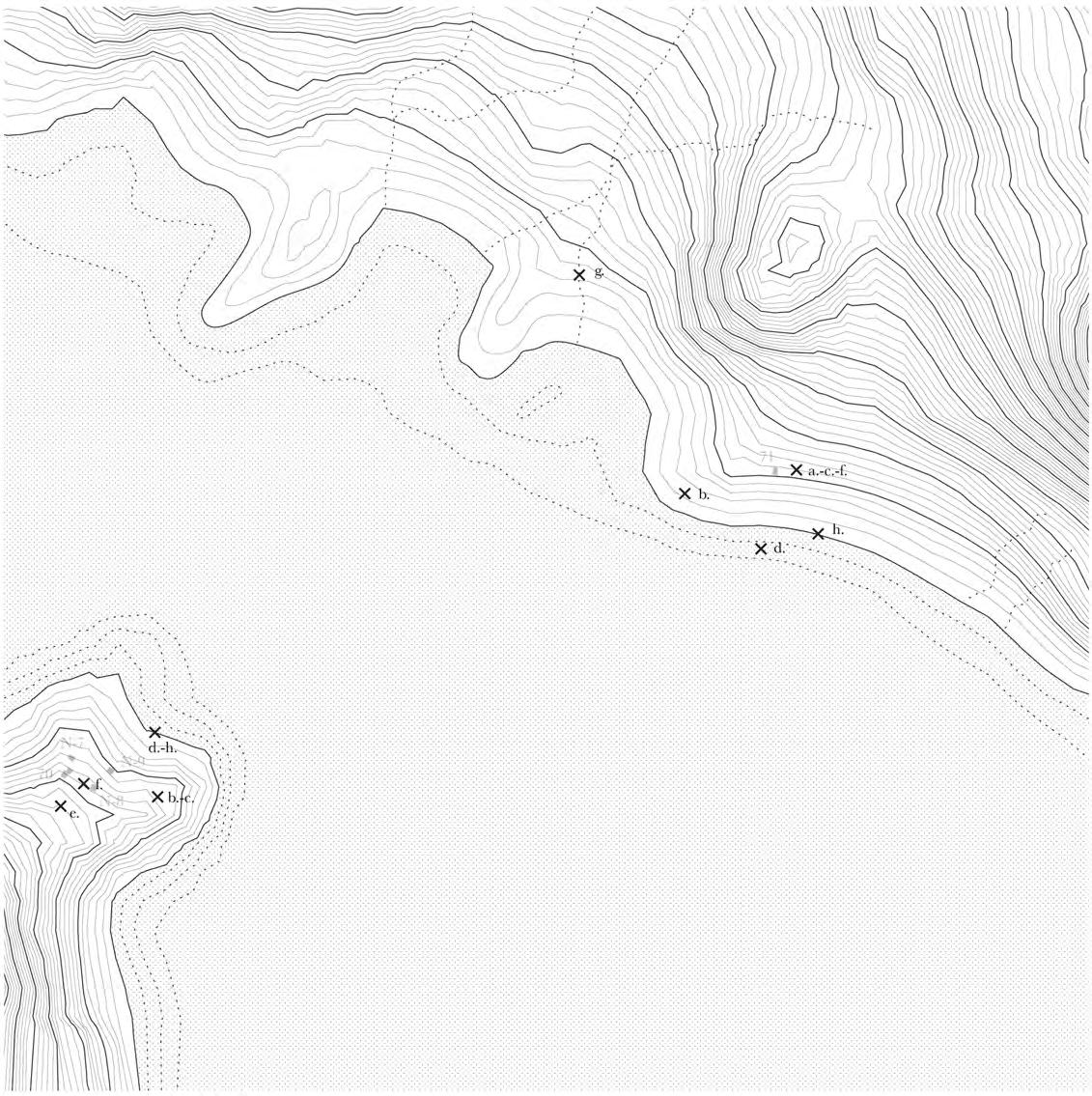 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Passe Ford
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Passe Ford
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 231
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde
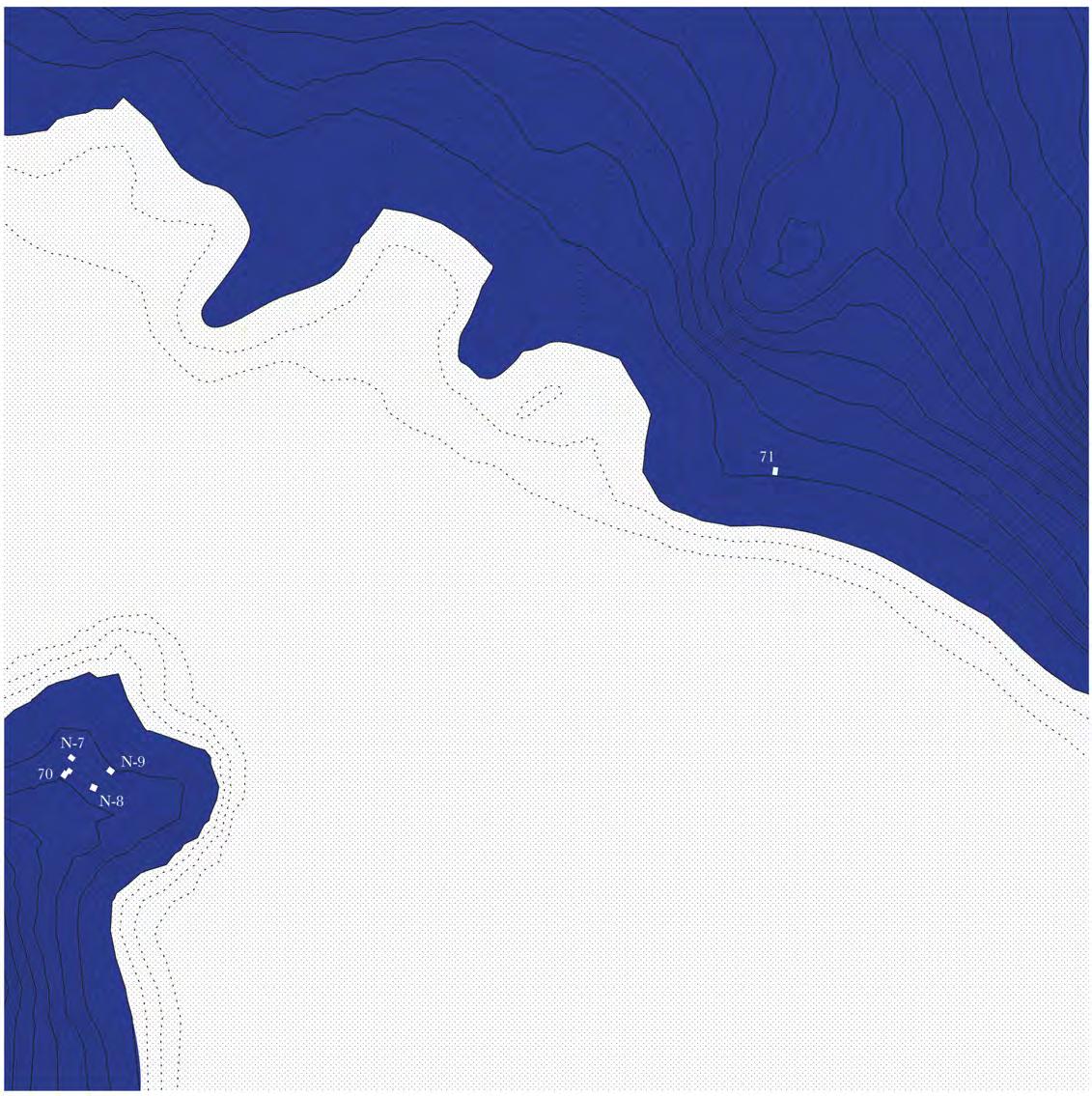
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
Passe Ford
Fjord de Salluit
Annexe 1 - page 232
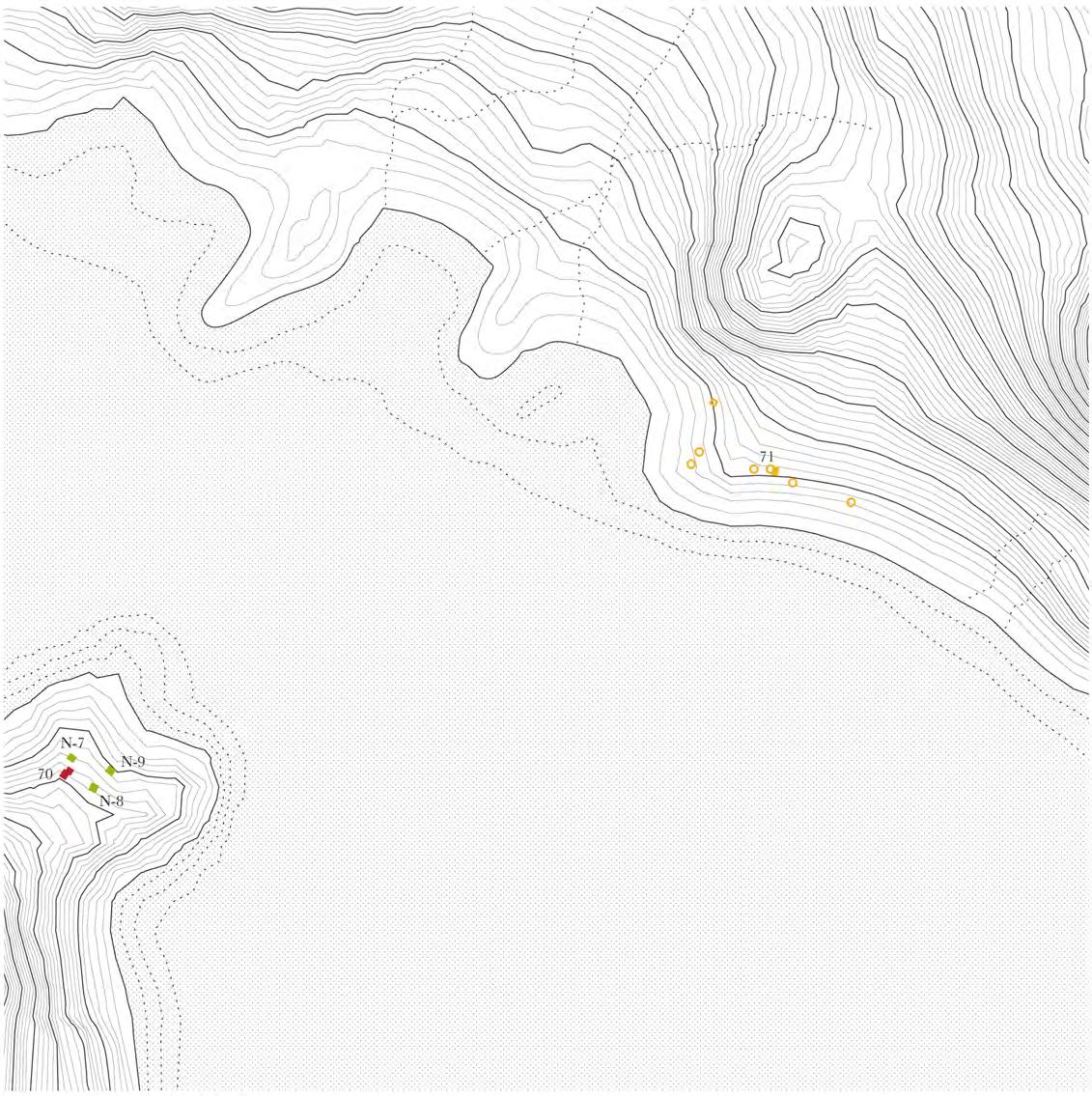
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
Ford Fjord de Salluit
5.
Passe
Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
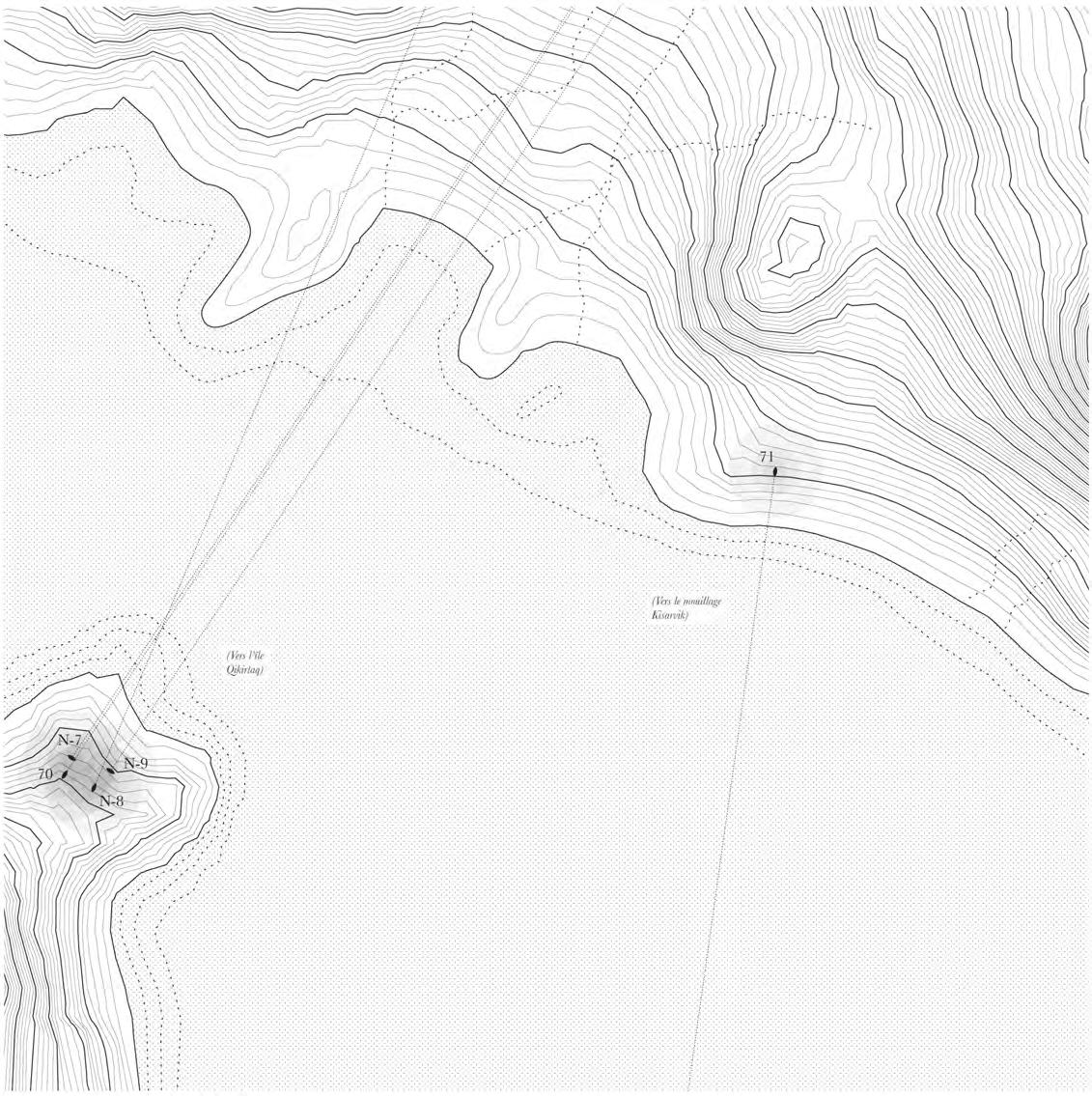
m
m
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 233
6. 40
20
Passe Ford
Fjord de Salluit
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 234
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 234
Entre Kisarvik et Ilijjaaqait - m7 - n7
Les deux campements situés entre Kisarvik et la baie Ilijjaaquait comportent chacun trois cabanes. Ces campements situés à l’extérieur du fjord de Salluit sont, dans un cas, bâti sur un afeurement rocheux et, dans l’autre, sur un dépôt marin.

Chacun bénéfcie d’accès favorables depuis la rive ou vers l’intérieur du territoire et un maximum de critères préférentiels se regroupent dans chacun des deux secteurs. L’orientation de toutes les cabanes de ces campements apparait aussi conséquente de l’origine des vents du sud-ouest qui ici pourrait tout aussi bien descendre des vallées.
Selon la morphogénèse des campements, il est intéressant de remarquer que les cabanes plus au sud (bâties sur un dépôt meuble) étaient autrefois cinq ou six. À l’inverse, l’autre campement (bâti sur le roc) s’est récemment agrandi par l’ajout d’une cabane. Ainsi, et puisqu’un phénomène relativement semblable s’observe au sein des autres campements, il semble que, par rapport aux plus anciennes, les cabanes les plus récentes tendent à se construire sur des sols, plus élevés, plus stables et donc plus éloignés des berges.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 235
Annexe 1 - page 236
1. Image satellite du campement
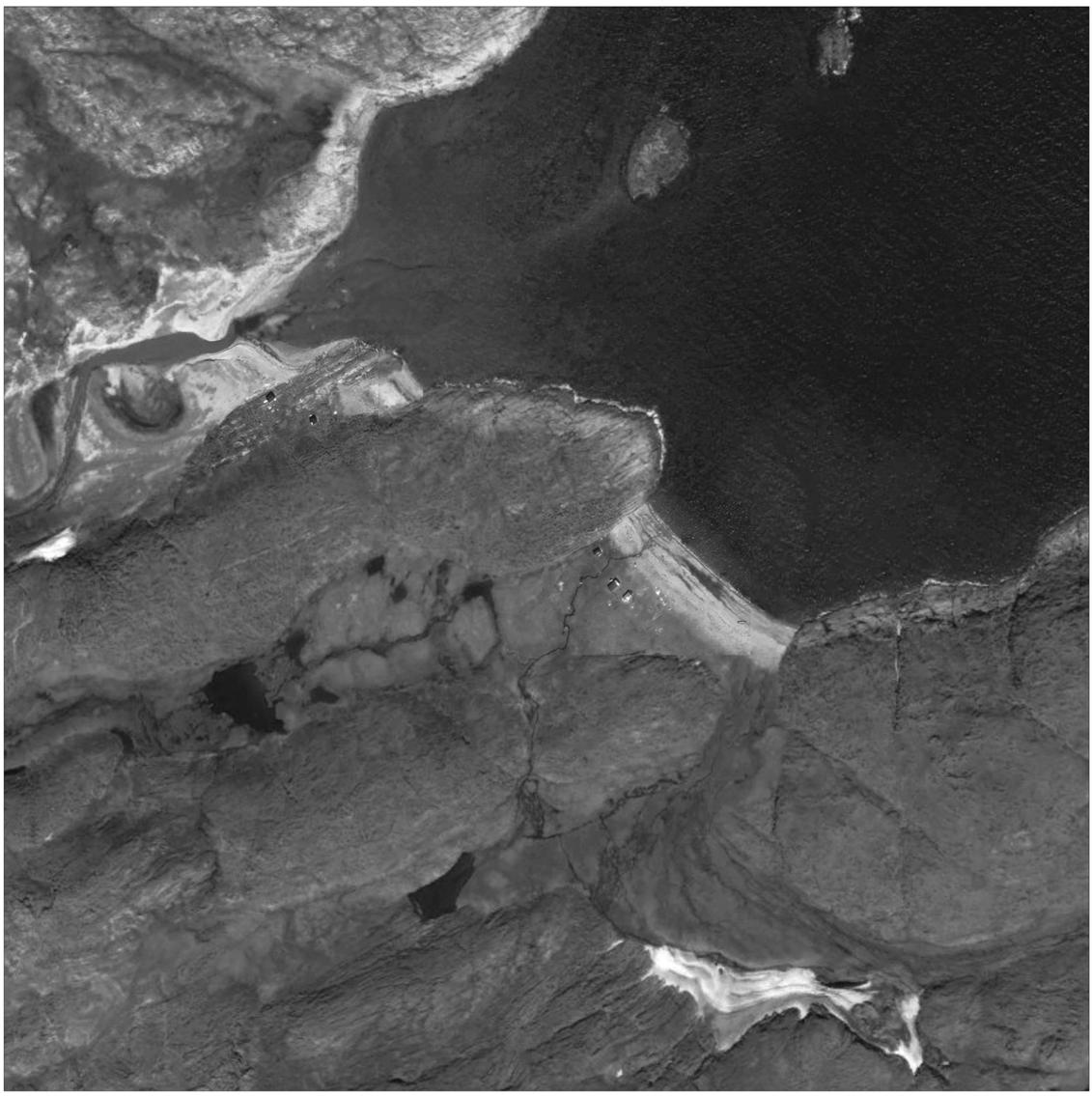
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 237


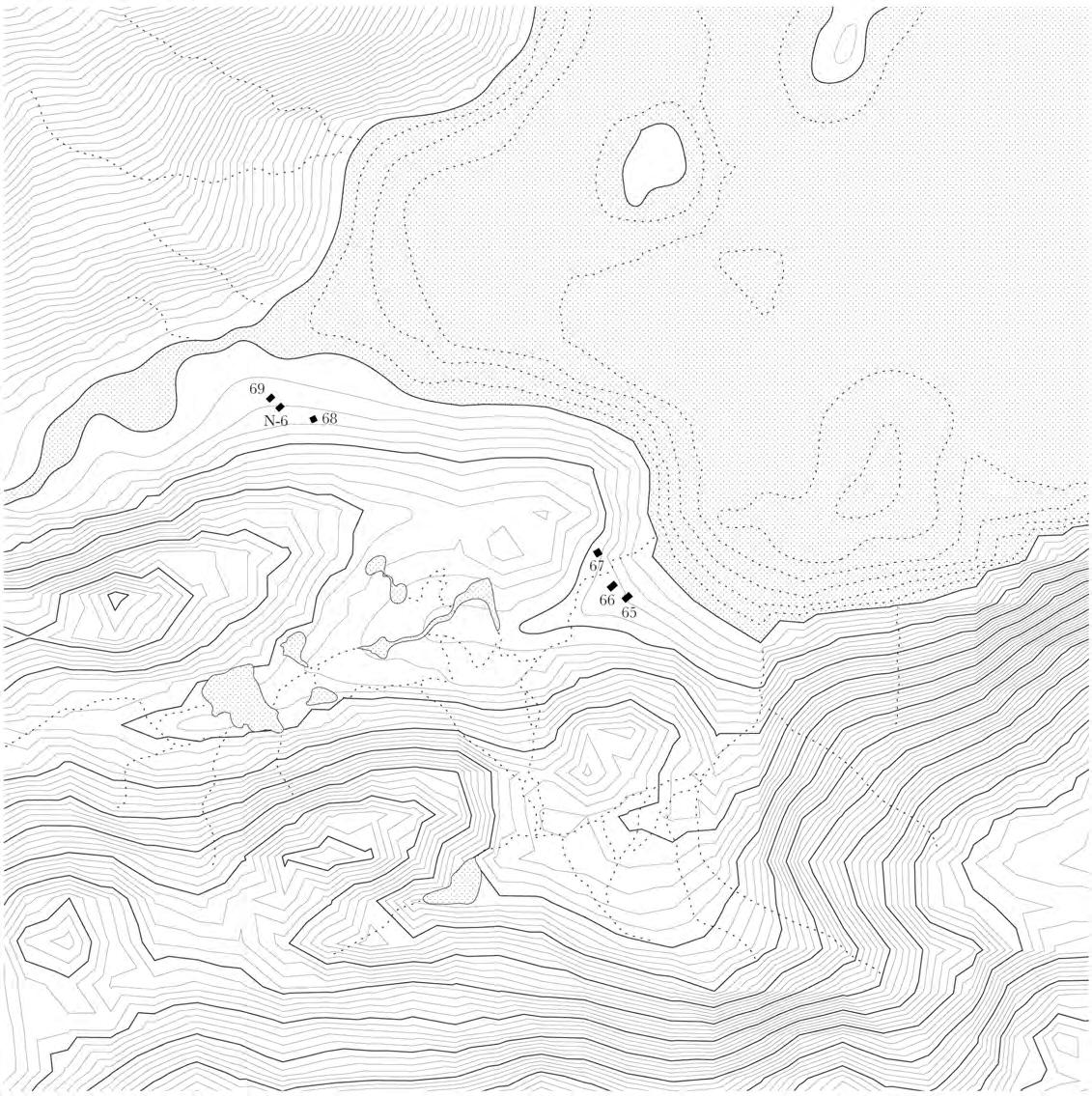
2. Cours d’eau
Annexe 1 - page 238








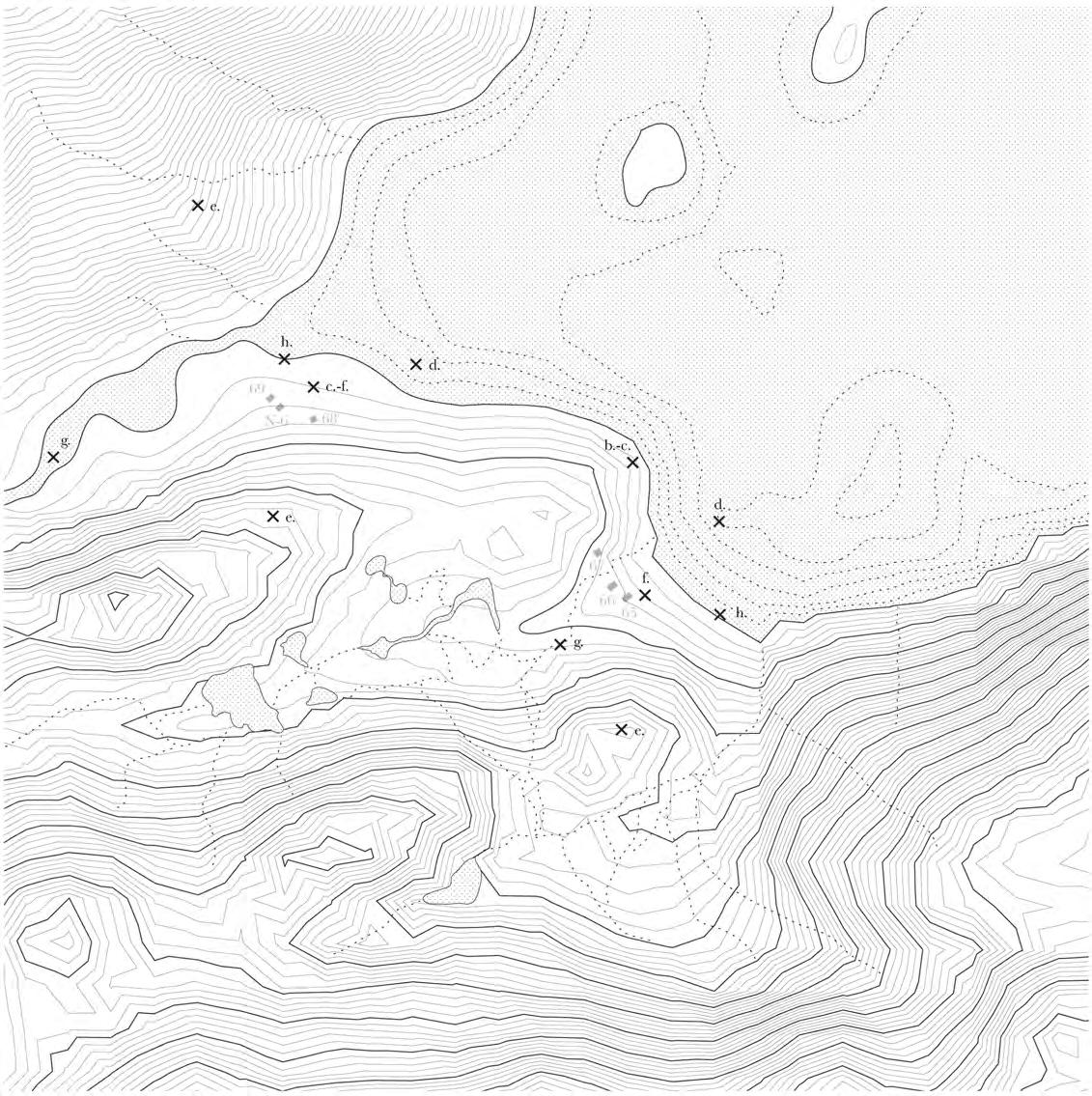 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 239
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde
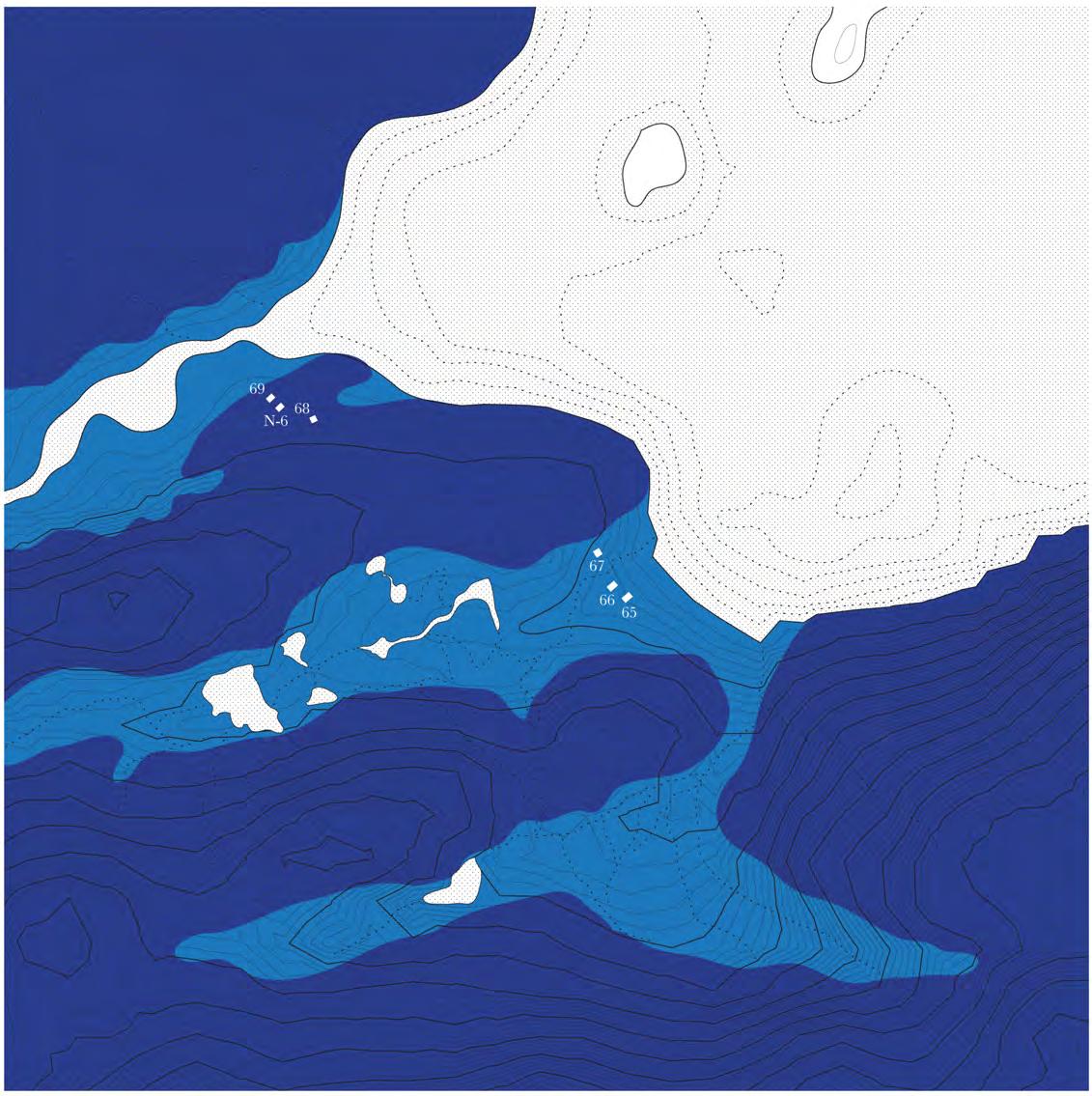
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
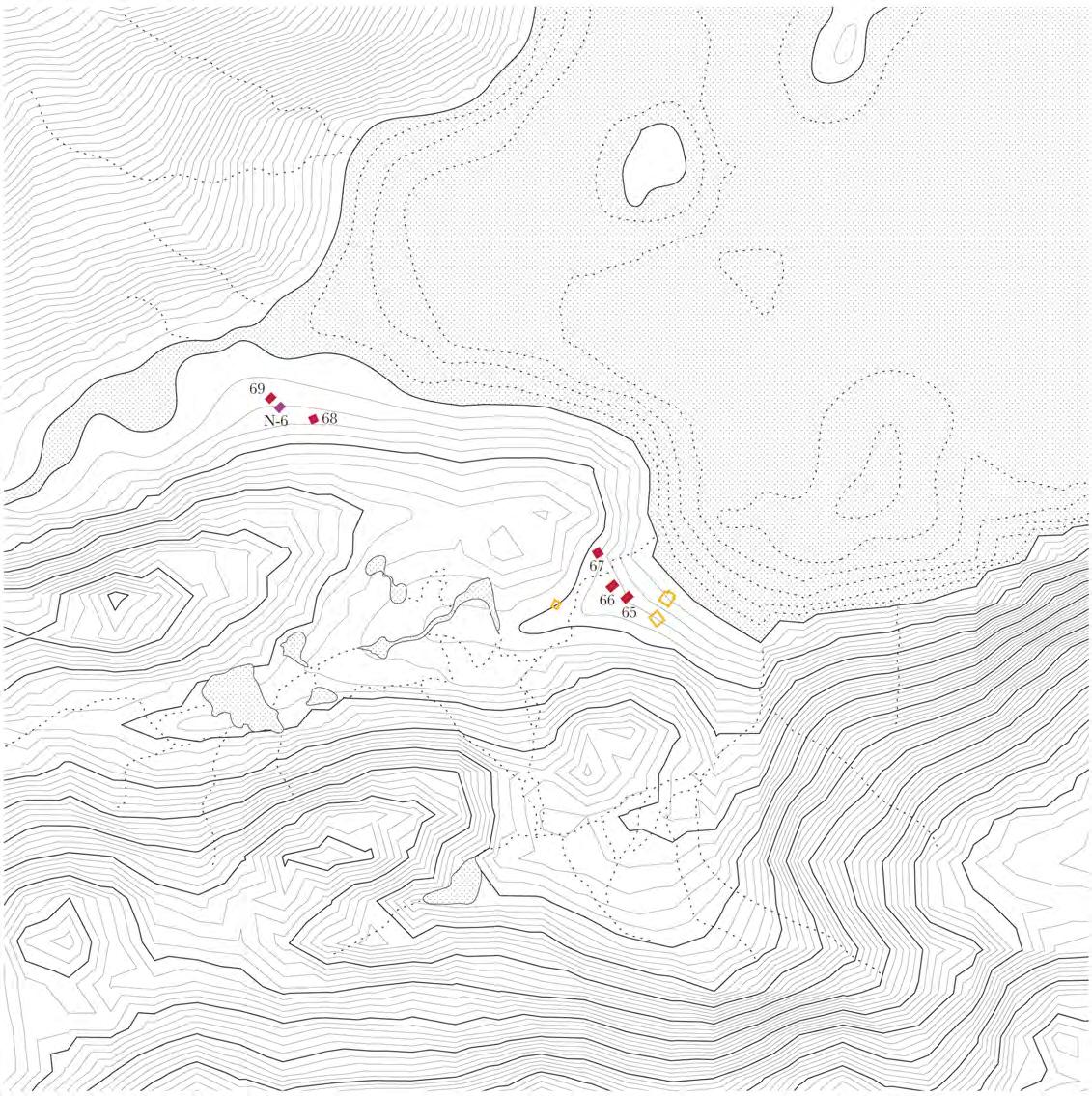
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019 Annexe 1 - page 240
5.
Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
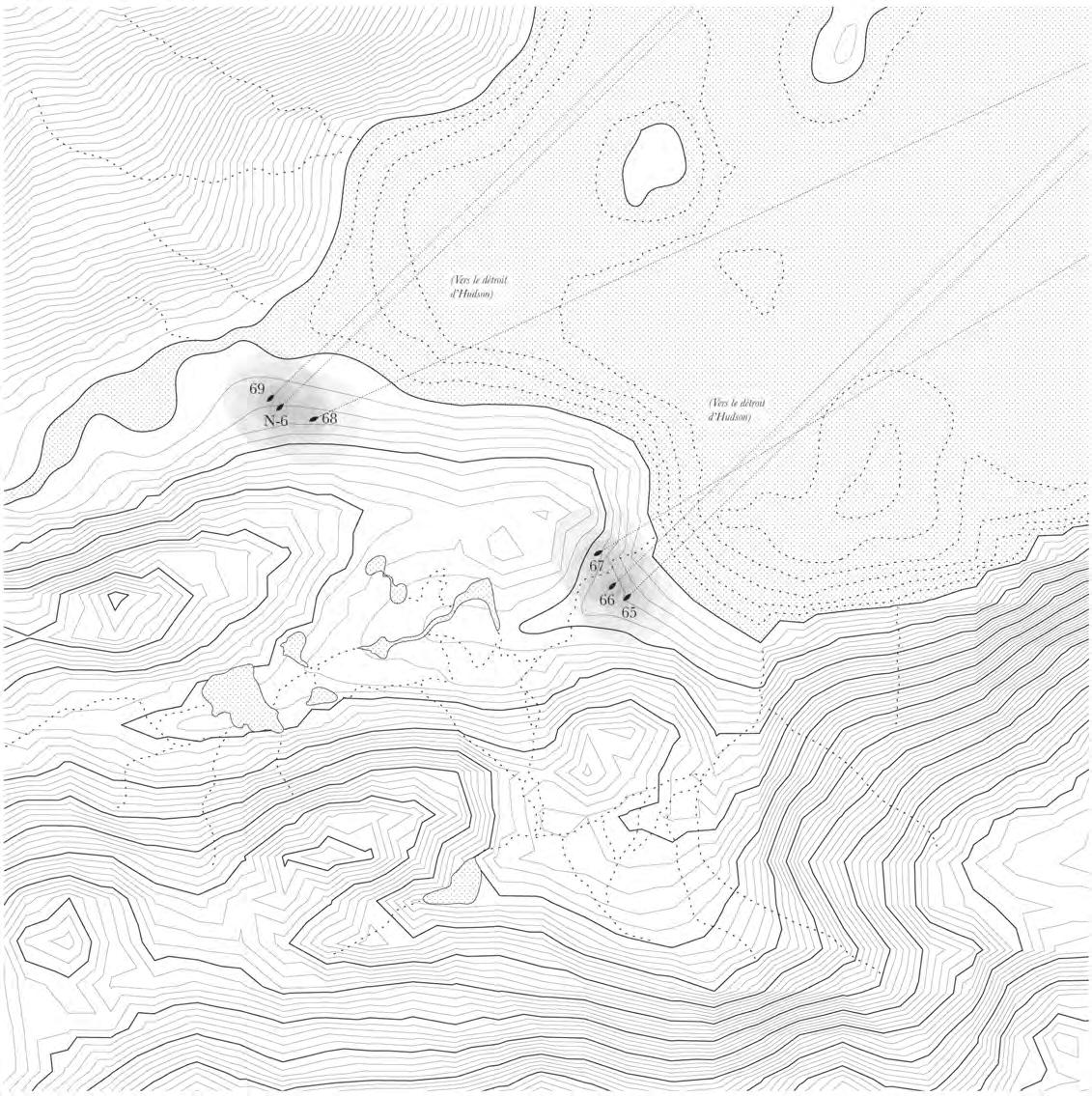
m
m
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 241
6. 40
20
Annexe 1 - page 242

Demeule, août 2018
Kikkaluk - q9 - q10
Le campement de Kikkaluk fait face à l’île Qikirtaq et se trouve à l’entrée du fjord (sur sa rive sud). Il rassemble un maximum de critères préférentiels et compte pas moins de huit cabanes pour la plupart assez grandes et différentes les unes des autres en raison de leur forme et de leur configuration.

La moitié des cabanes de Kikkaluk sont construites sur un affleurement rocheux, tandis que les autres se retrouvent sur des dépôts meubles. De plus, les cabanes qui occupent un affleurement rocheux près de la rive et légèrement surélevé sont relativement récentes, tandis que celles qui se retrouvent plus bas et plus près de la plage semblent plus anciennes.
D’autres cabanes aujourd’hui démolies auraient autrefois occupé le creux de la vallée.
Protégées par des montagnes situées au sud-ouest du campement, les cabanes de Kikkaluk sont orientées de façon à minimiser l’impact des vents qui descendent par une vallée située au sud. Chaque cabane bénéficie également d’une vue importante et d’un rapport privilégié au fjord.
Enfin, si Kikkaluk est avant tout accessible par canot, un sentier de VTT, et possiblement de motoneige, permet de rejoindre Salluit.
Annexe 1 - page 243
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 244
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 245


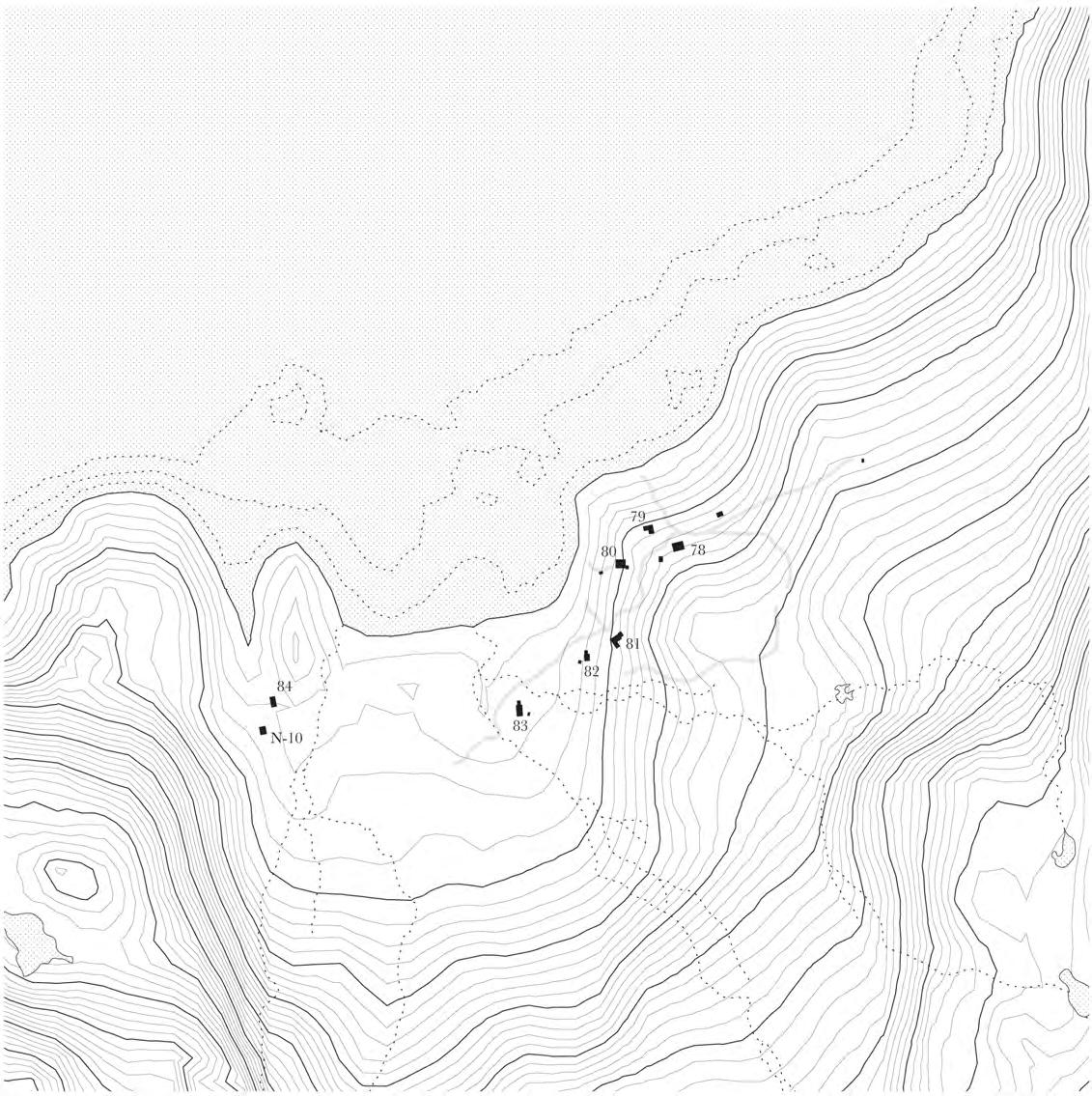 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
Annexe 1 - page 246








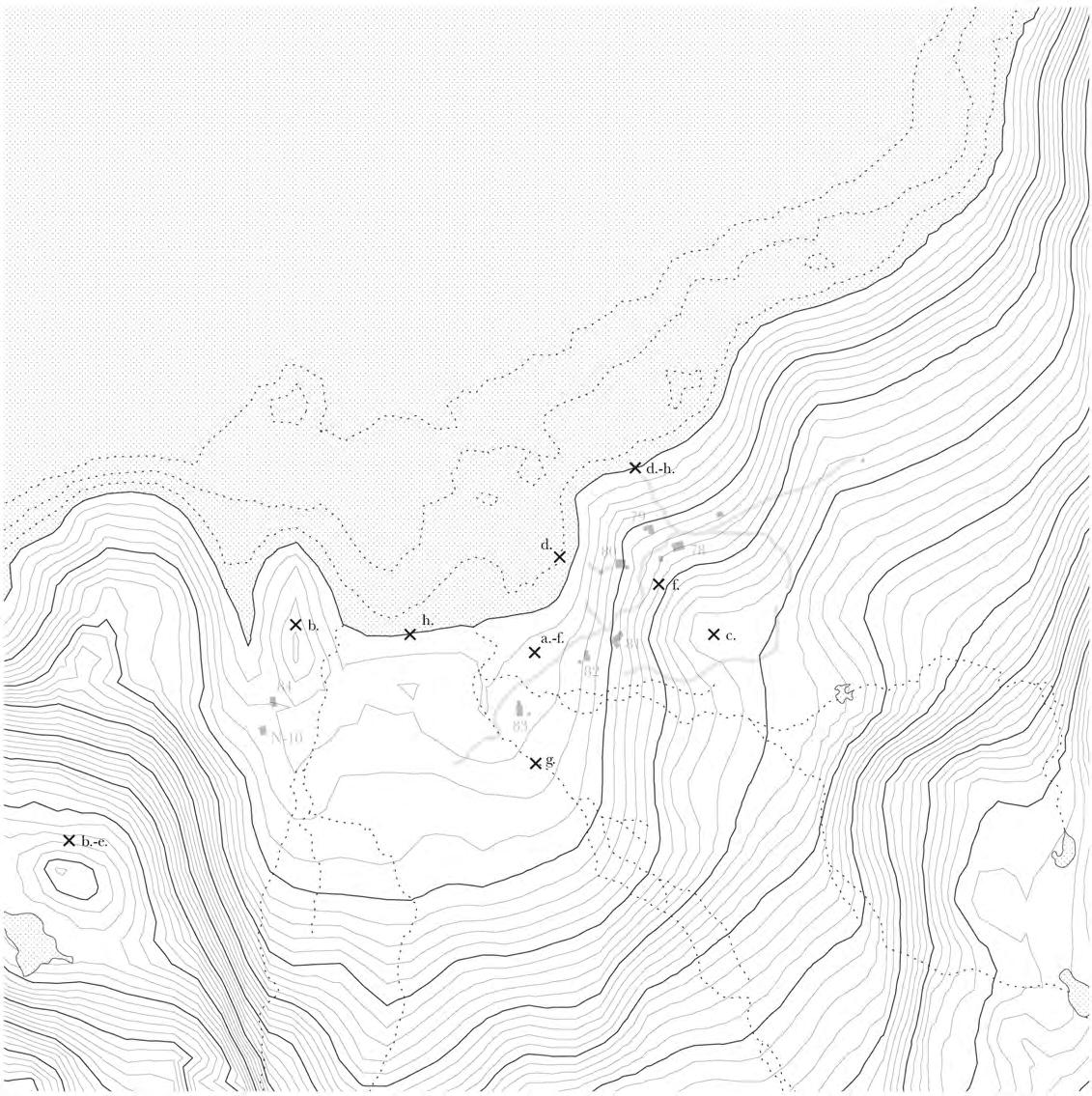 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Classes de dépôts Dépôts de surface
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires
Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 247
Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde
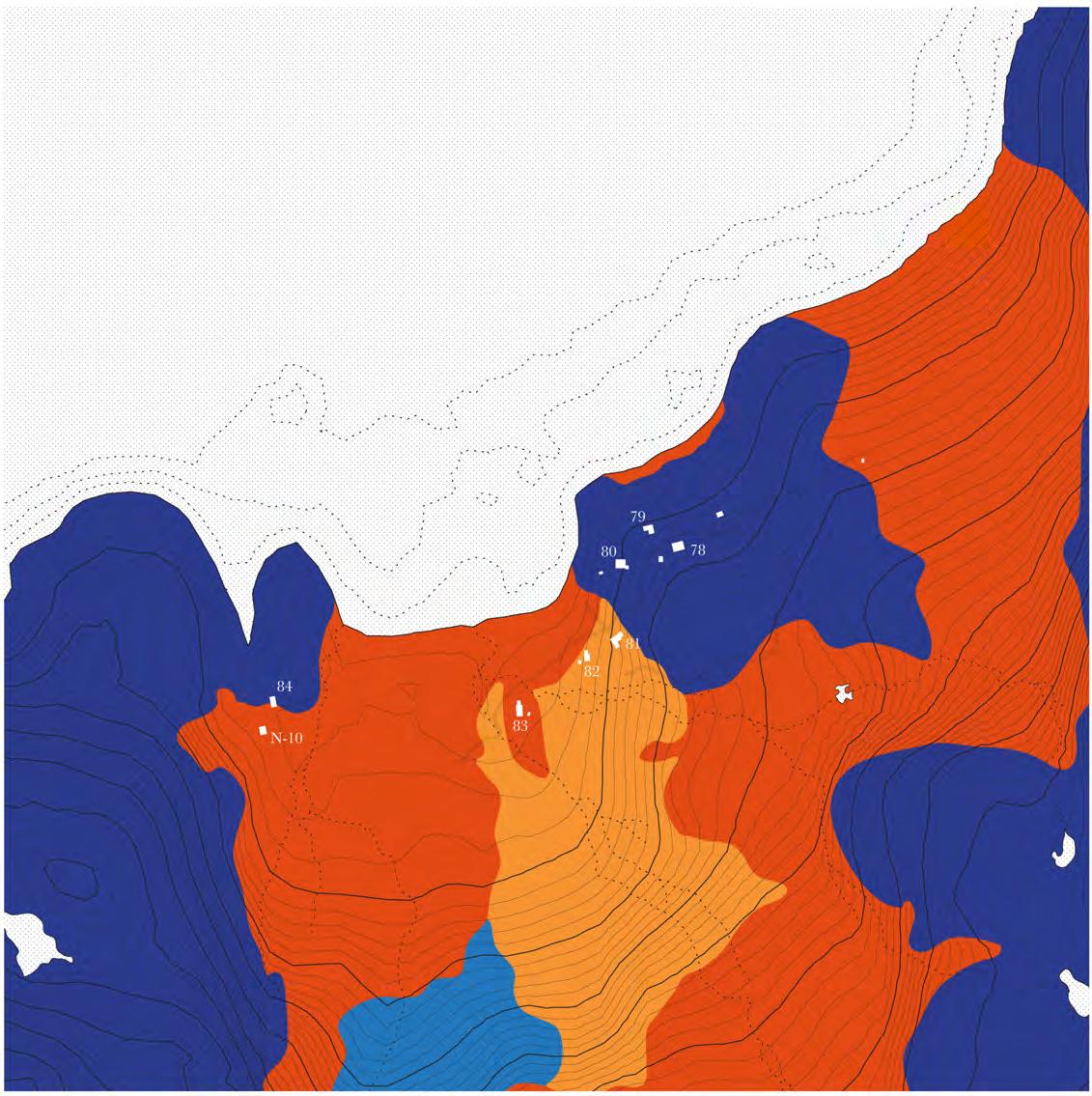
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
Annexe 1 - page 248
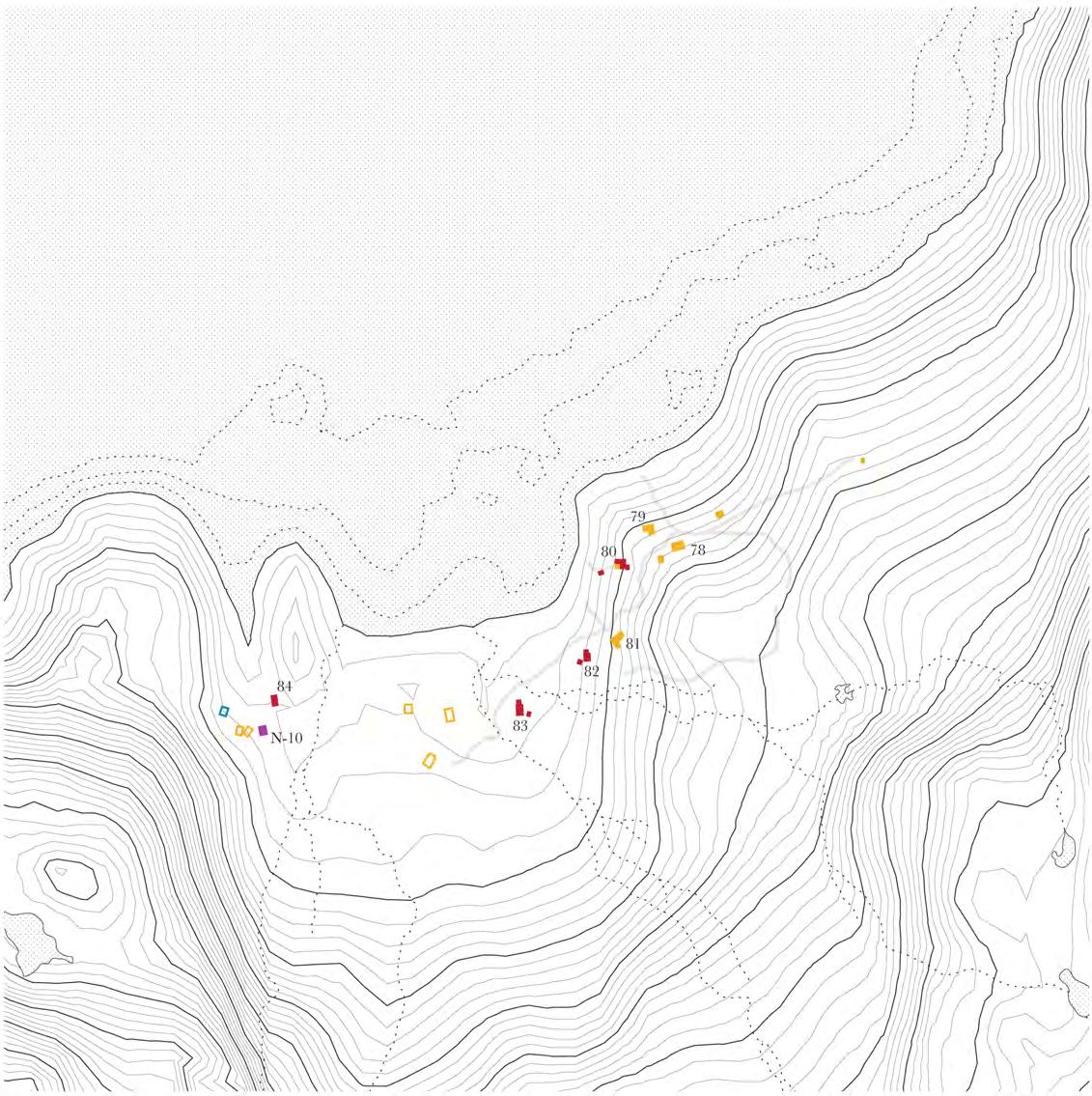
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
5.
Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
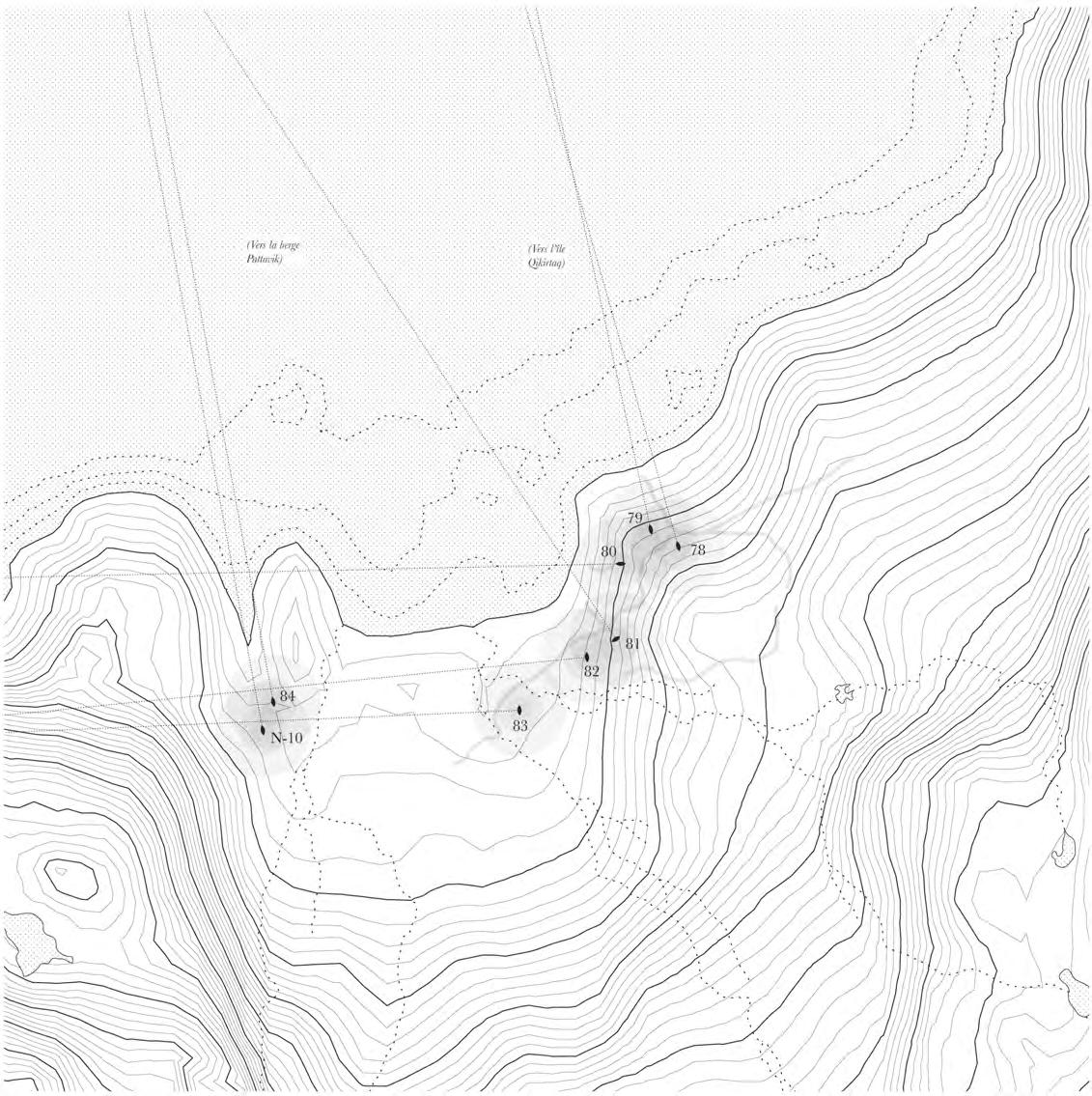
m
m
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 249
6. 40
20
Annexe 1 - page 250
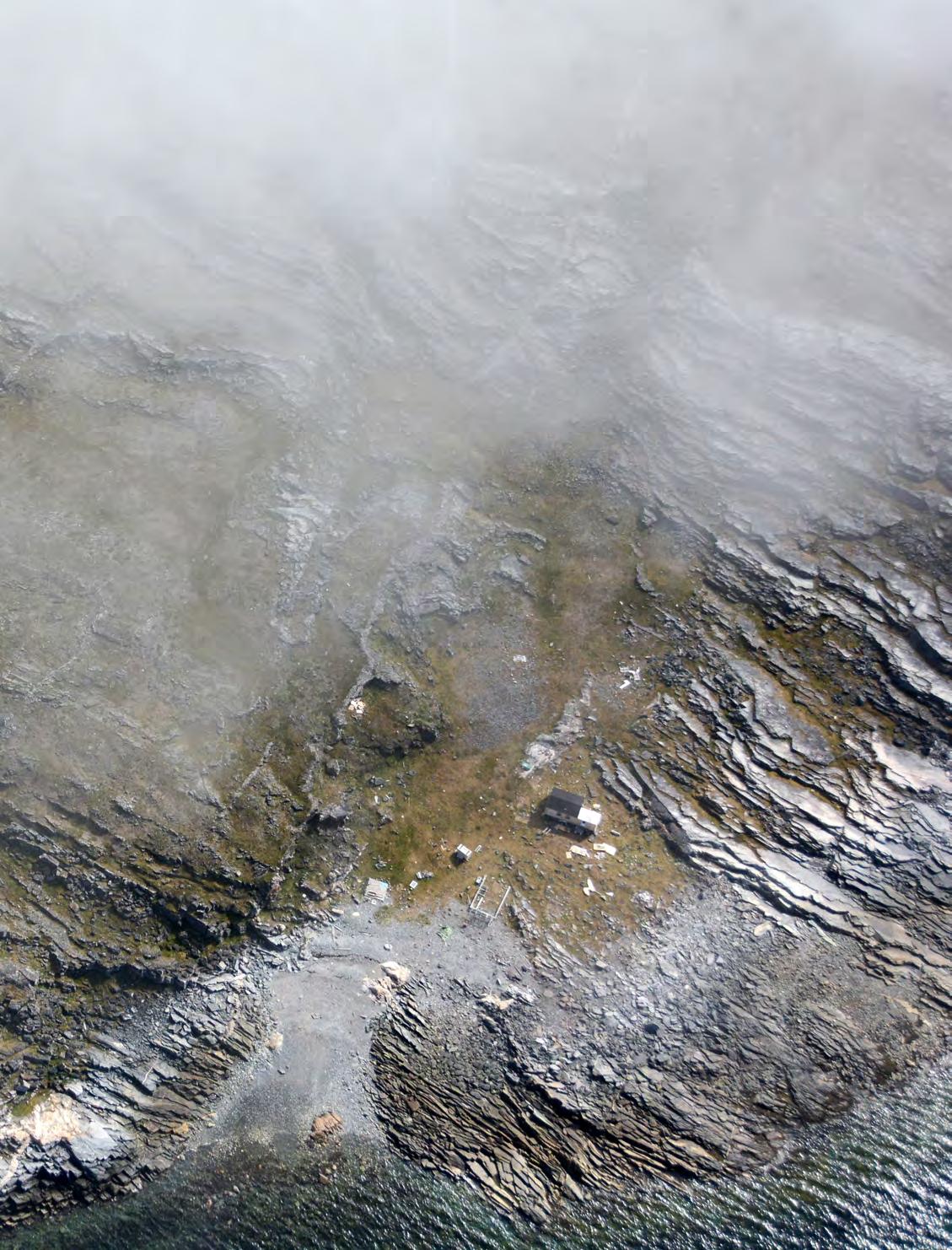 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Qikkigiaq - p10
Le campement de Qikkigiaq se trouve sur la rive sud du fjord, à environ un kilomètre au sud-ouest de Kikkaluk. L’unique cabane est de taille moyenne et est implantée dans une dépression creusée à même les affleurements rocheux. Bien qu’essentiellement rocailleux, la nature du sol de cet emplacement est favorable à la construction. La pente est plus douce autour de l’endroit choisi pour la cabane et une petite plage facilite et sécurise l’accès. Les affleurements rocheux au pourtour du site rendent difficile l’accès par VTT ou par motoneige depuis Salluit et le fjord demeure la voie d’accès principale du campement.

Par sa forme enclavée et son orientation, le site de Qikkigiaq semble bénéficier d’une bonne protection des vents. Malgré sa taille réduite, il présente aussi un maximum de critères préférentiels (b.-c.-d.e.-f.-h.). Ici encore, la cabane et son sas d’entrée sont orientés pour mieux résister aux vents. Cette configuration offre aussi de plus grandes ouvertures vers le fjord.
Enfin, une nouvelle construction s’est ajoutée sur le site en 2019 (N-11). Toutefois, il est difficile d’évaluer s’il s’agit d’une autre cabane plus petite ou d’un rangement auxiliaire puisque les images satellites n’offrent pas suffisamment d’indices.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 251
Annexe 1 - page 252
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 253


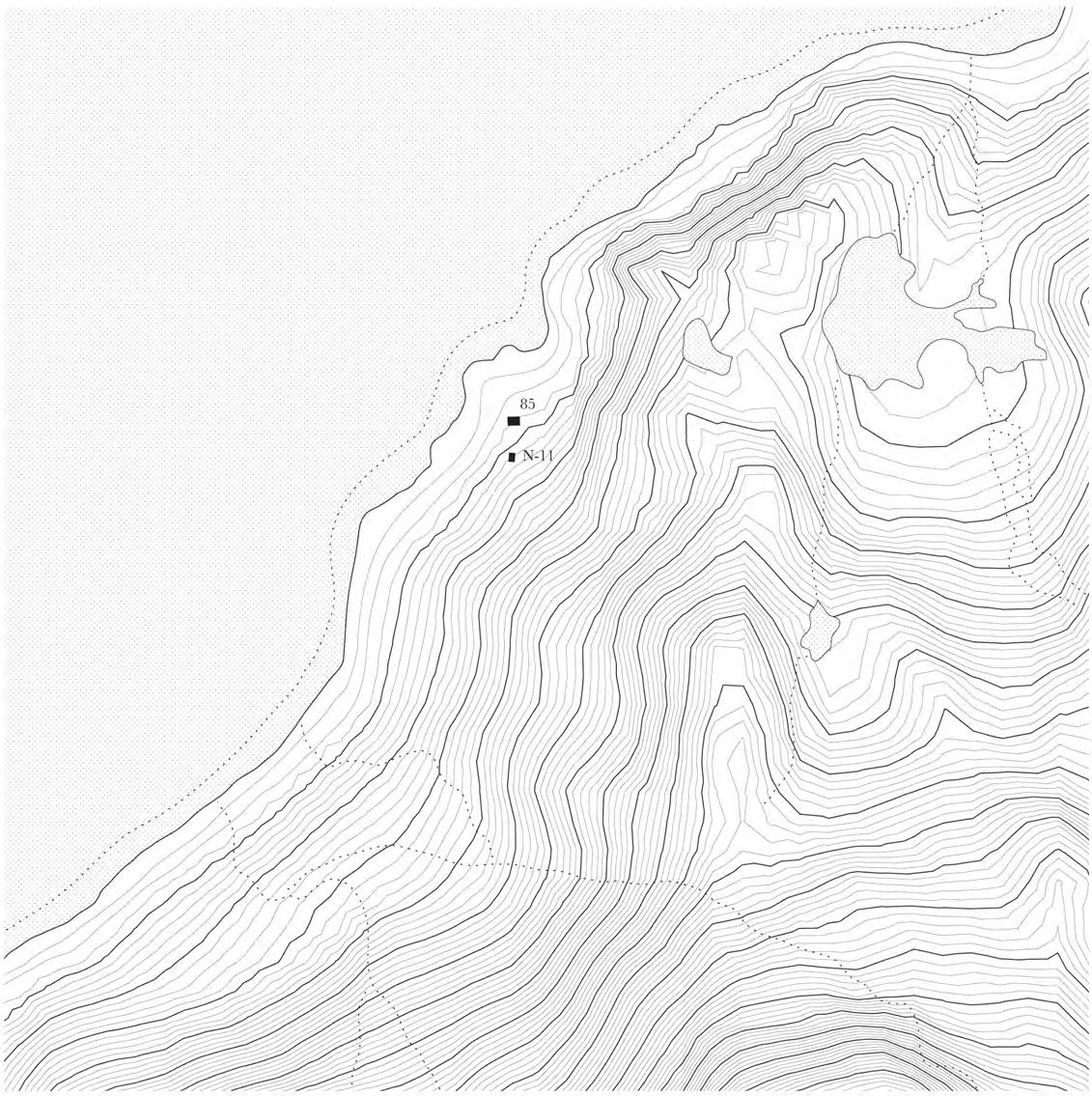
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 254
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde





Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative

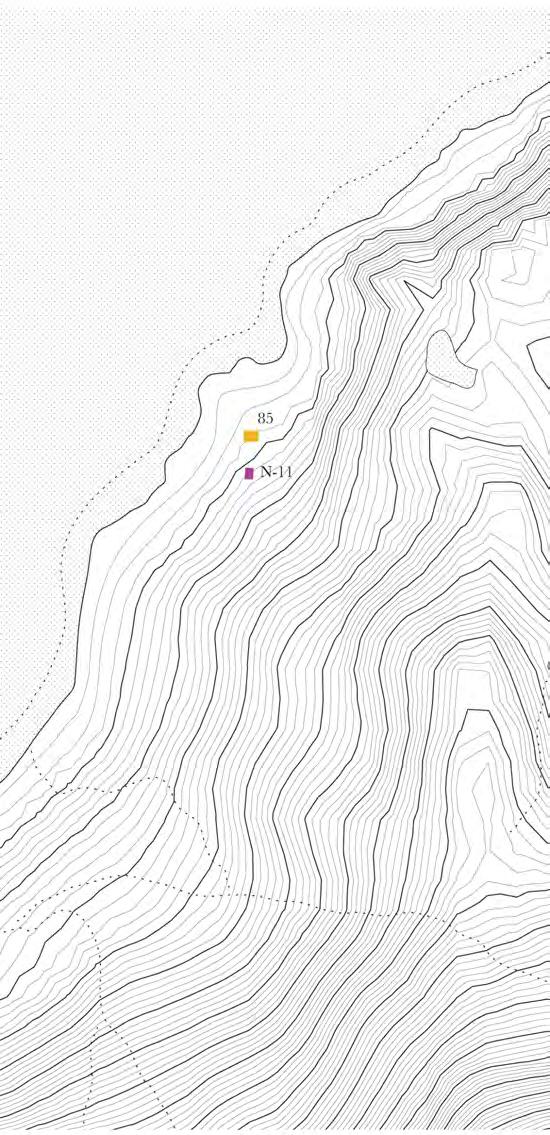
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 255
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 256
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Greve de Kikkalualuk (1/2) - o11
Kikkalualuk est une colline située sur la rive sud-est du fjord, soit environ à la moitié de la distance entre l’embouchure du fjord et le village de Salluit. À l’ouest de la colline, la pente s’adoucit et laisse place à une grève rocailleuse, puis à une langue de sable bordée par le ruisseau Kikkaluk.

Au commencement de la grève, une cabane de taille moyenne tire proft d’un afeurement rocheux large et plat. Cette cabane, bien qu’isolée des autres campements, demeure parmi les plus accessibles en VTT ou par motoneige depuis le village de Salluit. Une cabane voisine construite plus au sud (N-12) semble inachevée et inoccupée.
Ce premier campement sur la grève de Kikkalualuk regroupe plusieurs critères préférentiels (b.-c.-d.-e.-f.g.-h.). Par conséquent, même si le site est étroit et que la cabane ne se trouve pas au creux d’une baie, celle-ci profte d’un renfement de la colline pour être à l’abri des vents dominants. La grande plage qui borde le site ofre quant à elle plusieurs possibilités d’accès, tandis que la batture relativement courte par rapport aux autres campements en amont du fjord ofre des fenêtres d’accès plus favorables.
Annexe 1 - page 257
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Annexe 1 - page 258
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 259


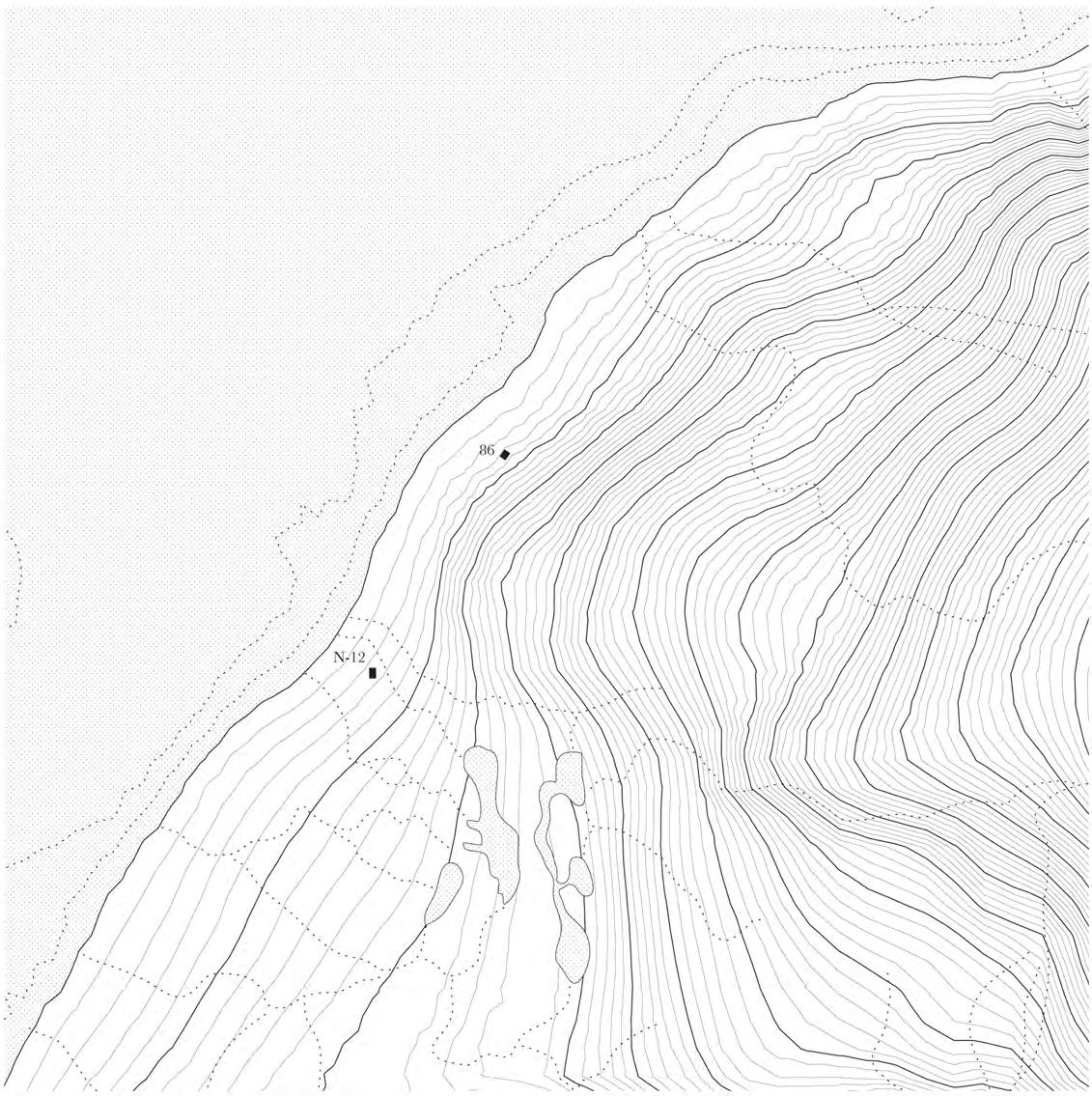
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 260
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



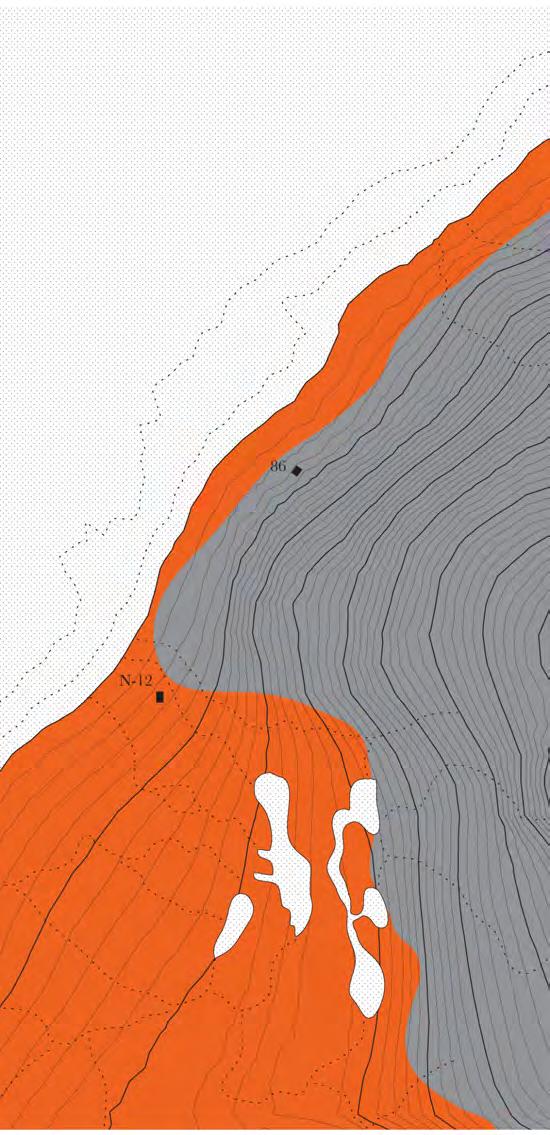
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
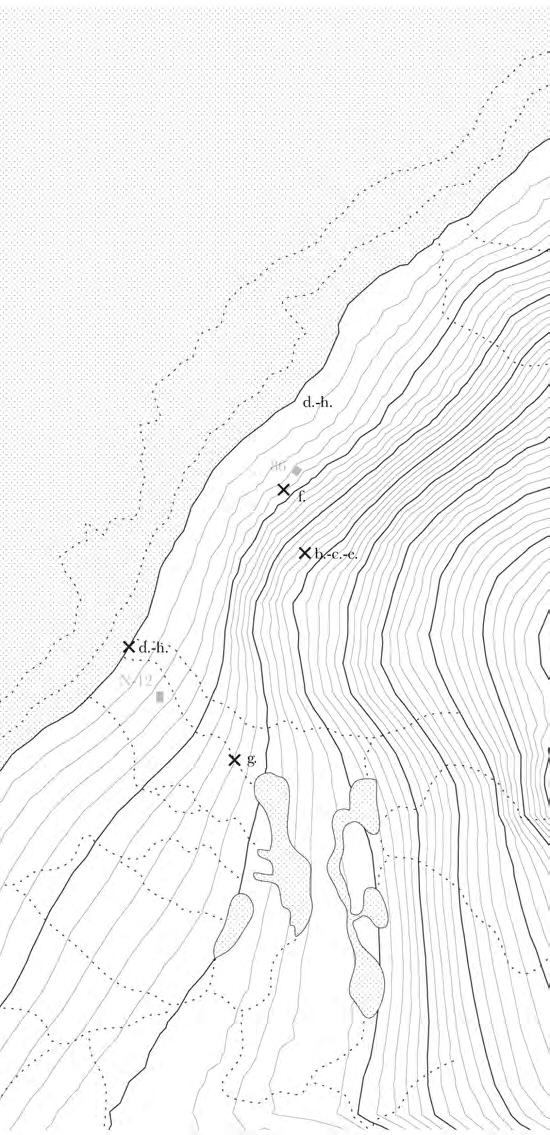 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
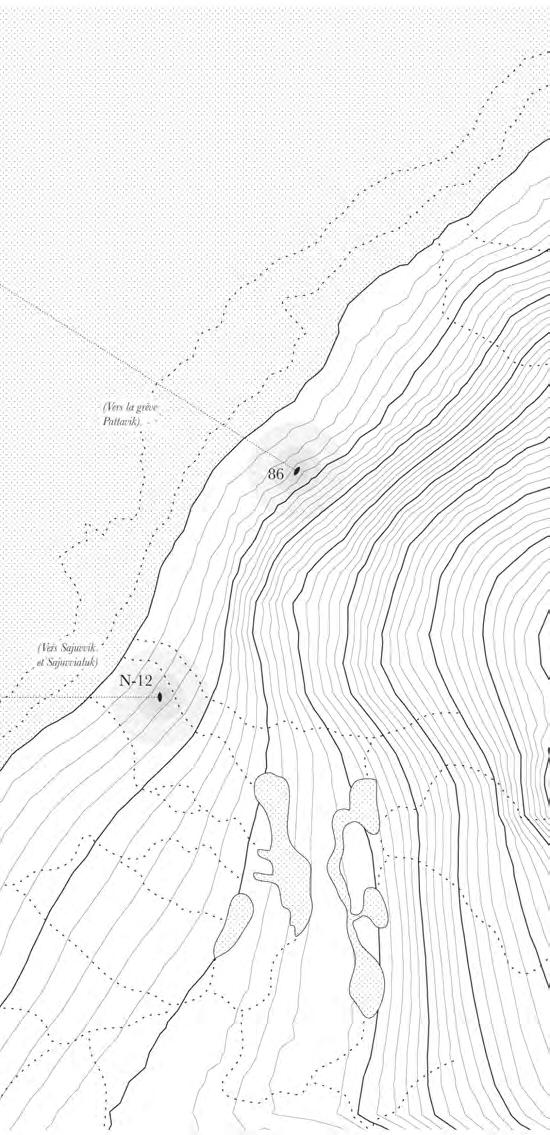
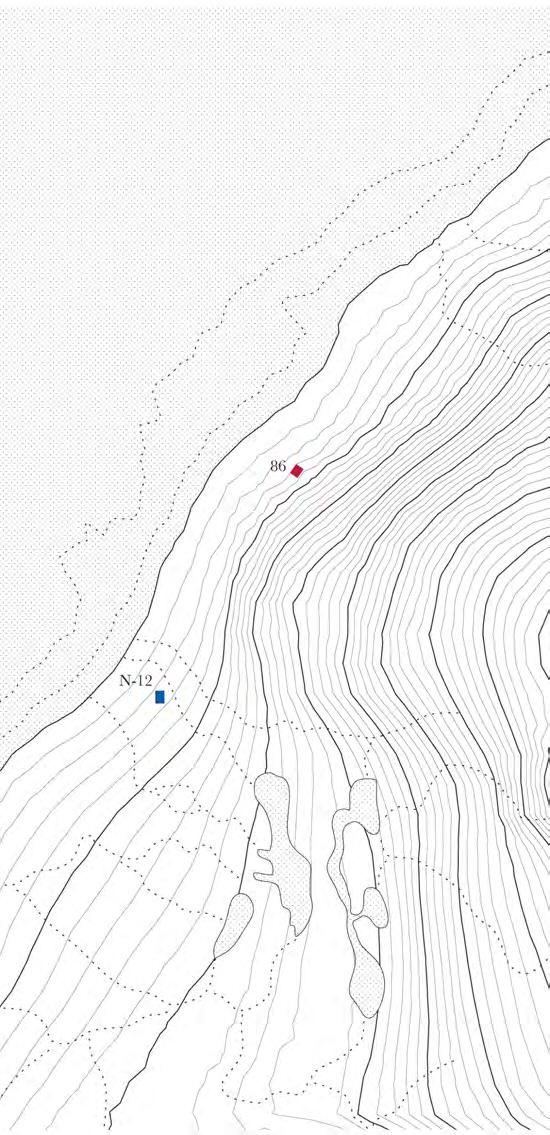
Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 261
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20
5.
m
Annexe 1 - page 262
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Greve de Kikkalualuk (2/2) - n11
Plus loin sur la grève de Kikkalualuk, soit au bout de la langue de sable mentionnée précédemment, un deuxième campement autrefois composé de deux cabanes n’en comporte aujourd’hui qu’une seule. La visite sur le site a aussi révélé la présence d’une plateforme de camping près de la rivière. La cabane manquante semble pour sa part avoir été déplacée, puis abandonnée, ou littéralement emportée par le vent, puis lourdement endommagée après son impact avec le sol à quelque deux cents mètres de distance de l’endroit où on l’aperçoit sur la photo aérienne.

Les critères préférentiels de ce site sont visiblement peu nombreux (d.-f.-g.-h.) et l’exposition aux vents
dominants y semble plus importante que dans n’importe quel autre campement du fjord. Pour leur résister, l’unique cabane encore debout est orientée de façon parallèle à la rive et elle est profondément ancrée dans le sable à l’aide de tirants de bois.
Selon les bâtisseurs locaux, l’usage cette cabane est plus sporadique du fait qu’elle sert occasionnellement les activités du centre jeunesse de Salluit. Durant les entretiens, la proximité du village et la possibilité de réunir de grands groupes de personnes ont été évoquées comme étant les facteurs qui expliquent pourquoi ce site a été choisi malgré ses inconvénients...
Annexe 1 - page 263
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 264
1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Site approximatif de l’écrasement.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 265


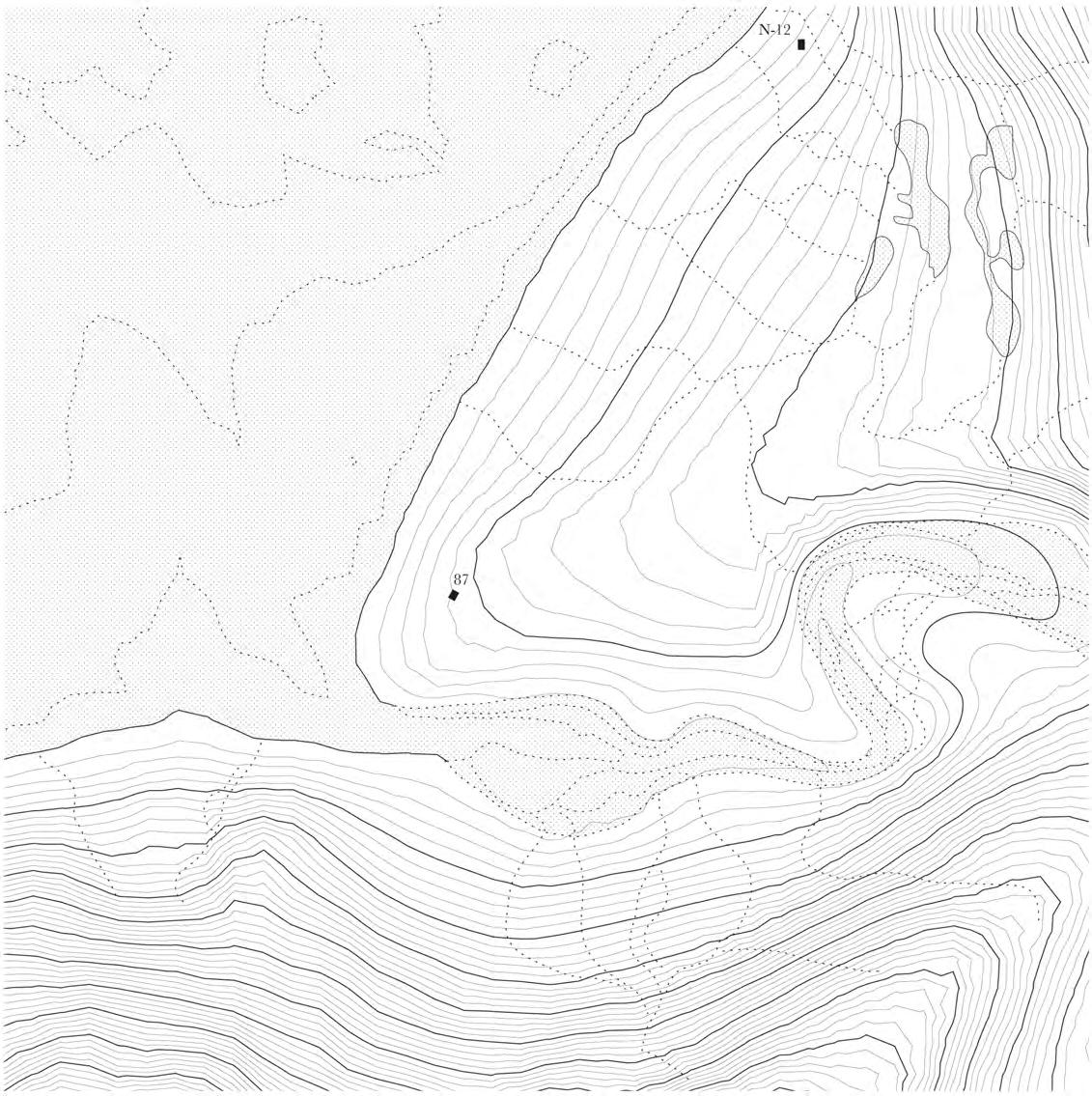 2.
2.
P
Cours d’eau
Site approximatif de l’écrasement.
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 266
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
Sédiments marins d’eau peu profonde



Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)

 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
P P
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Annexe 1 - page 267


ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
P Site approximatif de l’écrasement. 40 m 20 m Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures. Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
5.
Annexe 1 - page 268

Demeule, août 2018
Niaqunnguut - n12
Le campement de Niaqunnguut est séparé de Salluit par seulement quelques collines situées au sud-ouest. Une marche dans la toundra d’environ 4 kilomètres permet de rejoindre ce site qui ne compte qu’une seule petite cabane endommagée par le temps, et désormais inhabitable. Une plateforme de camping est aussi présente à quelques mètres de la cabane.
Malgré la cabane délaissée, le site regroupe un nombre intéressant de critères préférentiels (b.c.-e.-f.-g.-h.). Le campement repose aussi sur un affleurement rocheux stable et bénéficie d’un panorama unique sur l’embouchure du fjord.
Pour expliquer en partie le sort de la cabane de Niaqunnguut, les entretiens avec les bâtisseurs locaux ont révélé qu’un accès trop « facile » depuis Salluit n’est pas nécessairement souhaitable puisqu’il ne permet pas la déconnexion recherchée avec le quotidien du village.
Annexe 1 - page 269
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
Annexe 1 - page 270
1. Image satellite du campement
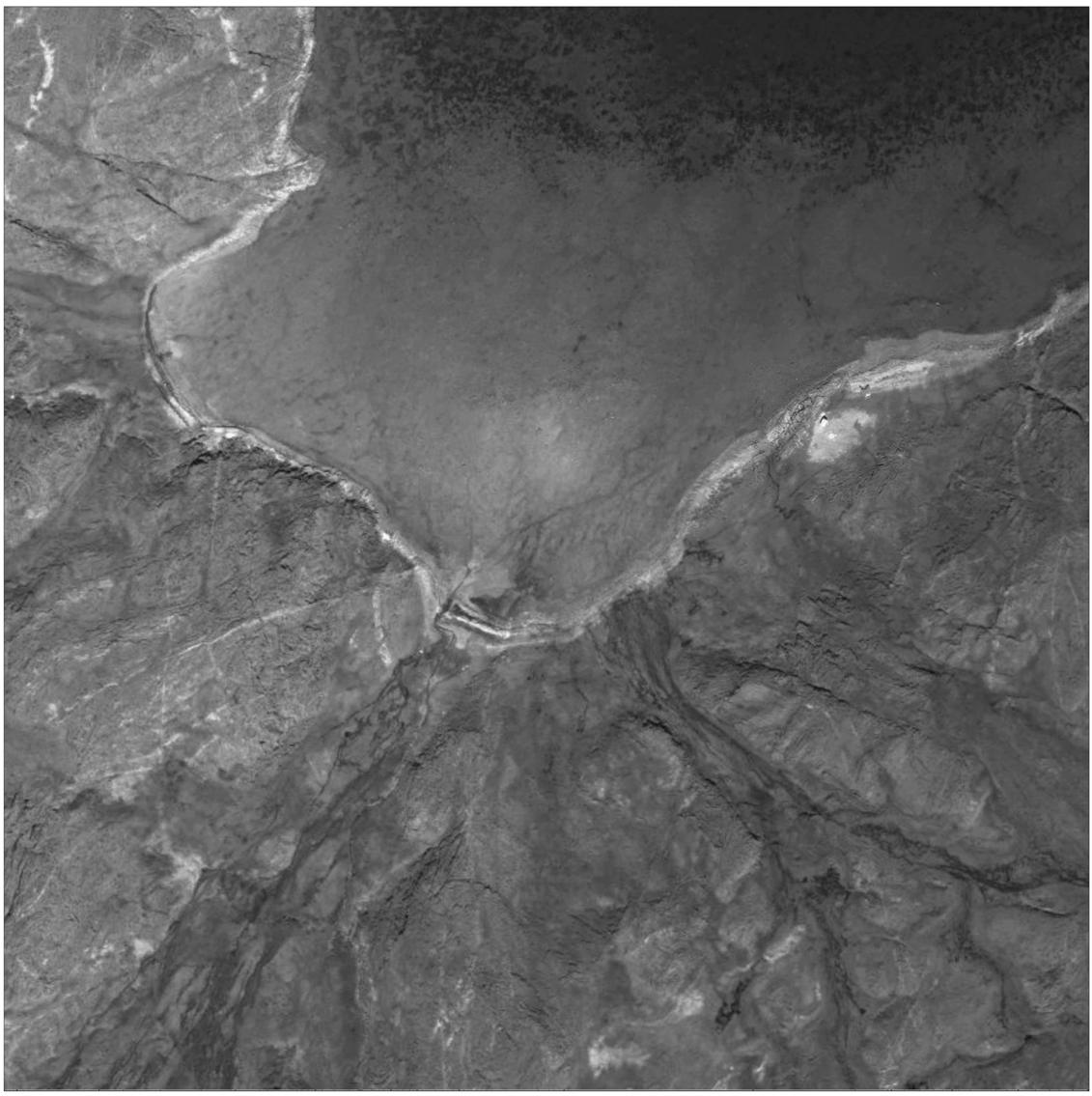
2. Topographie autour du campement
3. Caractéristiques préférentielles
4. Dépôts de surface
5. Morphogénèse
6. Orientations et distance relative
1.
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 271


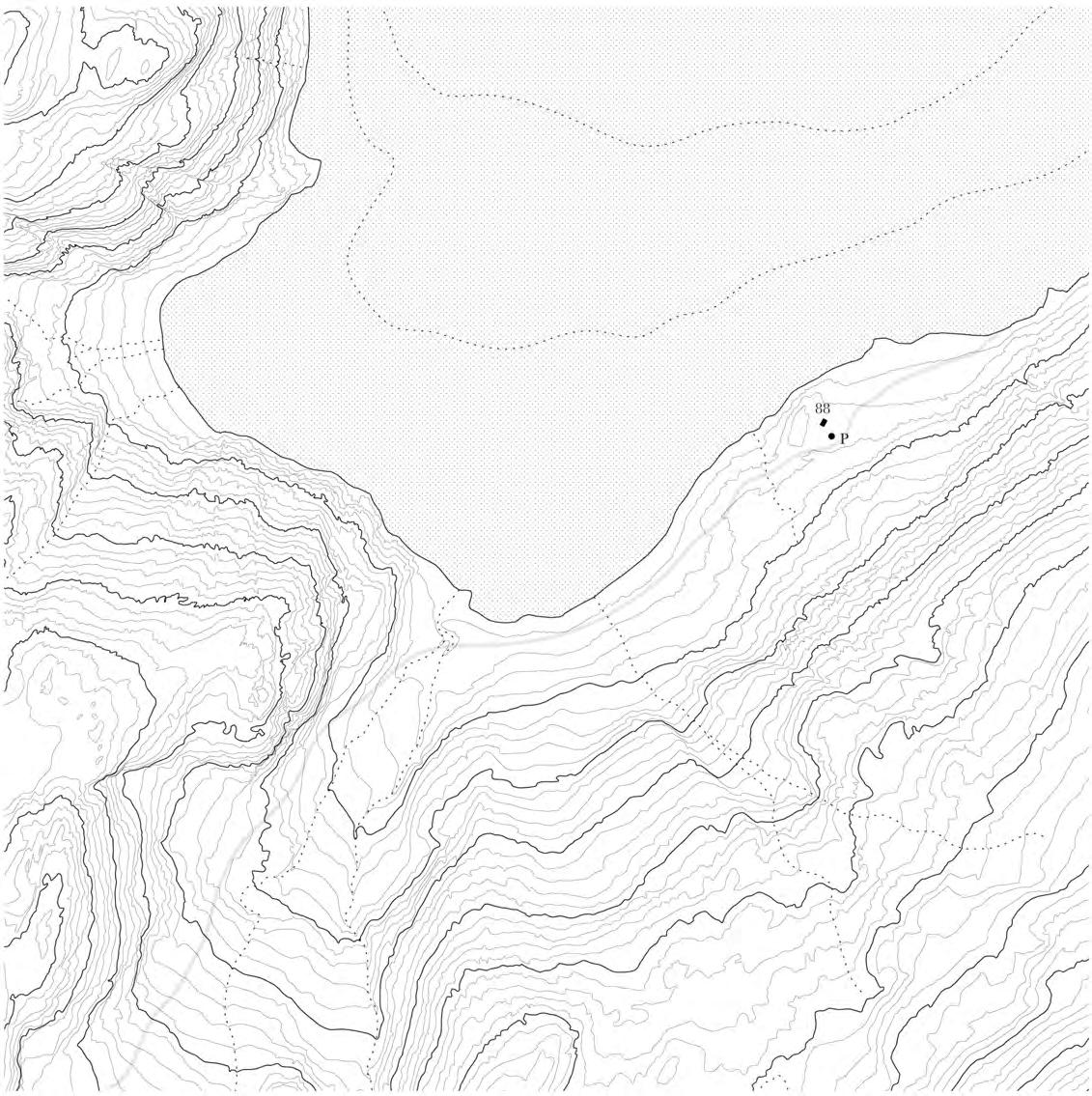
2. Cours d’eau
Classes de dépôts
Instables
Marins
Littoraux
Fluviatiles
Glaciaires




Substrats rocheux Stables
Annexe 1 - page 272
Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde
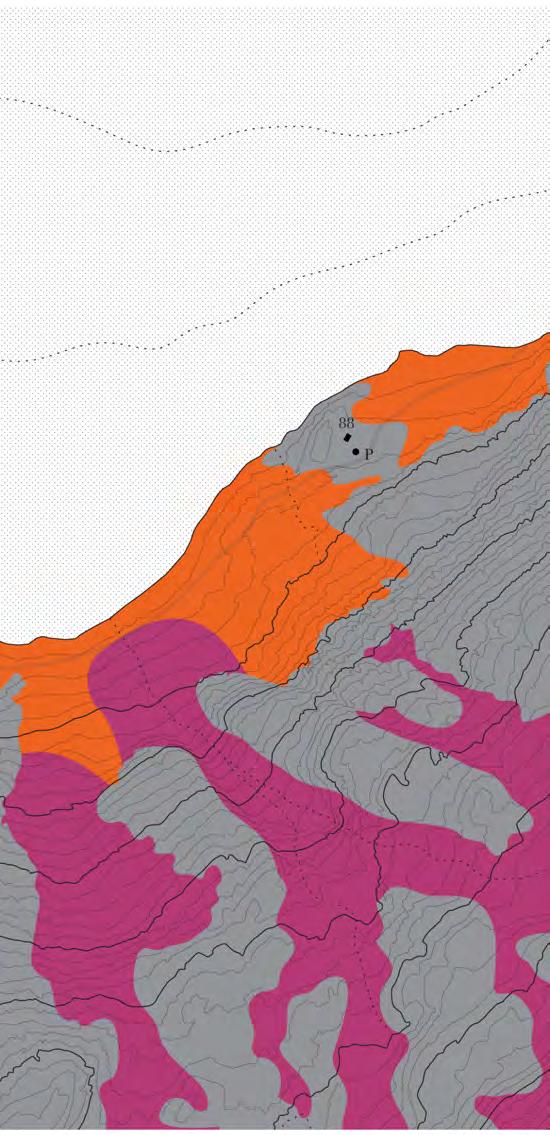
Sédiments marins d’eau peu profonde



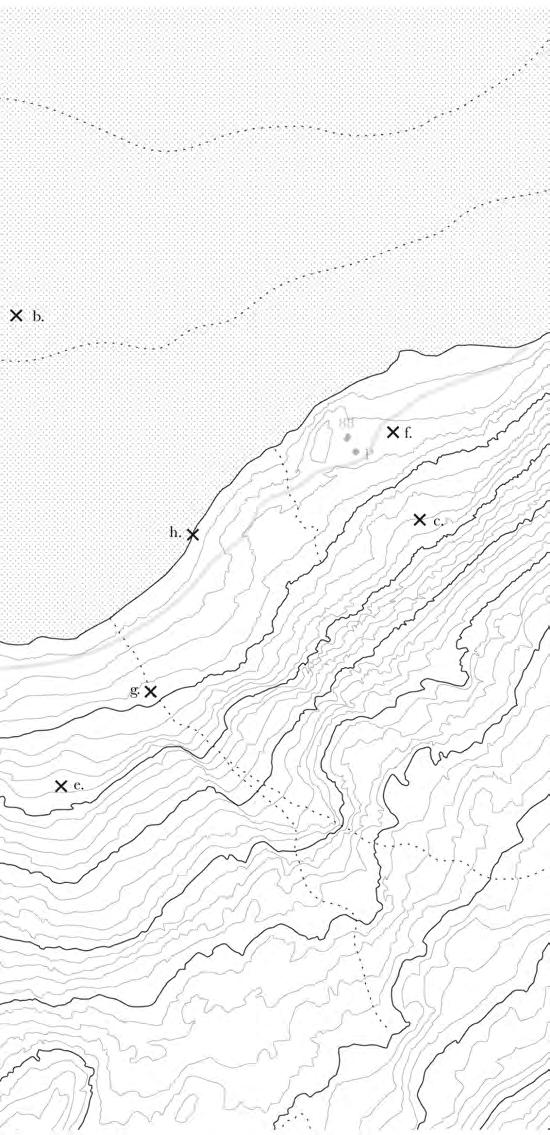
Till
Roc (< 50 %)
Roc (> 50 %)
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Orientations gérérales Distance relative
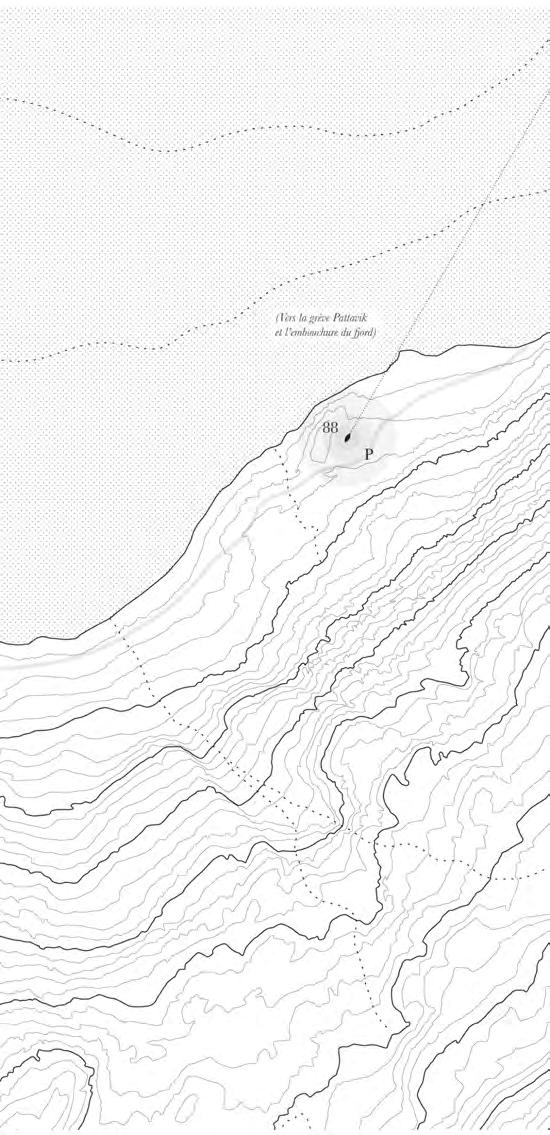

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.
Orientation du faîte du volume principal de la cabane.
Annexe 1 - page 273
ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019
6.
40 m 20 m
5.

III
ANALYSE DES CABANES ET DE LEURS RELATIONS AU SITE

Méthode d’analyse des cabanes
Le texte qui suit constitue un extrait du chapitre 6 du mémoire.
À l’issue de l’étude du fjord et de ses campements, la distinction de caractéristiques propres aux sites d’établissement constitués de cabanes plus anciennes et plus récentes semble corroborer l’hypothèse précédemment énoncée selon laquelle il y aurait des diférences constructives témoignant de l’évolution de leur usage et de leur rapport au territoire. Pour approfondir et valider cette idée, l’étude à l’échelle des cabanes s’est concentrée sur les 39 constructions relevées lors de l’étude de terrain. À cette étape, l’analyse a reposé sur trois exercices concentrés sur la volumétrie des cabanes, leur orientation dans le site et leur position par rapport au fjord.
La volumétrie des cabanes
La volumétrie des cabanes a été évaluée à partir de dessins axonométriques facilitant la comparaison de leurs dimensions et de leur composition générale (Figure 6). Ces dessins n’avaient pas pour objectif de reproduire les détails constructifs, mais bien de traduire les caractéristiques les plus distinctives des volumes. Par exemple, une attention particulière a été portée à leur fractionnement pour déterminer si les cabanes ont été construites en un seul « mouvement » ou suite à l’ajout de diférentes annexes. Les proportions des murs, des ouvertures et des sections, ainsi que la superfcie des aires de planchers ont été mesurées pour initier une catégorisation des formes. À noter que pour les fns de l’étude, les cabanes dont la superfcie de plancher avoisine vingt mètres carrés sont dites petites et qu’à l’inverse, celles dont l’aire de plancher avoisine cinquante mètres carrés sont dites grandes (des cabanes dites moyennes se situant dans un entre-deux).
L’orientation des ouvertures des cabanes
À partir de ces indices, l’orientation des cabanes a ensuite été évaluée en superposant leur aire de plancher avec le tracé de cônes de vision, soit une représentation en plan de l’importance tridimensionnelle de chacune des ouvertures.
Cette mesure tient compte d’une appréciation qualitative des vues visées (ou exclues) et se base sur le calcul présenté à la fgure 7. Ici, plus le rayon d’un cône de vision est long et plus la superfcie de l’ouverture qu’il qualife est importante. Pareillement, plus un cône a d’amplitude et plus l’ouverture qui s’y rattache est large. Enfn et toujours selon le même principe, un cône large mais de faible rayon indique une petite ouverture en bandeau, tandis qu’un cône étroit et profond indique une importante ouverture verticale. Là où l’exercice devient particulièrement intéressant, c’est dans la comparaison des cônes avec les éléments se trouvant en périphérie des cabanes. En admettant que les ouvertures soient positionnées en fonction d’orientations préférentielles déterminées par des critères comme la relation au territoire, au voisinage, l’exposition aux vents, au paysage ou à la position du soleil, il devient possible d’estimer la prédominance des facteurs jouant un rôle dans la confguration des cabanes.
La position des cabanes par rapport au fjord
Pour étayer davantage la documentation des cabanes et donner suite aux indices s’intéressants cette fois à leur position, il s’est avéré pertinent d’évaluer leur distance et leur altitude par rapport au niveau haut des eaux du fjord. Une variabilité de ces facteurs suppose diférentes conditions d’établissement impliquant à leur tour une adaptation des approches constructives et évolutives. Se faisant, il apparaît raisonnable de penser qu’un site plus élevé et plus éloigné du rivage ofre des vues plongeantes sur le fjord, mais implique aussi des eforts considérables pour y acheminer les matériaux et y ancrer un bâtiment. À la diférence d’une cabane posée directement sur une plage, une cabane juchée sur un promontoire est imaginée dans un rapport plus permanent au site puisqu’elle est nécessairement plus difcile à transporter ou à déménager. Enfn, cette position des cabanes par rapport au fjord a été mesurée depuis un axe de coupe tracé de façon perpendiculaire à la berge (Figure 9.). En attribuant des coordonnées aux multiples points fgurant le profl du sol le long de chaque axe, une distance (x) et une altitude (y) ont pu être enregistrées pour la position de chaque cabane.
Annexe 1 - page 276
Annexe 1 - page 277

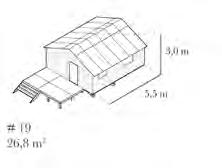
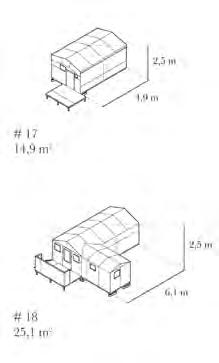
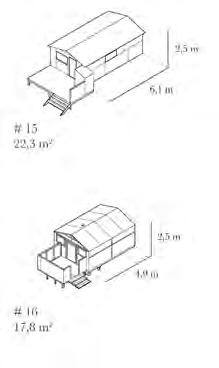
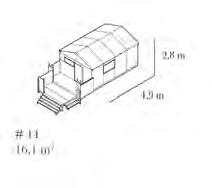
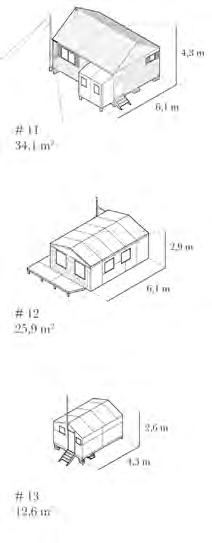
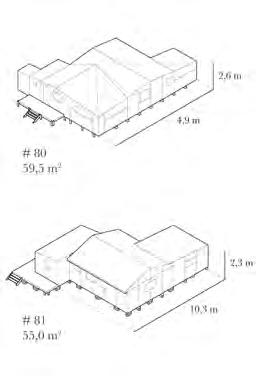
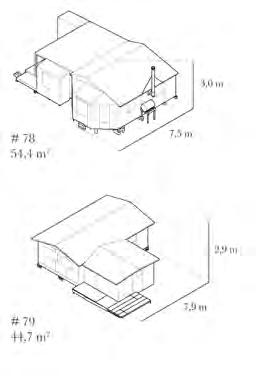
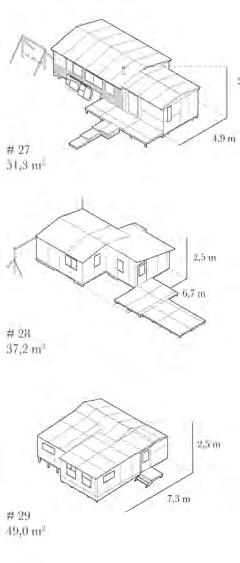
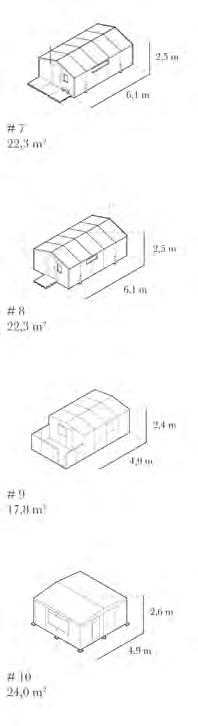
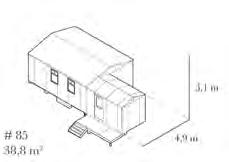
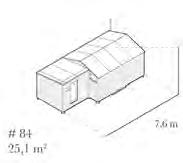
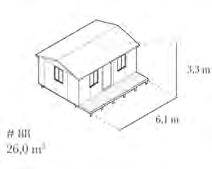
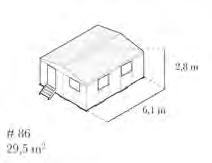
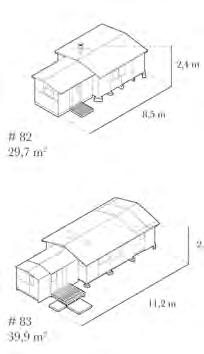
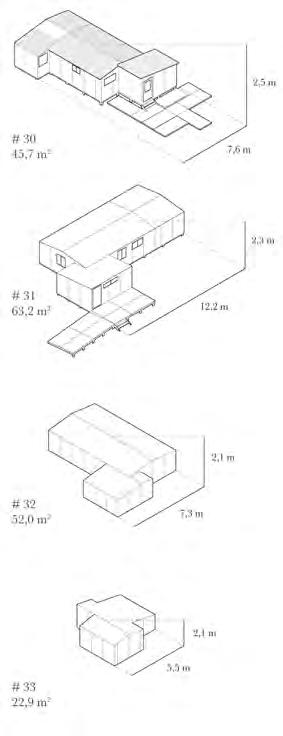 Figure 6. Exemples de quelques dessins volumétriques des cabanes du fjord de Salluit.
Figure 6. Exemples de quelques dessins volumétriques des cabanes du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page
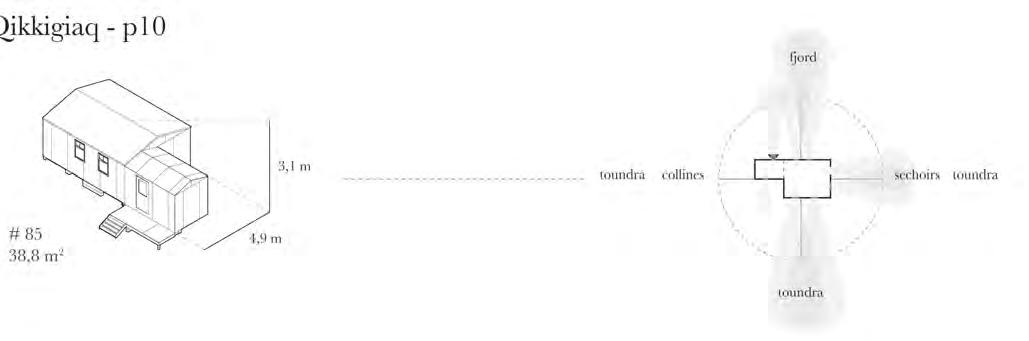
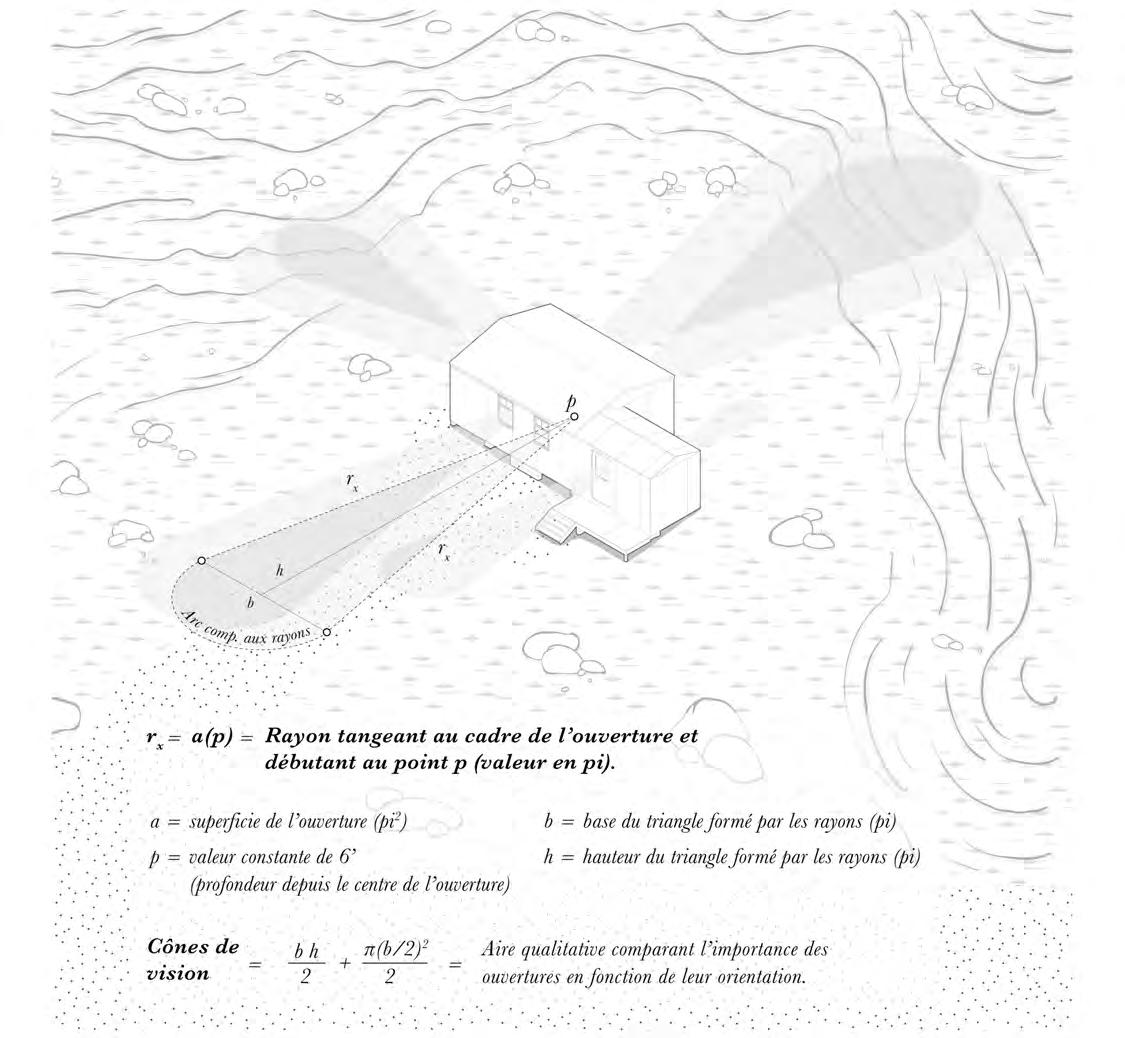 Figure . xemple exprimant les c nes de ision de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 7. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer l’importance et l’orientation des cônes de vision des cabanes.
278
Figure . xemple exprimant les c nes de ision de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 7. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer l’importance et l’orientation des cônes de vision des cabanes.
278
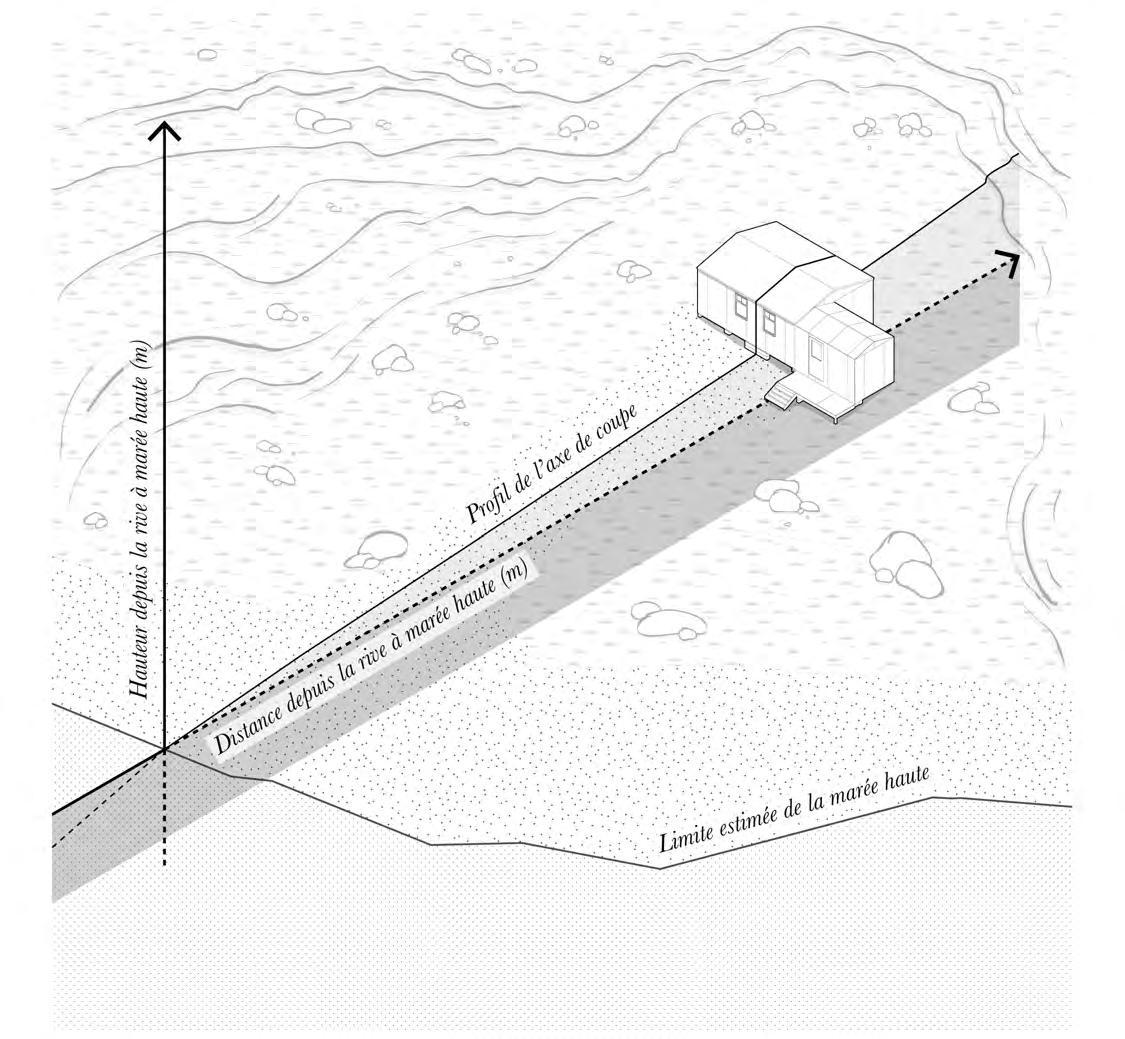
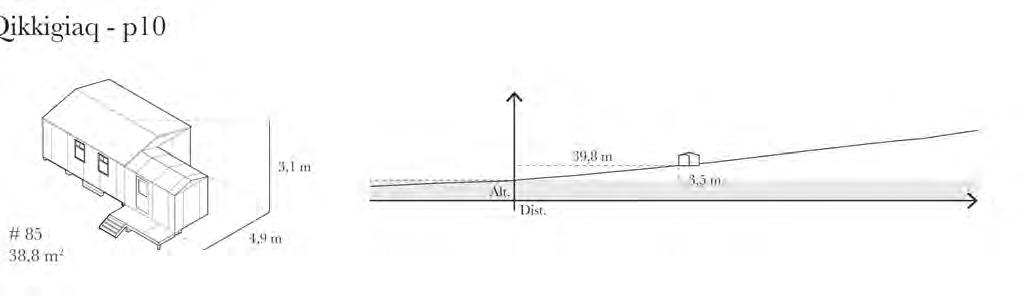 Figure 10. xemple exprimant le profl altimétrique de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 9. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer la position des cabanes.
y x
Annexe 1 - page 279
Figure 10. xemple exprimant le profl altimétrique de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 9. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer la position des cabanes.
y x
Annexe 1 - page 279
Les cabanes d’Igajialuk
Volumétries
Les volumétries des six cabanes qui composent le campement d’Igajialuk sont relativement semblables. Elles sont construites sur un plan rectangulaire et elles sont munies d’un toit à deux versants dont le faîte est pratiqué sur le sens long.
Là où ces cabanes diffèrent, c’est au niveau de leurs dimensions. Si elles suivent toute une trame et une hauteur induites par la taille standard des panneaux de bois de leur revêtement (4’x8’), la cabane 5 présente une superficie de plancher deux fois plus grande que celle de ses voisines les cabanes 2, 3 et 6
(± 42 m 2 vs ± 20 m 2). Les cabanes 1 et 4 sont pour leur part plus menues puisqu’elles comportent une superficie d’environ 13 m 2
Autrement, l’étendue des transformations des cabanes d’Igajialuk apparaît relativement limitée dû à leur petite taille et dû à leur volumétrie uniforme. Par exemple, seule la cabane 2 comporte un petit sas d’entrée, seules les cabanes 3, 4 et 5 possèdent un petit balcon, et seule la cabane 5 semble être équipée d’un système de chauffage permanent.
Annexe 1 - page 280
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
Positions
La distance moyenne des cabanes d’Igajialuk se trouve à 97 m de la ligne estimée des hautes eaux du fjord, tandis que leur altitude moyenne se trouve à 3 m de cette même référence.
Toutefois, si ces données sont relativement groupées en ce qui concerne la distance des cabanes par rapport à la rive, il est important de noter que la cabane 6 est implantée sur un button élevé (7,3 m) et que la plage où sont installées les autres cabanes du campement occupe nécessairement une altitude beaucoup moins importante (1,5 à 2,6 m). En parallèle, il a déjà été mentionné (à travers l’échelle d’analyses précédente) que la cabane 6 semble avoir une configuration différente du fait qu’elle est isolée et qu’elle est issue d’une période de construction plus récente.
Orientations
Peu d’informations ont pu être collectées par rapport à l’orientation des ouvertures des cabanes d’Igajialuk.
Chose certaine néanmoins, seules les cabanes 3 et 6 possèdent une entrée sur l’un de leurs côtés longs. L’entrée des autres cabanes est pratiquée dans le sens court des volumes et fait toujours face aux rives du fjord et de la rivière Foucault.
La présence d’un sentier menant au village de Salluit ne semble pas influencer l’orientation des entrées des cabanes. Comme mentionné précédemment, ce sentier ne semble pas être une voie d’accès privilégiée du campement puisqu’il présente un parcours très pentu, surtout dans sa portion la plus rapprochée d’Igajialuk.
Comparaison de la position des cabanes d’Igajialuk
Annexe 1 - page 281
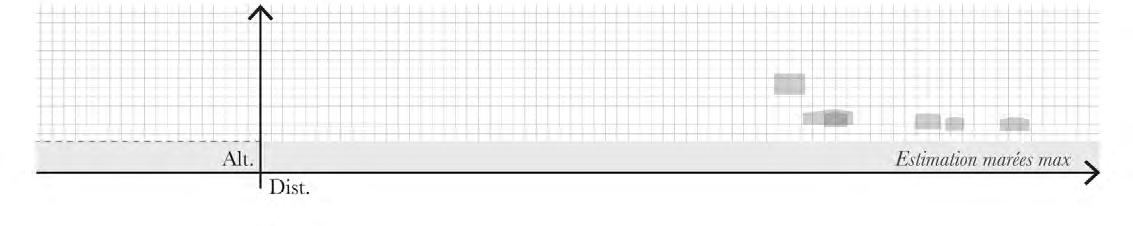
Annexe 1 - page 282
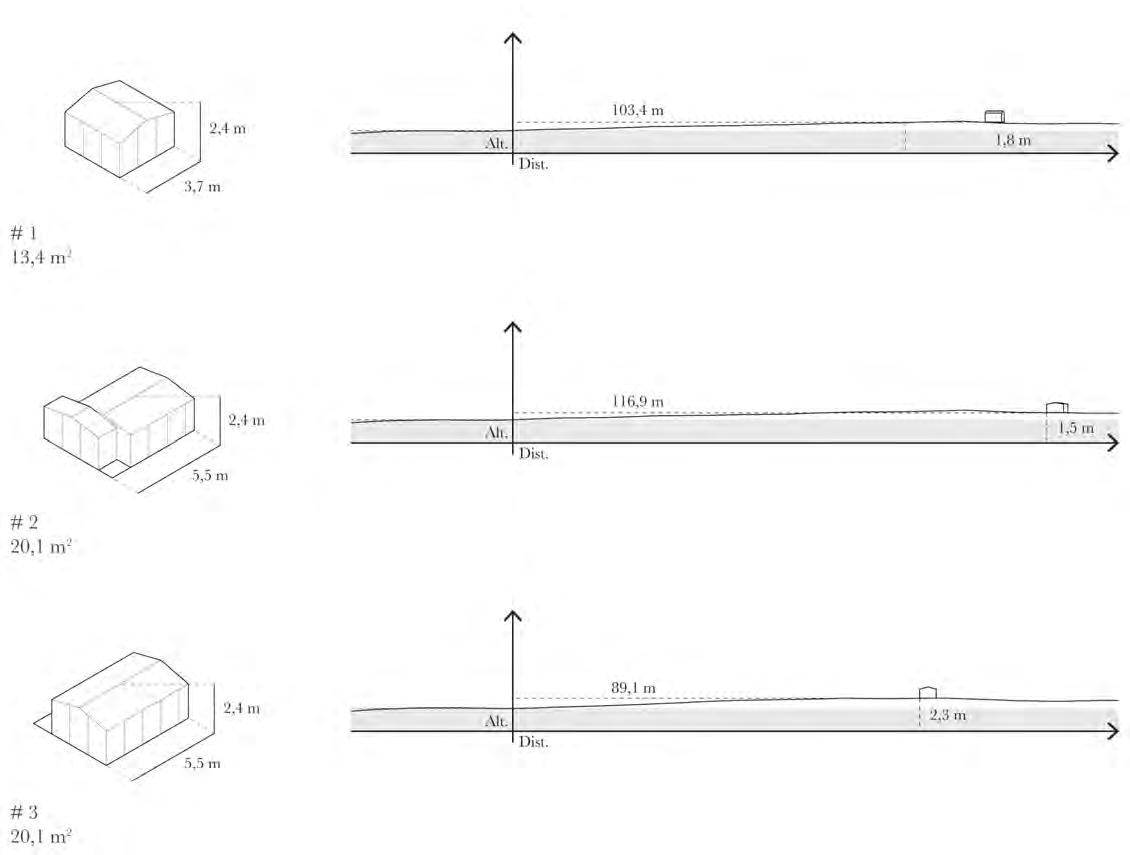
Volumétries Positions par rapport au fjord
Annexe 1 - page 283
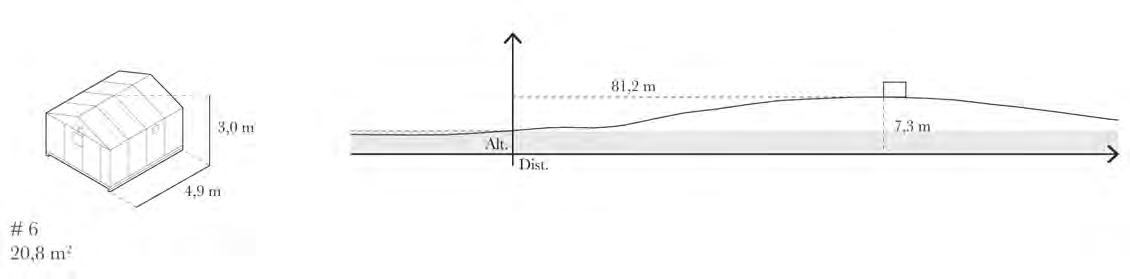
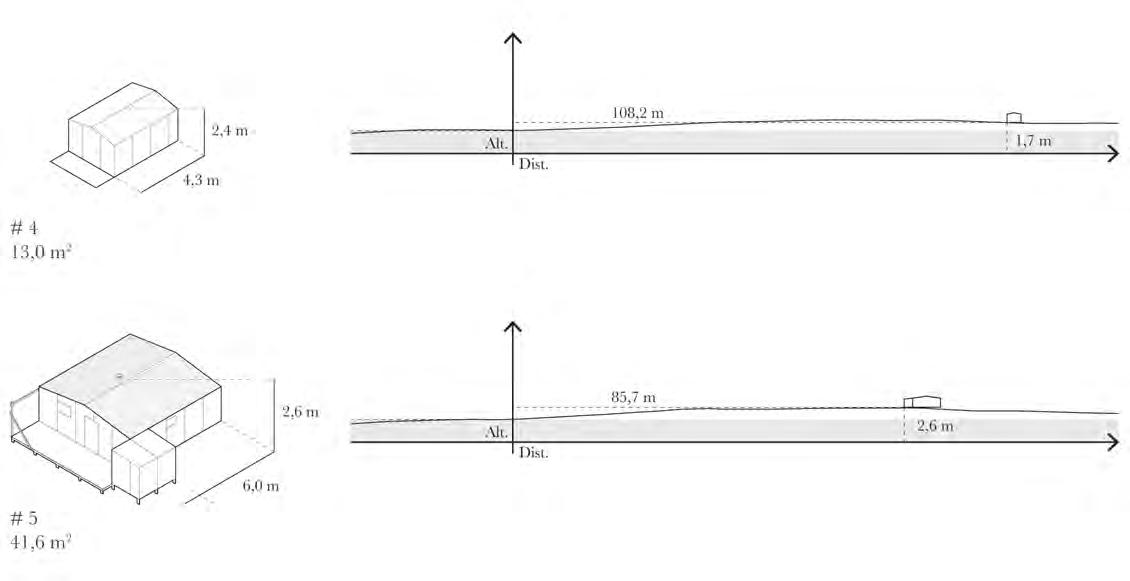
Volumétries Positions par rapport au fjord
Annexe 1 - page 284
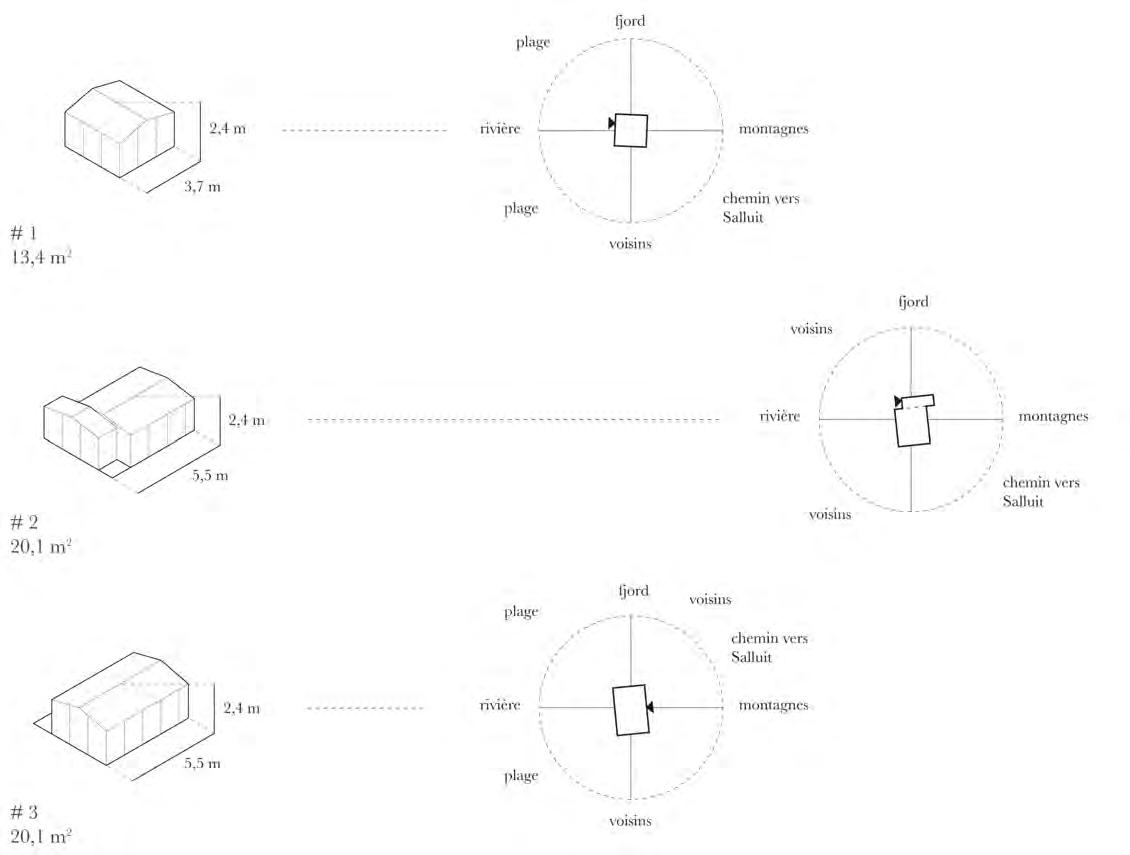
Volumétries Orientations
Annexe 1 - page 285
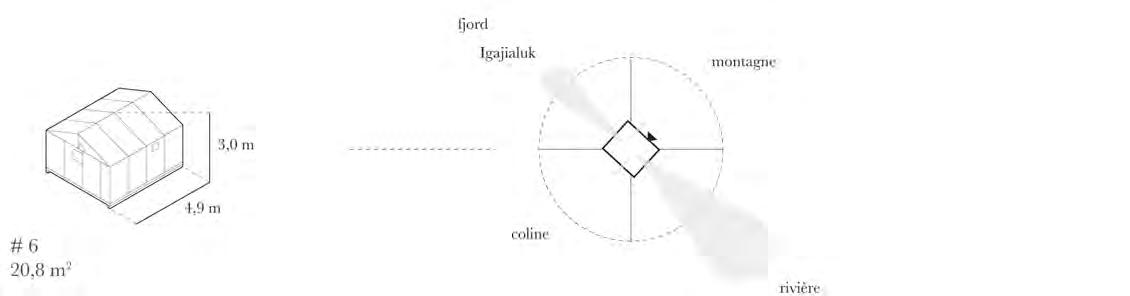
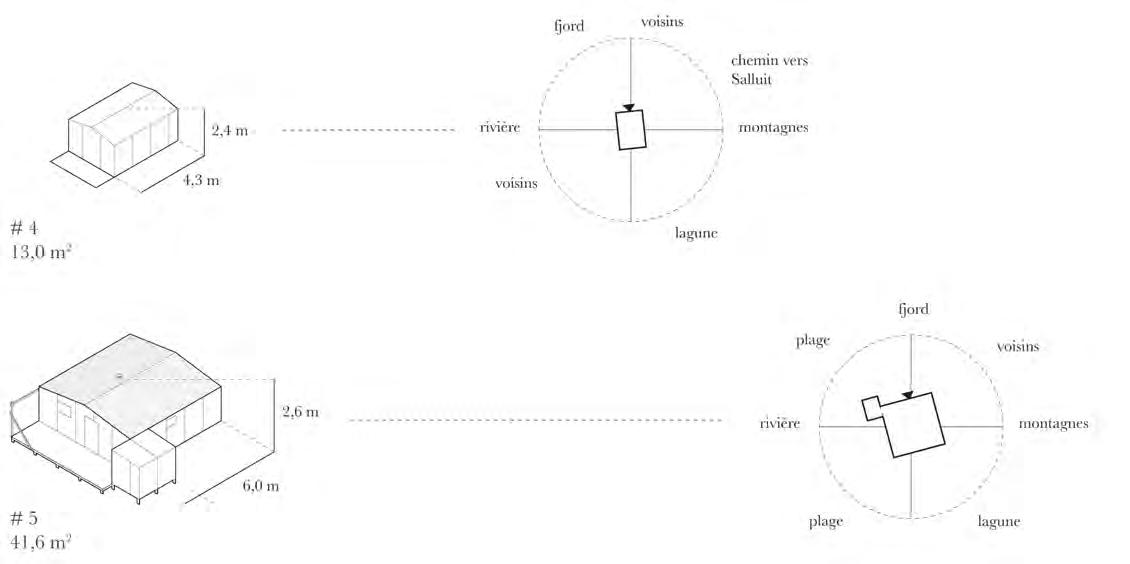
Volumétries Orientations
Les cabanes de Mivvik
Volumétries
Les volumétries des cabanes de Mivvik sont semblables d’une construction à l’autre dans la mesure où chacune est construite sur un plan rectangulaire, chacune possède une toiture à deux versants, et chacune suit une trame et une hauteur déduites par la modulation des panneaux de bois de leur enveloppe (4’x8’).
En dehors de ces similitudes, la cabane 10 est la plus singulière du campement. Plus carrée que rectangulaire et très fenestrée vers le fjord, son plan libre et sa grande hauteur sous plafond induite par ses pentes de toit peu prononcées laissent percevoir le désir d’y organiser un espace à la fois spacieux, ouvert et versatile.
De plus, le fait que cette cabane 10 présente des caractéristiques uniques au sein du campement de Mivvik et qu’elle en soit aussi la plus récente suggère peut-être une transformation active des pratiques d’autoconstruction du fjord. D’ailleurs, selon les entretiens avec les bâtisseurs locaux, il semble qu’obtenir des madriers assez solides pour soutenir de « grandes portées » soit plus facile qu’autrefois grâce à l’ofre de matériaux plus diversifée de la coopérative du village ainsi qu’à divers programmes d’aide à l’autoconstruction. Les récents et nombreux chantiers de rénovation et de construction des logements ont aussi
Annexe 1 - page 286
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
libéré des fenêtres et des rebus en tout genre facilitant et nourrissant l’inventivité des bâtisseurs.
Pour leur part, les cabanes 7, 8 et 9 ont la particularité d’avoir un petit balcon. Si dans le cas de la cabane 8 il s’agit davantage d’un marchepied, celui de la cabane 9 intègre un garde-corps qui agit aussi à titre de brisevent (ce qui facilite la cuisine à l’extérieure).
Positions
La distance moyenne des cabanes de Mivvik par rapport à la rive du fjord est très variable.Toutefois, il est important de rappeler que ces cabanes sont aussi éloignées entre elles et, qu’en ce sens, l’altitude très peu élevée de leurs assises par rapport à la ligne estimée des hautes eaux (0,3 à 1,4 m) offre peutêtre une explication à leur distance variable. Par exemple, en choisissant un site aussi plat et peu élevé par rapport au fjord, il est possible que les bâtisseurs aient été contraints de distancer leur cabane les unes des autres pour privilégier des localisations où ils ne seraient pas inondés à la première occasion.
Orientations
Les cônes de vision des cabanes 7, 8 et 9 indiquent des ouvertures restreintes sur la majorité des côtés. Ces ouvertures semblent organisées pour converger au centre des pièces. Les plus grandes fenêtres sont des bandeaux orientés vers la toundra (plaine), tandis que les plus petites fenêtres se trouvent sur les côtés courts et sont orientées vers le fjord (à l’avant) ou vers les montagnes (à l’arrière). Les entrées des cabanes 7, 8 et 9 sont d’ailleurs pratiquées sur les côtés courts faisant face au fjord.
En matière d’orientation, la cabane 10 est encore bien différente de ses voisines. Tel que le démontrent ses cônes de vision, les proportions de ses ouvertures vers le fjord et vers la rivière (et sa voisine) sont considérablement plus grandes. Comme les autres cabanes de Mivvik cela dit, les fenêtres de la cabane 10 convergent vers le coeur de l’espace, tandis que la porte est pratiquée sur le mur pignon (lequel fait face à l’ouest et est dépourvu d’autre ouverture).
Comparaison de la position des cabanes de Mivvik
Annexe 1 - page 287
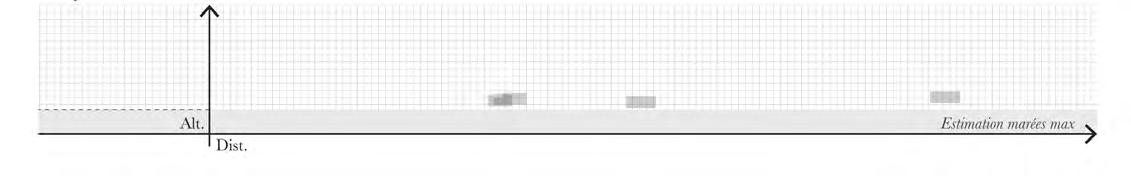
Volumétries
Annexe 1 - page 288
Positions par rapport au fjord
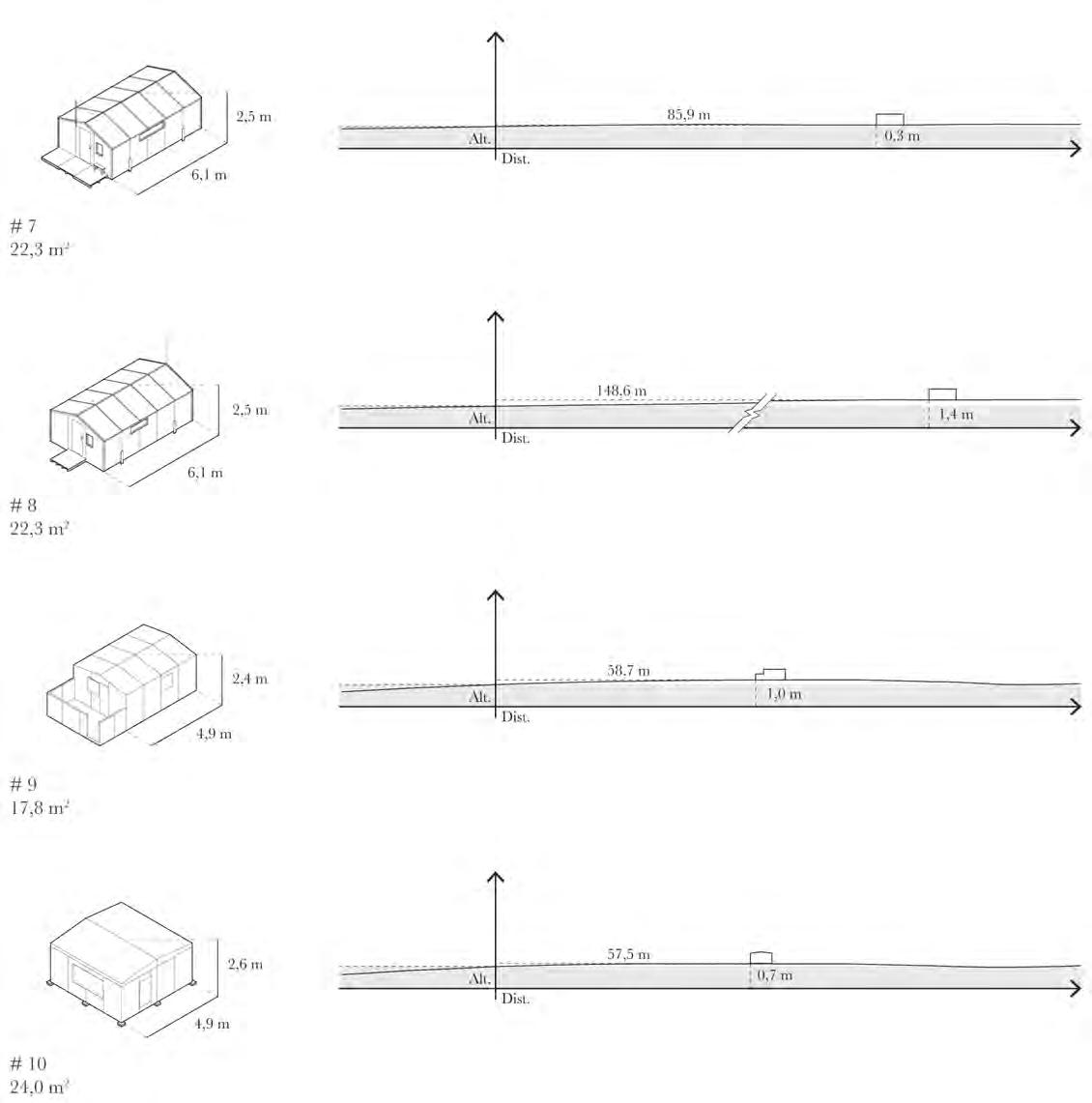
Volumétries
Annexe 1 - page 289
Orientations
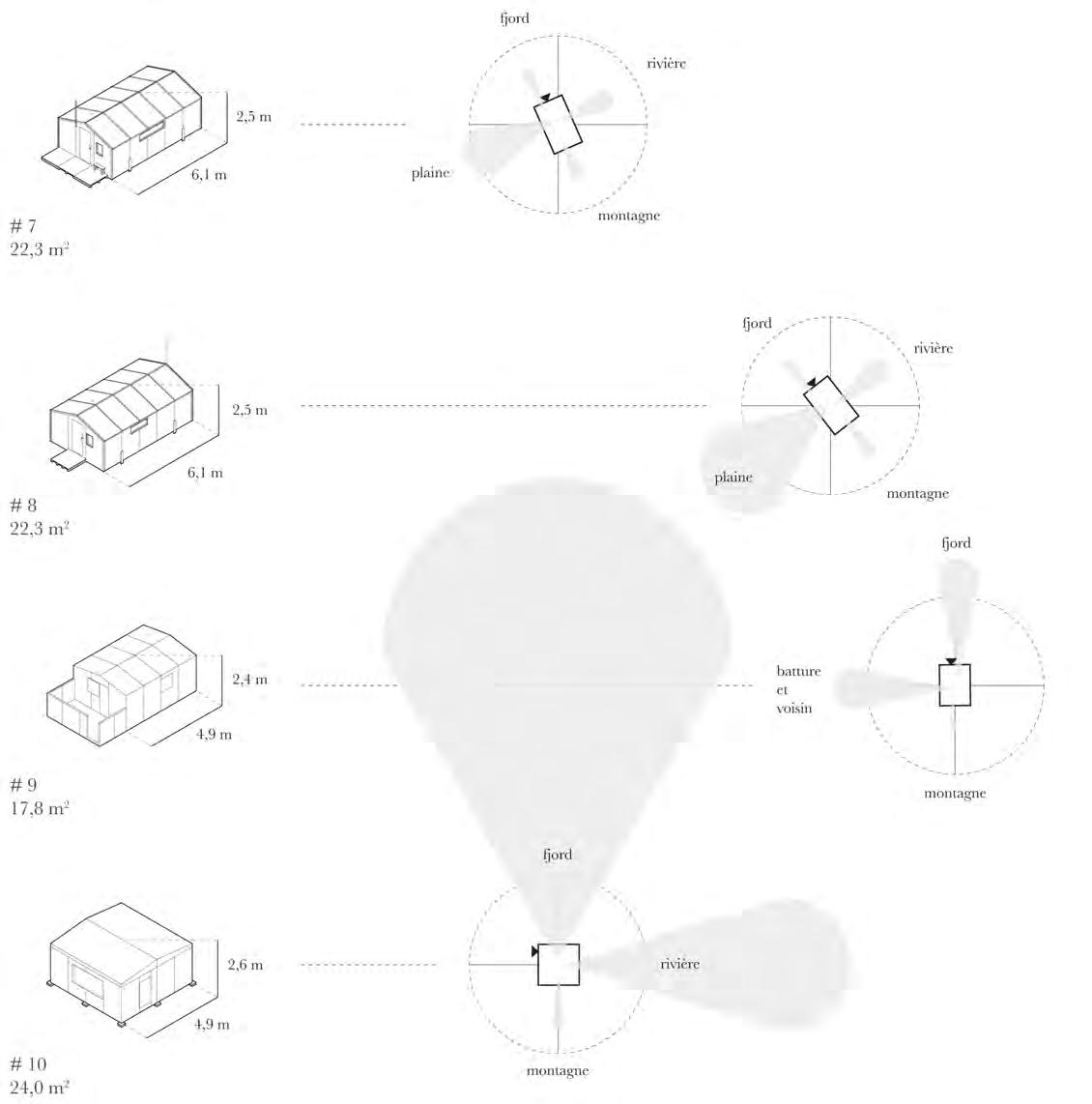
Les cabanes de Qarqaluarjutuaq
Volumétries
Comme au sein des deux campements précédents, les cabanes de Qarqaluarjutuaq partagent un plan rectangulaire, une hauteur d’environ huit pieds et possèdent pratiquement toutes un toit à deux versants. Les cabanes 11 et 18 sont diférentes dans leur forme puisqu’elles intègrent un sas d’entrée en appentis (dans le premier cas) et une annexe munie d’une toiture en noue (dans le second cas).

En matière de dimensions et d’enveloppe, la cabane 11 est très diférente des autres. Elle possède une superfcie de ± 34 m2, tandis que la superfcie moyenne des autres cabanes est de ± 20 m2. Son enveloppe (à l’apparence beaucoup plus étanche) est composée de déclins de vinyle
horizontaux et elle possède même des solins en aluminium (détail rarissime). En comparaison avec les autres cabanes, elle semble appartenir à un tout autre paradigme.
Les dimensions des cabanes 12 à 19 suivent pour leur part la modulation de panneaux de bois standards. Toutefois, et à la diférence de cabanes homologues au sein des autres campements, les panneaux de bois utilisés ici présentent un état plus vétuste ainsi qu’une rythmique quelque peu hétéroclite. Certains panneaux ont été raboutés, alors que d’autres ont été habilement récupérés de sorte que certaines façades prennent l’allure d’un patchwork.
Annexe 1 - page 290
Demeule, août 2018
La plupart des cabanes possèdent un balcon et près de la moitié de ces balcons intègrent un brise-vent ou un gardecorps d’environ un mètre de haut.
Les cabanes 14,15 et 19 possèdent de courts débords de toit, tandis que les autres n’en ont pas.
Positions
La distance moyenne des cabanes de Qarqaluarjutuaq se trouve à 21 m de la ligne estimée des hautes eaux du fjord, tandis que leur altitude moyenne se trouve à 2 m de cette même référence.
Le schéma d’ensemble exprimé au bas de la page démontre que les cabanes 12 à 18 forment un noyau plus dense et que les cabanes 11 et 19 se détachent sur des positions plus élevées. À cet efet, il est intéressant de constater que ces deux cabanes sont aussi les plus volumineuses du campement.
En se référant à l’étude de la morphogénèse des cabanes efectuée lors de l’analyse des campements, il apparait aussi pertinent de noter que la cabane 11 est plus récente que les autres cabanes de Qarqaluarjutuaq.
Orientations
La direction et la proportion des cônes de vision des cabanes 12 à 18 sont analogues dans la mesure où diverses petites ouvertures semblent orchestrées dans le but premier d’illuminer l’espace central.
Cependant, les cônes de visions démontrent également que chez certaines cabanes comme la 12 et la 18, des ouvertures plus importantes ou plus nombreuses sont préférablement orientées vers le fjord. D’ailleurs, si les cabanes 13 à 17 ne possèdent pas de fenêtres ofrant une vue particulièrement généreuse du fjord, elles orientent à tout le moins leur entrée dans cette direction. Dans presque tous les cas, de petites fenêtres aux pourtours des portes marquent aussi l’intention d’observer le fjord et les activités qui se déroulent sur l’eau ou sur la plage.
Finalement, la cabane 11 se distingue aussi par ses ouvertures puisque celles-ci sont orientées de façon à cadrer les rives du fjord et de la rivière Foucault. Parallèlement, si les vues en contrebas vers le reste du campement semblent moins privilégiées, un chemin d’accès, l’aire d’activités extérieures et l’entrée de la cabane sont positionnés de façon à favoriser les échanges avec la communauté (voir analyse du campement de Qarqaluarjutuaq, p. 42).
Comparaison de la position des cabanes de Qarqaluarjutuaq
Annexe 1 - page 291
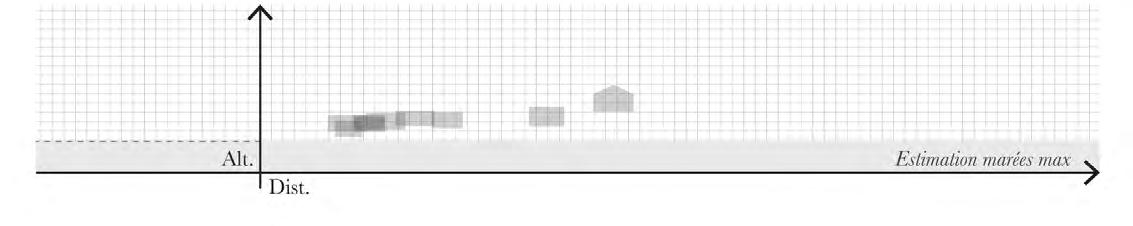
Volumétries Positions par rapport au fjord
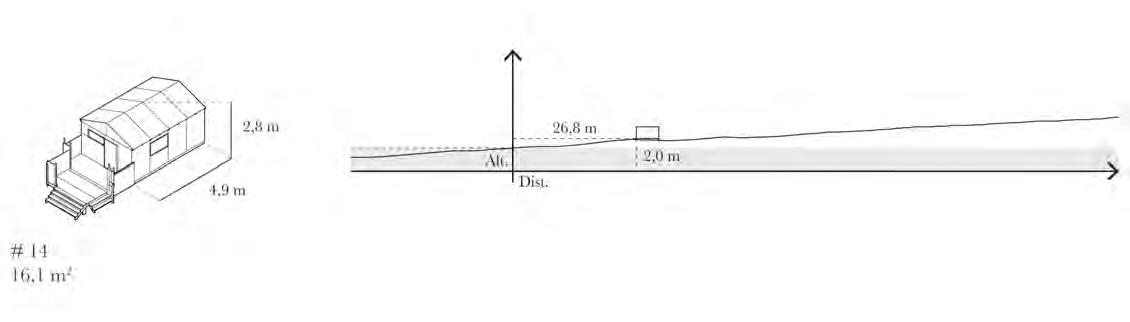
Annexe 1 - page 292
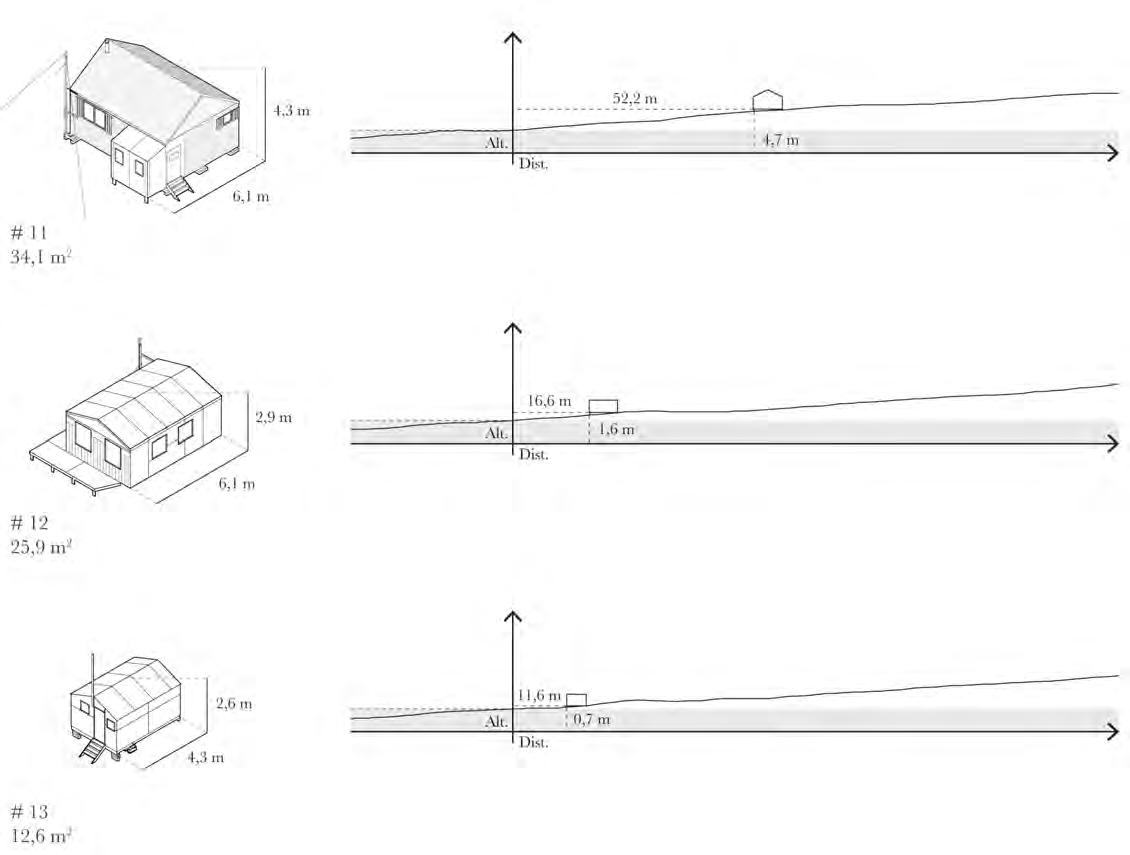
Annexe 1 - page 293
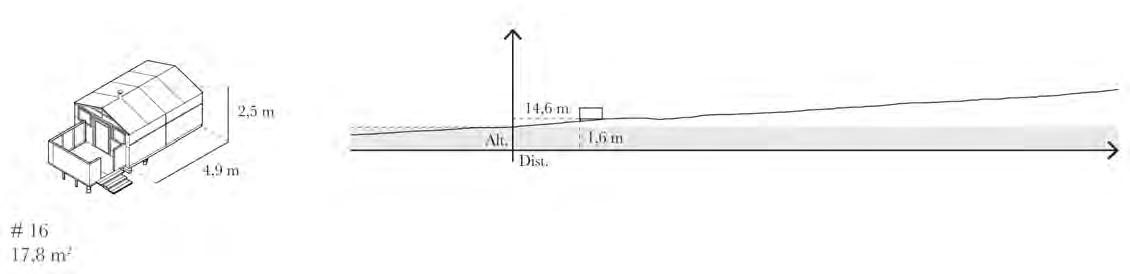
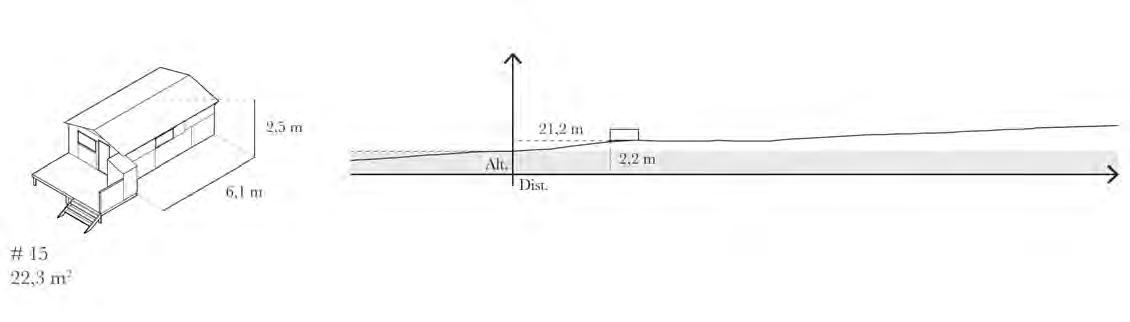
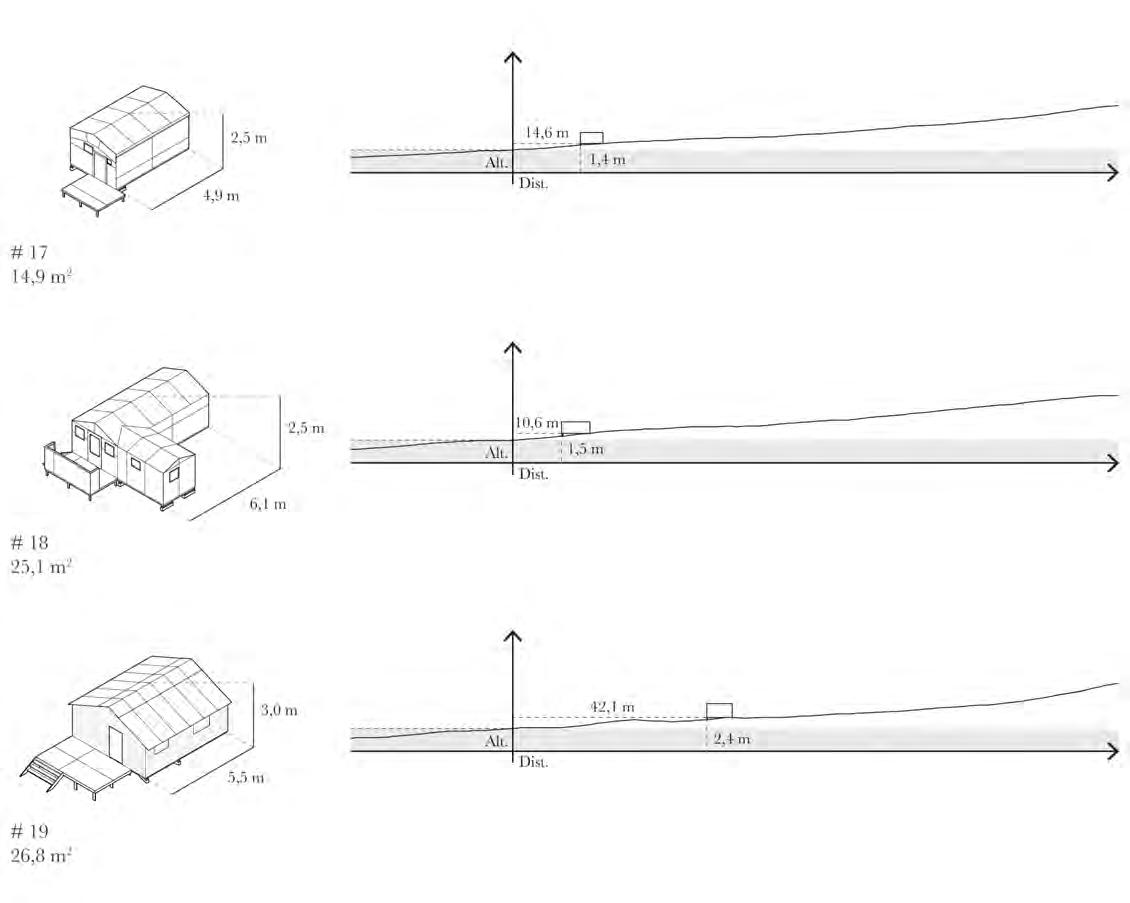
Annexe 1 - page 294
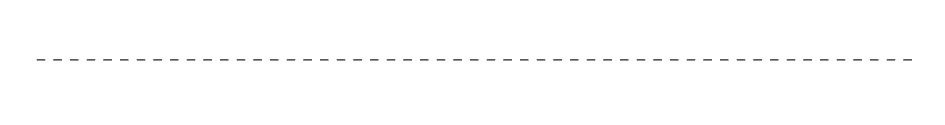
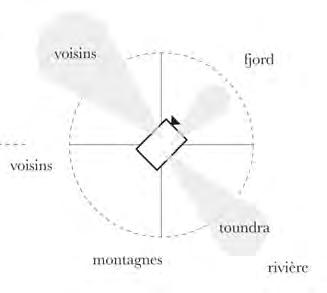
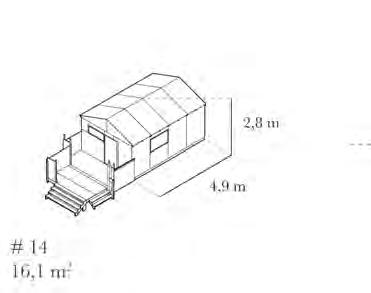
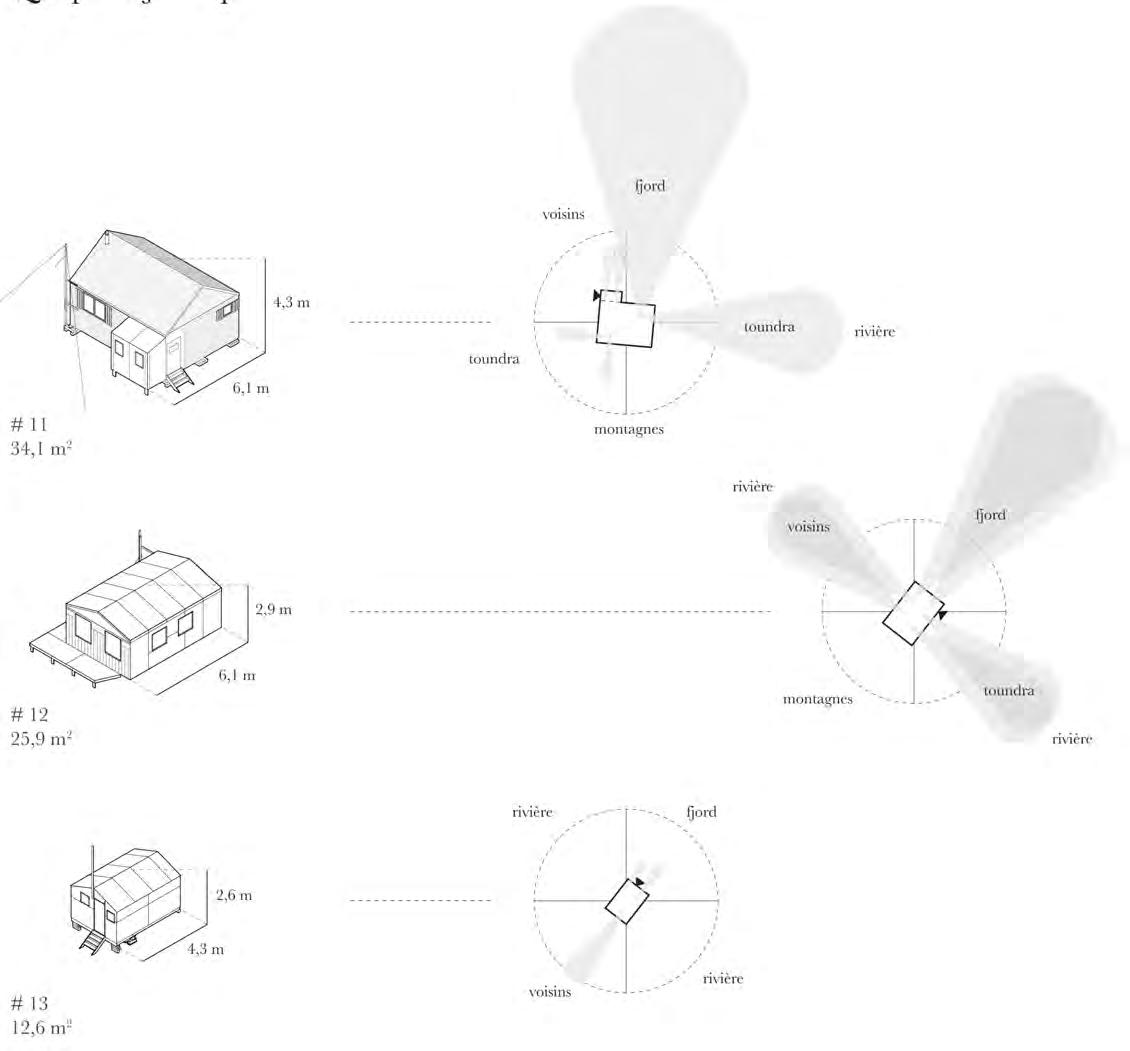
Volumétries Orientations
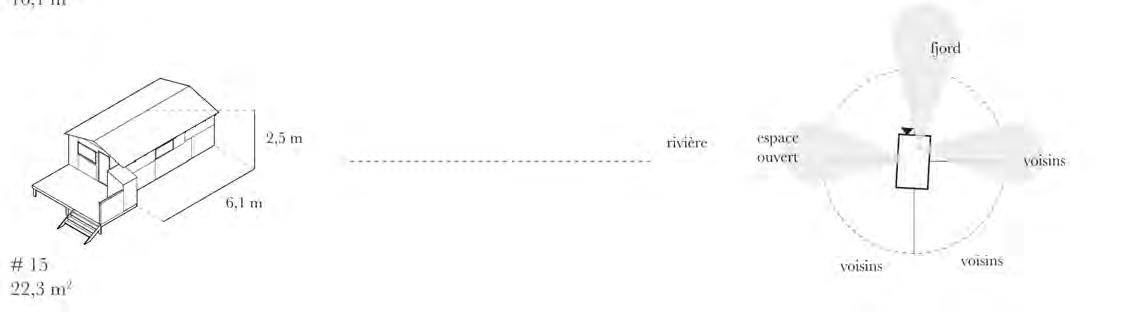
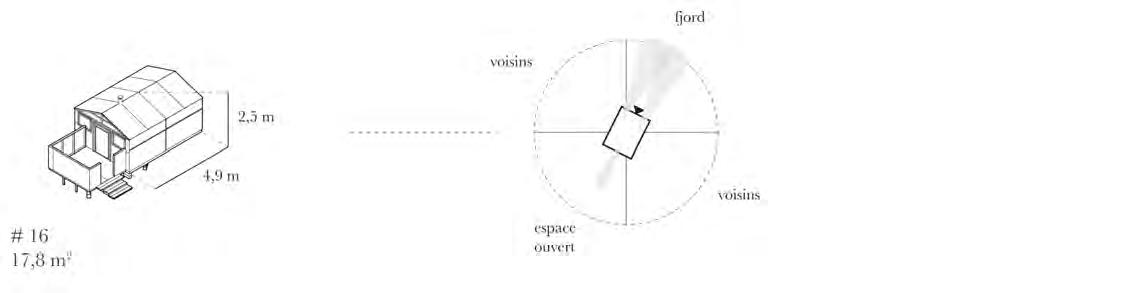
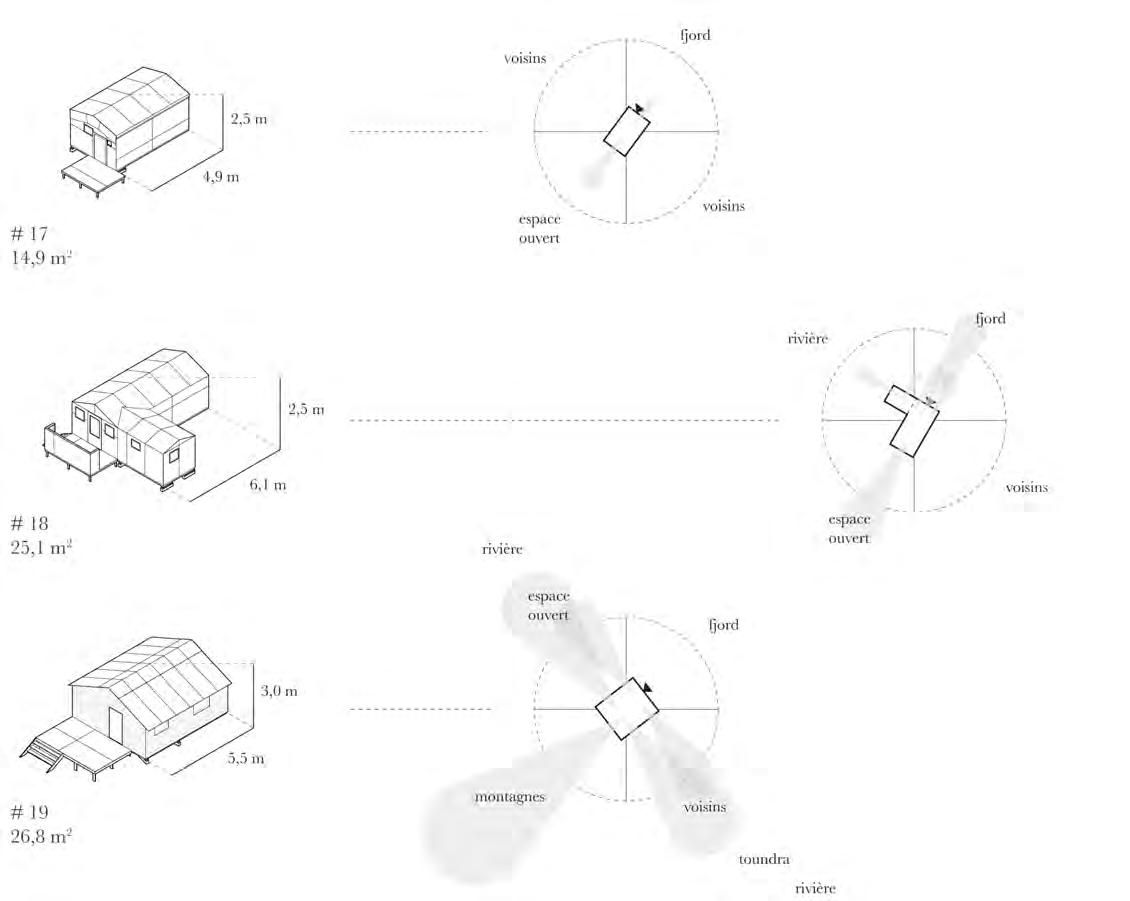
Annexe 1 - page 295
Les cabanes de Sittuuniit
Volumétries
Au campement de Sittuuniit, la majorité des cabanes sont plus volumineuses que celles relevées dans les autres sites en amont du fjord (vers l’ouest). De plus, la moitié d’entre elles sont implantées selon un axe parallèle au fjord et toutes présentent des annexes et les traces de multiples transformations. Par conséquent, la volumétrie des constructions de Sittuuniit est variée et si chaque cabane semble répondre aux besoins particuliers des occupants, il reste que les configurations de leurs ajouts suggèrent des processus évolutifs homologues. Les

enveloppes des annexes comme des cabanes sont dimensionnées par la modulation des panneaux de bois (4’x8’) et les volumes sont toujours conçus sur un plan rectangulaire.
Au niveau des toitures, le volume initial des cabanes est toujours chapeauté d’un toit à deux versants, tandis que ceux des annexes peuvent en présenter un ou deux.
Dans l’ensemble, deux types d’annexes se distinguent. Il y a les sas d’entrée qui peuvent offrir
Annexe 1 - page 296
Demeule, août 2018
du rangement supplémentaire, un espace de cuisine ventilé ainsi qu’une protection des bourrasques visà-vis l’entrée, puis il y a les annexes qui augmentent les espaces dédiés au séjour et au repos. Dans le cas de la cabane 29, le sas d’entrée est placé en position latérale (du côté opposé aux vents dominants), tandis que les deux annexes qui augmentent l’habitabilité de la cabane ont été construites du côté du fjord. Cet exemple permet aussi de percevoir comment l’orientation et la configuration des sas et des annexes semblent le plus souvent réfléchies dans l’optique de conserver ou d’améliorer les contacts et les percées visuelles vers le fjord.
Positions
Les positions des cabanes de Sittuuniit sont réparties en trois zones. Une première série de cabanes implantées sur un plateau bas forment une rangée parallèle à la rive. Ces cabanes (29 à 32) se situent en moyenne à 20 m de la ligne estimée des hautes eaux du fjord. Vers la rivière, la rangée de cabanes se dédouble et les cabanes 33 à 35 forment un carré où la distance moyenne par rapport au fjord est
alors de 33 m. Pour ces sept cabanes implantées au niveau de la plage, l’altitude moyenne est de 2 m. Les cabanes 26 à 28 forment la troisième série. Elles sont plus distantes entre elles, plus éloignées du fjord et surtout plus élevées (leur altitude moyenne est de 8 m). Enfn, il est intéressant de constater qu’à défaut d’investir davantage le plateau bas plus facilement constructible, certains bâtisseurs ont peut-être préféré resserrer certains liens de voisinage en s’implantant sur le plateau supérieur. Cela dit, il faut souligner que plus de hauteur signife également un meilleur regard sur les eaux du fjord et l’orientation des cabanes 26 à 28 en tire aussi avantage.
Orientations
Au risque de répéter ce qui a été mentionné sur l’orientation des cabanes de Sittuuniit à travers l’analyse de leur position, il est important de signaler que les cônes de vision indiquent clairement une orientation préférable des ouvertures des cabanes vers le fjord. Aussi, les entrées des sas positionnées face au fjord communiquent toujours avec des aires d’activités extérieures fortement en lien avec la communauté et la rive.
Comparaison de la position des cabanes de Sittuuniit
Annexe 1 - page 297
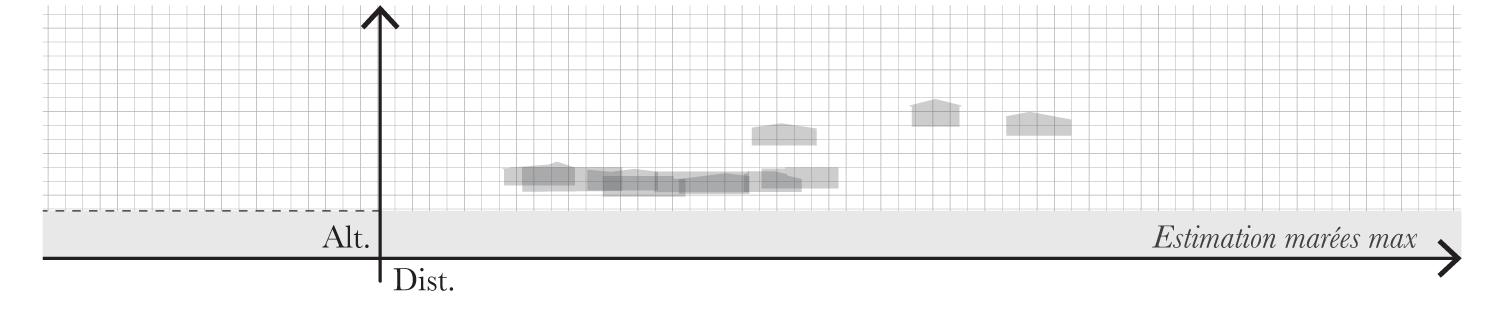
Volumétries
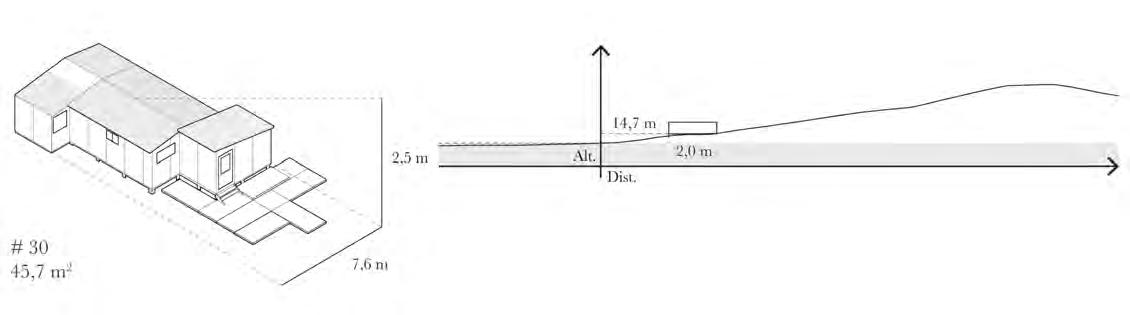
Annexe 1 - page 298
Positions par rapport au fjord
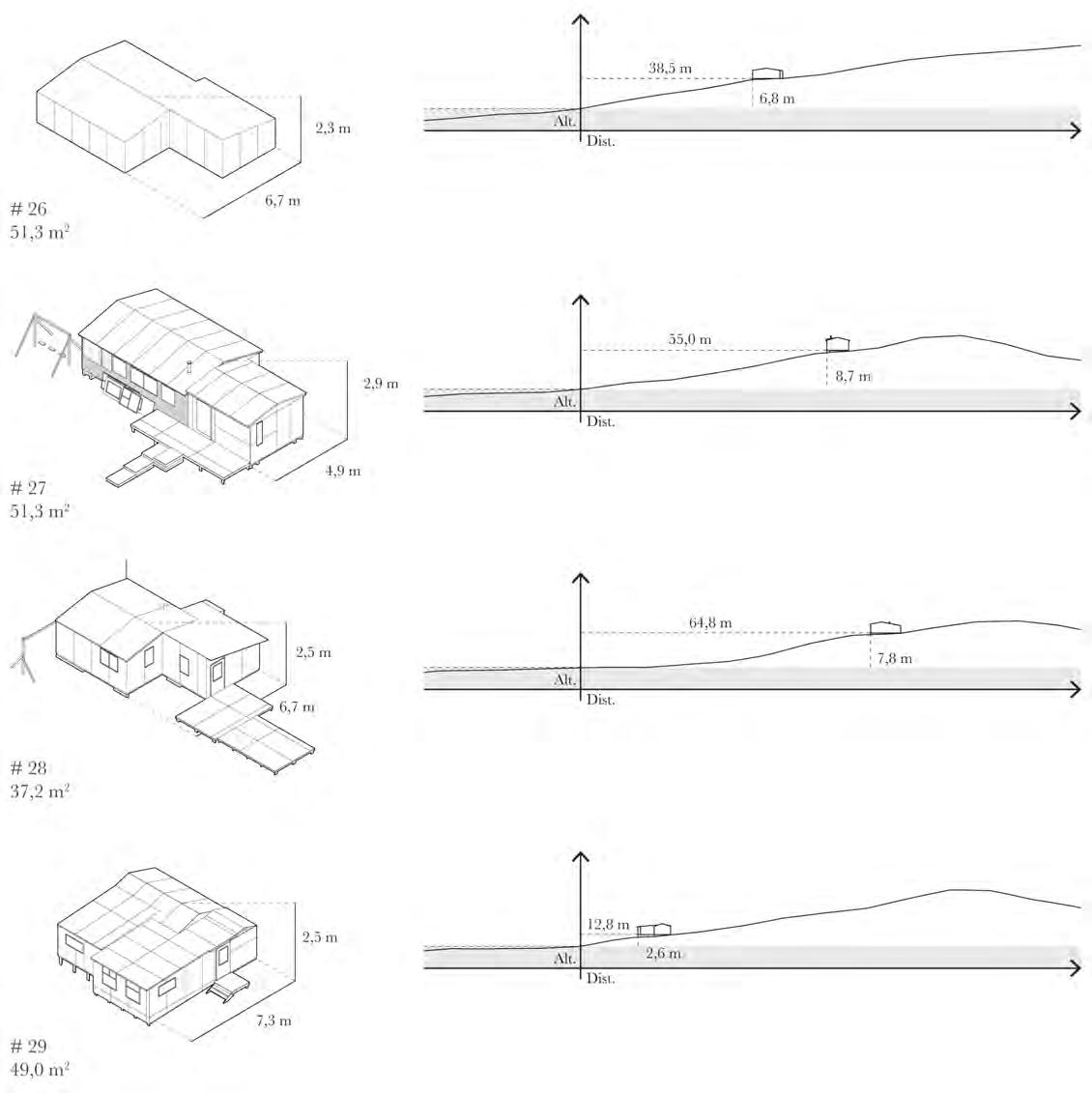
Volumétries Positions par rapport au fjord
Annexe 1 - page 299
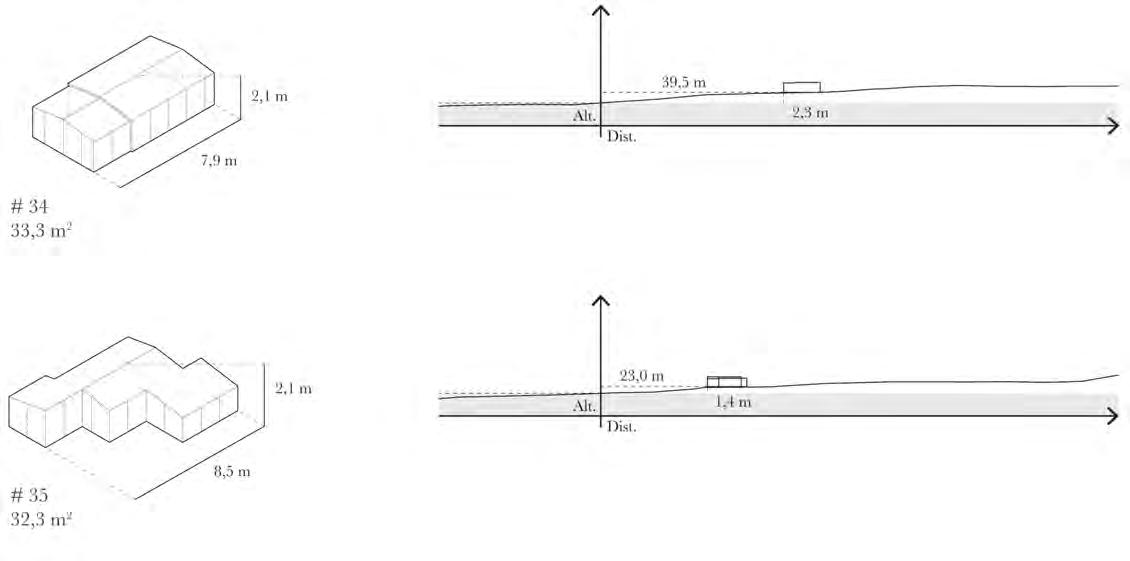
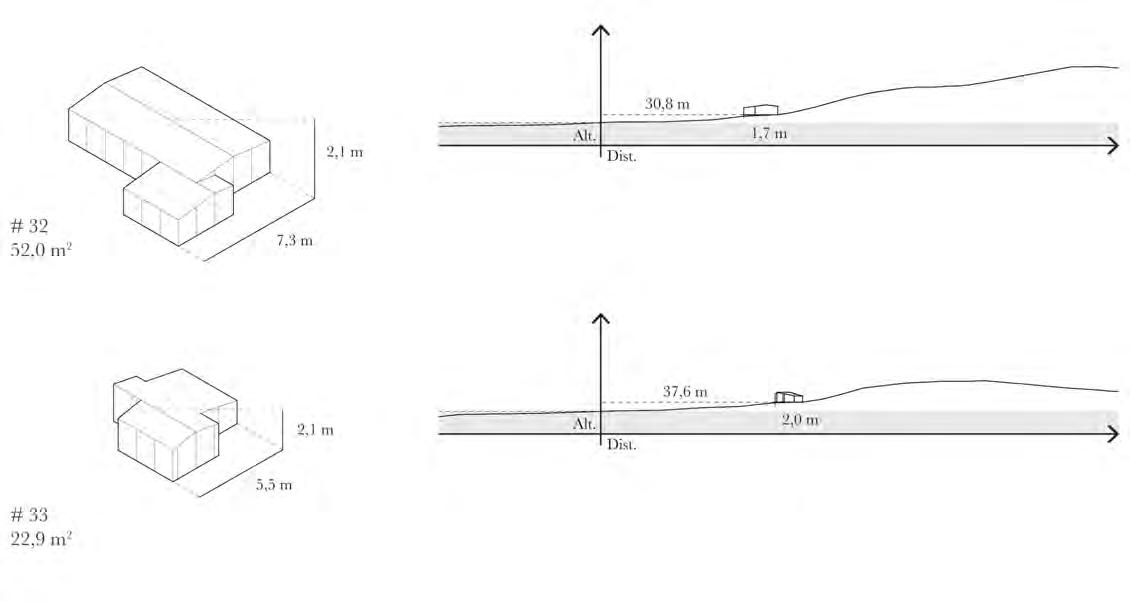
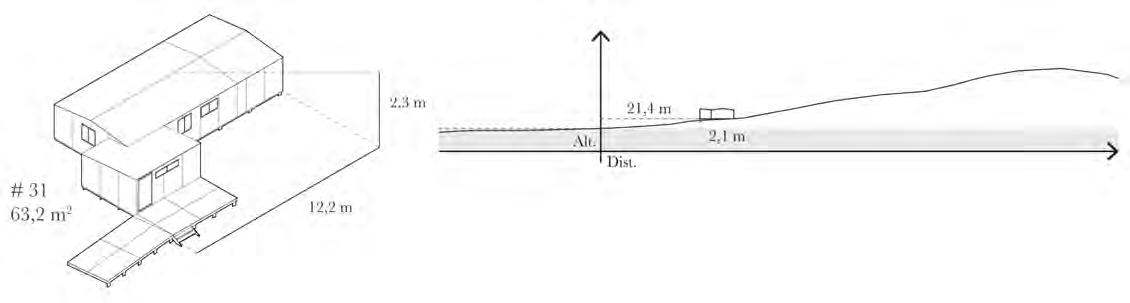
Annexe 1 - page 300
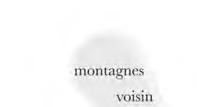
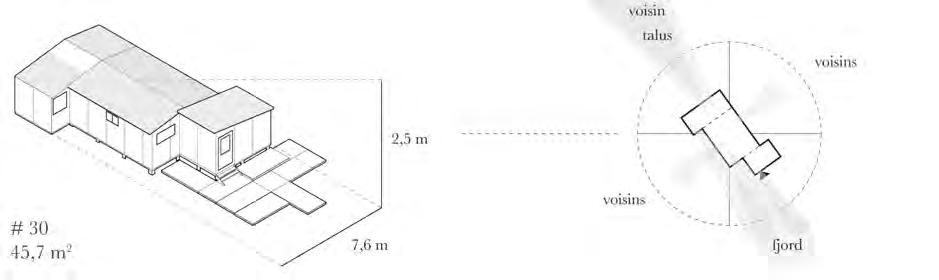
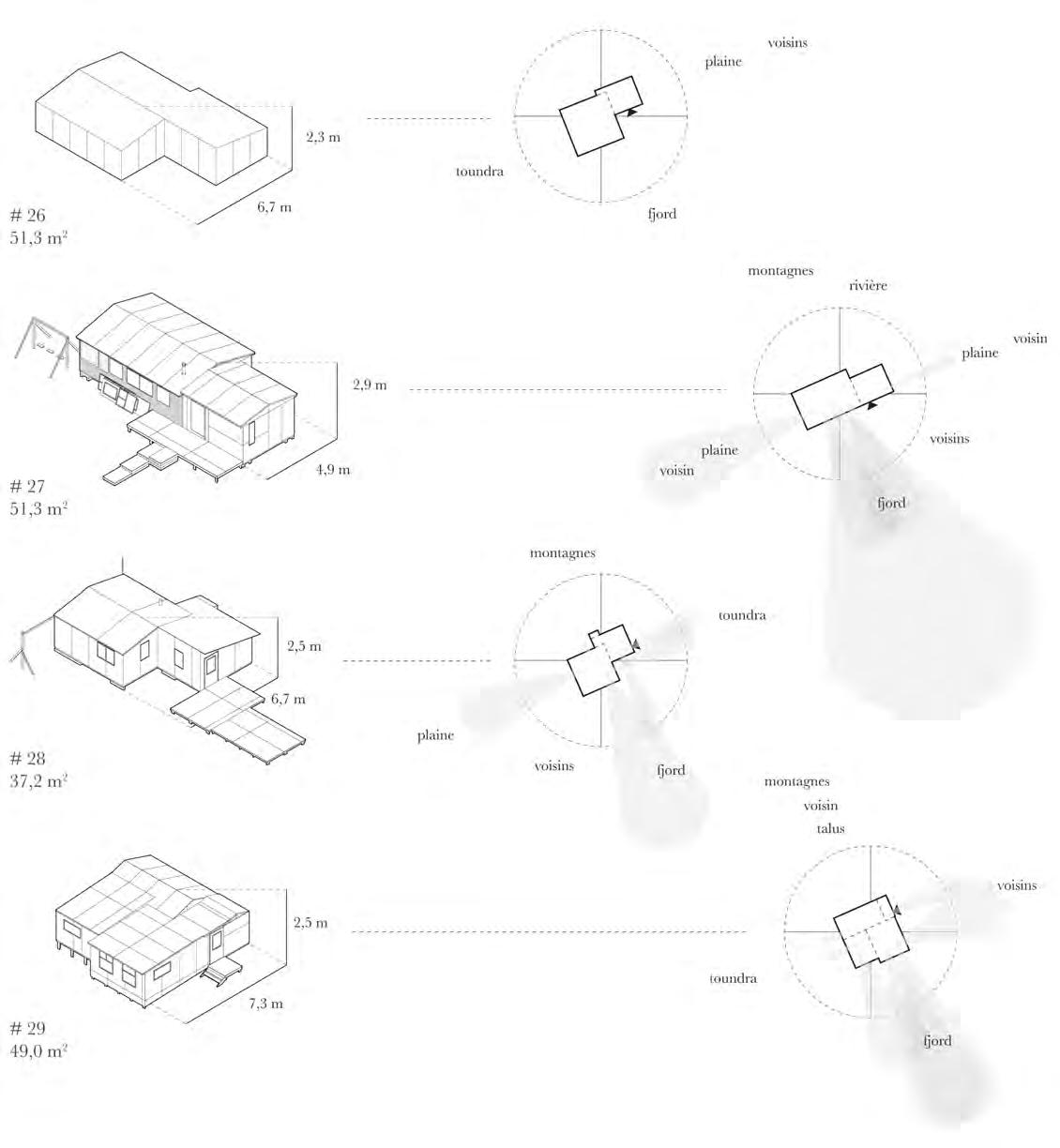
Volumétries Orientations
Annexe 1 - page 301
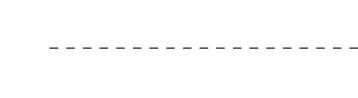
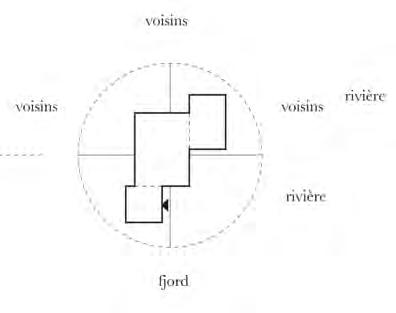
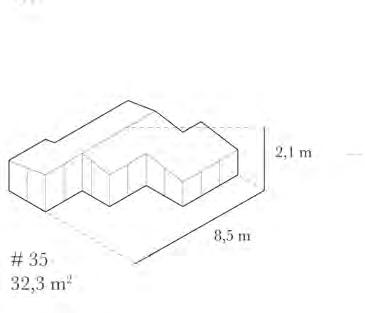
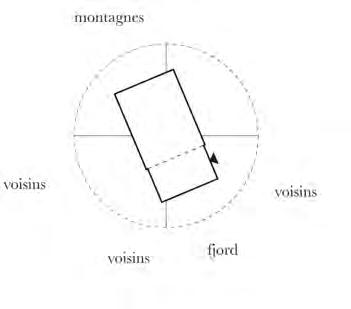
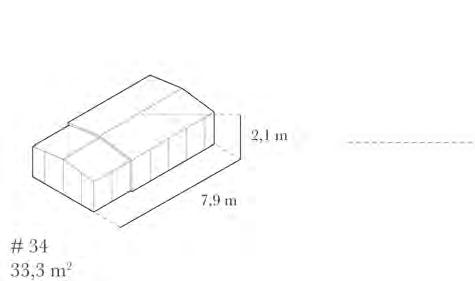
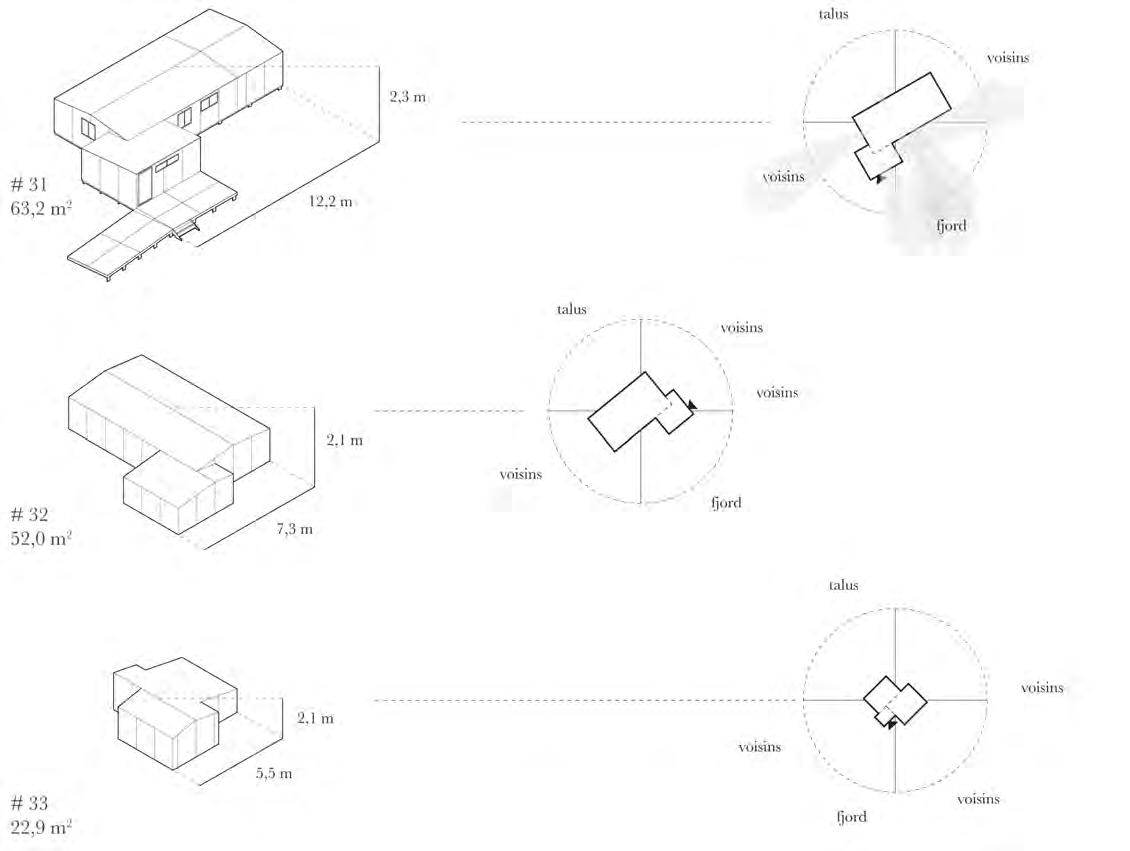
Volumétries Orientations
Les cabanes de Kikkaluk

Volumétries
Les cabanes de Kikkaluk partagent beaucoup de points en commun avec les cabanes de Sittuuniit. Par exemple, les dimensions des grandes et des moyennes cabanes sont comparables et toutes possèdent au moins, un sas, une annexe ou de multiples traces de transformations. Toutefois, la présence d’afeurements rocheux induit à Kikkaluk des implantations et des confgurations formelles plus variables qu’à Sittuuniit puisque la morphologie du sol est évidemment moins homogène. Dans l’ensemble, les sas, les annexes ou les volumes initiaux des cabanes semblent suivre des règles de composition semblables à celles précédemment relevées.
À cet efet, il est intéressant de noter que les cabanes 78 à 81 sont parmi les plus grandes, les plus transformées et les plus tournées vers le fjord. Parallèlement, elles semblent aussi avoir été modifées dans le but d’ofrir un meilleur « confort » (ajout de chambres, d’espaces de séjour et de pièces de services comme une salle de bain et de plus grands espaces de cuisine).
Enfn, presque toutes les cabanes de Kikkaluk disposent d’un système de chaufage ou possèdent des infrastructures permettant d’en installer un temporairement (support extérieur pour le carburant, ouverture dans l’enveloppe pour la cheminée et trou d’aération au pignon).
Annexe 1 - page 302
Demeule, août 2018
Positions
Les cabanes de Kikkaluk sont dispersées les unes par rapport aux autres en raison de l’implantation de quatre d’entre elles sur un afeurement rocheux au profl irrégulier. Les quatre autres cabanes du campement sont plus rapprochées entre elles et se trouvent sur des dépôts littoraux et marins. La position en hauteur des quatre premières cabanes les distancie du fjord, tandis que les quatre autres sont implantées plus bas, plus près de la plage. Ici encore, il semble important de noter que les cabanes les plus récentes ou les plus récemment transformées sont celles qui occupent les afeurements rocheux (78, 79, 80, 81). Ainsi, bien que certaines autres cabanes implantées sur la plage aient aussi subi des transformations importantes, celles-ci semblent simultanément plus anciennes.
Orientations
La comparaison des cônes de visions des cabanes en positions hautes et des cabanes en positions basses de Kikkaluk résume bien les observations efectuées jusqu’à présent sur l’ensemble des autres cabanes.
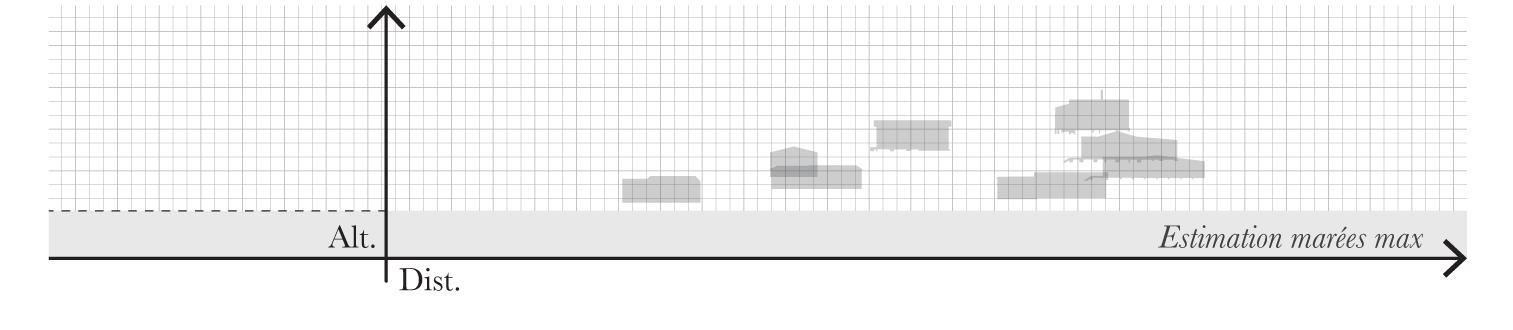
Les constructions plus récentes ou plus récemment transformées orientent leurs ouvertures et leurs espaces intérieurs de telle sorte que leur relation avec le fjord apparaît magnifée. De plus, il est utile de se référer aux plans des campements pour constater que les orientations et les vues semblent choisies avec une attention qui respecte les percées visuelles des autres cabanes. En ce sens, les entrées et les sas se retrouvent plus souvent en position latérale, soit sur les faces des cabanes les moins fenestrées et les plus susceptibles d’ofrir une protection des vents.
Les cabanes anciennes, plus souvent construites près de l’eau (en terrain bas) et sur des dépôts meublent, présentent aussi une tendance à orienter leurs confgurations et leur espace d’activités extérieures vers le fjord. Toutefois, cette tendance s’exprime moins par le nombre, la dimension ou l’orientation des ouvertures que par l’orientation de leur entrée face à la rive ou la proximité de leurs assises avec celle-ci.
Comparaison de la position des cabanes de Kikkaluk
Annexe 1 - page 303
Volumétries Positions par rapport au fjord
Annexe 1 - page 304
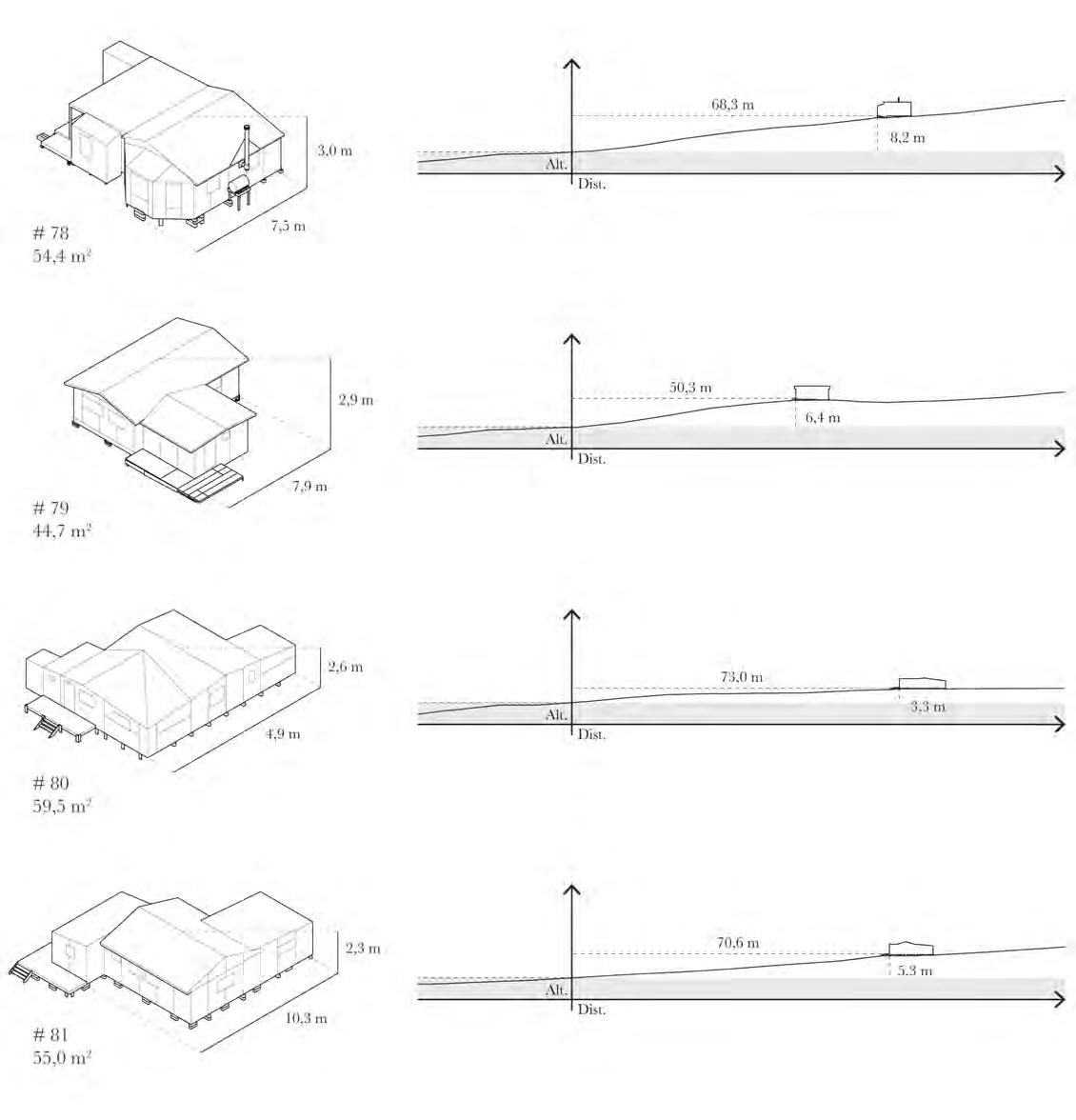
Volumétries Positions par rapport au fjord
Annexe 1 - page 305
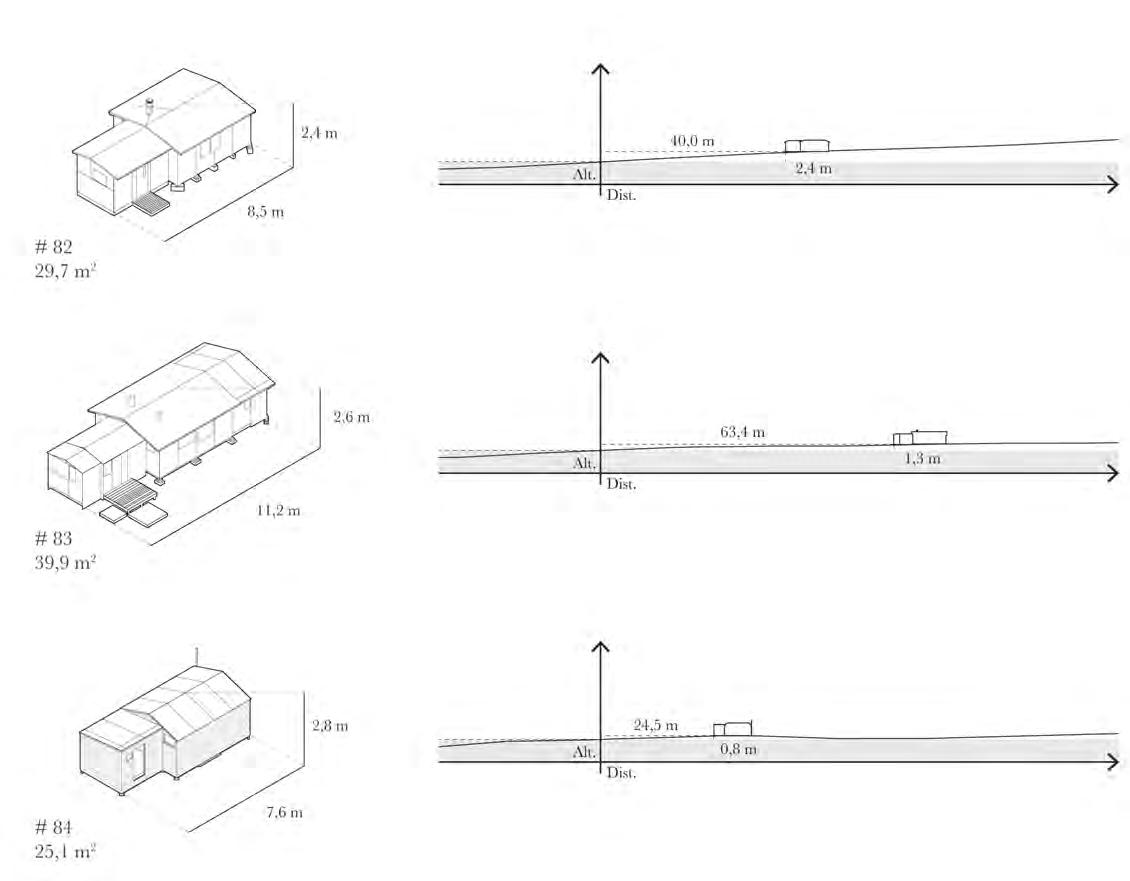
Annexe 1 - page 306
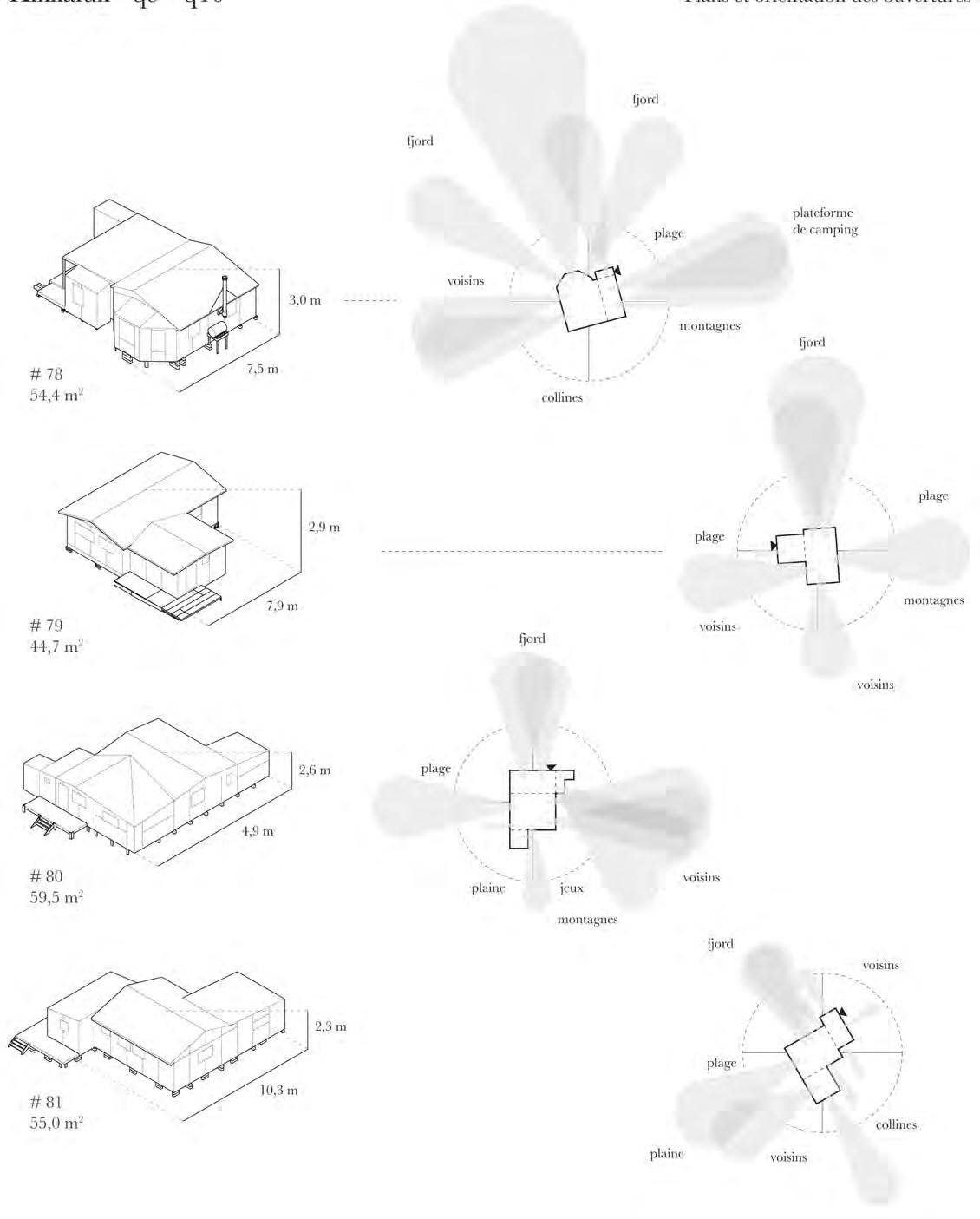
Volumétries Orientations
fjord
Annexe 1 - page 307
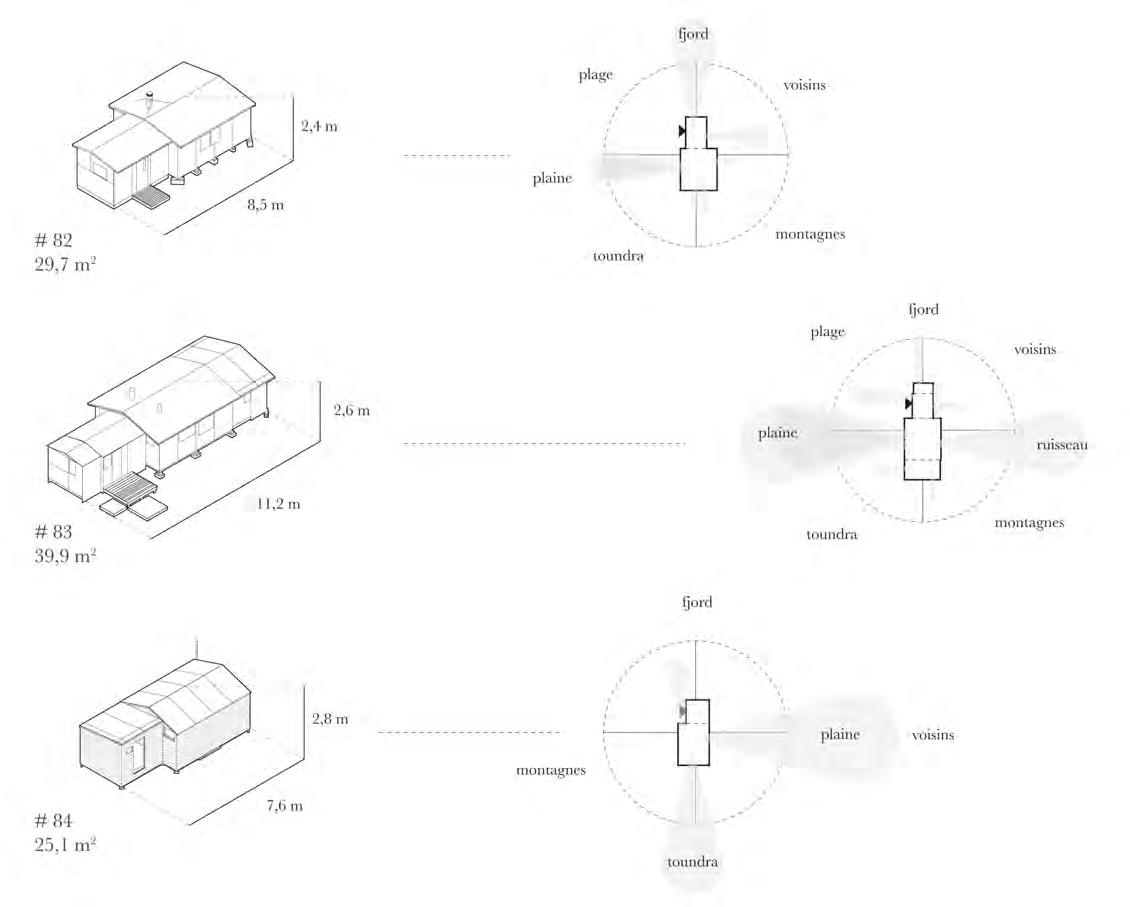
Volumétries Orientations
Les cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk
Volumétries
Les trois cabanes solitaires de Qikkigiaq et Kikkalualuk présentent une volumétrie analogue à celle de la grande majorité des autres cabanes relevées dans le fjord de Salluit. Elles sont construites sur un plan rectangulaire qui suit une trame déterminée par les dimensions des panneaux de bois de leur enveloppe (4’x8’). En ce sens, la hauteur des murs porteurs ne dépasse pas huit pieds, leur toiture présente deux versants et elles sont implantées de façon à limiter leur emprise face aux vents (soit ici de façon parallèle à la rive).
La cabane 85 est la seule des trois à avoir un sas d’entrée, tandis que les cabanes 86, 86 et 88 possèdent toutes un balcon. Dans le cas de la cabane 86, ce balcon est directement constitué par l’affleurement rocheux très plat sur lequel elle est implantée (voir analyse et photo du campement de Kikkalualuk 1/2, p. 142).

1 - page 308
Demeule, août 2018
Annexe
Positions
Malgré leur implantation sur des sols de natures différentes, les positions des cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk sont très similaires. Leur distance moyenne se trouve à 36 m de la ligne des hautes eaux du fjord, tandis que leur altitude moyenne se trouve à 3 m de cette même ligne de référence.
Orientations
Les cônes de vision démontrent que les ouvertures des cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk sont encore une fois positionnées dans le but d’offrir un maximum de vues vers le fjord de Salluit.
Ainsi, bien que les entrées des cabanes 85 et 88 se trouvent face au fjord, celles-ci sont organisées en faveur des espaces intérieurs qui conservent de grandes percées visuelles vers la rive. L’une fait usage d’un sas latéral pour libérer ses façades avant et arrière, tandis que l’autre place son entrée au milieu de sa façade avant pour que chacun des deux côtés de son espace intérieur bénéficie d’une grande fenêtre.
Pour sa part, l’entrée de la cabane 86 est en position latérale, soit face au nord et à l’embouchure du fjord. Cette configuration orchestre deux grandes fenêtres vers la rive ainsi qu’une autre adjacente à l’entrée et orientée vers l’aire d’activités extérieures.
Comparaison de la position des cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk

Annexe 1 - page 309
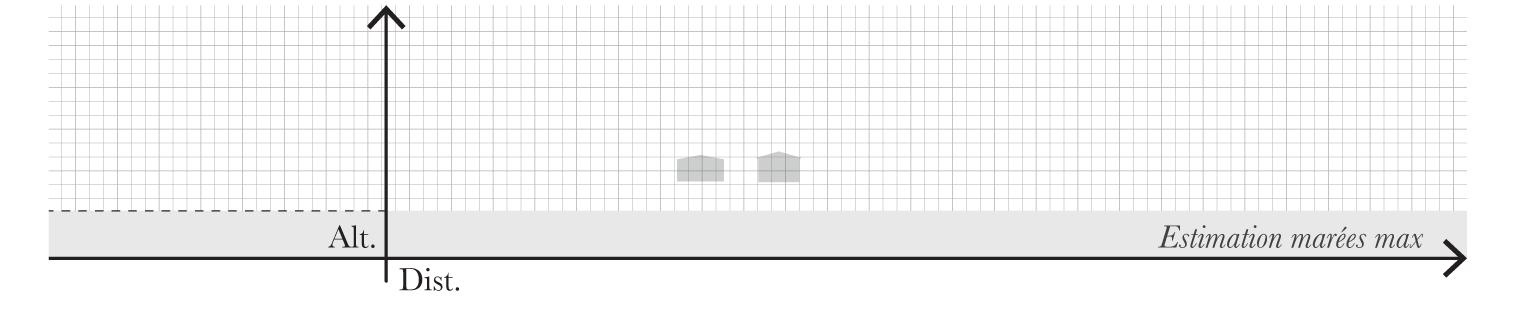
Volumétries
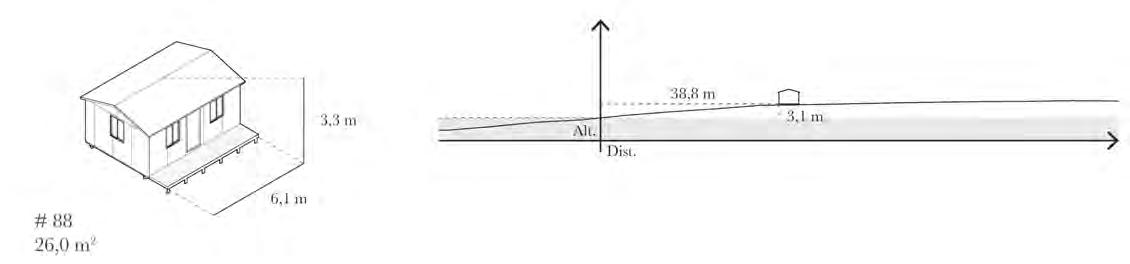
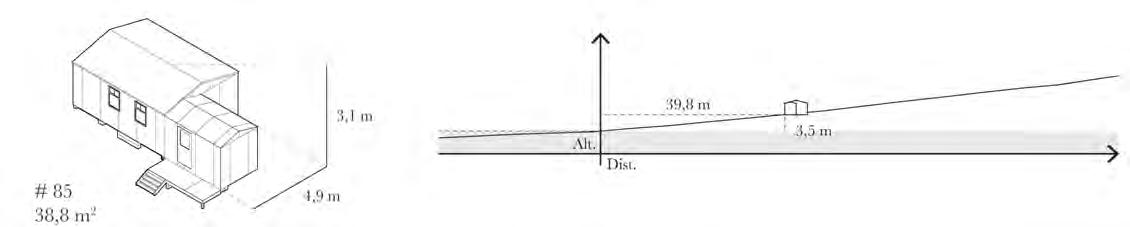
Annexe 1 - page 310
Positions par rapport au fjord
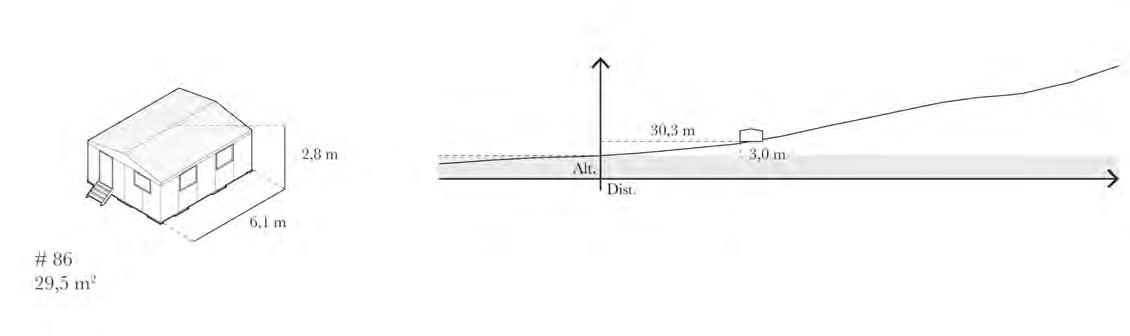
Annexe 1 - page 311
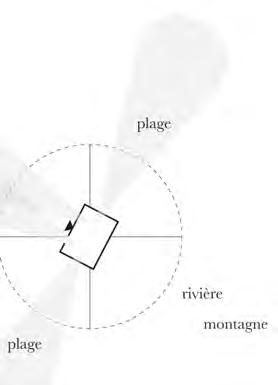

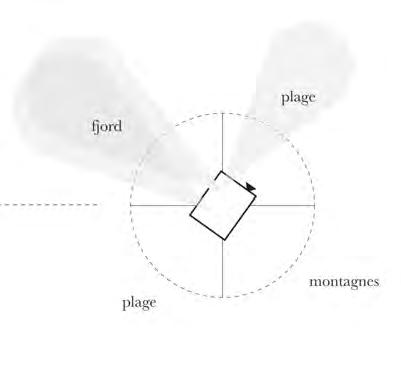
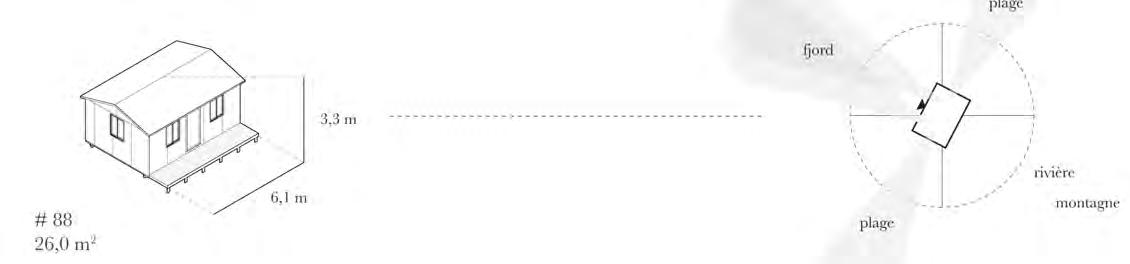
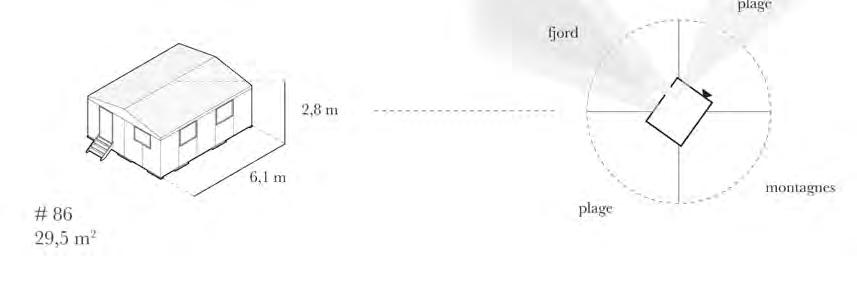
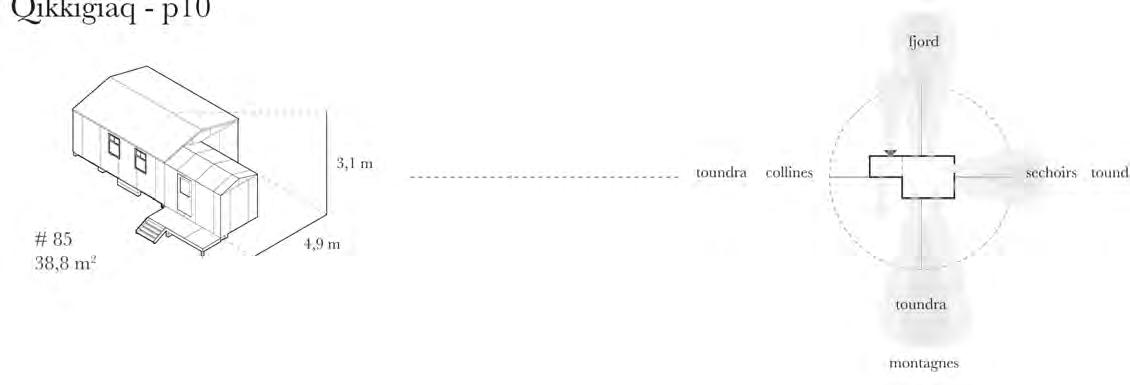
Volumétries Orientations

IV
ANALYSE DE LA TECTONIQUE DES CABANES ET SUGGESTION DE MODÈLES TYPES

Méthode d’analyse de la tectonique des cabanes
Le texte qui suit constitue un extrait du chapitre 6 du mémoire.
La dernière échelle d’analyse a, dans un premier temps, exploré à tâtons la composition matérielle des 39 cabanes relevées sur le terrain et des 61 autres observées à distance par photographies ou images satellites. Après avoir acquis une connaissance sommaire de cet échantillon, cinq cabanes sensiblement diférentes et représentatives des caractéristiques observées jusqu’alors ont été sélectionnées. Ce choix a identifé deux premiers exemples correspondants le mieux aux « plus petites » et aux « plus grandes » cabanes. Un premier modèle type appelé « la cabane en mouvement » a englobé 13 cabanes parmi celles relevées, alors que l’autre modèle plus abouti et complexe, nommé « la cabane fxe et déployée », en a regroupé cinq. Les cabanes restantes ont été réparties au sein de trois modèles intermédiaires : « la cabane immobilisée » ; « la cabane qui observe (type a) » et « la cabane qui observe (type b) ». Ces modèles intermédiaires suggèrent une évolution des approches constructives plus ou moins directe ou exclusive. Chaque modèle tente d’identifer, en ce sens, une logique d’assemblage qui s’appuie sur l’expérience du modèle précédent et s’ils ne constituent pas une forme ou un passage obligé entre eux, ils supposent à tout le moins l’infuence dans le
temps de processus de formation et de transformation du bâti qui ont cours à travers les pratiques d’autoconstruction du fjord. En fonction des facteurs étudiés jusqu’à maintenant, et pour rendre compte des diférents degrés de corrélation perceptibles entre ces modèles, les fgures [présentées au sein de la section suivante] sont éclairantes.
Ces divers liens entre les modèles suggérés ont fnalement encouragé la précision de caractéristiques formelles permettant de mieux décrire la confguration des cabanes observées au sein du fjord de Salluit. Pour ce faire, la déconstruction graphique s’est poursuivie en deux temps : soit par une lecture, une modélisation et une hiérarchisation numérique des diférents modèles et de leurs matériaux ; puis par la production de dessins axonométriques détaillés permettant de comparer et d’illustrer des caractéristiques typiques à chaque modèle.
La fguration de chaque couche de matériaux superposée les unes aux autres a ainsi permis de comparer les logiques d’assemblage des cabanes et d’approfondir une compréhension architectonique de leur formation et de leurs transformations.
Annexe 1 - page 314
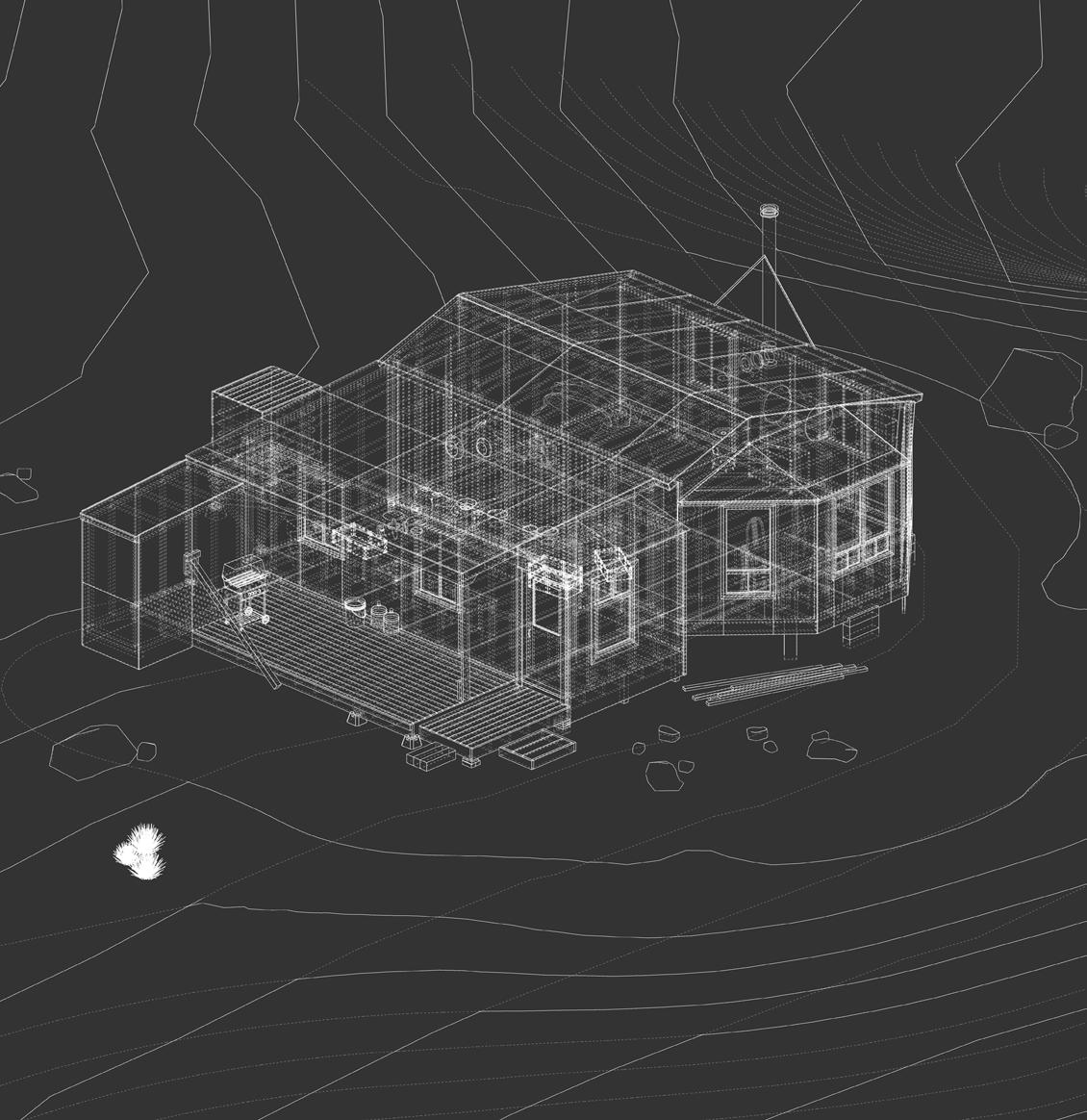 Figure 11. Exemple du niveau de détails d’une modélisation numérique d’une cabane.
Annexe 1 - page 315
Figure 11. Exemple du niveau de détails d’une modélisation numérique d’une cabane.
Annexe 1 - page 315
Les cabanes en mouvement
Les cabanes en mouvement se déploient en des constructions sufsamment petites et élémentaires pour permettre leur remorquage complet ou en pièces détachées sur les glaces du fjord. Ces cabanes s’implantent donc sur des sites de faible élévation et leur orientation adopte un axe parallèle à la direction des vents. Au sein de l’échantillon observé, cet axe était le plus souvent perpendiculaire à la rive et il était alors facile d’imaginer comment les cabanes avaient pu être tirées depuis le fjord gelé.
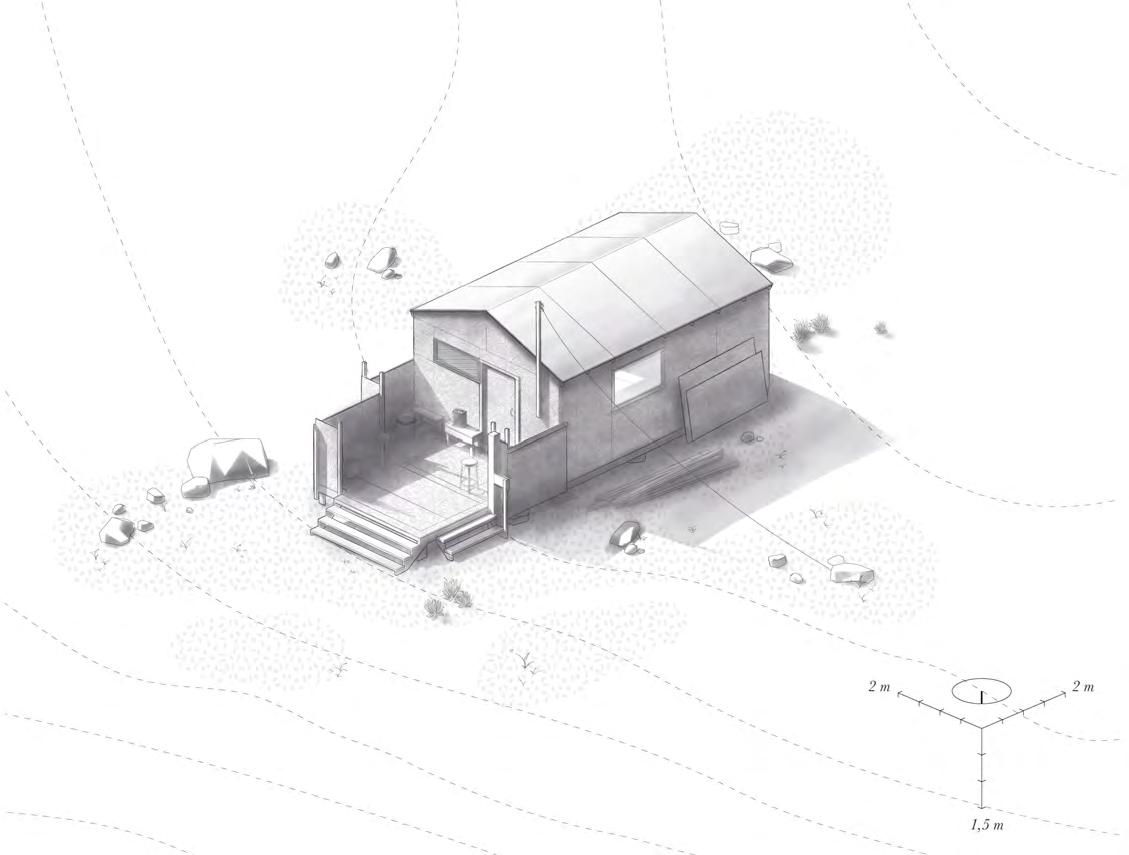
L’aménagement des cabanes en mouvement reprend de nombreuses caractéristiques des habitats traditionnels, et ce, notamment dans la séquence des espaces qui les composent. L’entrée est protégée des vents par des murets ou des défecteurs
et elle est pratiquée sur une façade en pignon faisant face au fjord et à une aire d’activités extérieures. À l’intérieur de l’unique pièce, une plateforme de repos est opposée à l’entrée. Le centre de l’espace demeure quant à lui assez libre puisque le rare mobilier de rangement ou de cuisine est placé près de l’entrée. Les fenêtres sont petites et semblables dans leurs dimensions comme dans leur superfcie. Elles desservent l’espace central dans le but premier d’y apporter de la lumière, l’arrière étant laissé plus sombre et protégé des vents.
Représentation dimétrique d’une cabane en mouvement (haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite).
Annexe 1 - page 316
Figure 12.
La poutre faîtière comme la charpente du toit sont faites de bois (2x4). Les chevrons sont légèrement échancrées à leur basse pour mieux s’appuyer sur les sablières des murs. Le tout est recouvert de contreplaqués ; eux-mêmes recouverts d’une membrane bitumineuse pour l’étanchéité.
La face intérieure des montants est parfois couverte d’une membrane de polyéthylène (ex. : Tyvek) pour couper les courants d’air. Dans les cavités des montants, de l’isolant permet de conserver la chaleur et, plus rarement, un écran pare-pluie est glissé derrière le revêtement extérieur. Ne pas installer d’écran pare-pluie semble être une stratégie permettant de facilement érifer l’état intérieur des murs, remplacer les composantes trop abimées par les intempéries ou modifer la modulation des ouvertures. Dans cette situation, les joints entre les panneaux sont toutefois recouverts de fourrures bois afn d’emp cher les infltrations que pourraient pro oquer des précipitations poussées par le vent.
Le balcon est protégé par des brise ent ou des dé ecteurs pour faciliter la cuisine extérieure et protéger l’entrée. La cabane, composée d’une seule pièce, rassemble une table, du rangement, un espace libre et une plateforme de repos assez grande pour une famille. Le dessous de la plateforme sert également de rangement pour divers objets.
Les plateformes de bois qui structurent le balcon semblent résulter de deux ajouts progressifs. Ces plateformes comme celle de la cabane sont conçues à partir de différentes pièces de bois (2x6 pour les plus grandes solives et les solives de rives, et 2x4 pour les plus courtes).
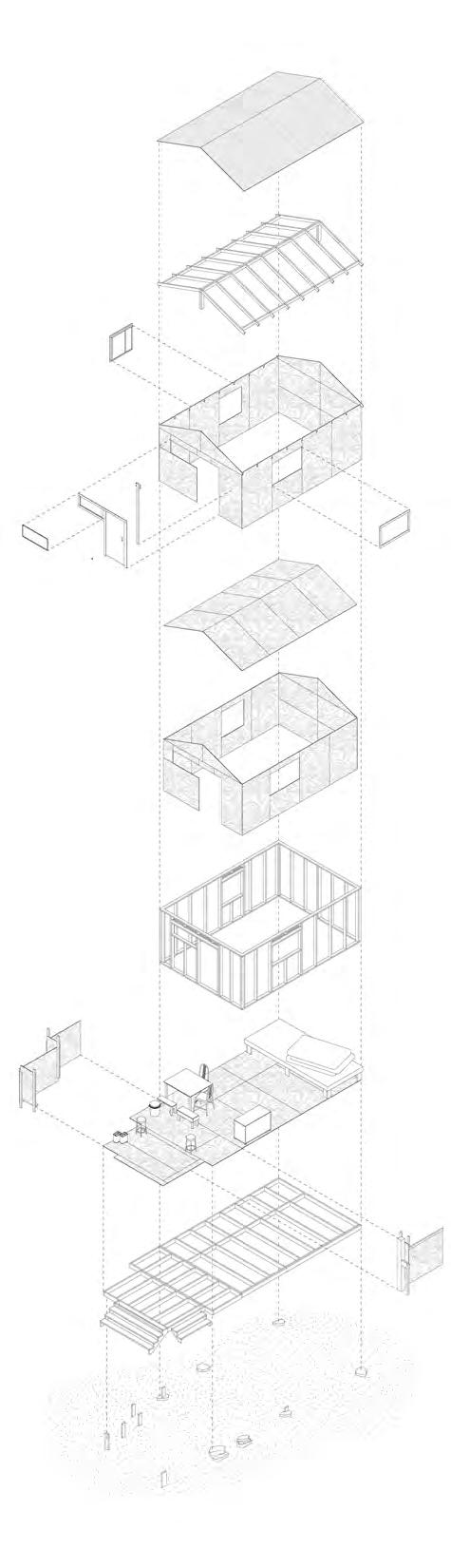
Annexe 1 - page 317
Fait intéressant, un trou pratiqué à même le toit a été noté sur de nombreuses cabanes semblables. Les entretiens ont révélé qu’il est pratiqué pour assurer une aération adéquate lorsqu’un système de chauffage au gaz est utilisé. Un tel détail est aussi présent dans les iglous notamment.
Les fenêtres sont fabriquées à partir d’un cadre de bois et d’une feuille de plexiglas scellée. La disponibilité de ces feuilles apparait jouer un certain rôle dans le dimensionnement des ouvertures. Les portes et d’autres fenêtres sont aussi issues d’un effort de recyclage.
Le contreventement des murs est assuré par les revêtements intérieur et extérieur en contreplaqués.
Une ossature de bois en 2x4 (@ 24’’ d’espacements) soutient les murs dont les hauteurs latérales sont de 6’. Cela limite le volume d’air à chauffer et laisse au centre un espace suffsamment haut pour y être debout. Des linteaux et des pilastres reprennent les charges transférées par les ouvertures.
Le plancher est fait de panneaux de contreplaqués. Dans certains cas, de l’isolant rigide est ajouté, puis une seconde épaisseur de contreplaqués peint assure une plus grande pérennité de l’ensemble. En tout, la surface de plancher intérieure représente 16 m2
Les appuis et les ancrages reposent sur un sol graveleux. Ceux-ci sont fabriqués par des empilements de pierres et des montants de bois plantés profondément.
Exemples associés au modèle de la cabane en mouvement




Igajialuk 1/2 (f17)
Igajialuk 1/2 (f17)
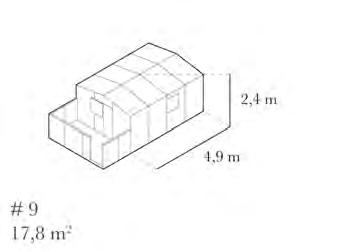
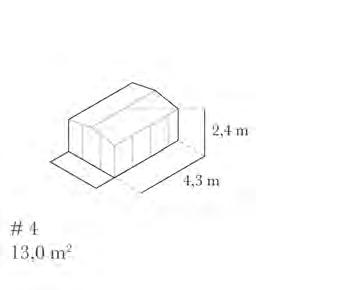
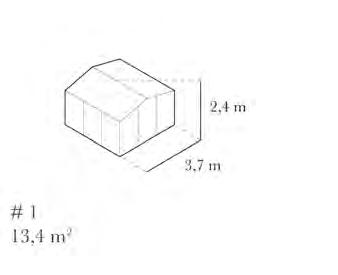
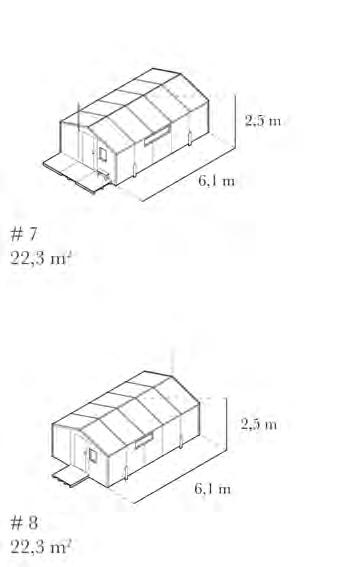
Mivvik (e18 - f18)
Mivvik (e18 - f18)
Mivvik (e18 - f18)
Annexe 1 - page 318
Annexe 1 - page 319

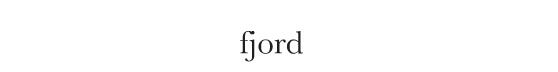

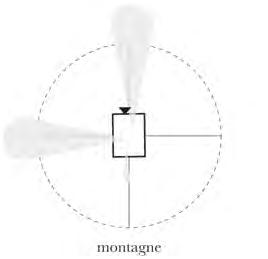
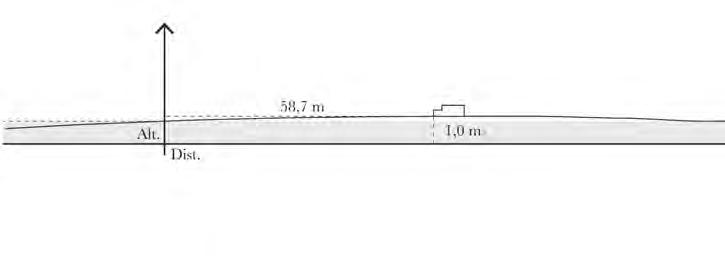

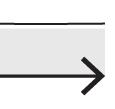


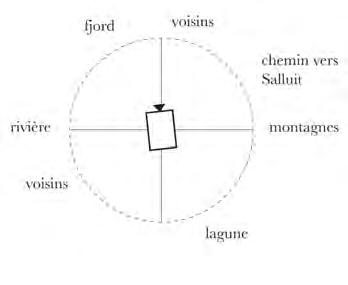
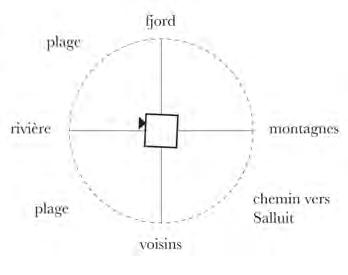
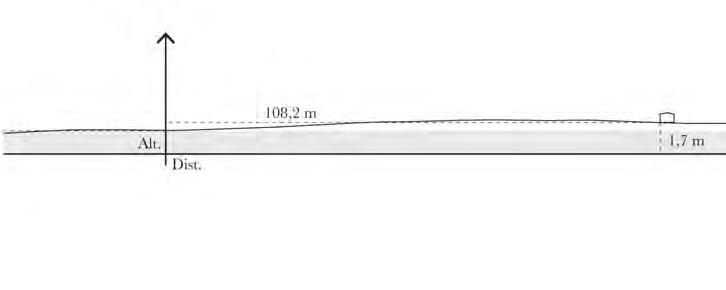
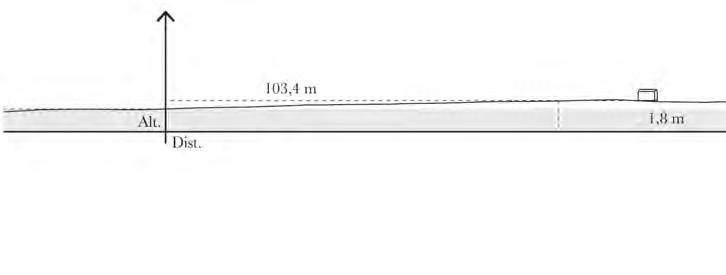
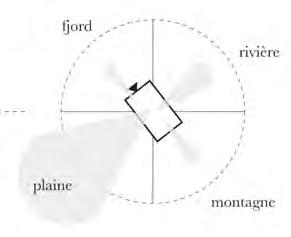
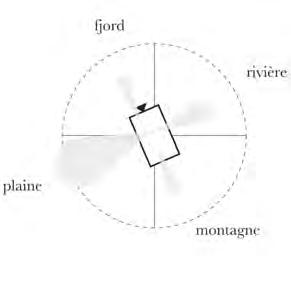
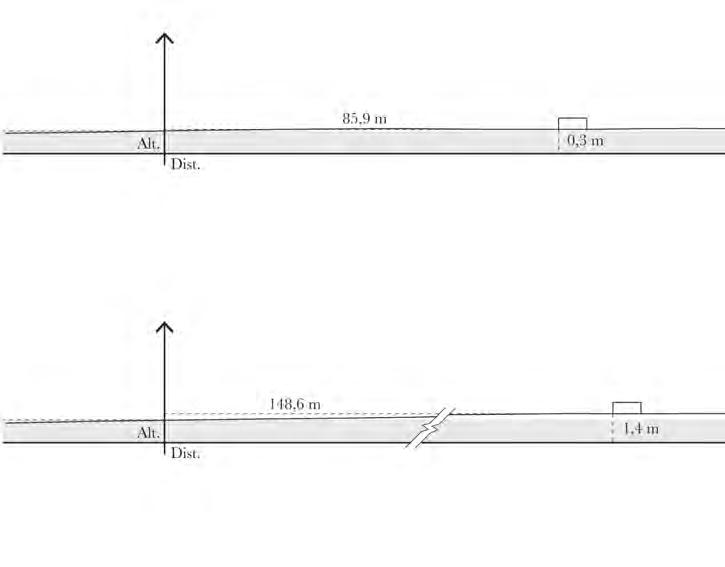
Exemples associés au modèle de la cabane en mouvement
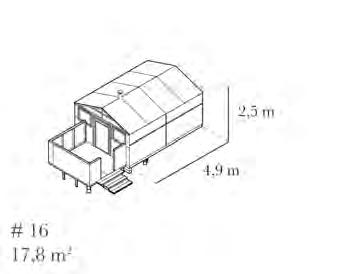
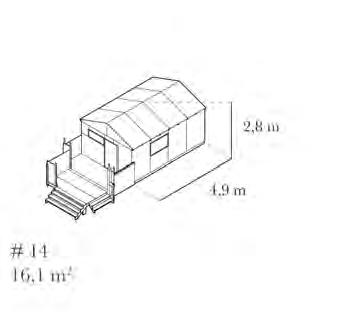
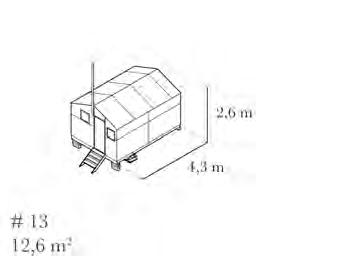
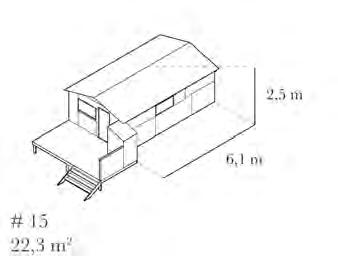
Qarqaluarjutuaq (d18)
Qarqaluarjutuaq (d18)
Qarqaluarjutuaq (d18)
Qarqaluarjutuaq (d18)



Annexe 1 - page 320

Annexe 1 - page 321
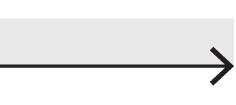
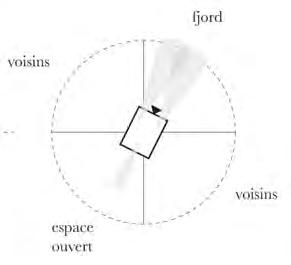
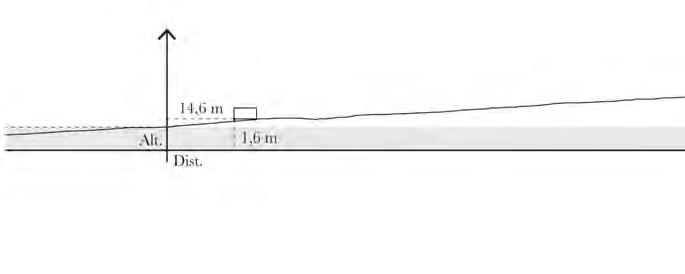
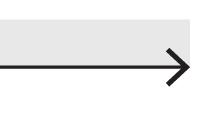
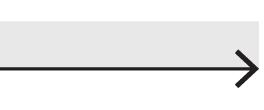
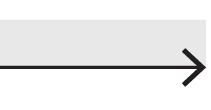
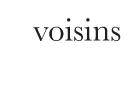

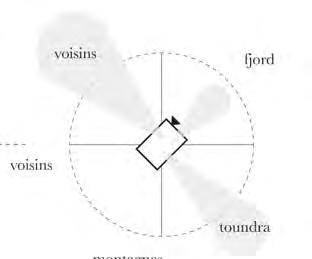
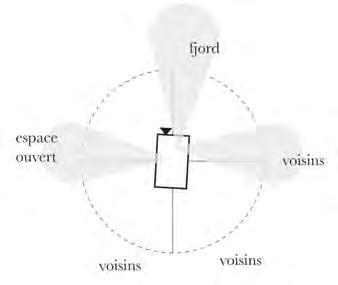
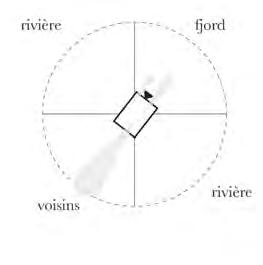
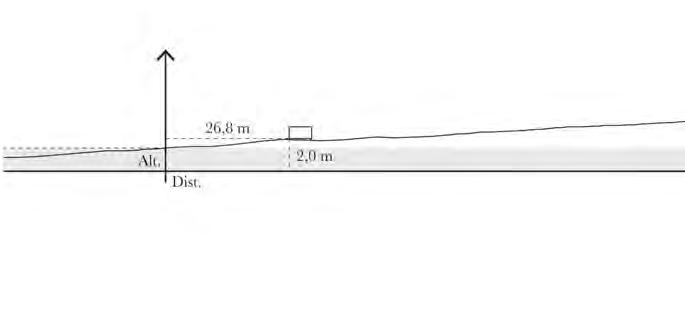
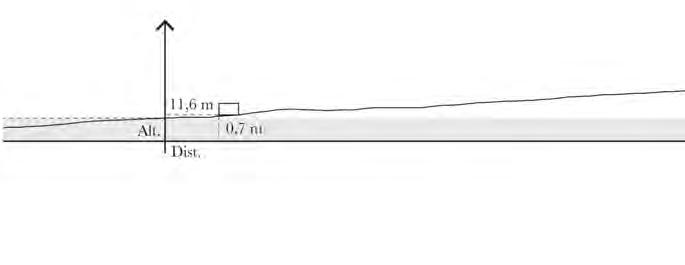
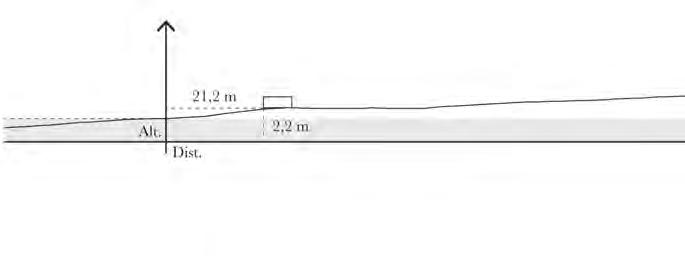
Exemples associés au modèle de la cabane en mouvement
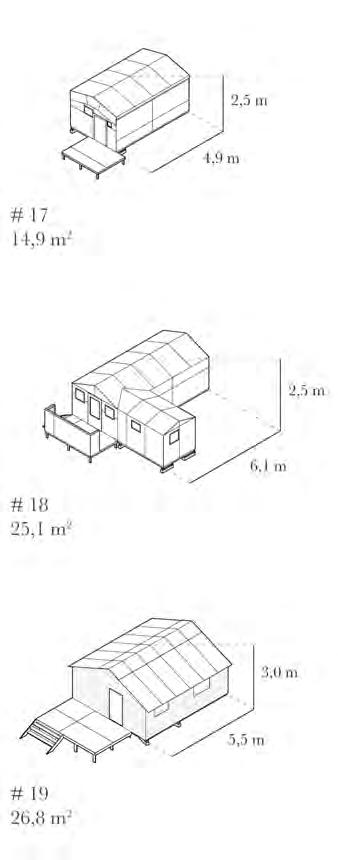
Qarqaluarjutuaq (d18)
Qarqaluarjutuaq (d18)
Qarqaluarjutuaq (d18)


Annexe 1 - page 322

Sommaire de la position des cabanes en mouvement
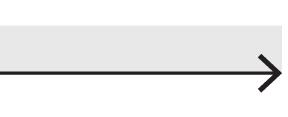
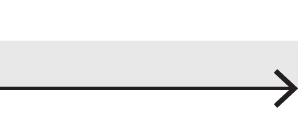
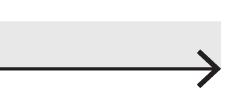
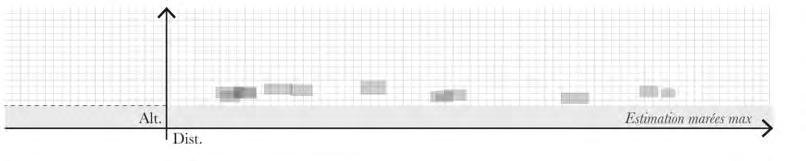
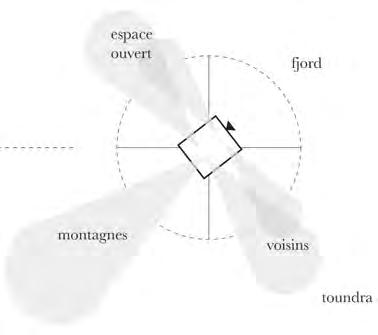
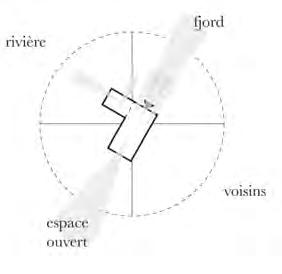
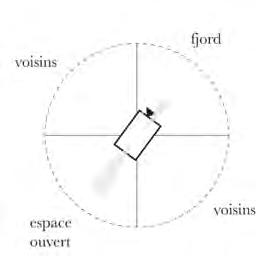
Annexe 1 - page 323
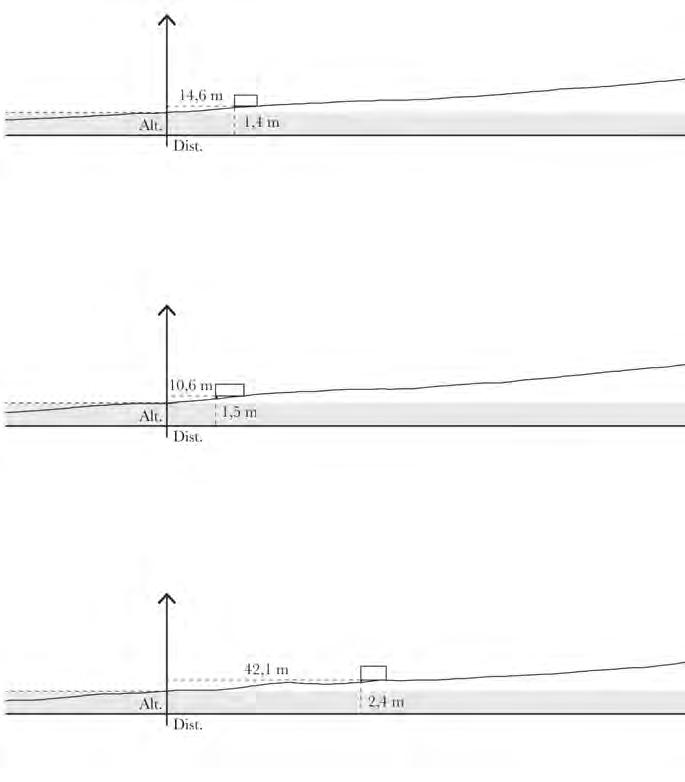
Les cabanes immobilisées
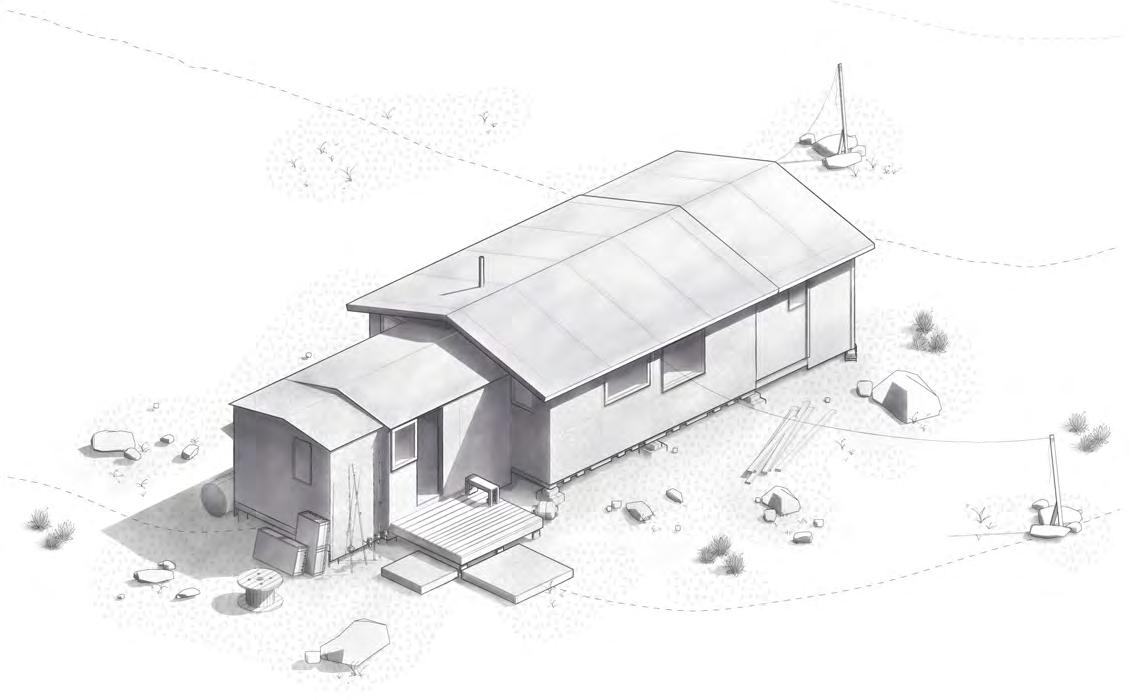
Les cabanes immobilisées sont apparentées aux cabanes en mouvement, mais elles font état de constructions transformées où la somme de plusieurs annexes linéaires a progressivement ancré la position de ces dernières. Ces annexes ont soit modifé l’intégrité structurale des cabanes d’une façon trop importante pour qu’elles puissent être démontées et remontées sans encombre, soit leur volume est désormais trop variable pour imaginer les déplacer sans les endommager. Les cabanes immobilisées se retrouvent donc aussi sur des sites de faible élévation, le long d’axes perpendiculaires à la rive du fjord et parallèles à la direction des vents.
L’aménagement des cabanes immobilisées suit une logique homologue à celle observée dans les cabanes en mouvement.
Outre un allongement manifeste de la superfcie des espaces et de leurs fonctions respectives, les principales diférences sont une augmentation de l’importance et du nombre d’ouvertures, puis (accessoirement) un repositionnement de l’aire d’activités extérieures après une réorientation latérale de l’entrée causée par la construction d’un sas. Si ce repositionnement permet d’éviter les congères hivernales devant l’entrée, il faut aussi mentionner que la « nouvelle façade » a souvent l’avantage de pouvoir conserver un rapport visuel avec le fjord.
Représentation dimétrique d’une cabane immobilisée (haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite).
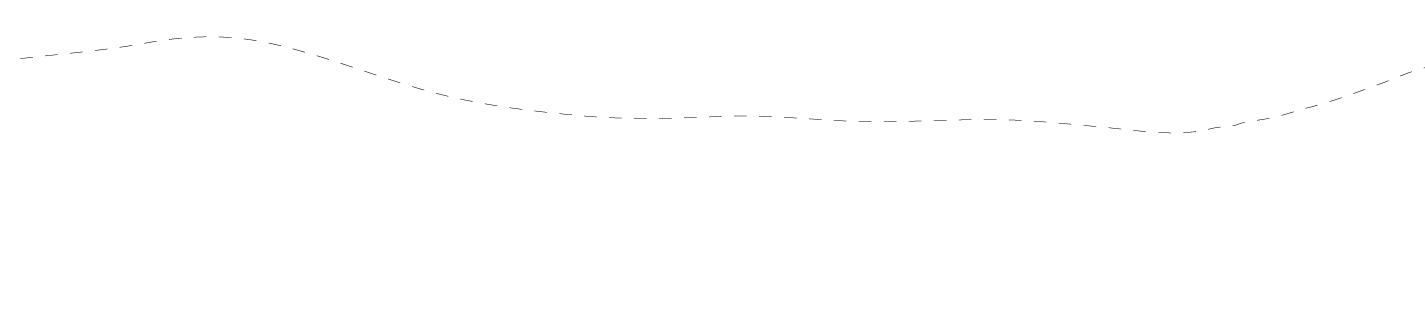
Annexe 1 - page 324
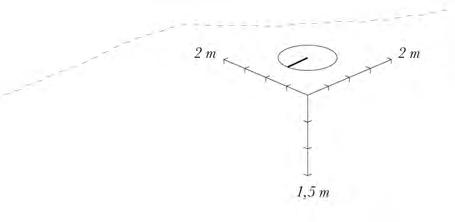 Figure 13.
Figure 13.
Le toit de la plus petite annexe est laissé à nue.
Les fenêtres sont fabriquées à partir d’un cadre de bois et d’une feuille de plexiglas scellée. La disponibilité de ces feuilles apparait ici aussi jouer un certain rôle dans le dimensionnement des ouvertures. Les portes, leur cadre et d’autres fenêtres ont été recyclés et adaptés aux dimensions de la cabane.
Un sas agrémenté d’une pièce de rangement en annexe protège l’entrée de la cabane. Ce type d’aménagement est également utile pour la cuisine puisqu’il limite les dangers d’utiliser un petit poêle au propane à l’intérieur. La cabane, composée de deux pièces, rassemble une table, du rangement, un évier (alimenté par un réservoir extérieur), une petite chaudière patentée, une télévision, un espace libre et quelques espaces de repos assez grands pour accommoder une large famille. À noter que l’espace de repos principal concerne la pièce du fond en entier.
En tout, la surface de plancher intérieure représente 39,9 m2
Les plateformes de bois qui structurent les trois annexes (deux à l’avant et une à l’arrière) semblent résulter d’ajouts progressifs à la pièce centrale. Toutes ces plateformes sont conçues à partir de composantes aux dimensions variables (2x6 et 2x8 pour les plus grandes solives et les solives de rives, et 2x4 pour les plus courtes).
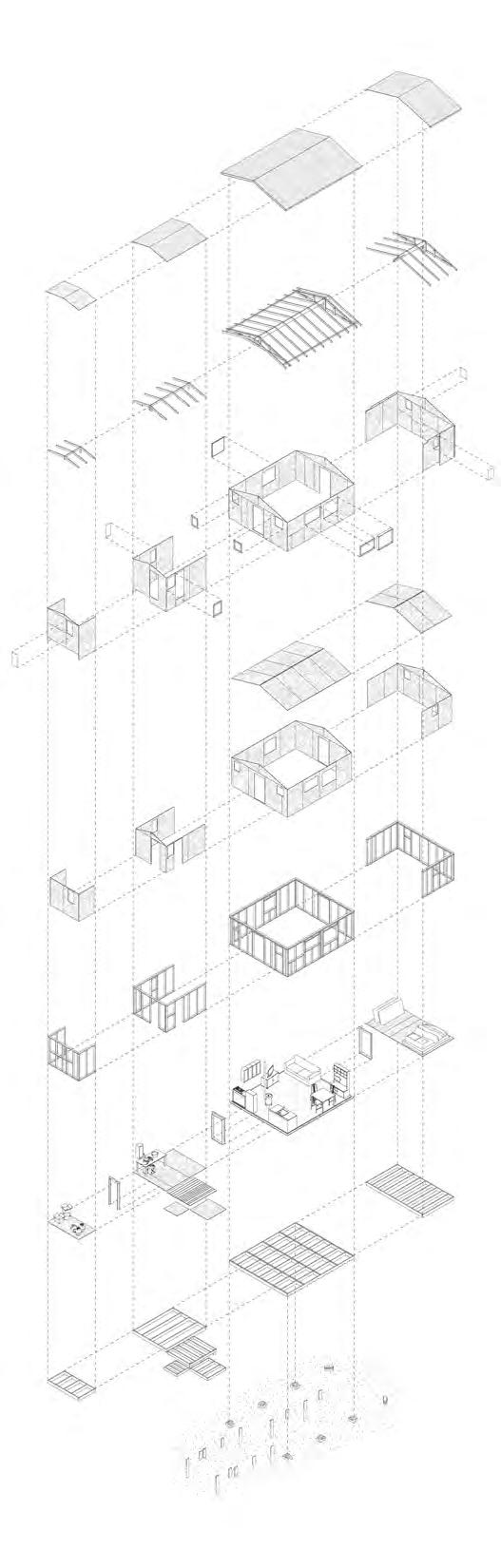
Annexe 1 - page 325
La poutre faîtière principale est composée d’un 2x8 ou d’un 2x10. Le reste de la charpente du toit est fait de 2x4. Les débords de toit sont recouverts de contreplaqués et les cavités sont vraisemblablement isolées. Les chevrons sont enfn légèrement échancrées à leur basse pour mieux s’appuyer sur les sablières des murs. Le tout est recouvert de contreplaqués ; eux-mêmes recouverts d’une membrane bitumineuse ou de bardeaux d’asphalte pour l’étanchéité.
Le contreventement des murs est assuré par les revêtements int. et ext. en contreplaqués. La face intérieure des montants est parfois couverte d’une membrane pare-vapeur et plus rarement d’une membrane de polyéthylène (ex. : Tyvek). Les cavités des montants sont pour leur part remplies avec de l’isolant. Bien que très probables, peu d’indices ont permis de déceler la présence d’un écran pare-pluie derrière le revêtement extérieur.
Une ossature de bois en 2x4 (@ 24’’ d’espacements)soutient les murs dont les hauteurs latérales sont d’environ 5’10’’. Cela limite le volume d’air à chauffer et laisse au centre un espace suffsamment haut pour y être debout. Des linteaux et des pilastres reprennent les charges transférées par les ouvertures.
La base des planchers est faite de contreplaqués. Dans les pièces centrale et arrière, de l’isolant rigide et une seconde épaisseur de contreplaqués peint sont ajoutés. La pièce centrale bénéfcie aussi d’un recouvrement de tuiles récupérées.
Les appuis reposent sur un sol graveleux. Ceux-ci sont fabriqués par l’empilement croisé d’anciennes poutres de bois. Leur ajustement précis est facile avec de plus petites planches.
Les ancrages sont faits de montants plantés profondément ici aussi.
Exemples associés au modèle de la cabane immobilisée




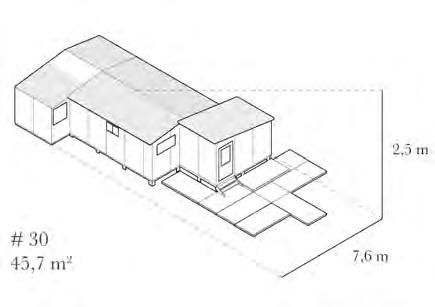
Igajialuk 1/2 (f17)
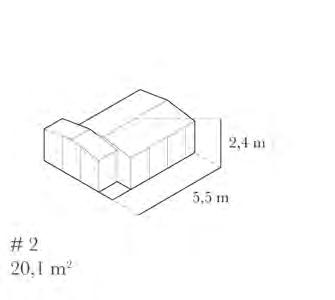
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)
Annexe 1 - page 326
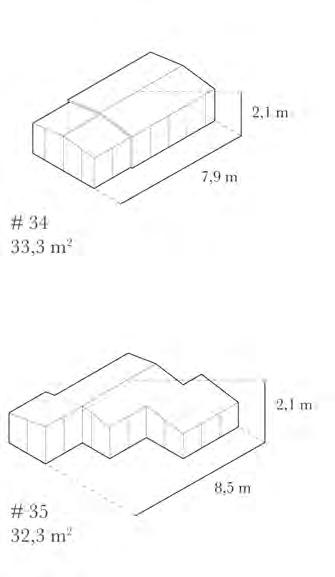
Annexe 1 - page 327
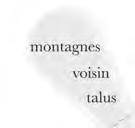

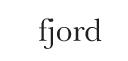
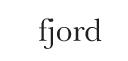

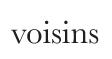
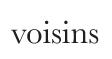
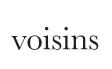
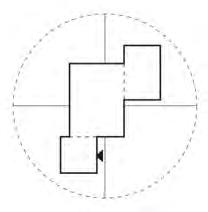
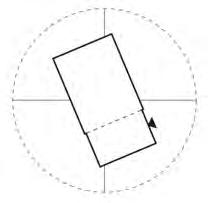
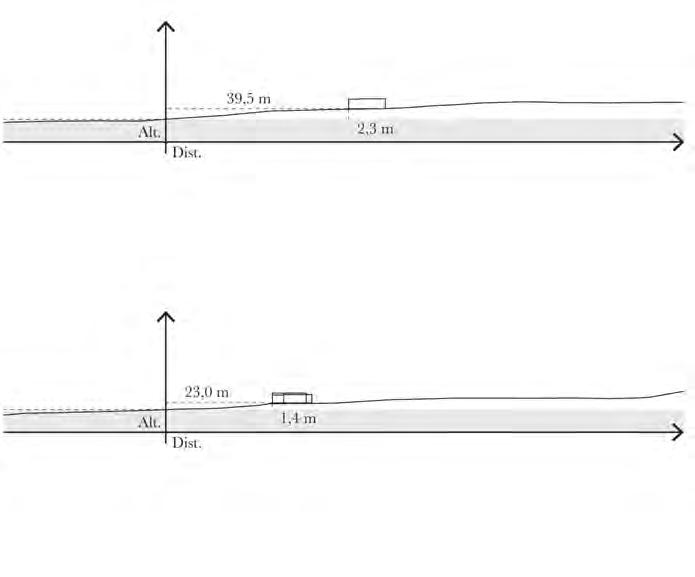


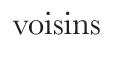
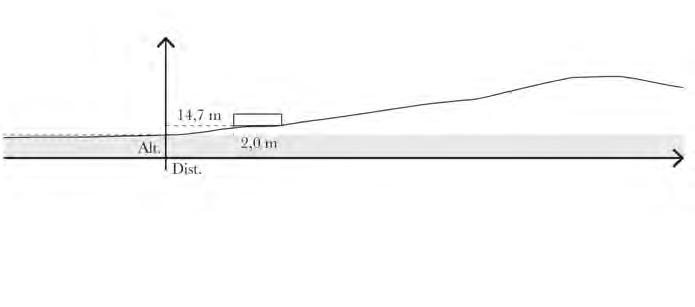
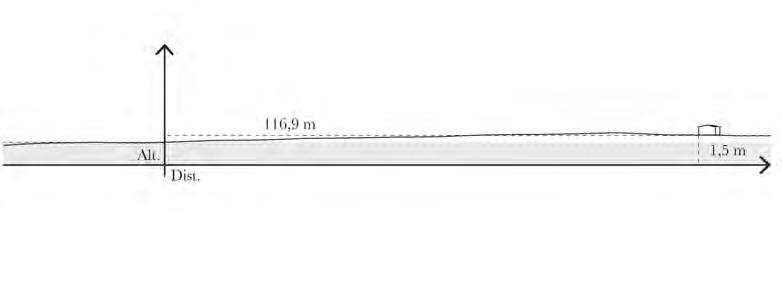
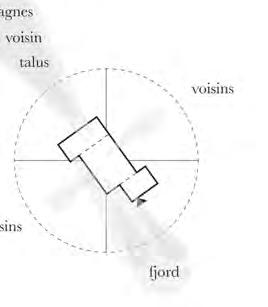
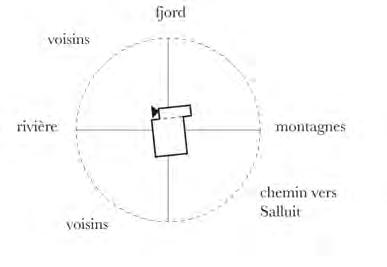
Exemples associés au modèle de la cabane immobilisée
Kikkaluk (q9 - q10)
Kikkaluk (q9 - q10)
Kikkaluk (q9 - q10)



Annexe 1 - page 328
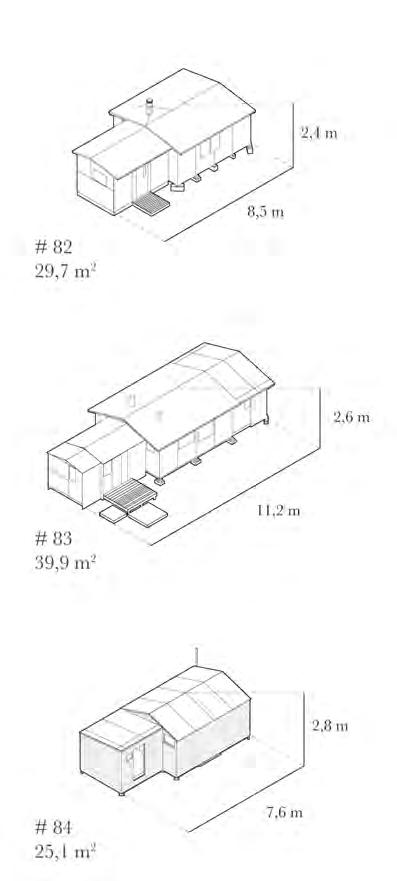
Sommaire de la position des cabanes immobilisées

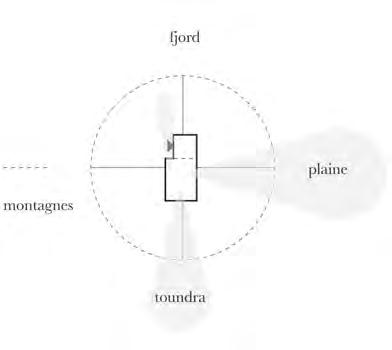
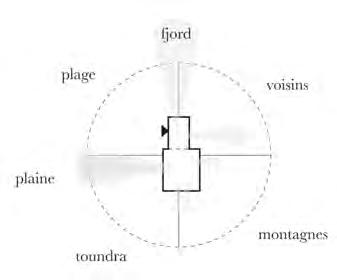
Annexe 1 - page 329
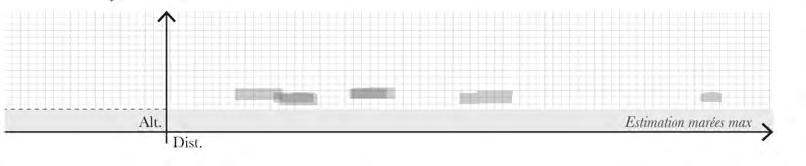
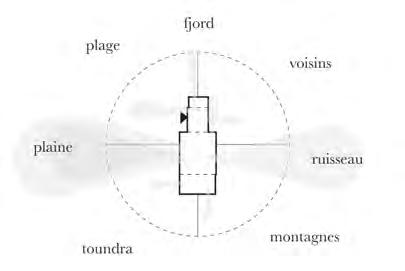
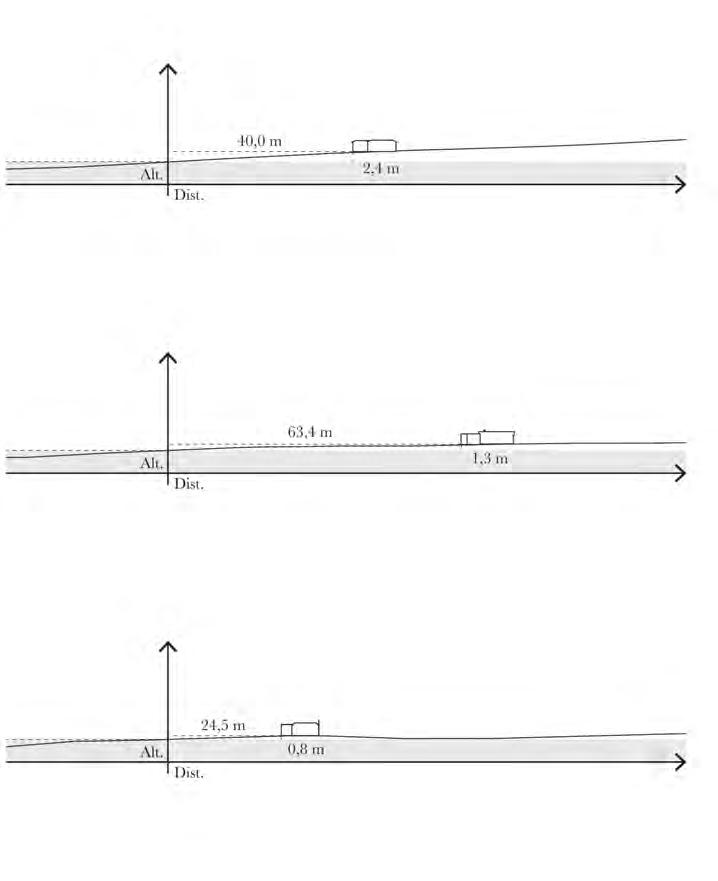
Les cabanes qui observent - type a
Les cabanes qui observent (type A et B) sont caractérisées par une entrée latérale et par une fenestration généreuse face au fjord. Dans le cas de constructions récentes, ces cabanes s’implantent préférablement sur des buttons rocheux à quelques mètres de hauteur par rapport à la rive. Si de telles implantations tirent proft d’une meilleure vue du fjord, elles apparaissent aussi plus stationnaires que les implantations des cabanes en mouvement puisqu’elles impliquent des eforts considérables pour y acheminer les structures et les matériaux.
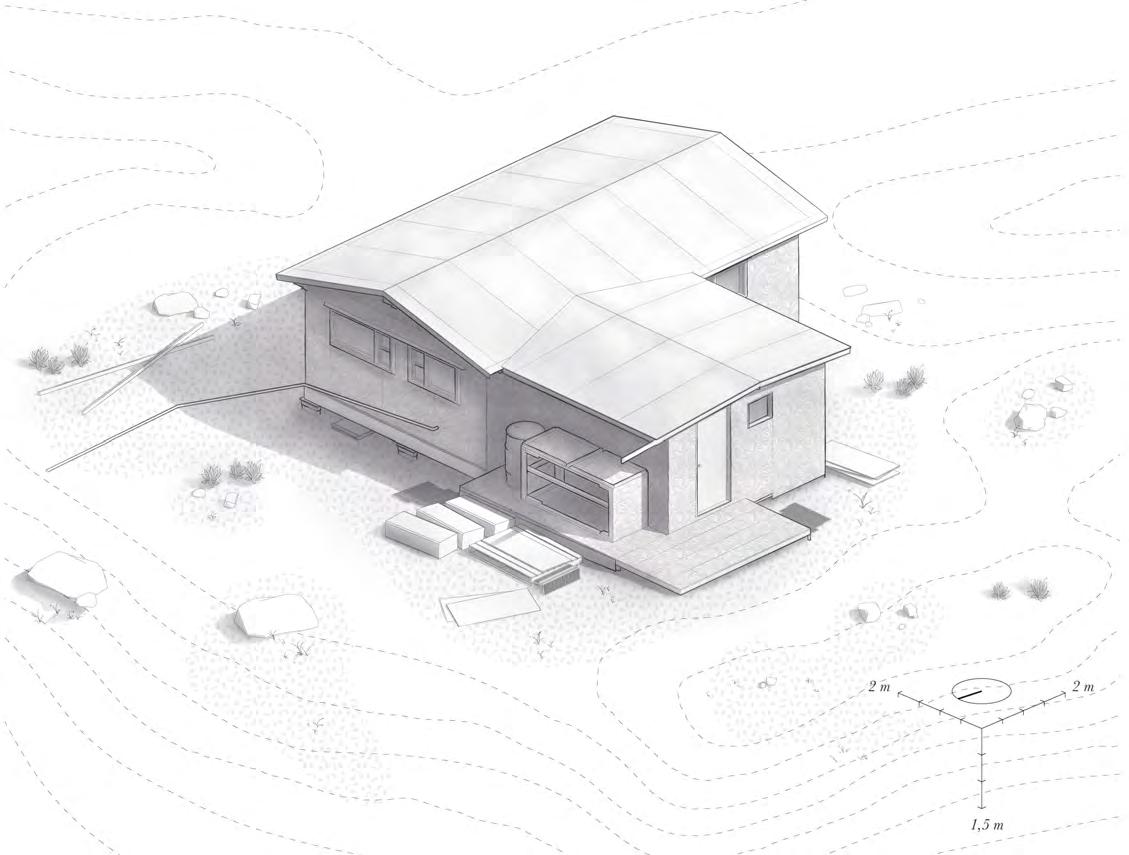
Le type A des cabanes qui observent est en partie déterminé par une orientation et un aménagement homologue aux cabanes en mouvement : l’aire d’activités extérieures comme la façade font face au fjord, l’orientation suit un axe
parallèle à la direction des vents et les diférentes fonctions des espaces intérieurs se suivent selon une même séquence. Une distinction, au-delà de l’implantation, vient donc du fait que l’entrée latérale permet une plus grande fenestration du mur en pignon. En plus de favoriser les rapports au fjord depuis l’intérieur (notamment dans l’espace cuisine et l’espace central), cette organisation favorise l’ajout d’un sas qui ne compromet pas la superfcie ou la connexion de l’aire d’activités extérieures avec le fjord.
Représentation dimétrique d’une cabane qui observe (variante a - haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite).
Annexe 1 - page 330
Figure 14.
Le toit de la plus petite annexe est laissé à nue.
Les portes et les fenêtres de la cabane semblent toutes avoir été recyclées et adaptées. Par exemple, des larmiers de bois ont été fabriqués autour des cadres de fenêtres pour pallier la différence d’épaisseur des murs. À noter également que les fenêtres correspondent précisément à celles installées initialement sur les maisons de la SHQ. Toutefois, celles-ci ont été réinstallées à l’horizontale.
Un généreux sas protège l’entrée de la cabane. Plutôt sombre en raison de sa petite ouverture, ce sas semble principalement servir de rangement. La pièce principale de la cabane rassemble un espace cuisine près de l’entrée, un espace libre situé au centre et un grand espace de repos à l’opposé de l’entrée. L’espace cuisine est fortement en lien avec le fjord et la zone d’activité extérieure.
Le plancher de la cabane est une composition sandwich de contreplaqués, de panneaux d’isolant rigides et de contreplaqués. Le plancher de l’annexe et ses murs ne semblent pas isolés. En tout, la surface de plancher intérieure représente 44,7 m2
Les plateformes de bois qui structurent l’annexe de la cabane semblent provenir d’ajouts progressifs . Ces plateformes comme celle de la pièce principale de la cabane sont conçues à partir de composantes aux dimensions variables (2x6 et 2x8 pour les plus grandes solives et les solives de rives, et 2x4 pour les plus courtes).
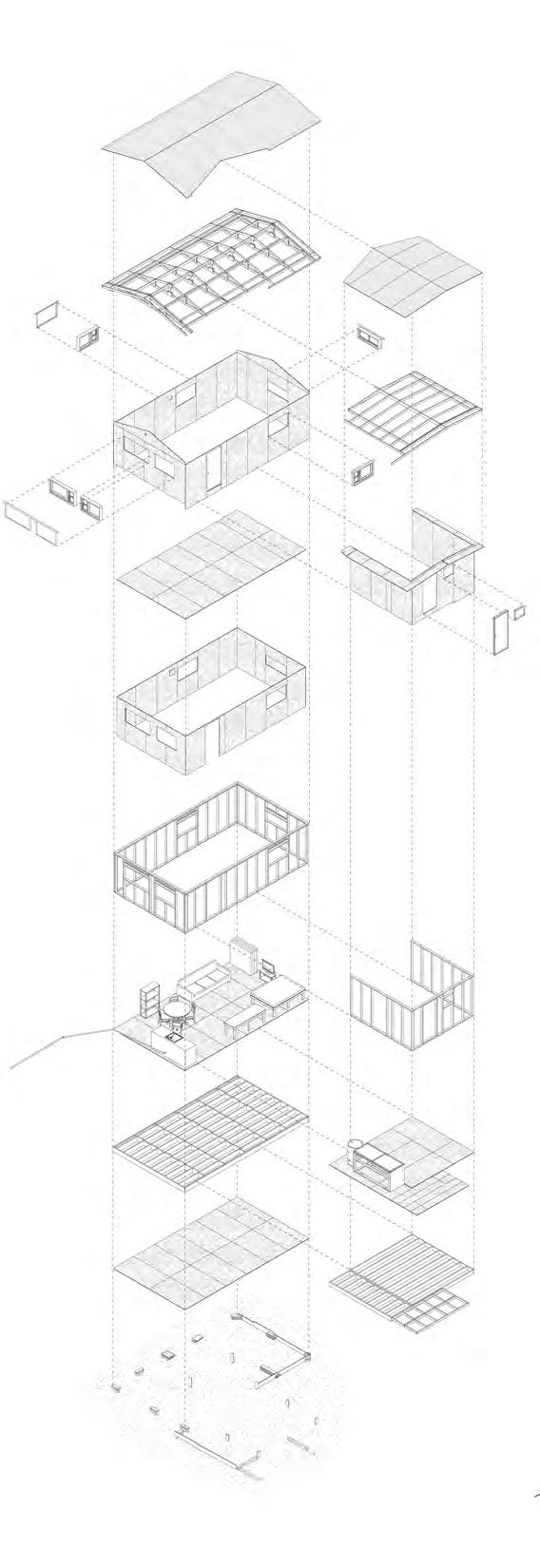
À noter qu’un revêtement de contreplaqué a été placé sous la plateforme principale afn de pouvoir l’isoler.
La toiture est composée de fermes dont la portée est suffsamment grande pour libérer la pièce centrale de toute colonne. Ces fermes sont faits de 2x4 et de contreplaqués, et elles demeurent assez basses pour limiter l’emprise du vent.
Le comble est isolé avec de l’isolant en nattes et sa ventilation est assurée par des ouvertures pratiquées sous les débords de toit.
Le tout est recouvert de contreplaqués ; eux-mêmes recouverts d’une membrane bitumineuse pour l’étanchéité.
Le contreventement des murs est assuré par les revêtements int. et ext. en contreplaqués. La face intérieure des montants est parfois couverte d’une membrane pare-vapeur et plus rarement d’une membrane de polyéthylène (ex. : Tyvek). Les cavités des montants sont pour leur part remplies avec de l’isolant. Bien que très probables, peu d’indices ont permis de déceler la présence d’un écran pare-pluie derrière le revêtement extérieur.
Une ossature de bois en 2x4 (@ 24’’ d’espacements)soutient les murs dont les hauteurs latérales sont d’environ 6’6’’.
Cela limite le volume d’air à chauffer et laisse assez de hauteur pour y être debout. Des linteaux et des pilastres reprennent les charges transférées par les ouvertures.
Juchés sur un promontoire rocheux, les appuis de la cabane reposent sur un sol parsemé d’îlots de gravier. L’empilement croisé d’anciennes poutres de bois est ici aussi une stratégie utilisée pour permettre leur ajustement précis et facile. Les ancrages sont plus diffciles en raison de l’af eurement du roc et des brise-vents ou des monticules de terre rabattus sur les murs empêchent les bourrasques de s’engouffrer sous la cabane. Ce détail est aussi présent dans quelques autres cabanes appartenant aux types précédents.
Annexe 1 - page 331
Exemples associés au modèle de la cabane qui observe - variante a


Igajialuk 2/2 (g18)
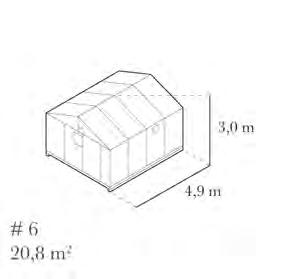
Annexe 1 - page 332
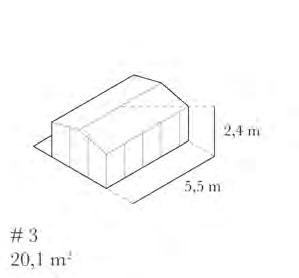 Igajialuk 1/2 (f17)
Igajialuk 1/2 (f17)
Annexe 1 - page 333

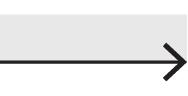
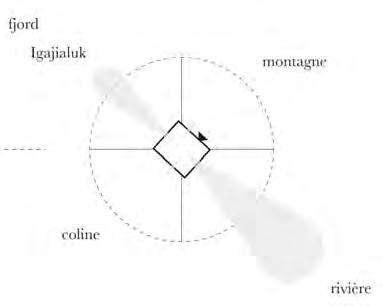
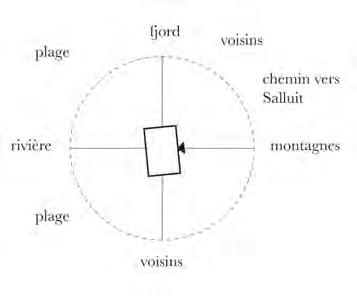
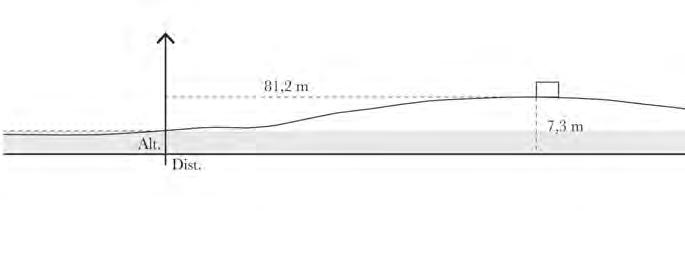
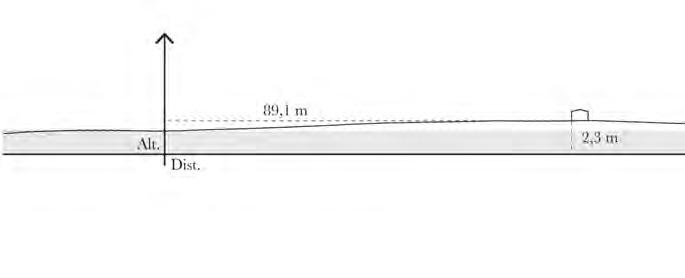
Exemples associés au modèle de la cabane qui observe - variante a


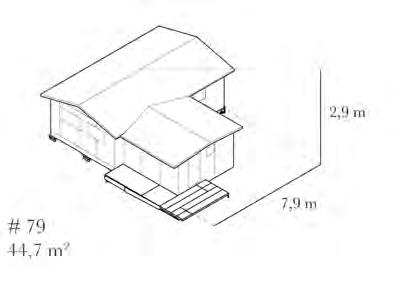
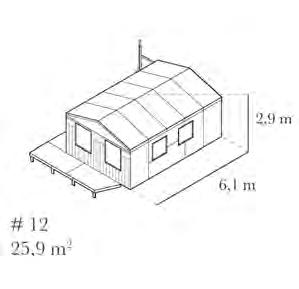
Kikkaluk (q9 - q10)
Kikkaluk (q9 - q10)
Annexe 1 - page 334
Sommaire de la position des cabanes qui observent (variante a)
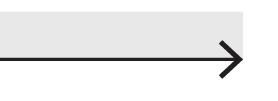
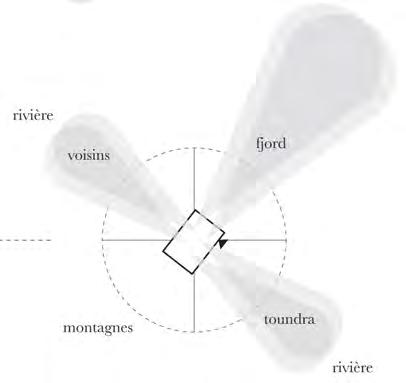
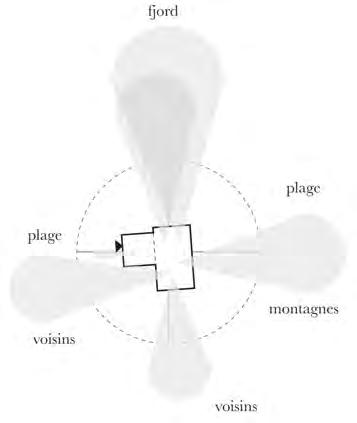
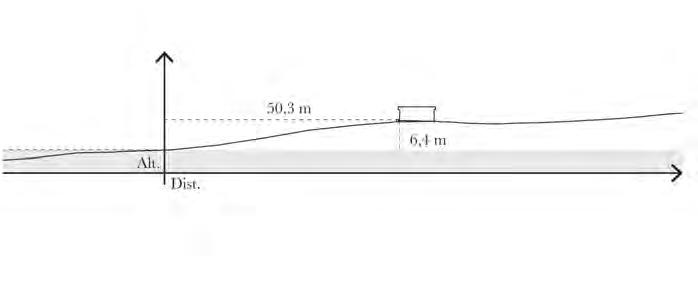
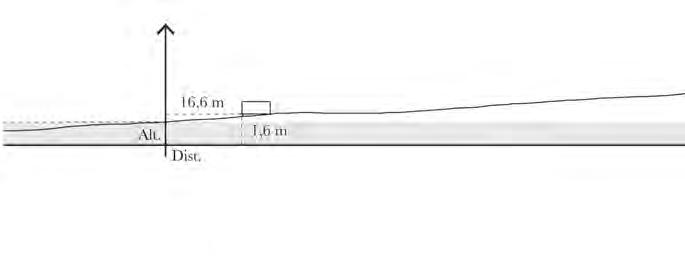
Annexe 1 - page 335
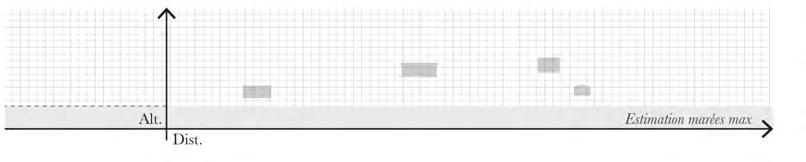
Les cabanes qui observent - type b
Le type B des cabanes qui observent présente, comme le type A, une importante fenestration face au fjord ainsi qu’une entrée latérale. Toutefois, et contrairement au type A ainsi qu’aux deux autres modèles précédents, les côtés longs des constructions ont ici la particularité d’être orientés de façon parallèle à la rive. Ces cabanes (souvent parmi les plus récentes observées) se retrouvent en des sites plus éloignés des baies où les vents suivent l’axe du fjord, et où il apparait nécessaire d’adapter l’orientation des murs pour limiter leur exposition aux vents. Face au fjord, l’une des longues façades s’avère propice à l’installation de grandes ouvertures (parmi les plus généreuses observées), tandis que l’entrée latérale favorise l’articulation d’un sas suivant lui aussi l’axe des vents. En plus des avantages
aérodynamiques, cette position du sas permet d’éviter les congères en redirigeant l’accès de la cabane vers le fjord et l’aire d’activités extérieures. Souvent, les autoconstructeurs saisissent l’opportunité de construire une terrasse devant l’entrée du sas pour faciliter les activités qui autrement ont lieu dans une pente ou un sol cahoteux dû à la nature des buttons rocheux qui caractérisent les sites d’implantation des cabanes qui observent.
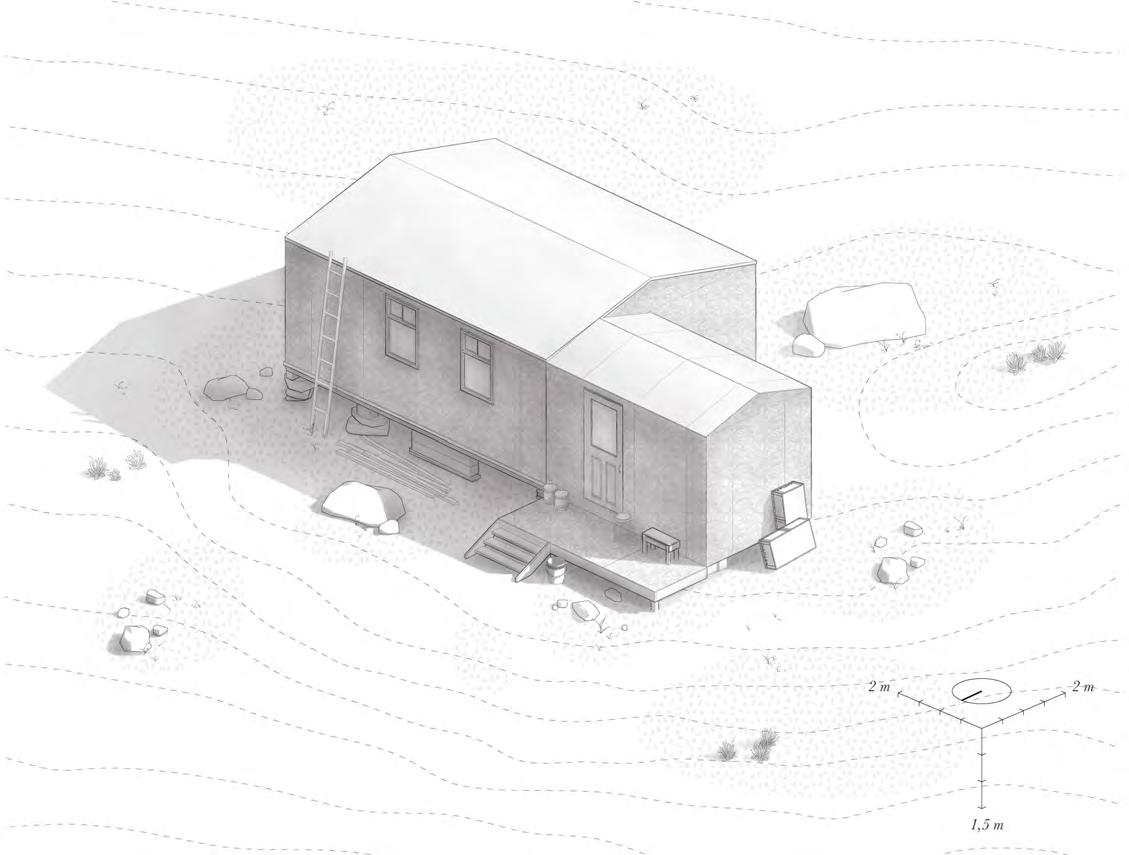
Représentation dimétrique d’une cabane qui observe (variante b - haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite).
Annexe 1 - page 336
Figure 15.
La poutre faîtière est une poutre composée de trois 2x8, tandis que le reste de la charpente du toit est fait de 2x6. Les chevrons ne forment pas de débords de toit et se butent sur des solives de rive.
Les cavités semblent isolées ici aussi avec de l’isolant en nattes. Le tout est recouvert de contreplaqués ; eux-mêmes recouverts d’une membrane bitumineuse pour l’étanchéité.
Les portes et les fenêtres de la cabane semblent toutes avoir été recyclées et adaptées. Ici encore, des larmiers de bois ont été fabriqués autour des cadres de fenêtres pour pallier la différence d’épaisseur des murs. À noter également que la plupart des fenêtres correspondent précisément à celles installées initialement sur les maisons de la SHQ. Toutefois, celles-ci ont tantôt été réinstallées à l’horizontale.
Un sas rectiligne protège l’entrée de la cabane. Une fois de plus, ce sas plutôt sombre en raison de sa petite fenêtre semble servir de rangement. La pièce principale de la cabane rassemble un espace cuisine près de l’entrée (lequel comporte plus de commodités et de rangements que les exemples de cabanes précédents), un espace libre situé au centre et de grands espaces de repos situés dans chacun des coins opposés à l’entrée. L’espace central semble être le plus fortement en lien avec le fjord et la zone d’activité extérieure.
Les plateformes de bois qui structurent l’ensemble de la cabane sont semblables dans la mesure où elles proviennent de 2x8 de bonne qualité et que leurs solives courantes présentent toutes un même espacement. En ce sens et bien qu’il soit diffcile d’évaluer combien de temps s’est écoulé entre la fabrication de la cabane et son annexe, il semble que l’ensemble soit le résultat d’un effort de construction continu.
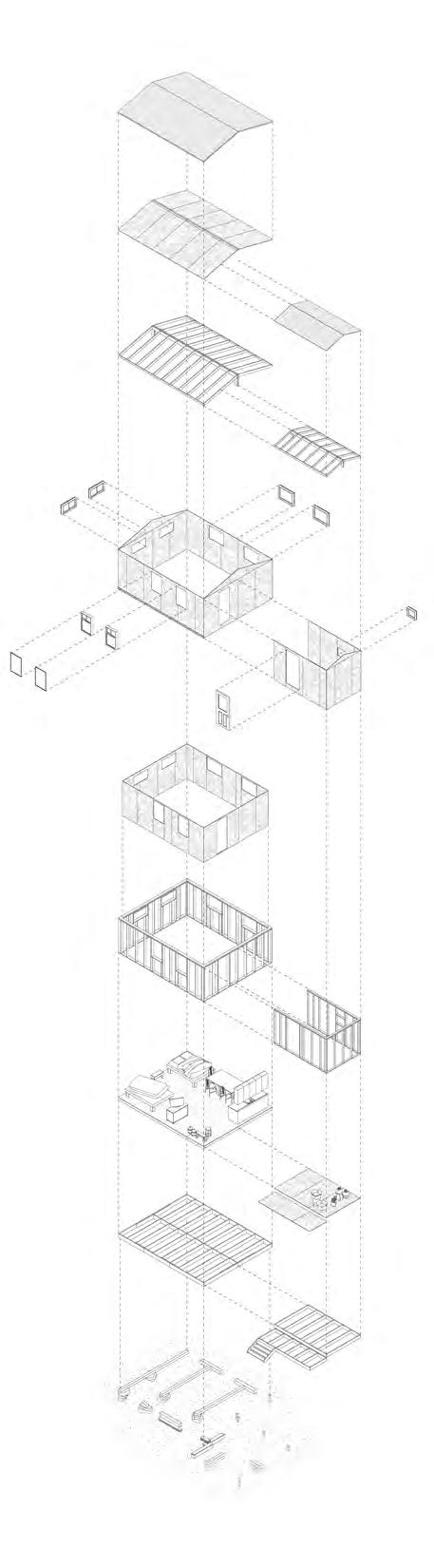
Annexe 1 - page 337
Le toit de la plus petite annexe est laissé à nue.
Le contreventement des murs est assuré par les revêtements intérieur et extérieur en contreplaqués.
La face intérieure des montants est parfois couverte d’une membrane pare-vapeur et plus rarement d’une membrane de polyéthylène (ex. : Tyvek). Les cavités des montants sont pour leur part remplies avec de l’isolant.
Bien que très probables, peu d’indices ont permis de déceler la présence d’un écran parepluie derrière le revêtement extérieur.
Une ossature de bois en 2x6 (@ 24’’ d’espacements)soutient les murs dont les hauteurs latérales sont d’environ 7’. Bien que le volume d’air à chauffer soit plus important dans cette cabane que dans les exemples précédents, l’isolation des cavités y est aussi supérieure. Des linteaux et des pilastres reprennent les charges transférées par les ouvertures.
Le plancher de la cabane est une composition sandwich de contreplaqués, de panneaux d’isolant rigides, de contreplaqués et d’un revêtement de sol (possiblement des tuiles recyclées). Le plancher de l’annexe est uniquement composé de contreplaqués. En tout, la surface de plancher intérieure représente 38,8 m2
Installés à même une pente, les appuis de la cabane reposent sur un sol parsemé d’af eurements rocheux et d’îlots de gravier. L’empilement de pierres et de poutres de bois permet l’ajustement de ces appuis.
Les ancrages plus diffciles en raison du roc, sont ici moins nécessaire puisque la position de la cabane au creux d’une saillie rocheuse lui offre une protection naturelle des vents.
Exemples associés au modèle de la cabane qui observe - variante b



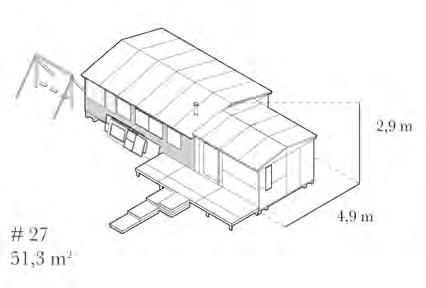
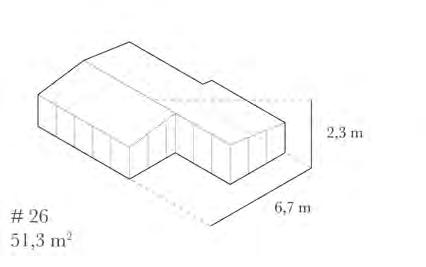
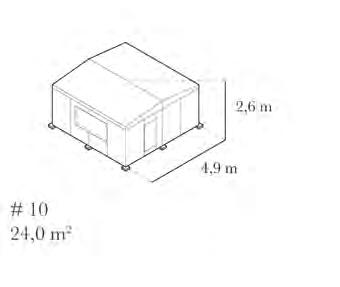
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)
Annexe 1 - page 338
Mivvik (e18-f18)
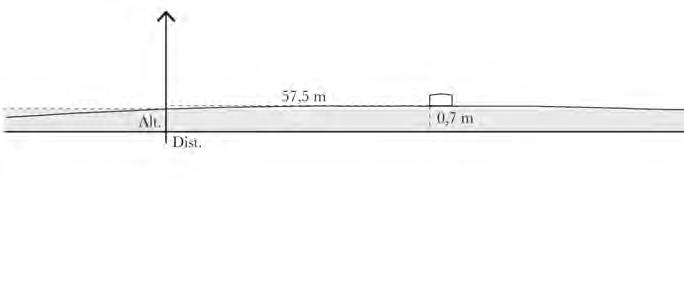
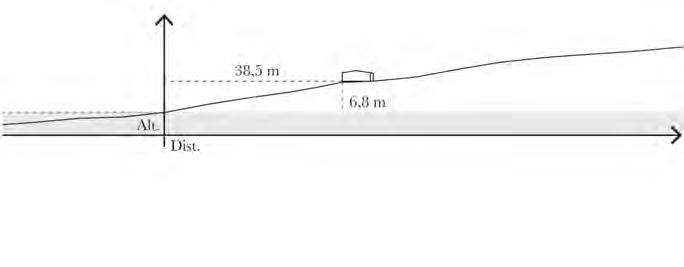
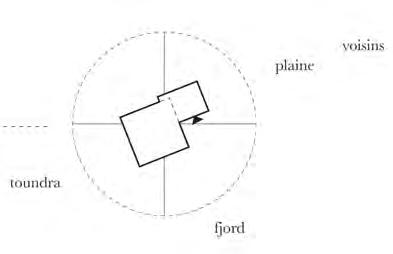

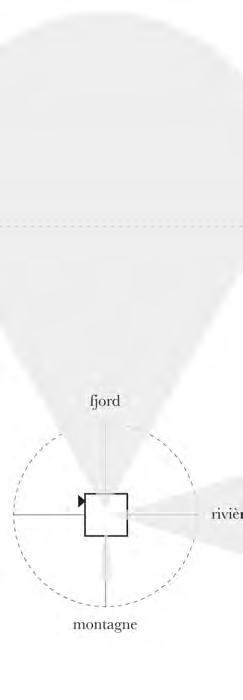



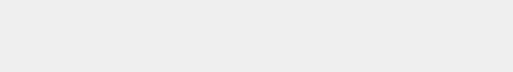
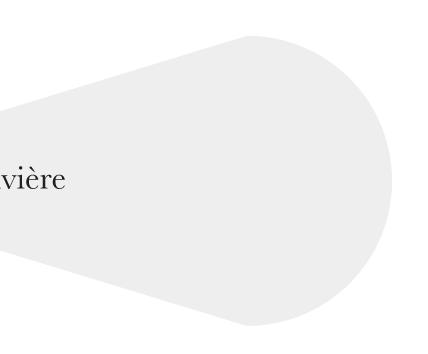

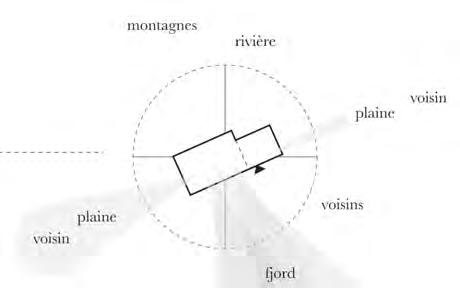
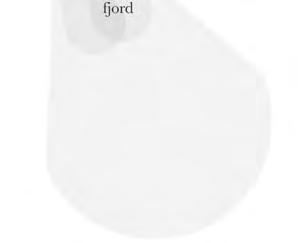
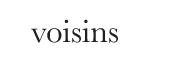
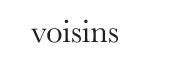
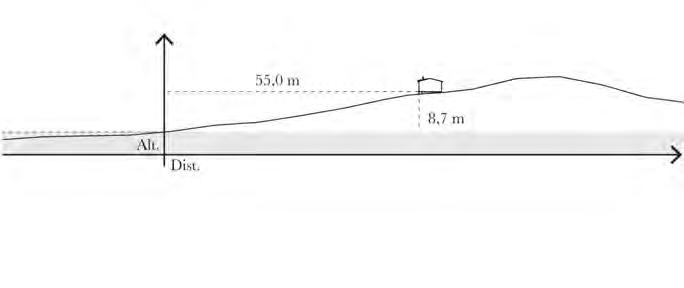
Annexe 1 - page 339
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)
Sittuuniit (e15)



Sittuuniit (e15) Annexe 1 - page 340


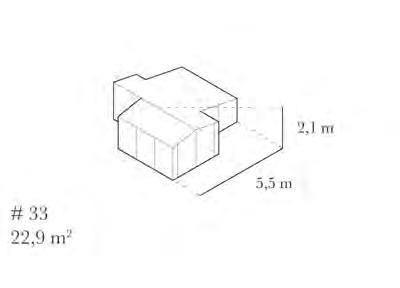
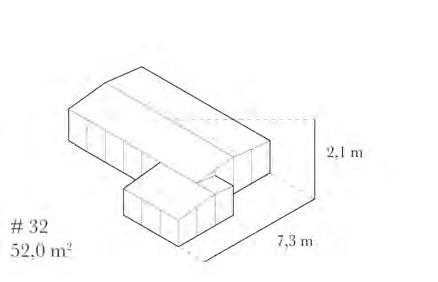
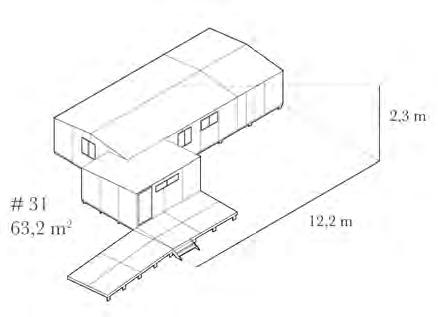
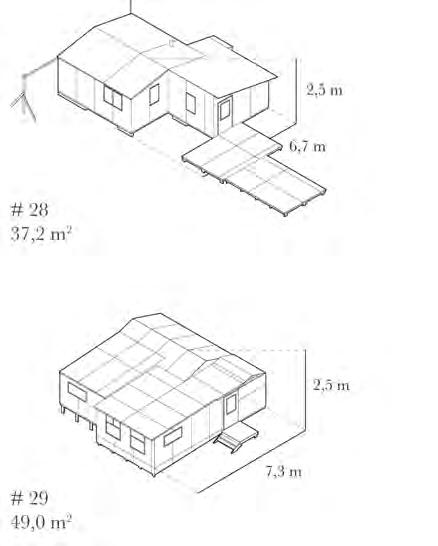
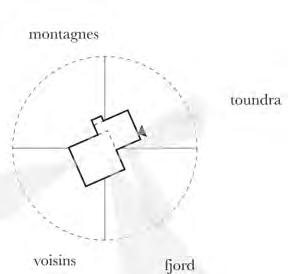
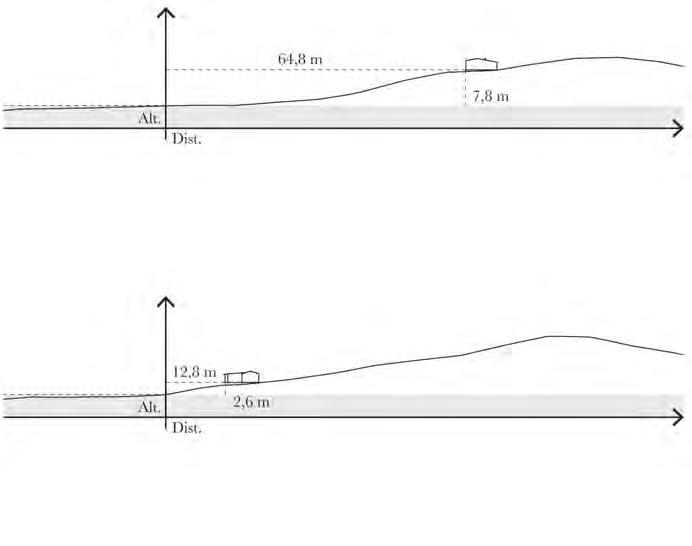
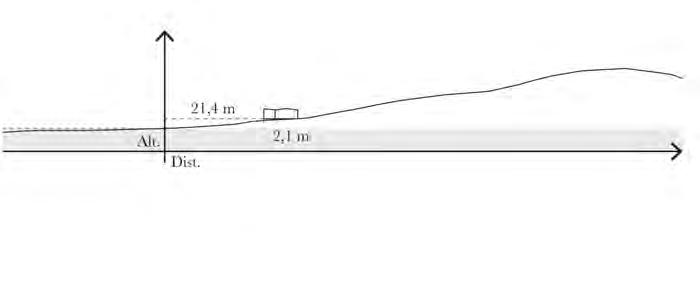
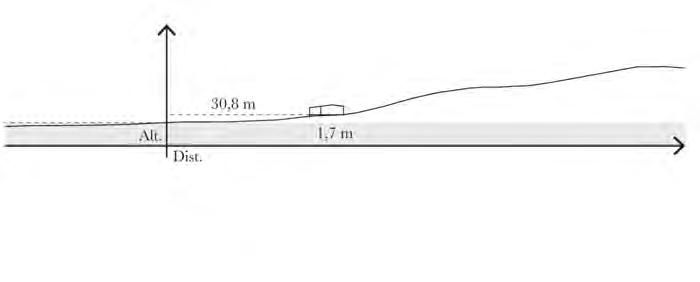
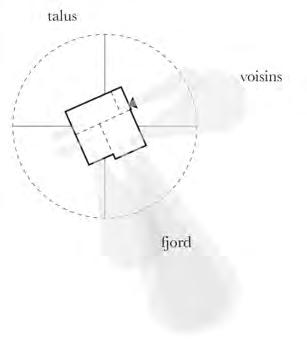
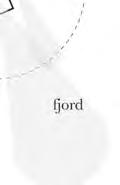
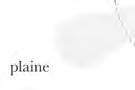

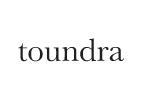
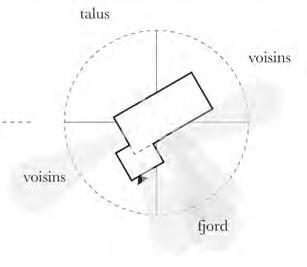
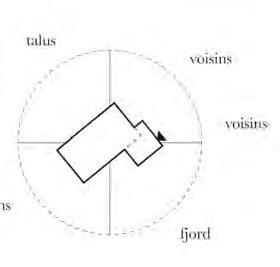
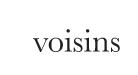


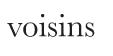
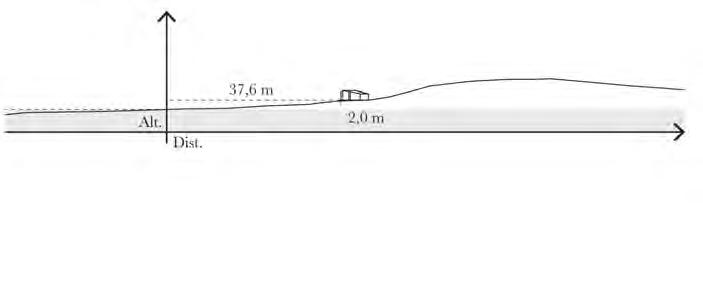
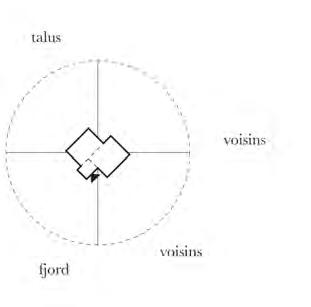
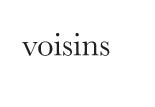
Annexe 1 - page 341
Qikkigiaq (p10)


Kikkalualuk 1/2 (011)
Kikkalualuk 1/2 (n11)
Exemples associés au modèle de la cabane qui observe - variante b

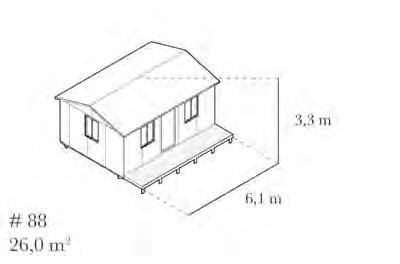
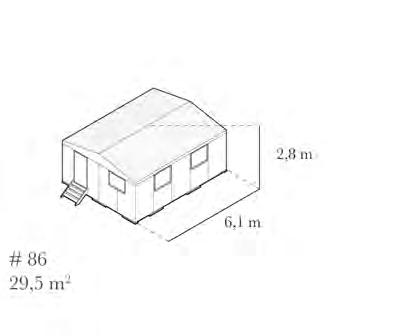
Annexe 1 - page 342
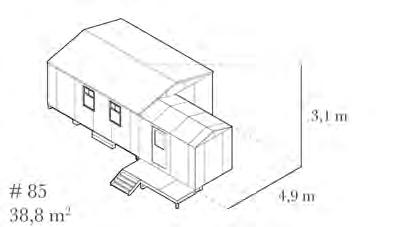
Sommaire de la position des cabanes qui observent (variante b)
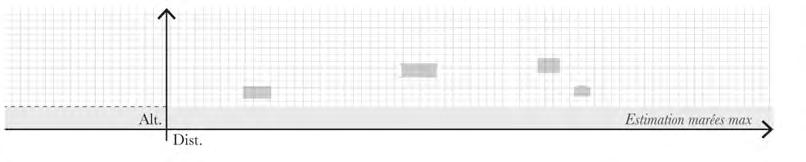
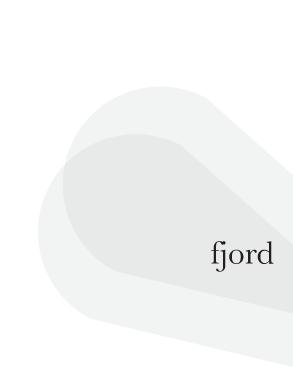

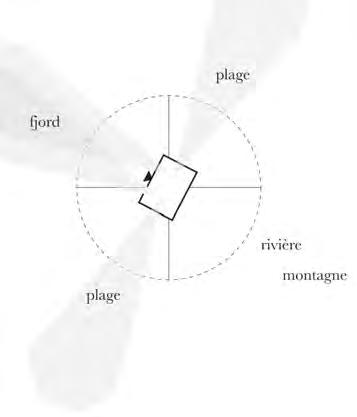

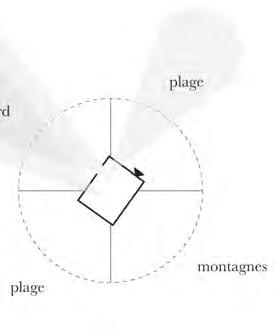


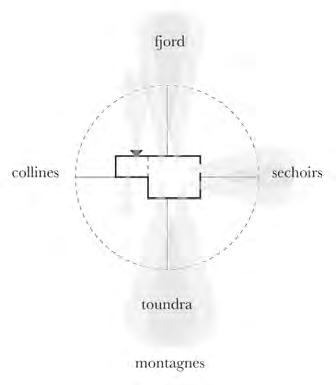
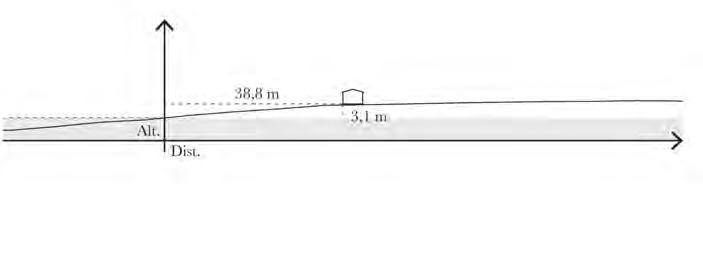
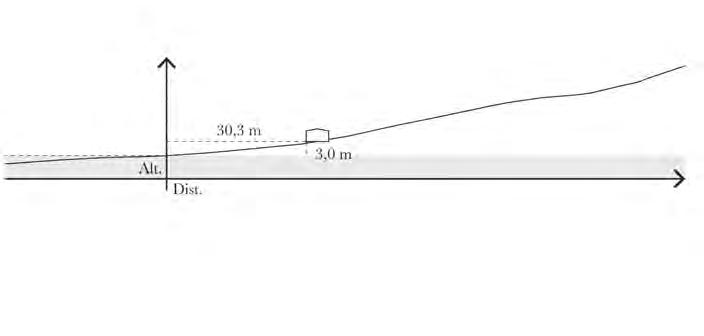
Annexe 1 - page 343
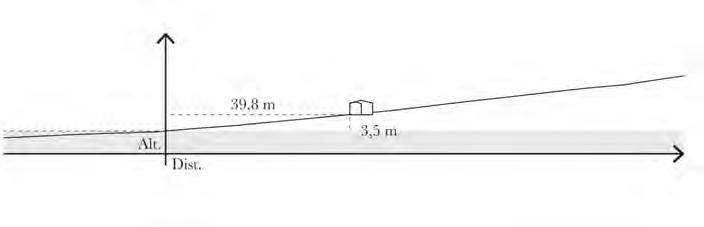
Les cabanes fxes et déployées
Les cabanes fxes et déployées regroupent un ensemble de constructions de grandes dimensions où il est souvent possible de constater l’ajout de plusieurs annexes ainsi qu’une fenestration importante et majoritairement orientée vers le fjord. Comme les cabanes qui observent, l’implantation de ce type de cabanes se situe sur des buttons à quelques mètres de hauteur par rapport à la rive. À l’opposé des cabanes en mouvement, elles sont dites fxes, car il apparait extrêmement difcile, voire impossible, de les déplacer. Elles difèrent ensuite des cabanes immobilisées dans la mesure où le déploiement des annexes ne se fait pas de façon linéaire, mais plutôt selon une logique qui semble valoriser les rapports au territoire et au fjord depuis l’intérieur. En ce sens, les annexes des cabanes fxes et déployées sont organisées de façon à conserver les
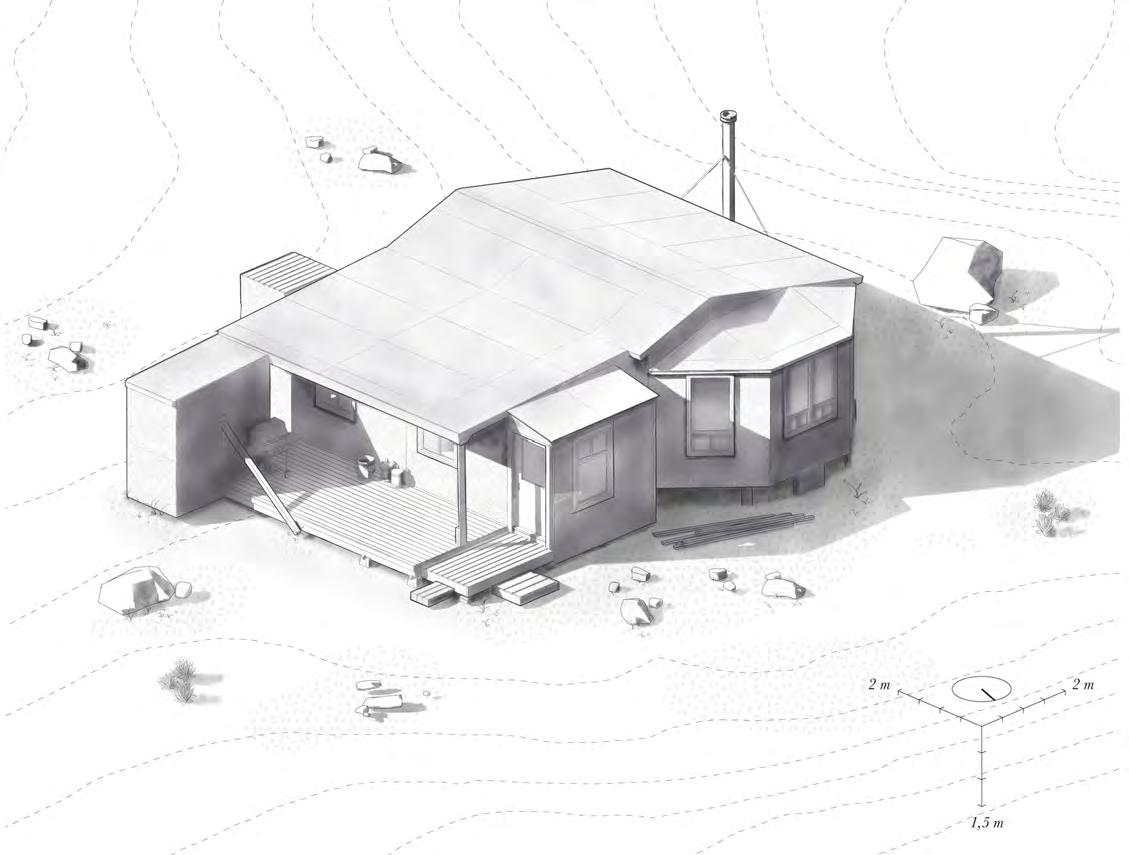
orientations bénéfciant de vues généreuses vers le fjord, ou de façon à améliorer les espaces de vie placés du côté du fjord.
Compte tenu de leurs transformations importantes et de leur parenté avec les cabanes qui observent, les cabanes fxes et déployées s’adaptent à l’emprise des vents en tirant proft de murs aveugles (possiblement mieux isolés) et en usant de défecteurs naturels (présents au sein de leur site d’implantation). En somme, ce modèle correspond vraisemblablement au plus abouti parmi ceux observés dans le fjord de Salluit.
eprésentation dimétrique d’une cabane fxe et déplo ée haut et axonométrie interprétati e de ses di erses composantes (droite).
Figure 16.
La poutre faîtière soutenant le toit de la grande pièce est une poutre composée de trois 2x8. Les chevrons qui s’y rattachent sont aussi faits de 2x8. L’entretoit de cette portion de la cabane semble être isolé. Les autres portions de toits qui couvrent les annexes sont quant à elles composées de 2x6 pour la cuisine et de 2x4 pour la baie vitrée. Le tout est recouvert de contreplaqués ; eux-mêmes recouverts d’une membrane bitumineuse ou de bardeaux d’asphalte.
Les portes et les fenêtres de la cabane semblent toutes avoir été recyclées et adaptées. Ici encore, des larmiers de bois ont été fabriqués autour des cadres de fenêtres pour pallier la différence d’épaisseur des murs.
À noter que la plupart des fenêtres correspondent précisément à celles installées initialement sur les maisons de la SHQ.
Une série de deux sas rythme l’entrée de la cabane. Le premier est relativement petit et semble servir de rangement. Le second est beaucoup plus généreux et abrite une cuisine où semblent se regrouper beaucoup de commodités (système d’eau récupérée, larges comptoirs, espace de cuisson au gaz, etc.).
Cette cuisine présente une confguration dite laboratoire et se trouve bien connectée à la grande galerie latérale et au fjord grâce aux deux fenêtres qui s’y trouvent. La pièce principale rassemble à son tour une salle à manger installée près de la baie vitrée, des espaces de repos situés dans les coins opposés à l’entrée ainsi qu’un espace libre situé au centre et autour duquel sont aménagés du rangement, du divertissement et une source de chaleur. Par ses trois fenêtres, la salle à manger est la plus fortement connectée avec le fjord. Toutefois, la zone d’activité extérieure semble se trouver plus près de la galerie.
Les plateformes de bois qui structurent l’annexe de la cabane semblent provenir d’ajouts progressifs . Ces plateformes comme celle de la pièce principale de la cabane sont conçues à partir de composantes aux dimensions variables (2x6, 2x8 ou 2x10).
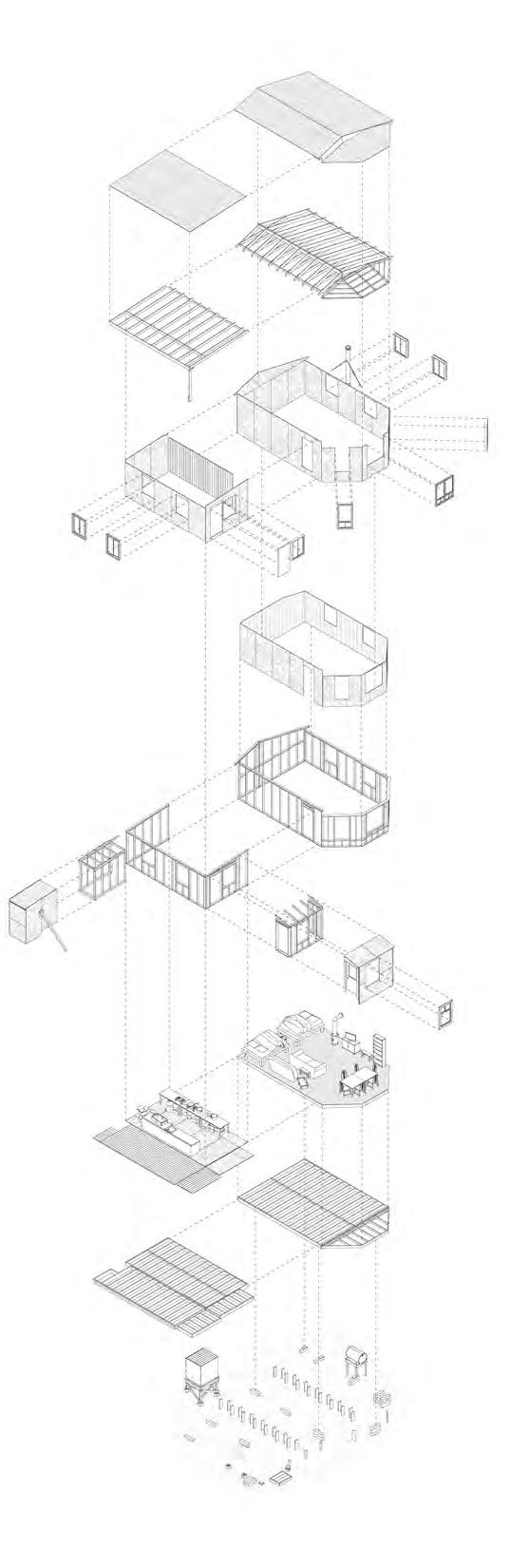
Le contreventement des murs est assuré par les revêtements intérieur et extérieur en contreplaqués.
La face intérieure des montants est parfois couverte d’une membrane pare-vapeur et plus rarement d’une membrane de polyéthylène (ex. : Tyvek). Les cavités des montants sont pour leur part remplies avec de l’isolant. Bien que très probables, peu d’indices ont permis de déceler la présence d’un écran pare-pluie derrière le revêtement extérieur.
Une ossature de bois en 2x4 (@ 24’’ d’espacements) soutient les murs dont les hauteurs latérales sont d’environ 6’6’’. Pour pallier au fait que cette grande cabane induit un volume d’air à chauffer encore plus important que dans les exemples précédents, la présence d’un système de chauffage à combustion apparait nessaire. Des linteaux et des pilastres reprennent les charges transférées par les ouvertures.
Le plancher de la pièce principale est une composition sandwich de contreplaqués, de panneaux d’isolant rigides, de contreplaqués et d’un revêtement de sol (possiblement des tuiles recyclées). Le plancher de l’annexe semble quant à lui uniquement fait de contreplaqués, tandis que celui de la galerie extérieure résulte d’un alignement usuel de planches espacées de quelques millimètres. En tout, la surface de plancher intérieure représente 54,4 m2
Les nombreux appuis de la cabane reposent sur un sol parsemé d’af eurements rocheux et d’îlots de sable et de gravier. Des socles de béton et des empilements de poutres de bois permettent l’ajustement précis de ces appuis par l’ajout de plus petites planches. Les ancrages, ponctués en deux séries, courent sous la structure des planchers en s’enfon ant légèrement dans le sol. Ici, la multiplication de ces ancrages permet de résister aux charges latérales des vents.
Exemples
associés au modèle de la cabane fxe et déployée
Igajialuk
Qarqaluarjutuaq (d18)



Kikkaluk (q9 - q10)
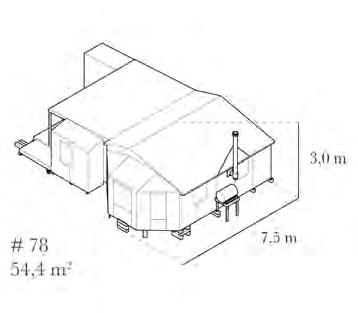
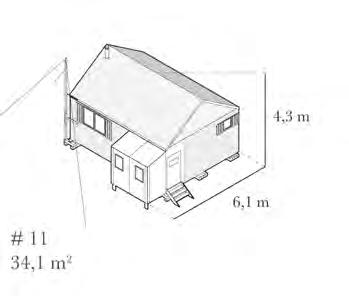
Annexe 1 - page 346
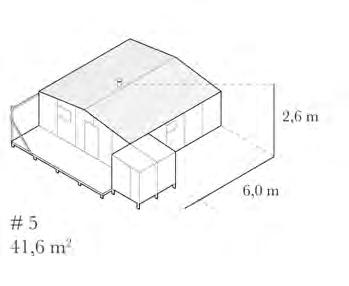 1/2 (f17)
1/2 (f17)
Annexe 1 - page 347
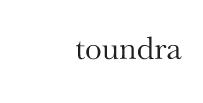

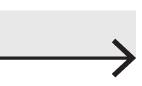

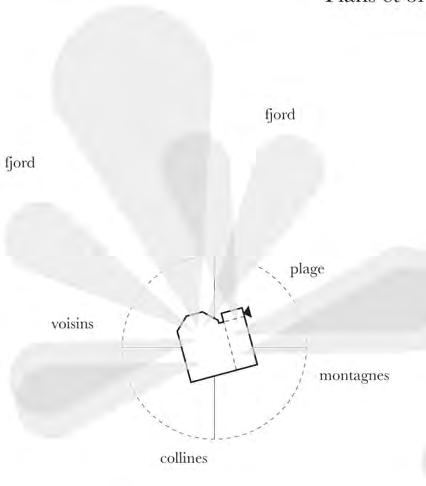
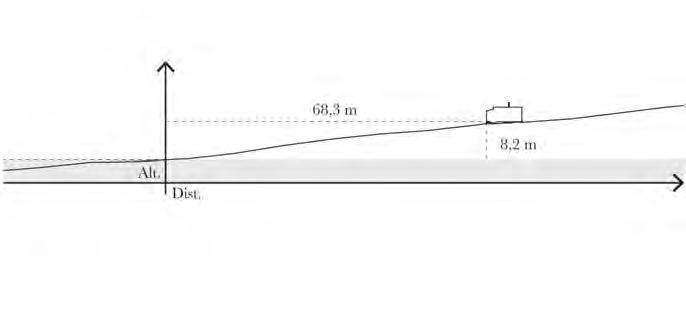
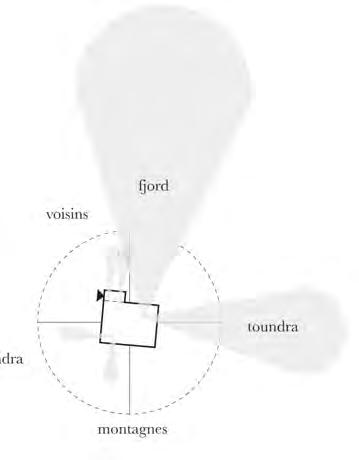
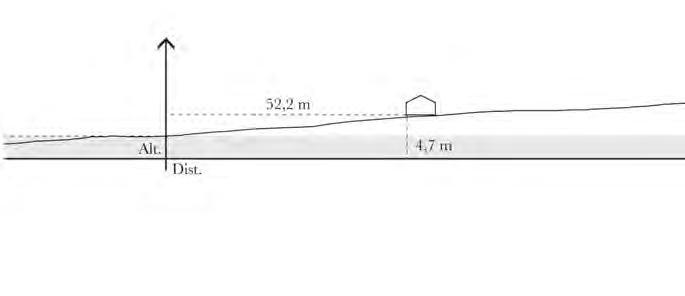
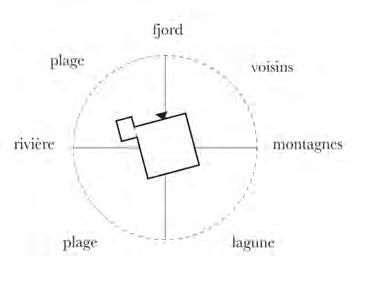
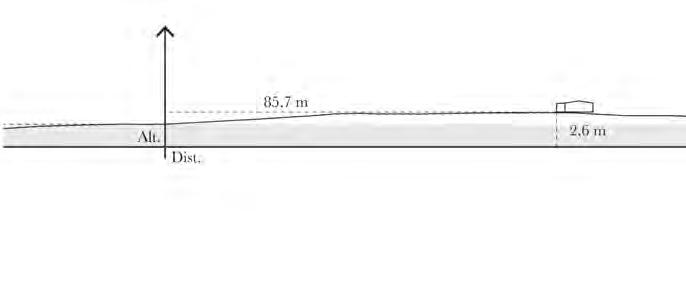
Exemples
associés au modèle de la cabane fxe et déployée
Kikkaluk (q9 - q10)
Kikkaluk (q9 - q10)


Annexe 1 - page 348
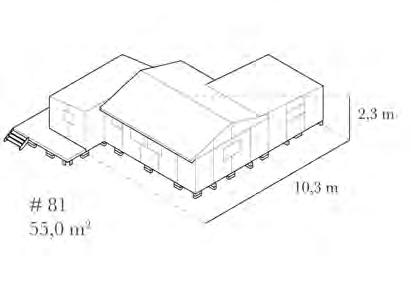
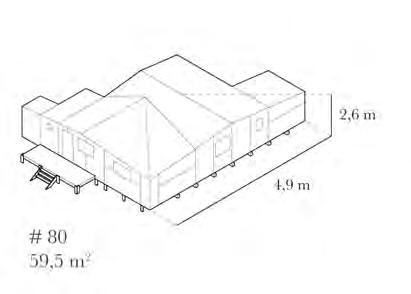
ommaire de la position des cabanes fxes en déplo ées
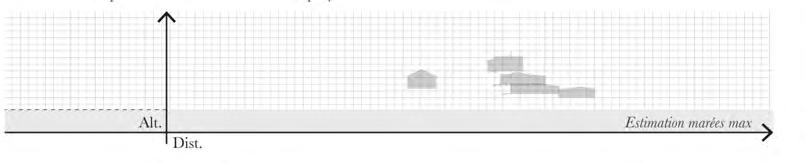
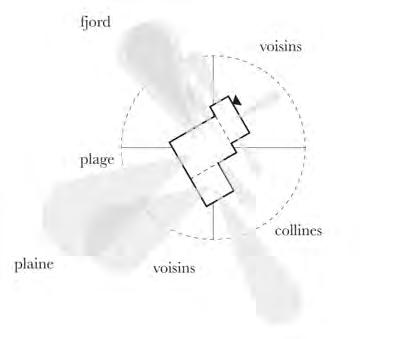
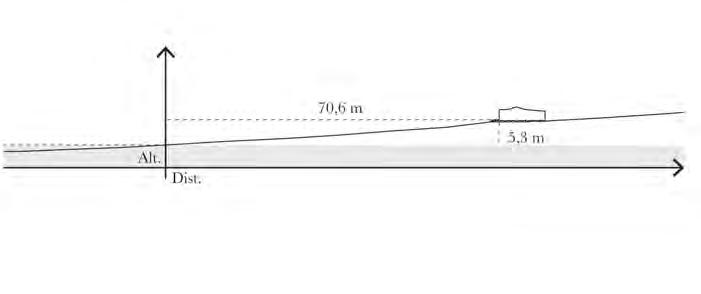
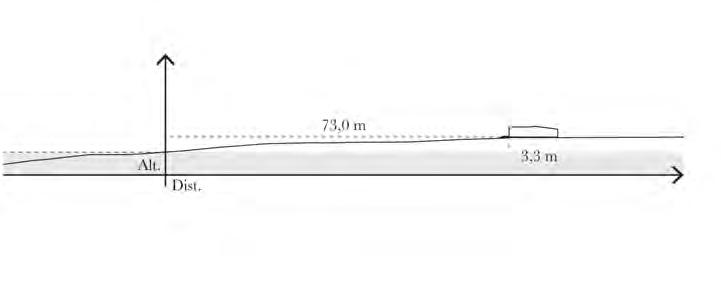
Annexe 1 - page 349
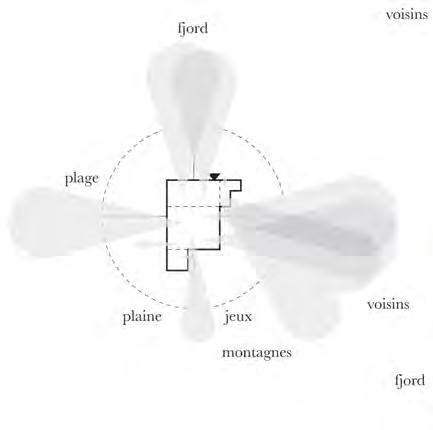
Analyses globales et corrélations des modèles
Les six schémas suivants sont présentés dans le chapitre 6 du mémoire. Les figures 17 et 18 revisitent quelques données probantes collectées sur l’ensemble des cabanes identifiées dans le fjord de Salluit, tandis que les figures 19 à 22 exposent différentes corrélations observables entre les cinq modèles types suggérés à la quatrième échelle d’analyse de la déconstruction graphique. En ce sens, les deux premières figures ont pour échantillon
la centaine de cabanes étudiées à travers l’analyse des campements du fjord, alors que les quatre autres figures regroupent pour leur part les 39 cabanes relevées à travers l’analyse de la volumétrie, de l’orientation et de la position des cabanes par rapport au fjord.
Annexe 1 - page 350

Annexe 1 - page 351
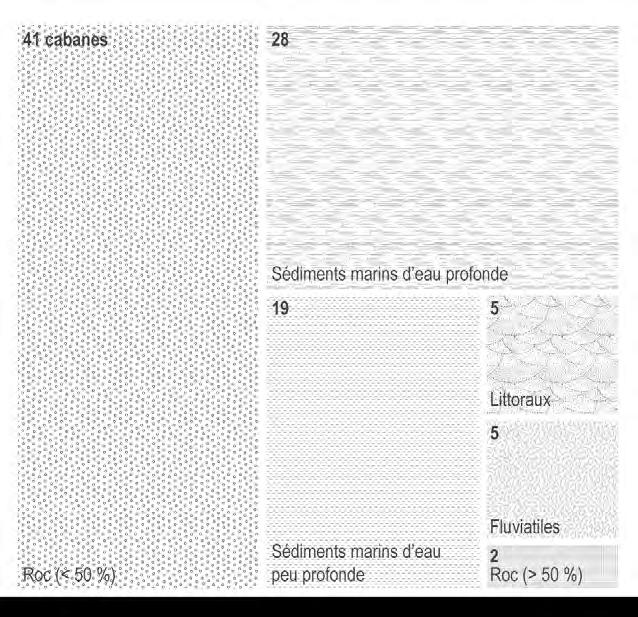
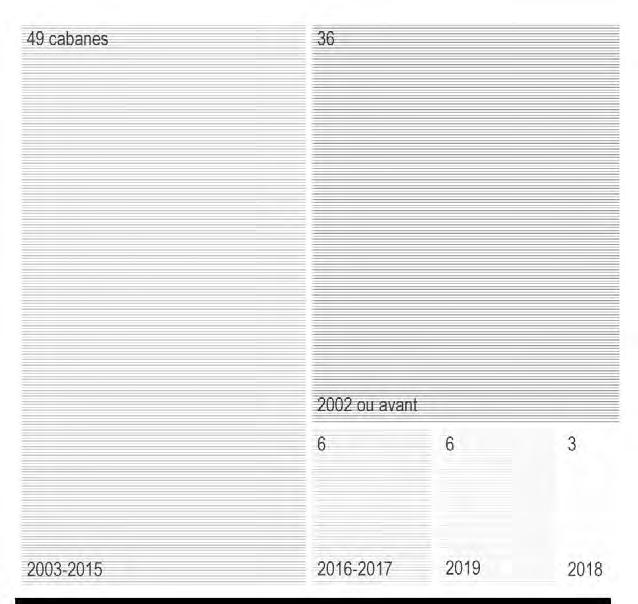 Figure 17. Nombre de cabanes par dépôts de surface répertoriées dans le fjord de Salluit.
Figure 18. Cabanes du fjord de Salluit répertoriées et construites (ou transformées) par périodes estimées.
Figure 17. Nombre de cabanes par dépôts de surface répertoriées dans le fjord de Salluit.
Figure 18. Cabanes du fjord de Salluit répertoriées et construites (ou transformées) par périodes estimées.
Annexe 1 - page 352
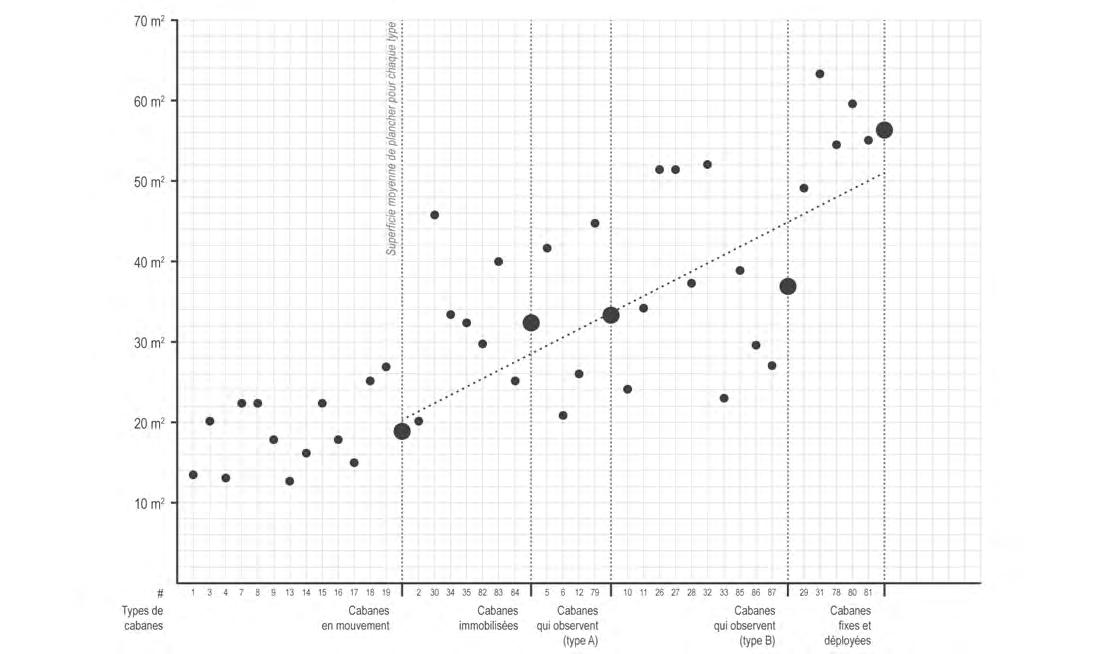
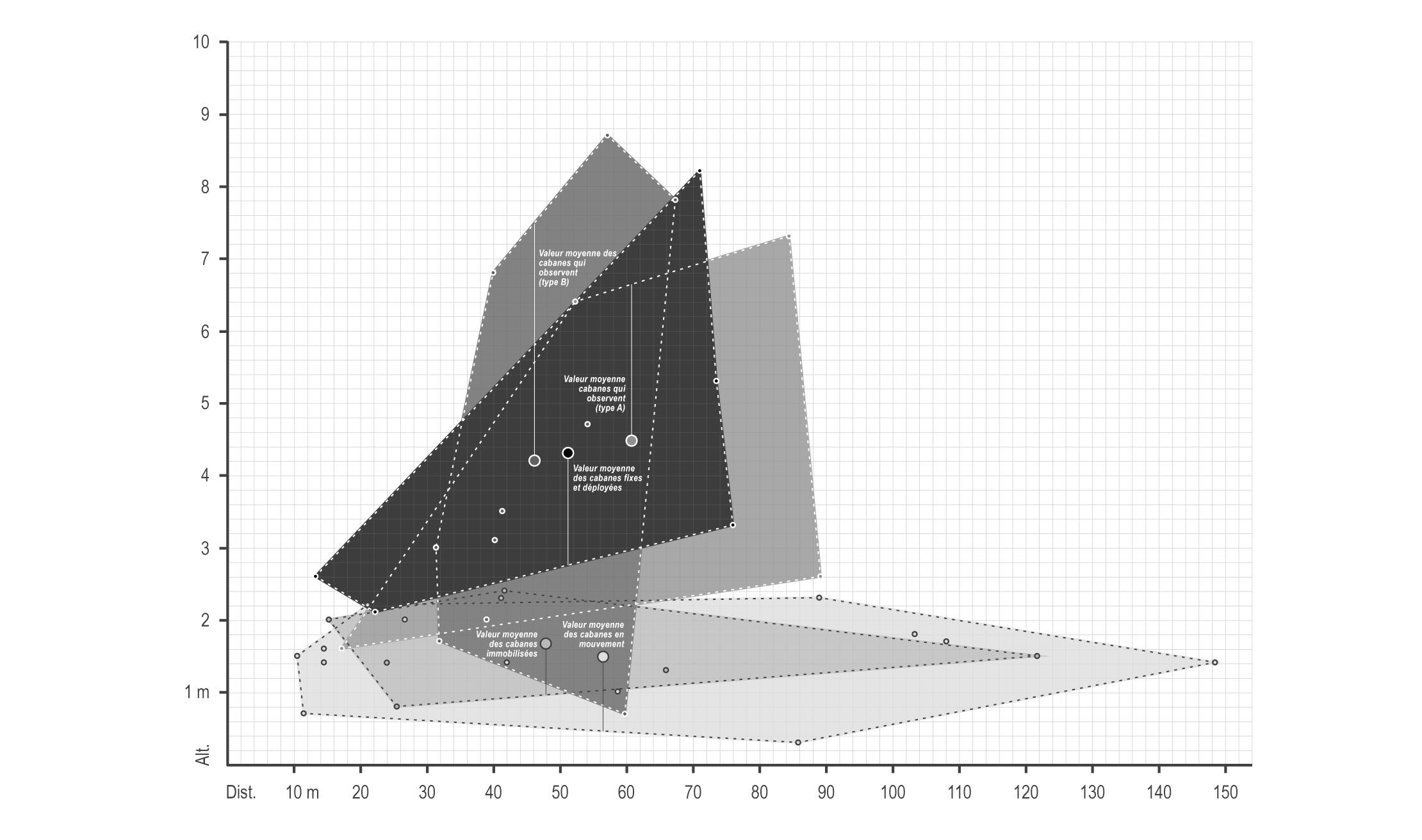 Figure 19. Corrélation entre la position des cabanes (altitude et distance par rapport à la rive) et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 20. Corrélation entre la superfcie de plancher des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 19. Corrélation entre la position des cabanes (altitude et distance par rapport à la rive) et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 20. Corrélation entre la superfcie de plancher des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 353
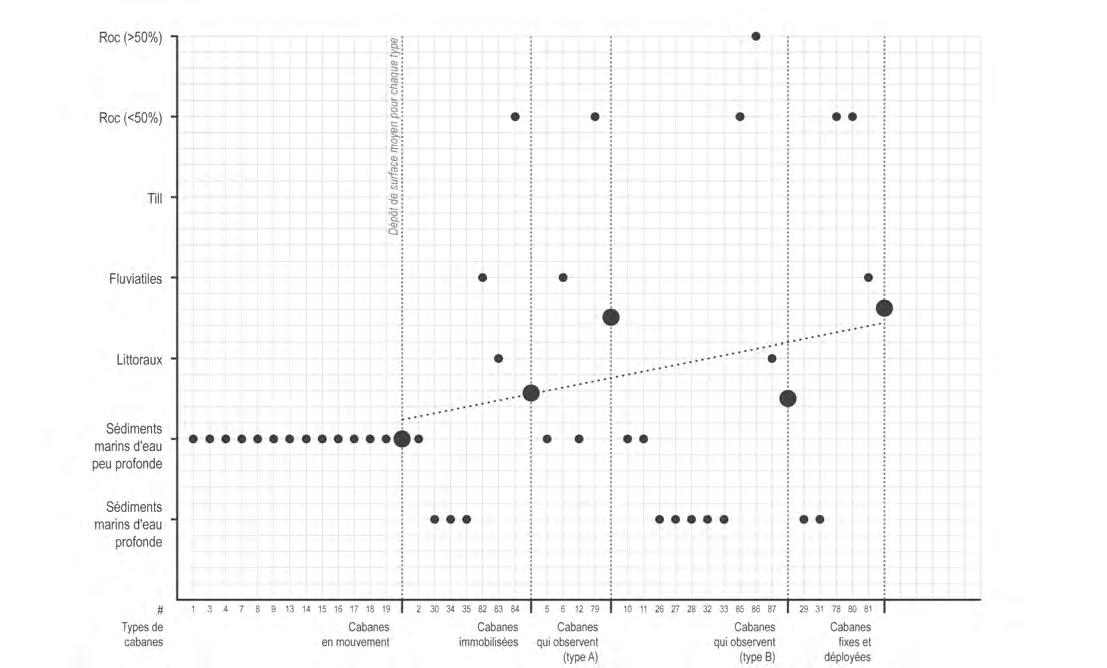
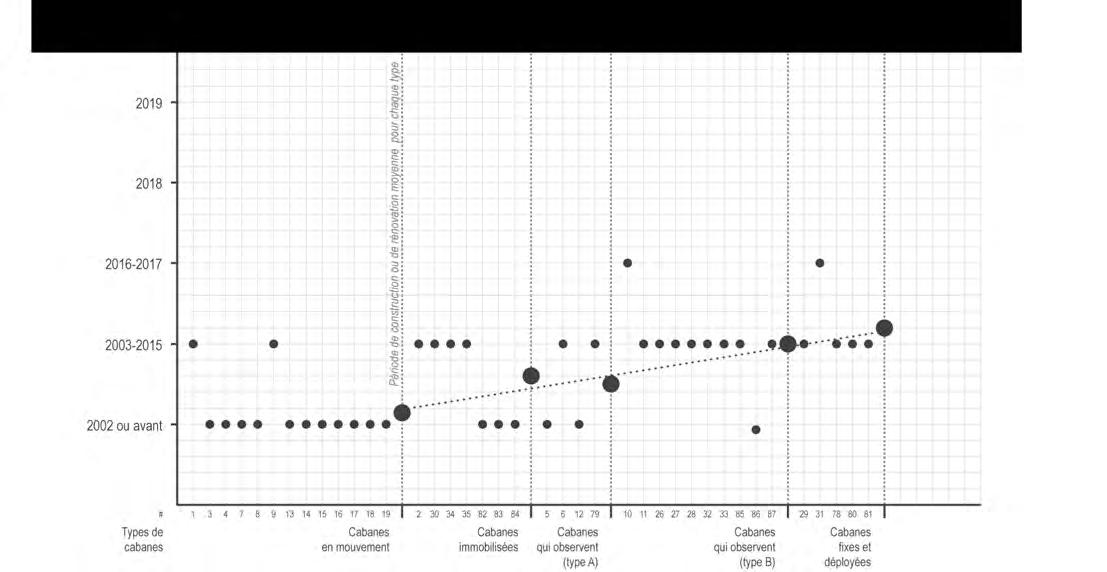 Figure 21. Corrélation entre la période de construction (ou de transformation) des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 22. Corrélation entre les dépôts de surface sur lesquels sont construites les cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 21. Corrélation entre la période de construction (ou de transformation) des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 22. Corrélation entre les dépôts de surface sur lesquels sont construites les cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.


Liste des fgures (de
l’annexe 01)
Le Nunavik au nord du 55e parallèle et ses quatorze communautés (Habiter le Nord québécois 2019). (p.11)
Le Nunavik septentrional et les terres de catégories convenues selon la CBJNQ. (p.13)
Campements et lieux du fjord de Salluit. (p.17)
Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements. (p.21)
Exemples de quelques séries d’analyses apportées à chacun des campements recensés dans le fjord de Salluit. (p.25)
Exemples de quelques dessins volumétriques des cabanes du fjord de Salluit.
Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer l’importance et l’orientation des cônes de vision des cabanes.
Exemple exprimant les cônes de vision de la cabane #85 donnée en exemple à la fgure précédente.
Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer la position des cabanes. Exemple exprimant le profl altimétrique de la cabane #85 donnée en exemple à la fgure précédente.
Exemple du niveau de détails d’une modélisation numérique d’une cabane. (p.203)
Représentation dimétrique d’une cabane en mouvement (haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite). (p.204-205)
Représentation dimétrique d’une cabane immobilisée (haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite). (p.212-213)
Représentation dimétrique d’une cabane qui observe (variante a - haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite). (p.218-2019)
Représentation dimétrique d’une cabane qui observe (variante b - haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite). (p.224-225)
Représentation dimétrique d’une cabane fxe et déployée (haut) et axonométrie interprétative de ses diverses composantes (droite). (p.232-233)
Figure 1.
Figure 2.
Figure 3.
Figure 4.
Figure 5.
Figure 6.
Figure 7.
Figure 8.
Figure 9.
Figure 10.
Figure 11.
Figure 12.
Figure 13.
Figure 14.
Figure 15.
Figure 16.
Annexe 1 - page 356
Nombre de cabanes par dépôts de surface répertoriées dans le fjord de Salluit. (p.239)
Cabanes du fjord de Salluit répertoriées et construites (ou transformées) par périodes estimées. (p.239)
Corrélation entre la position des cabanes (altitude et distance par rapport à la rive) et les cinq diférents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit. (p.240)
Corrélation entre la superfcie de plancher des cabanes et les cinq diférents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit. (p.240)
Corrélation entre la période de construction (ou de transformation) des cabanes et les cinq diférents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit. (p.241)
Corrélation entre les dépôts de surface sur lesquels sont construites les cabanes et les cinq diférents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit. (p.241)
Annexe 1 - page 357
Figure 17.
Figure 18.
Figure 19.
Figure 20.
Figure 21.
Figure 22.
Médiagraphie (de l’annexe 01)
ALLARD, Michel, et al. Problématique du développement du village de Salluit, Nunavik. Québec, Université Laval, Centre d’études nordiques, 2004, 93 p.
ArcGIS. ArcGIS Online, https://www.arcgis.com/ (Logiciel consulté entre janvier 2018 et mars 2021).
BOISSON, Antoine. Photographies aériennes des berges du fjord de Salluit, photographies numériques avec téléobjectif, 2015, Centre d’études nordiques de l’Université Laval.
BRAND, Stewart. 1995. How Buildings Learn: What Happens After They’re Built. Penguin Books.
CANIGGIA, Gianfranco, Gian Luigi MAFFEI. 1979. Composition architecturale et typologie du bâti, 1. Lecture du bâti de base. Traduit par Pierre Larochelle, École d’architecture de l’Université Laval, 2000.
DEMEULE, Pierre-Olivier. Photographies de terrain des relevés de cabanes dans le fjord de Salluit, photographies numériques avec téléobjectif et grand angle, 2018, partenariat Habiter le Nord québécois.
— , « Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra » Mémoire de maîtrise en science de l’architecture, Université Laval, (publication prévue en 2021).
— . (devrait paraître en 2021). « Savoir-faire locaux et autoconstruction dans la toundra, une lecture des cabanes du fjord de Salluit ». Études/Inuit/Studies 44(1-2).
DIPASQUALE, Letizia, Pinar Kisa OVALI, Saverio MECCA et Bilge Özel. 2014. « Resilience or vernacular architecture » Dans M. Correia, L. Dipasquale et S. Mecca (dir.), Versus, heritage for tomorrow : Vernacular knowledge for sustainable architecture, p. 64-73. Florence : Firenze University Press.
DUHAIME, Gérard. 1985. De l’igloo au H.L.M. : Les Inuit sédentaires de l’État-providence. Québec, Université Laval, Collection Nordicana.
—. 2019. « Les transformations sociales de l’habiter inuit, l’utopie pour une nouvelle saison ». Communication présentée au Congrès d’Études Inuit, Montréal, 3 octobre 2019.
GOOGLE. Google Earth Pro (7.3.3.7786 / 64-bit), https://earth.google.com/ (Logiciel consulté entre janvier 2018 et mars 2021).
Annexe 1 - page 358
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Forêt Ouverte (version: 1.6.3), https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/ (Logiciel consulté entre janvier 2018 et mars 2021).
GROUPE HABITATS ET CULTURES. 2017. Habiter ici : Portrait des communautés innues du Nitassinan et inuit du Nunavik. École d’architecture de l’Université Laval, Québec.
—. 2019. Imaginer : Projets collaboratifs de recherche-création Nitassinan et Nunavik. École d’architecture de l’Université Laval, Québec.
HABRAKEN, N. John. 1988. Transformation of the Site. Awater Press.
—. 1998. The Structure of the Ordinary : Form and Control in the Built Environment. The MIT Press.
HAVELKA, Susane. 2018. « Building with IQ (Inuit Qaujimajatuquangit): The Rise of a Hybrid Design Tradition in Canada’s Eastern Arctic. » Thèse de doctorat, McGill University.
HOLMES, Lauren H. 2013. « Nuna-Regionalism : A Vision of Iqaluit Regionalism ». Mémoire de maîtrise en architecture, University of Waterloo.
LÉVESQUE, Carole. La précision du vague, une documentation de friches industrielles et autre lieux délaissés pour la construction d’un imaginaire urbain et architectural. Exposition tenue au Centre de design de l’UQAM du 7 février au 14 avril 2019.
macOS, Sierra 10.12.6. Plans (version 2.0 / 1983.24.9.30.35), (Logiciel consulté entre janvier 2018 et mars 2021).
MAGNAGHI, Alberto. 2014. La biorégion urbaine : Petit traité sur le territoire, bien commun. Paris, France : Rhizome.
NVISION Insight Group. 2018. « Addictions and Trauma Treatment in Nunavut ». pour le Gouvernement du Nunavut. 115 p.
PARNASIMAUTIK. 2014. Rapport de la consultation réalisée auprès des Inuits du Nunavik en 2013 Novembre.
SEARLES, Edmund. 2010. « Placing Identity: Town, Land, and Authenticity in Nunavut, Canada ». Acta Borealia 27(2), 151-166.
Annexe 1 - page 359
Le présent document intègre tous les dessins et toutes les analyses produits dans le cadre du travail de mémoire intitulé : Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra.

Pour orienter la consultation de cette annexe et en permettre une lecture autonome, celle-ci est organisée en quatre sections (lesquelles suivent l’ordre et les étapes clés de la méthodologie de l’étude). Des résumés des objectifs et des exercices d’analyse propres à chaque étape accompagnent également le début des sections. Cela dit, pour bien comprendre les subtilités de l’approche entreprise par la recherche et surtout pour connaître les interprétations et les réfexions qui découlent du travail d’analyse, il est souhaitable de consulter l’intégralité du mémoire ou de minimalement lire l’article scientifque: Savoir-faire locaux et autoconstruction dans la toundra, une lecture des cabanes du fjord de Salluit (Études Inuit Studies - Construire et habiter l’Inuit Nunangat / Building and Dwelling in Inuit Nunangat - vol. 44, 1-2).









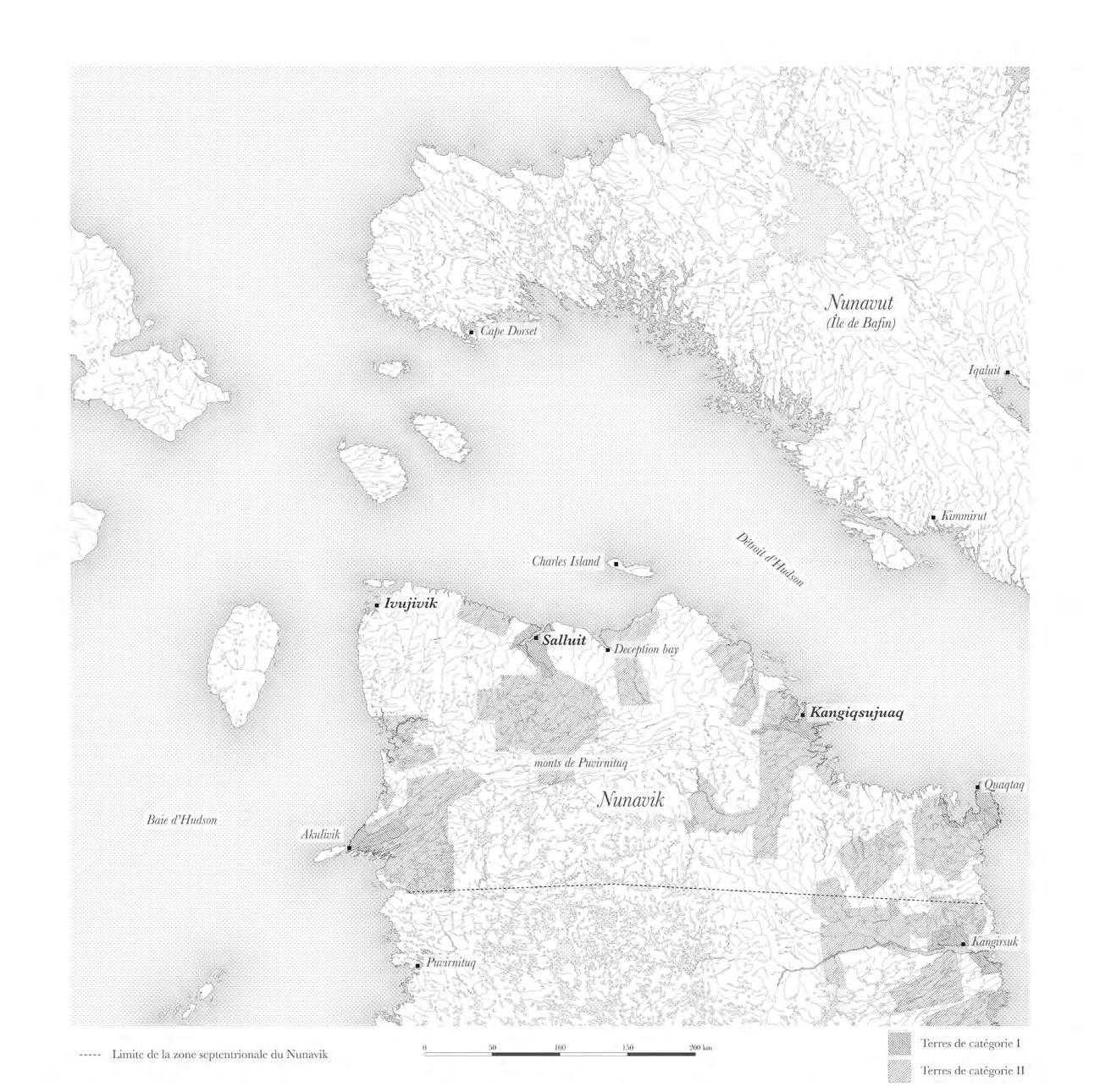 Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.
Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.
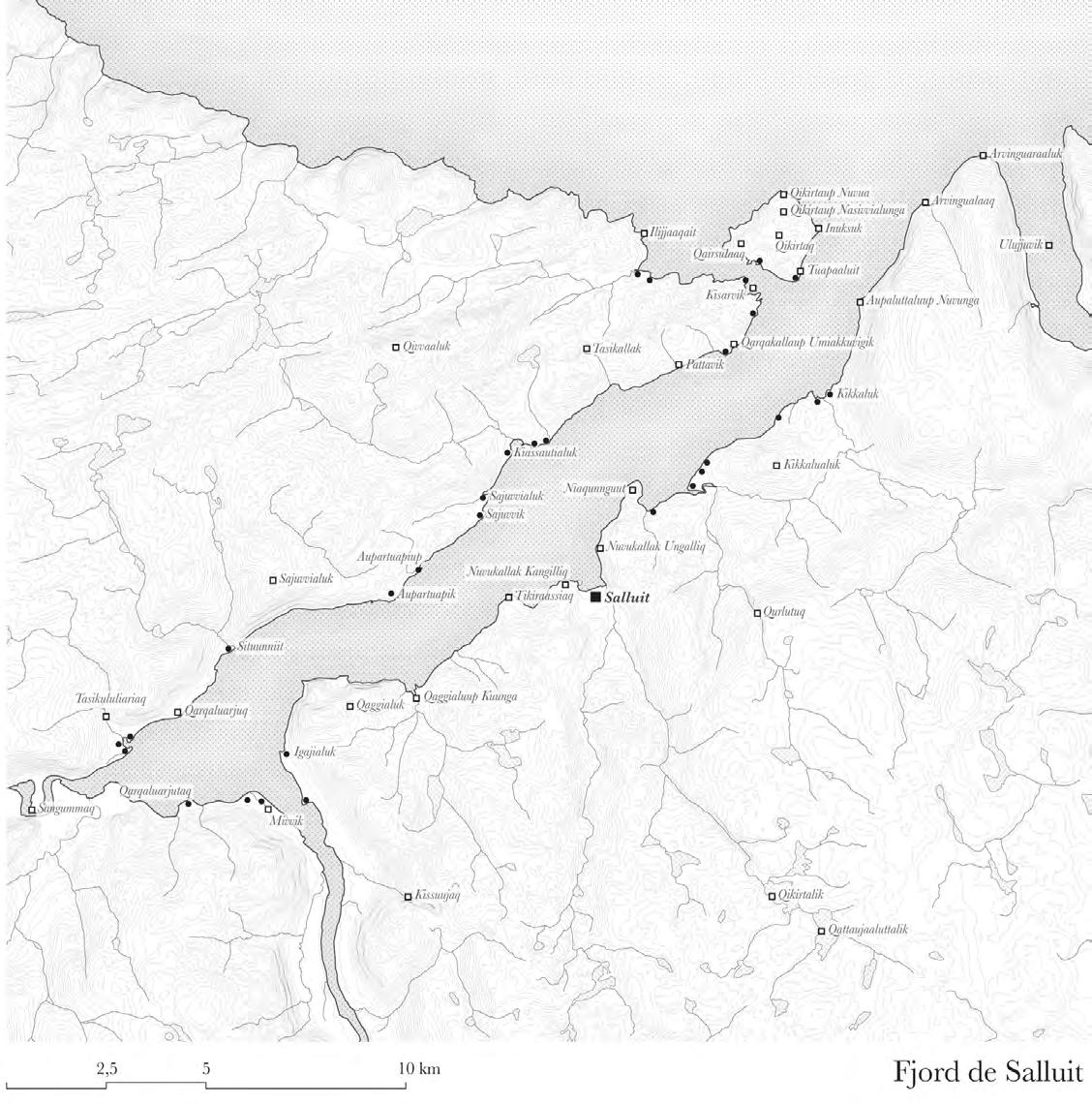
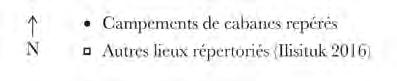 Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 129
Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.
Annexe 1 - page 129

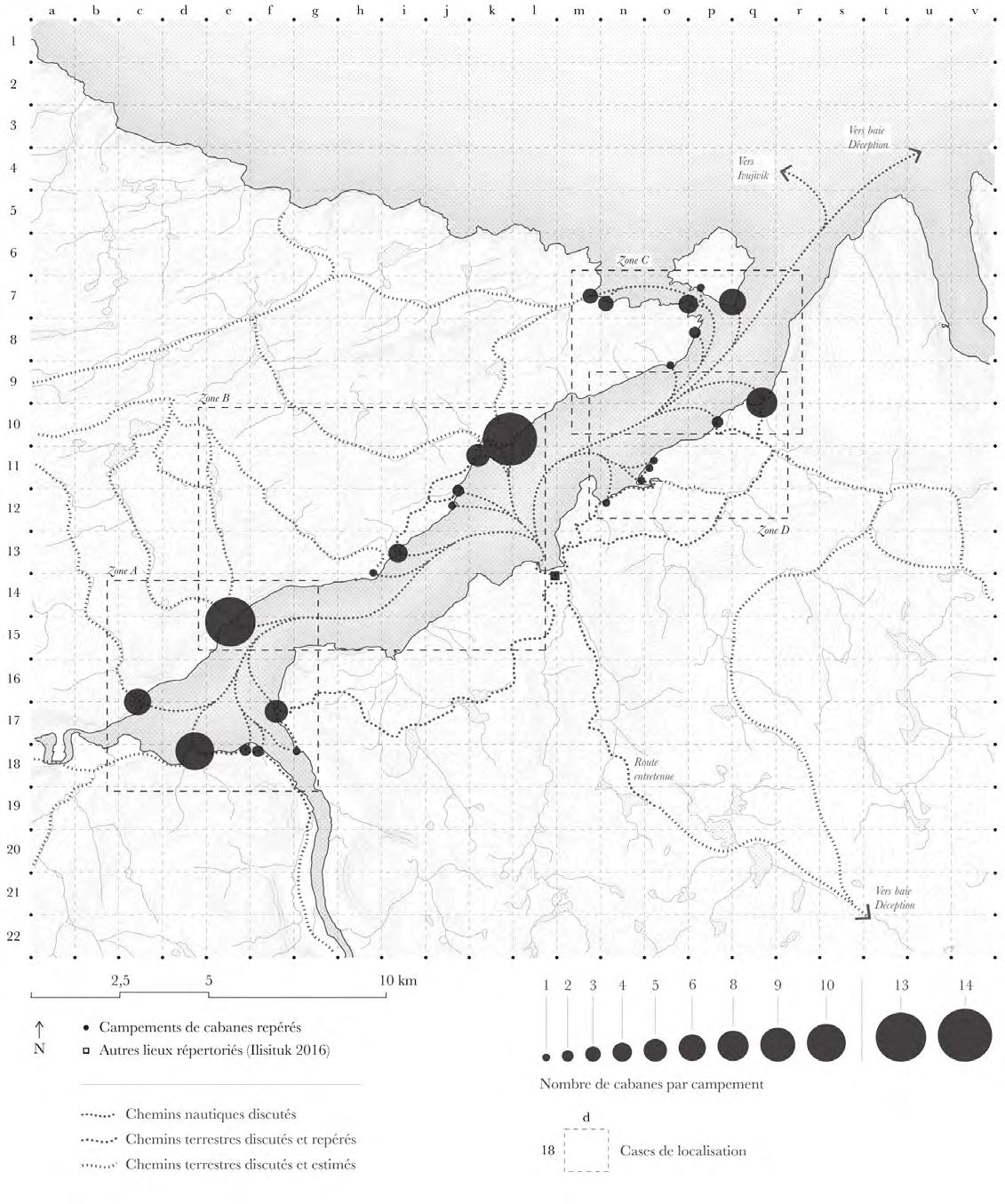 Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.
1 - page 133
Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.
1 - page 133



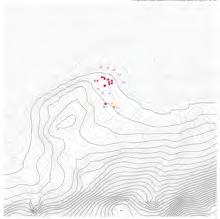
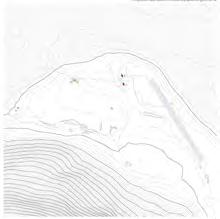

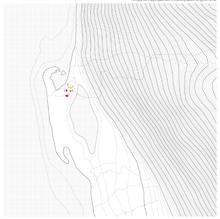

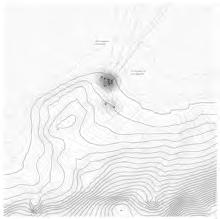


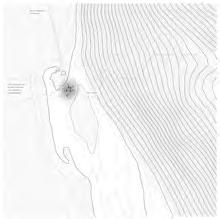



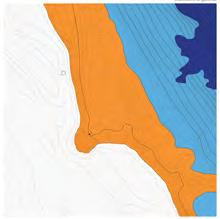

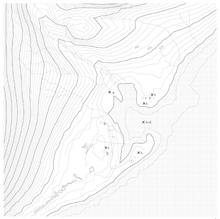
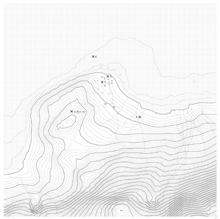


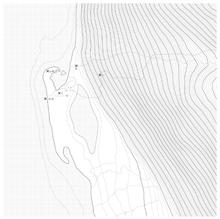
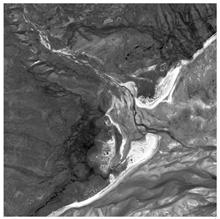

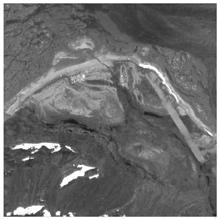
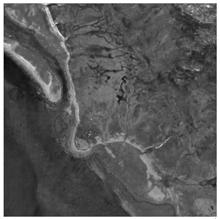

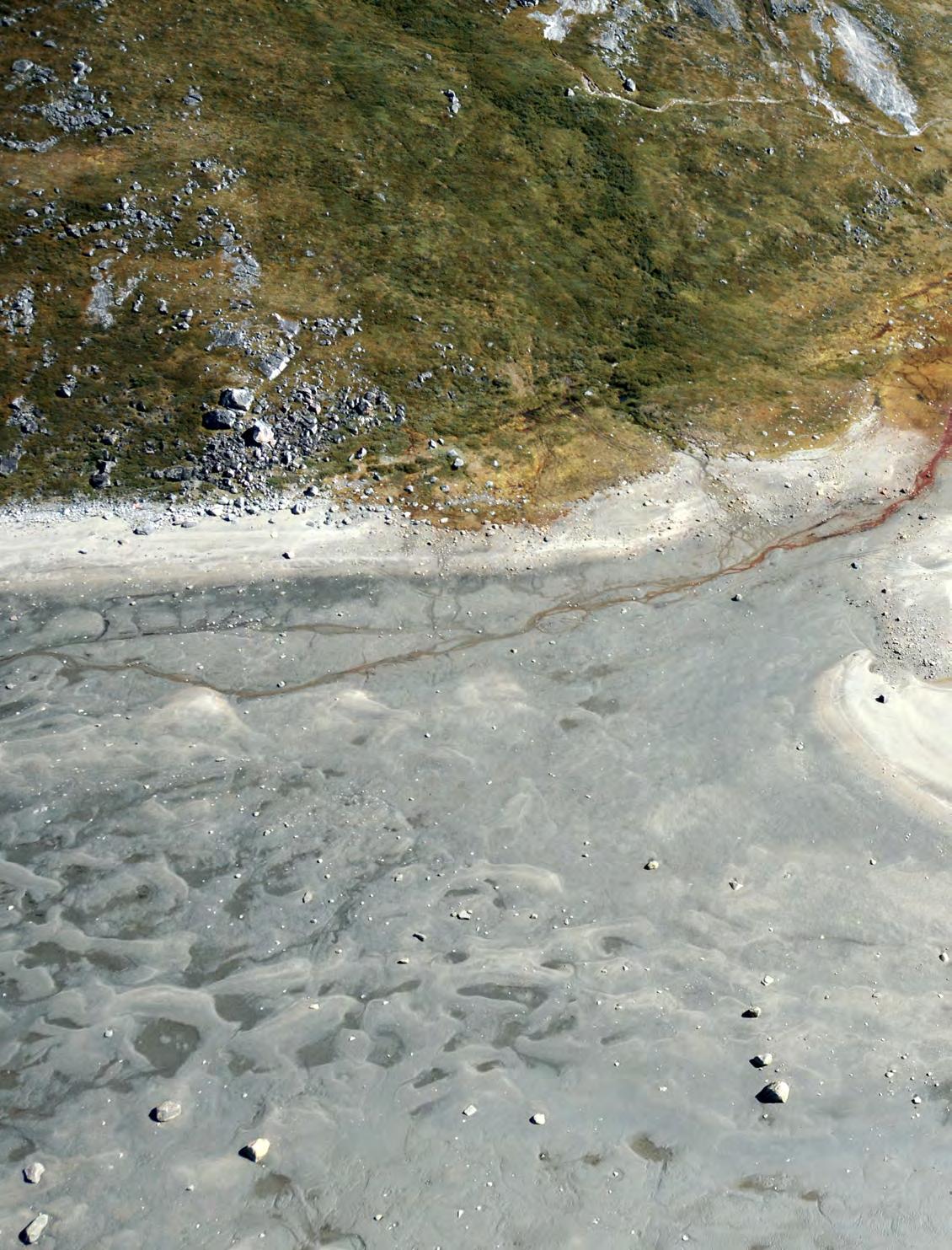 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

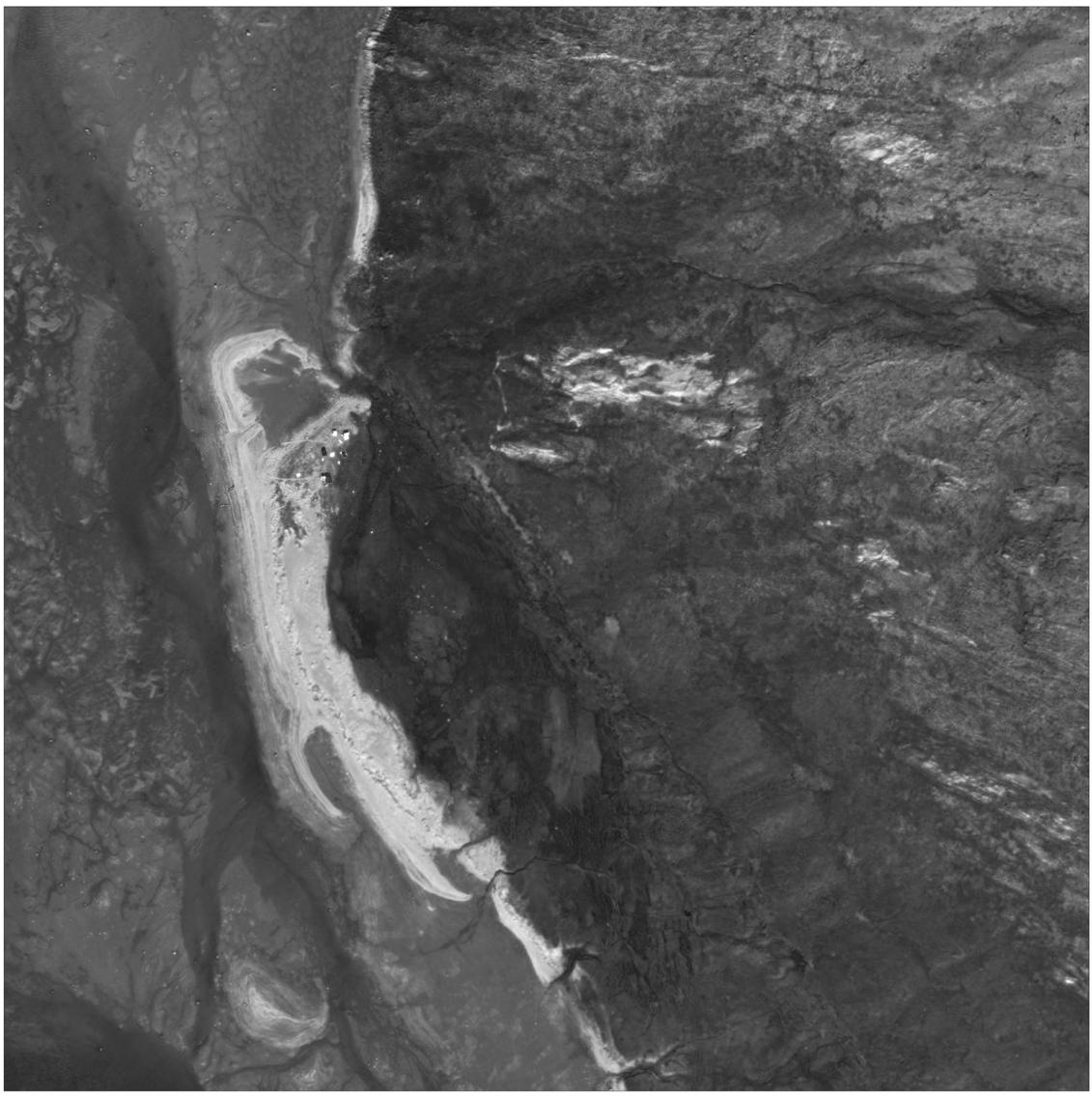











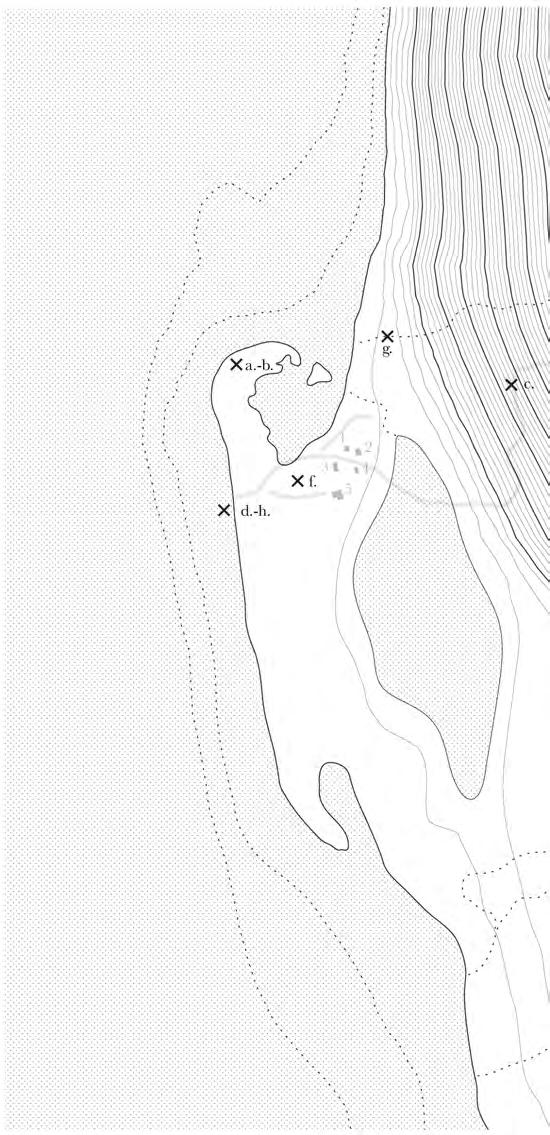
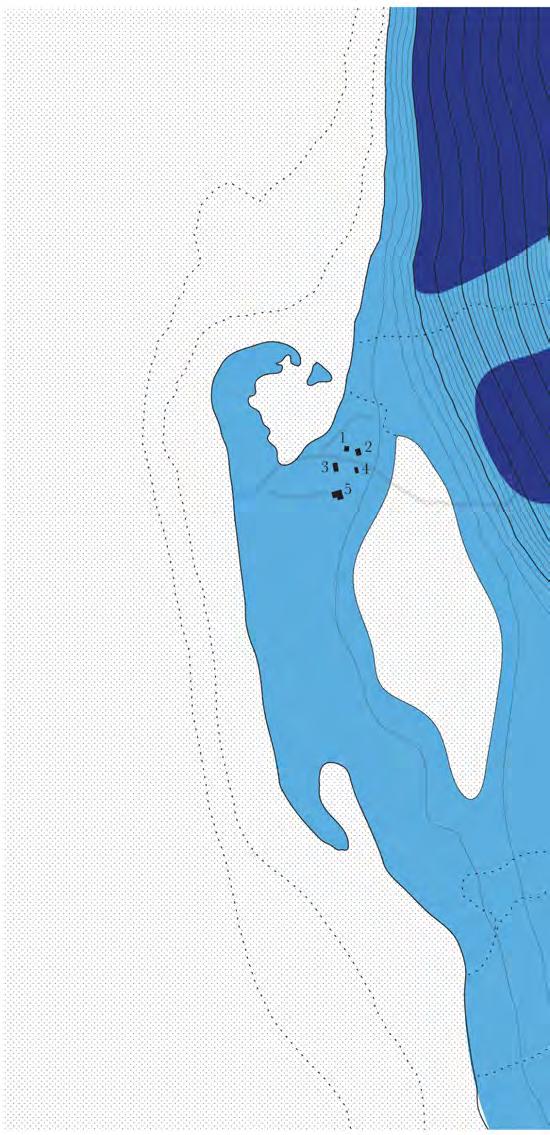

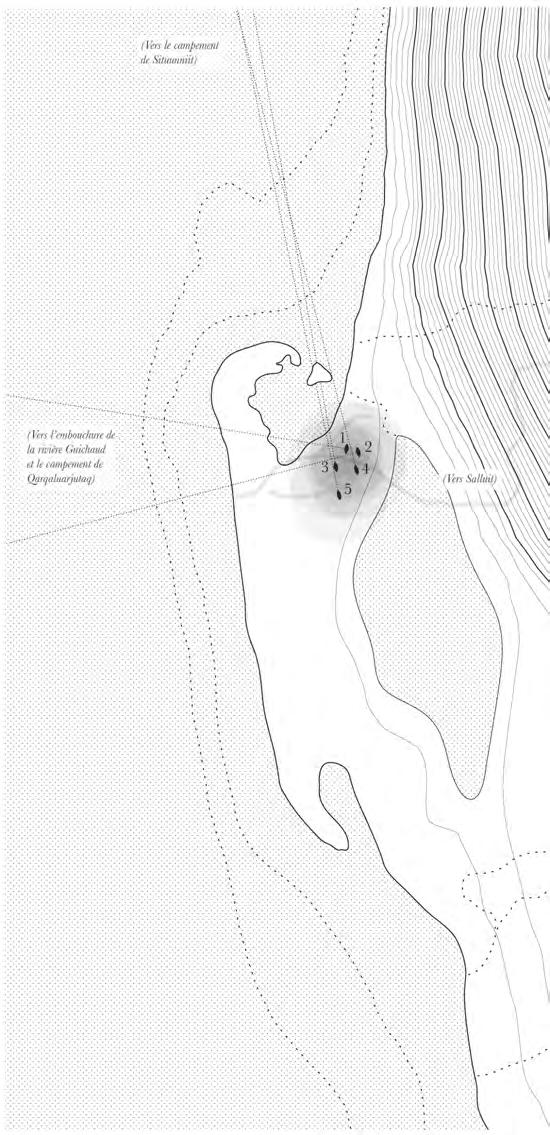


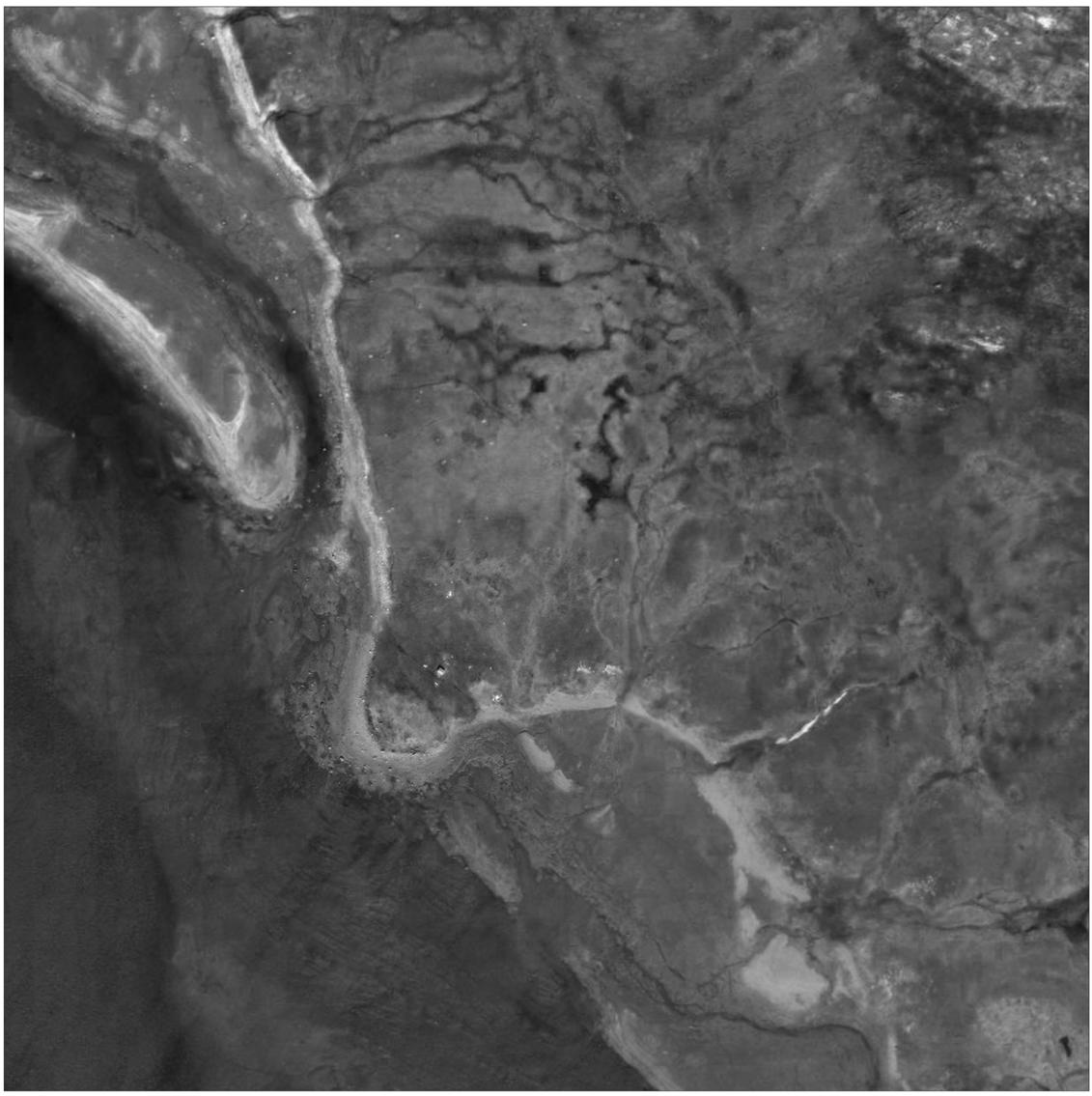
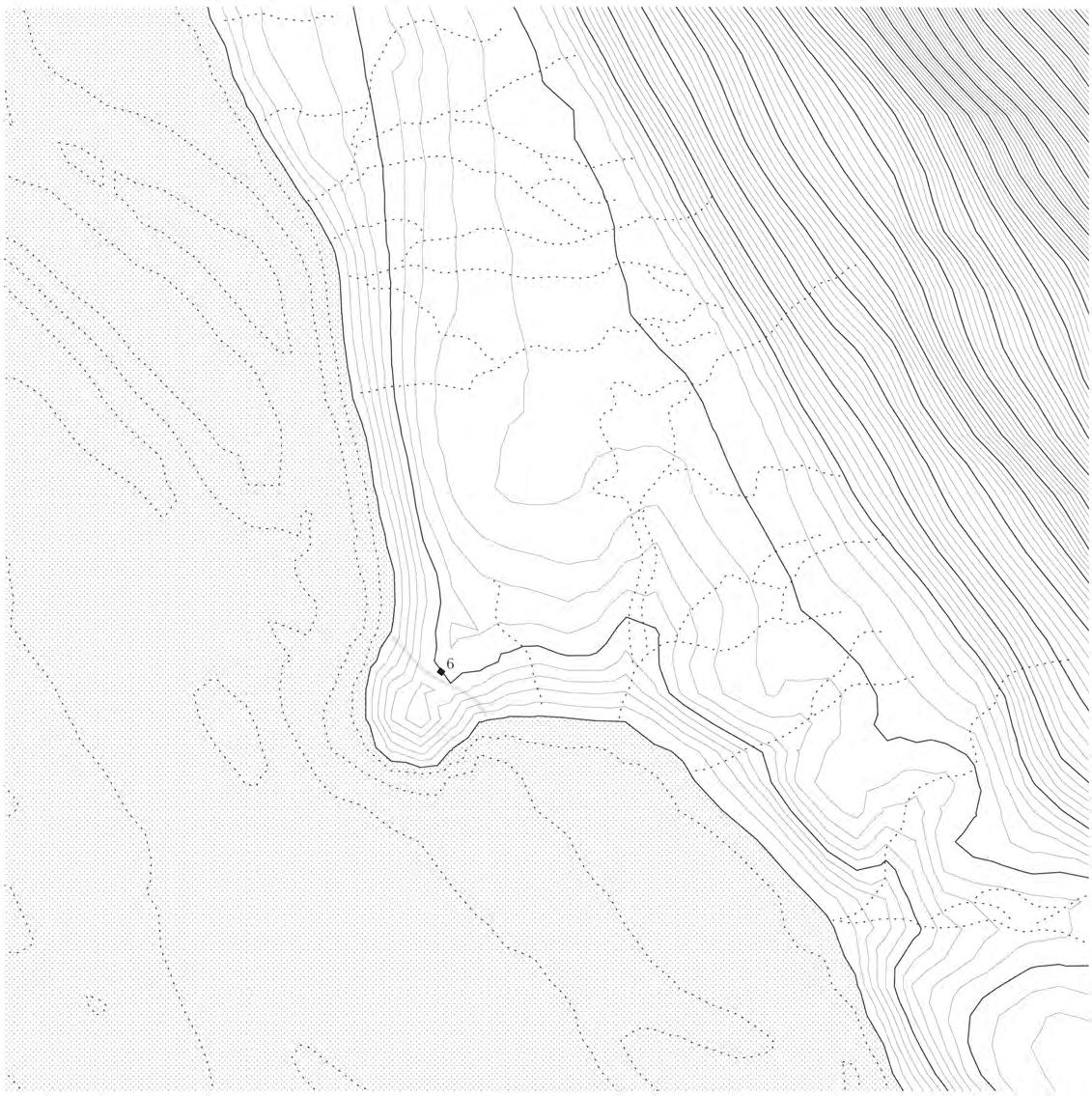 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
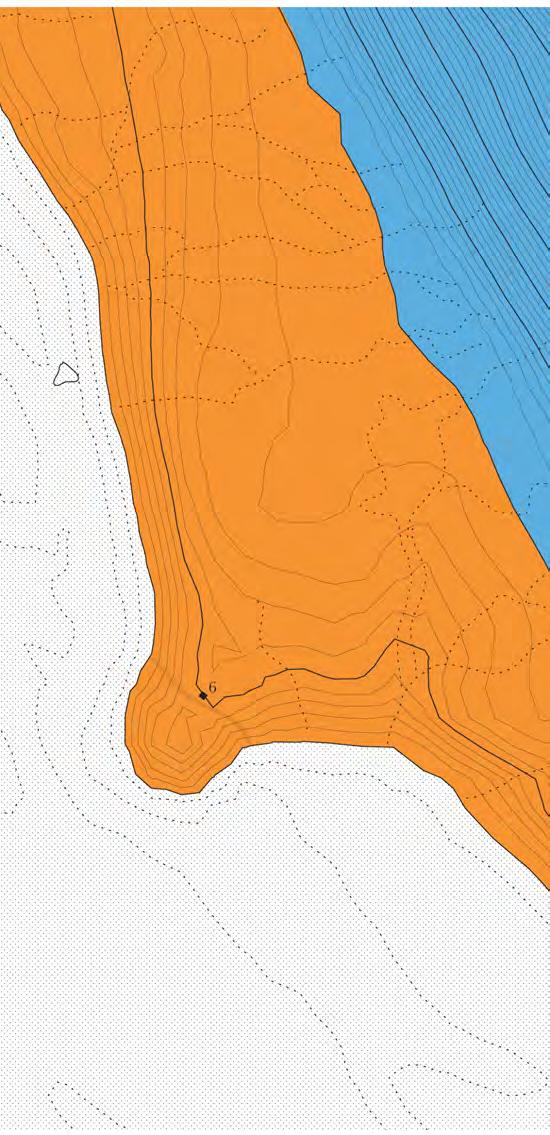
 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
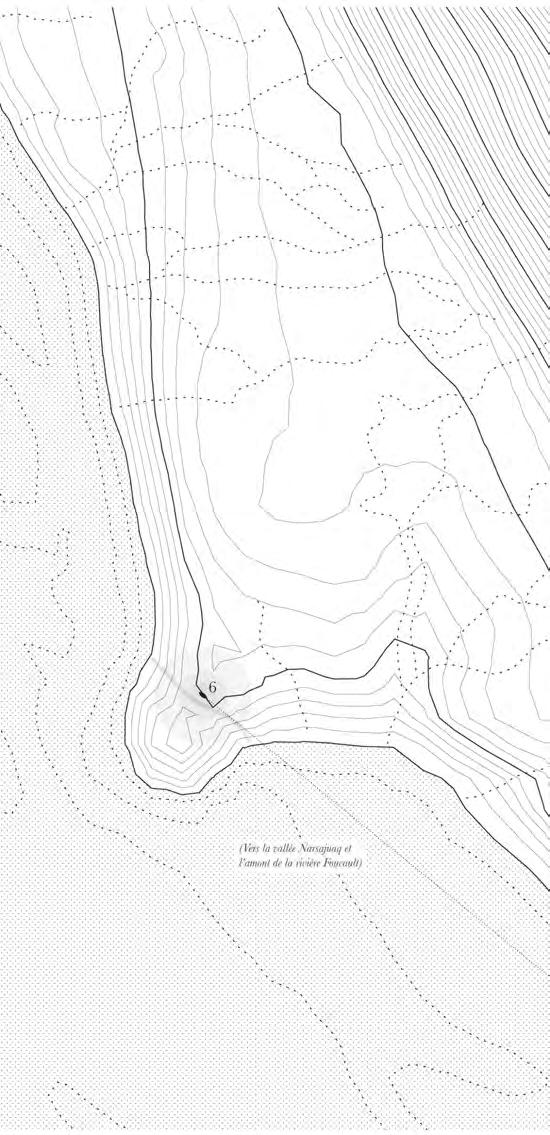



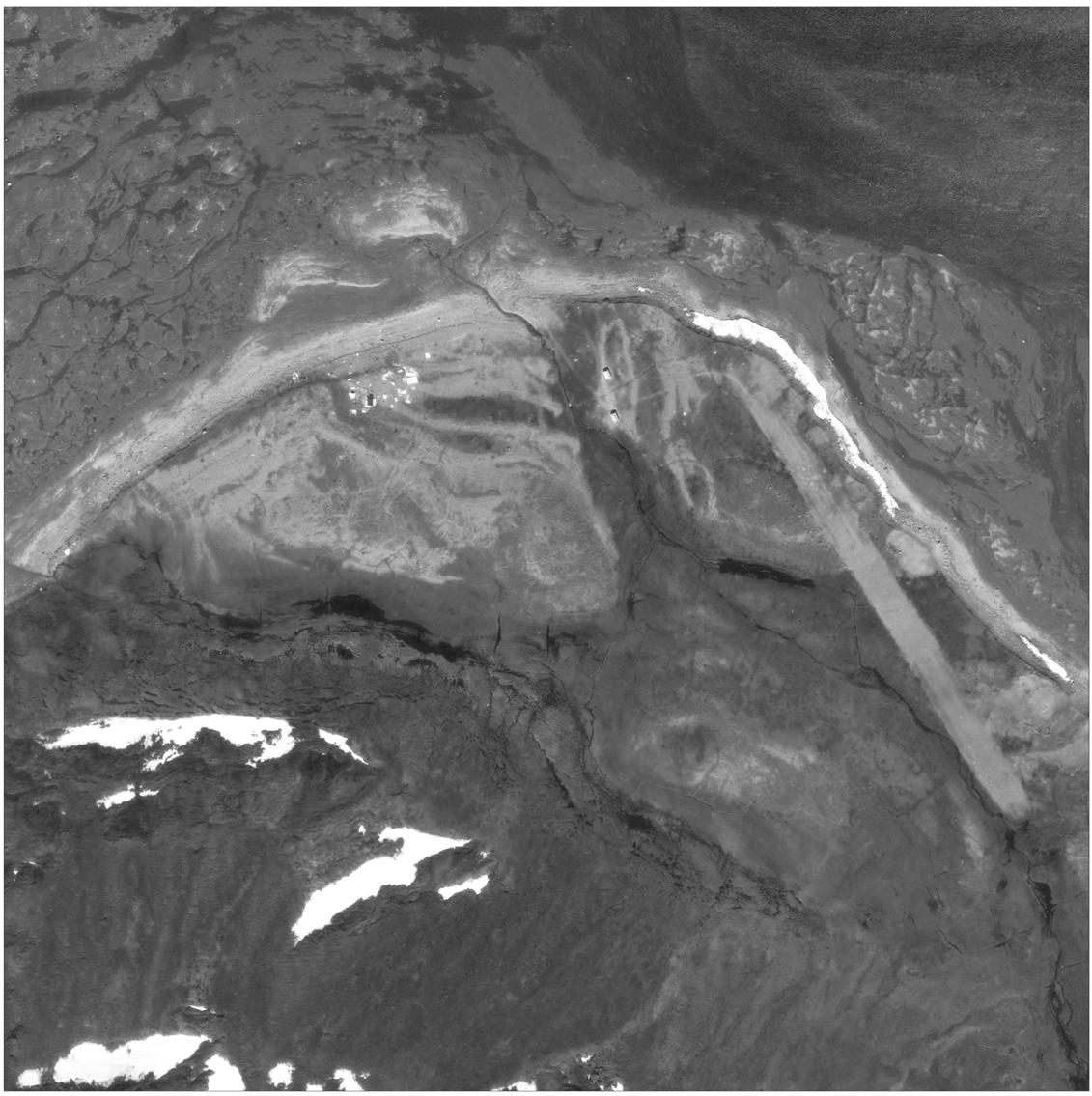
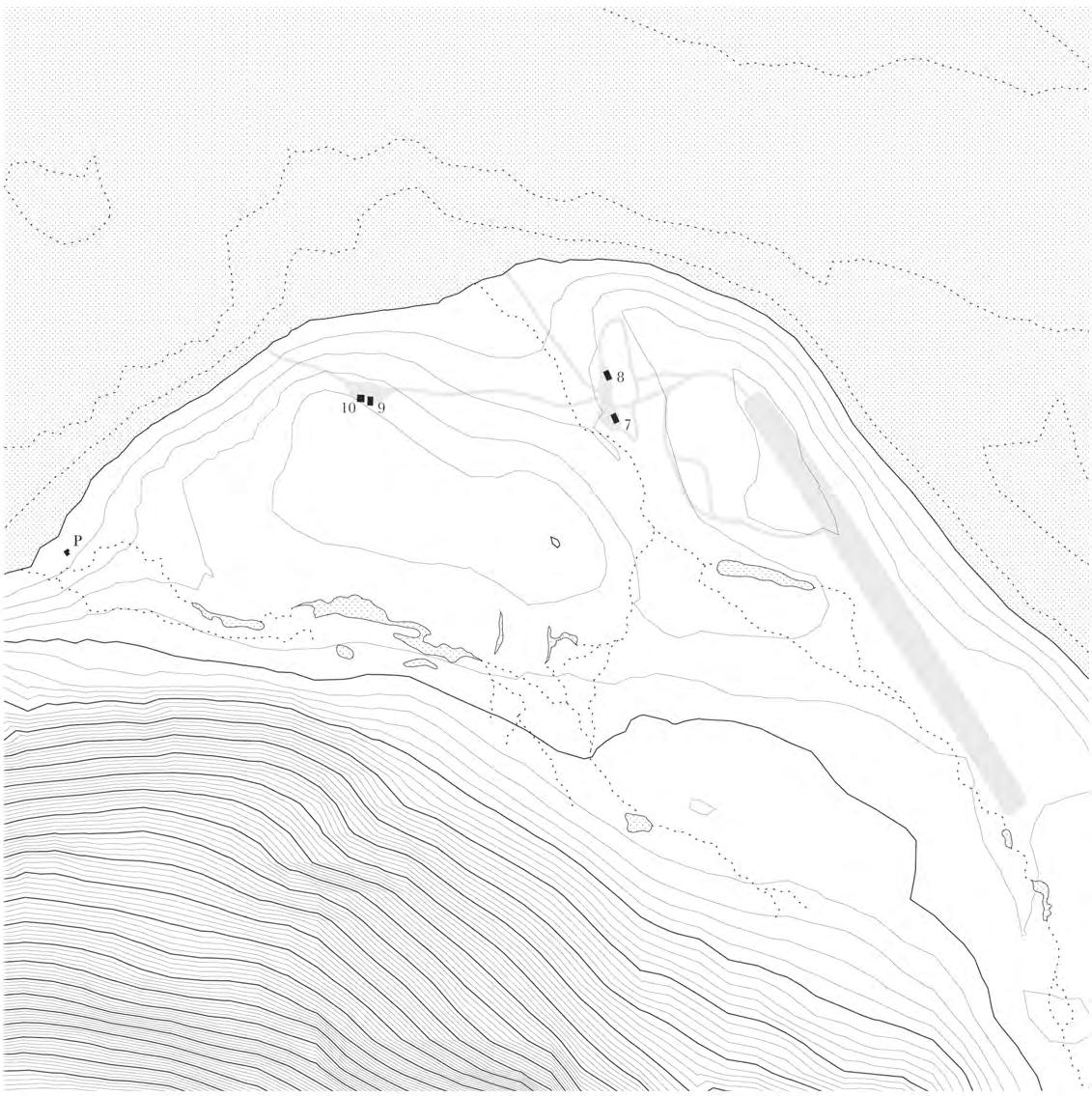
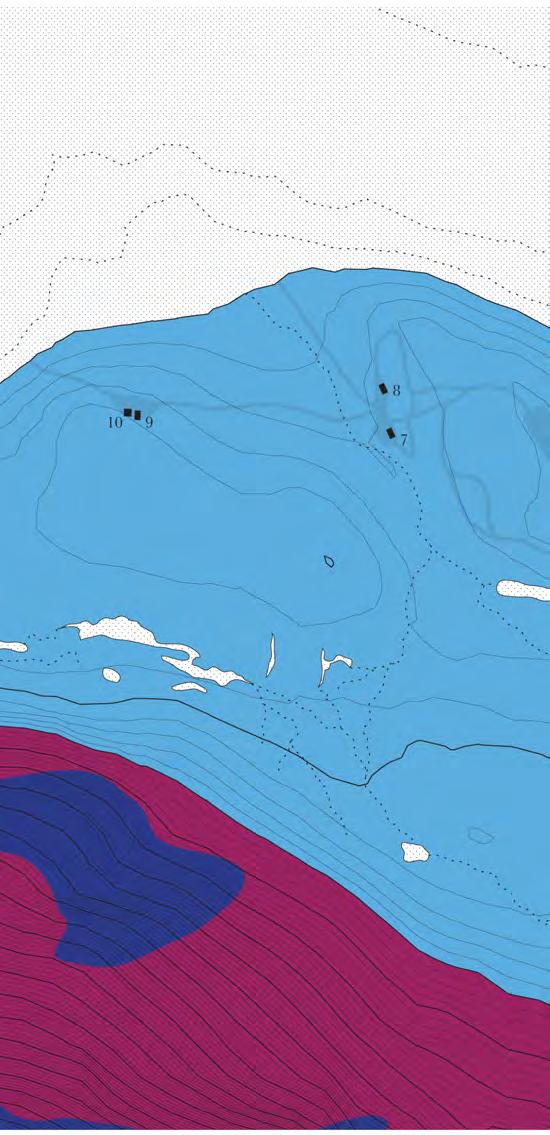
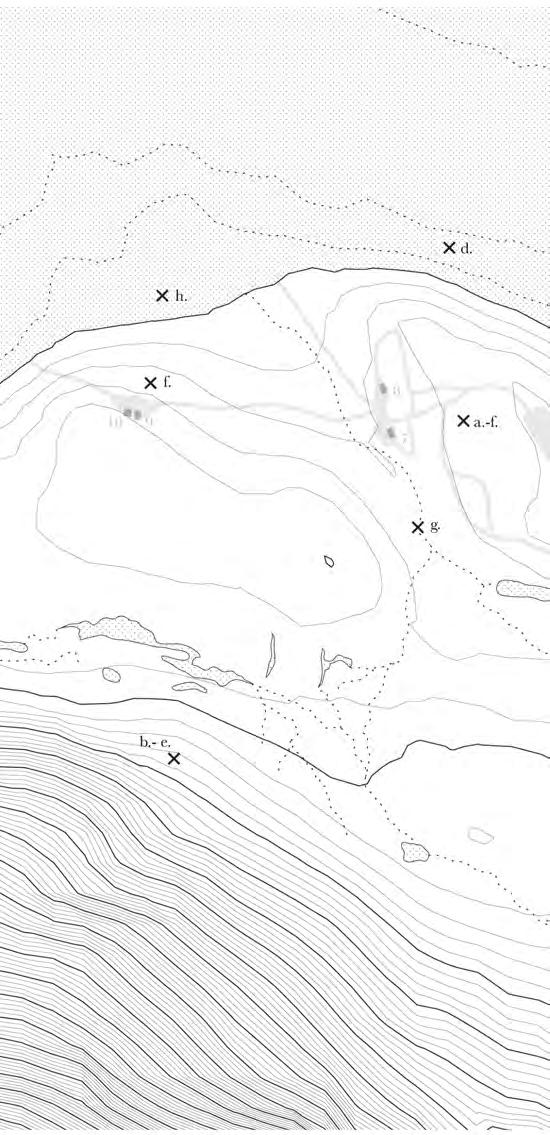
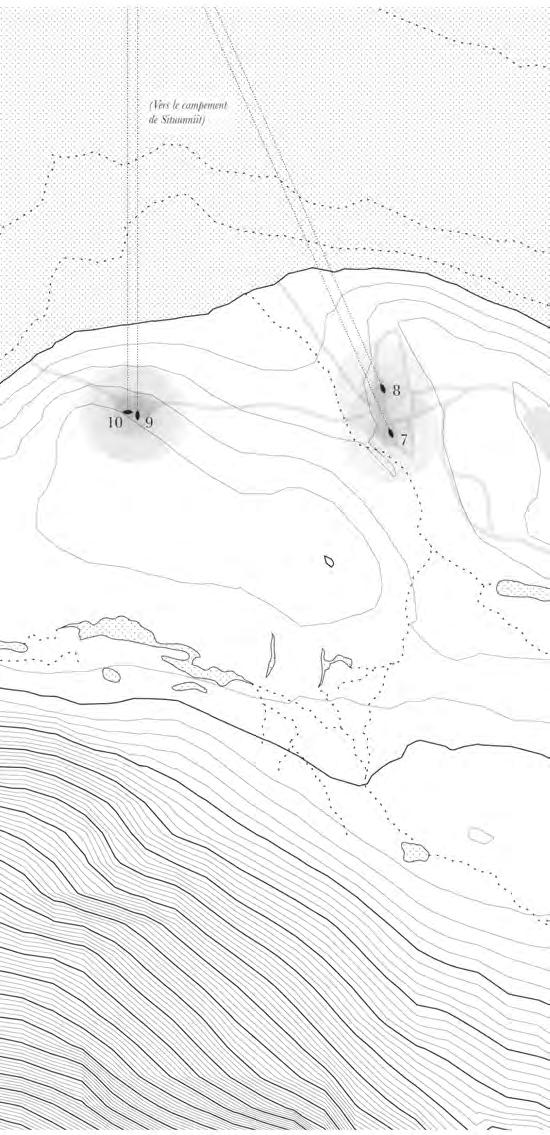
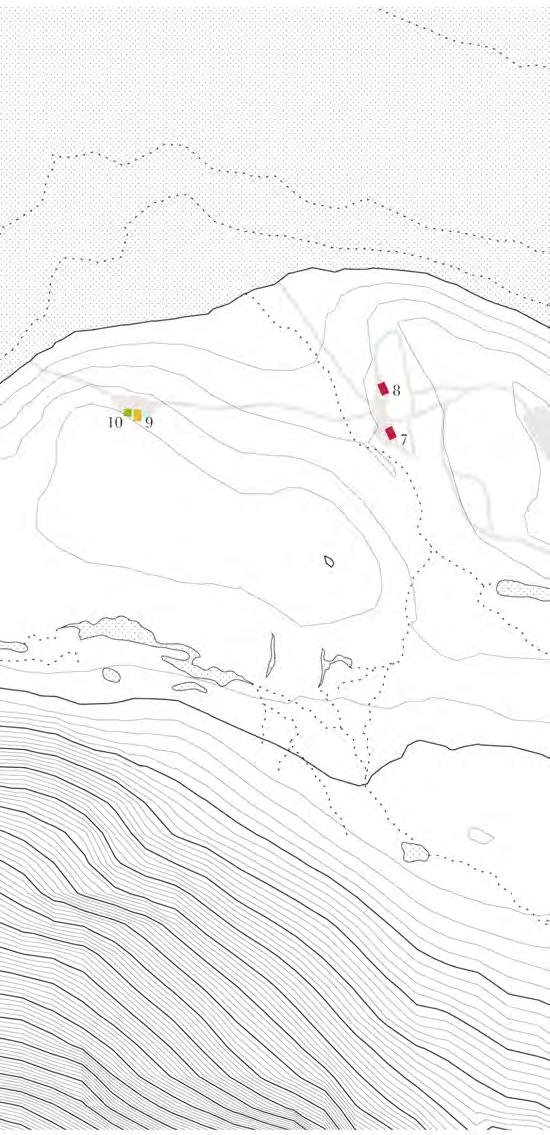


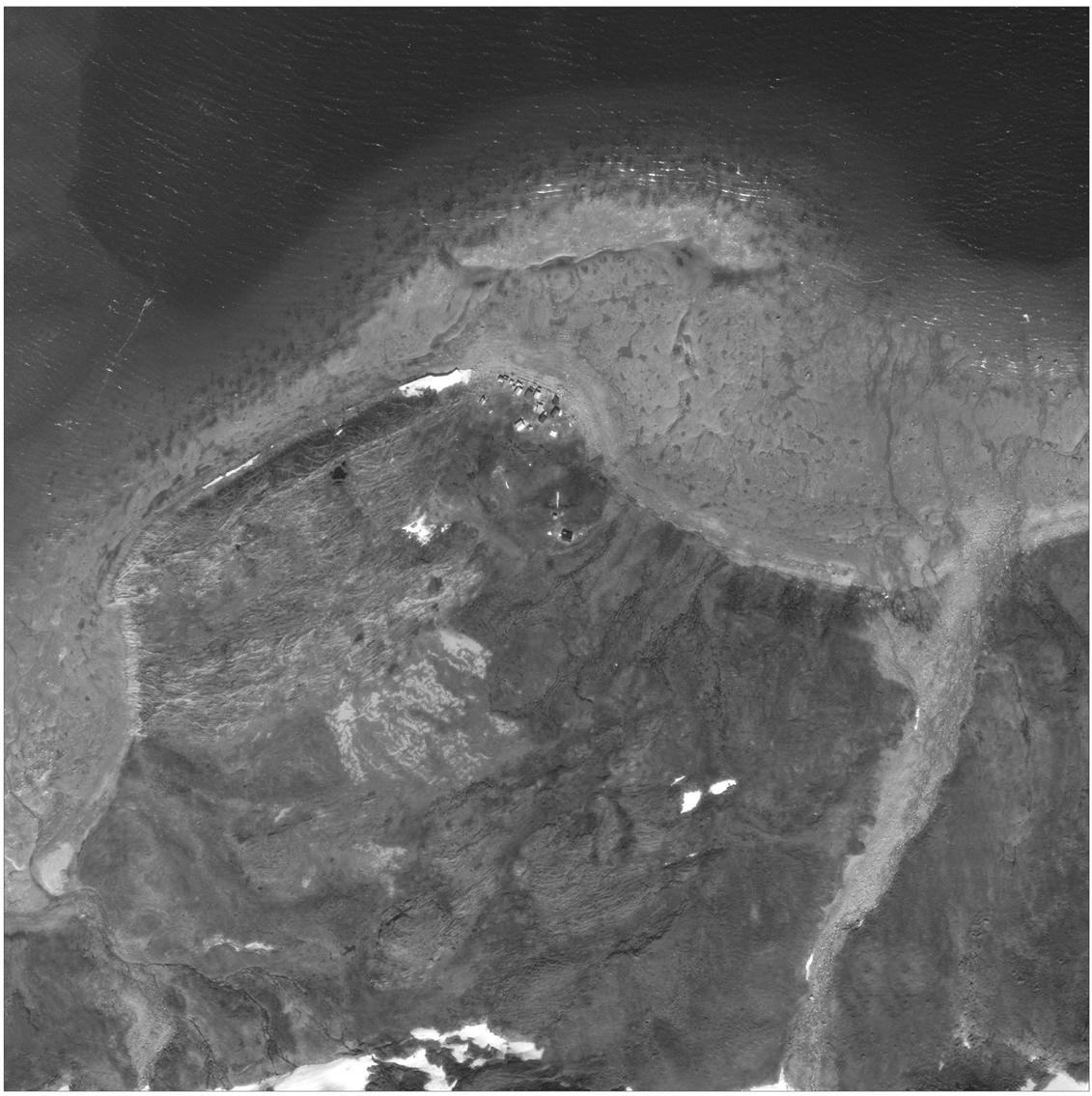
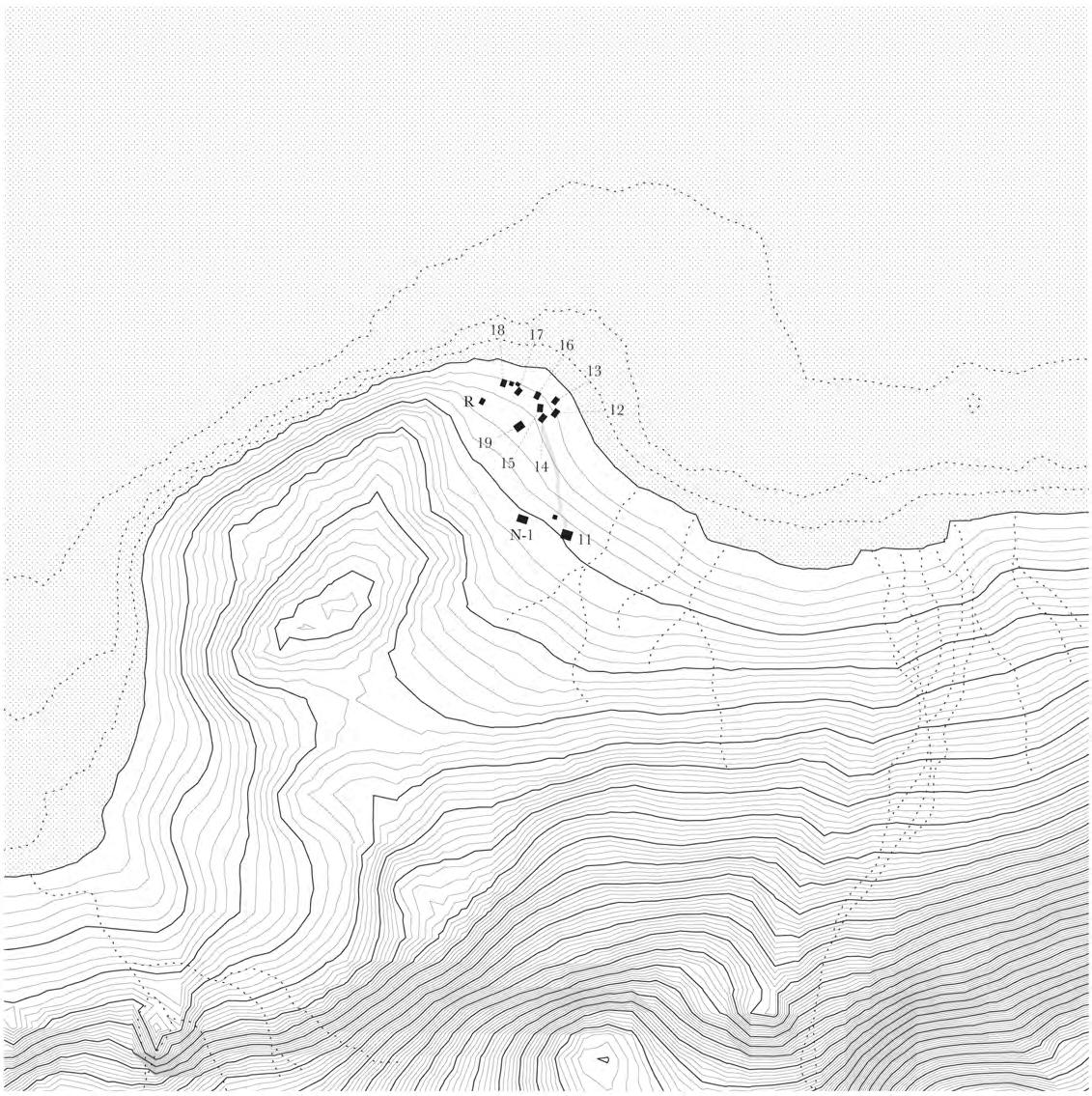 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
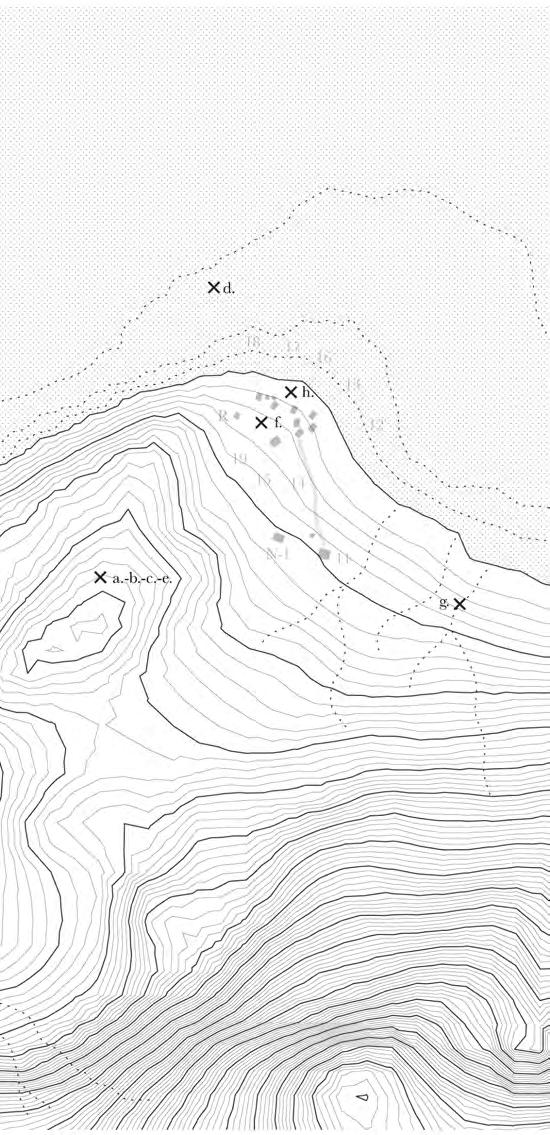
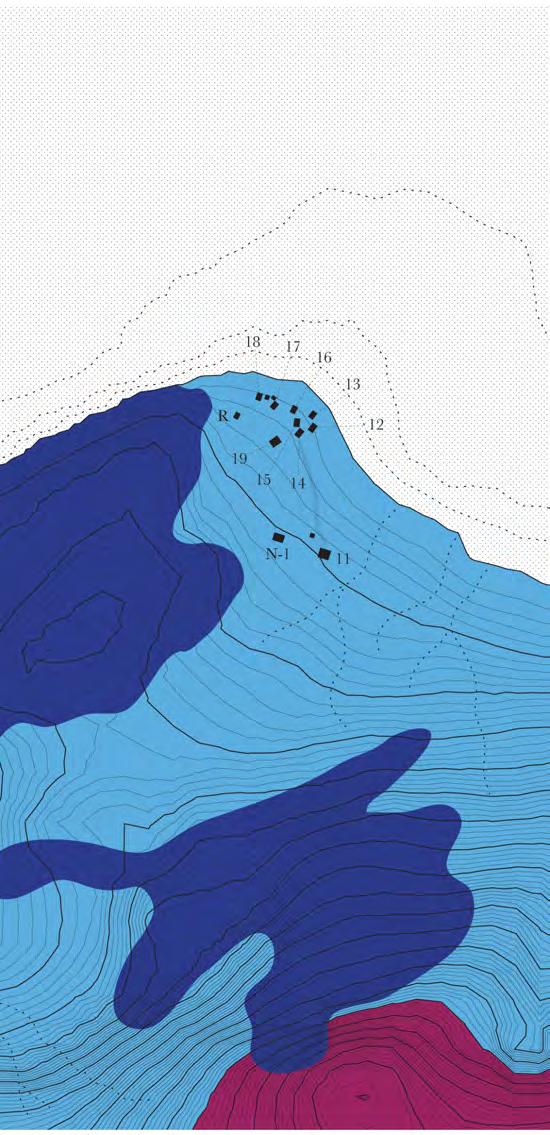
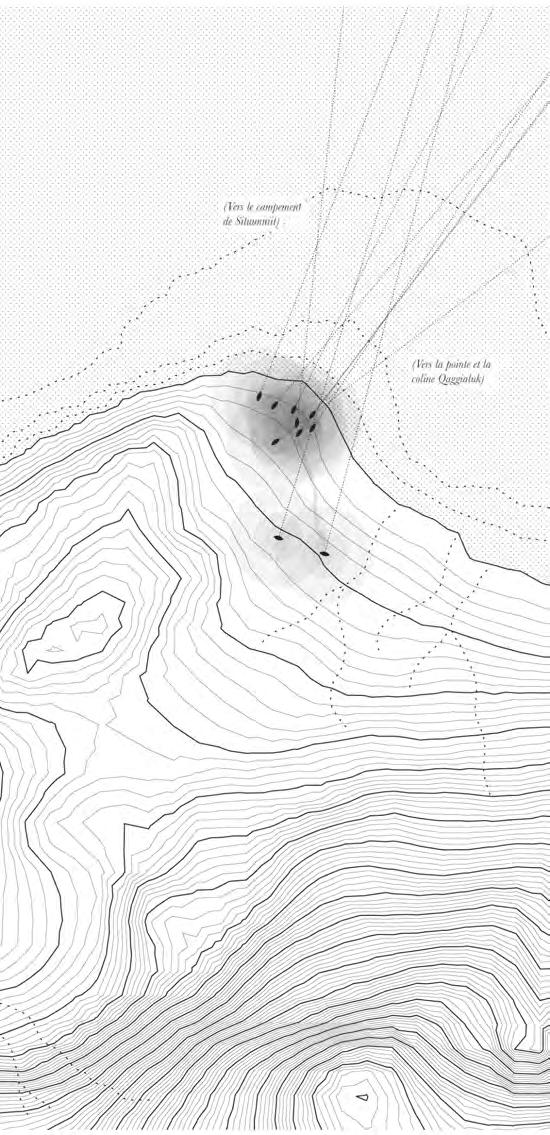
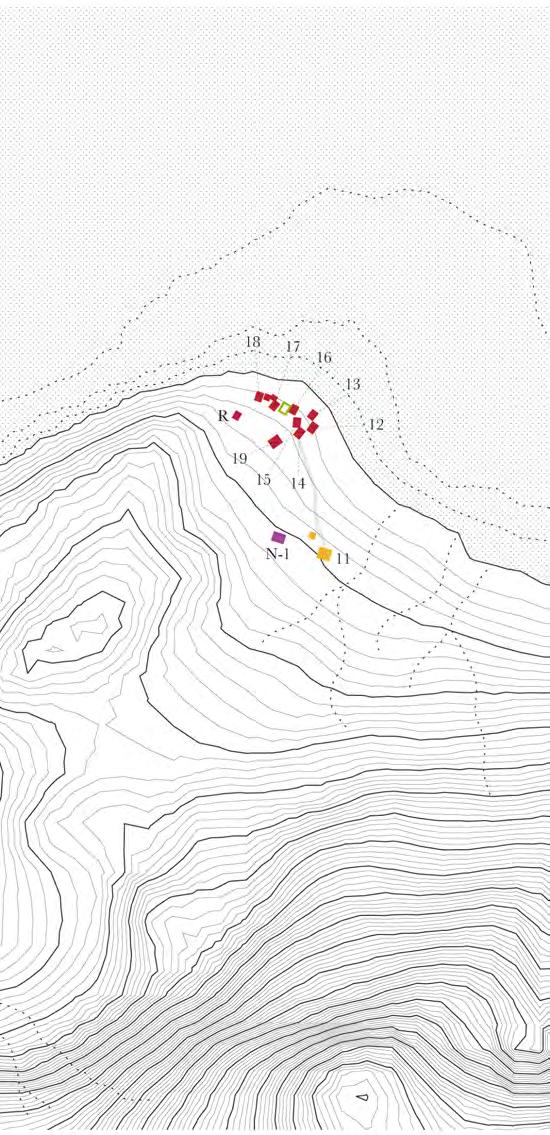
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

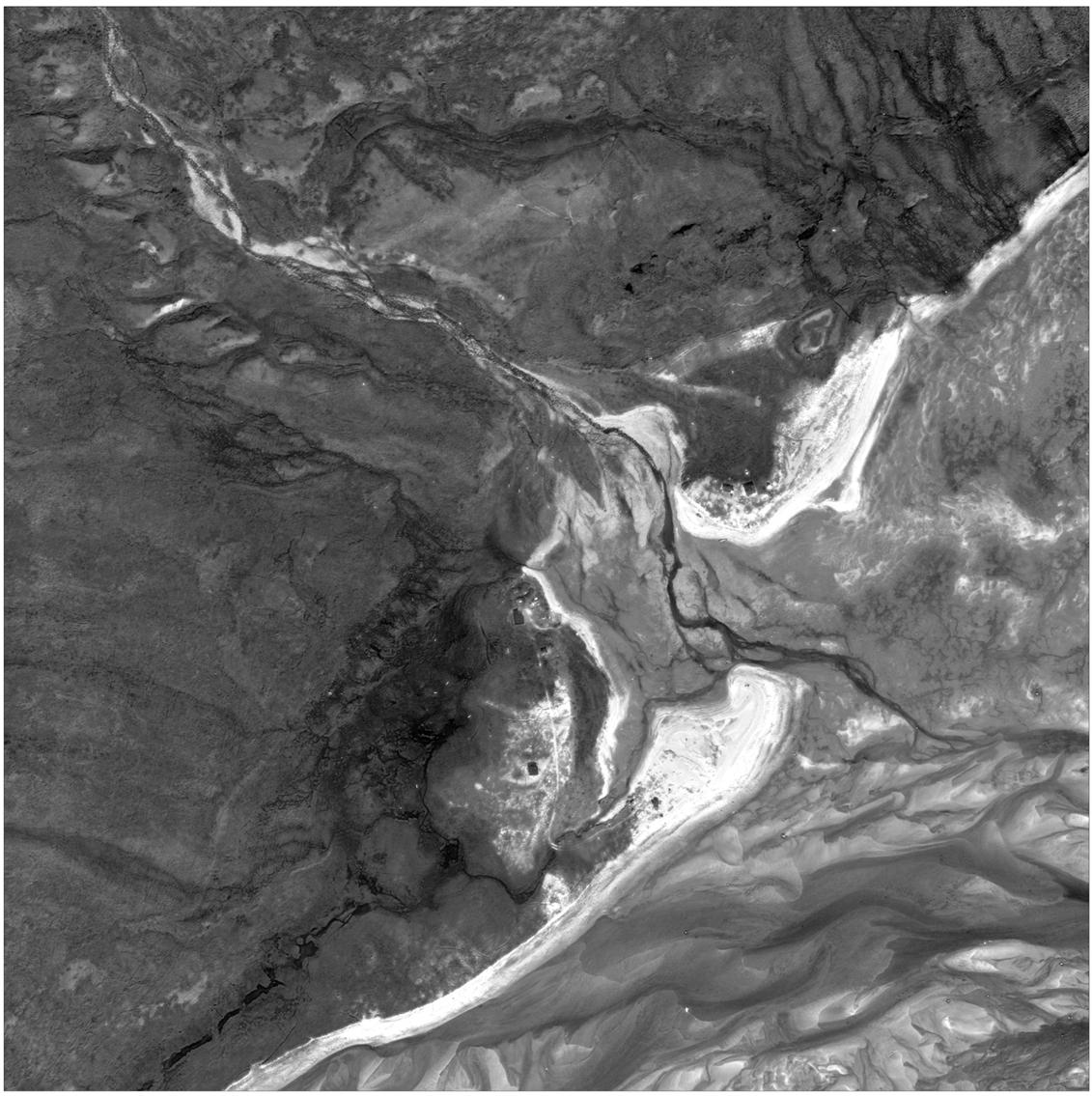
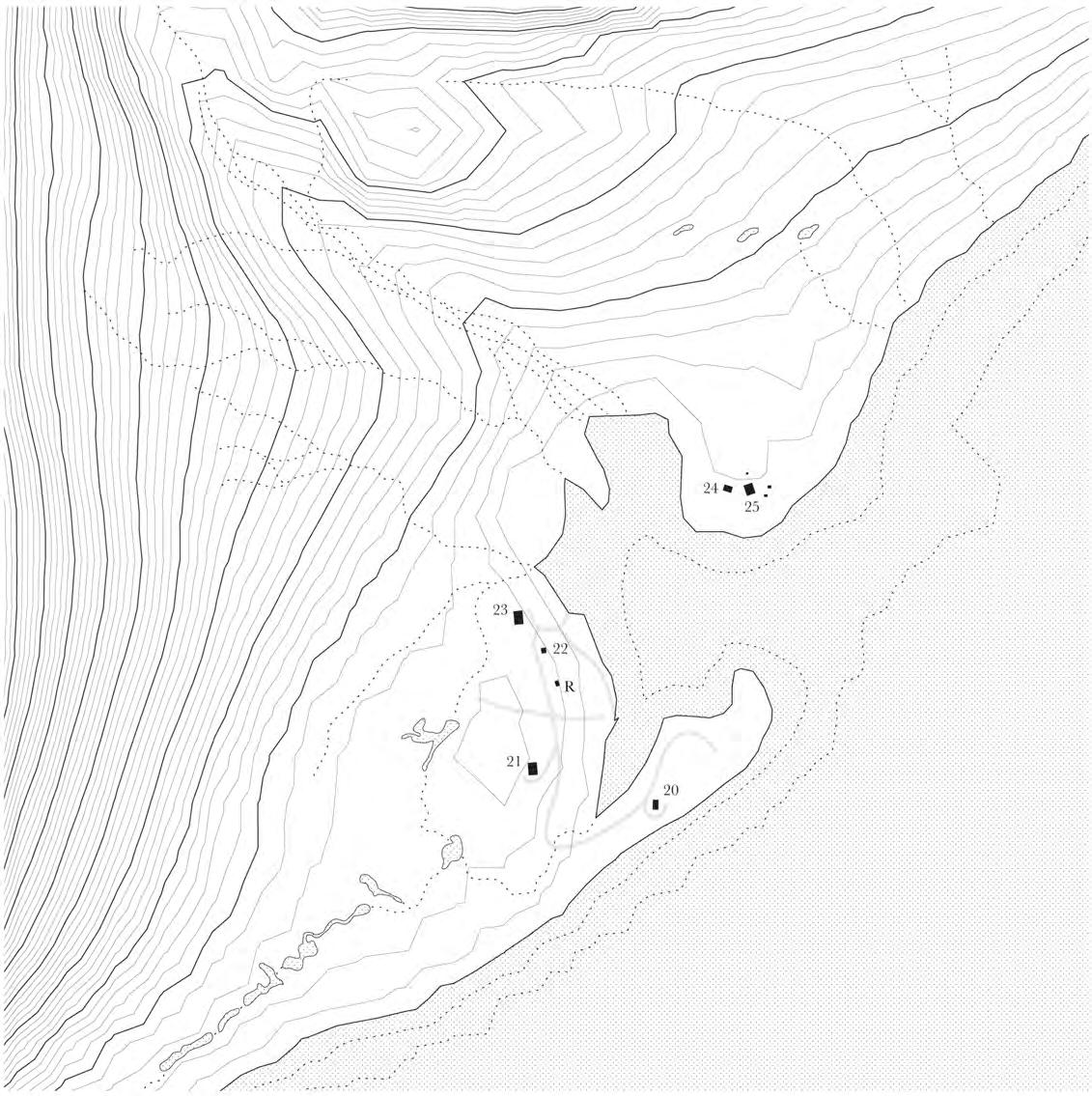

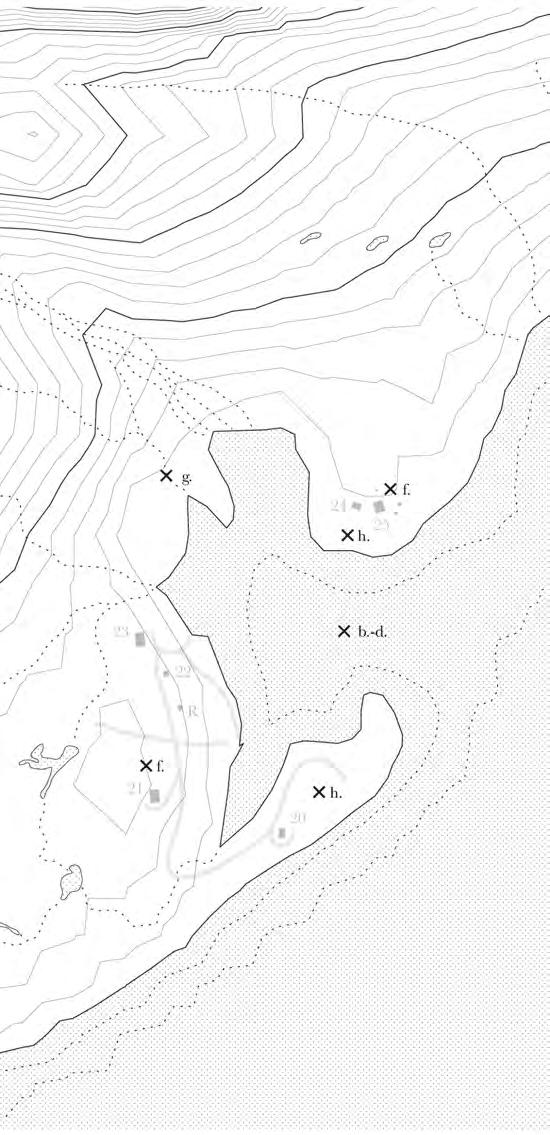 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
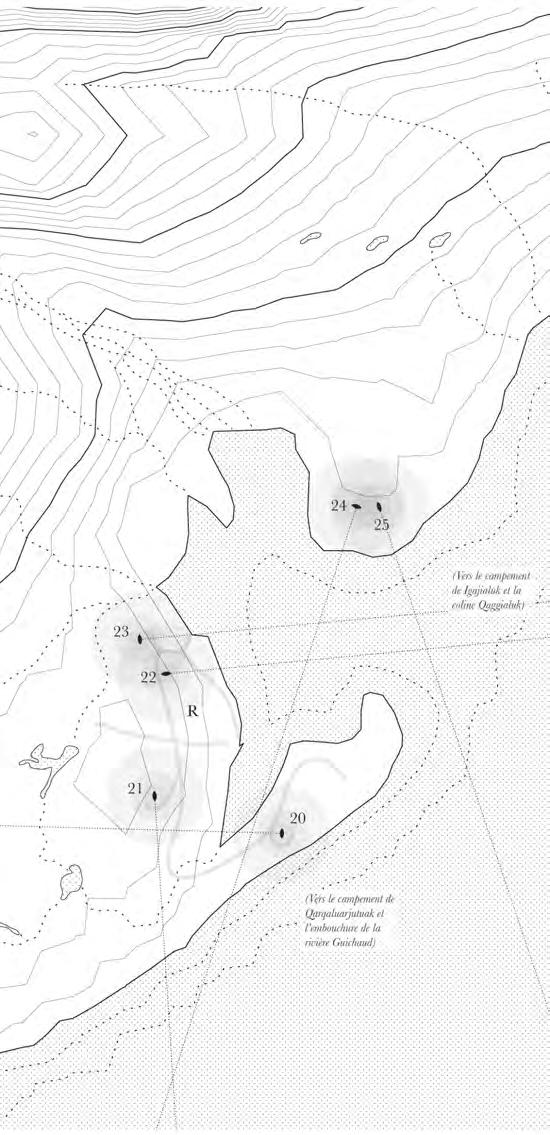
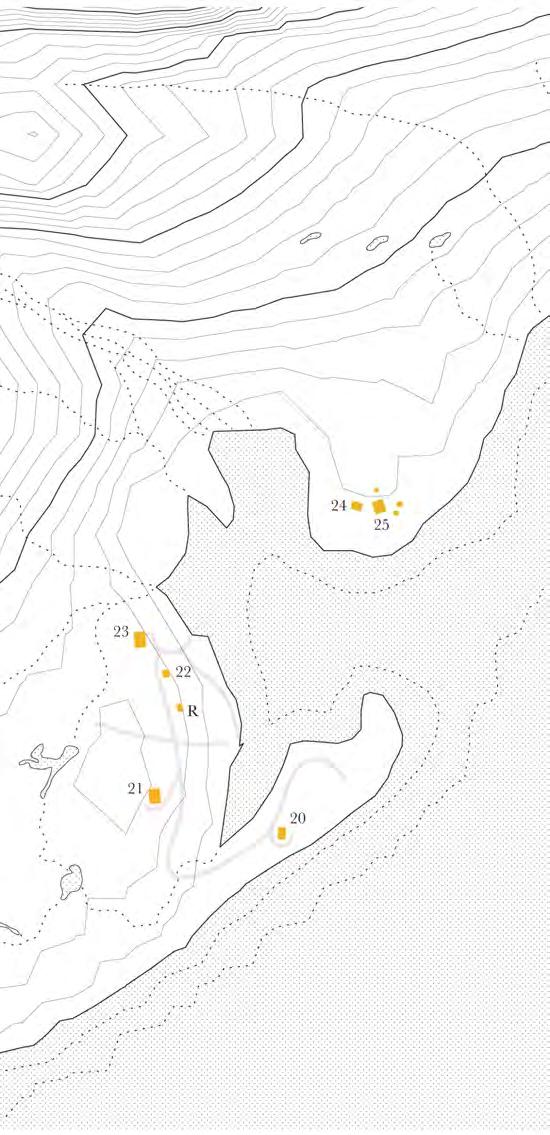
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018

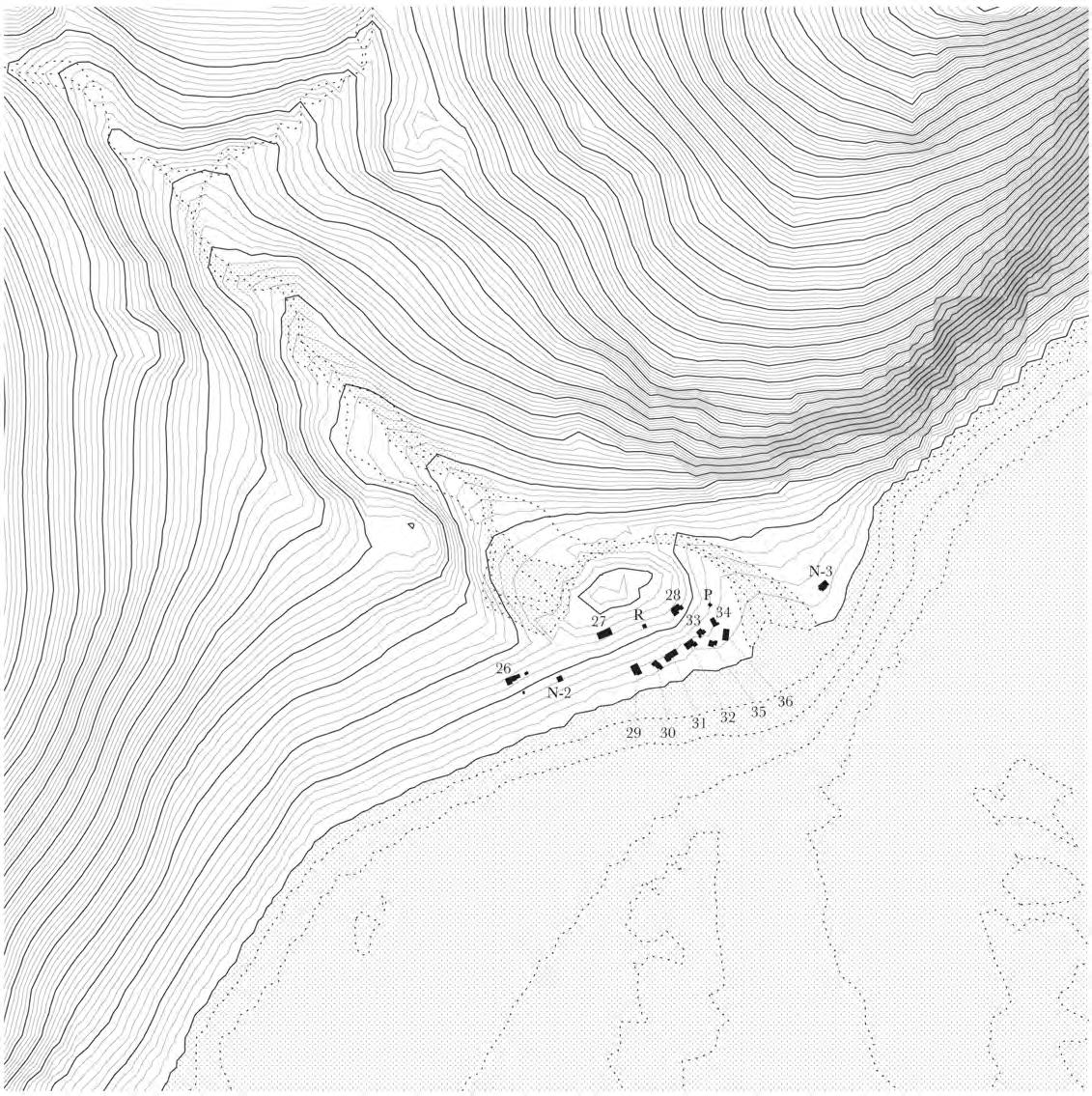 2.
2.
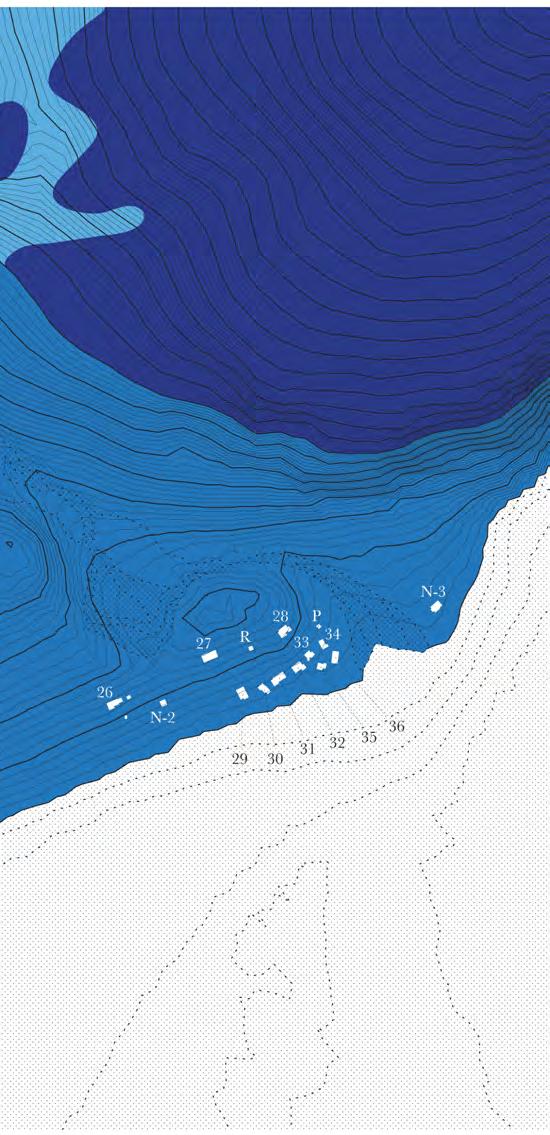
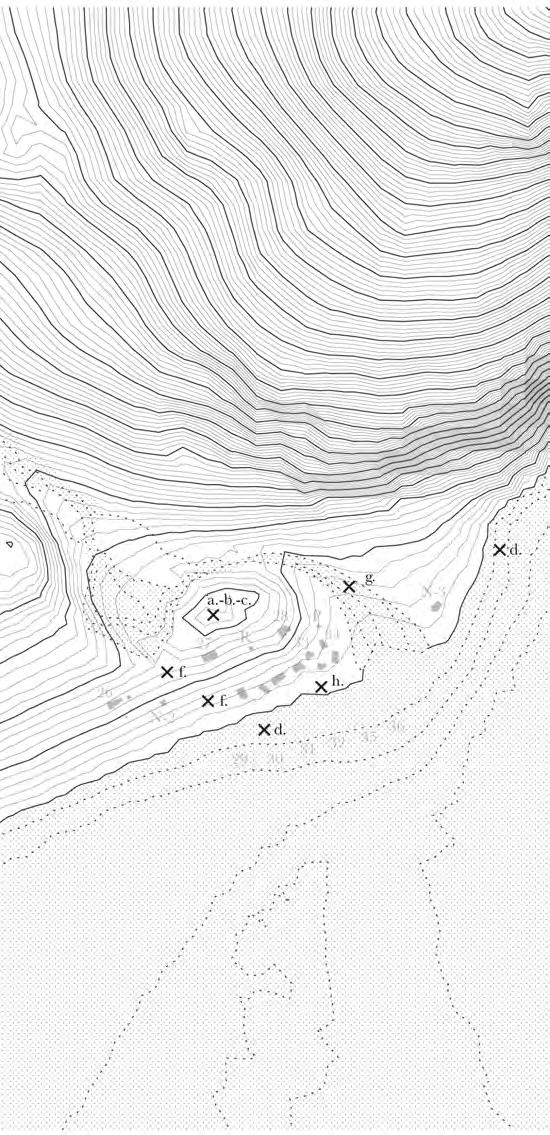
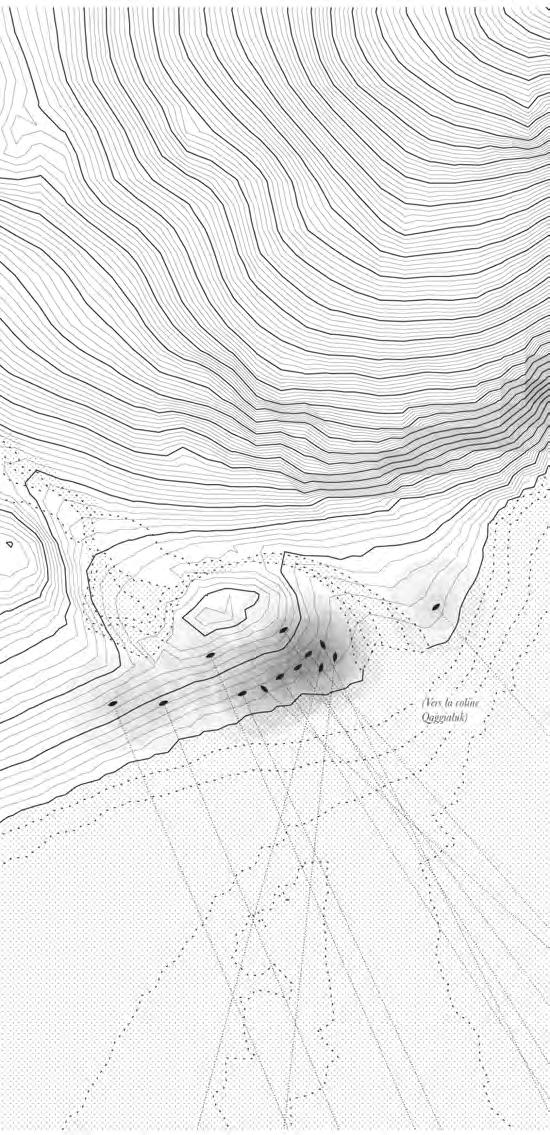
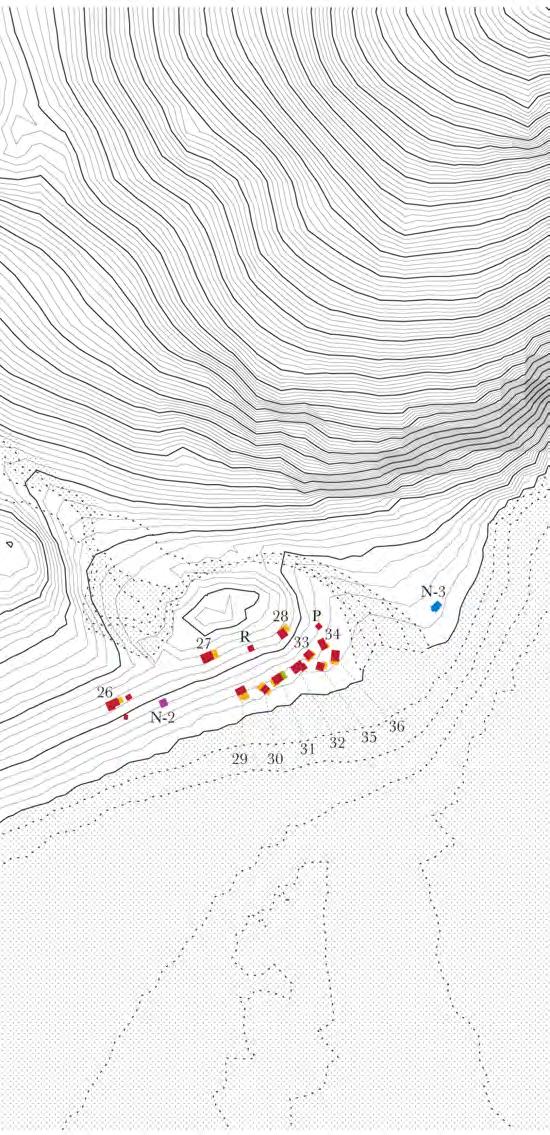


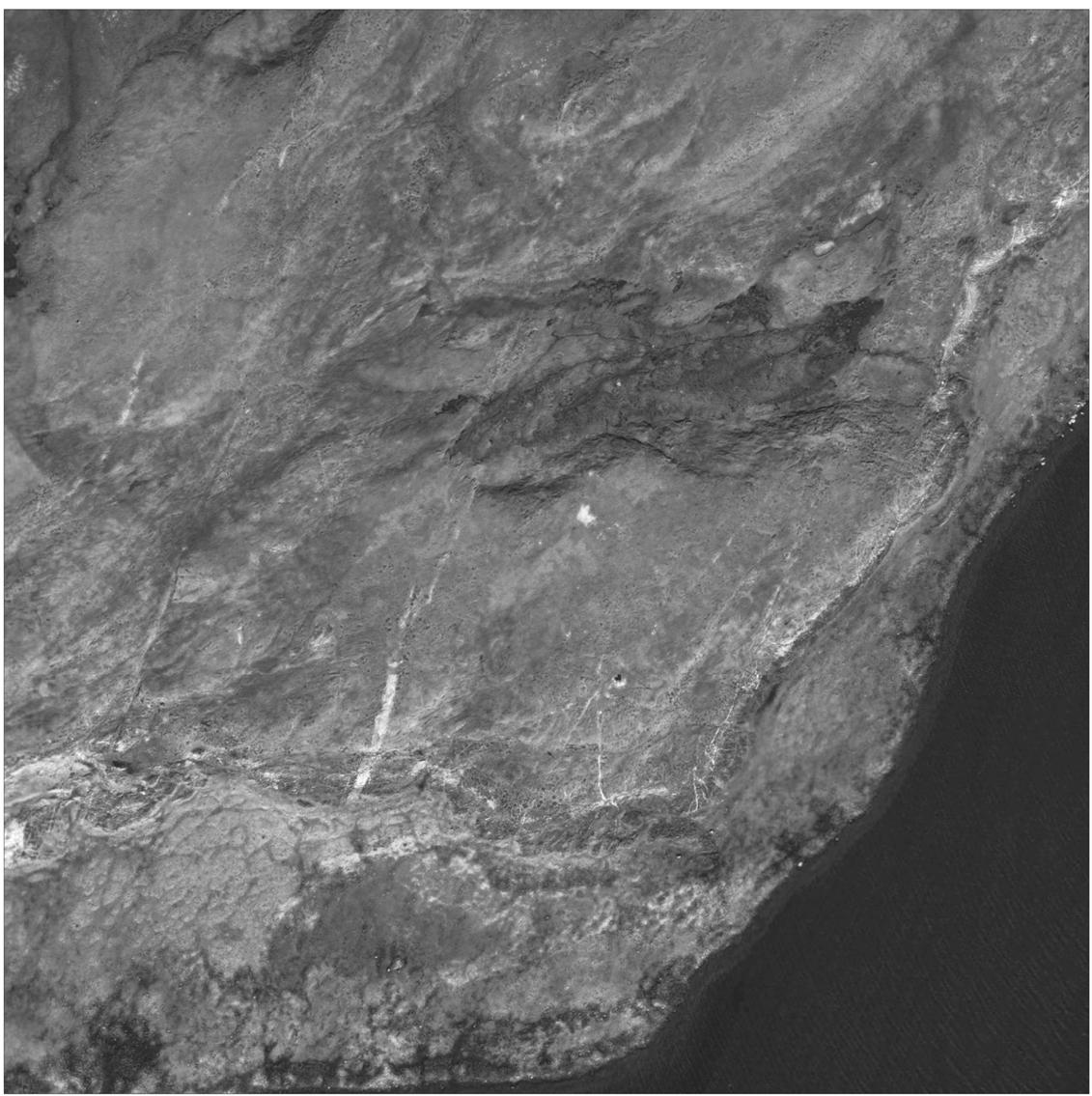
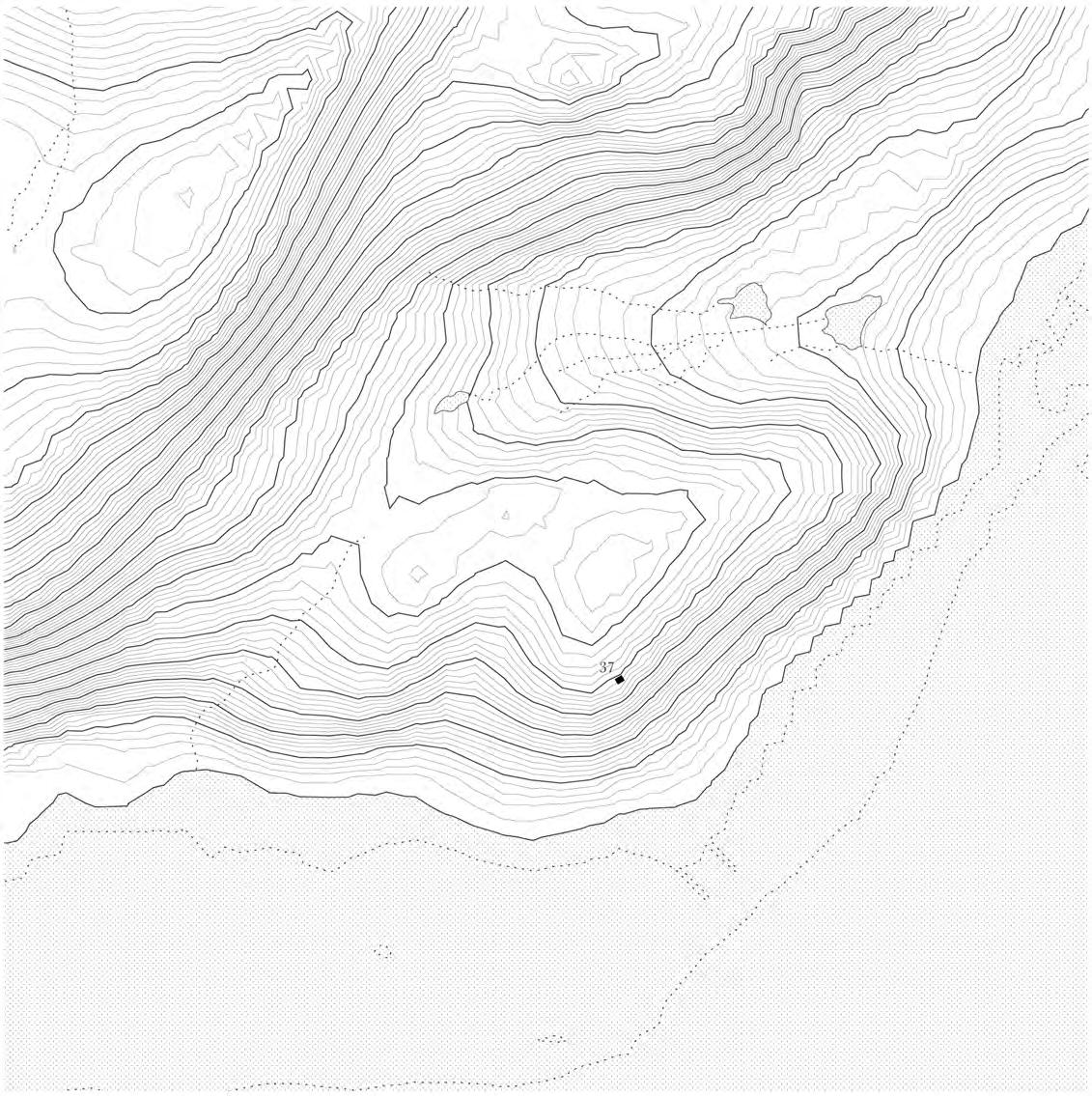
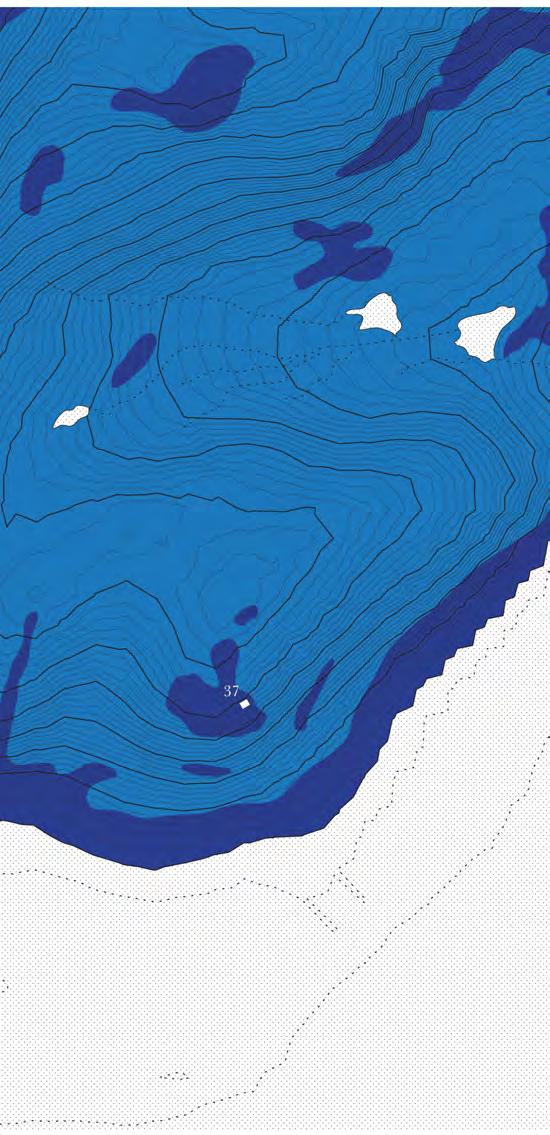
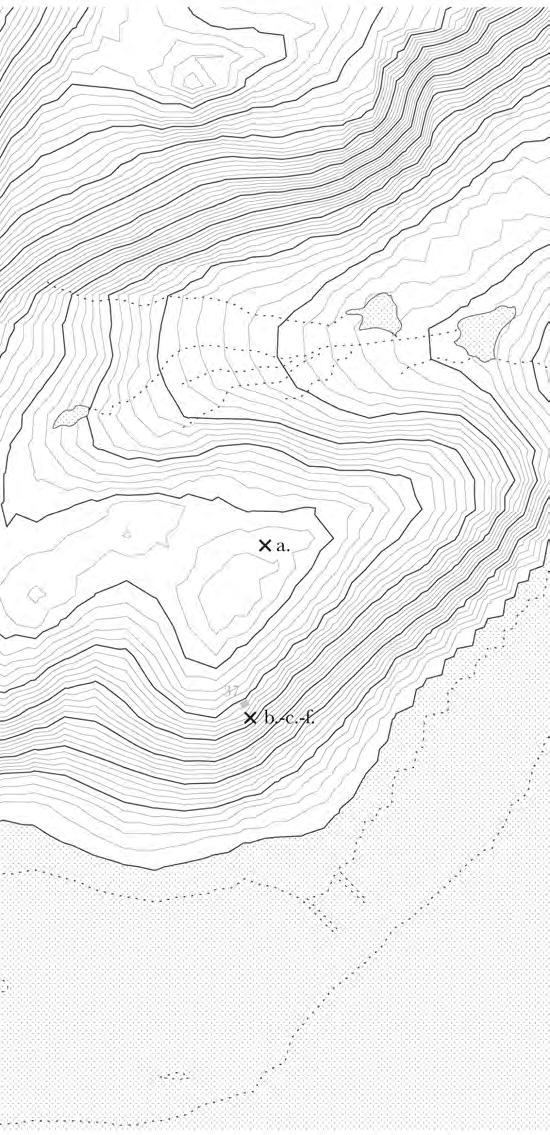
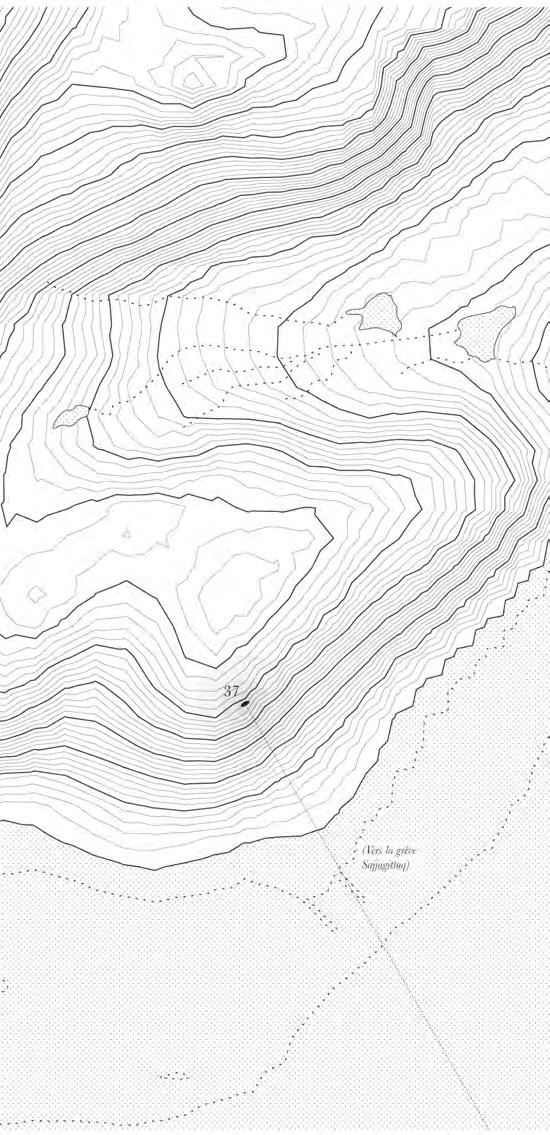
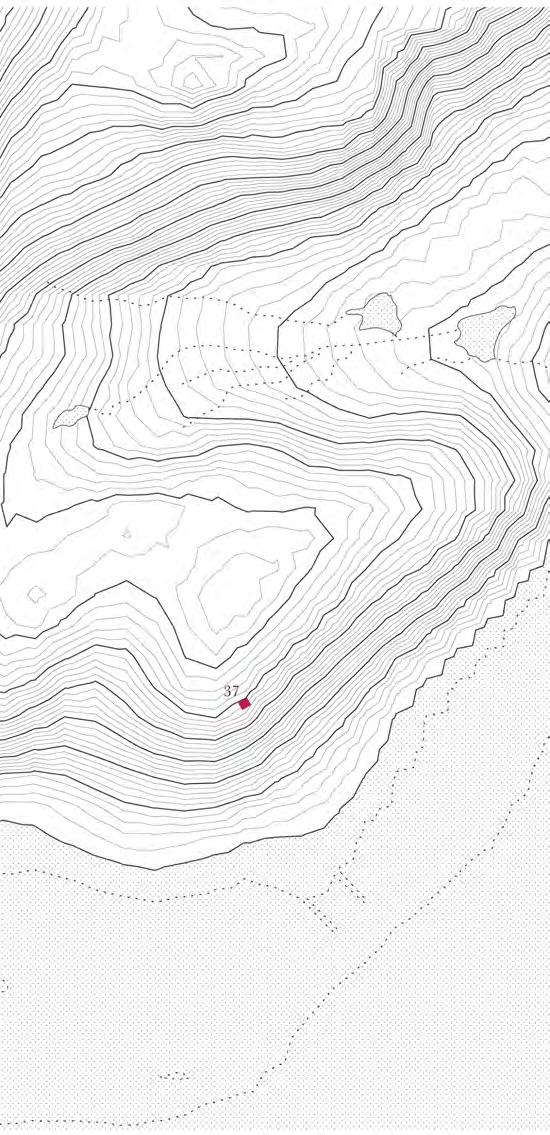


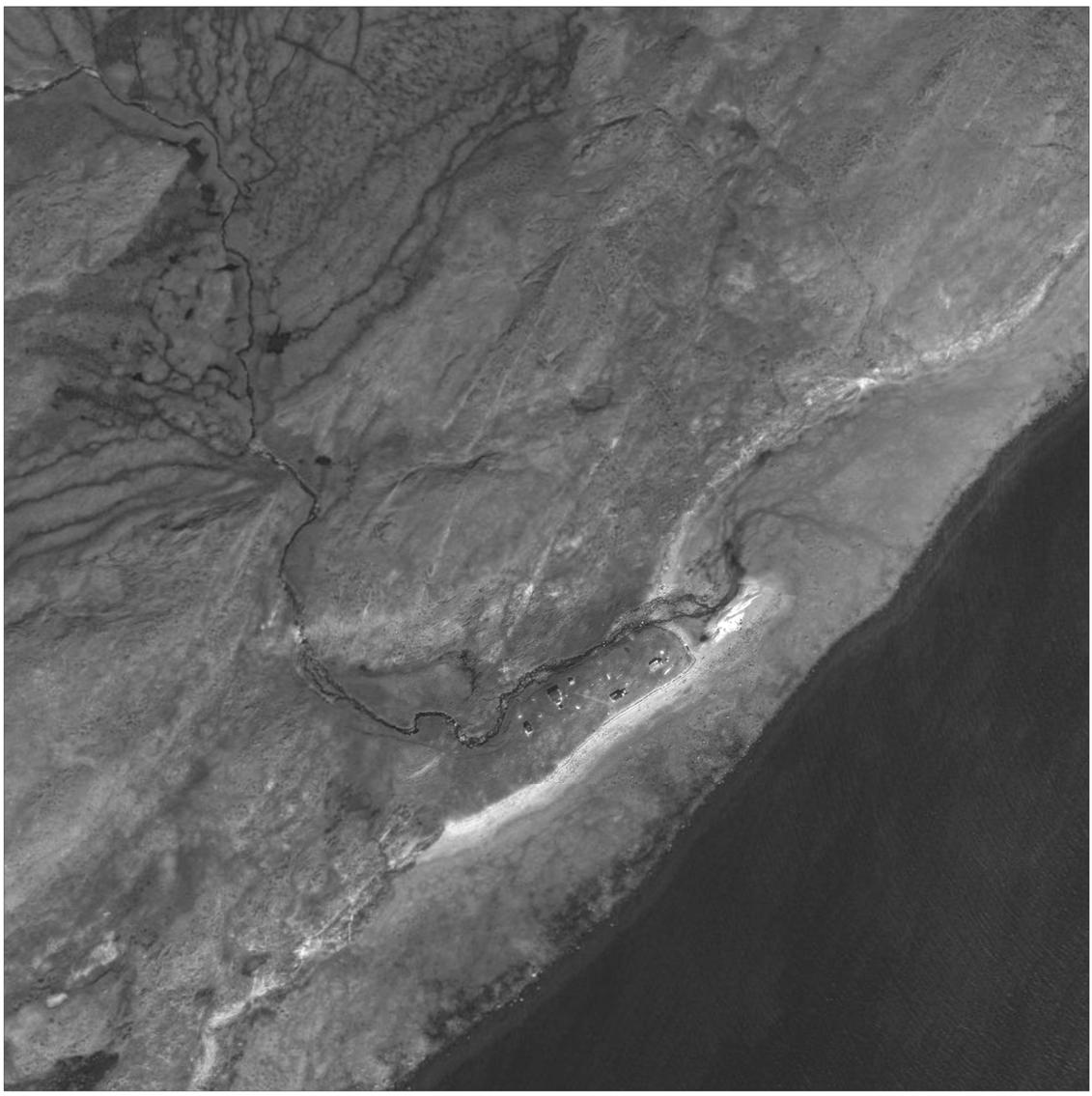
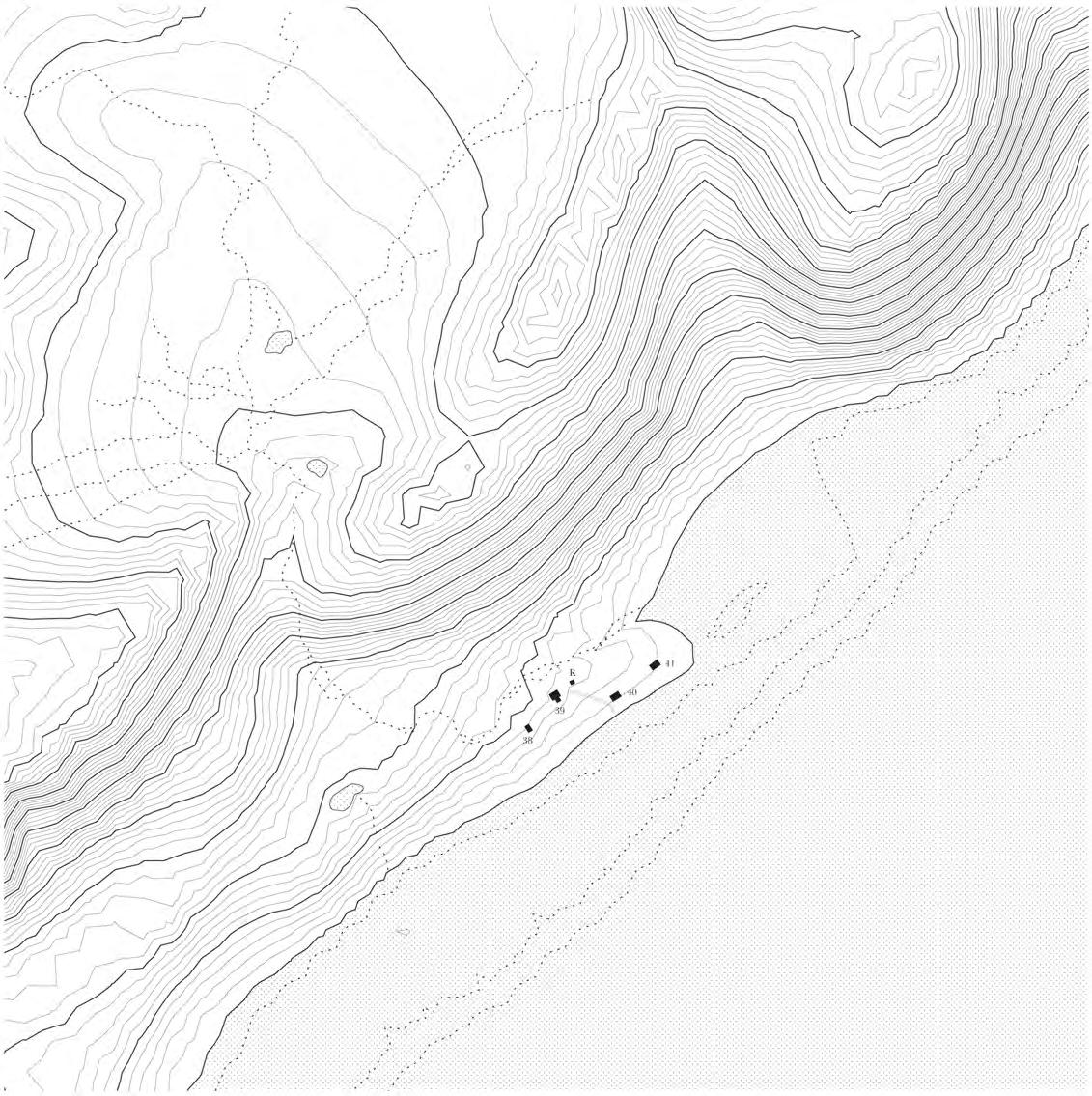

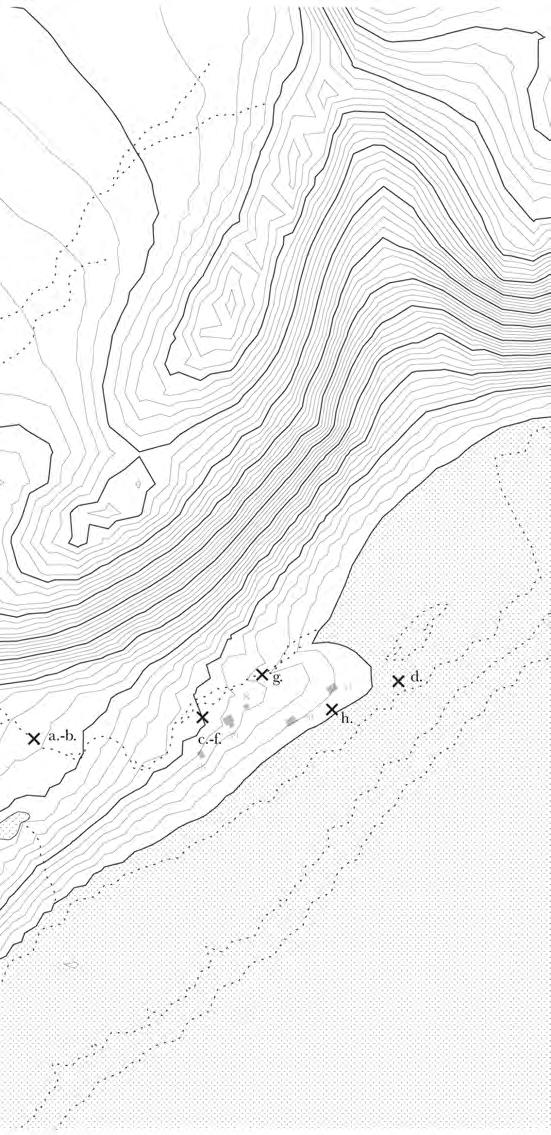

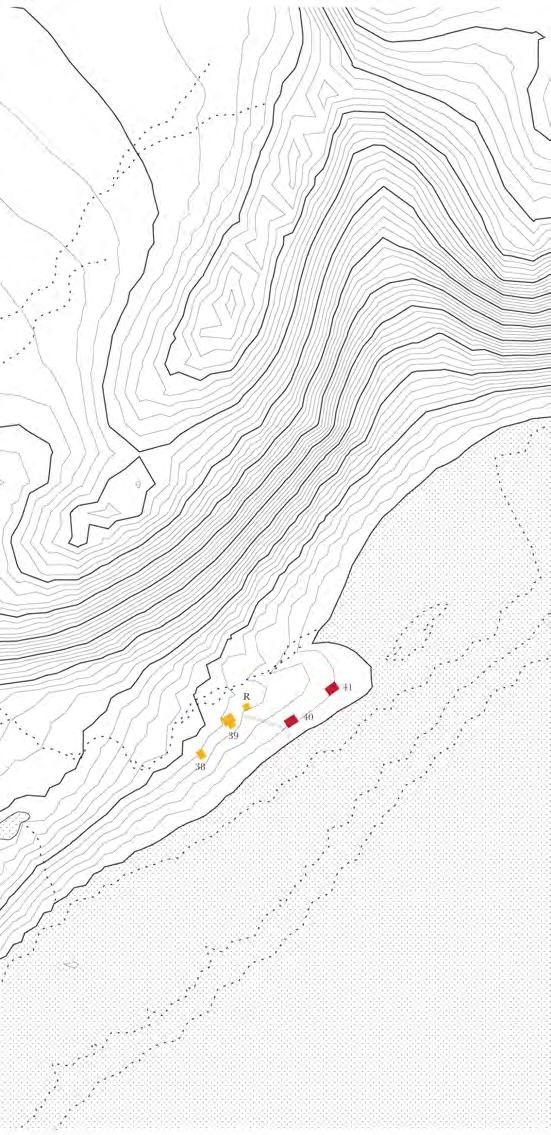


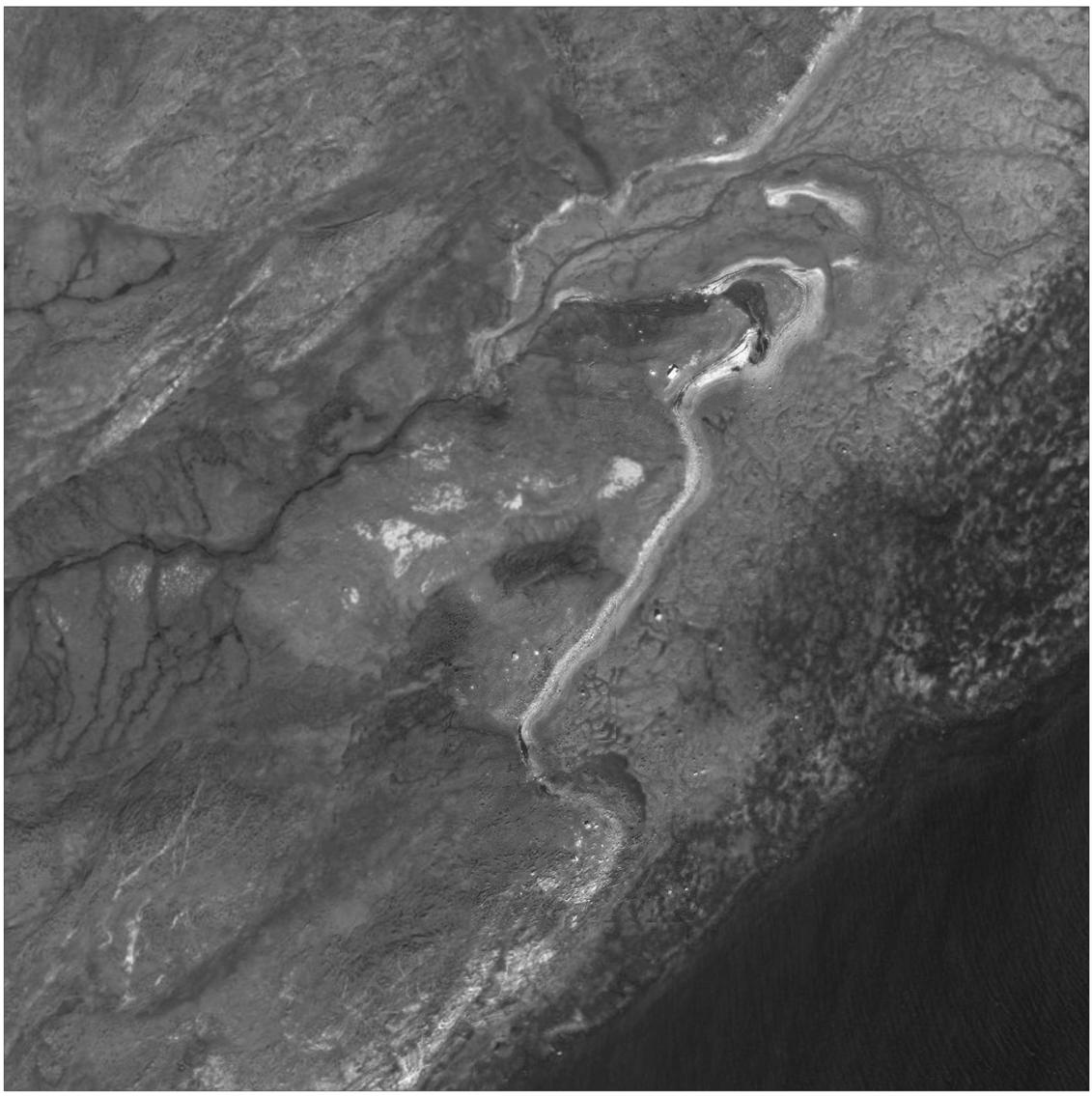
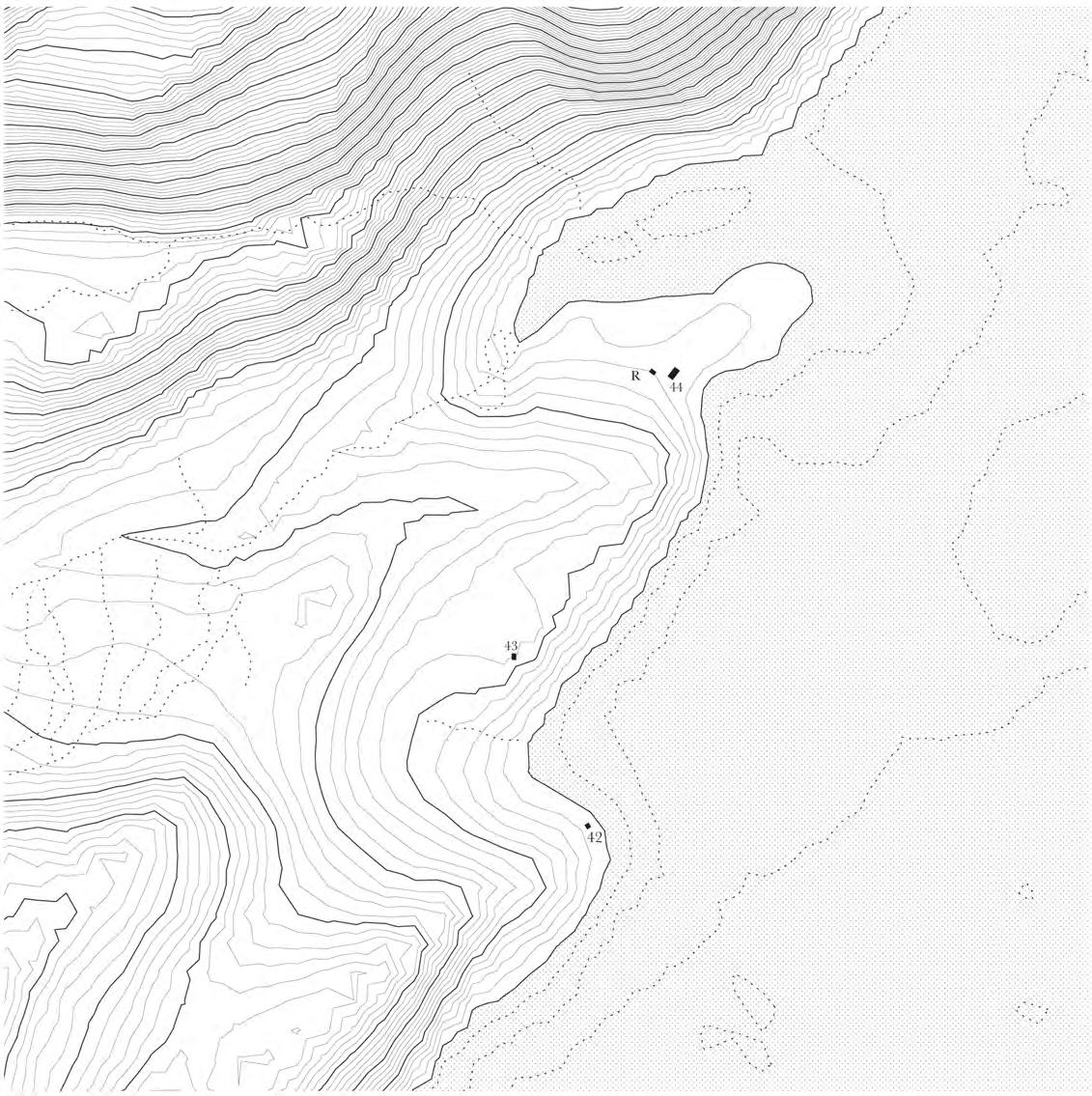 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
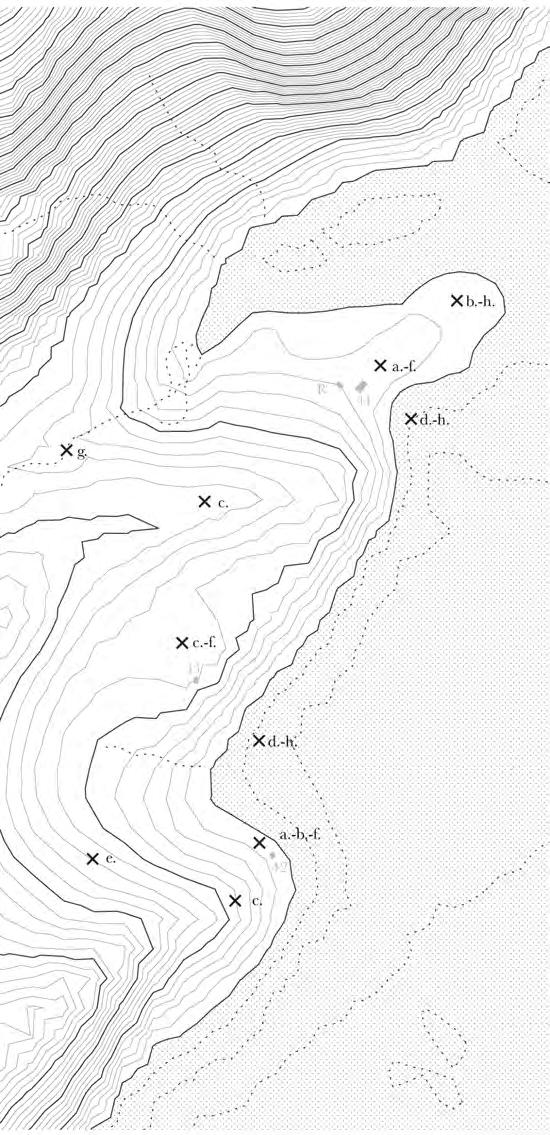





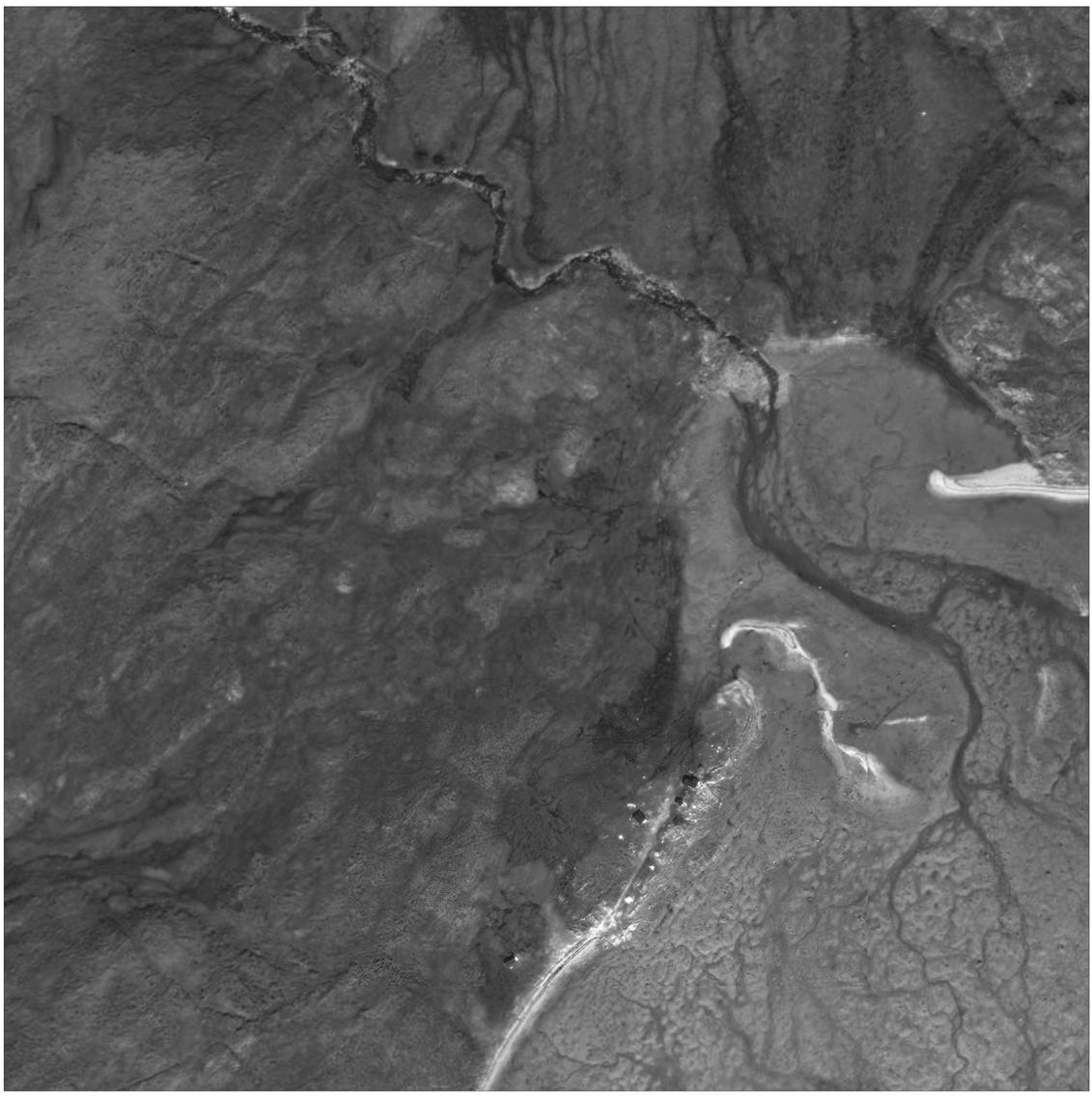
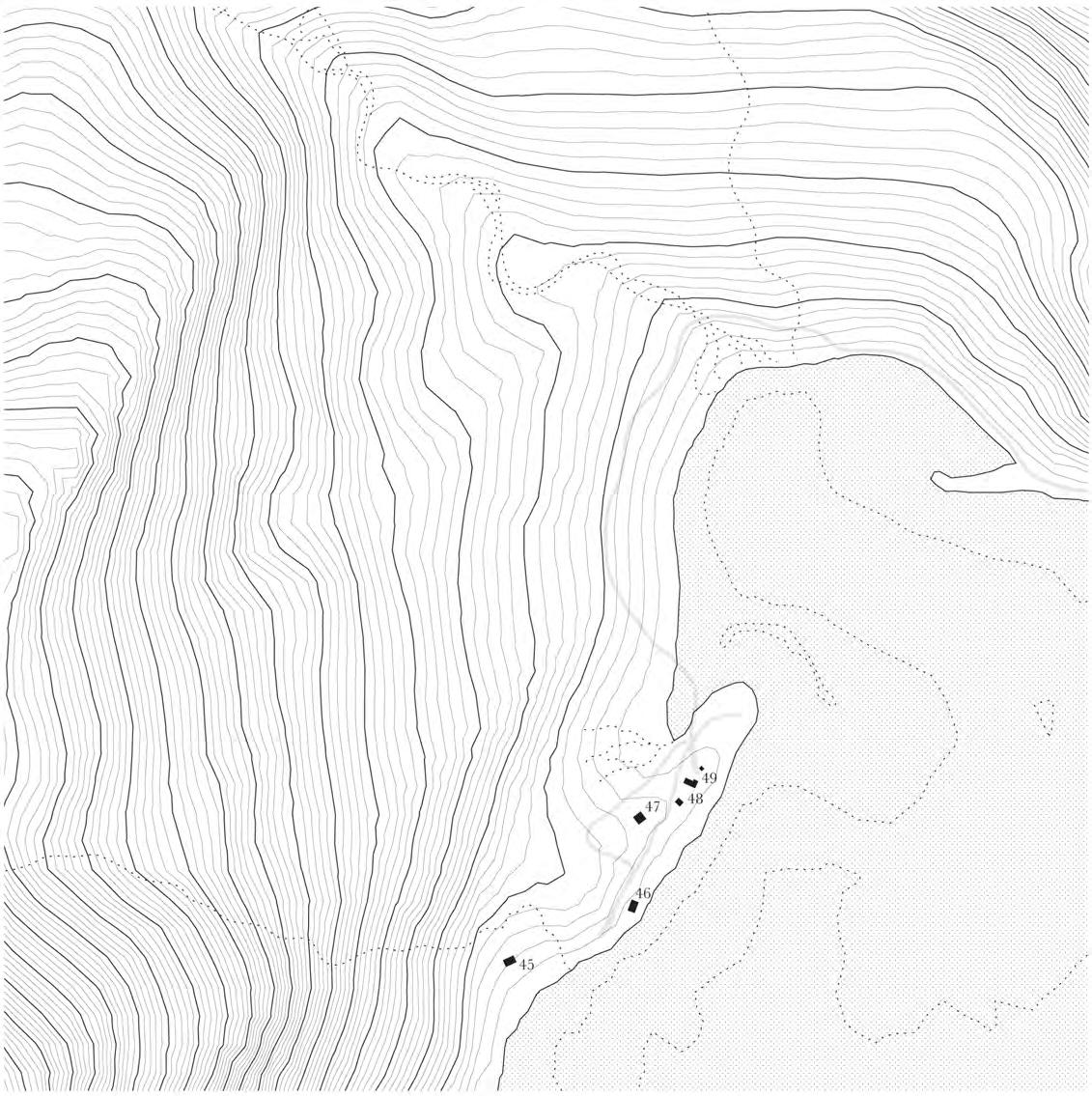
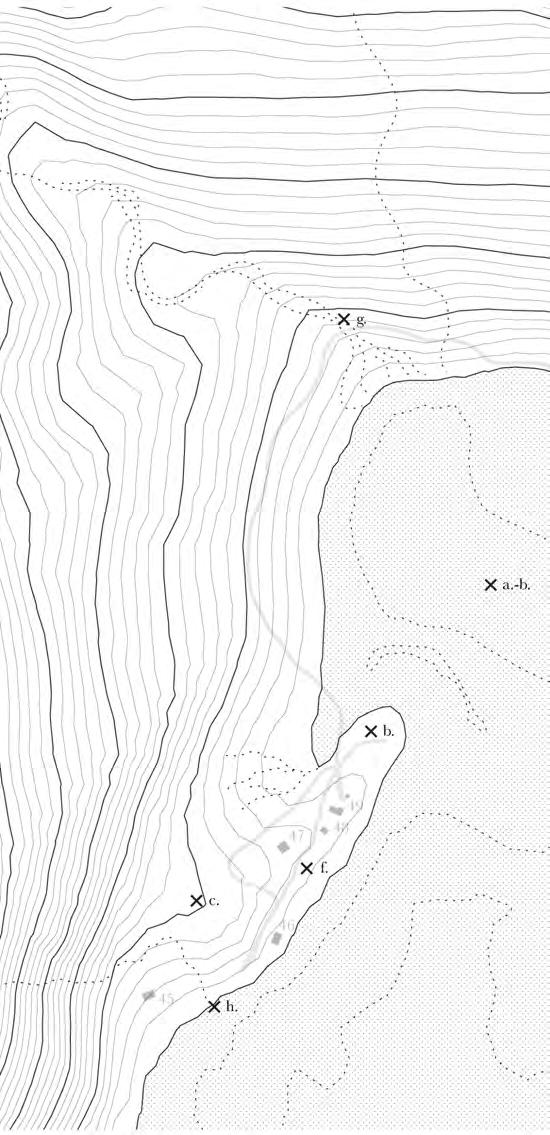

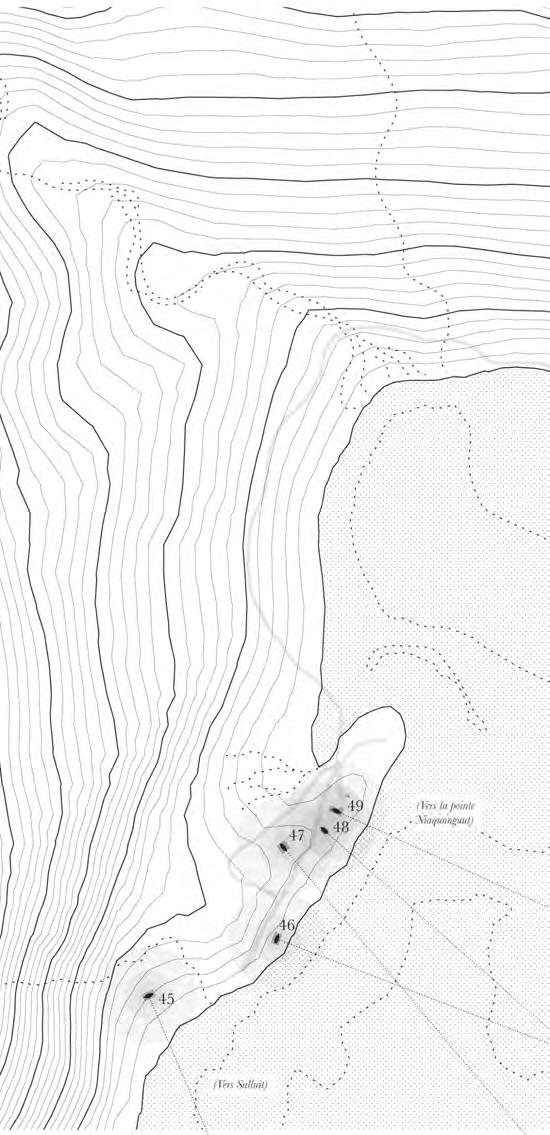
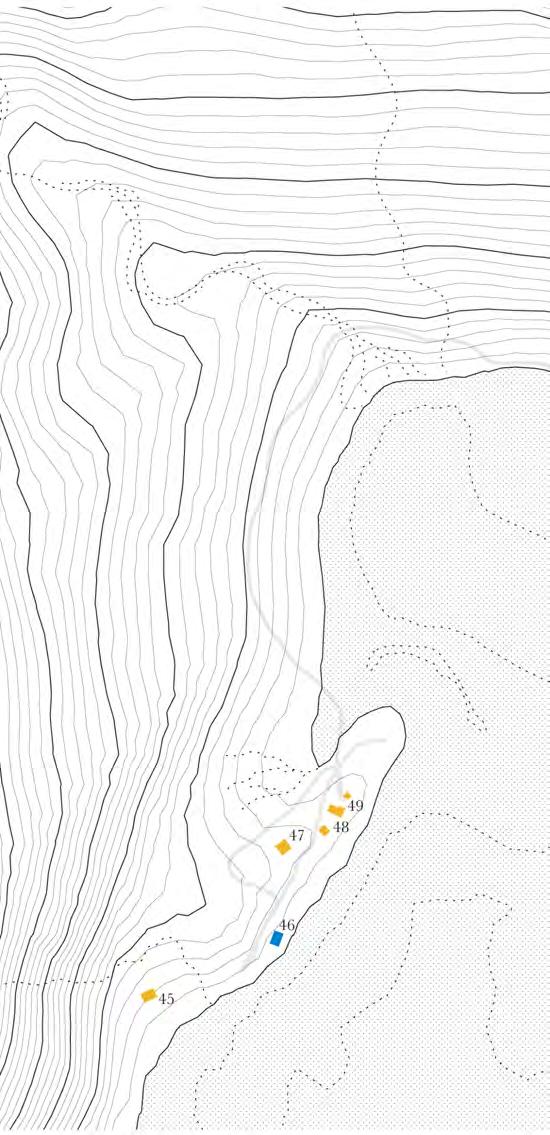
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

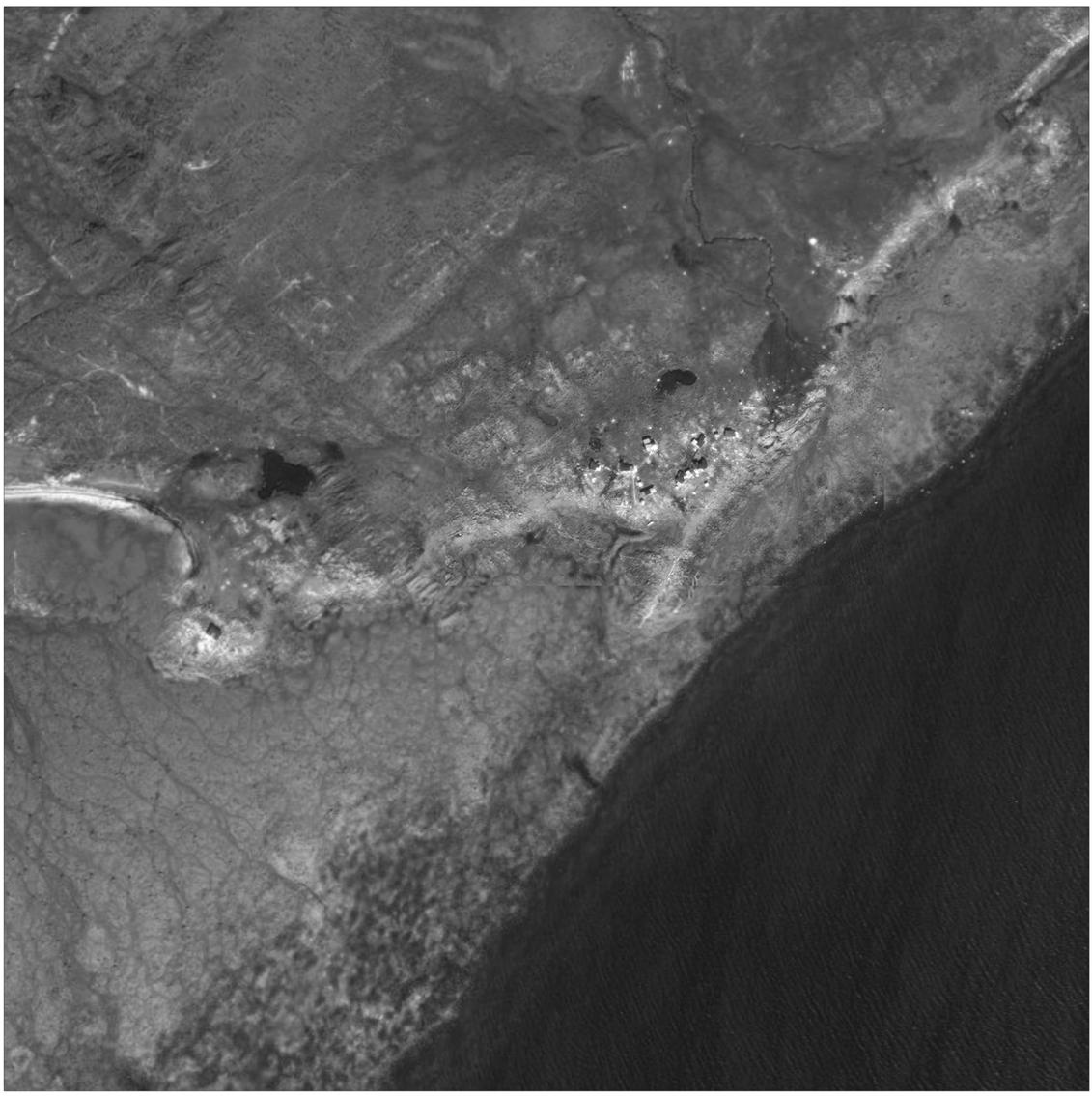
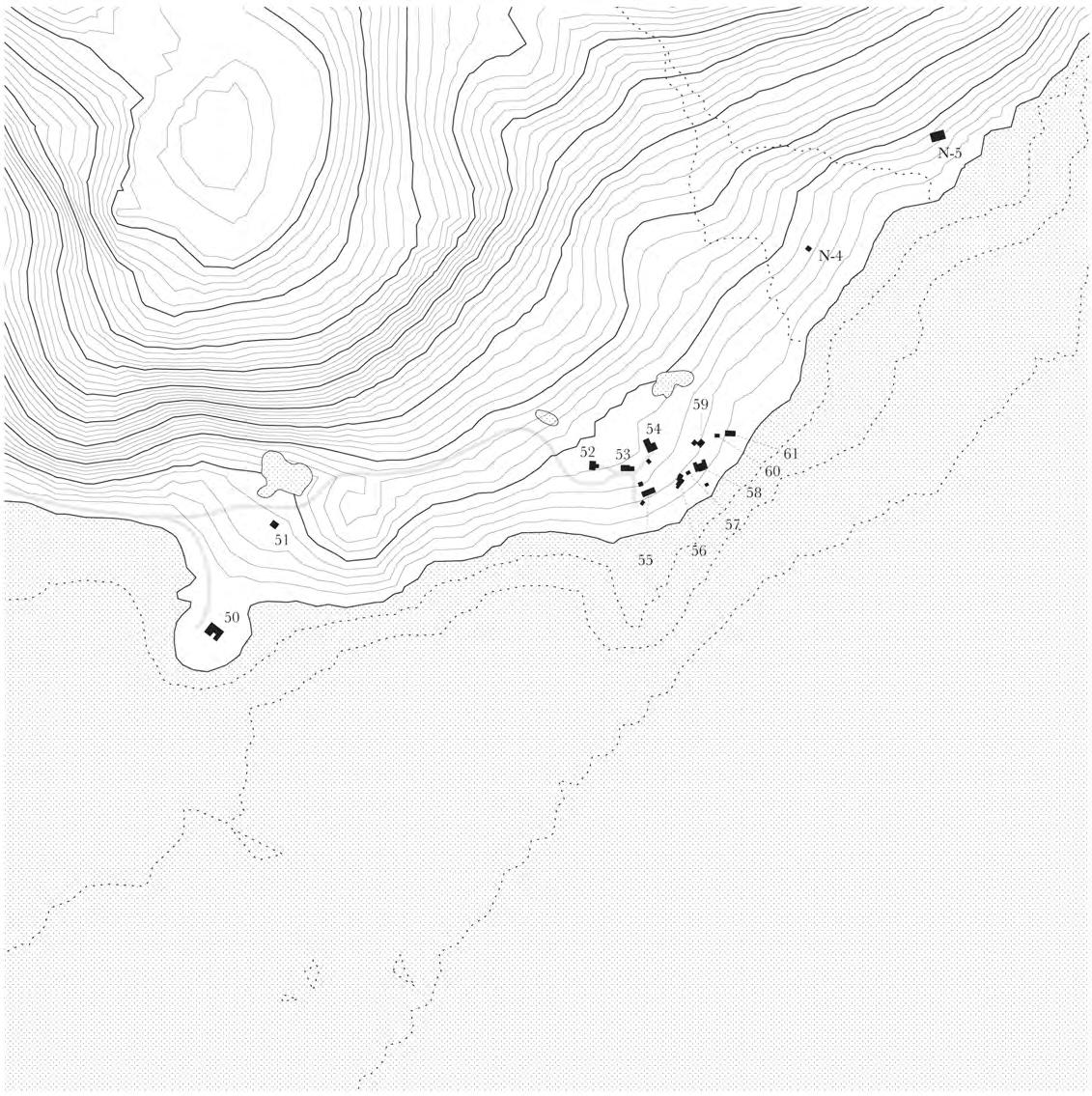
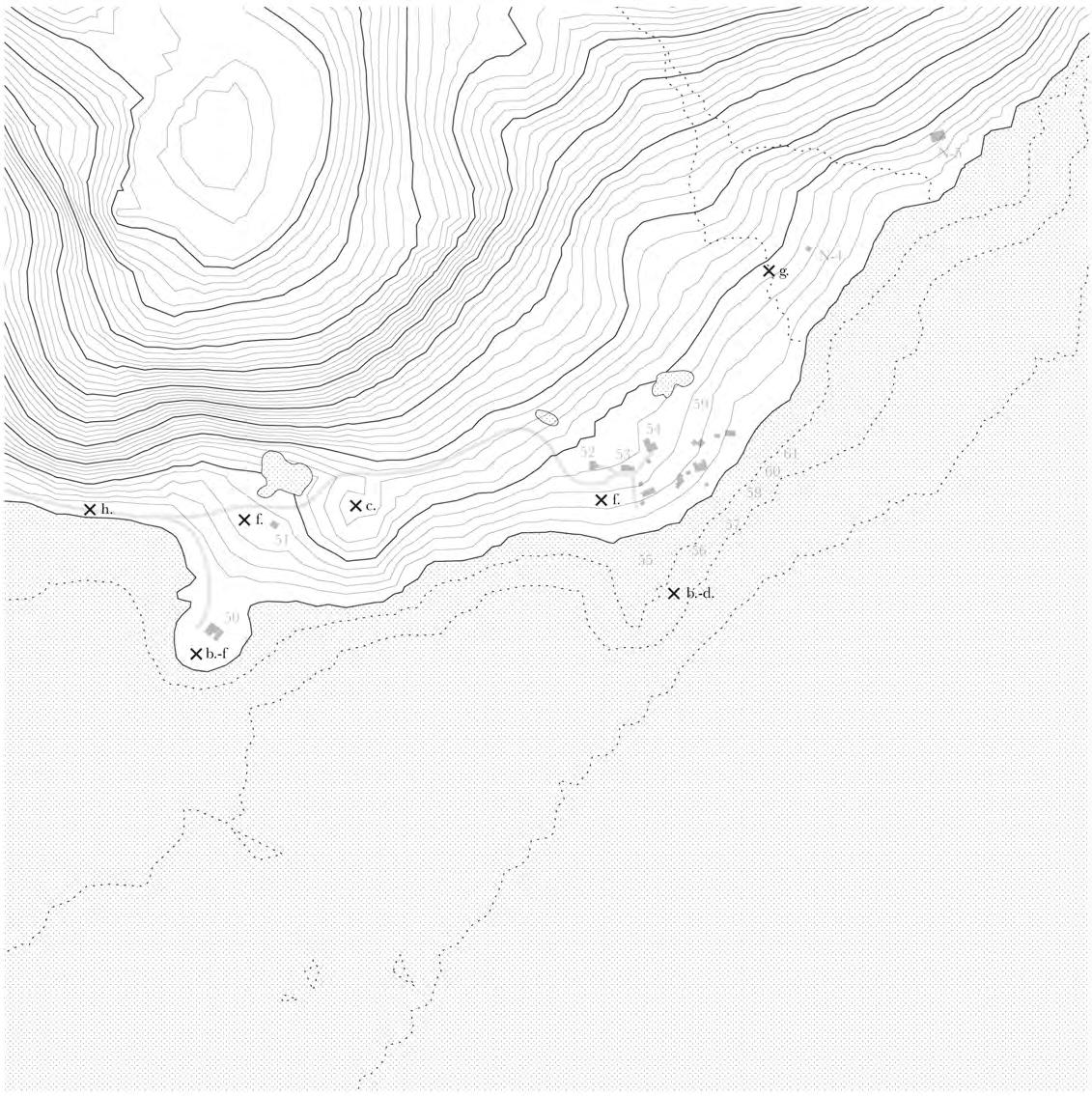 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
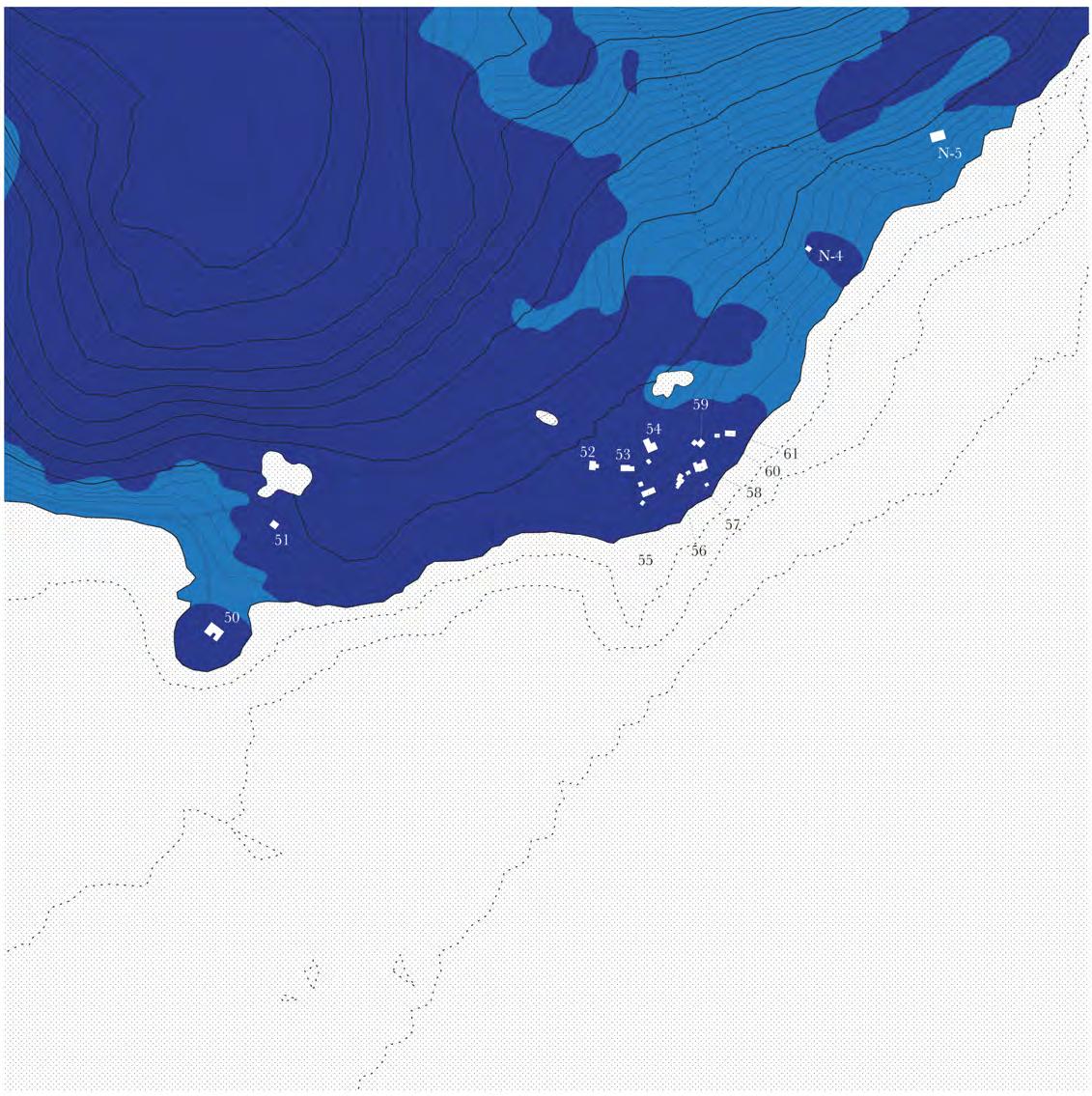 4.
4.
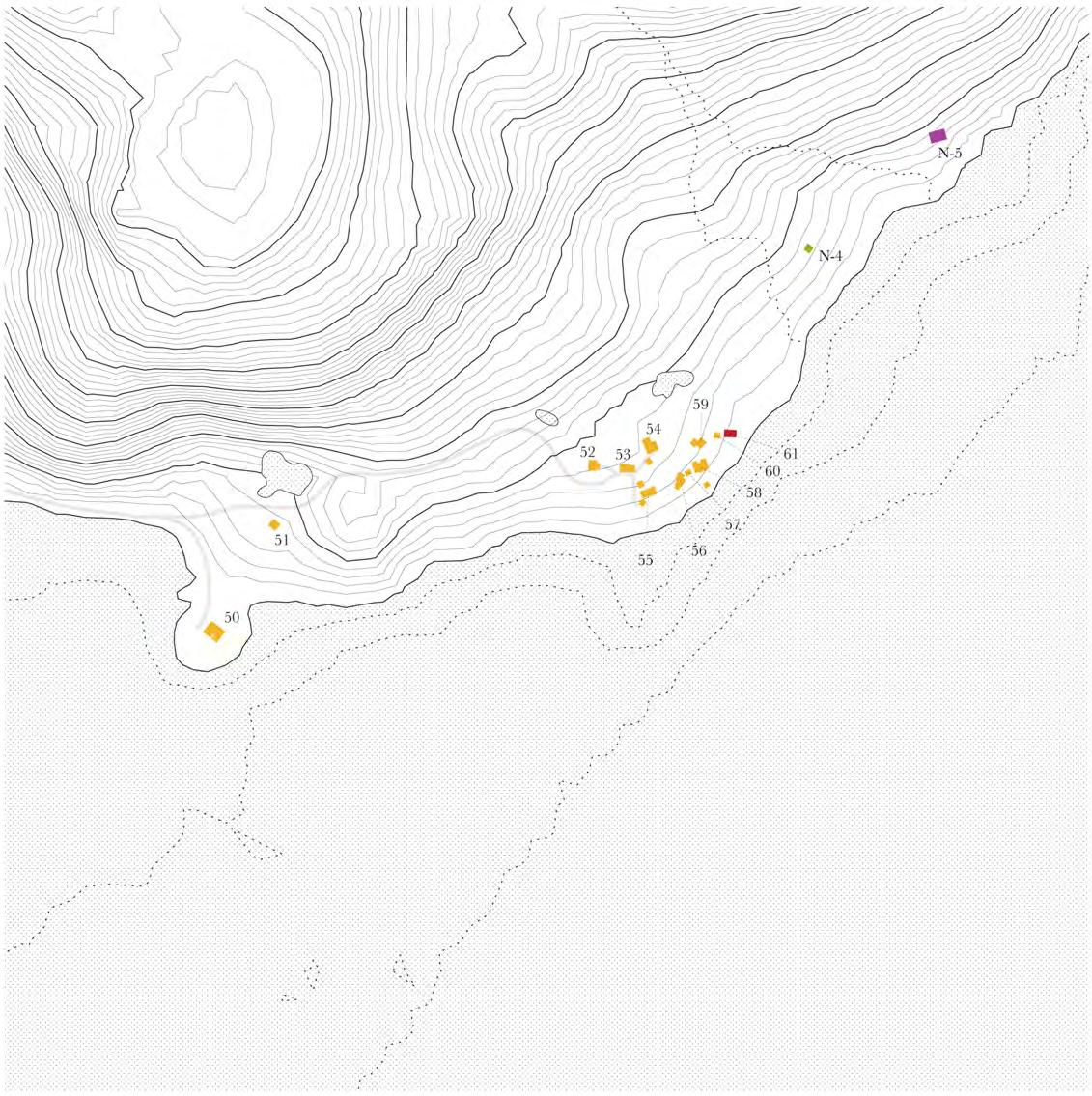
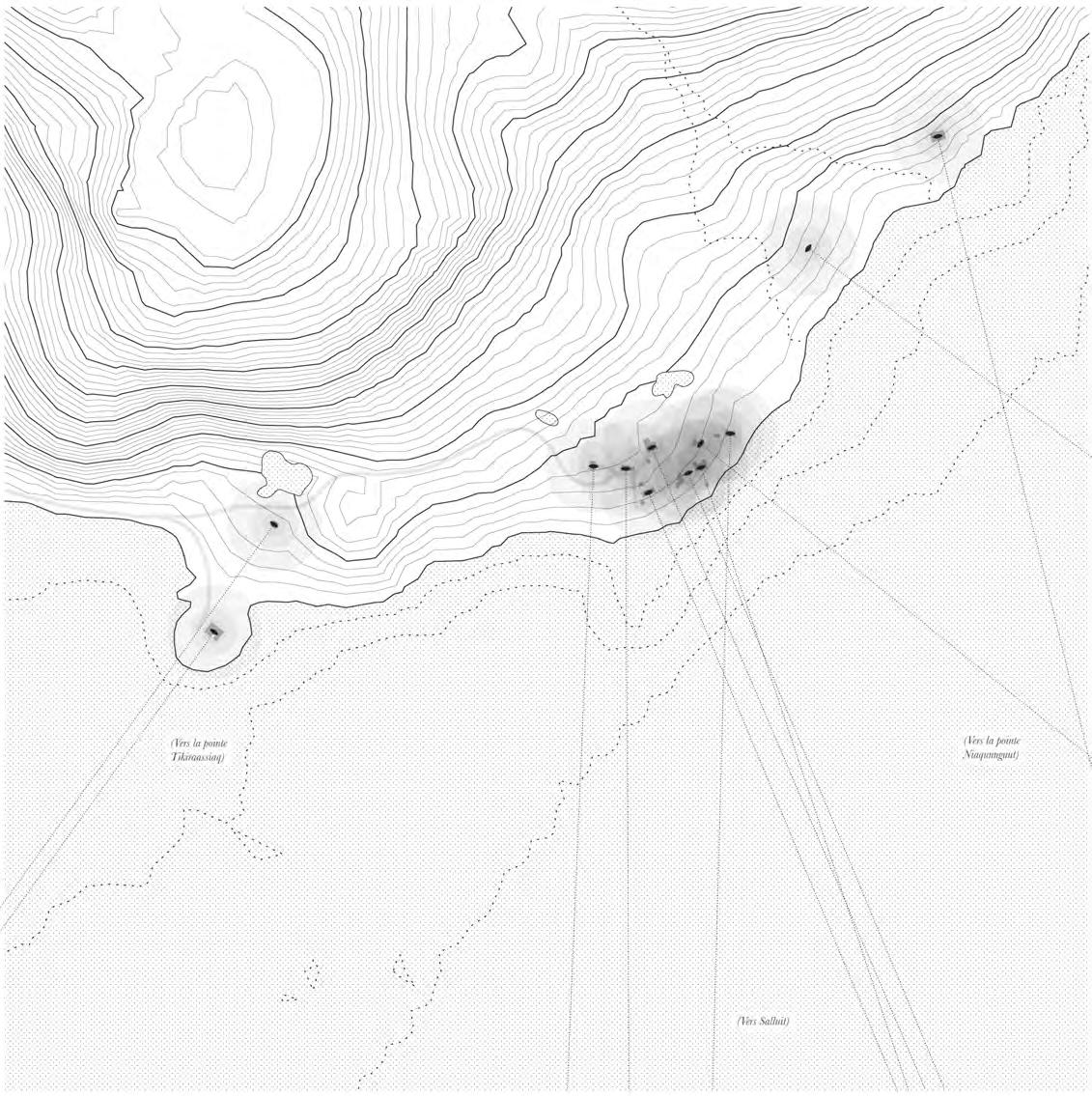
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

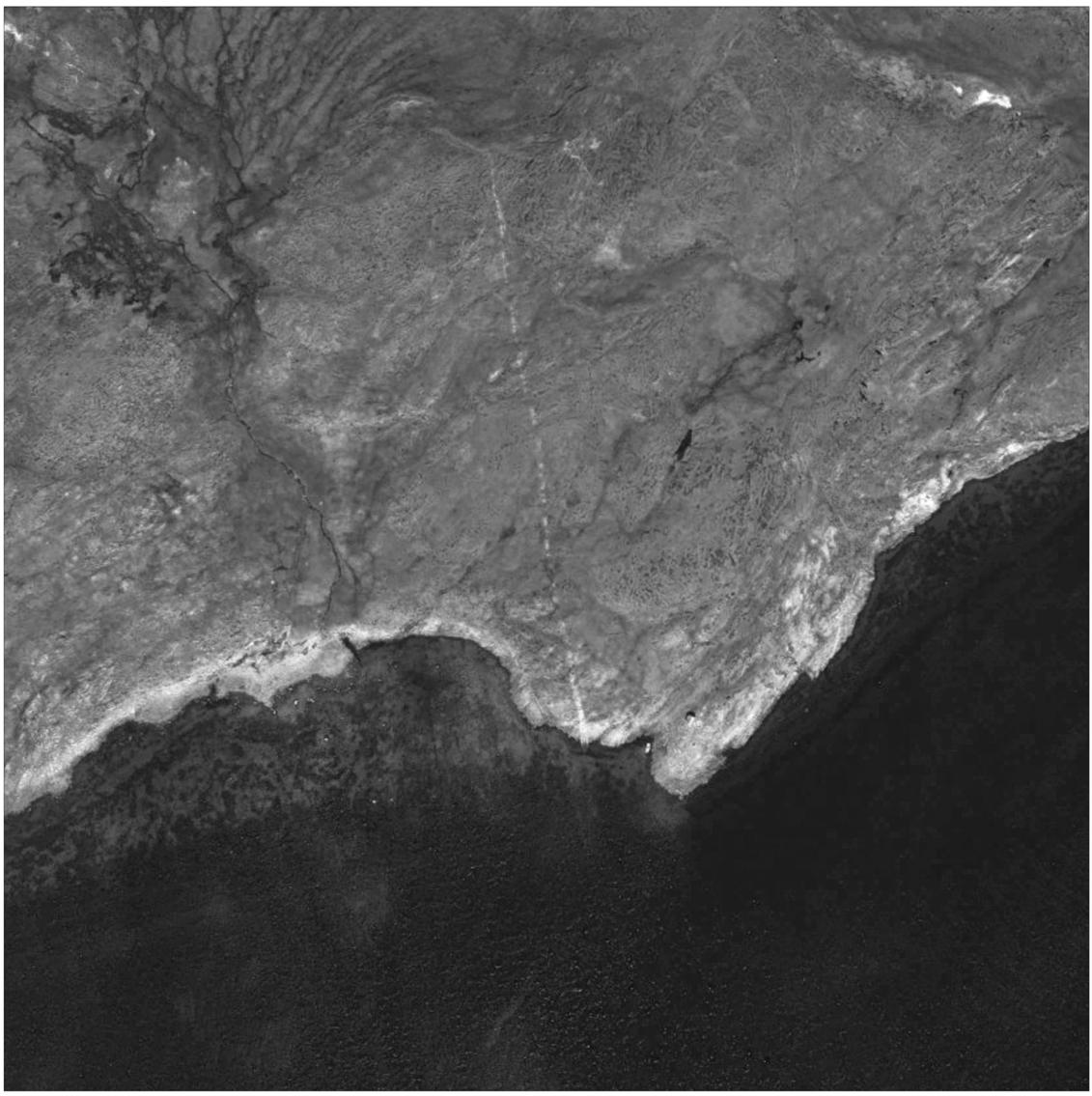
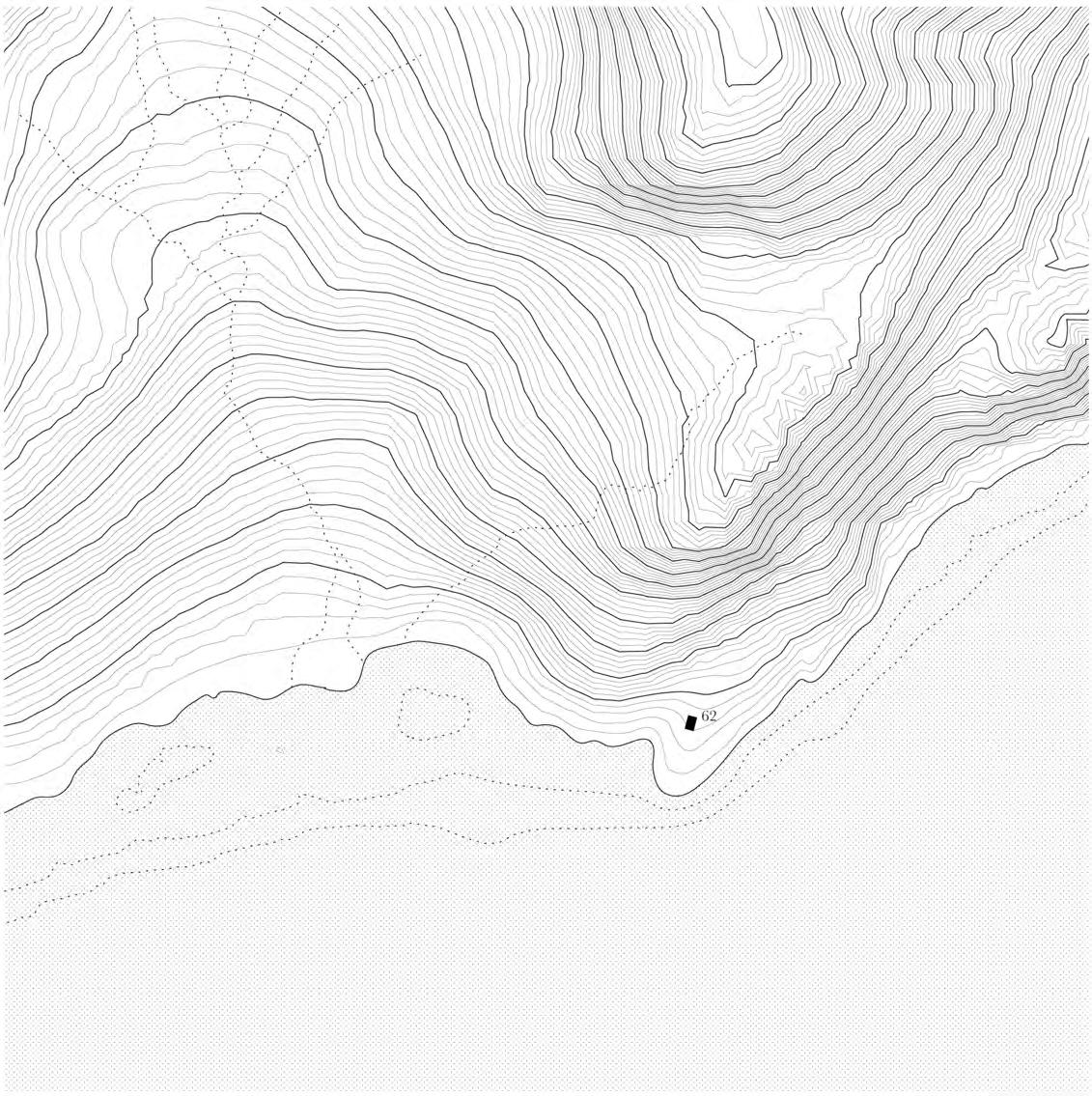

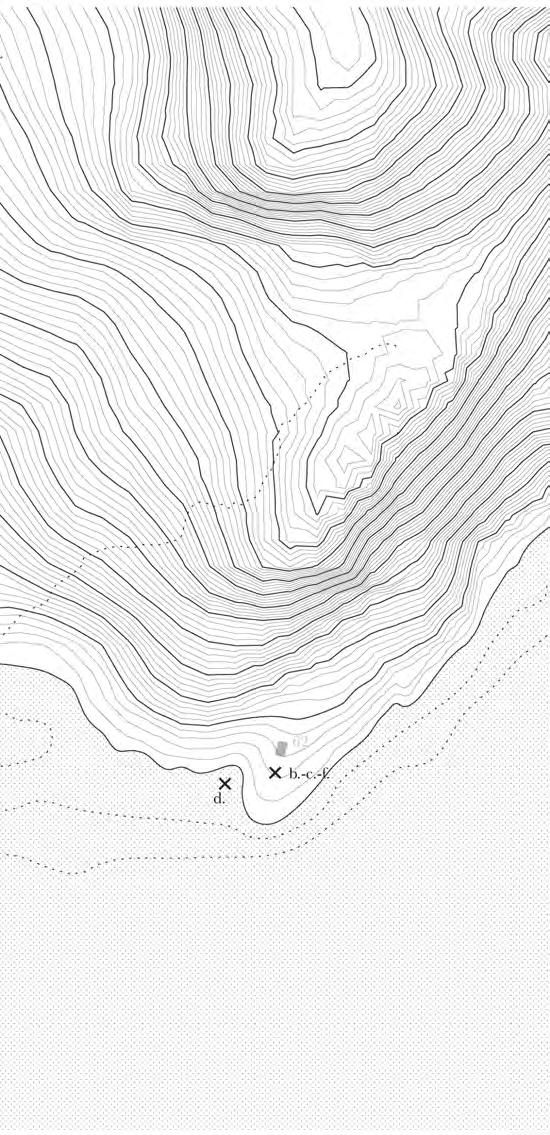
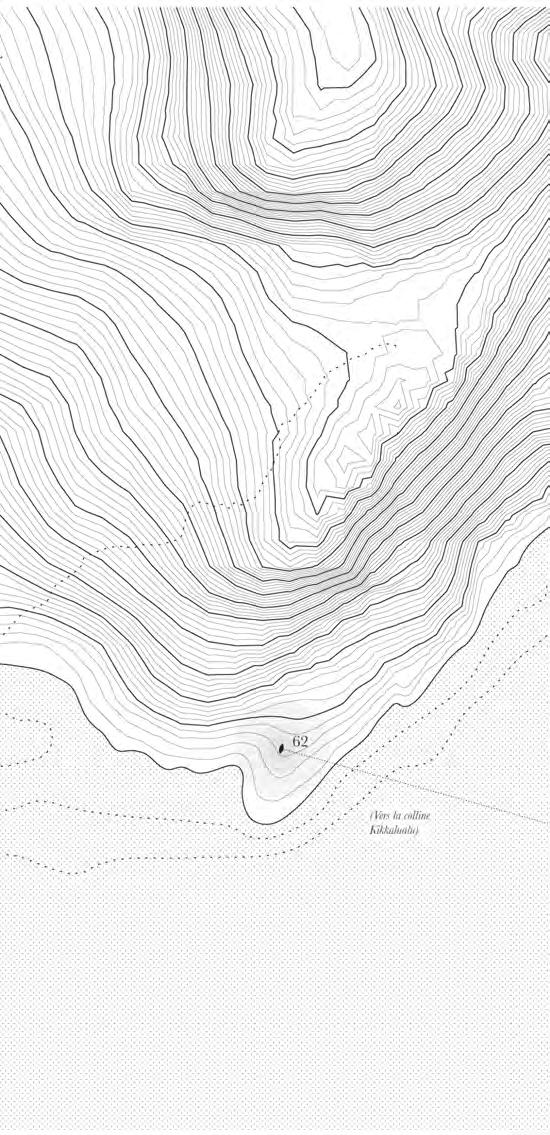
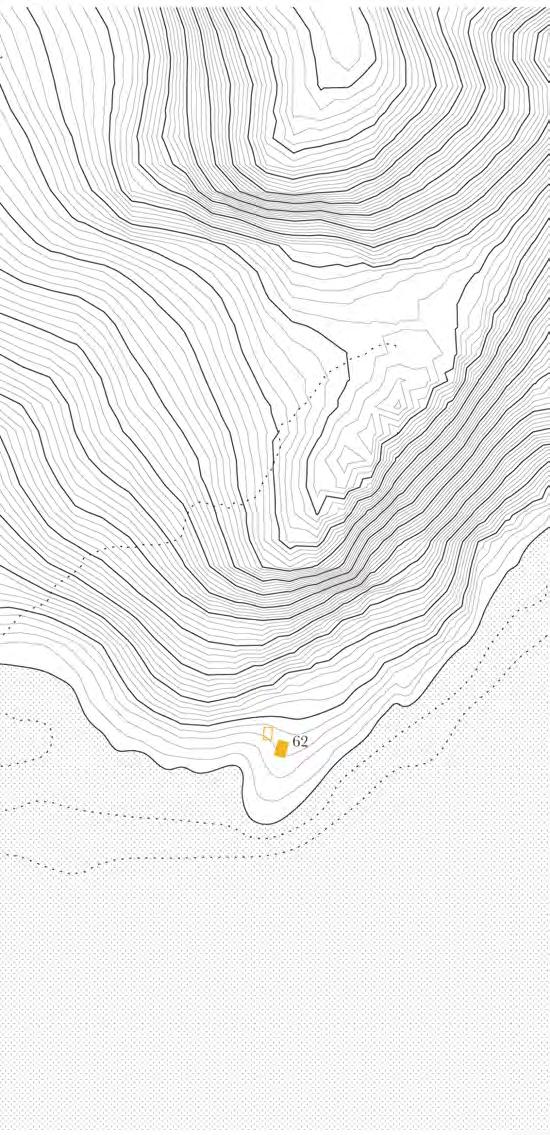
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 212
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 212
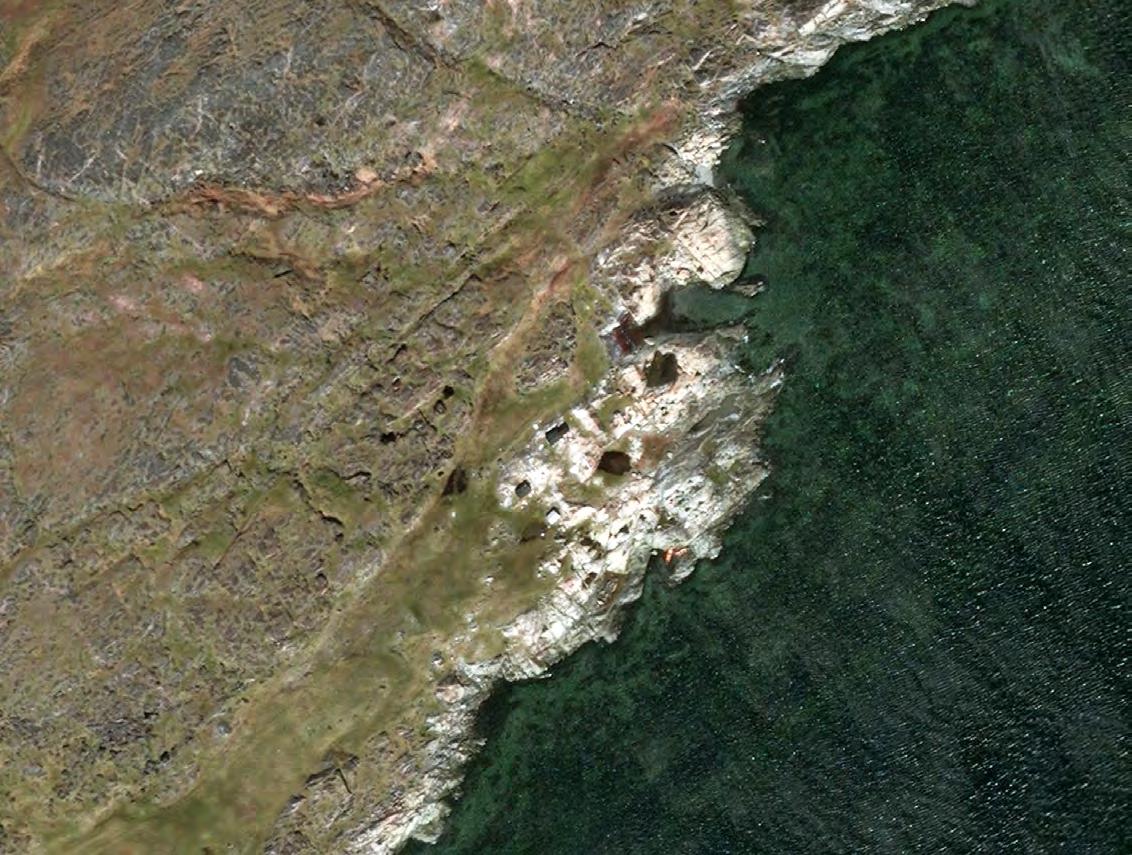 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
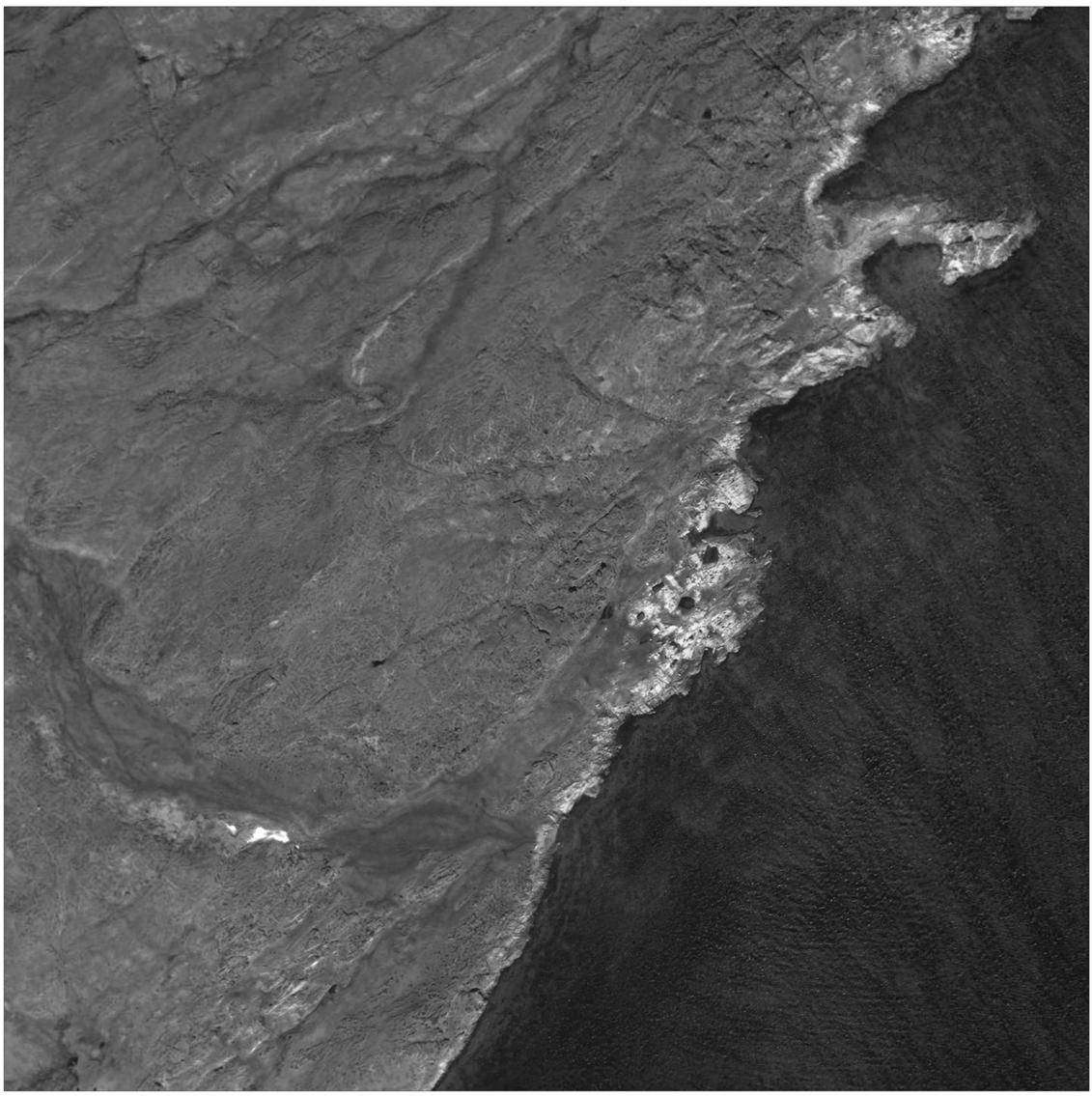
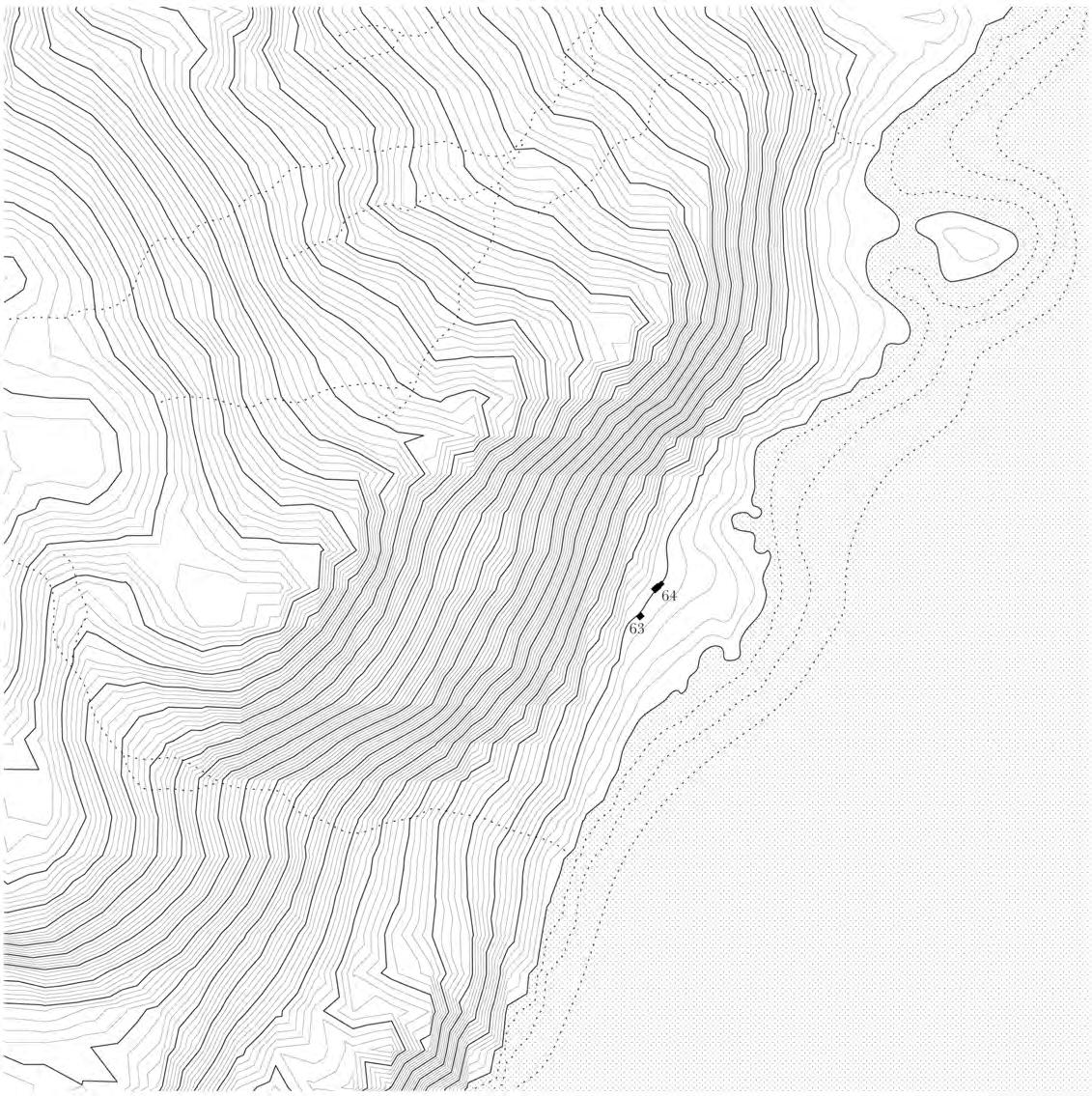


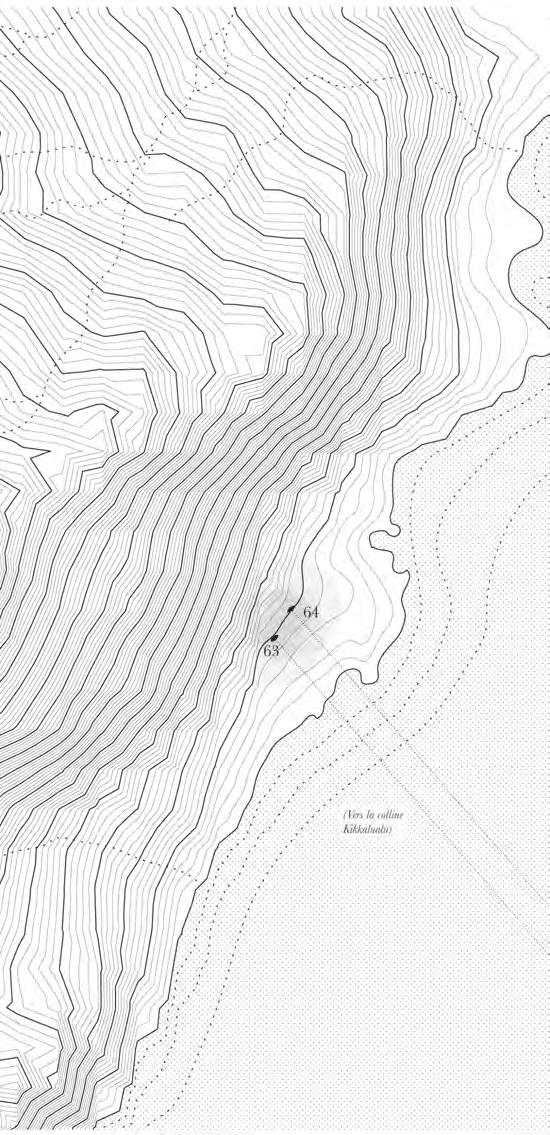

 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 218
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019
Annexe 1 - page 218
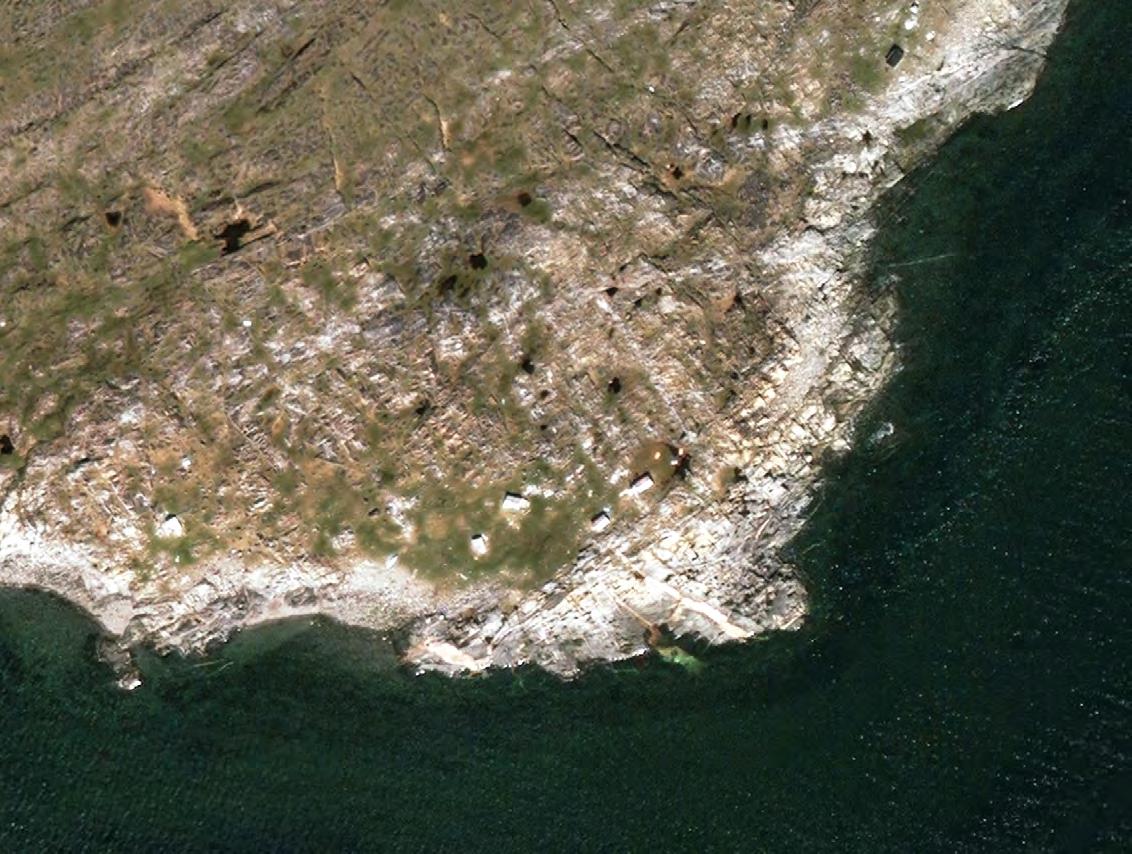
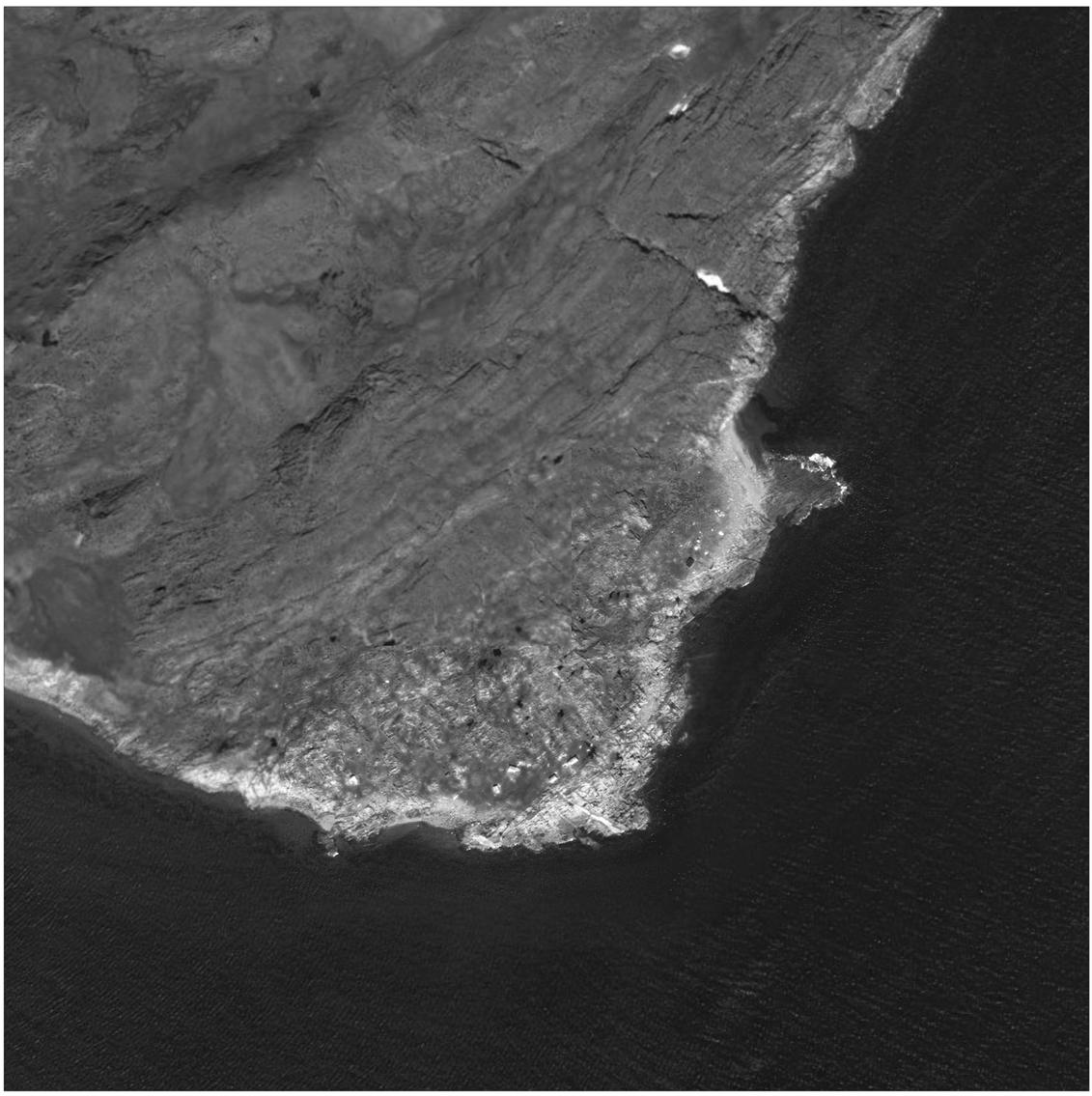
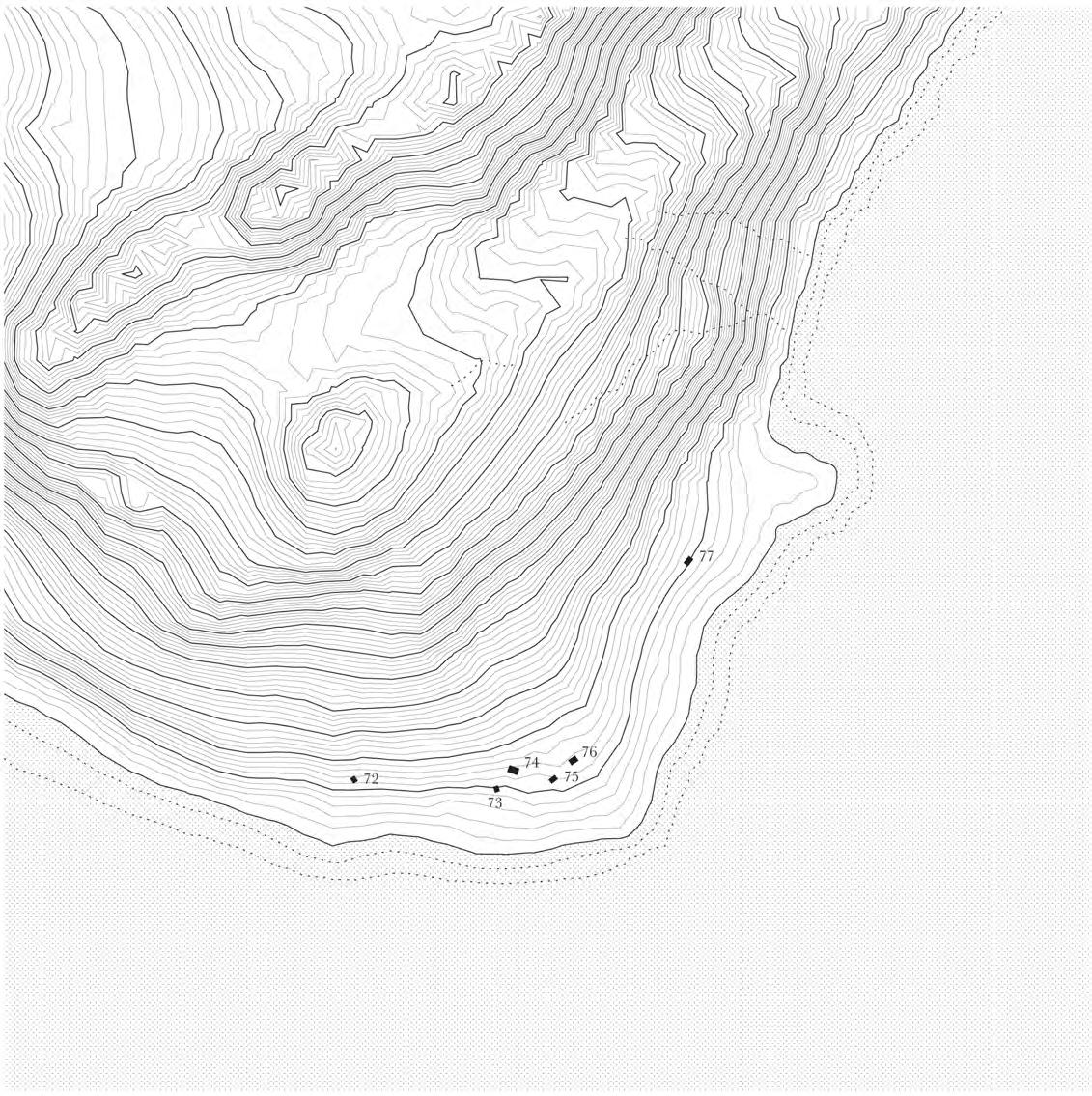
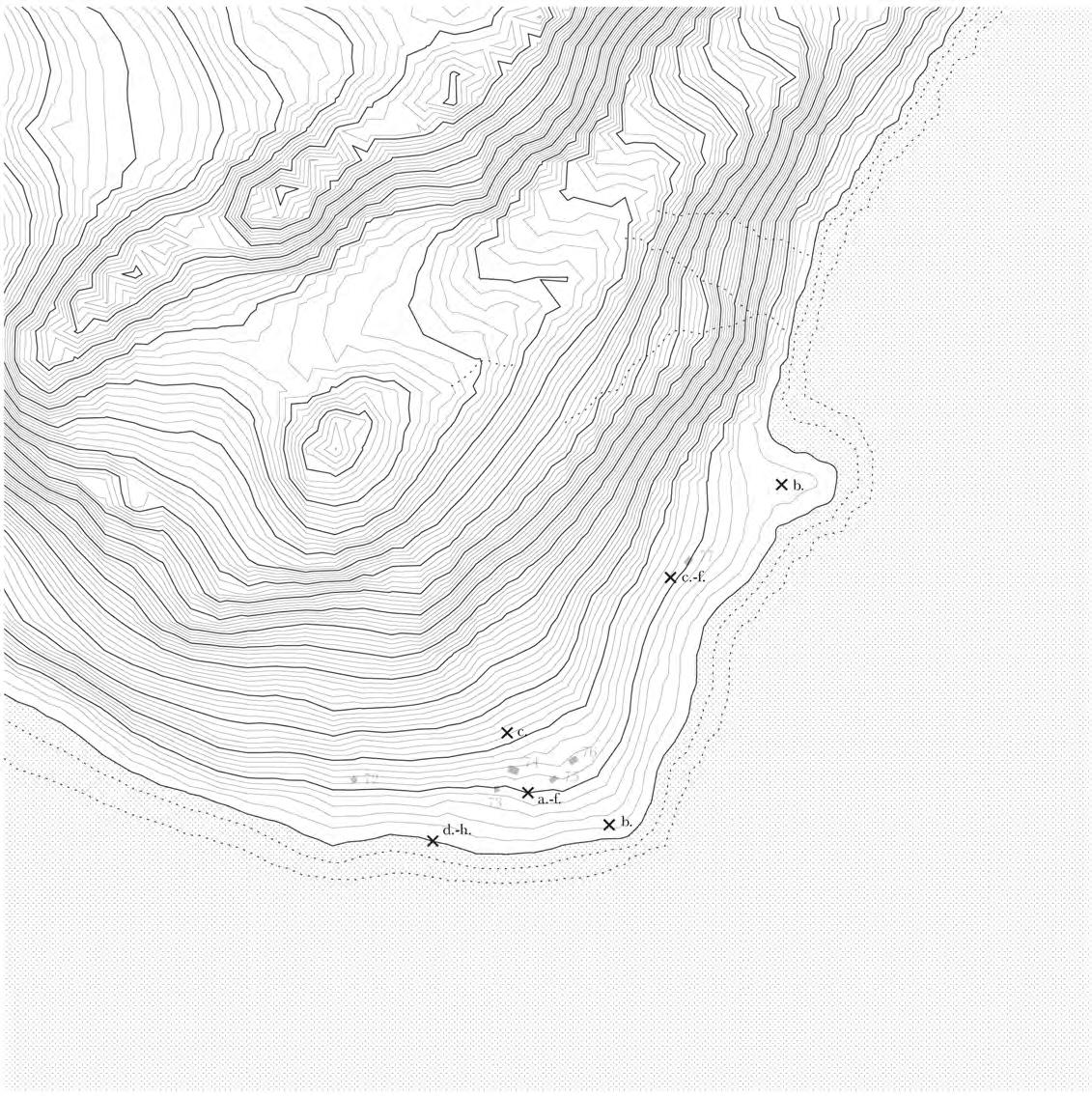 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
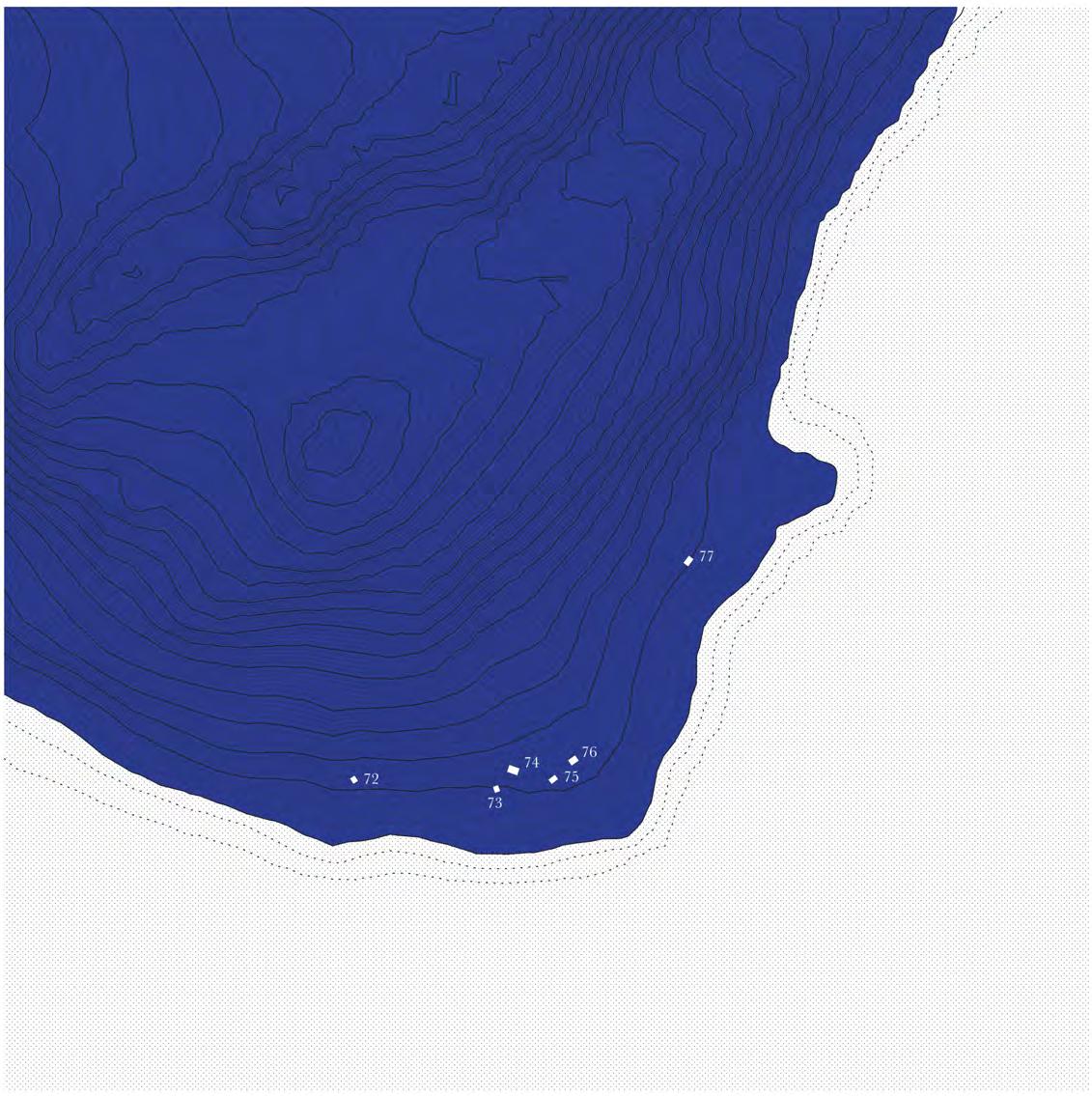
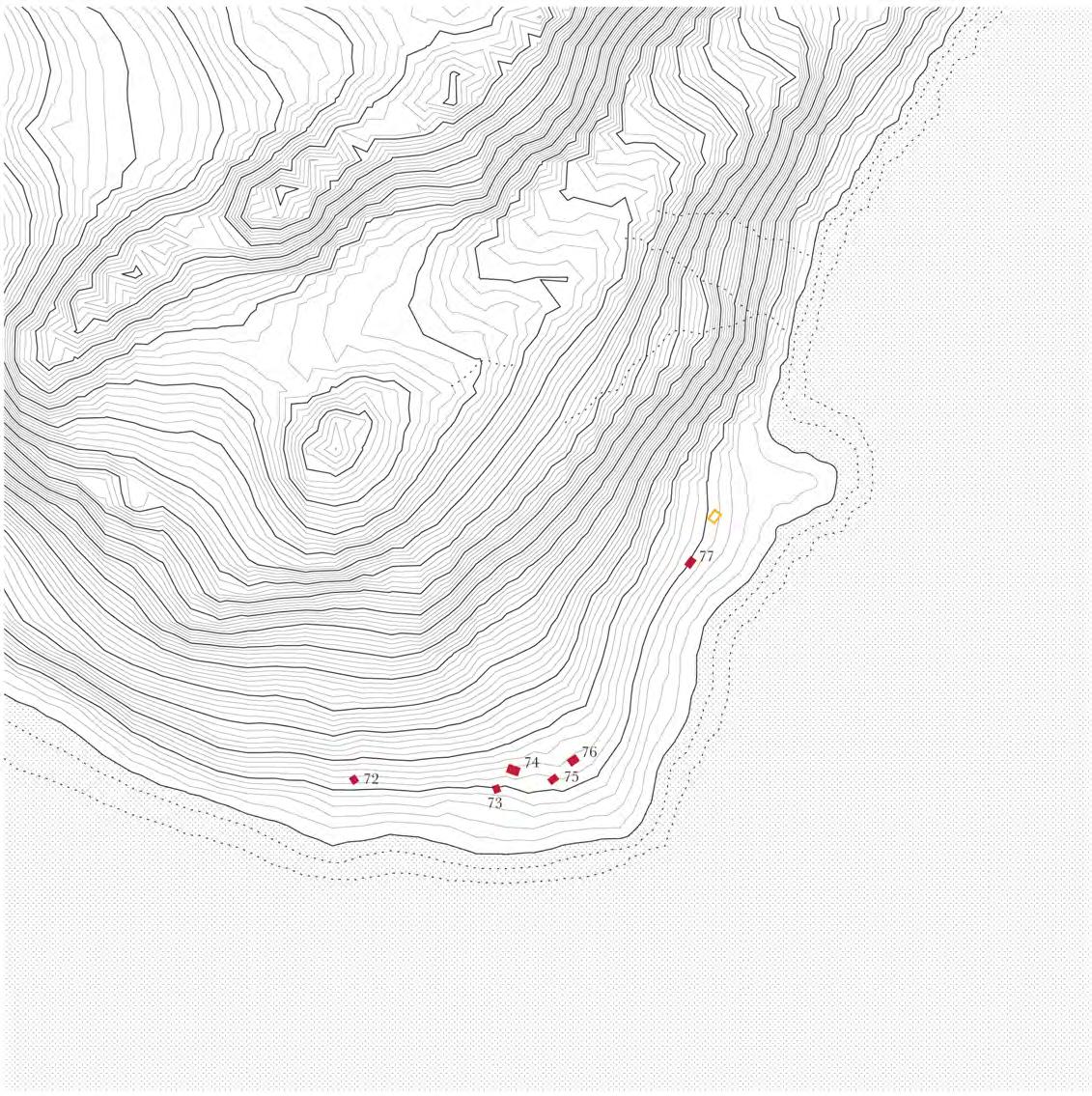
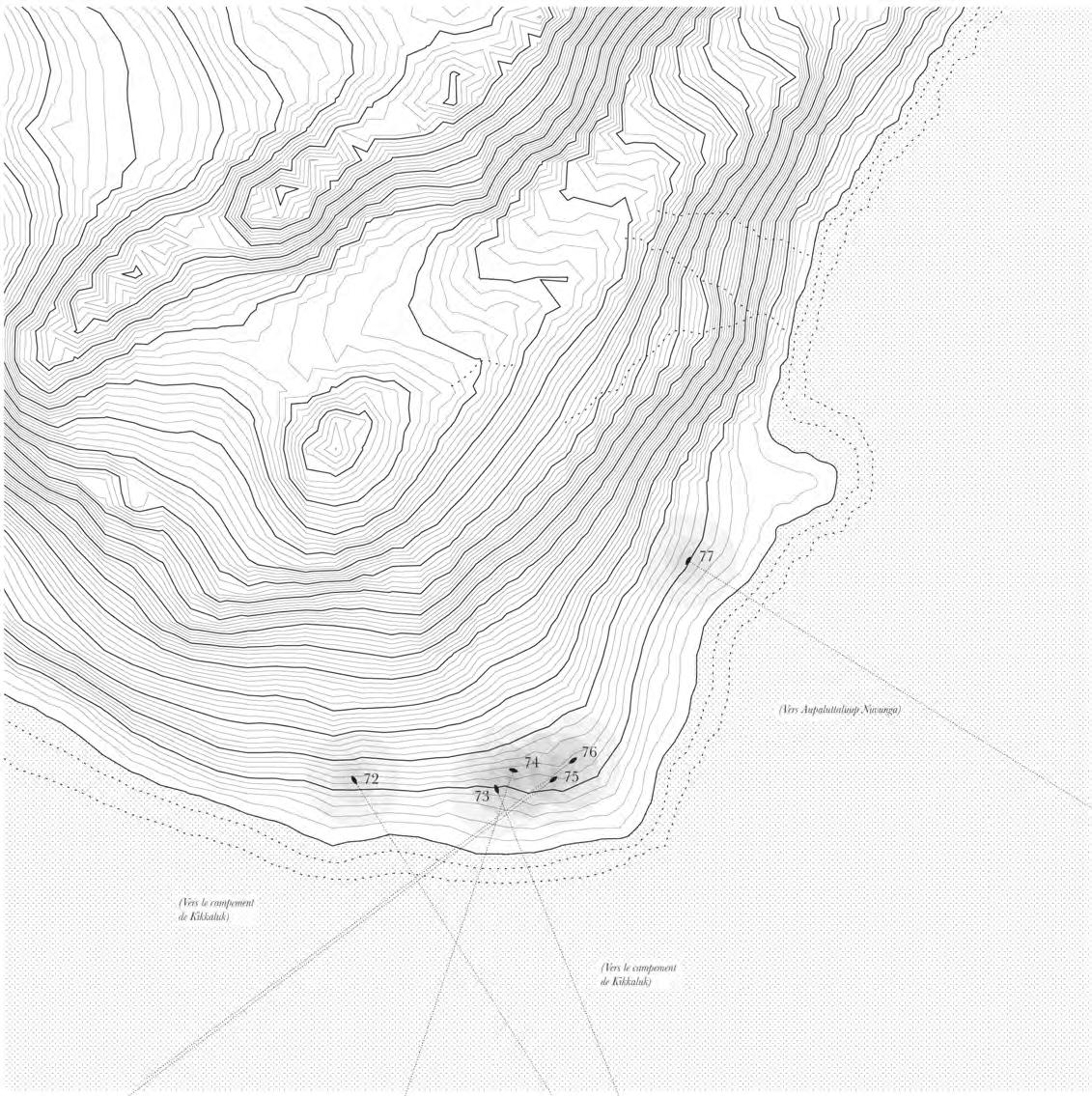
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 226
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 226


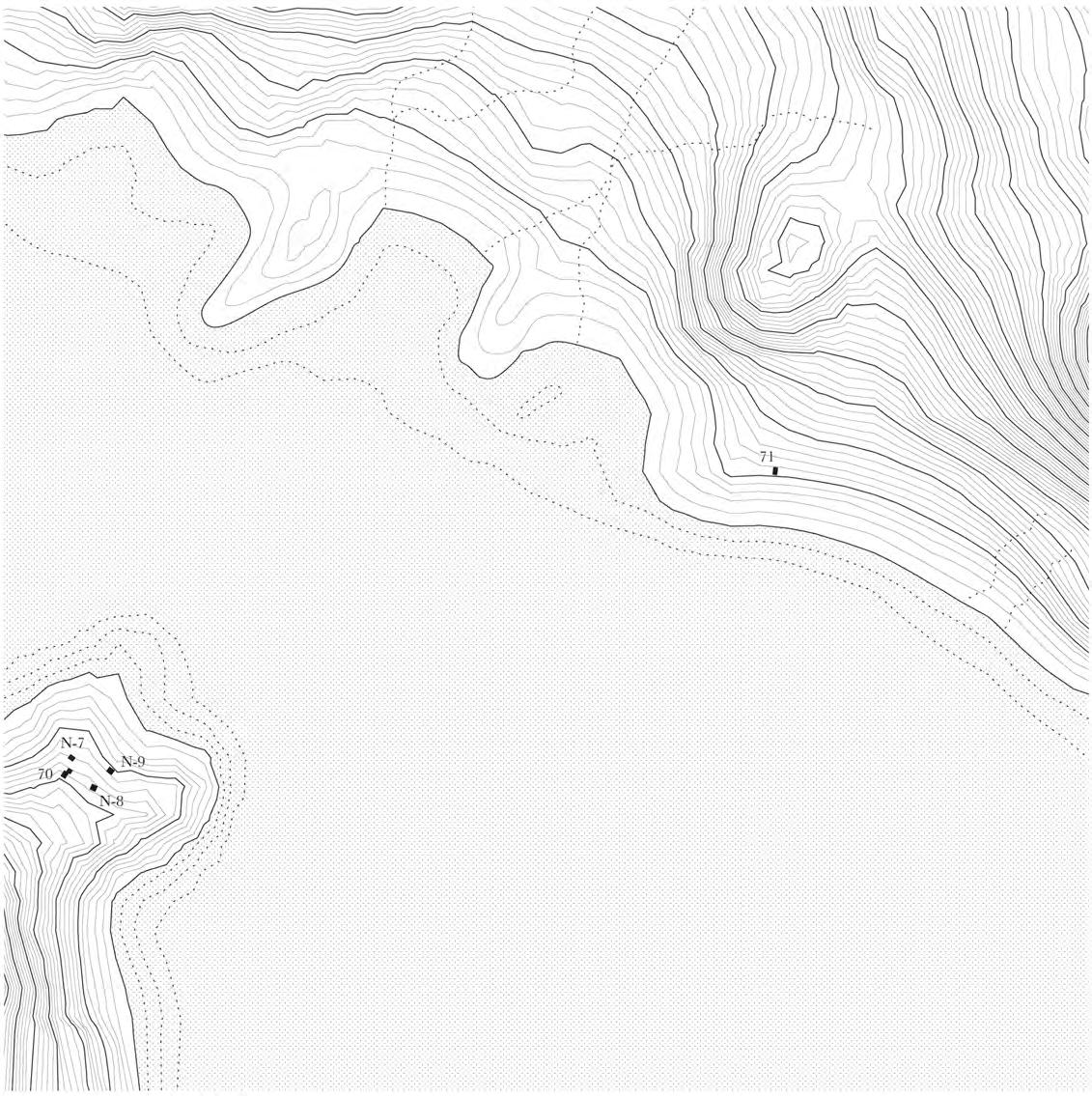 2.
Cours d’eau
Passe Ford
Fjord de Salluit
2.
Cours d’eau
Passe Ford
Fjord de Salluit
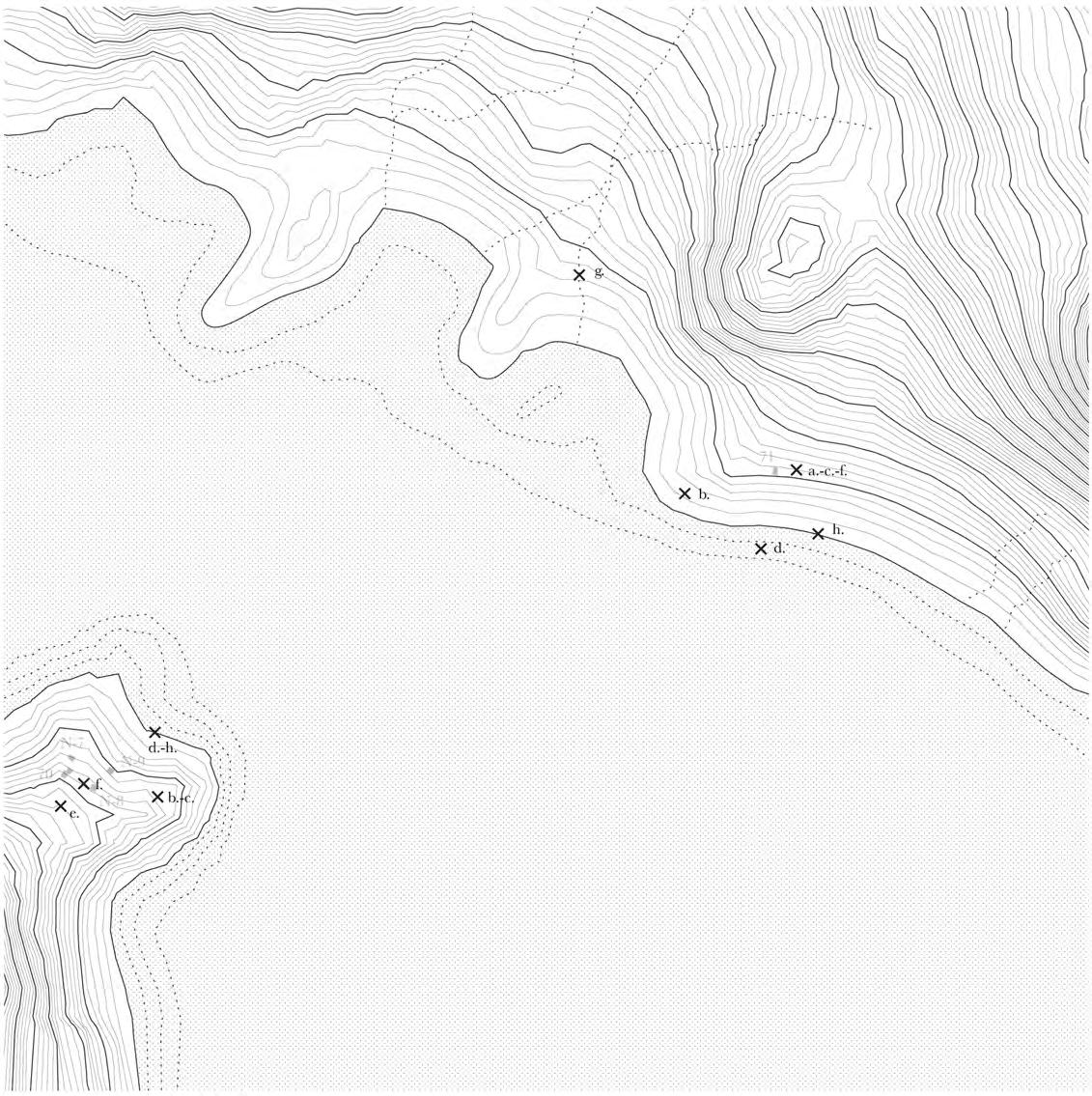 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Passe Ford
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
Passe Ford
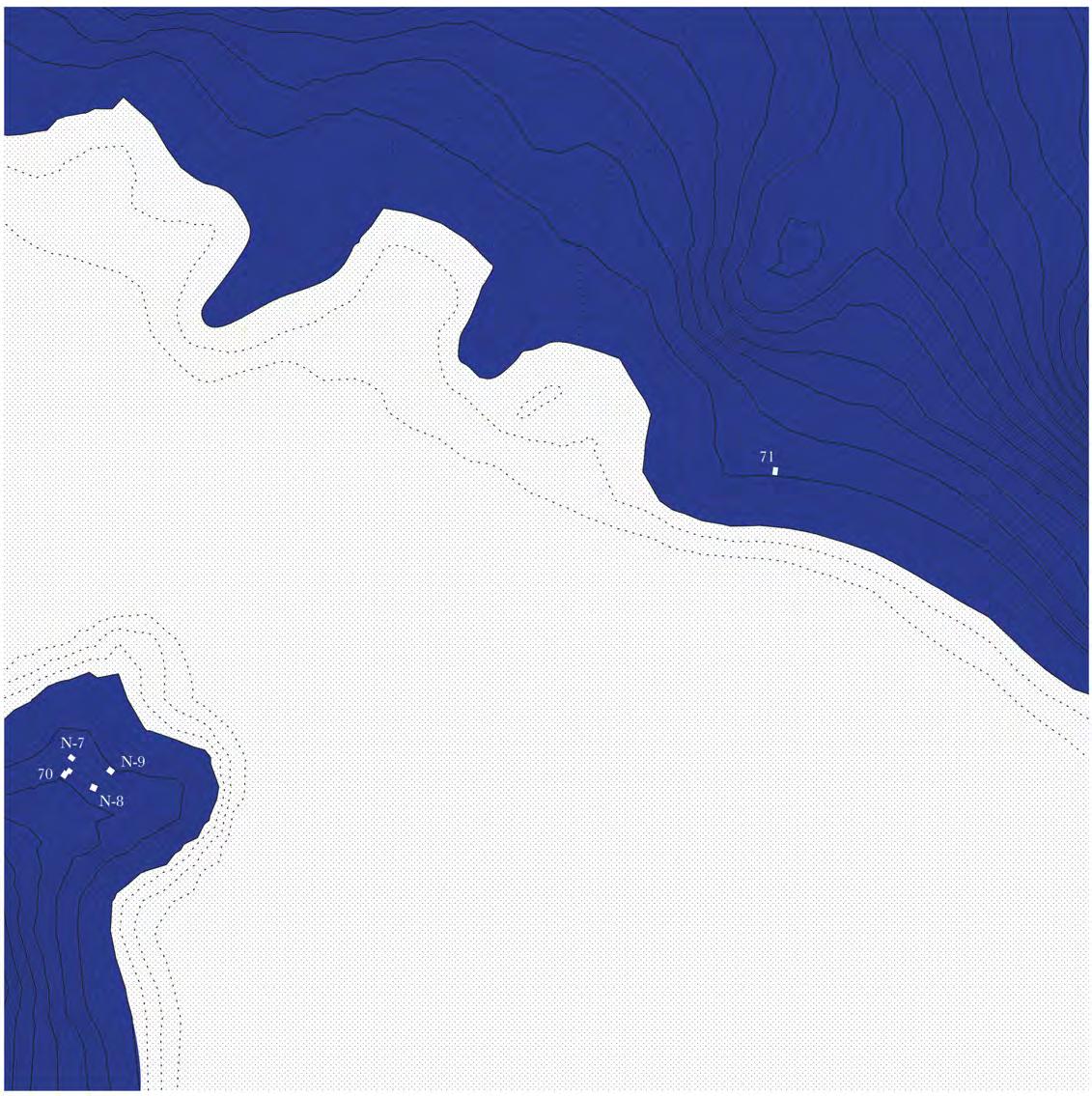
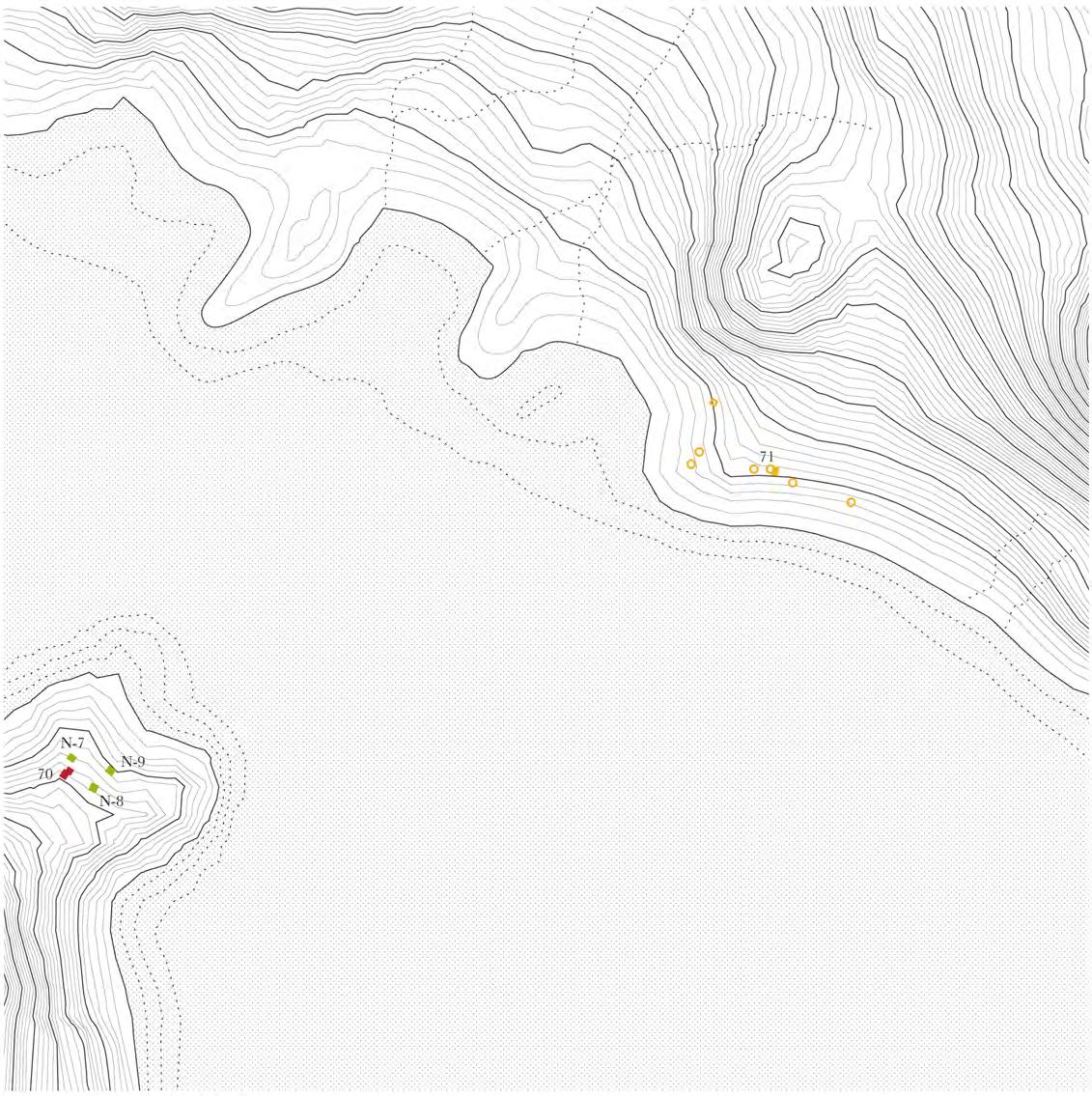
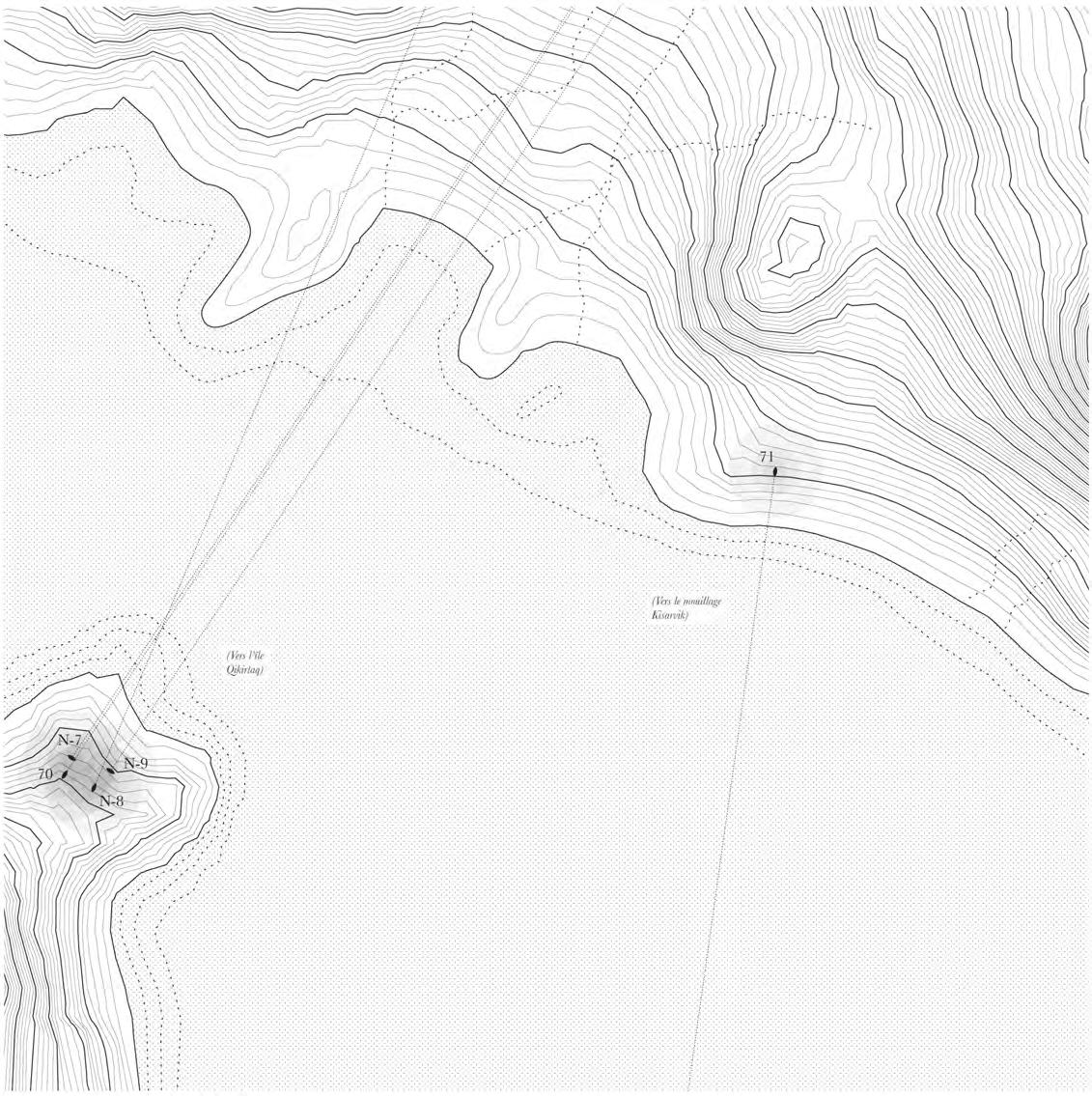
 Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 234
Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021
Annexe 1 - page 234

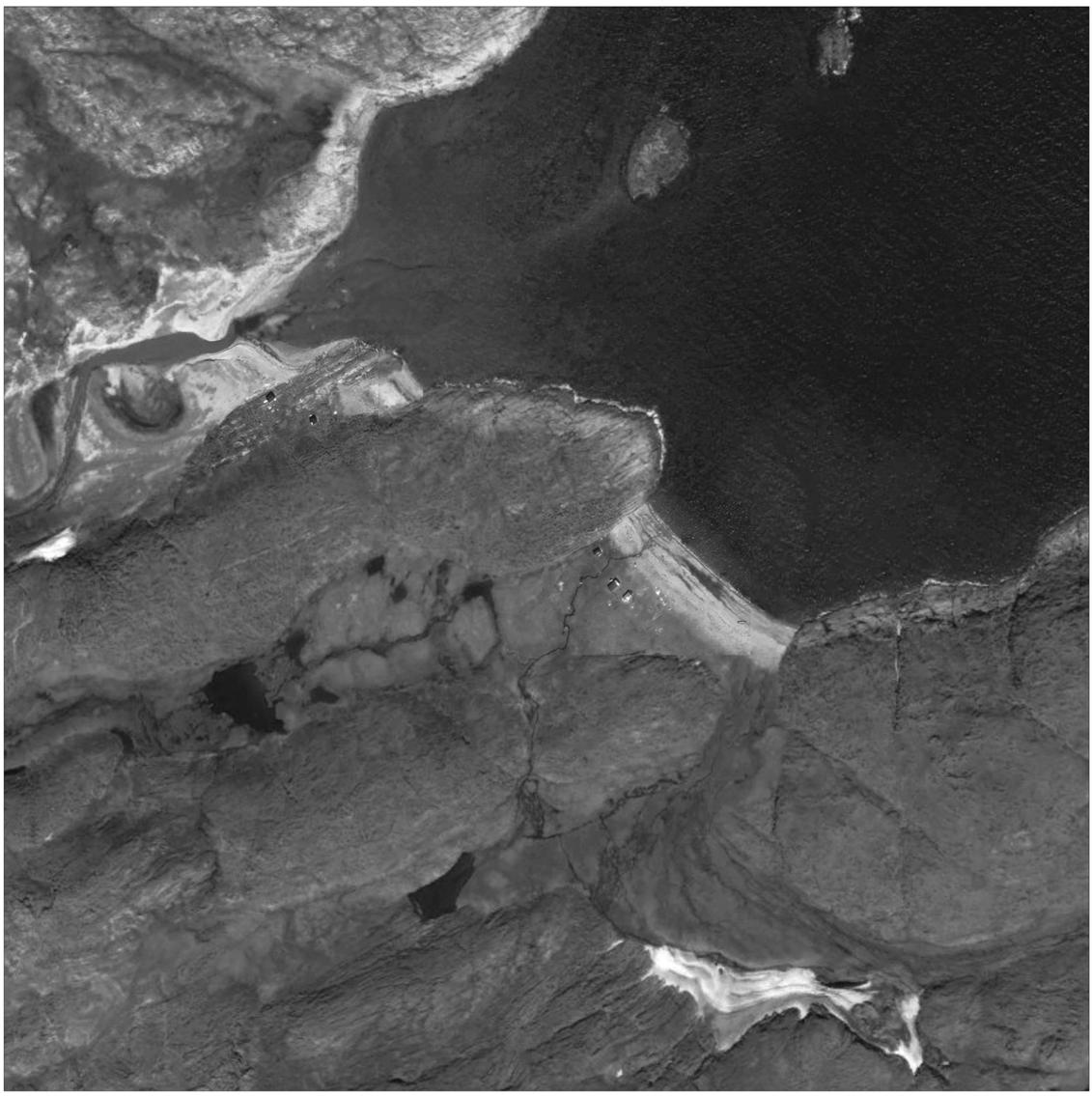
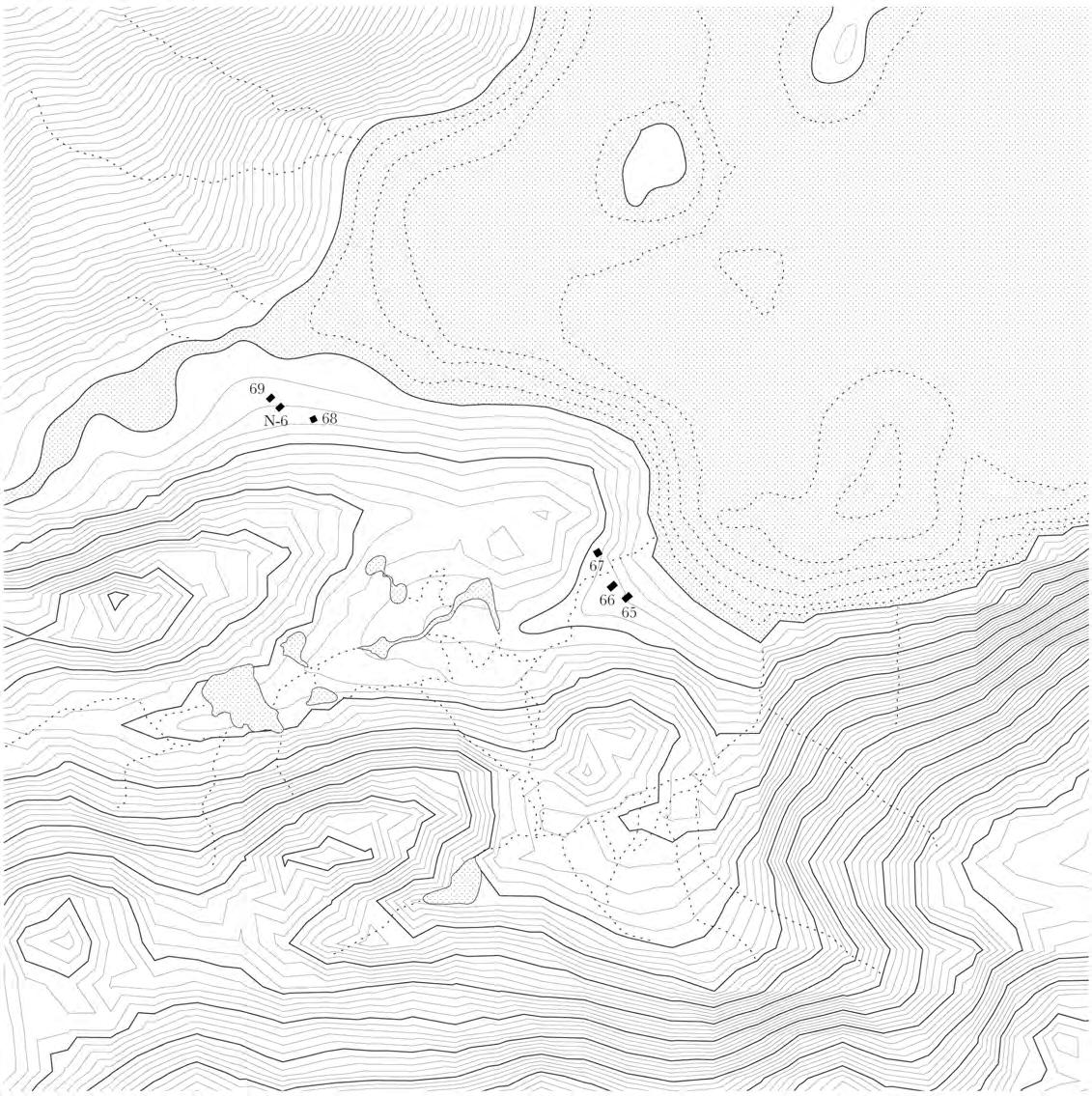
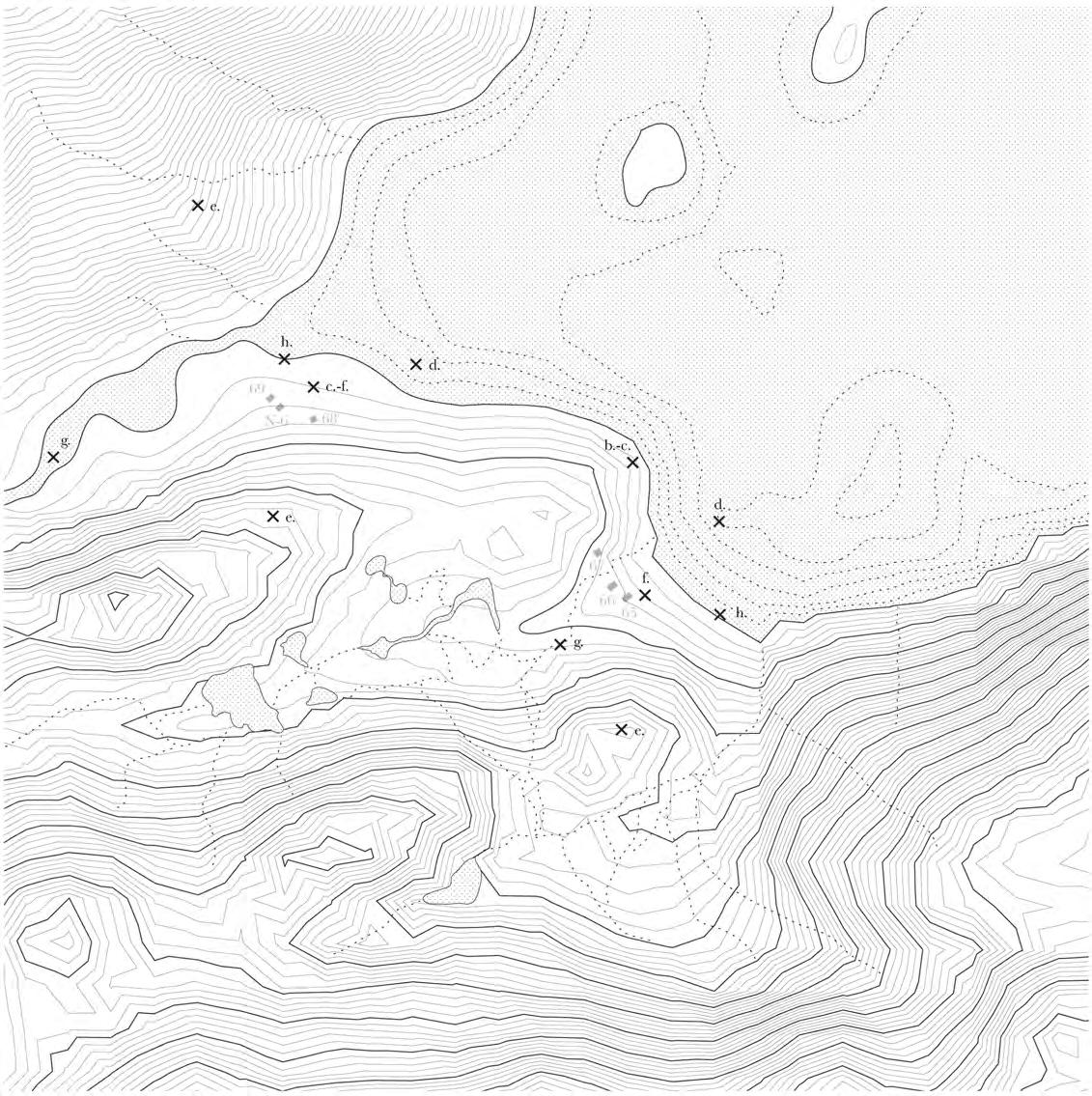 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
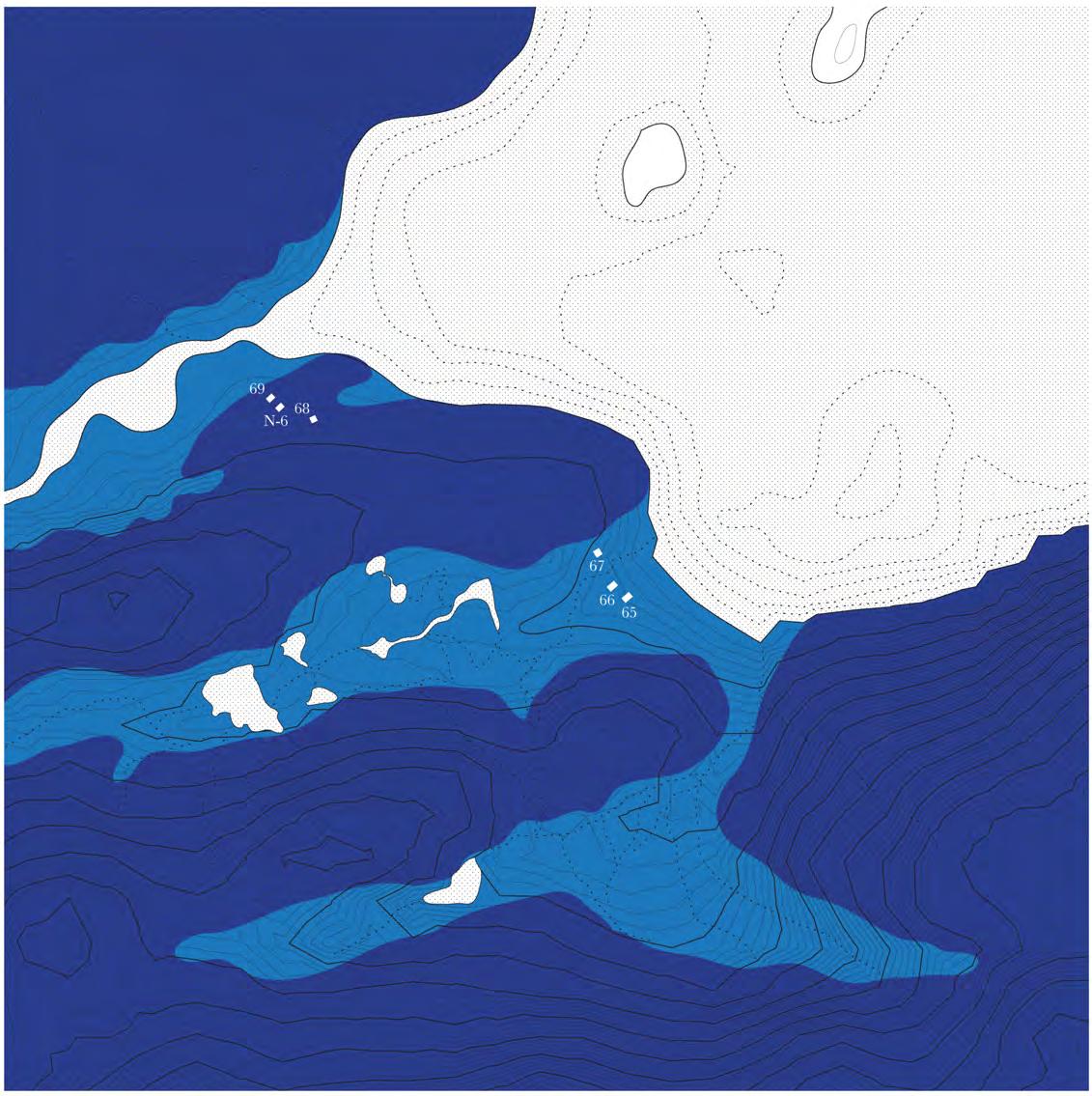
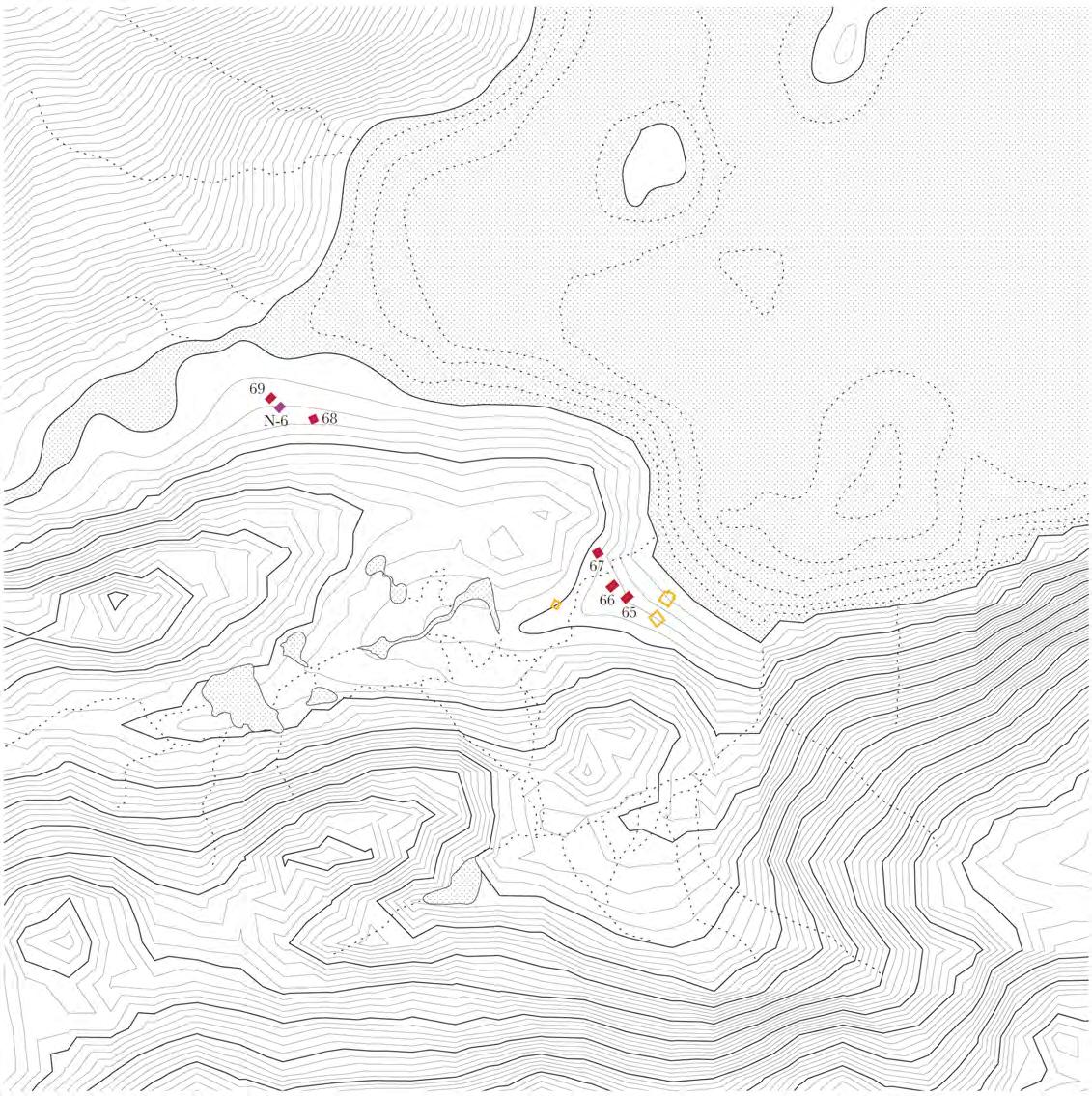
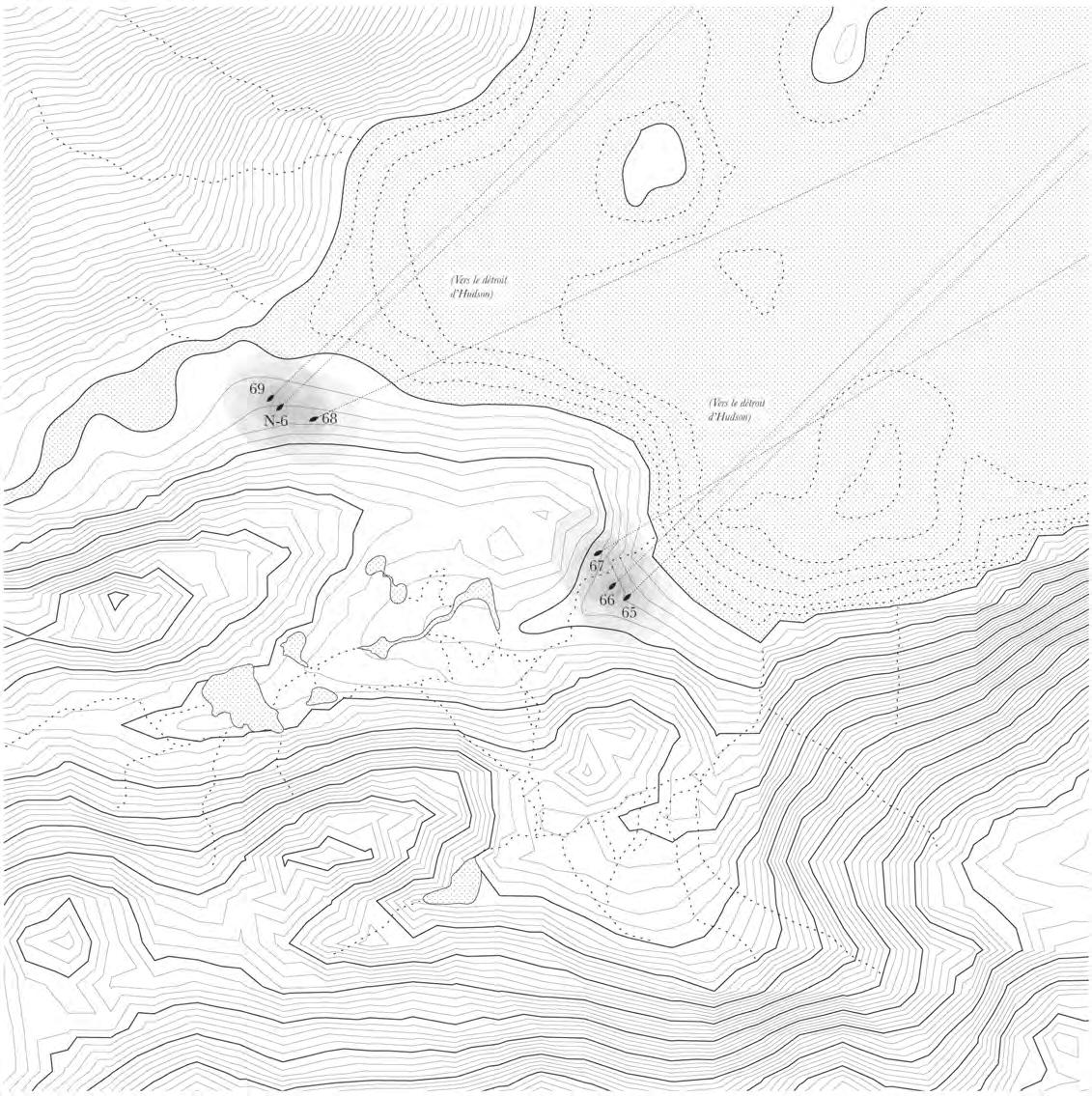



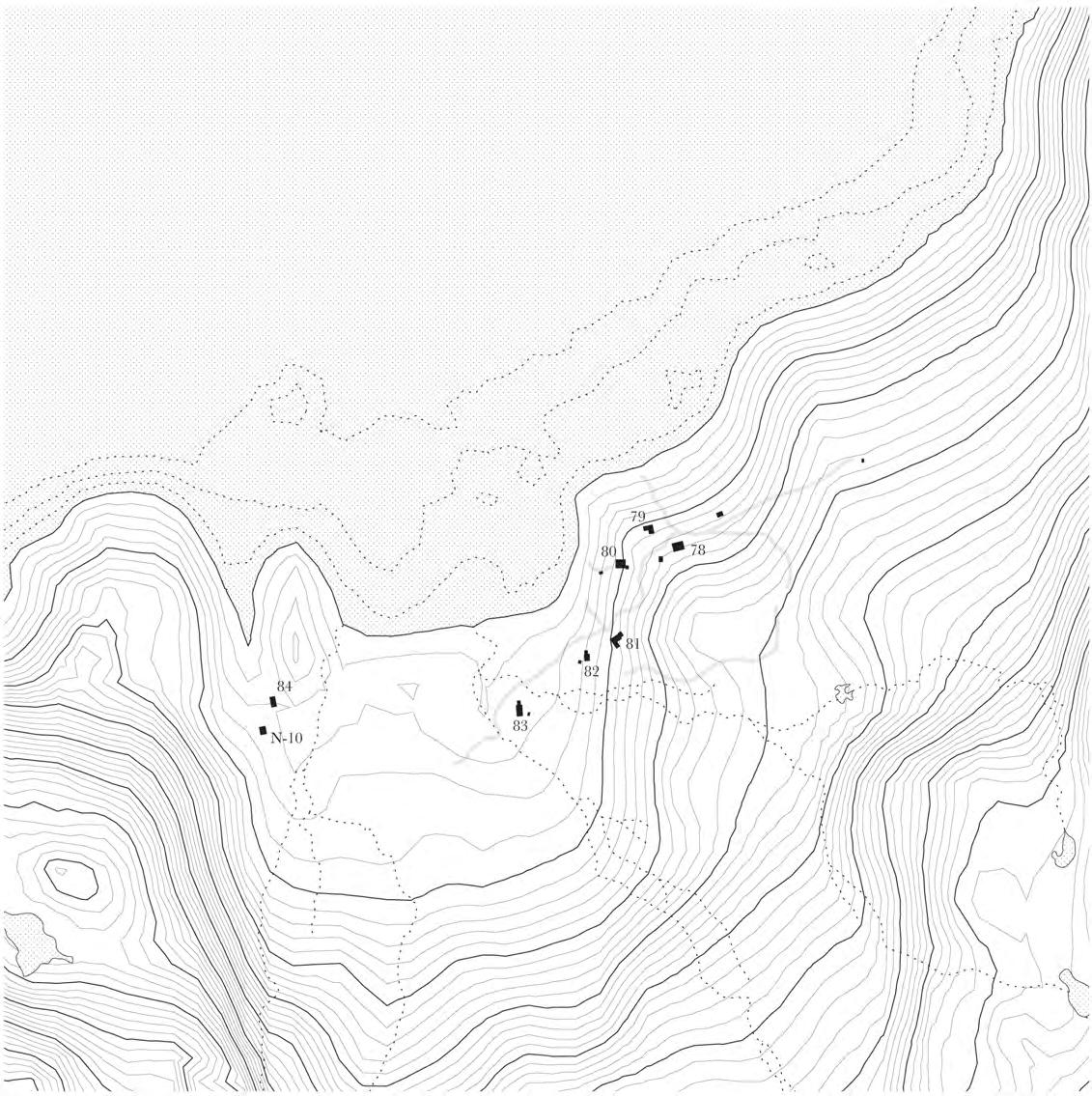 2. Cours d’eau
2. Cours d’eau
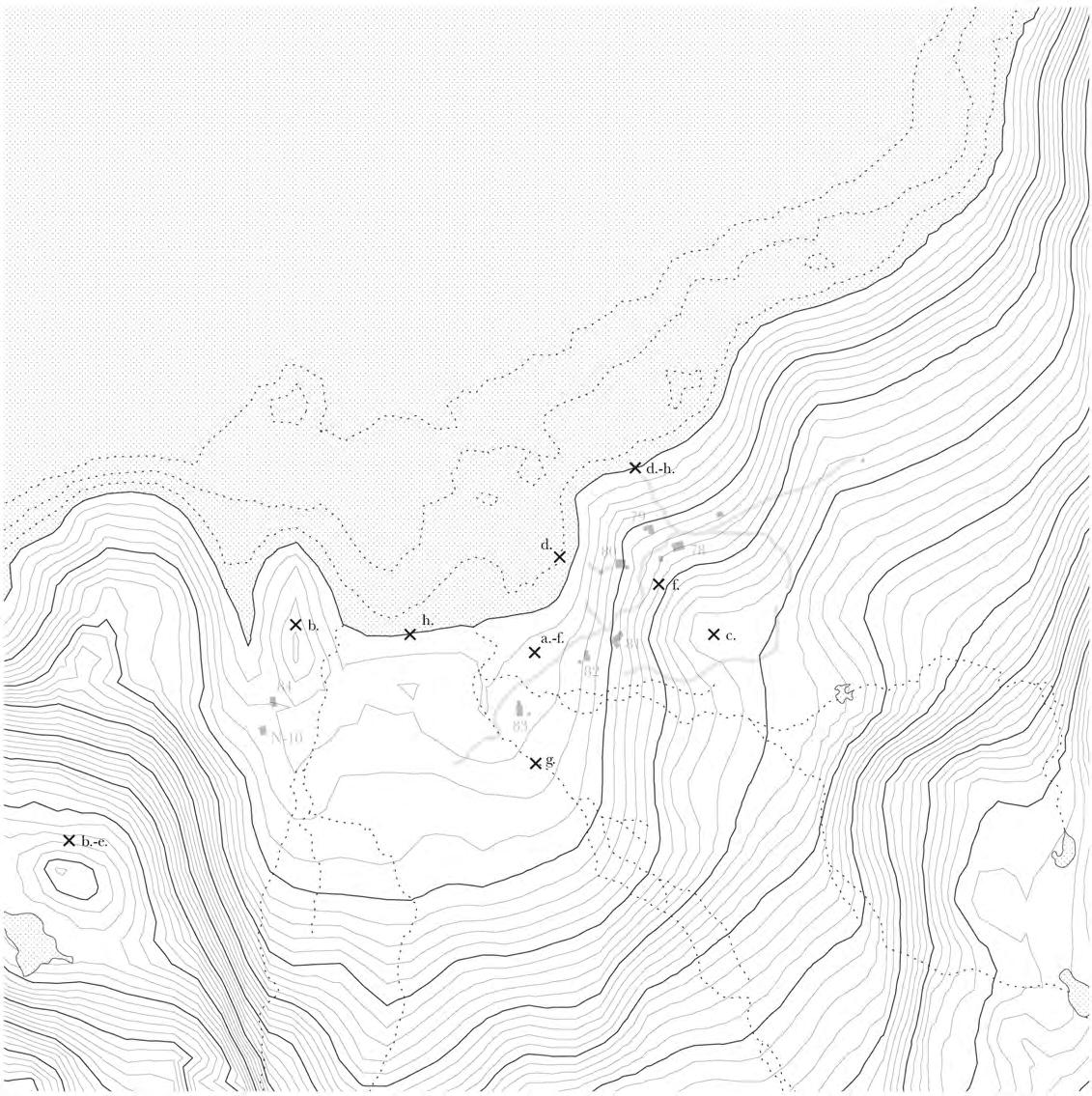 3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
3.
a. Rapport à un site traditionnel
c. Palier d’observation
e. Protection des vents
g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage
d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
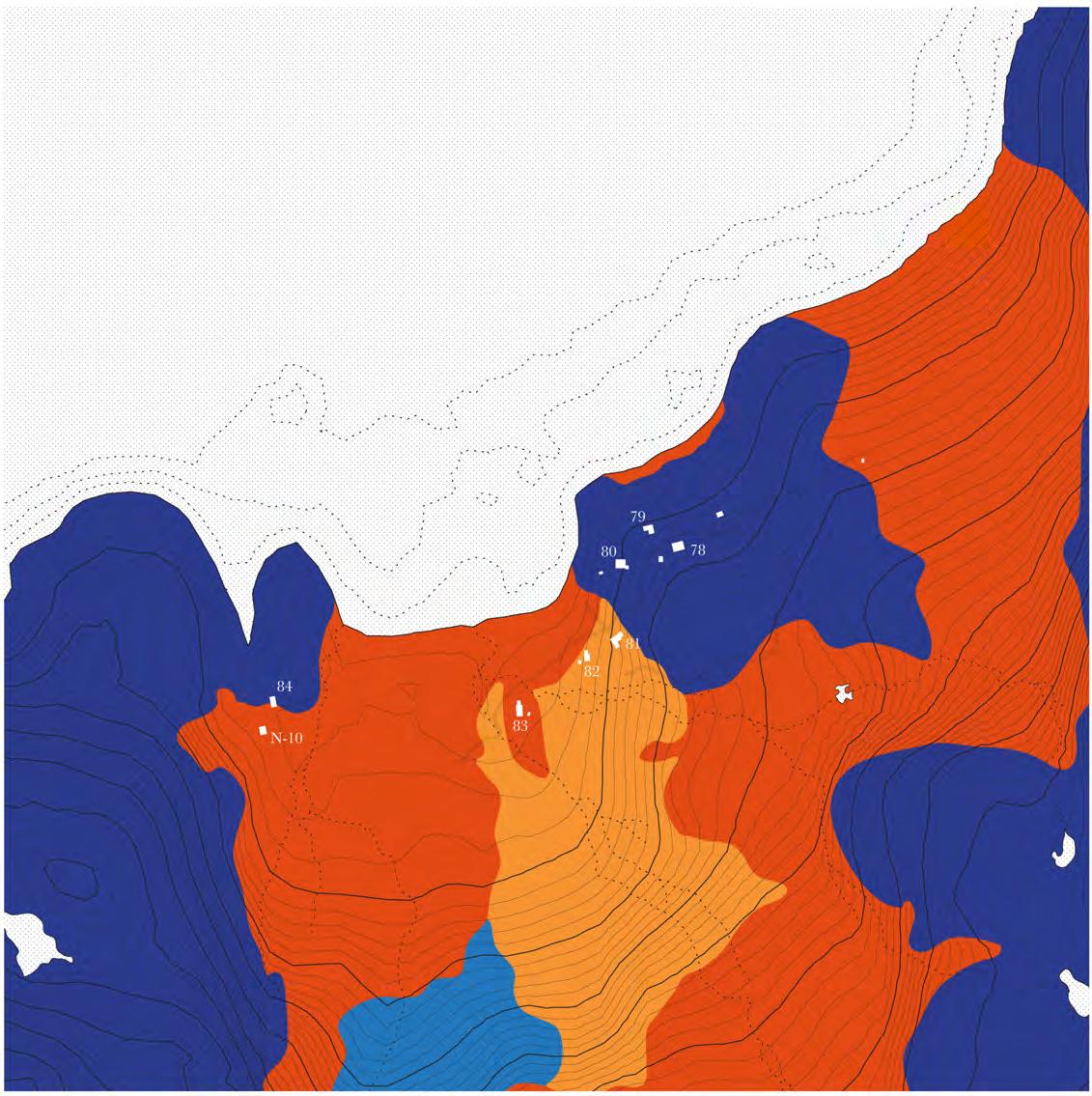
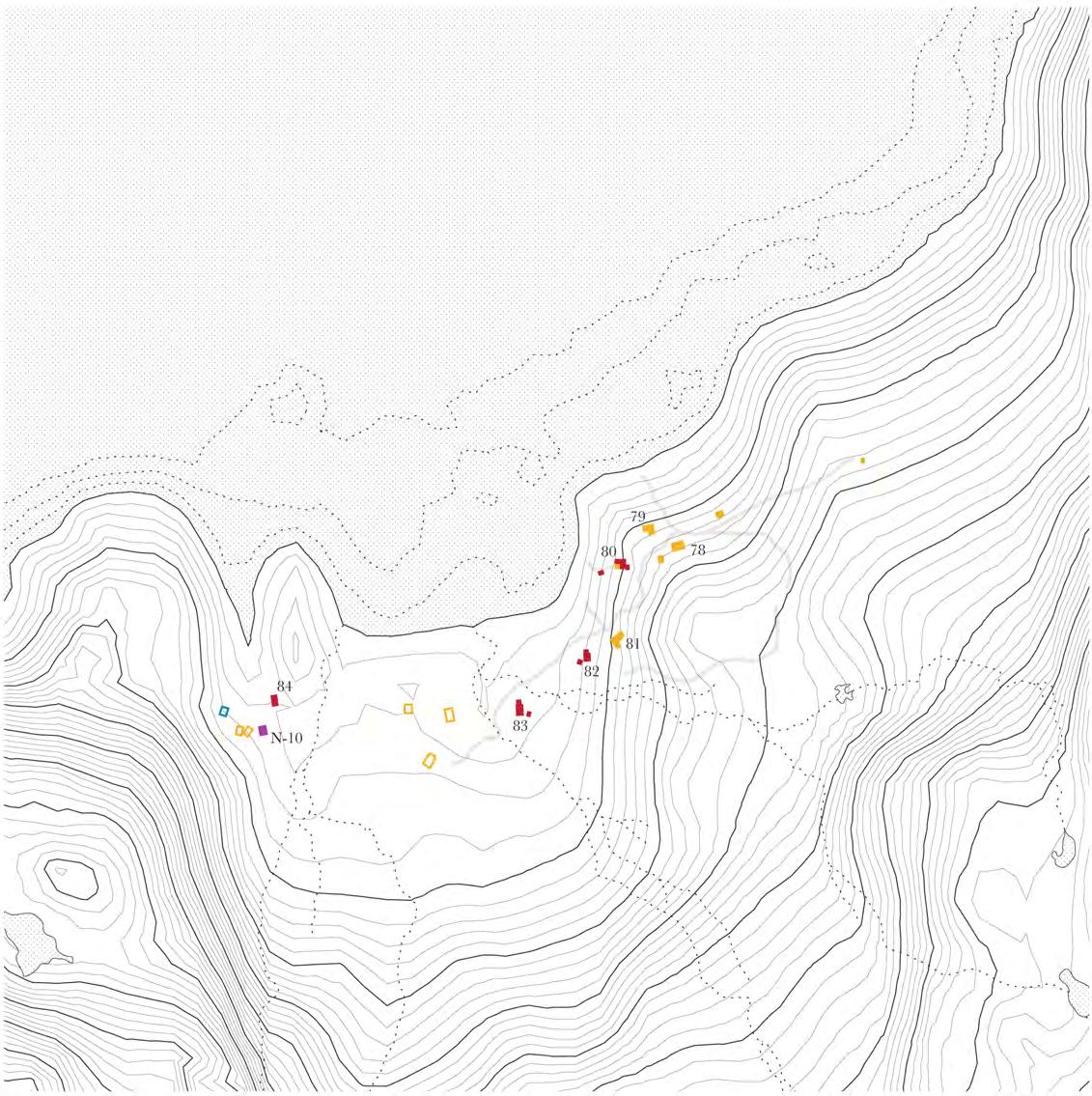
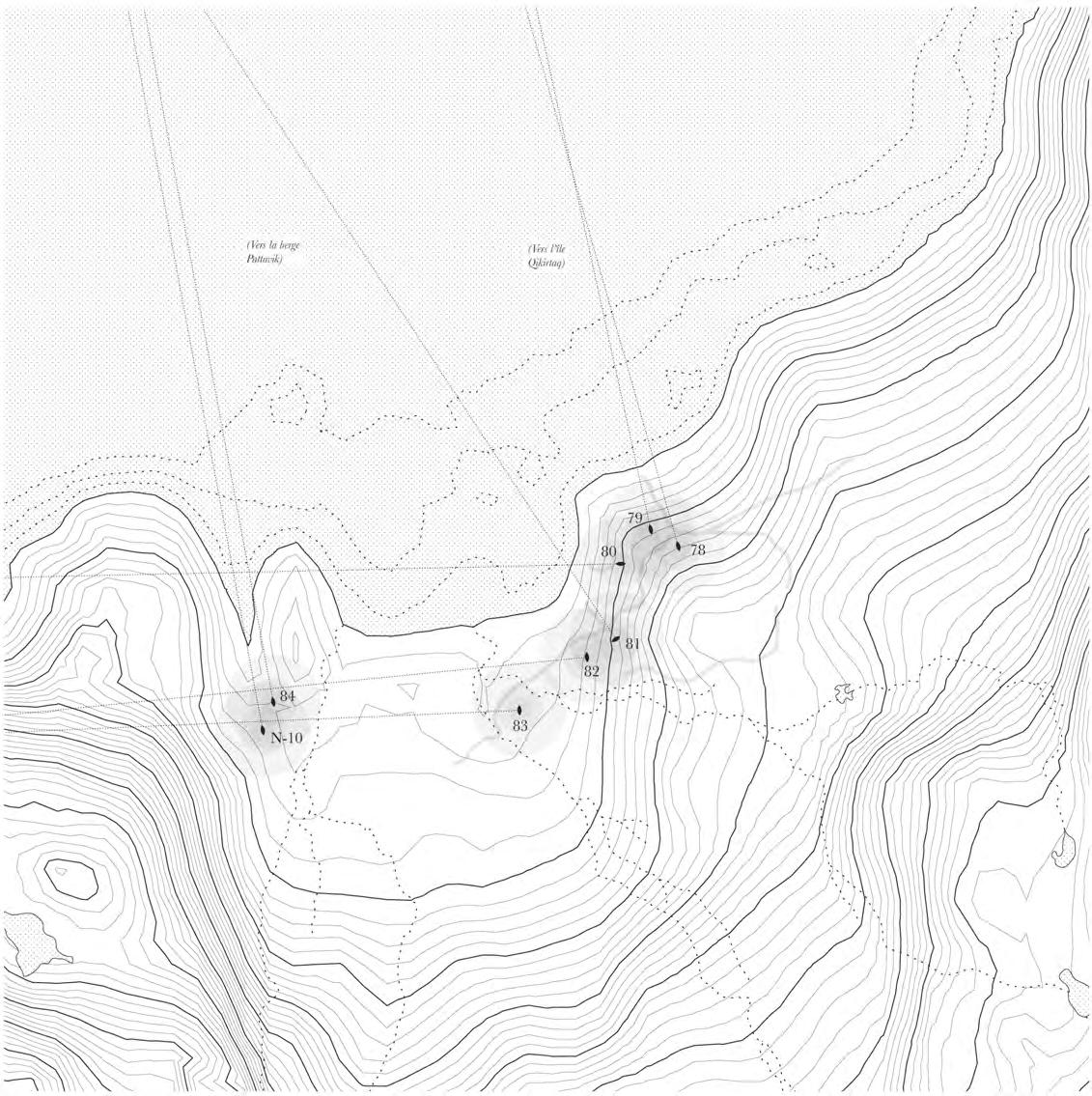
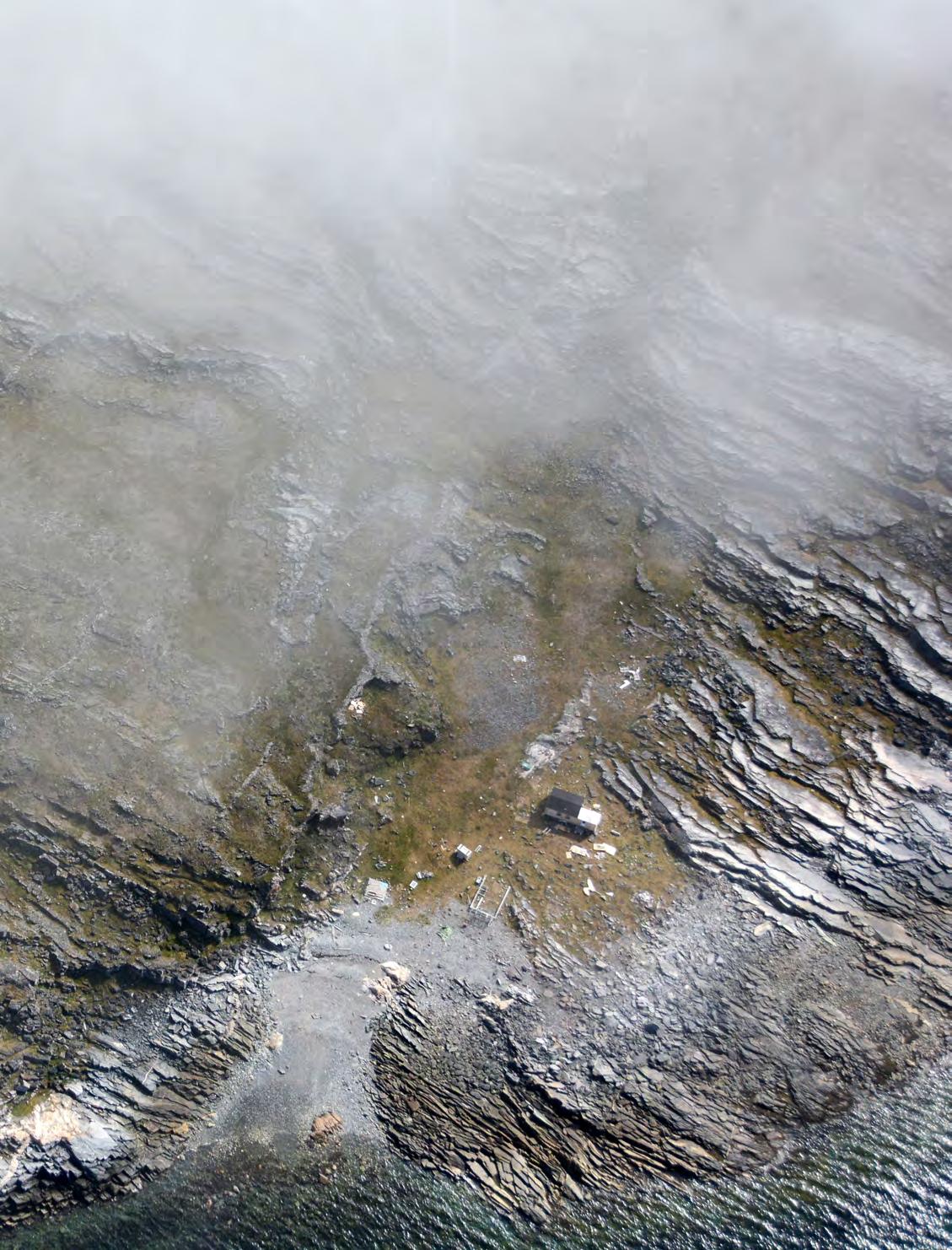 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015


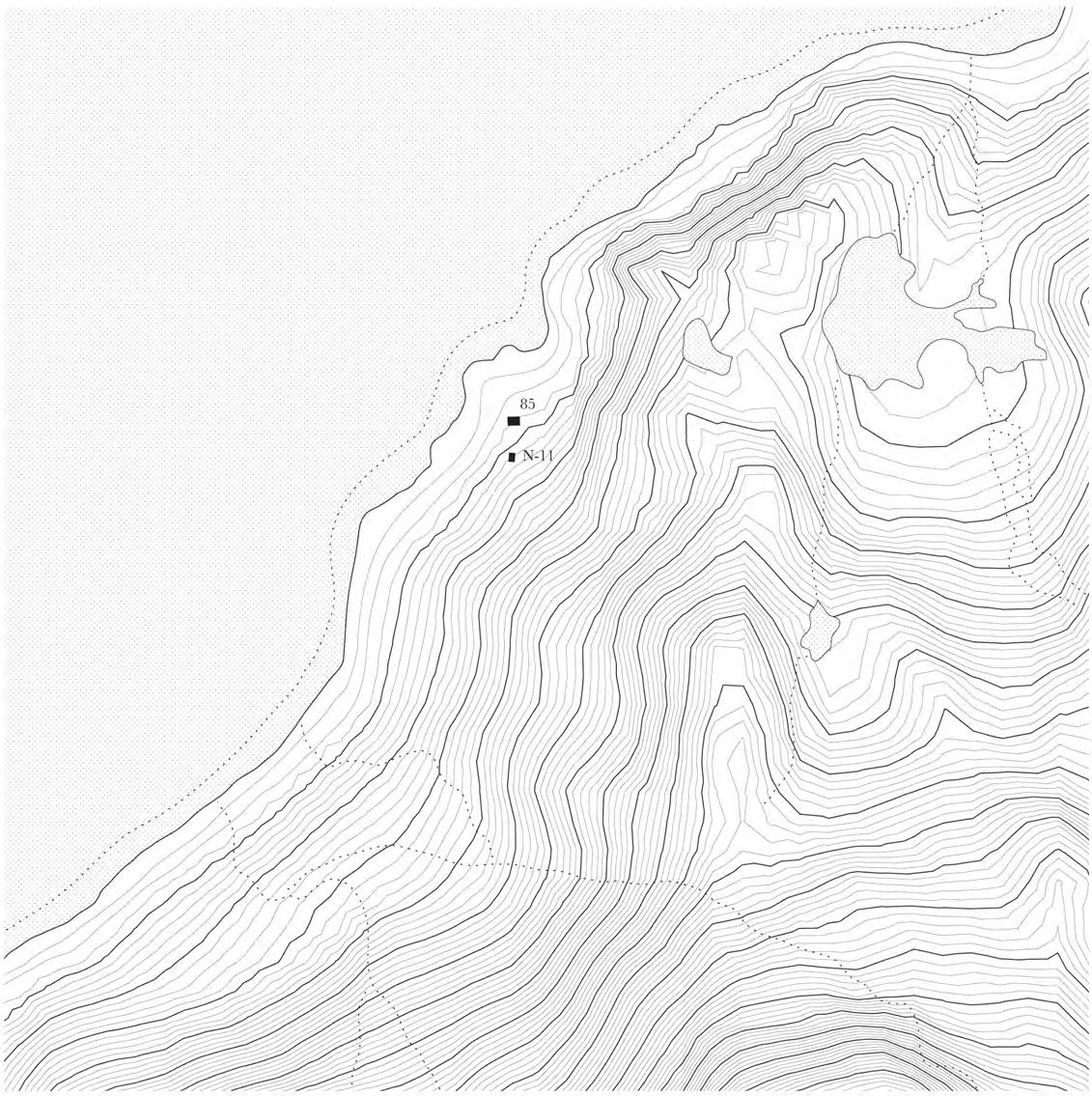



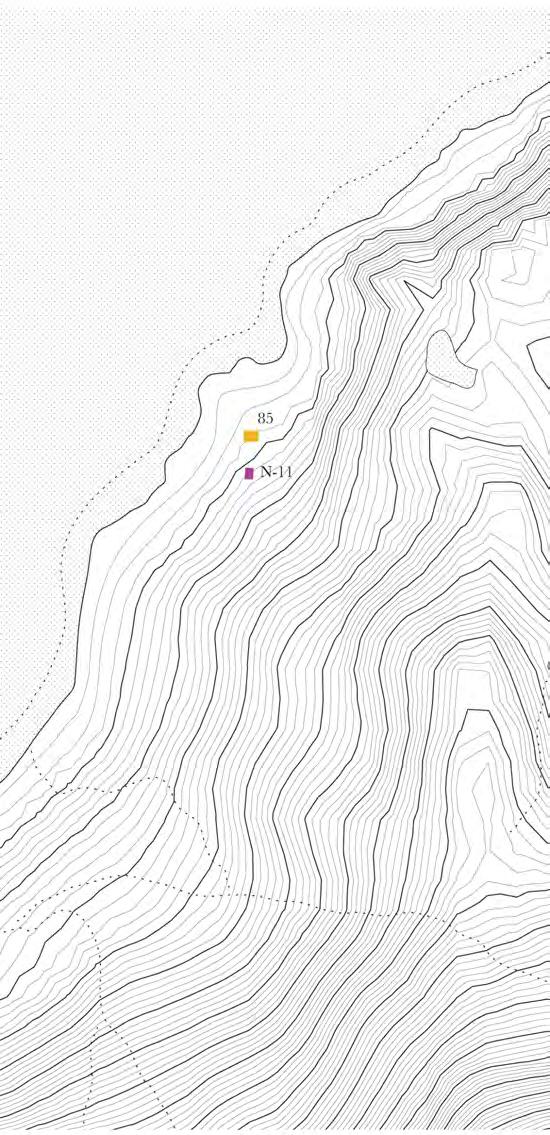
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015


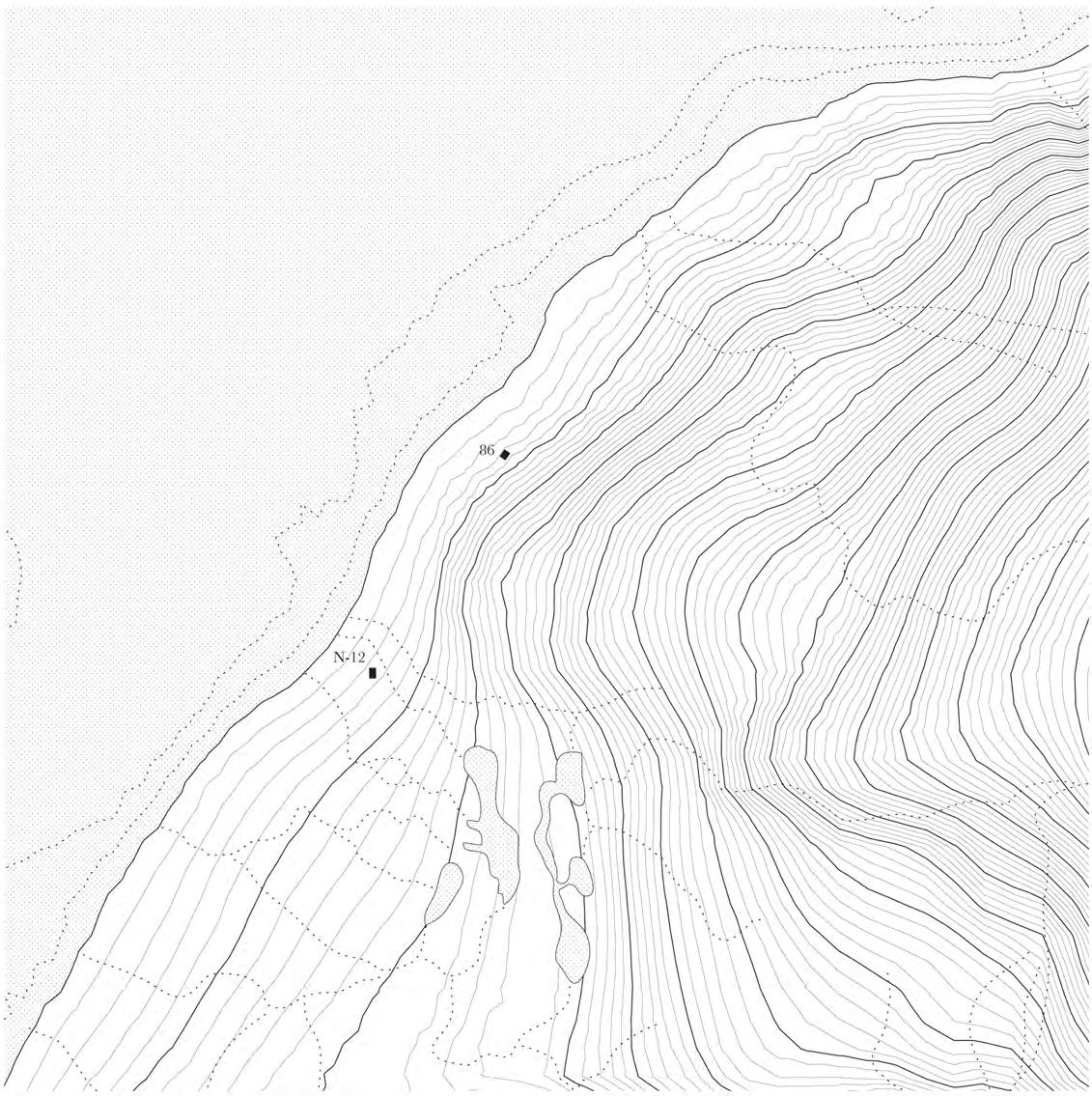
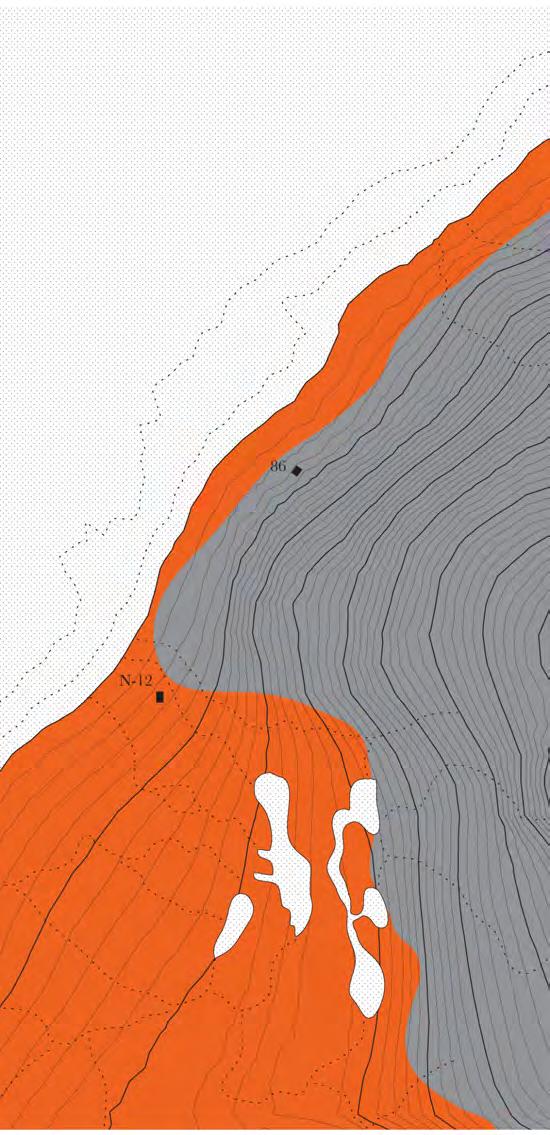
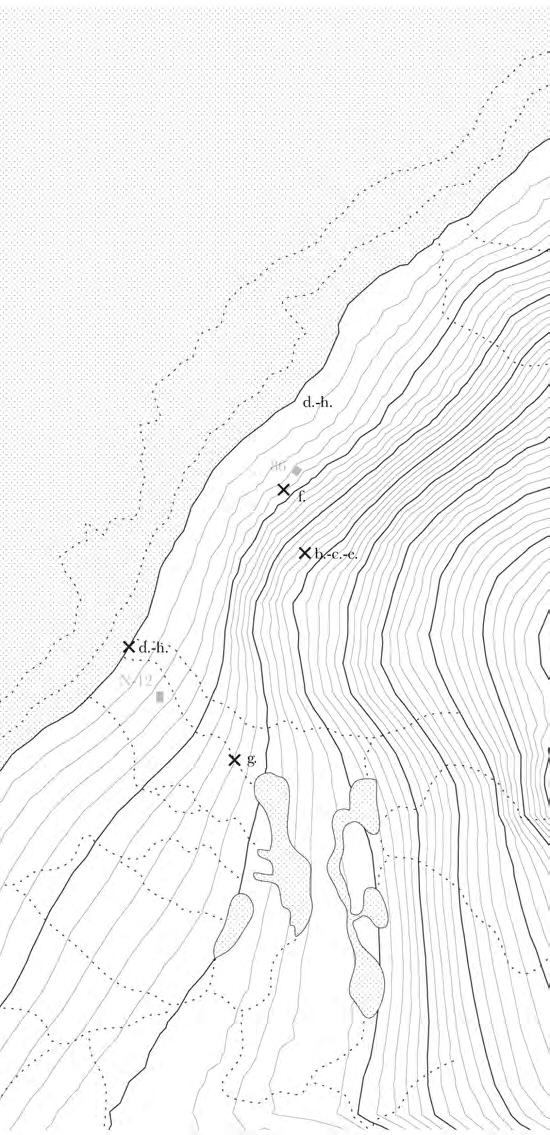 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage
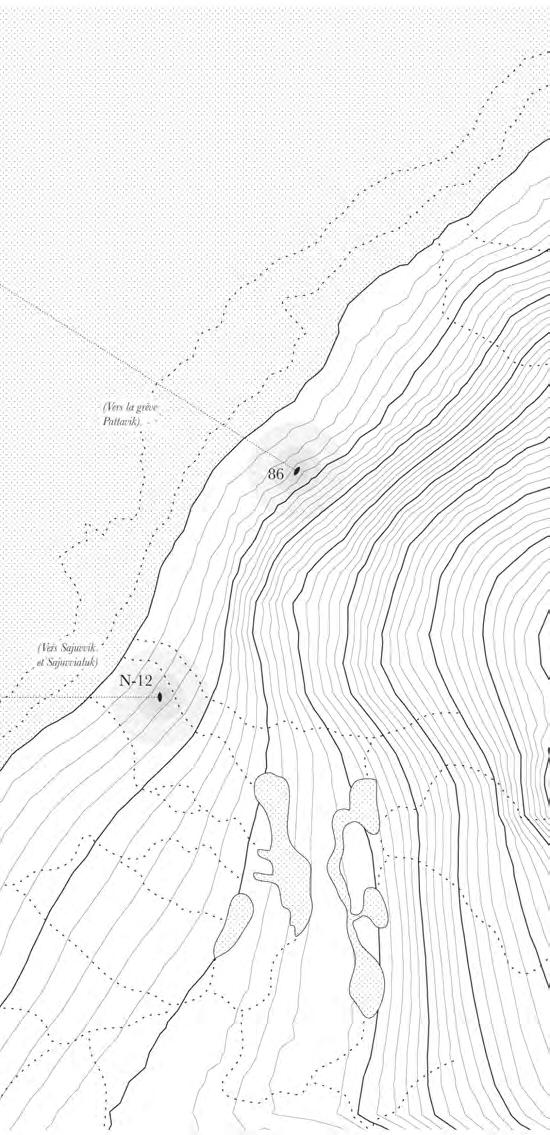
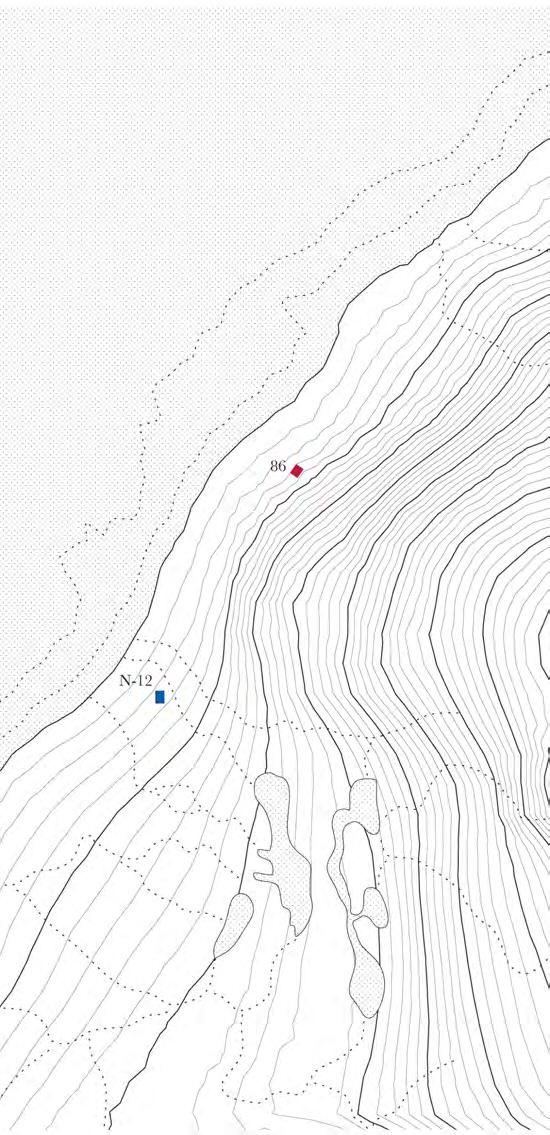
 Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015
Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015


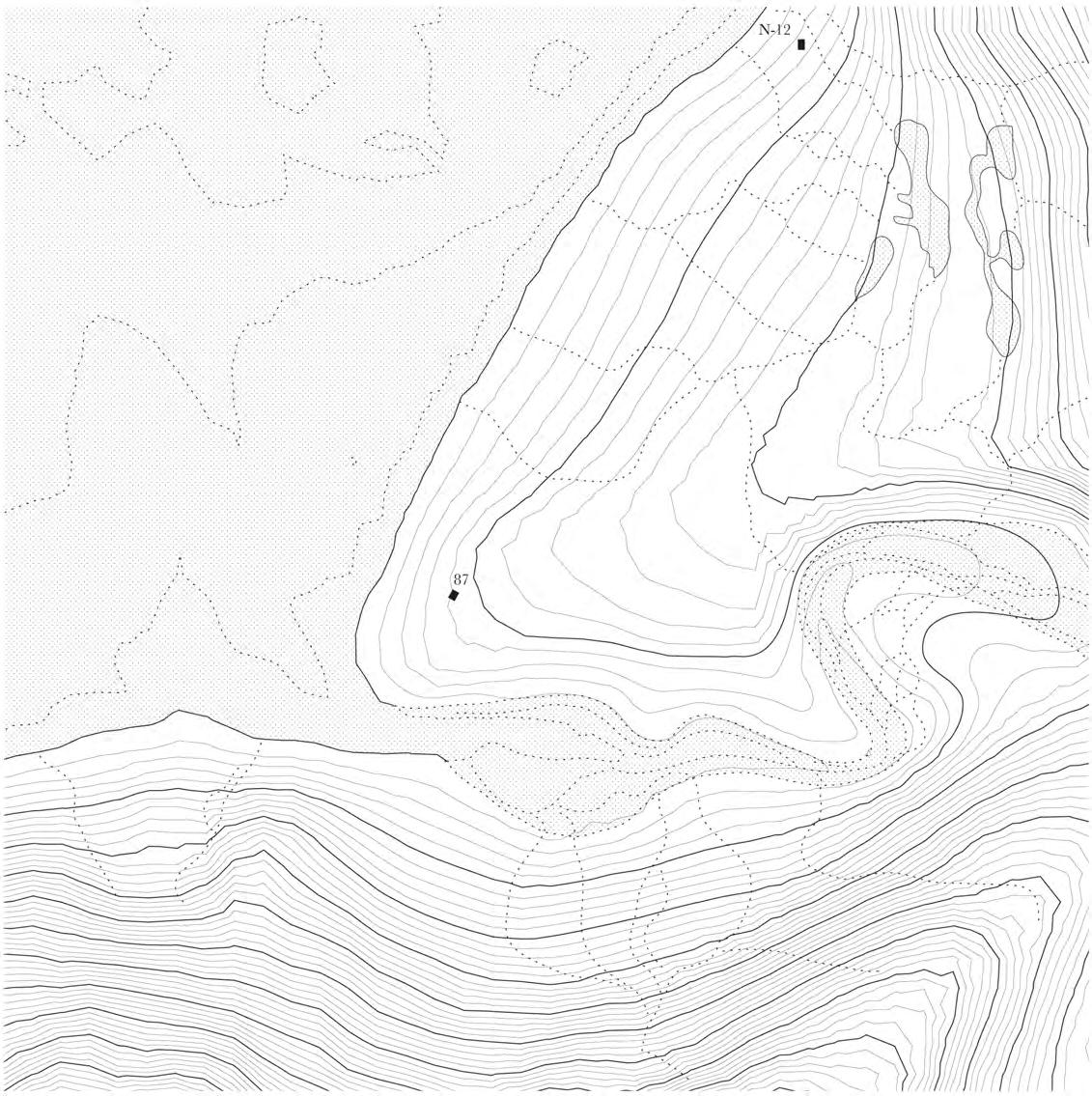 2.
2.

 4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse
4.
3.
a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation
e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce
b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse



 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
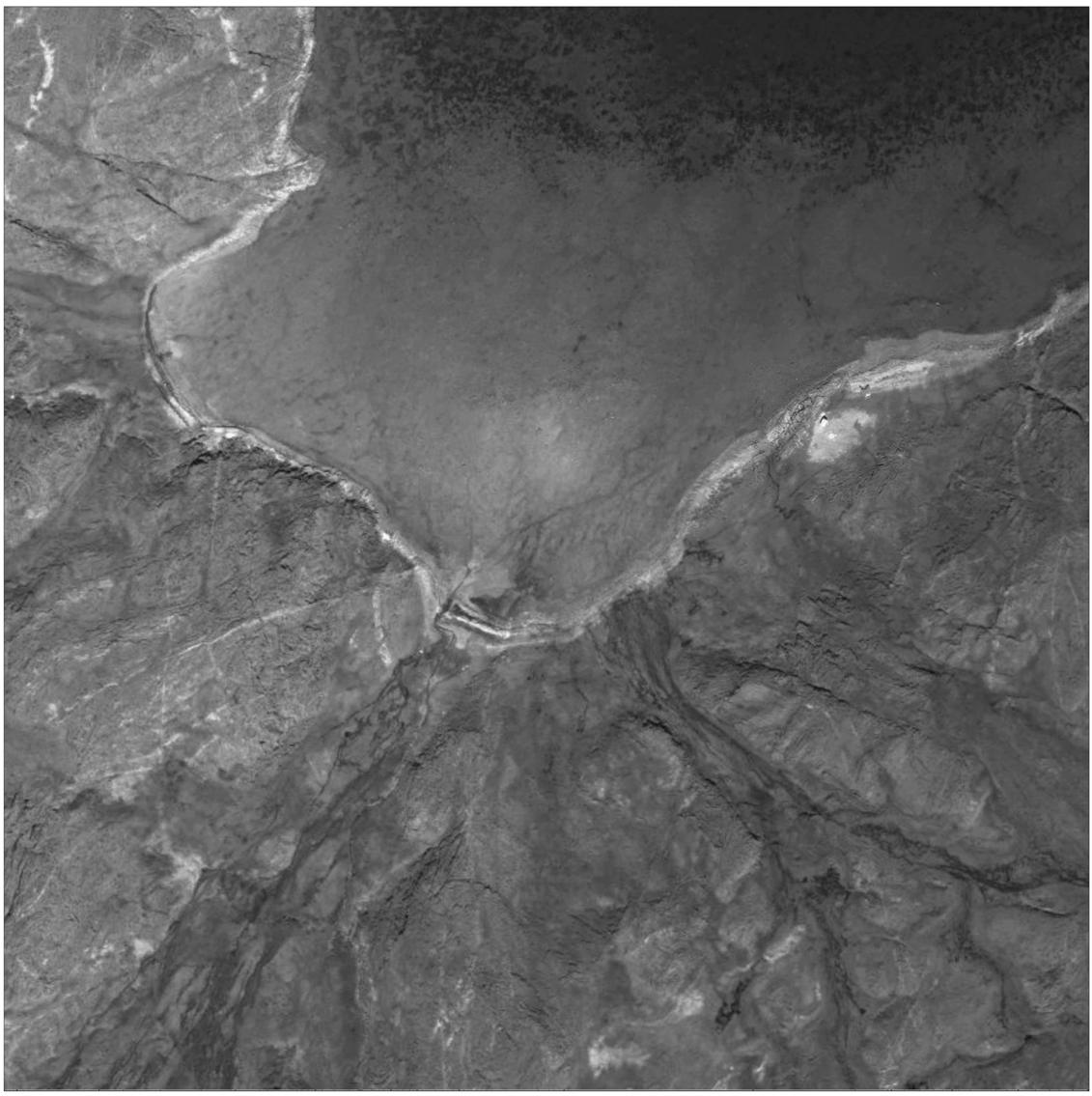
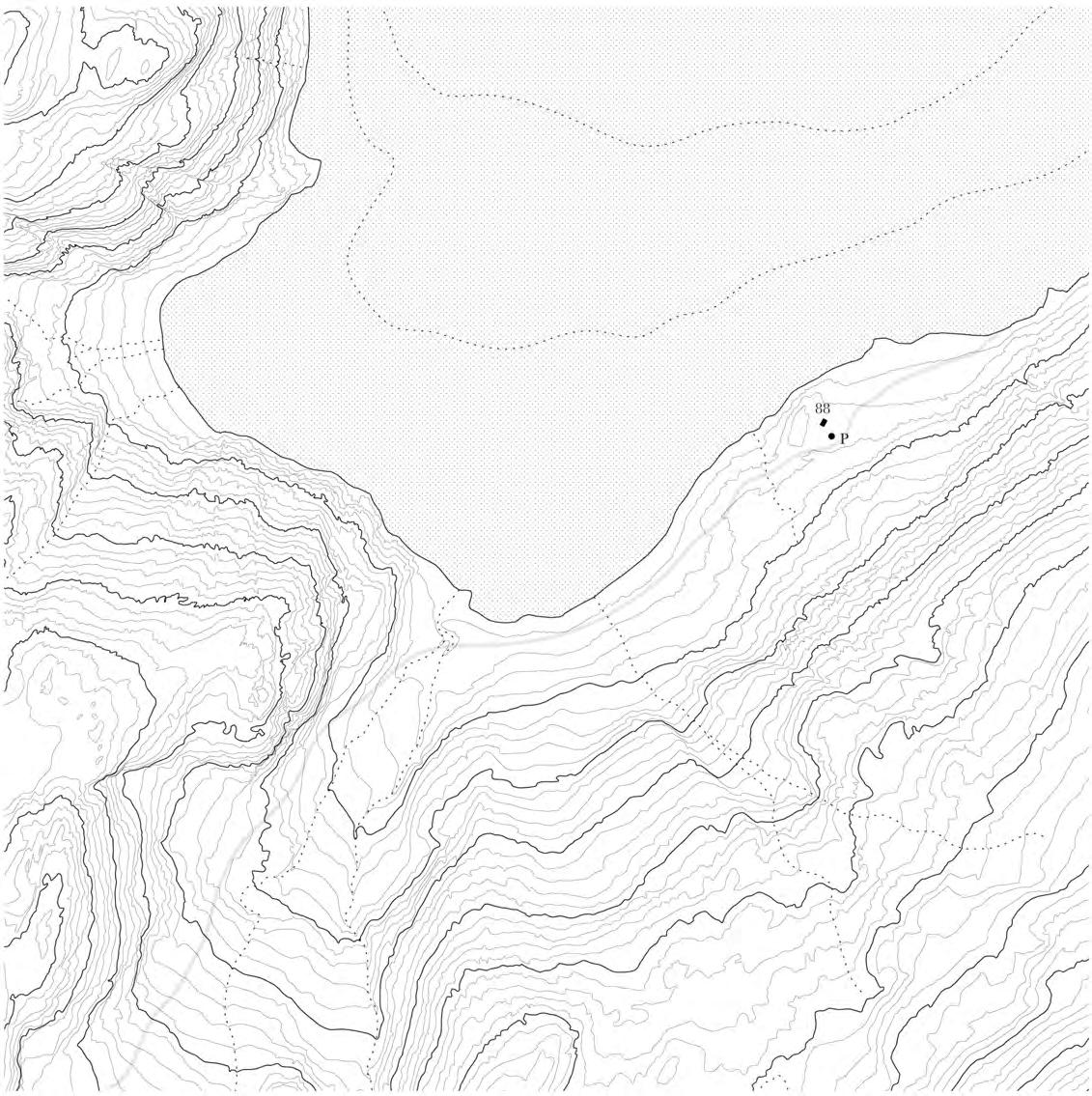
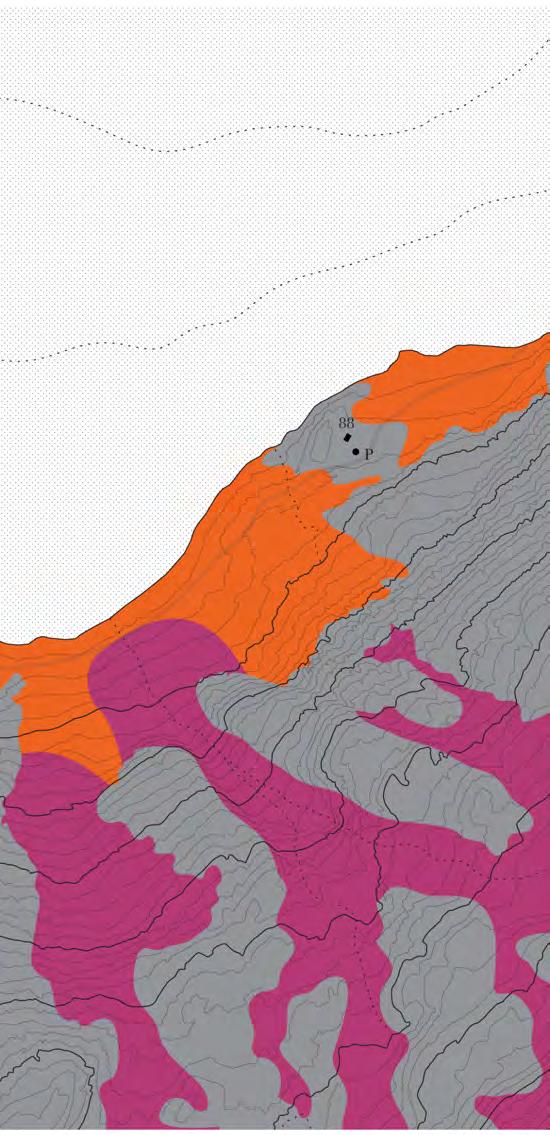
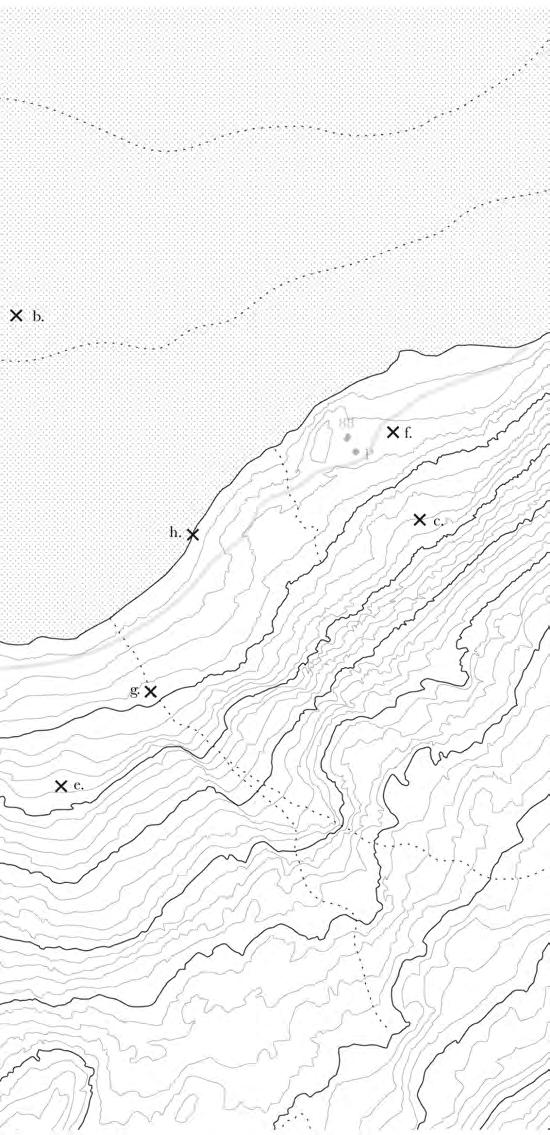
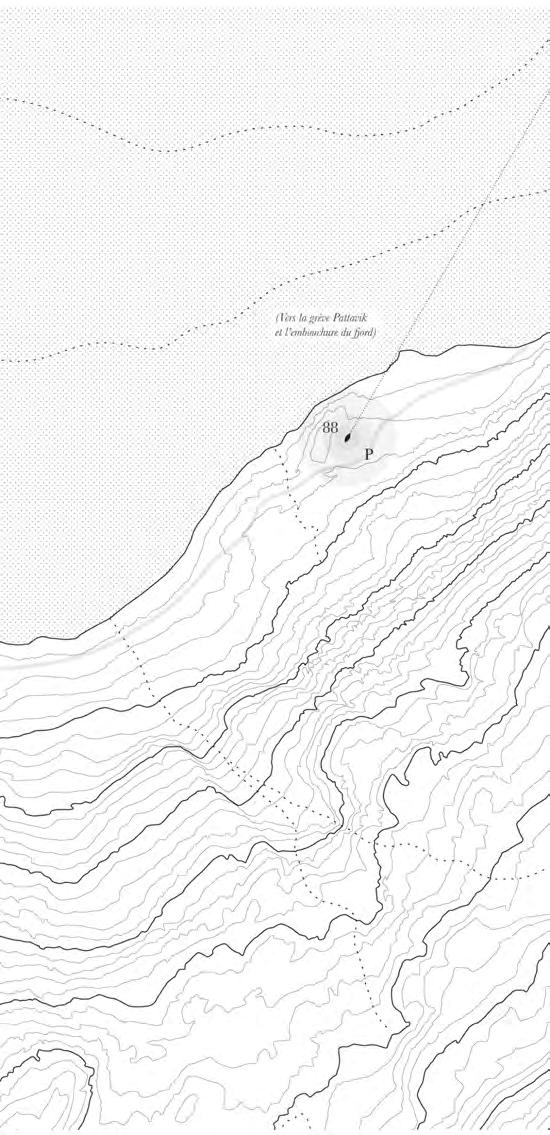




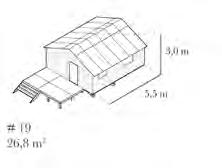
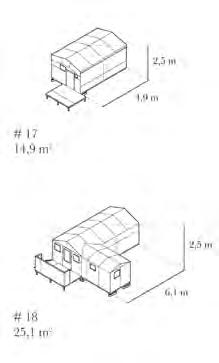
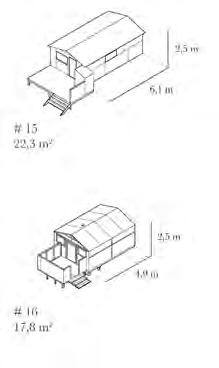
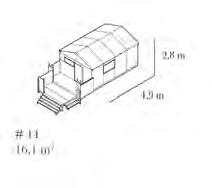
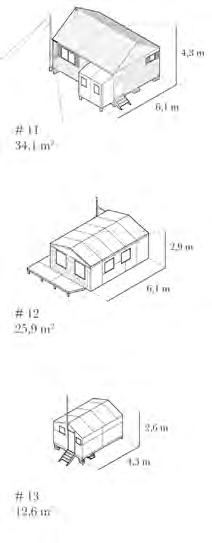
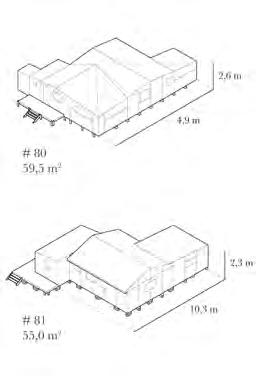
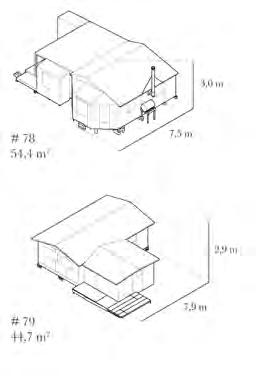
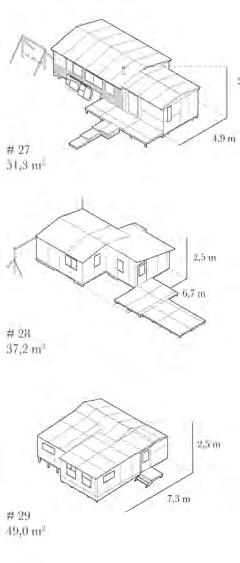
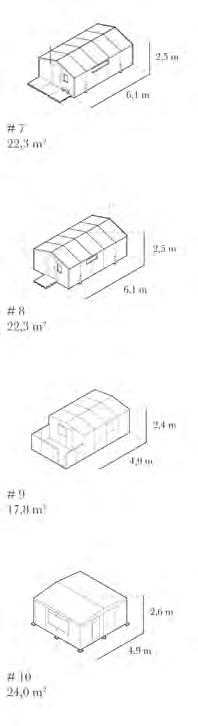
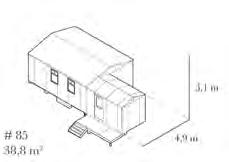
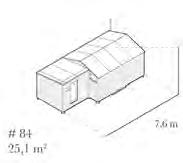
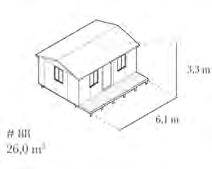
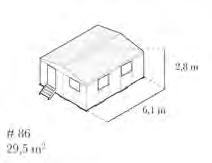
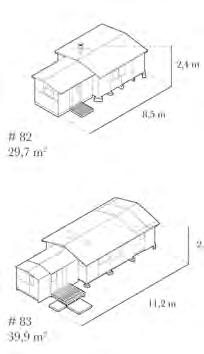
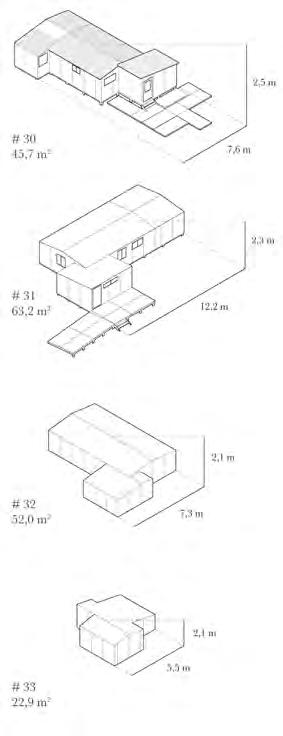 Figure 6. Exemples de quelques dessins volumétriques des cabanes du fjord de Salluit.
Figure 6. Exemples de quelques dessins volumétriques des cabanes du fjord de Salluit.
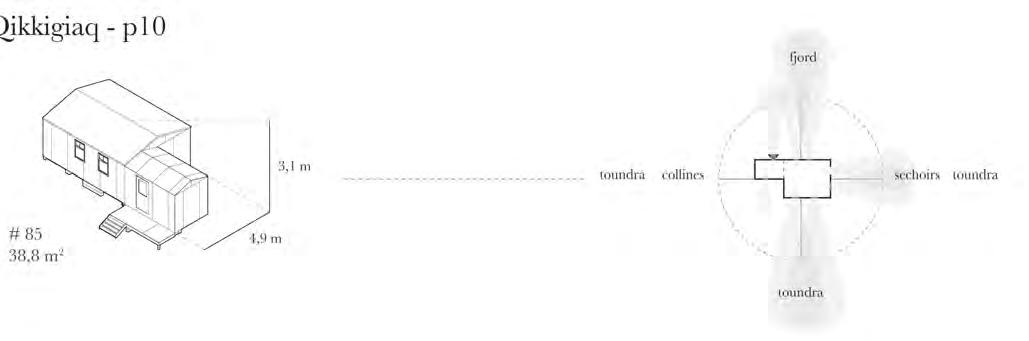
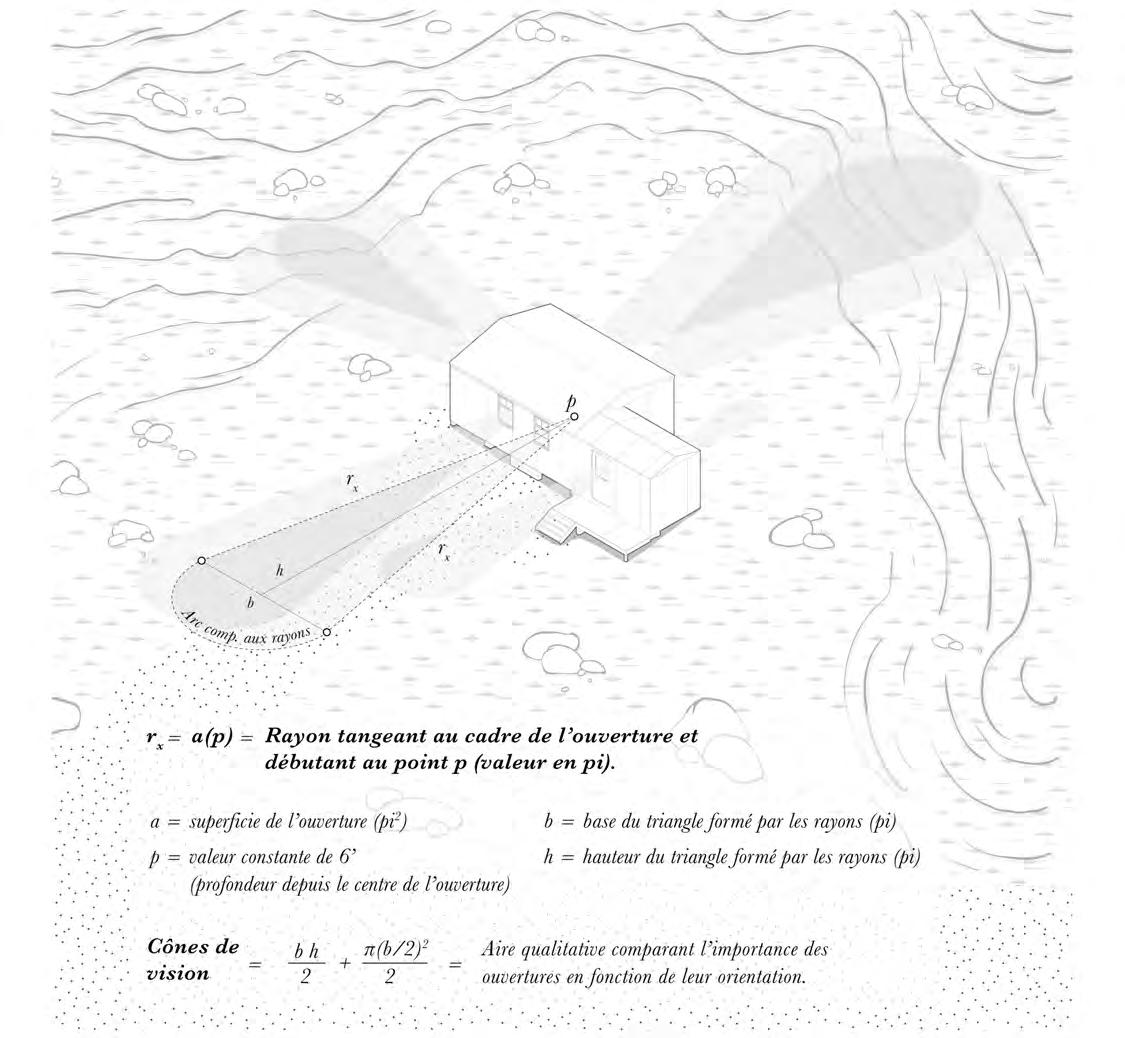 Figure . xemple exprimant les c nes de ision de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 7. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer l’importance et l’orientation des cônes de vision des cabanes.
278
Figure . xemple exprimant les c nes de ision de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 7. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer l’importance et l’orientation des cônes de vision des cabanes.
278
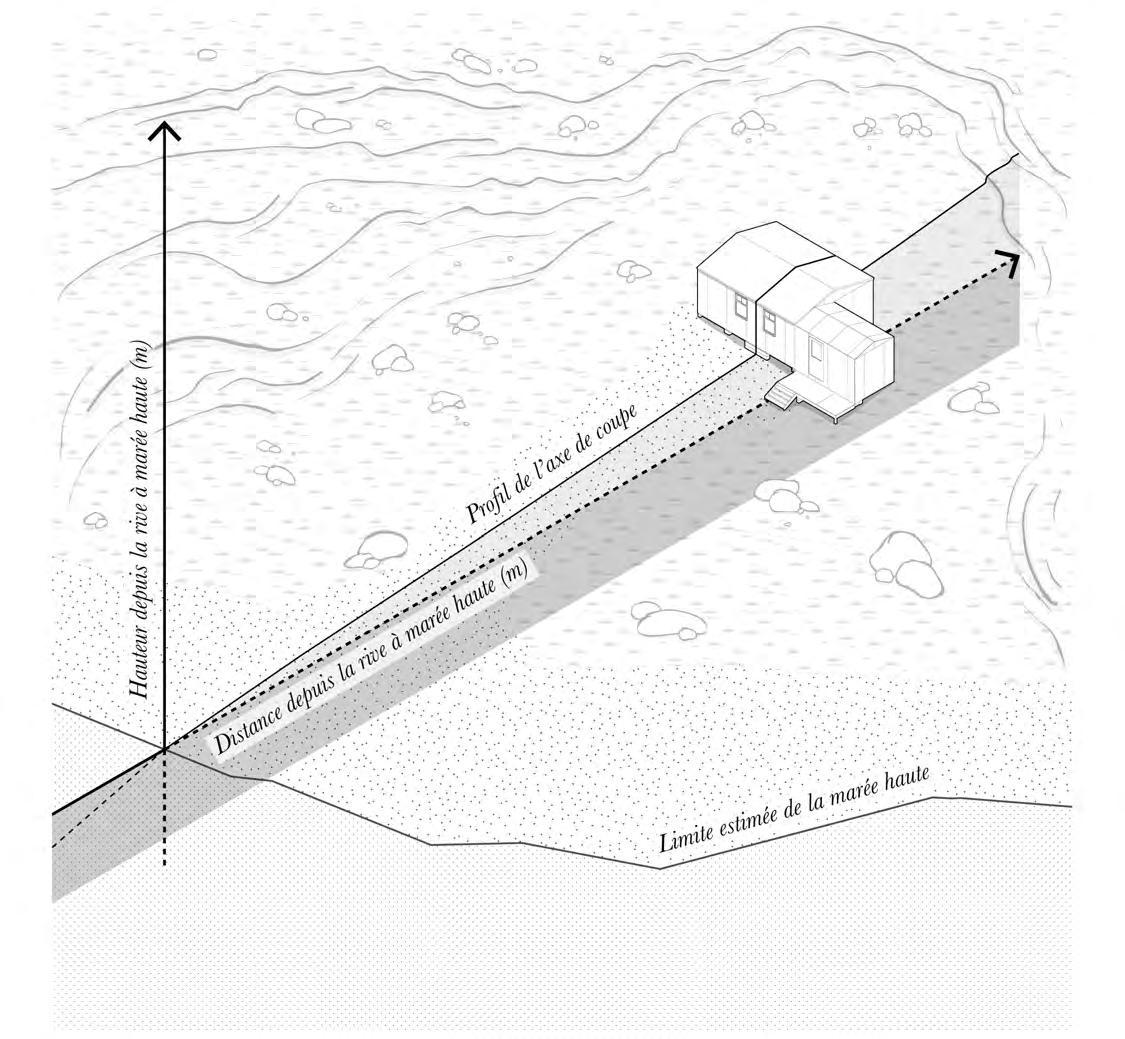
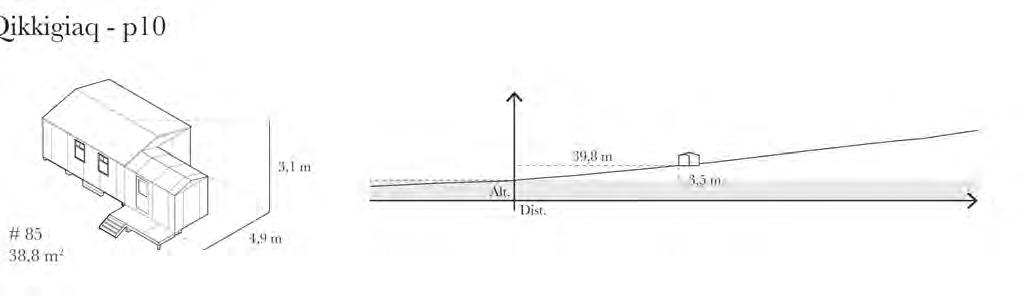 Figure 10. xemple exprimant le profl altimétrique de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 9. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer la position des cabanes.
y x
Annexe 1 - page 279
Figure 10. xemple exprimant le profl altimétrique de la cabane exemple de la fgure précédente .
Figure 9. Schéma expliquant la méthode employée pour exprimer la position des cabanes.
y x
Annexe 1 - page 279
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
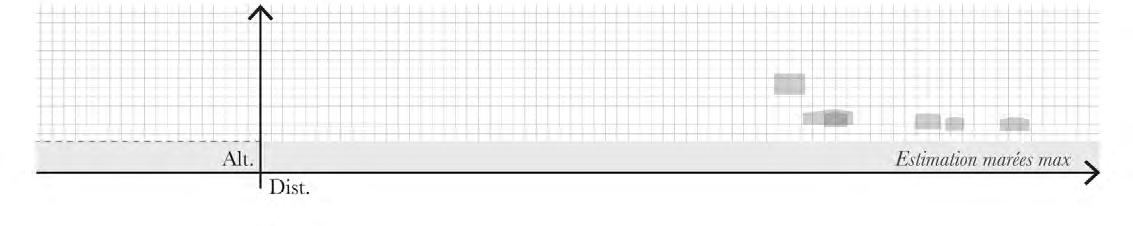
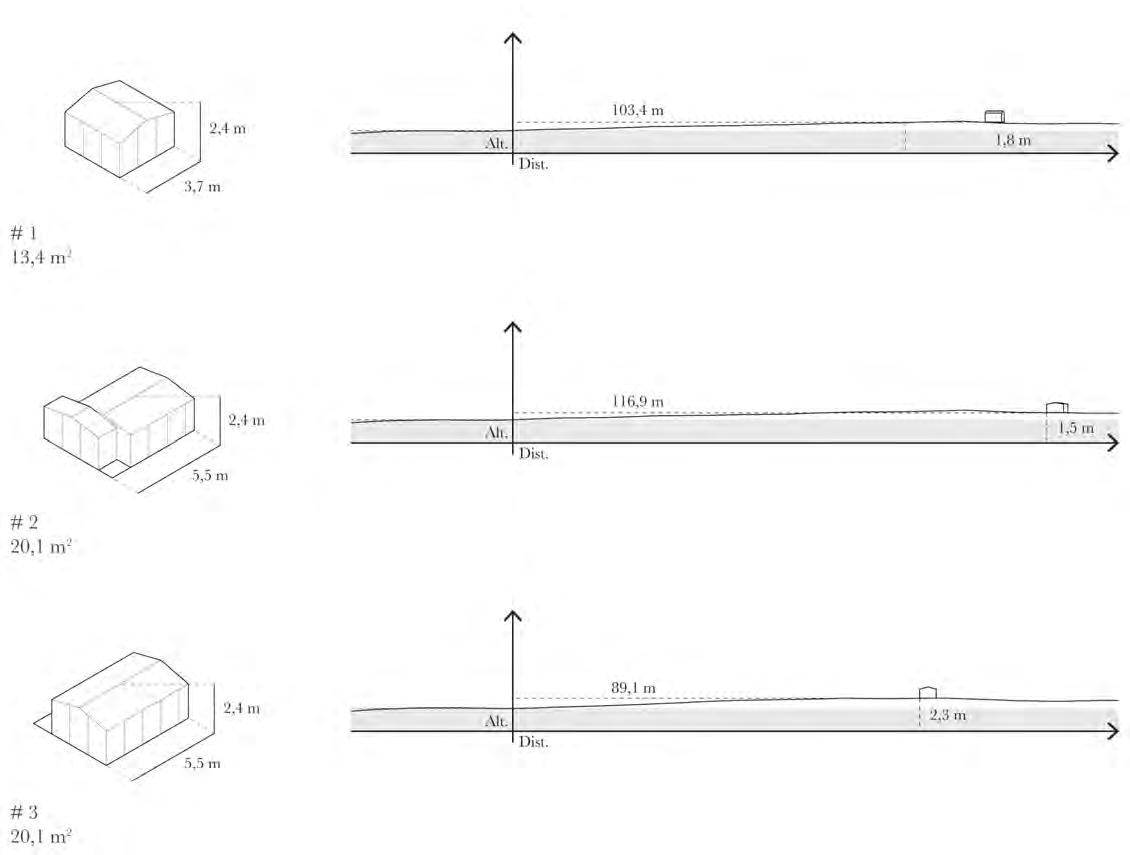
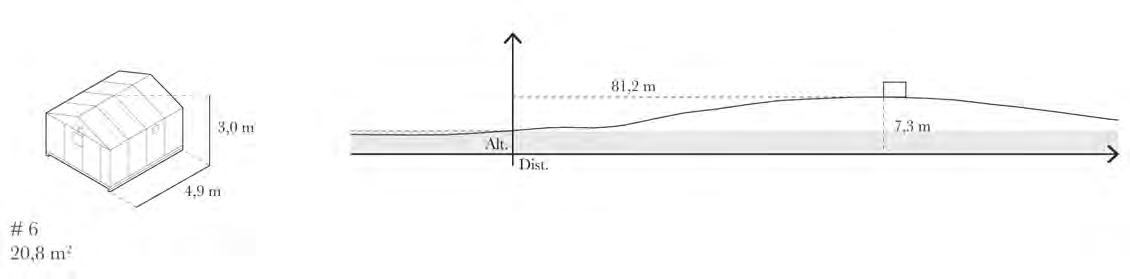
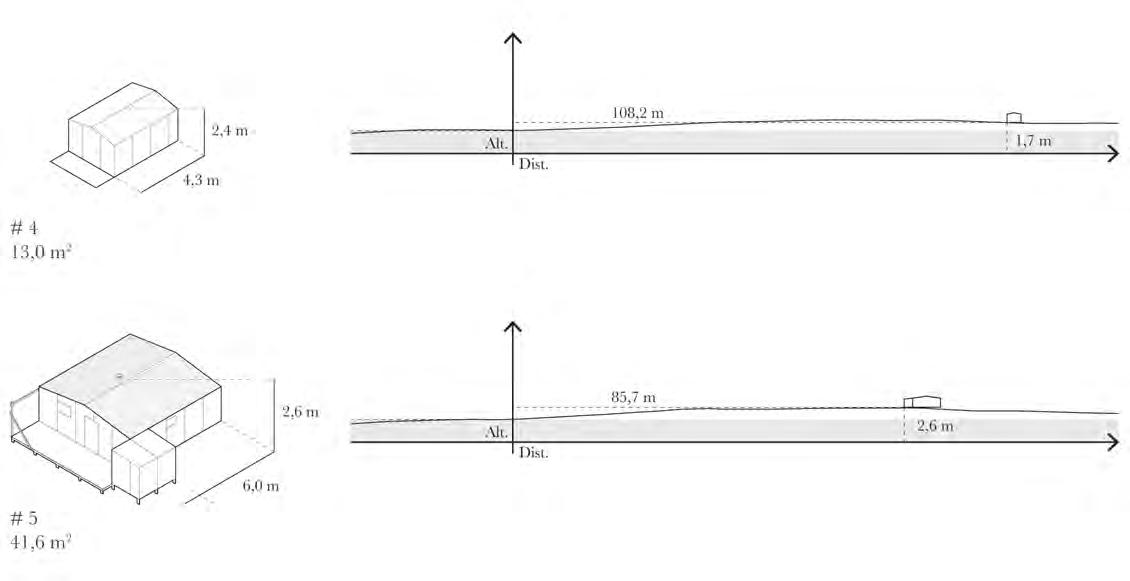
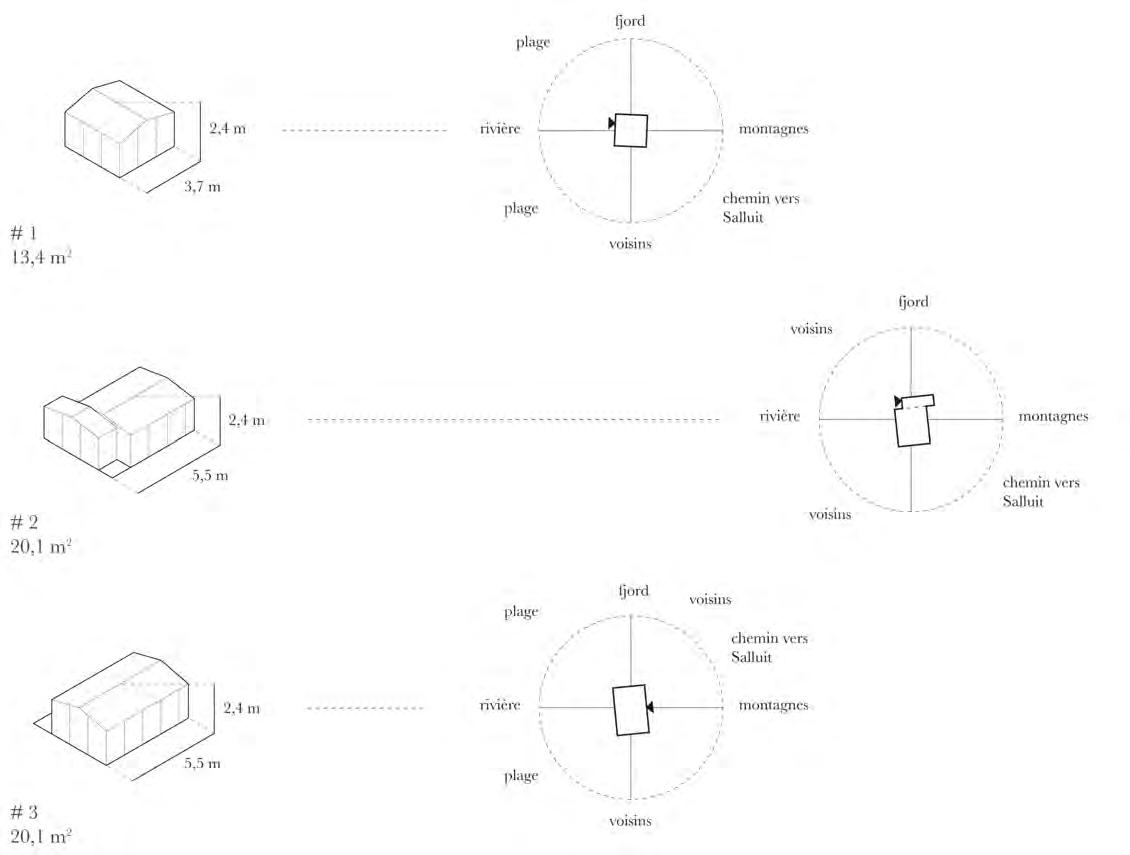
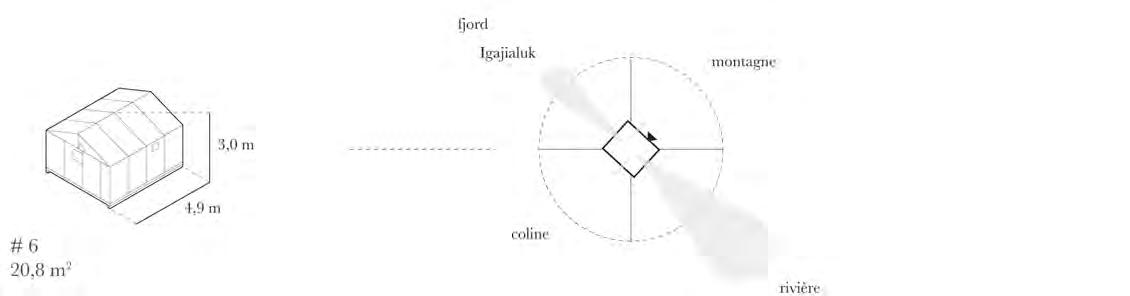
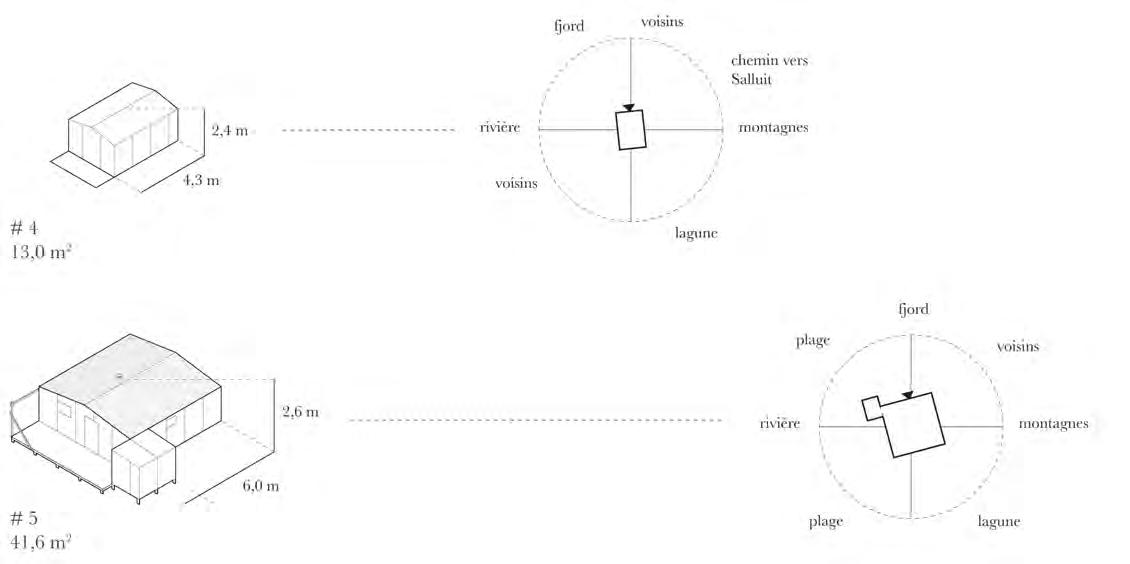
 Demeule, août 2018
Demeule, août 2018
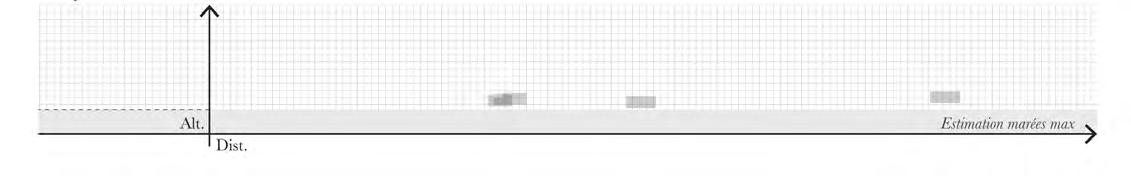
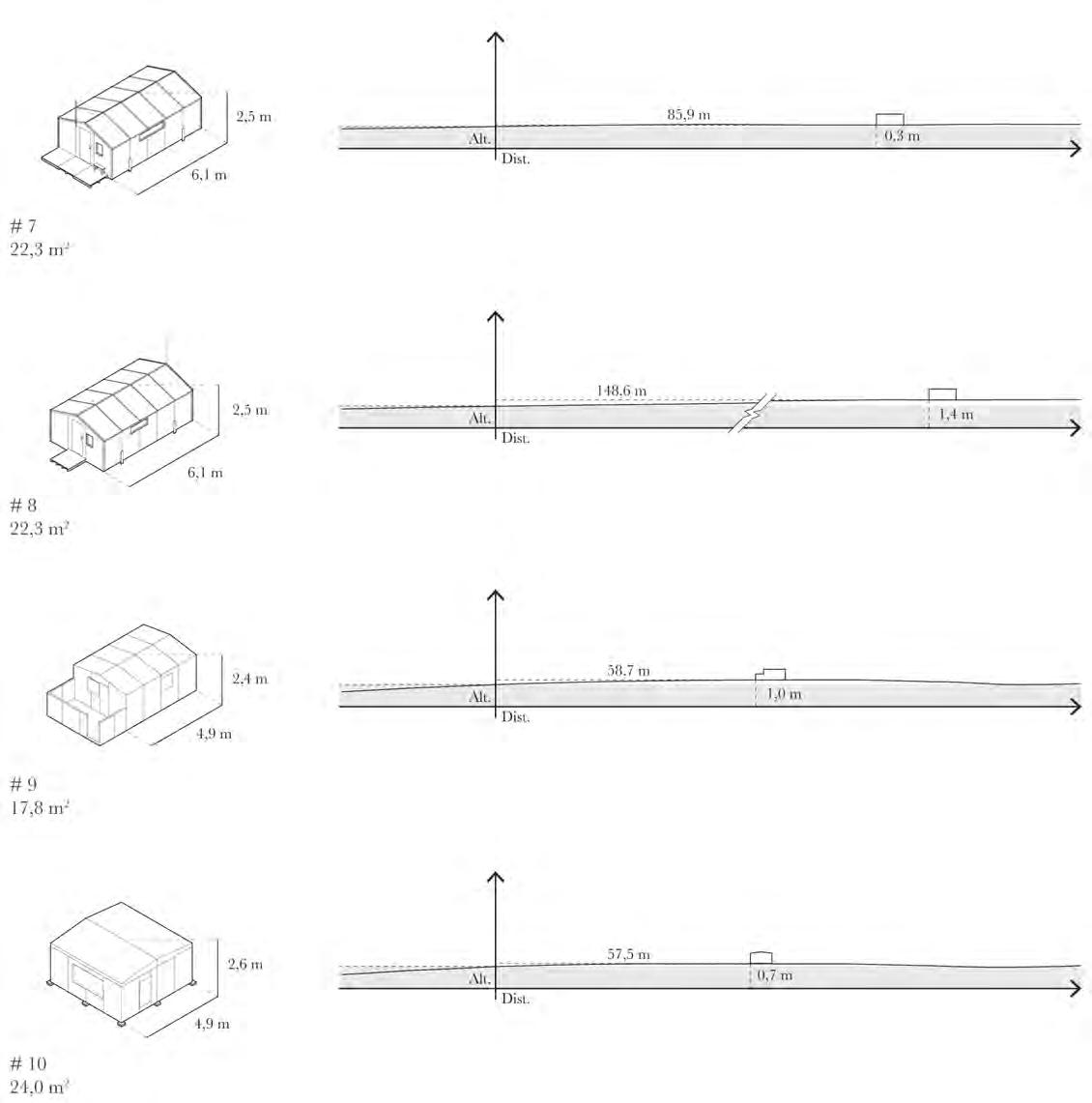
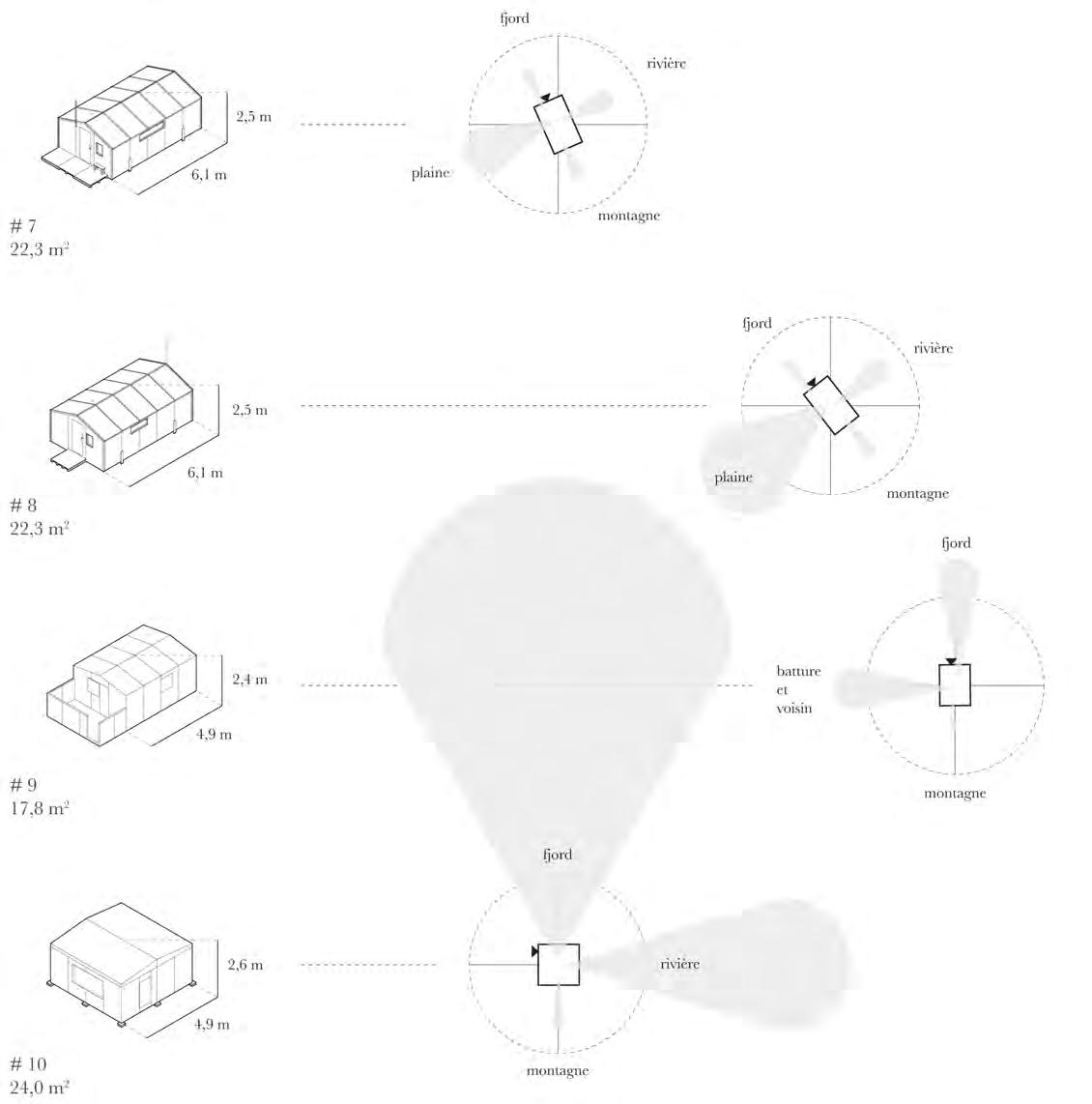

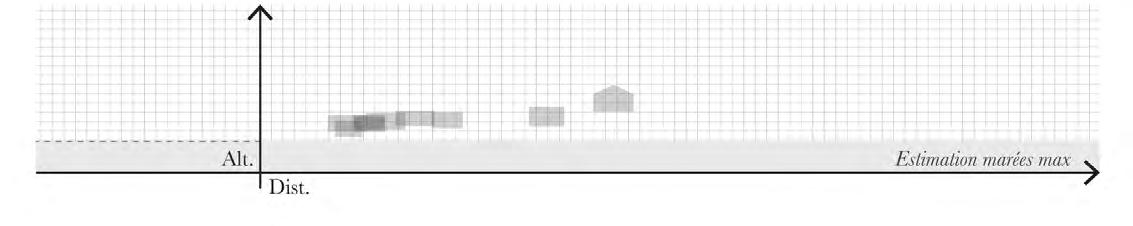
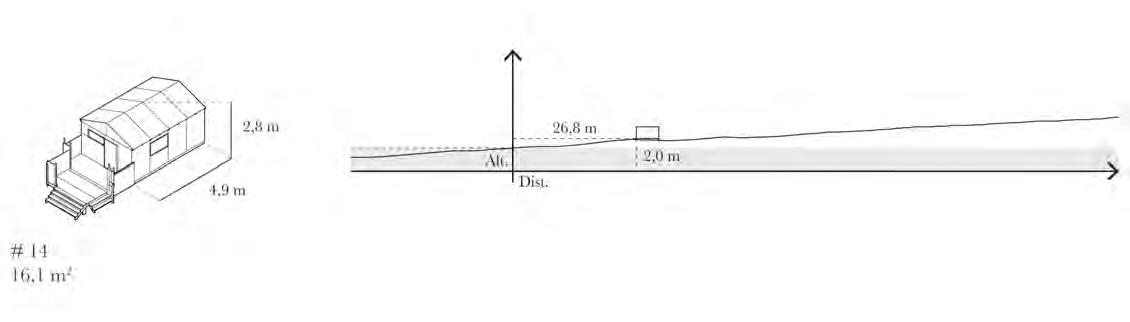
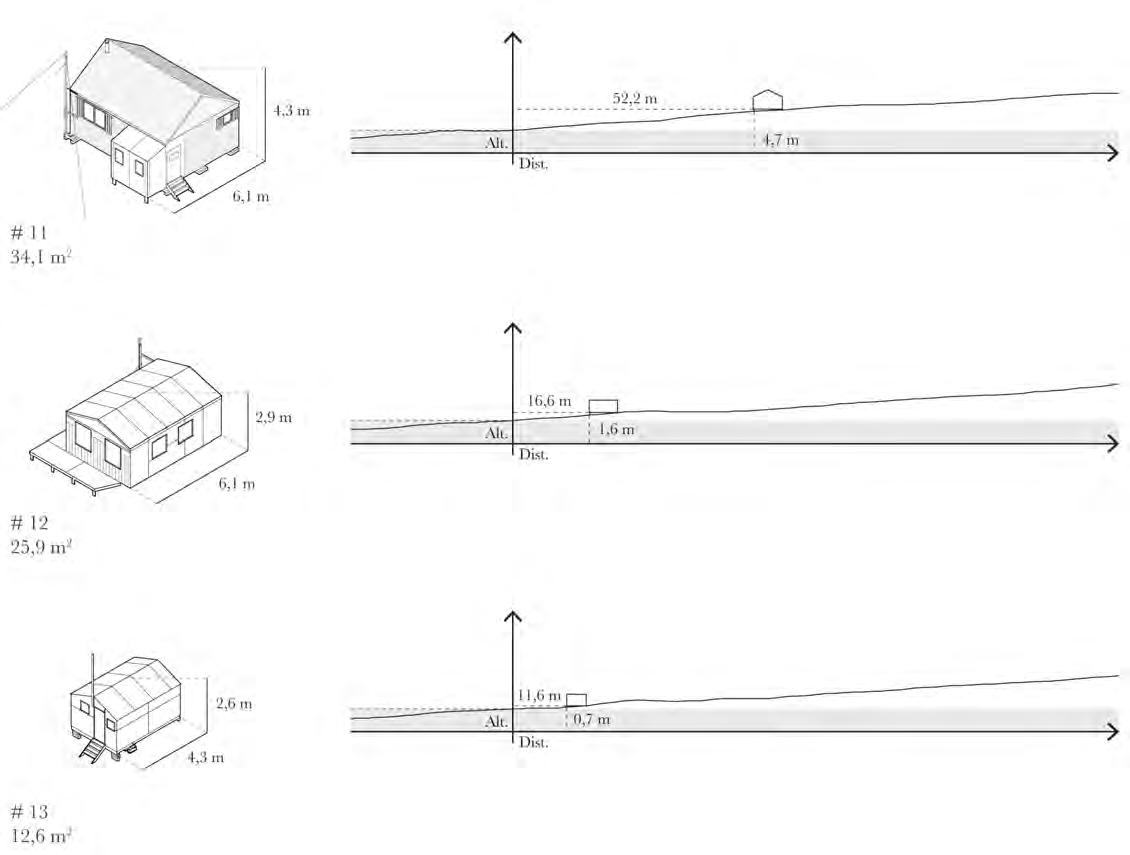
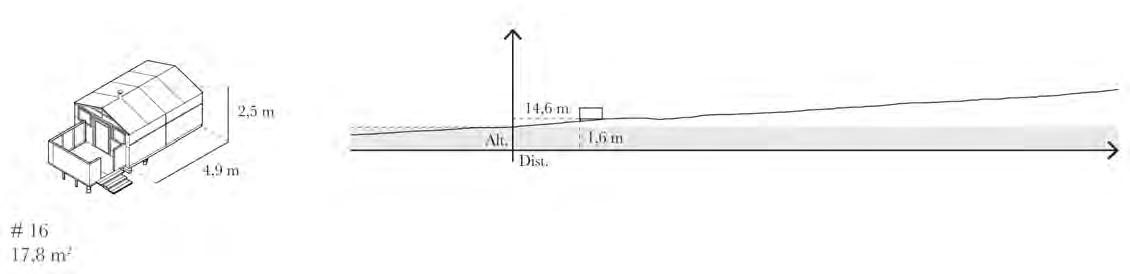
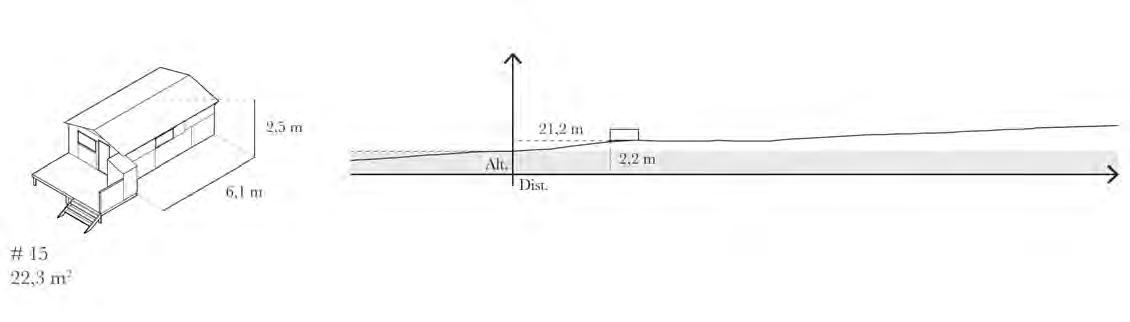
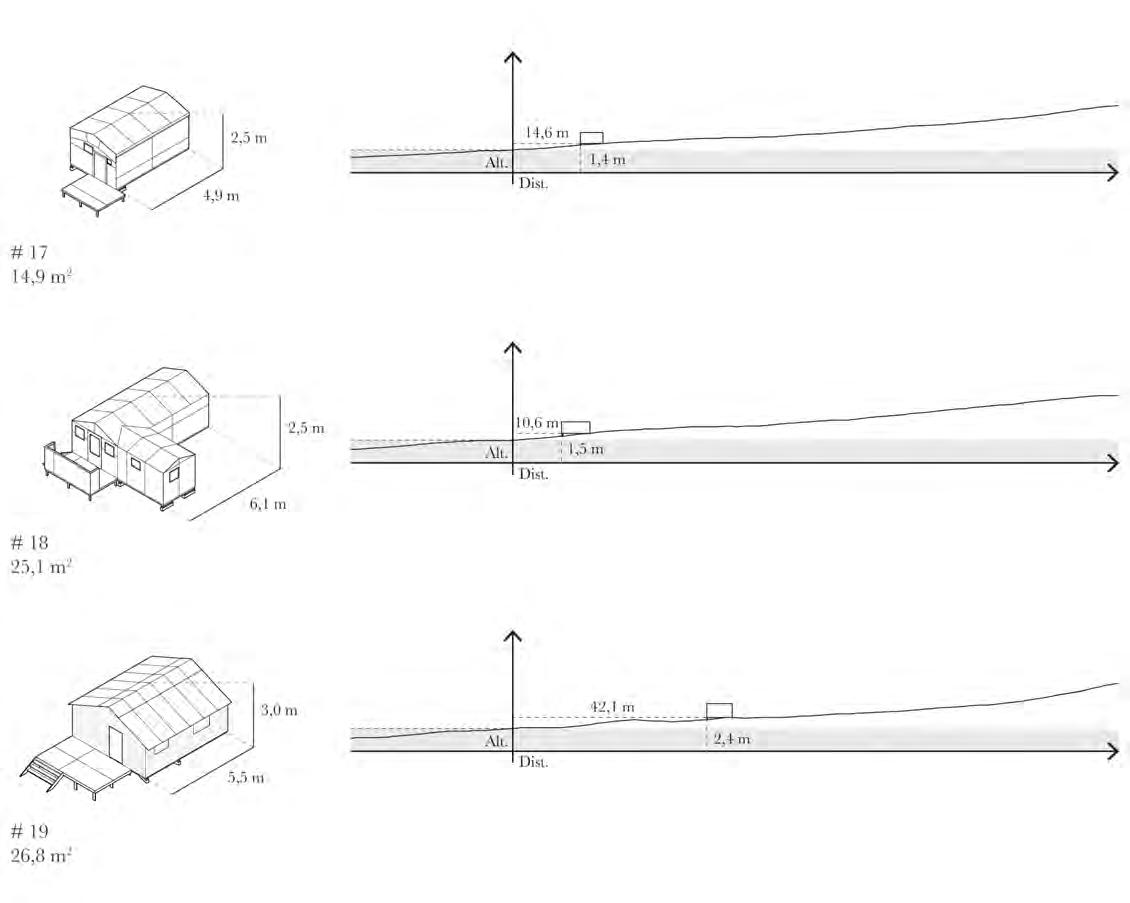
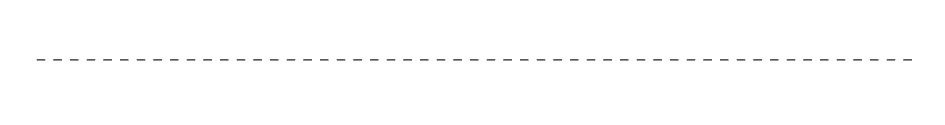
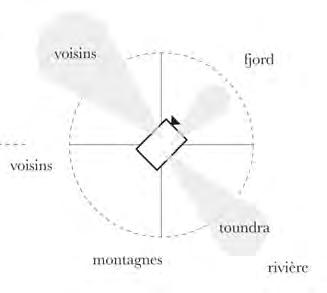
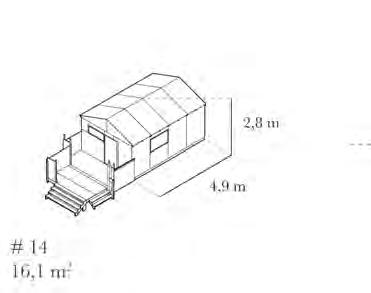
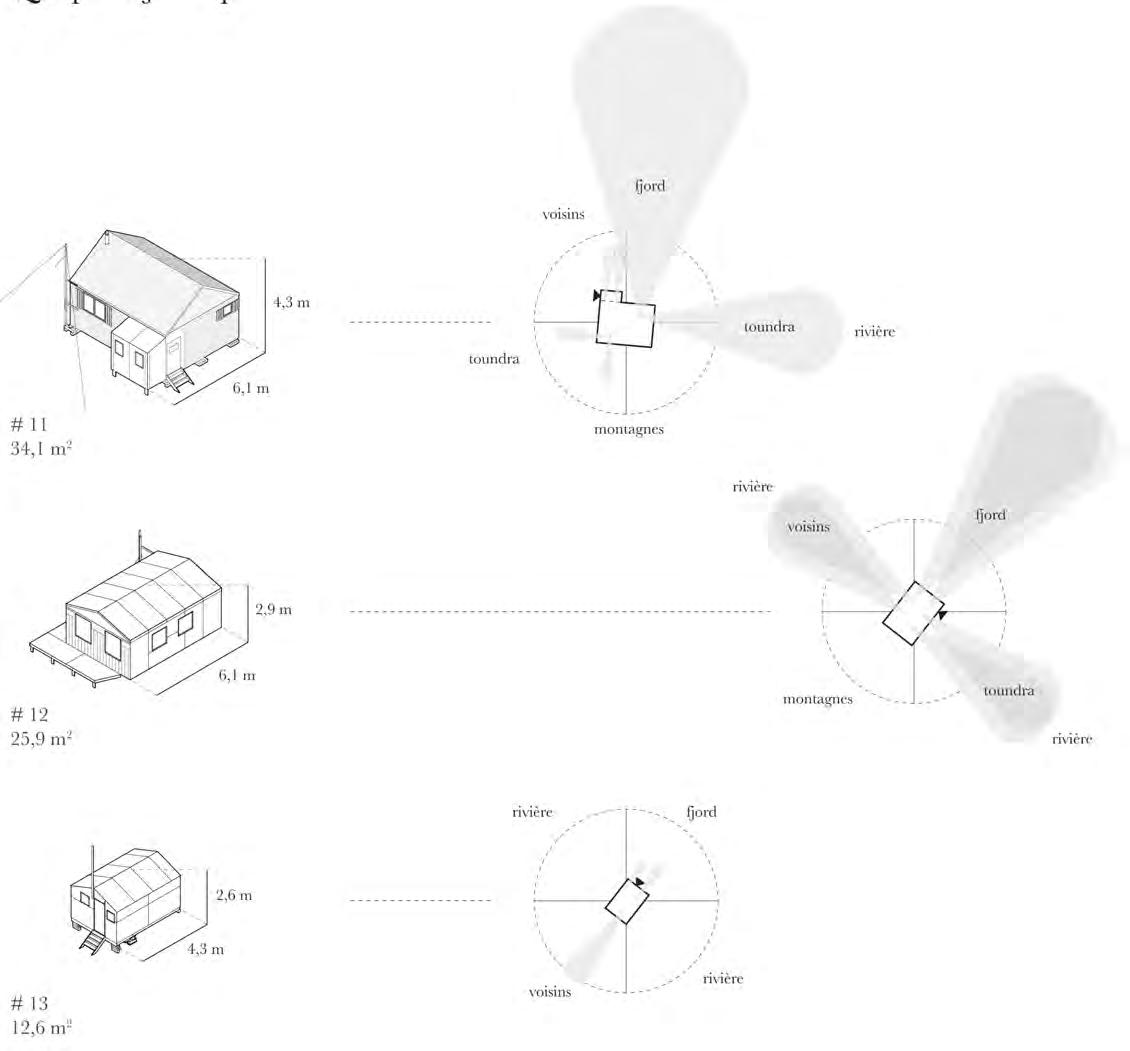
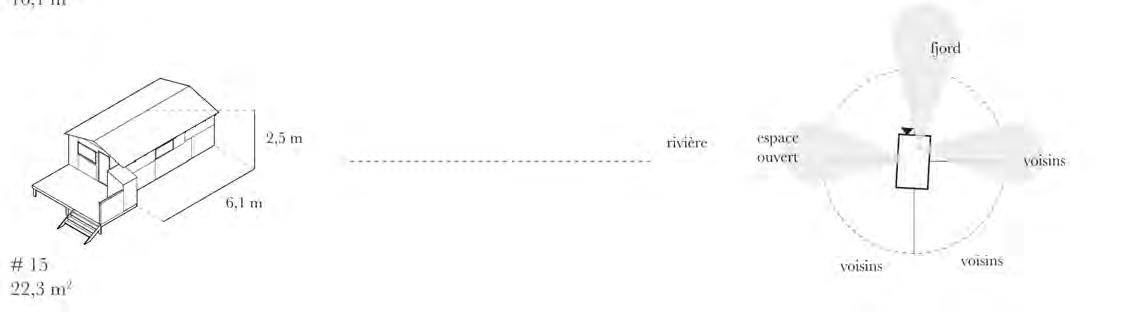
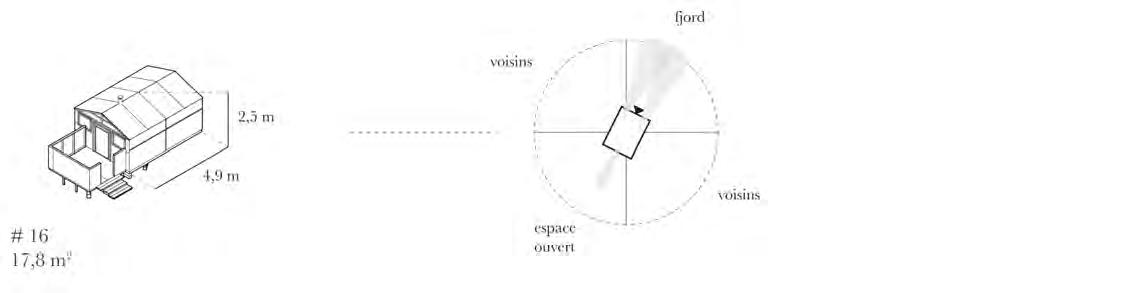
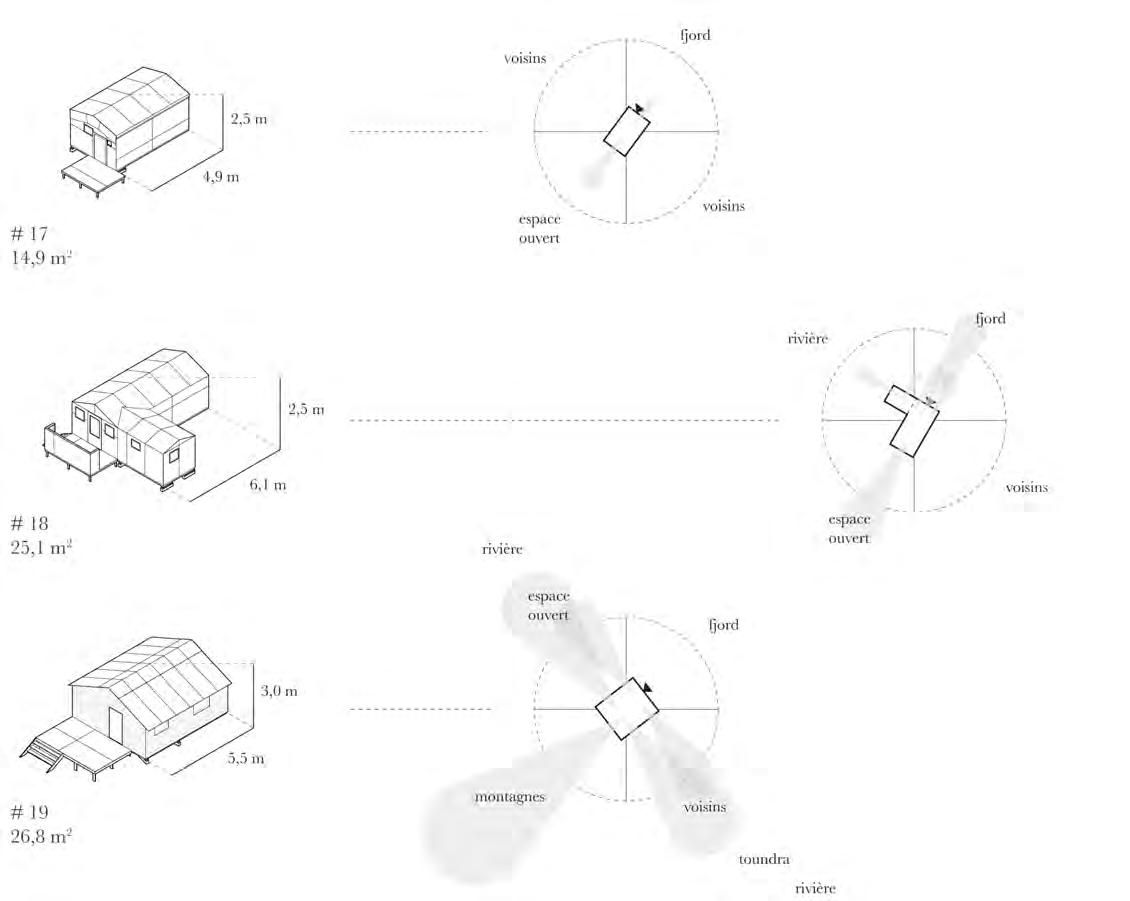

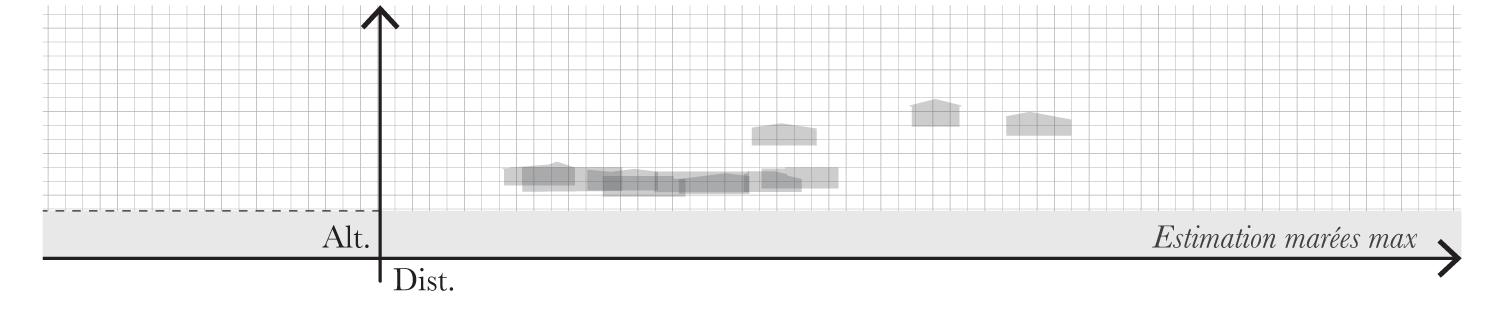
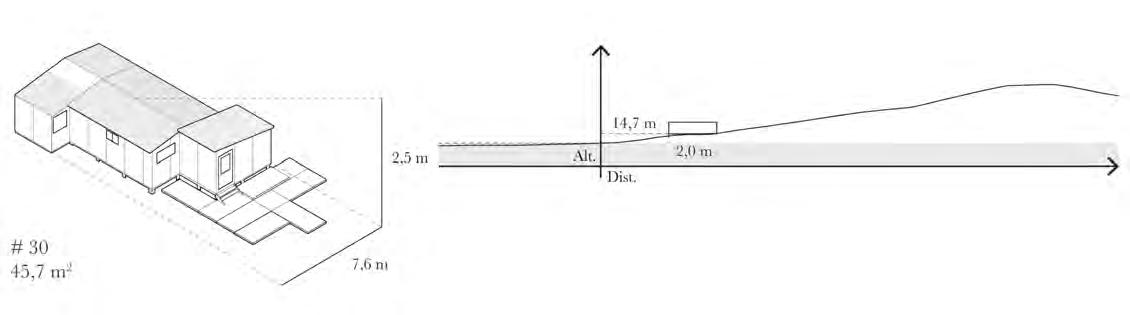
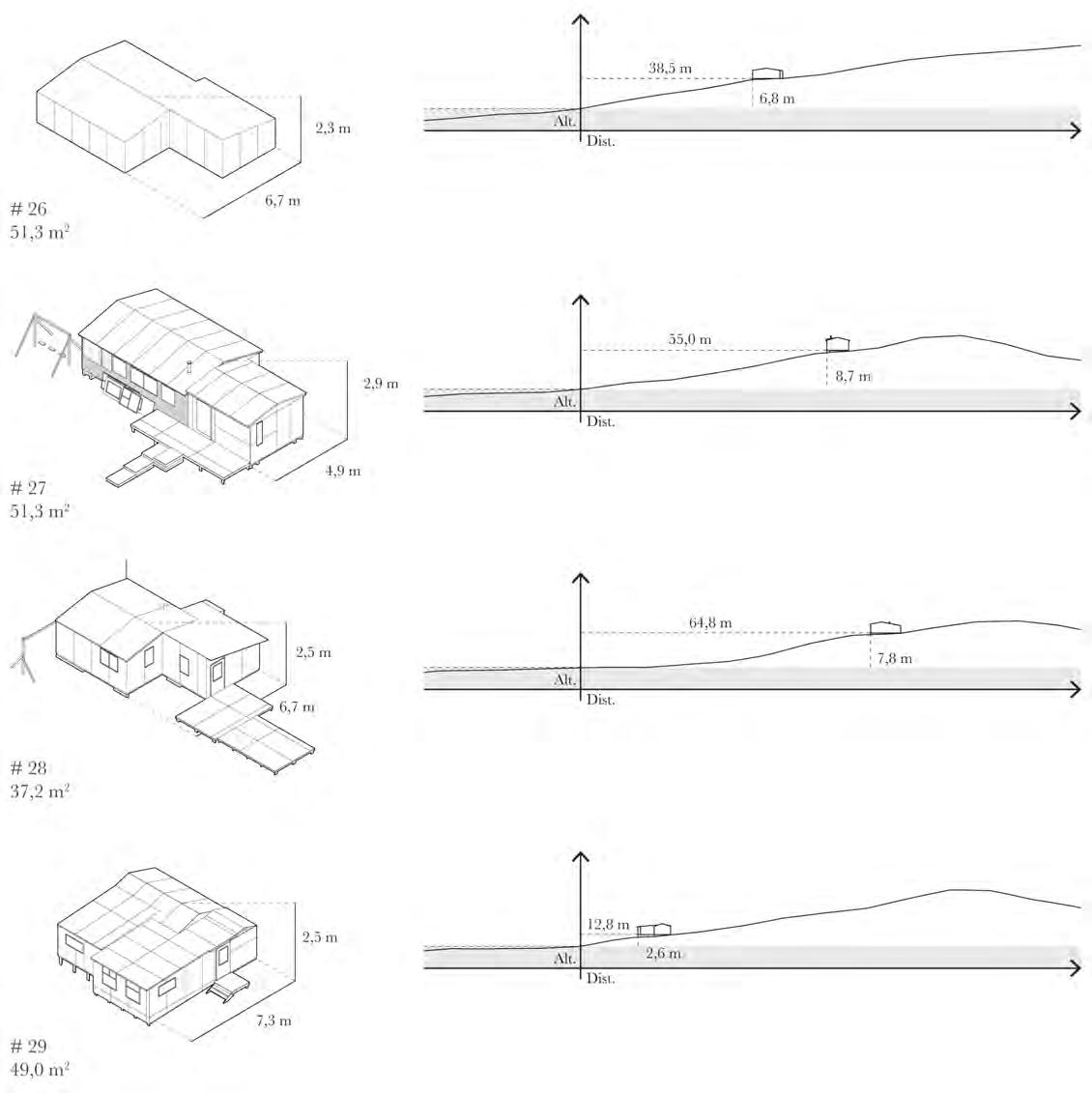
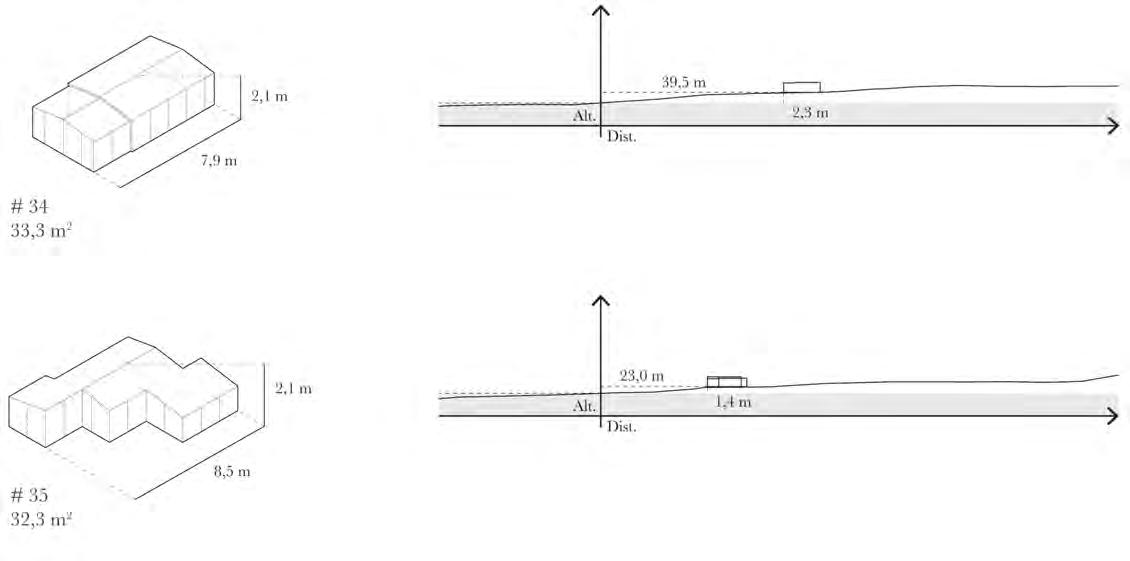
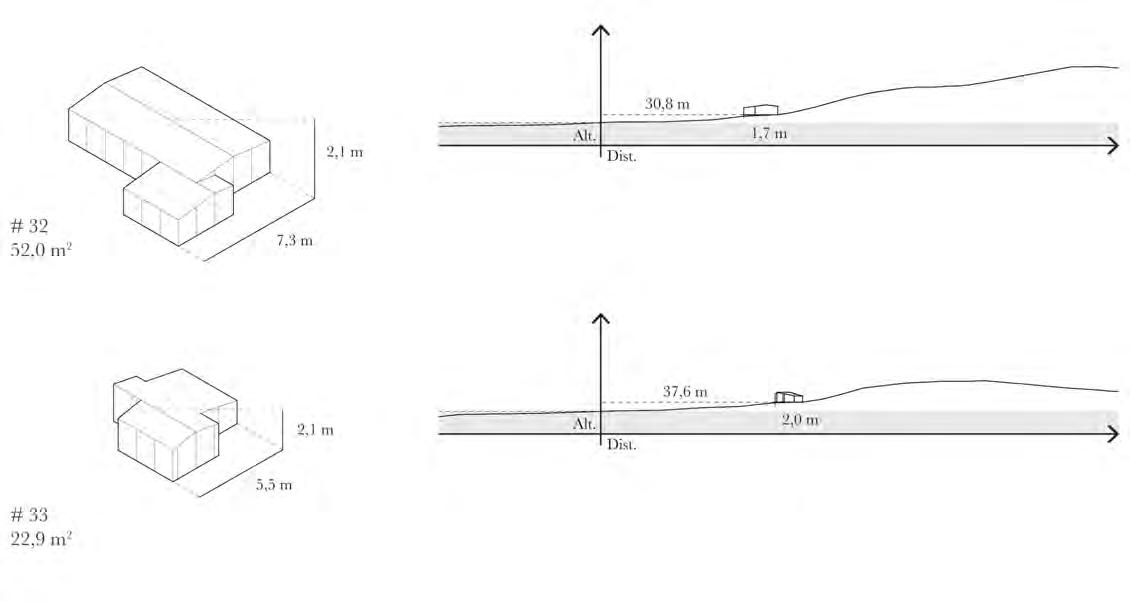
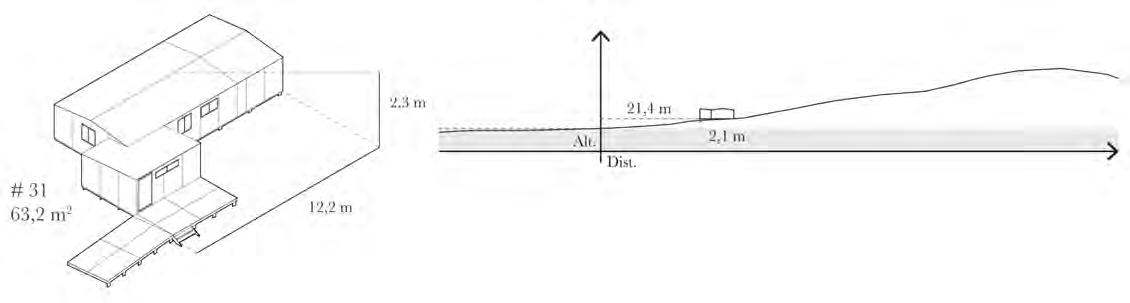
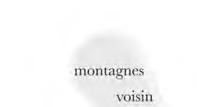
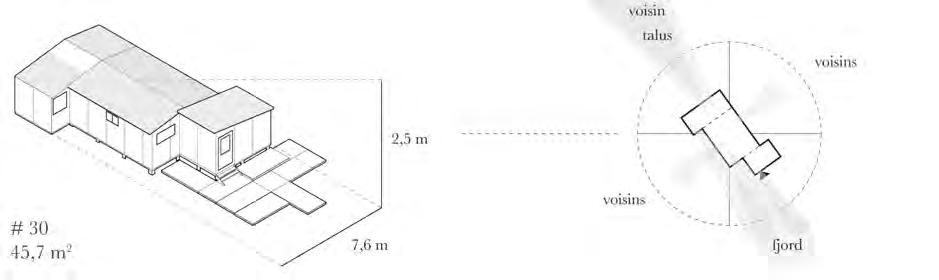
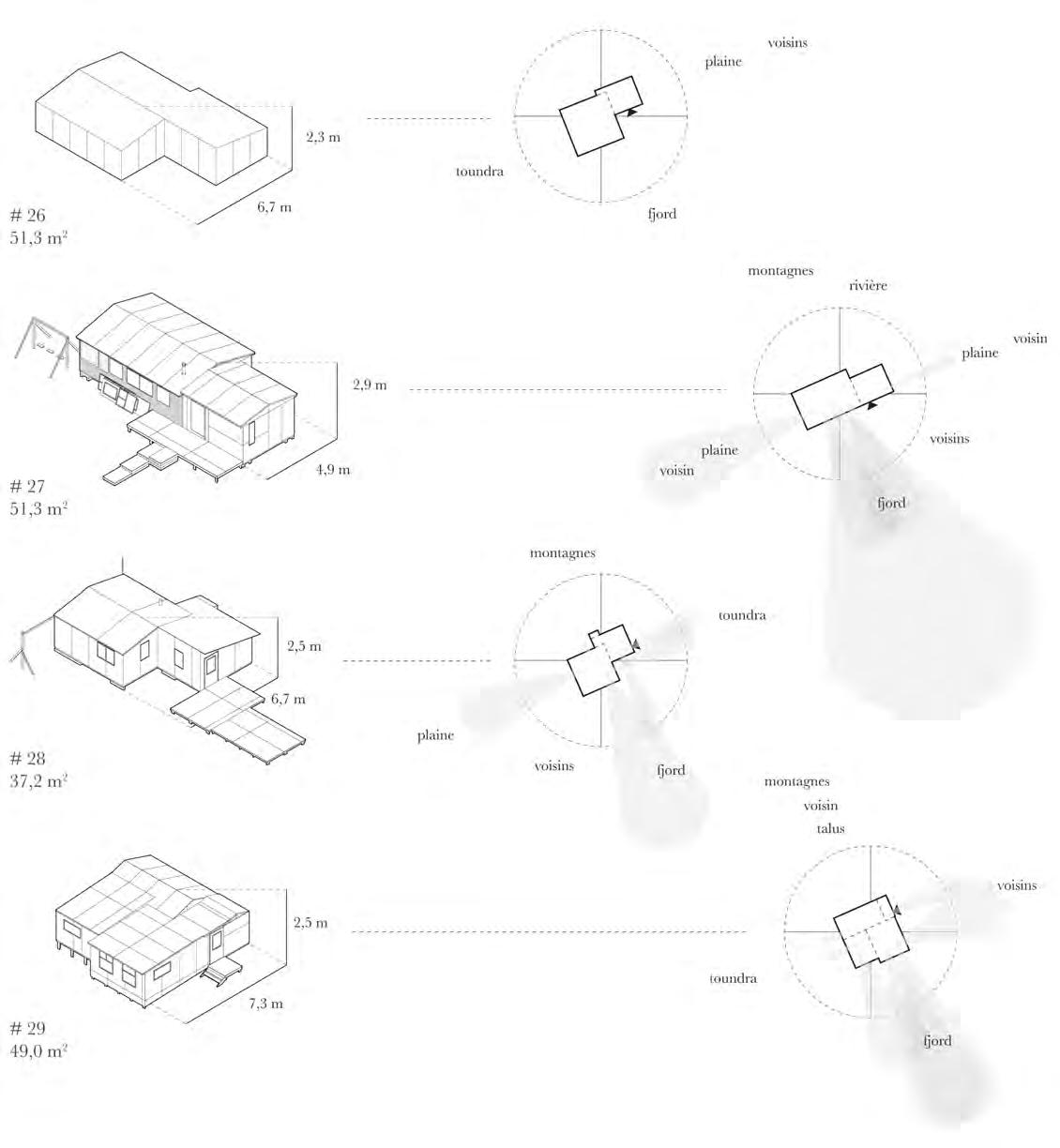
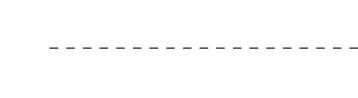
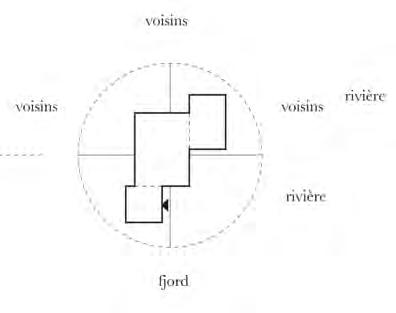
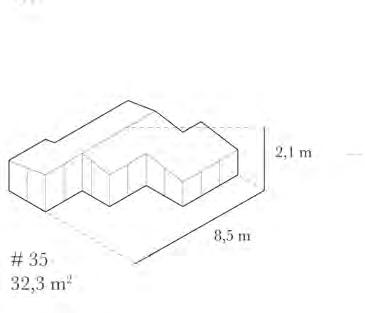
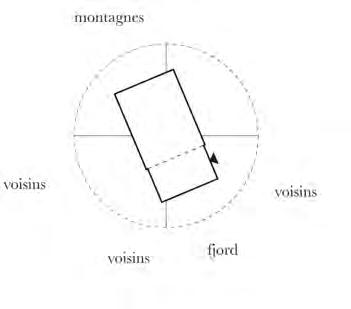
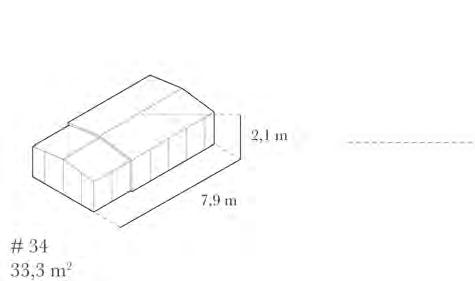
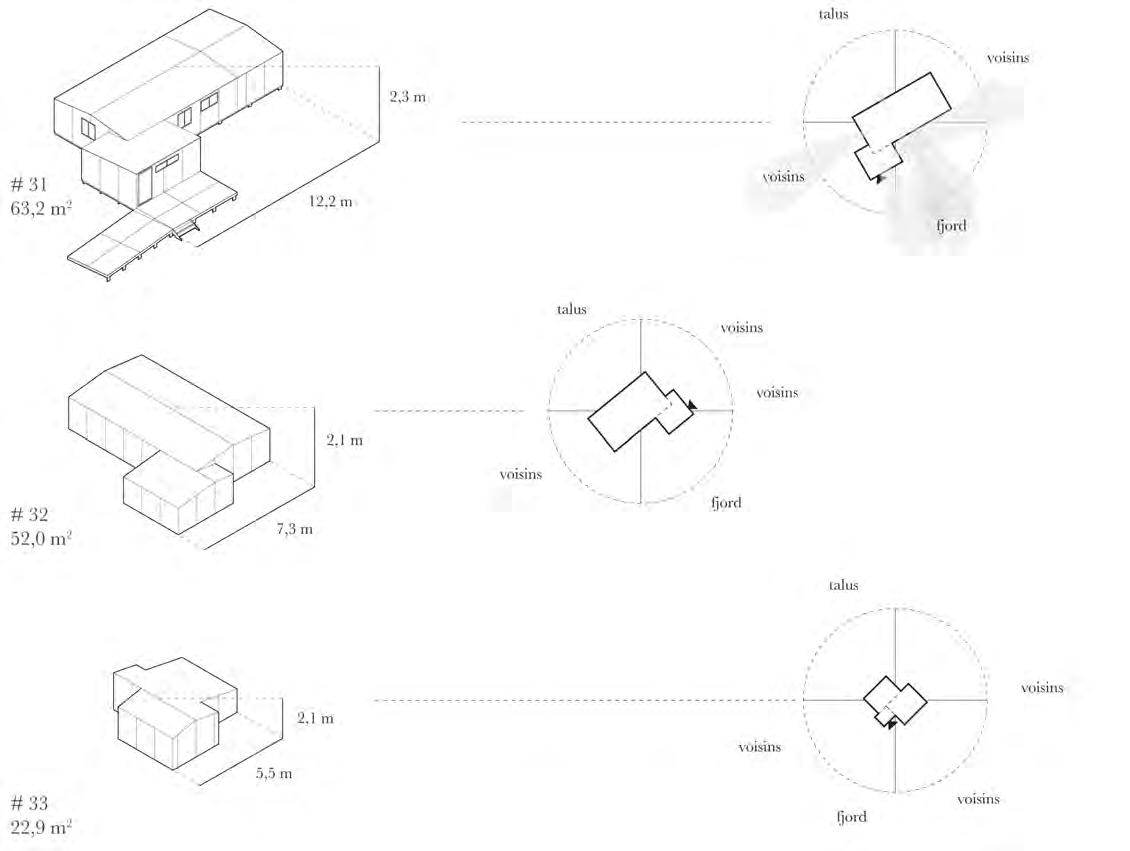

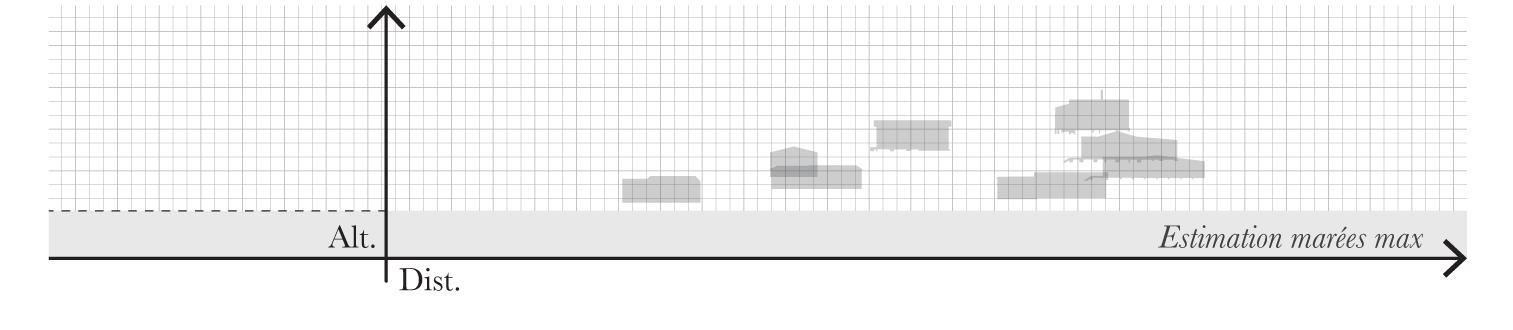
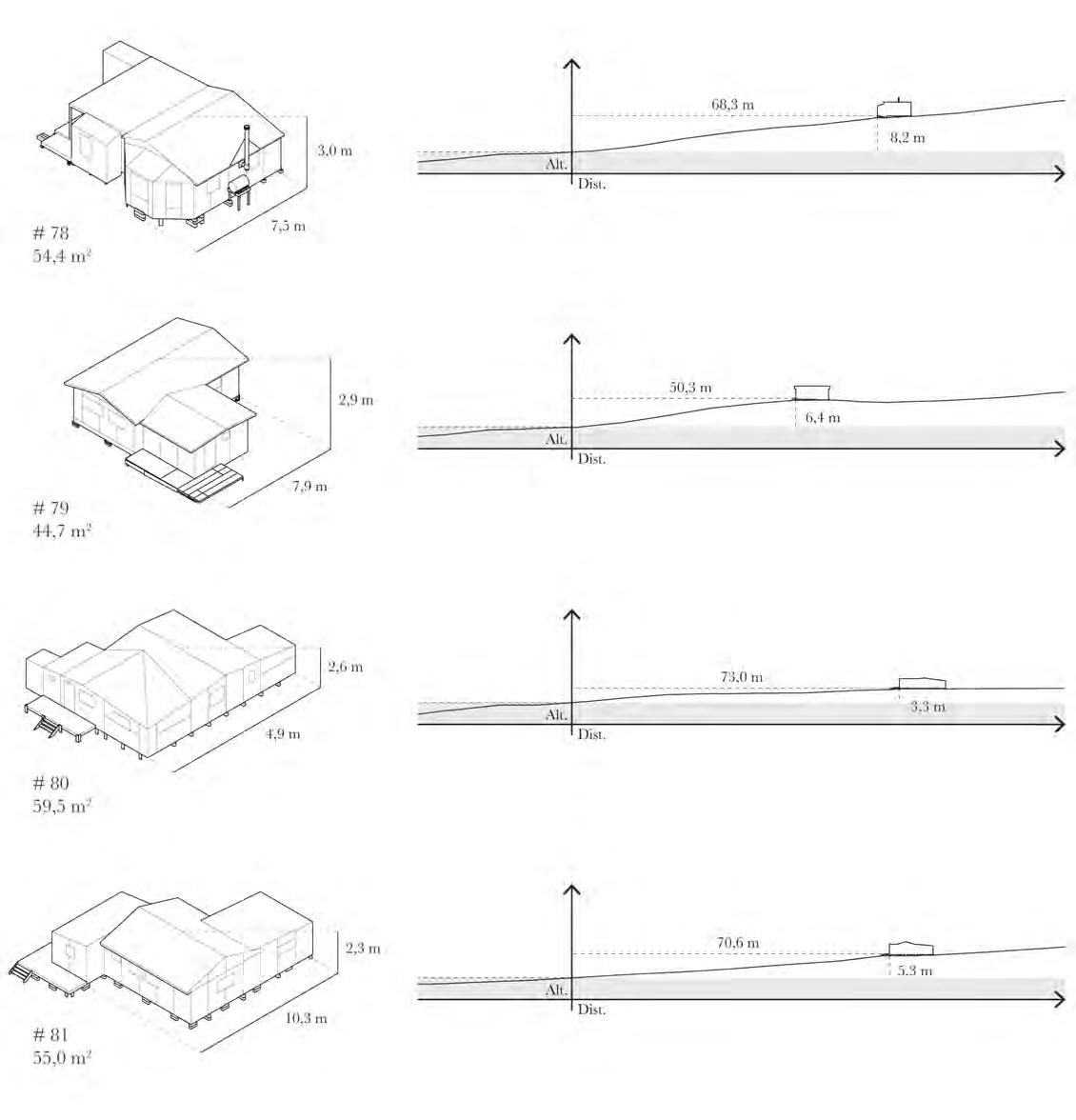
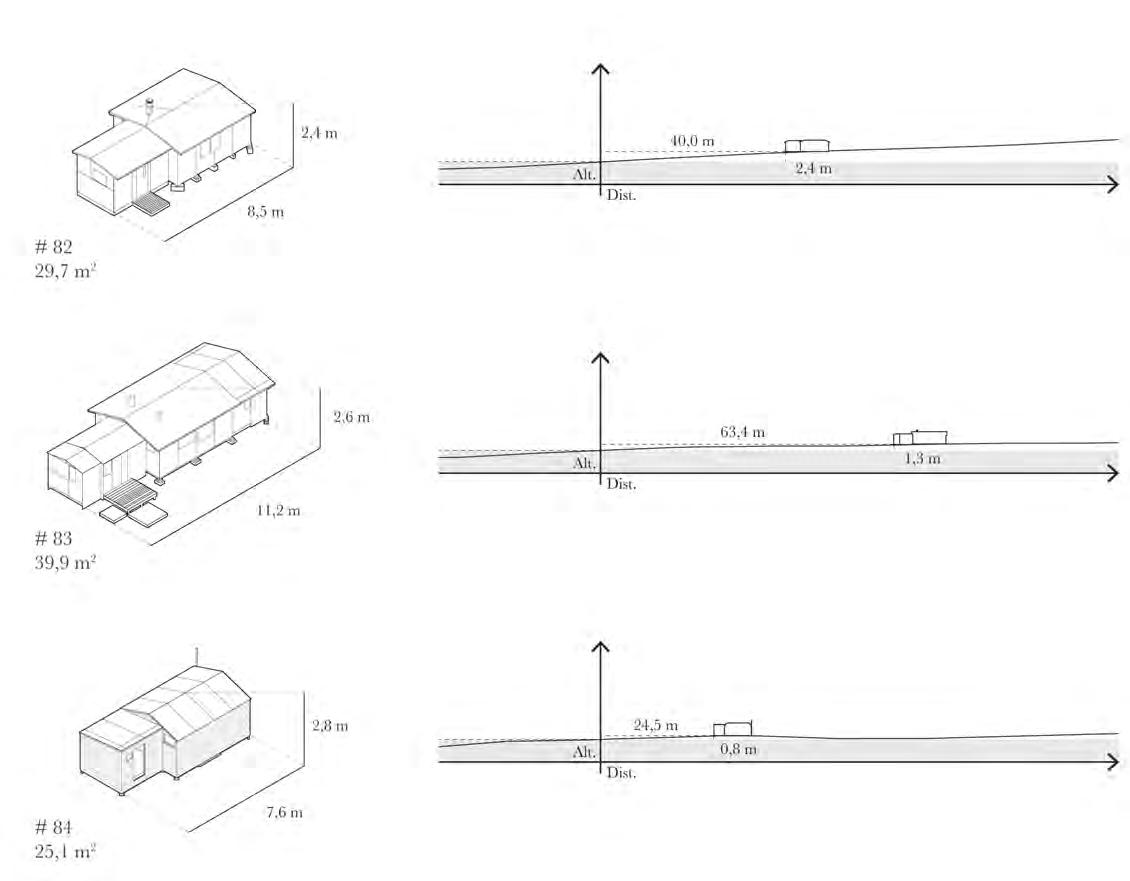
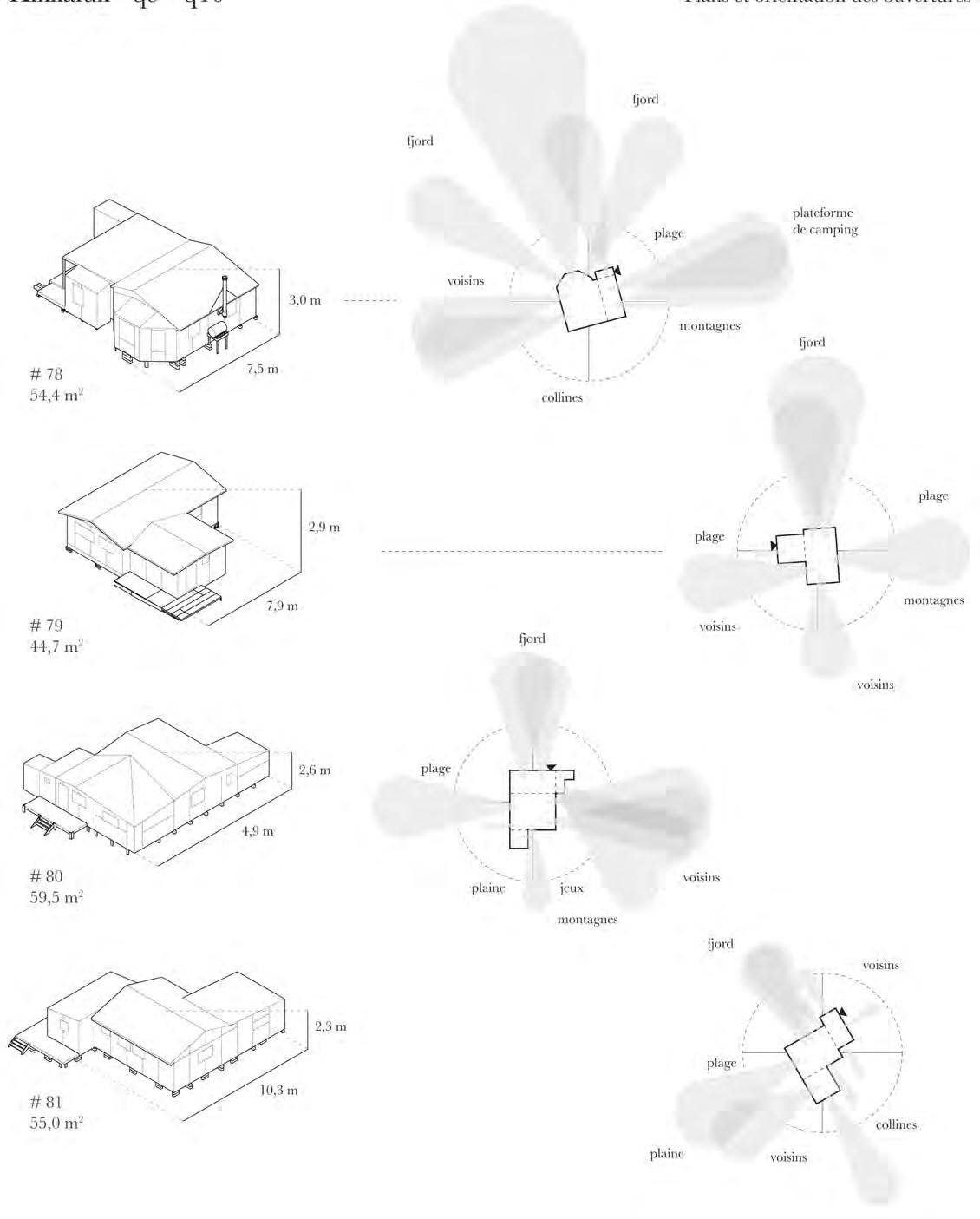
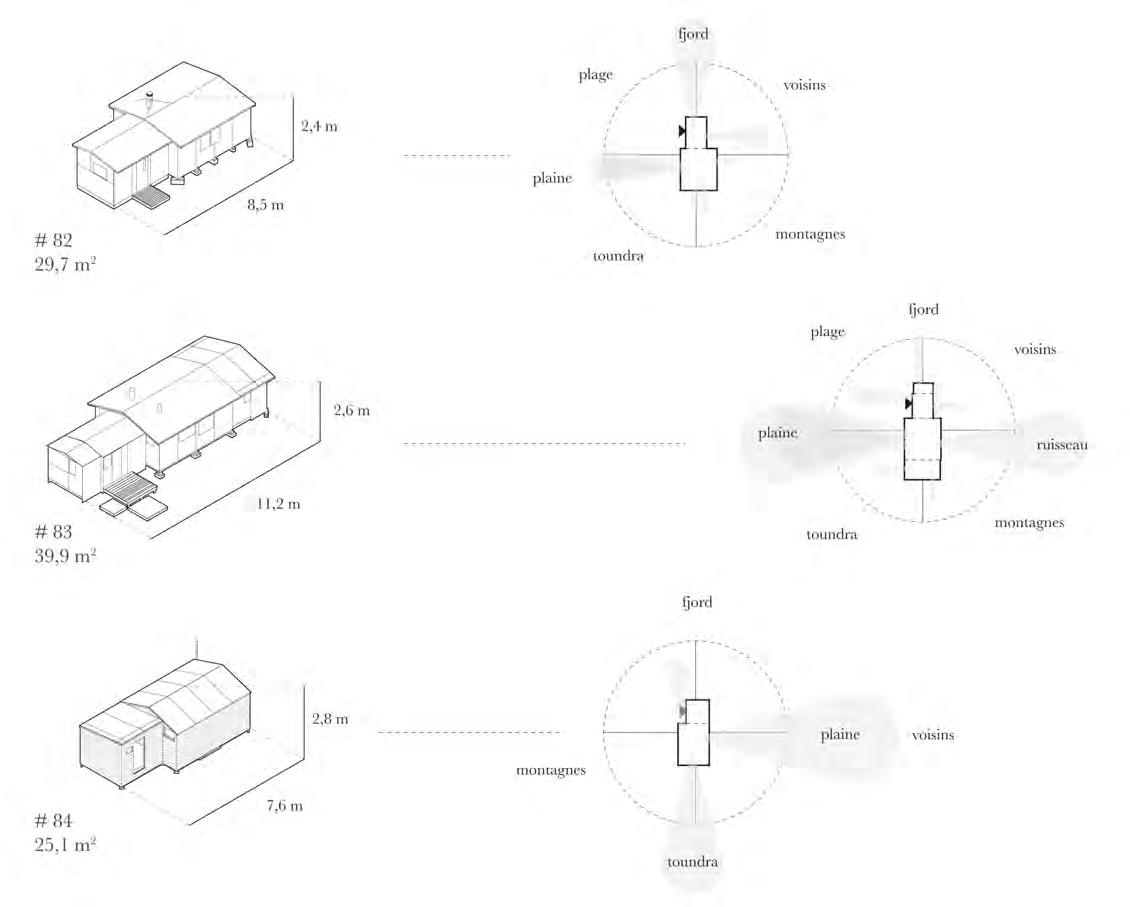

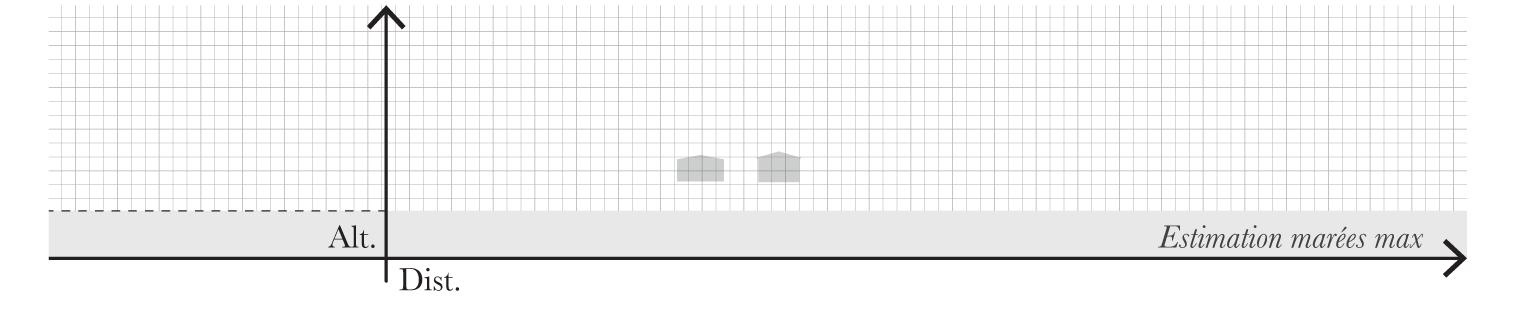
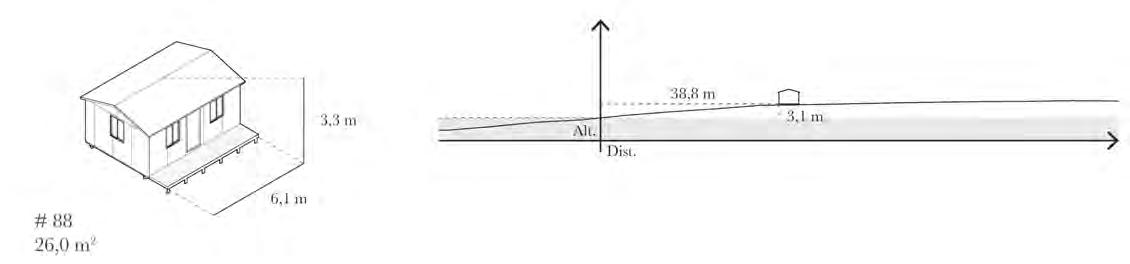
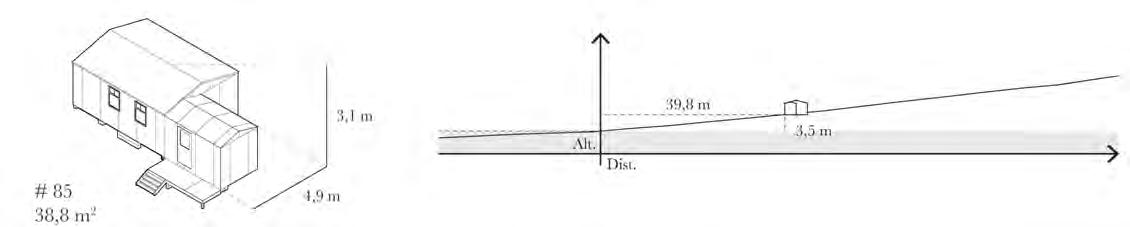
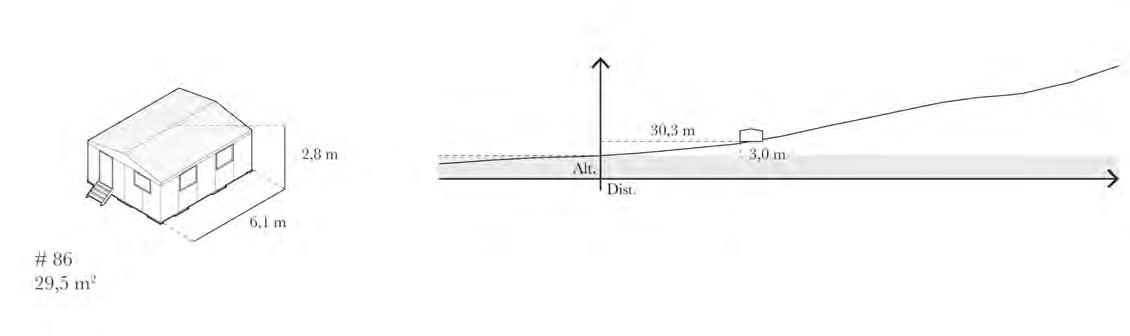
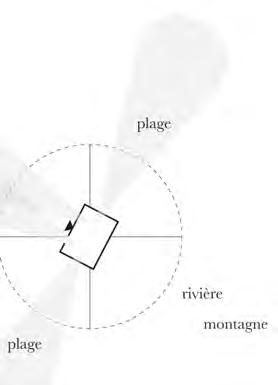

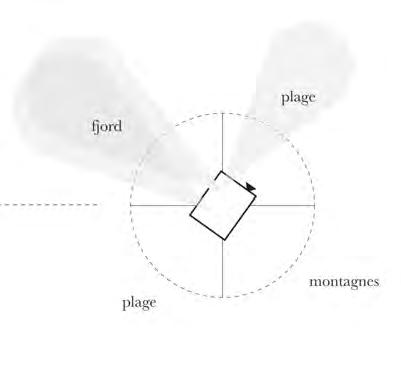
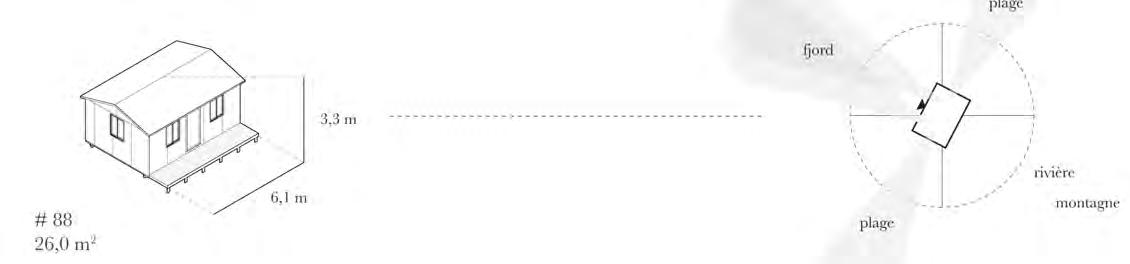
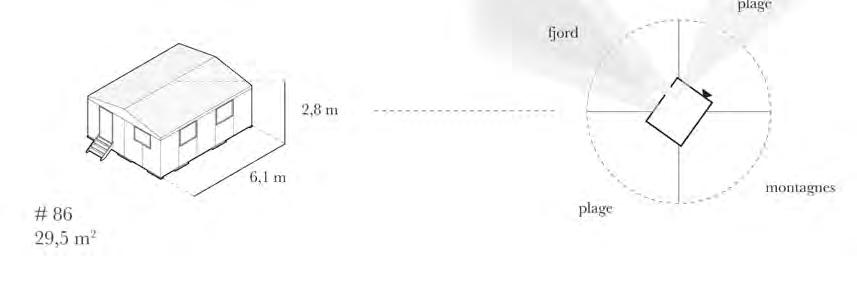
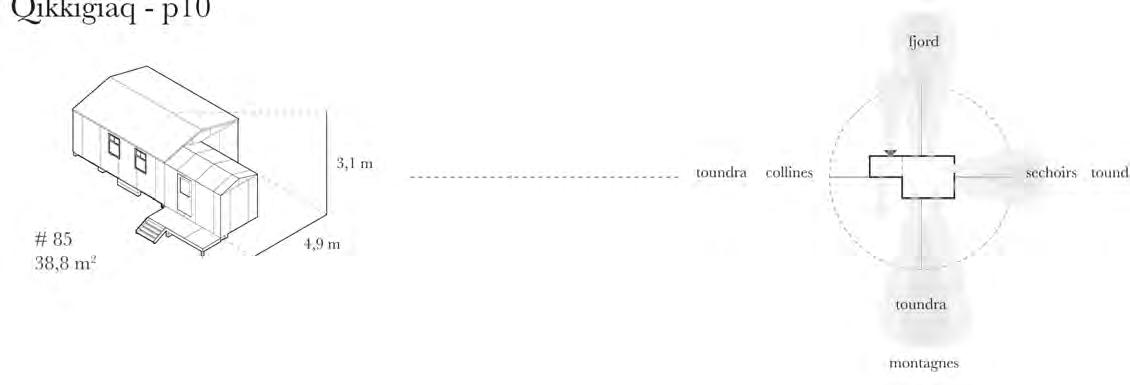


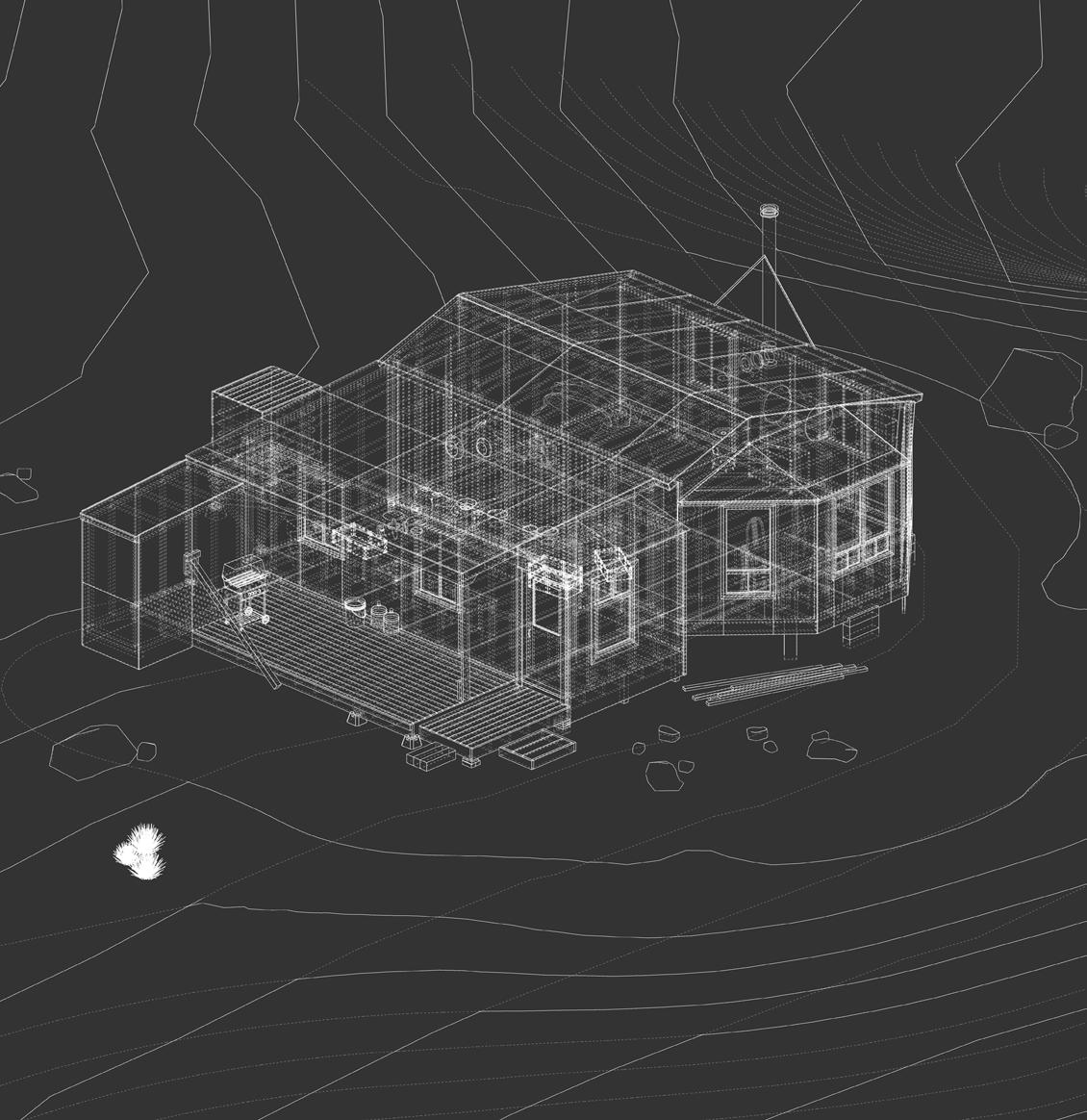 Figure 11. Exemple du niveau de détails d’une modélisation numérique d’une cabane.
Annexe 1 - page 315
Figure 11. Exemple du niveau de détails d’une modélisation numérique d’une cabane.
Annexe 1 - page 315
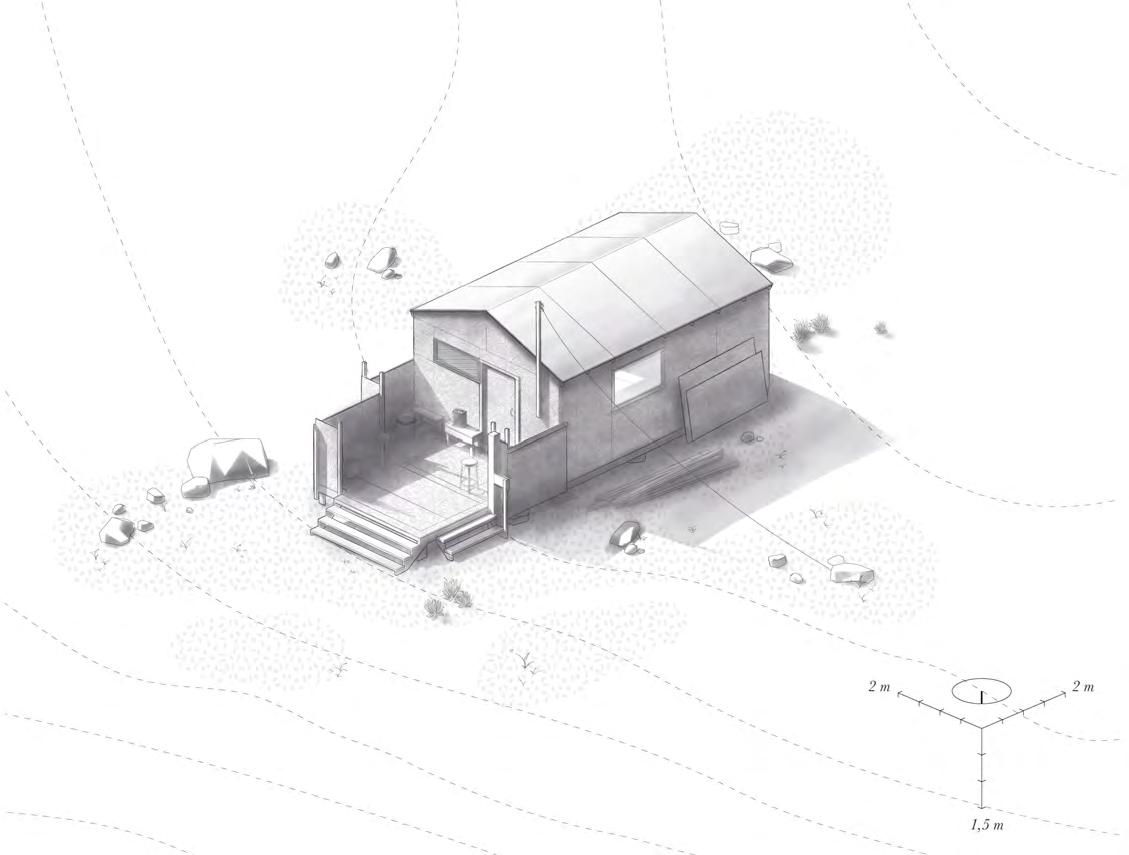
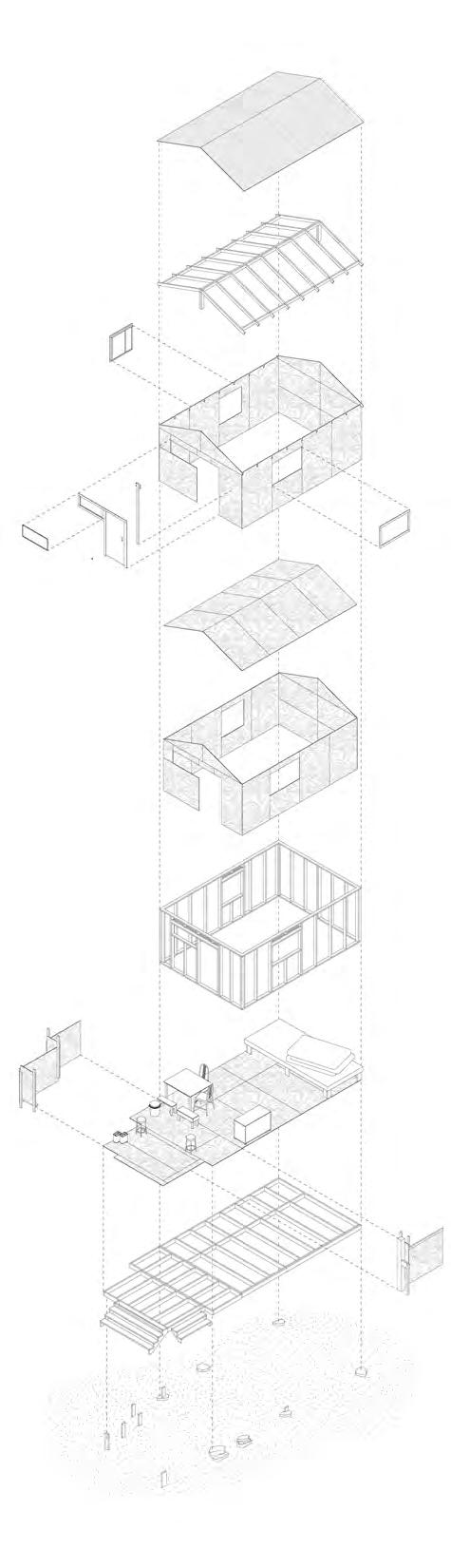




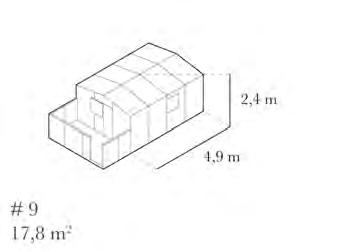
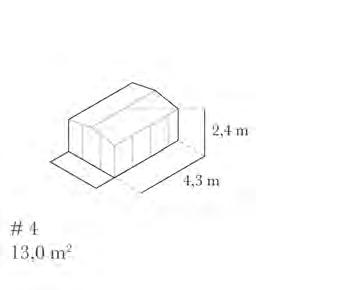
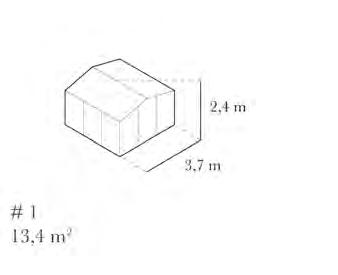
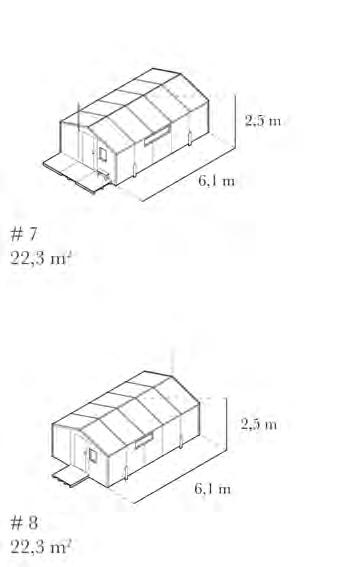
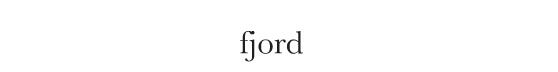

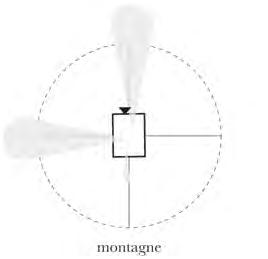
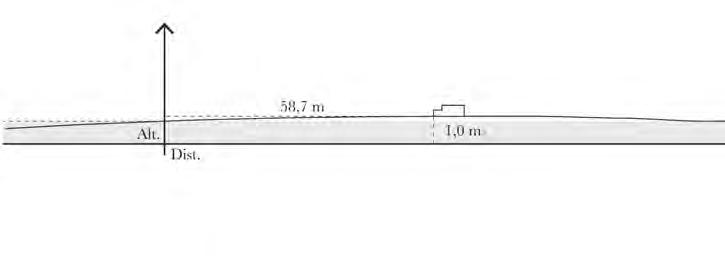

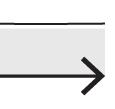
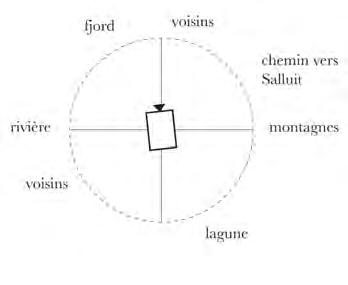
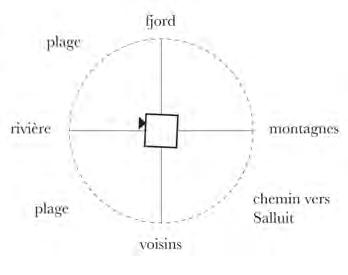
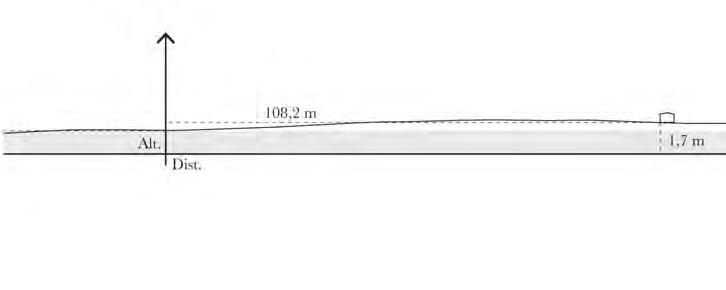
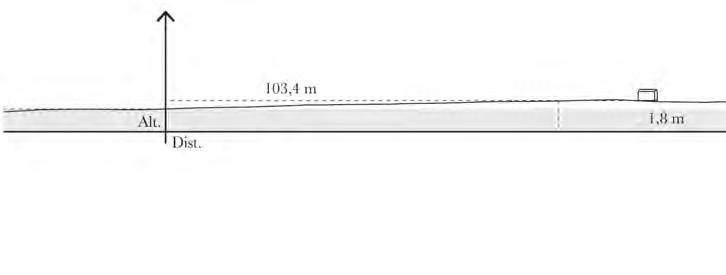
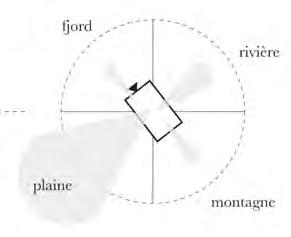
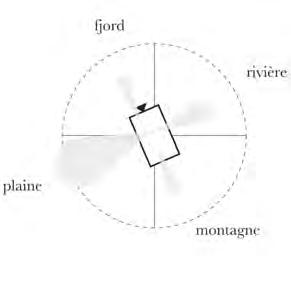
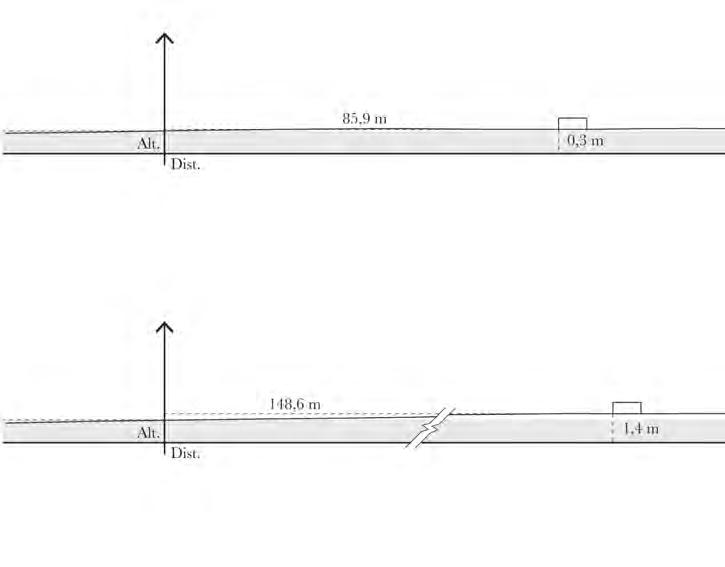
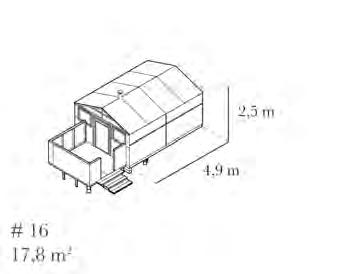
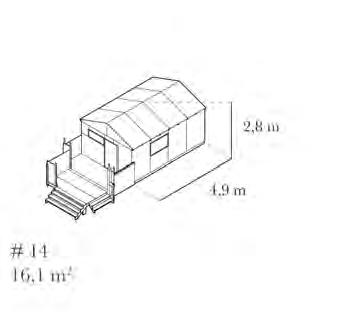
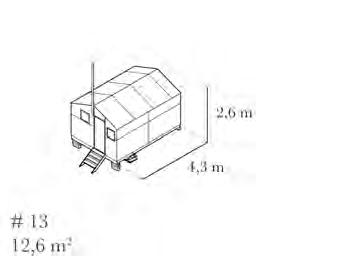
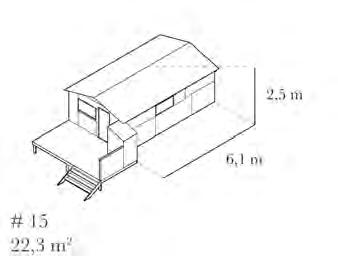




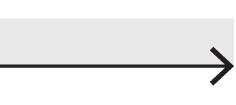
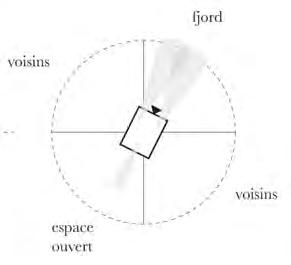
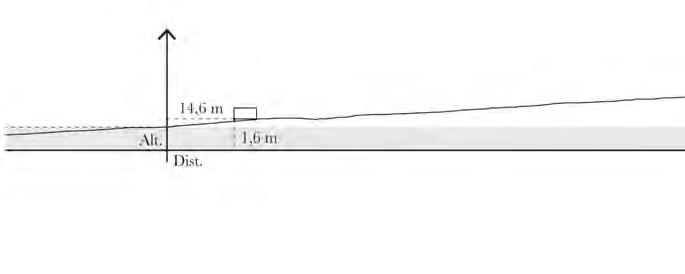
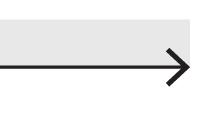
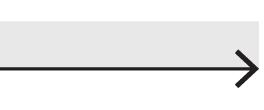
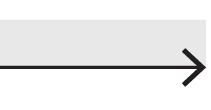
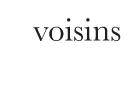
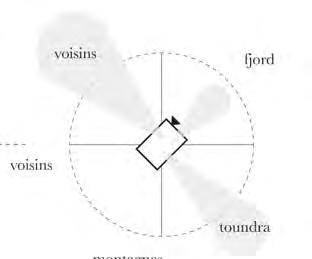
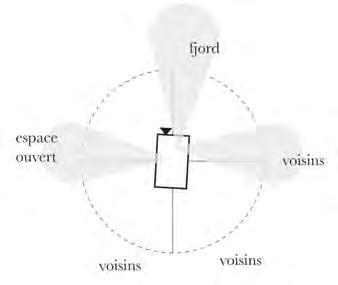
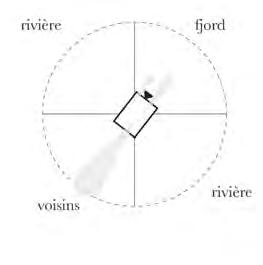
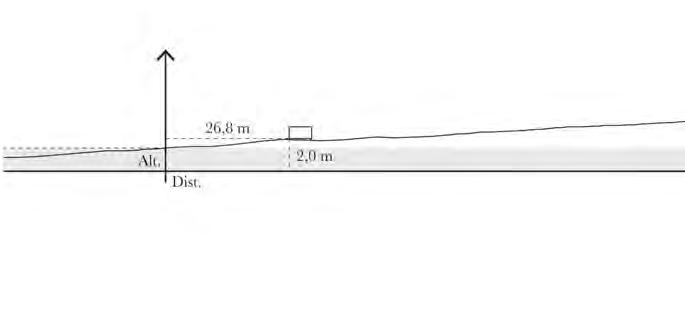
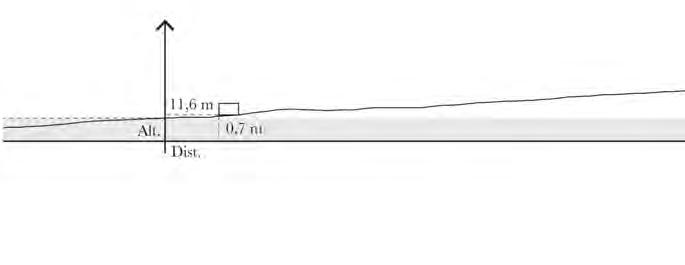
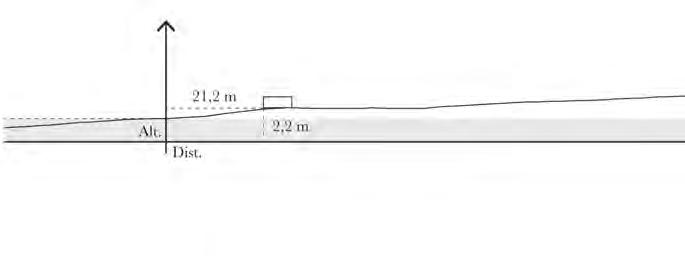
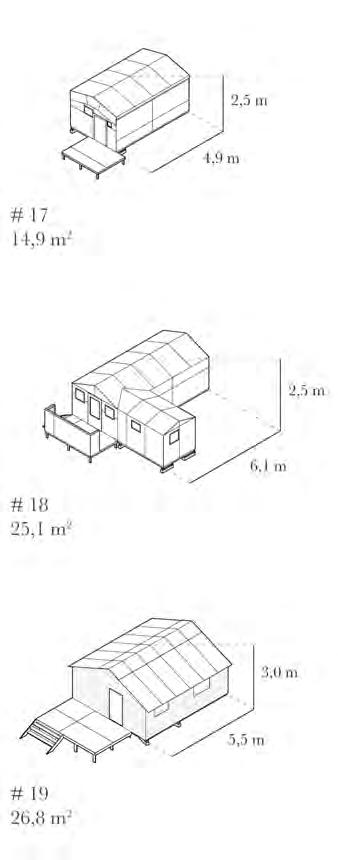



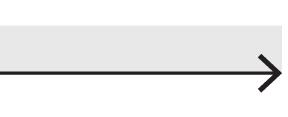
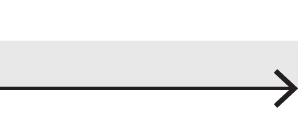
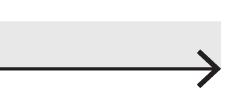
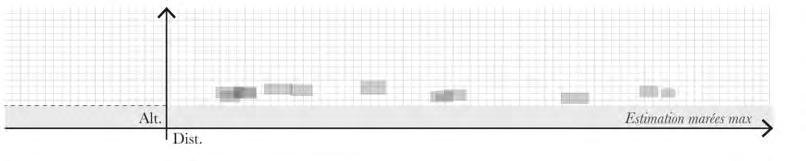
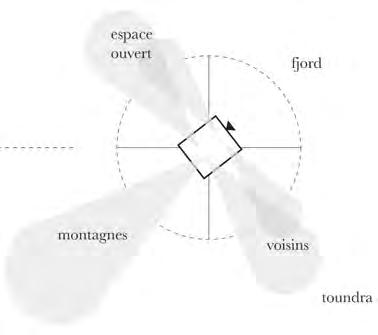
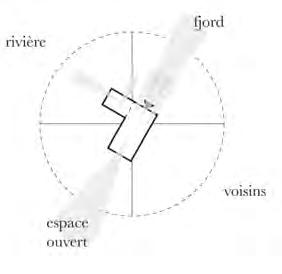
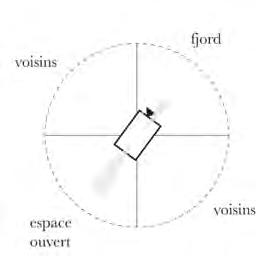
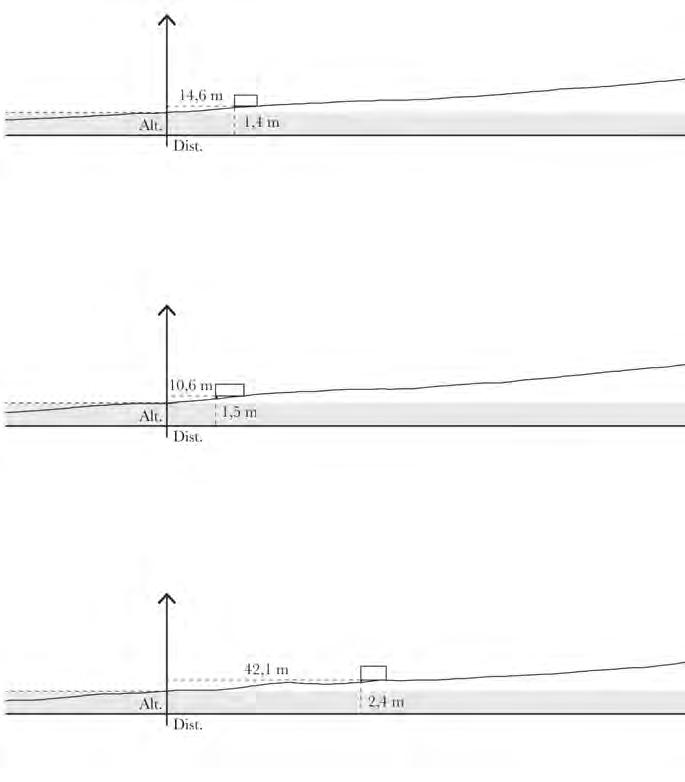
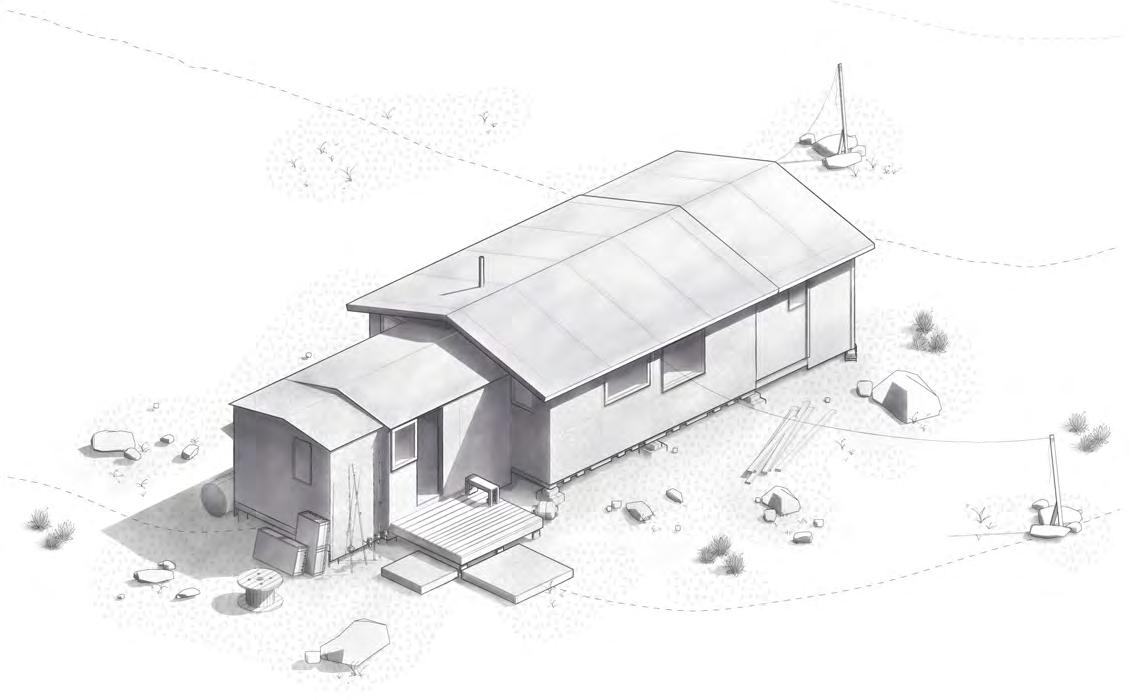
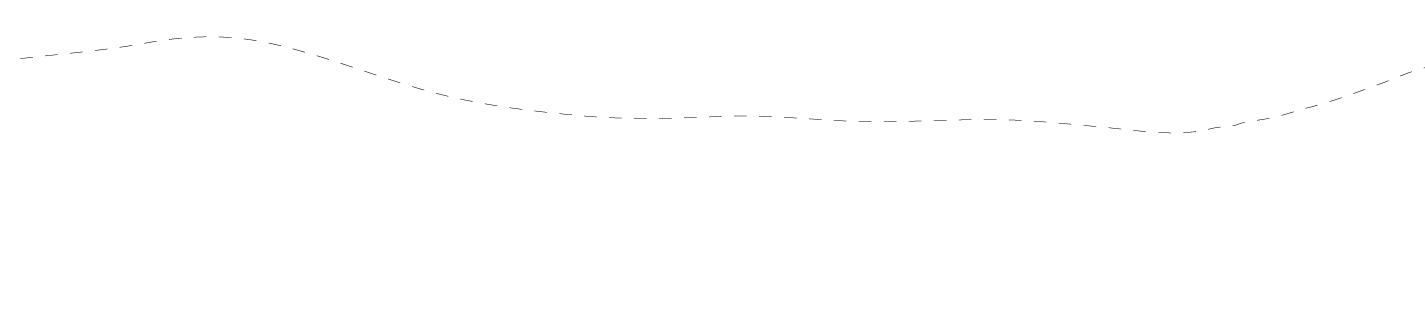
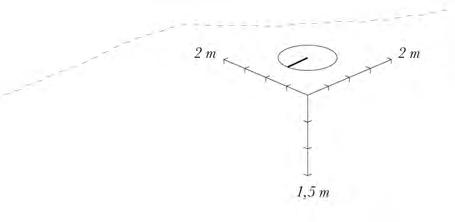 Figure 13.
Figure 13.
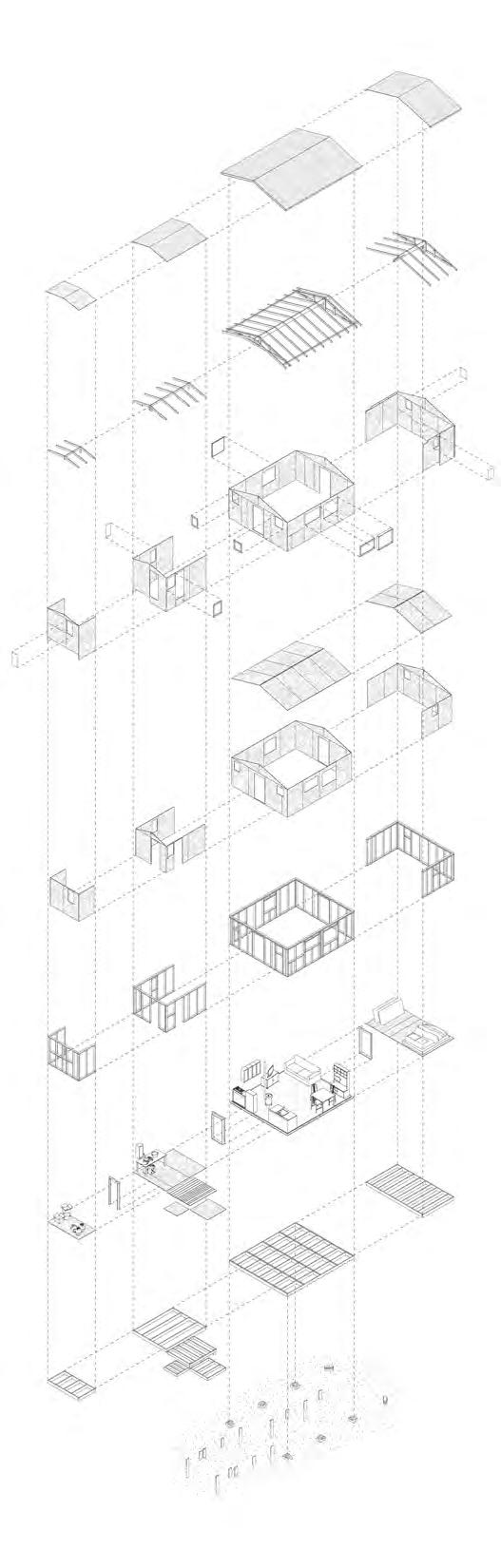




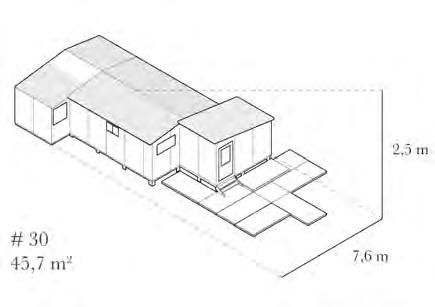
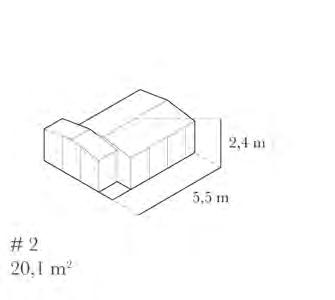
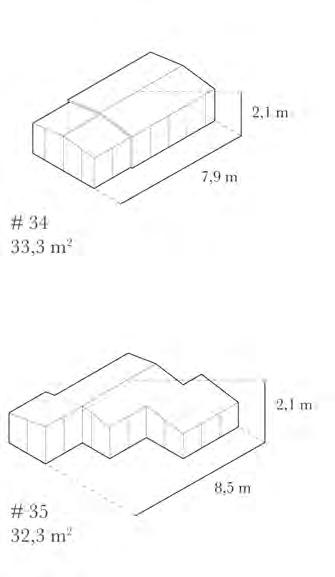
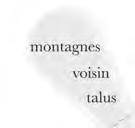
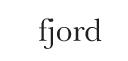

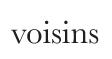
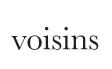
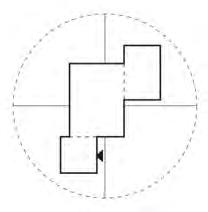
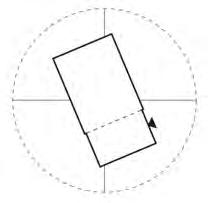
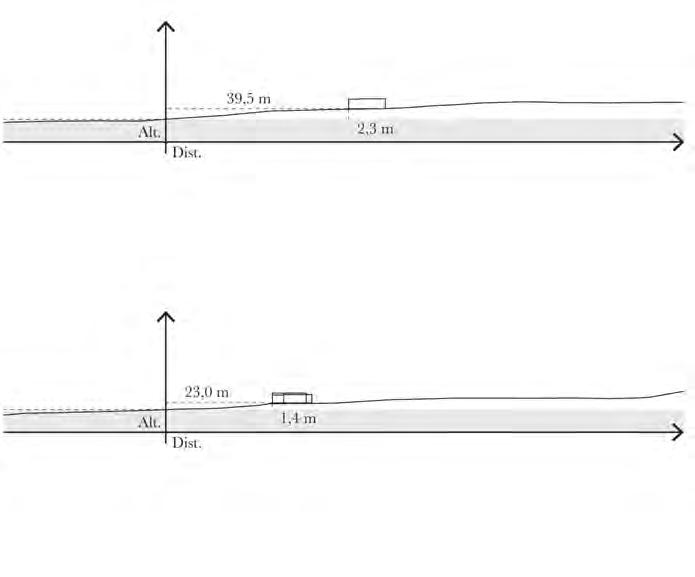
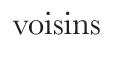
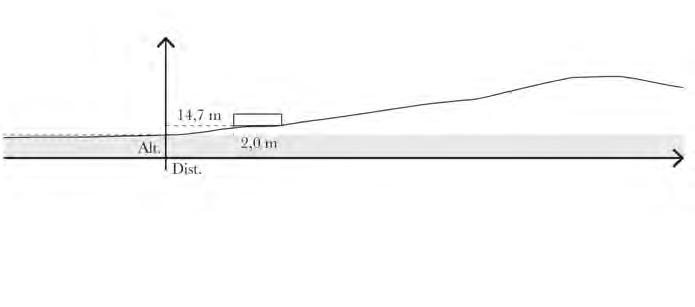
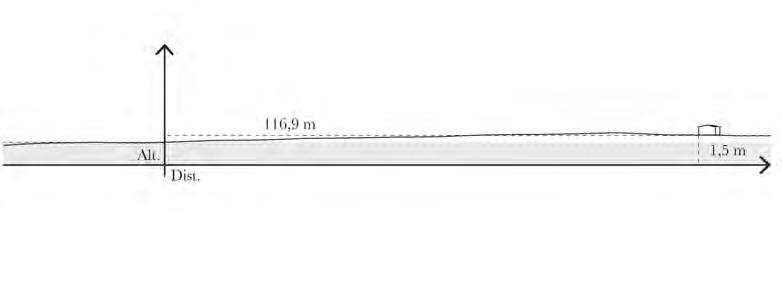
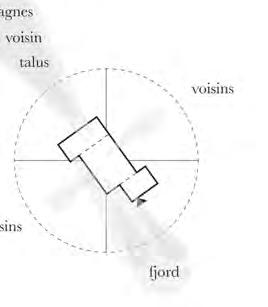
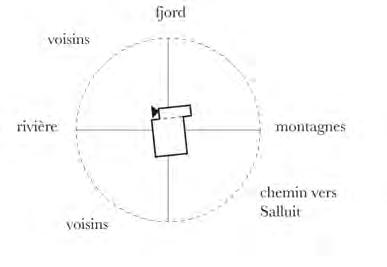



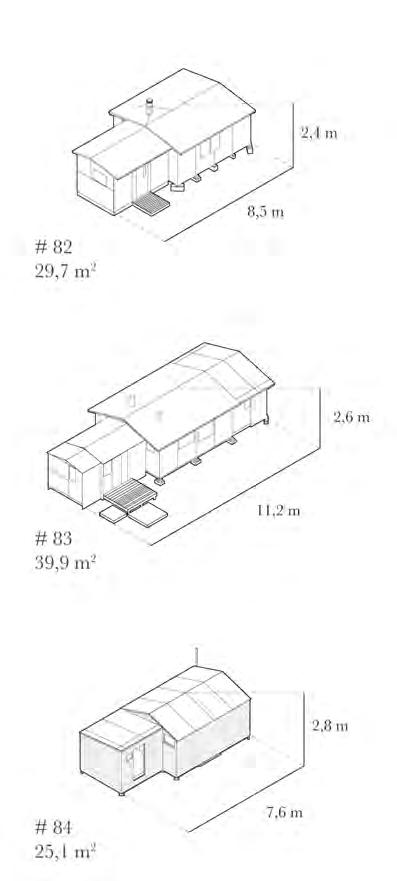

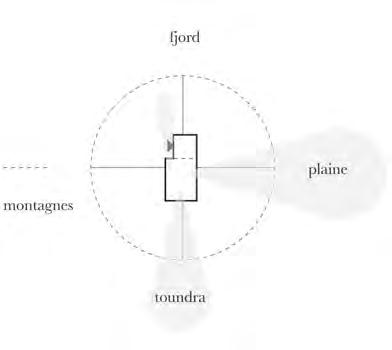
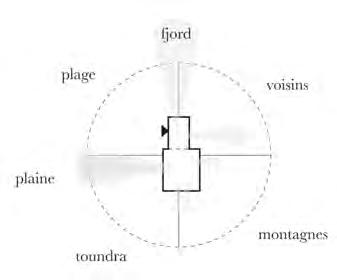
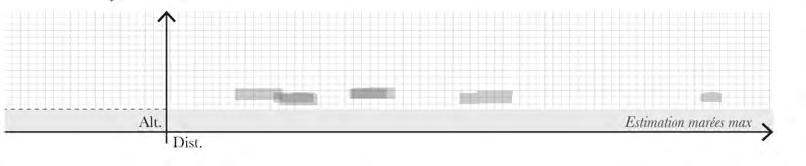
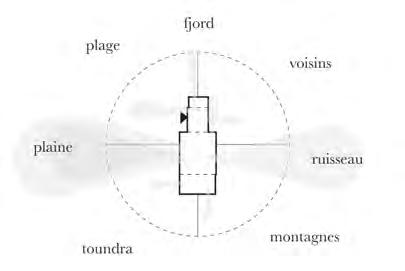
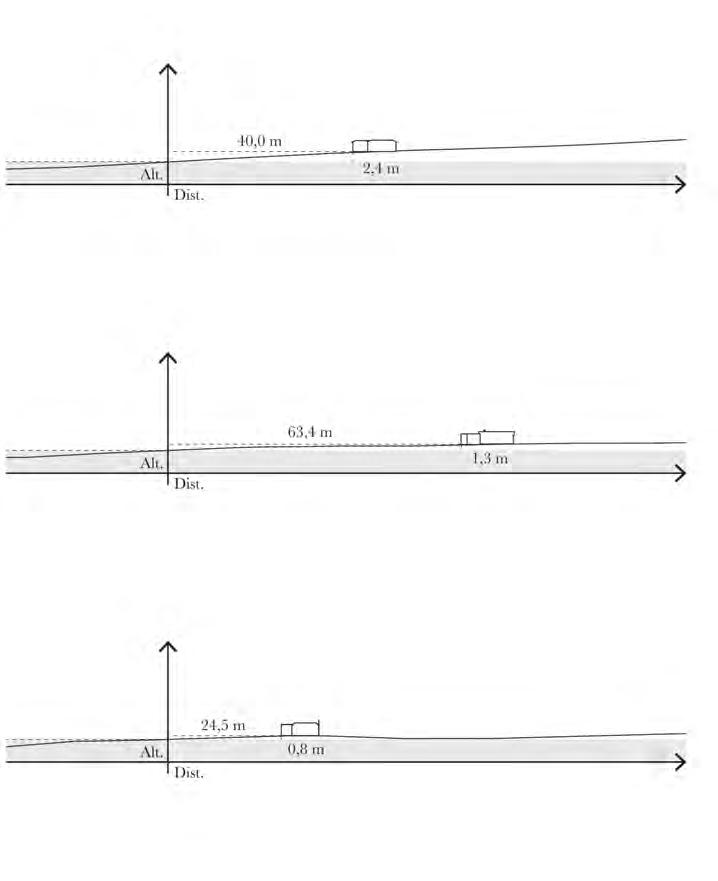
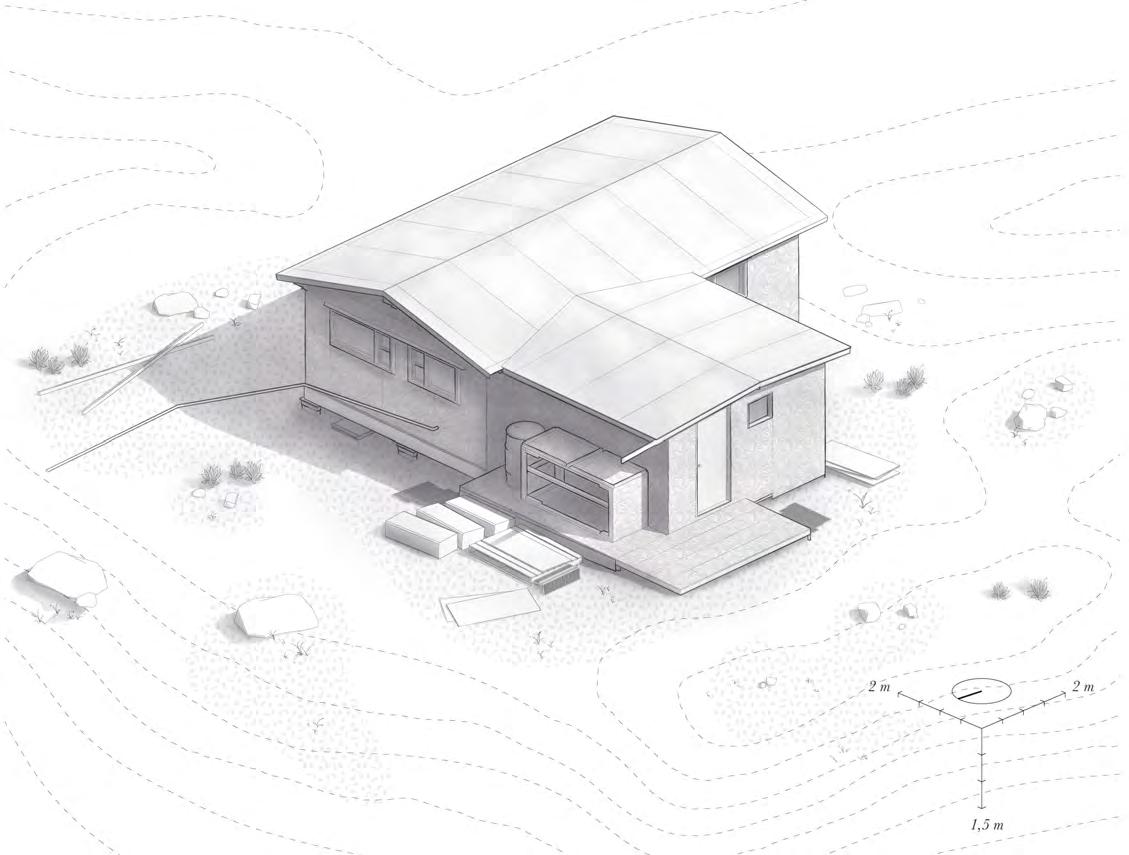
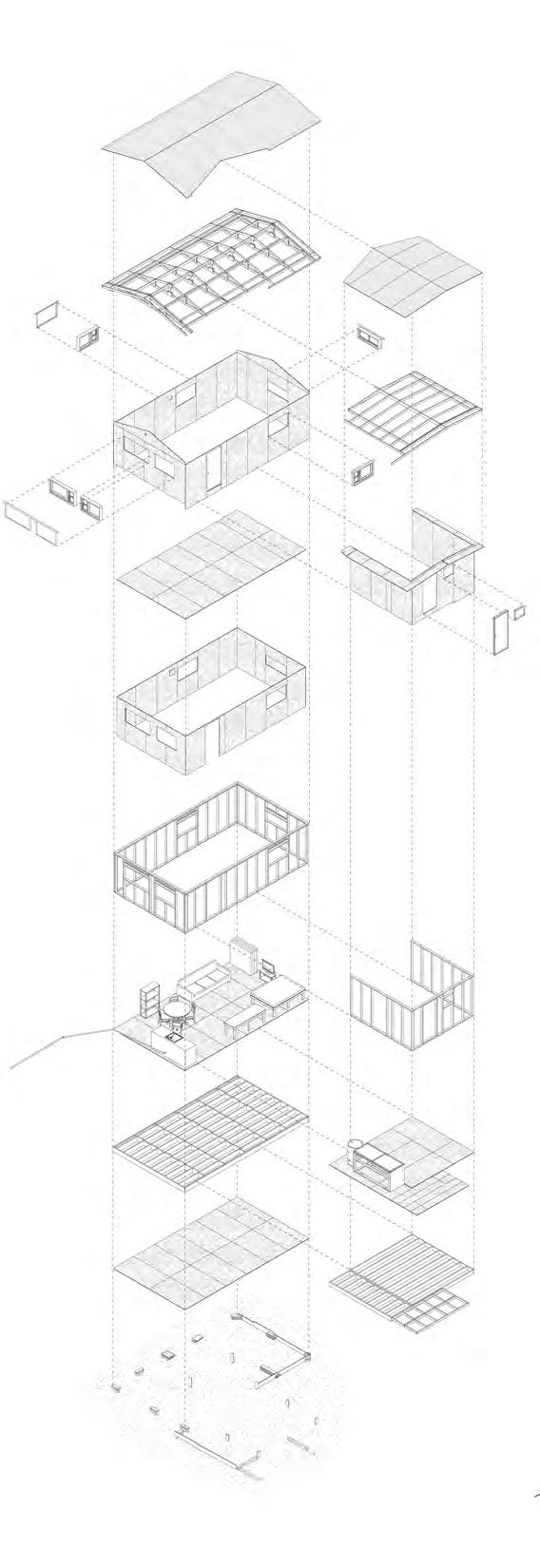


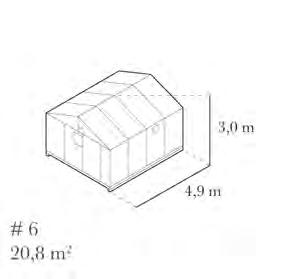
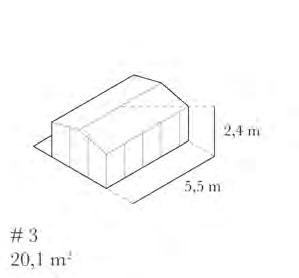 Igajialuk 1/2 (f17)
Igajialuk 1/2 (f17)

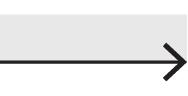
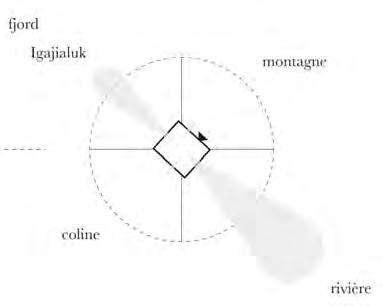
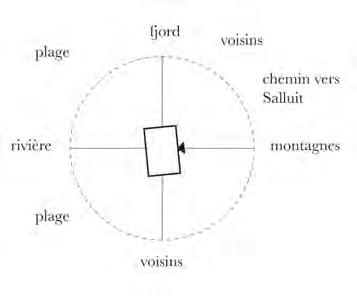
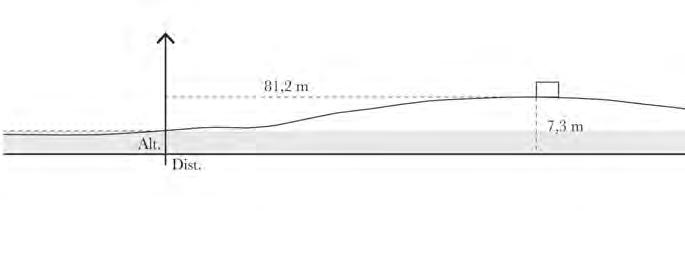
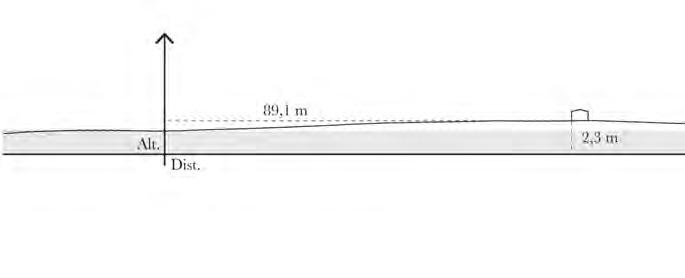


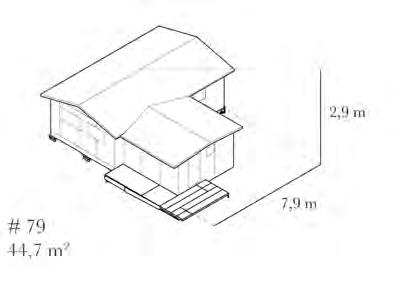
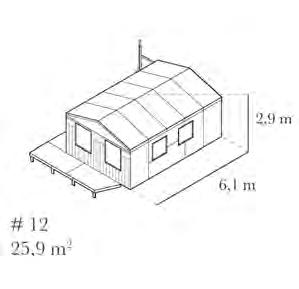
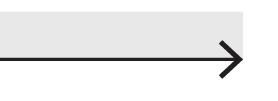
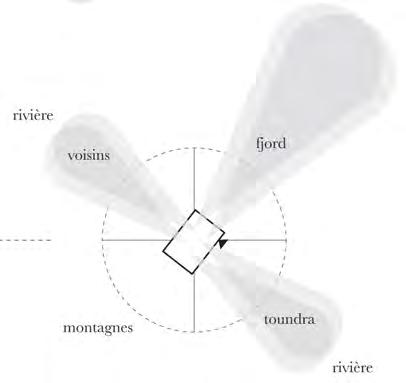
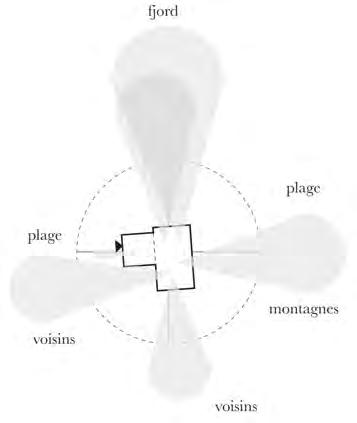
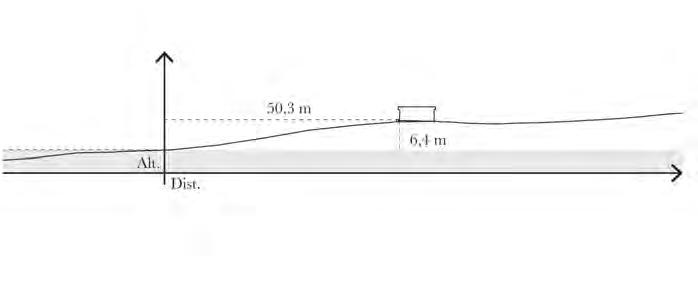
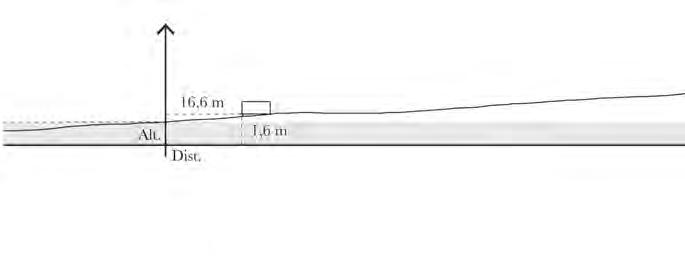
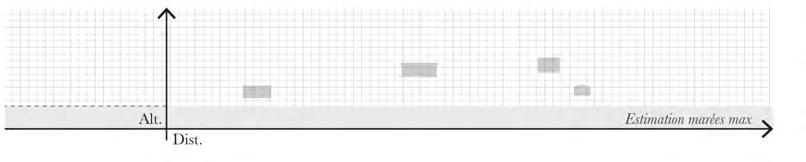
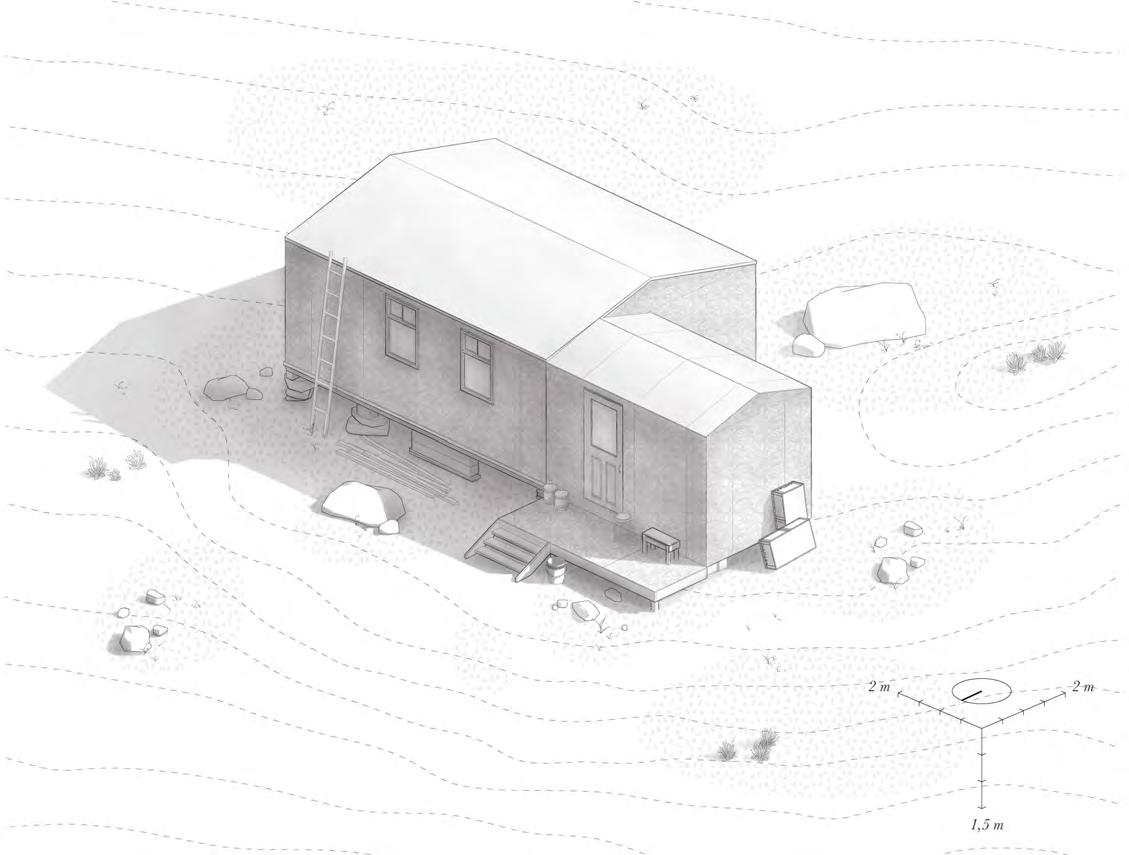
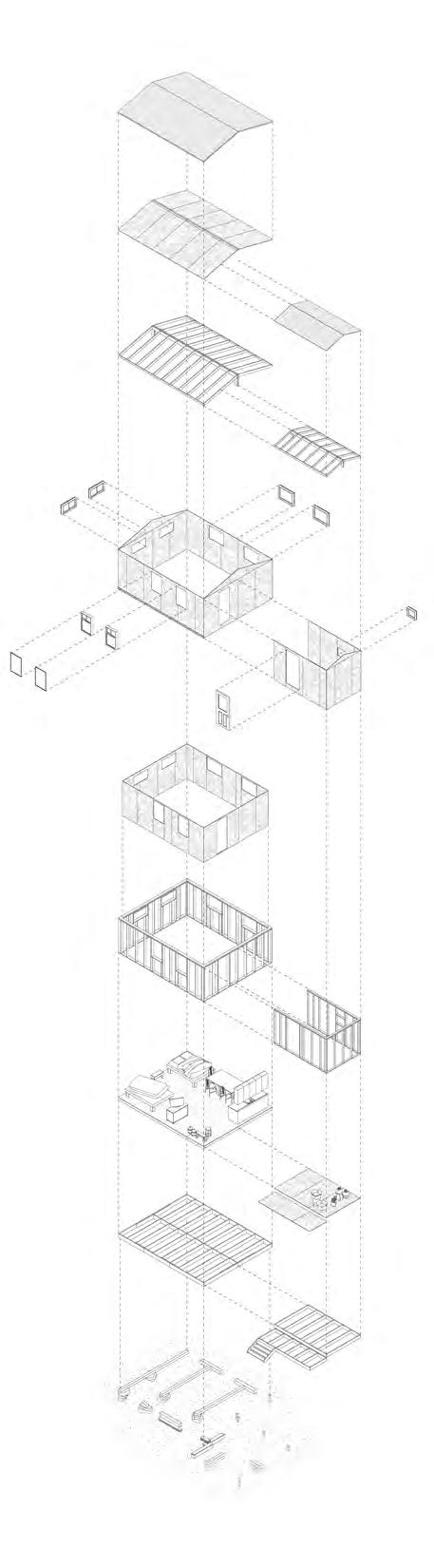



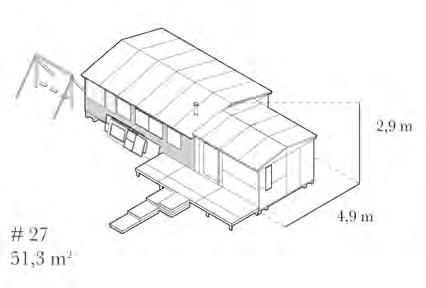
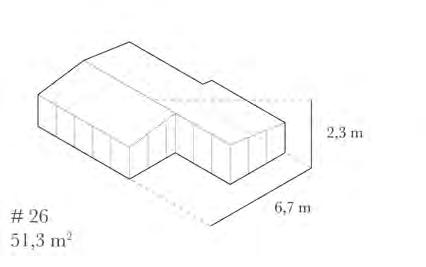
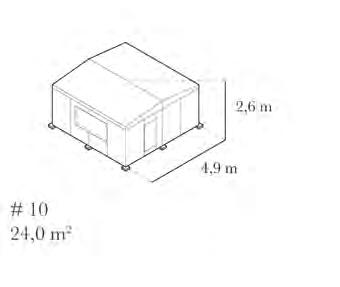
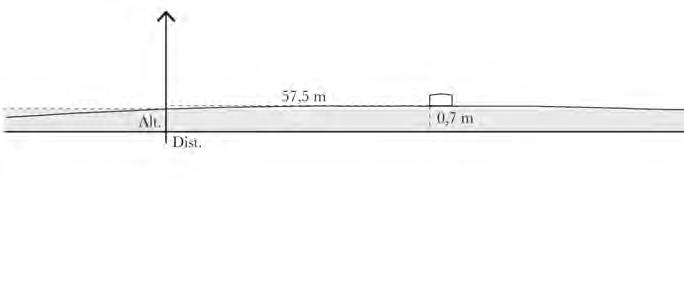
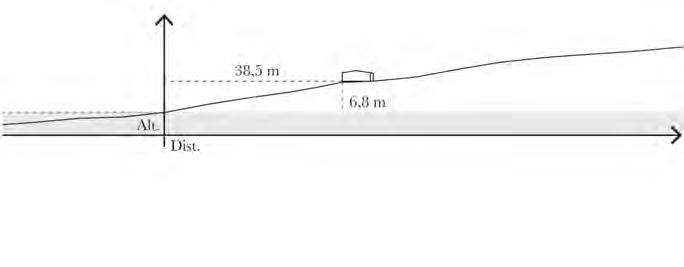
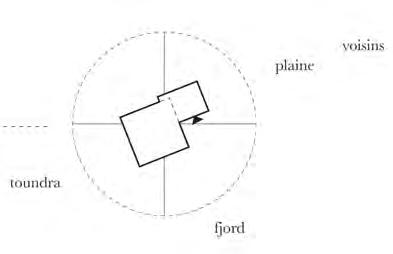

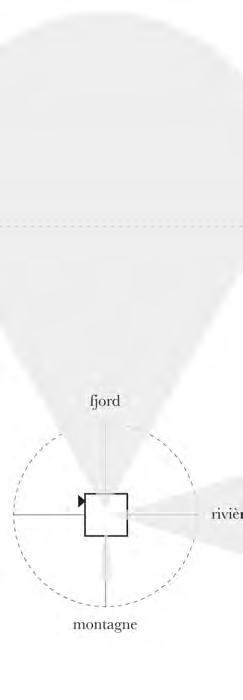



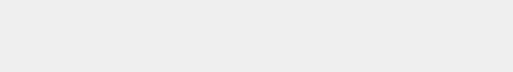
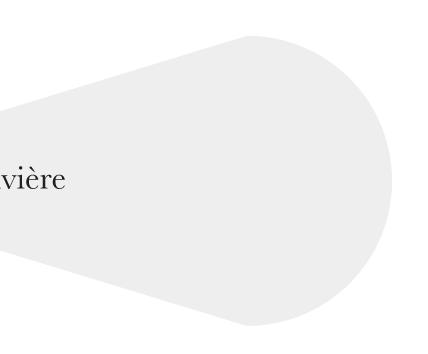

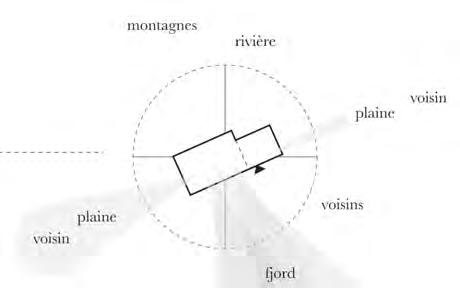
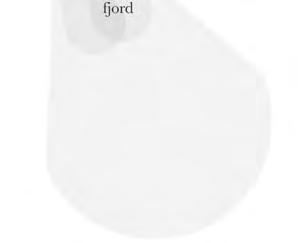
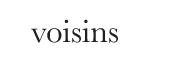
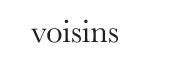
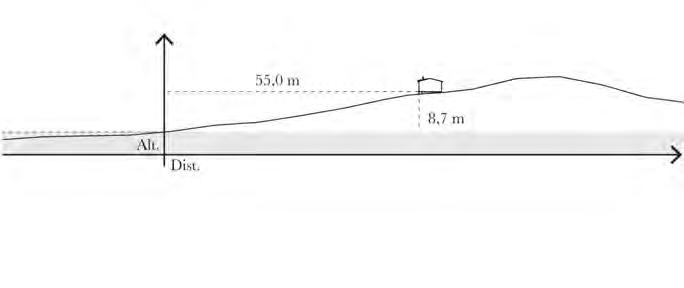





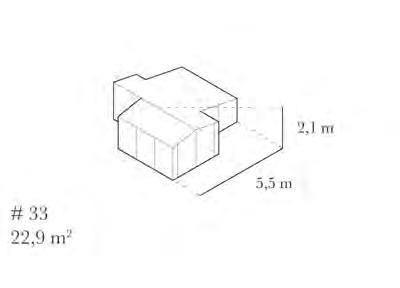
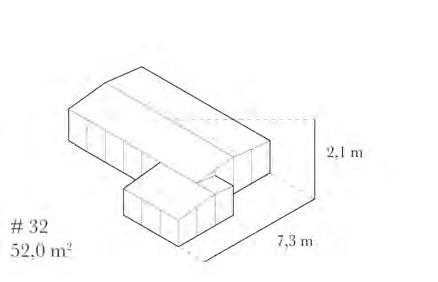
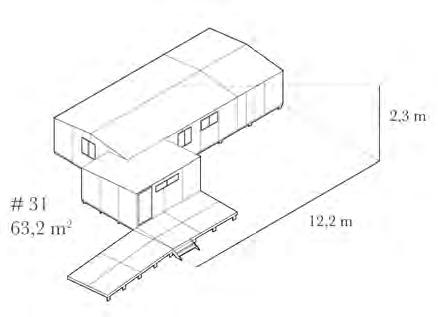
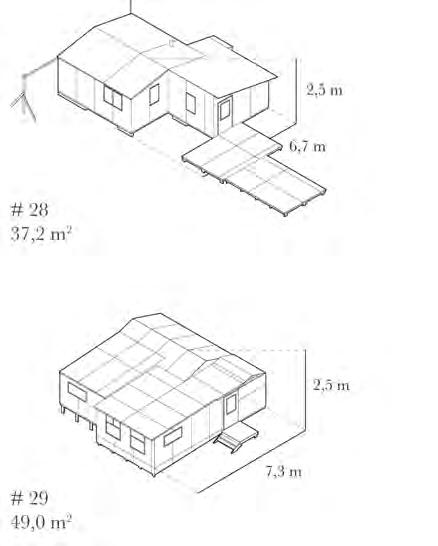
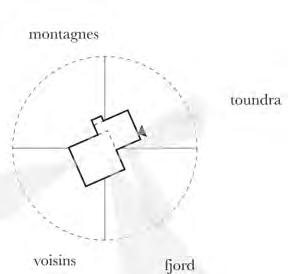
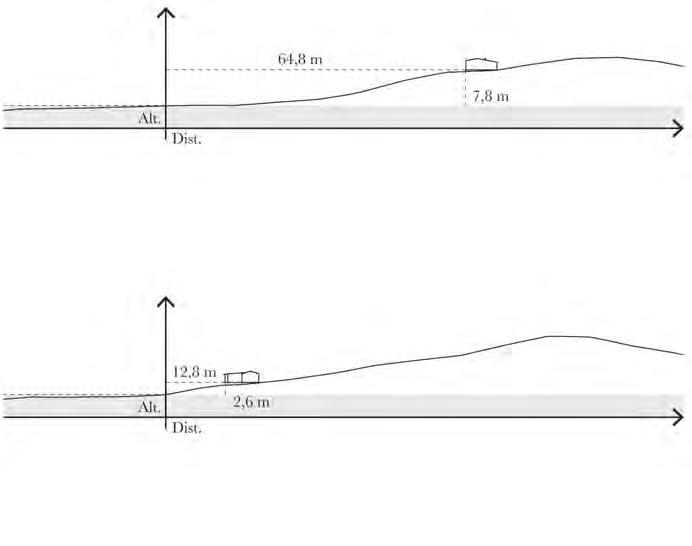
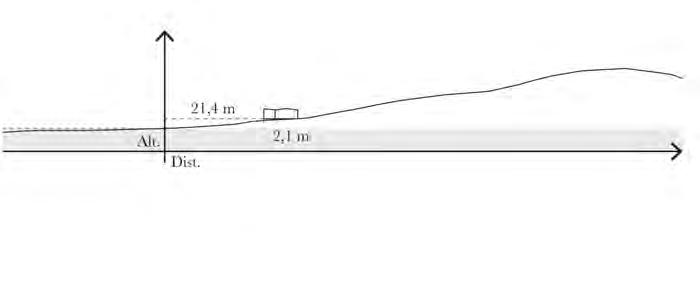
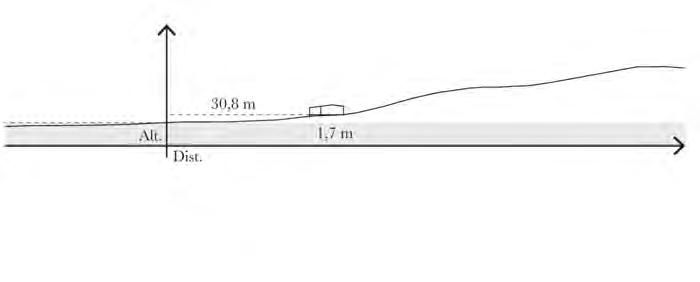
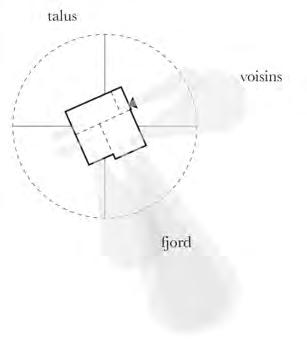
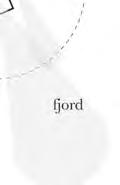
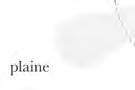

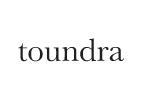
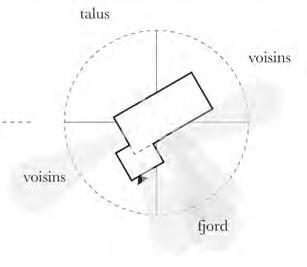
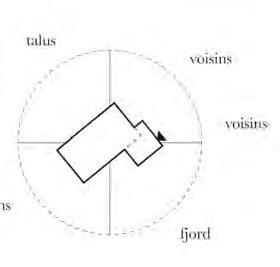
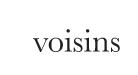

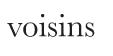
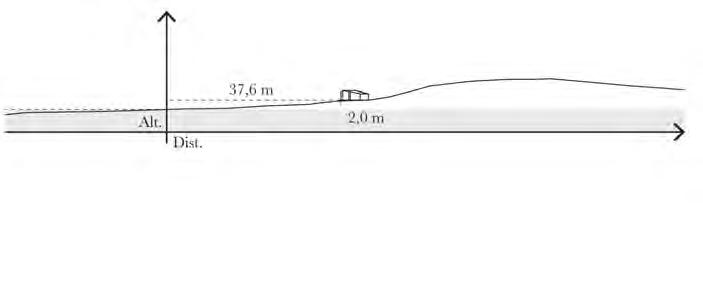
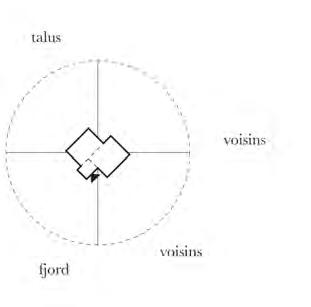
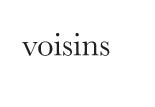



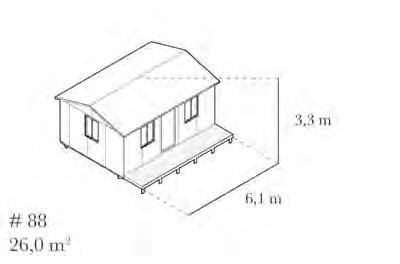
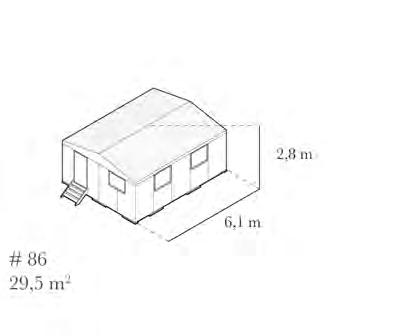
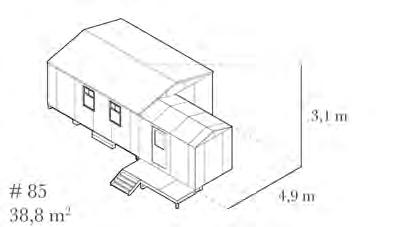
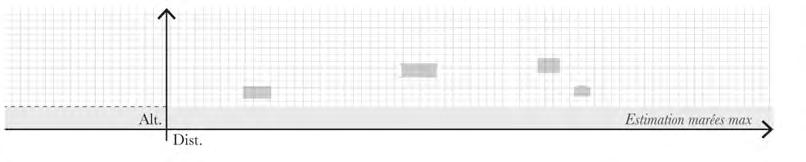
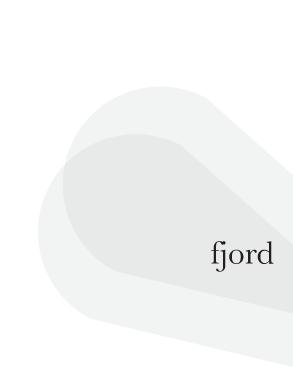

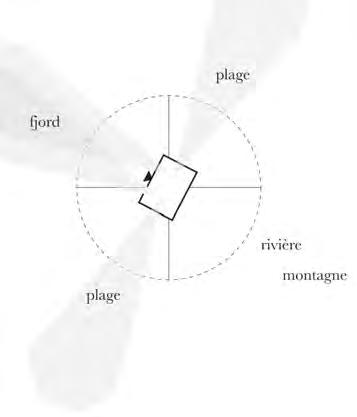

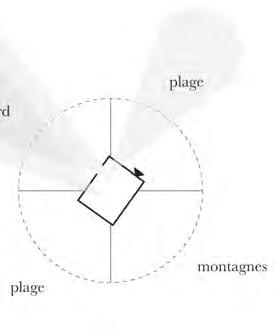

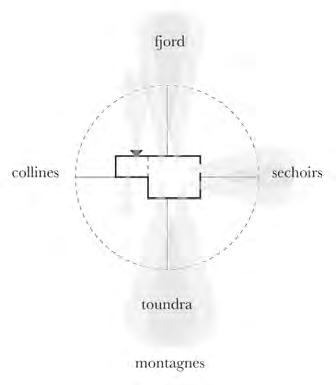
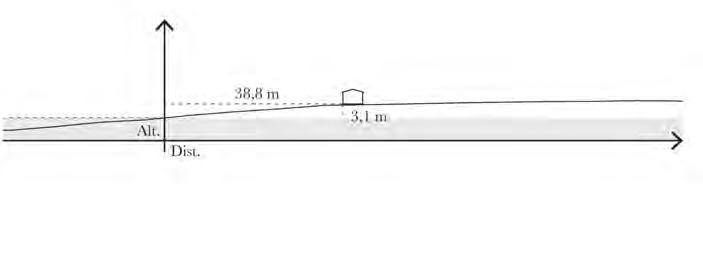
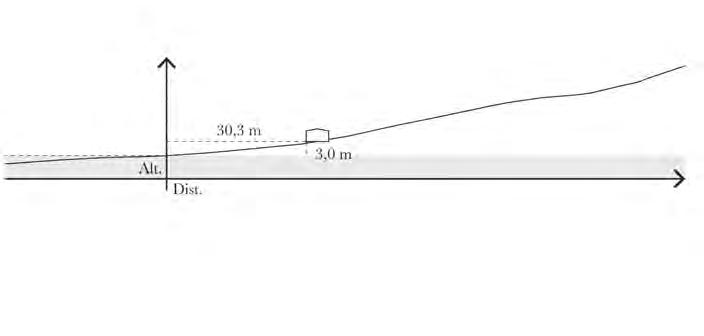
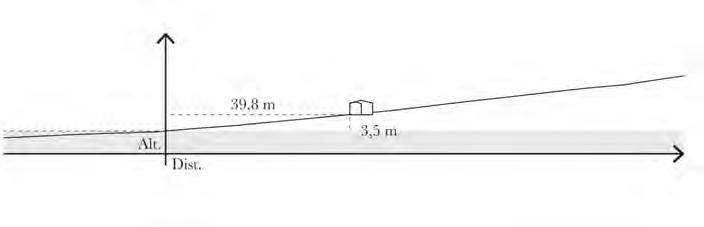
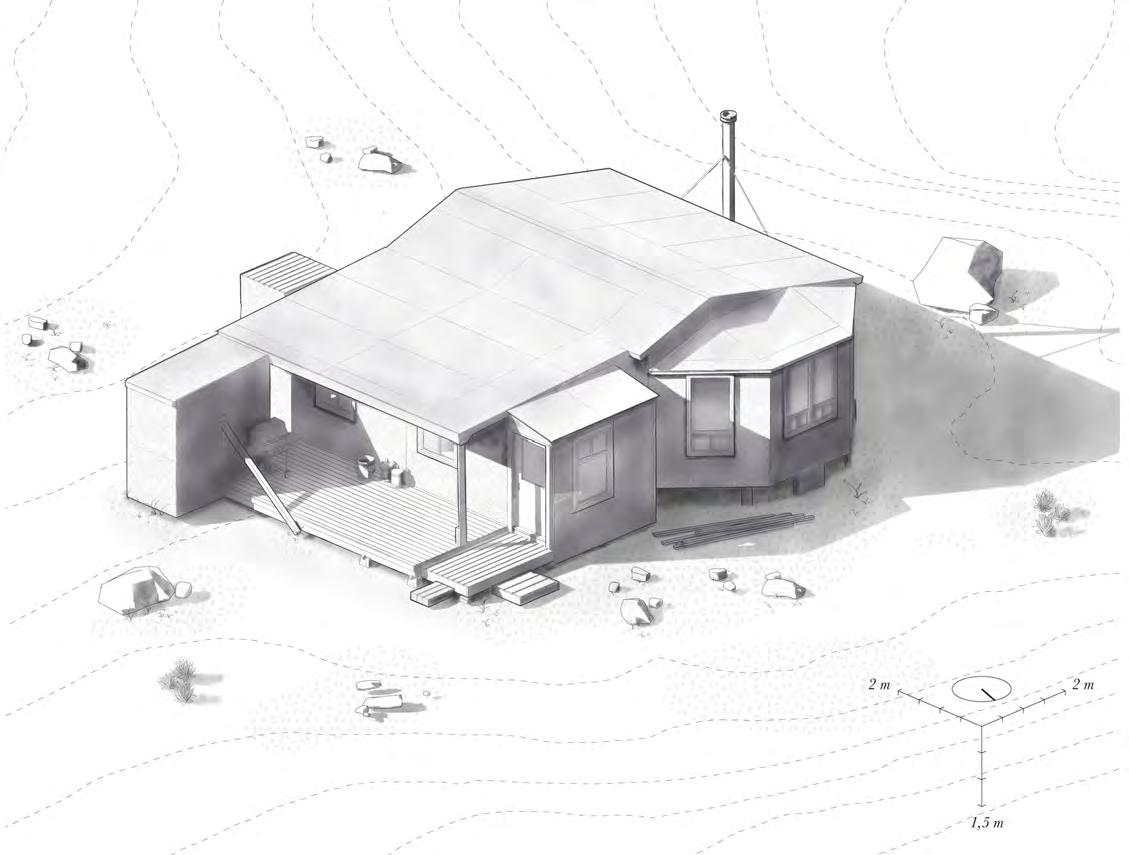
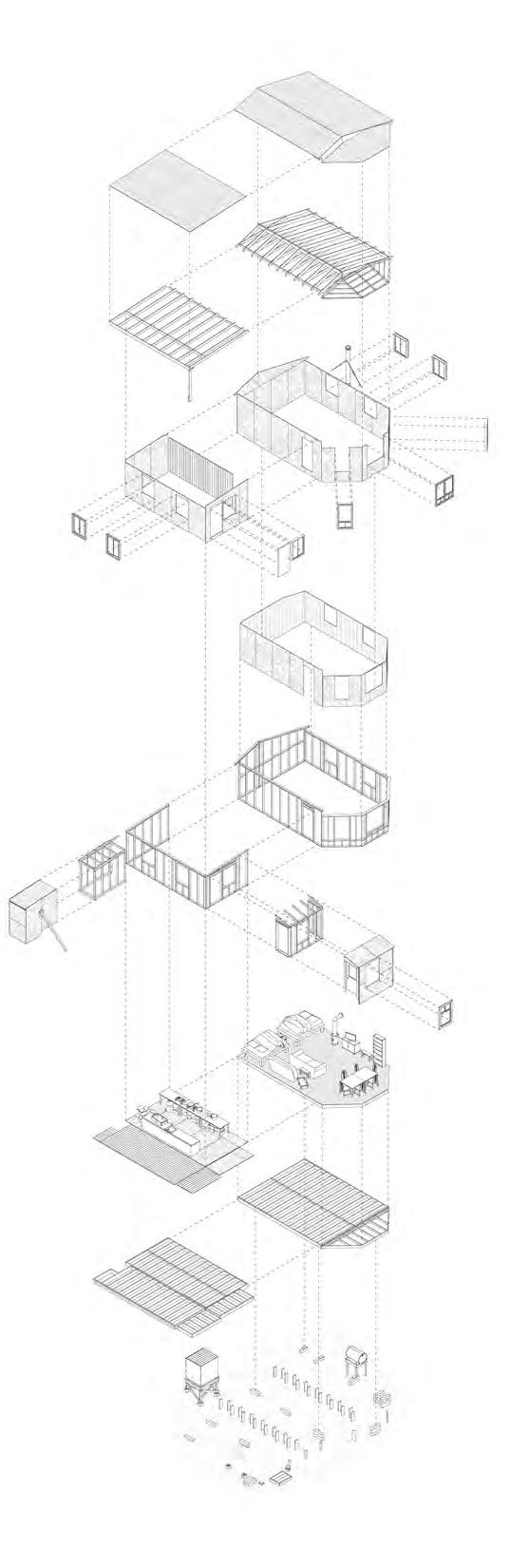



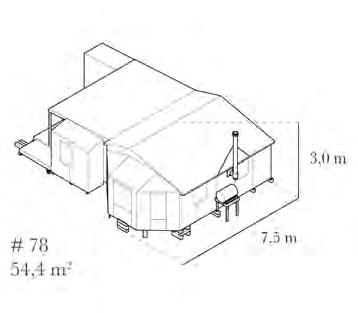
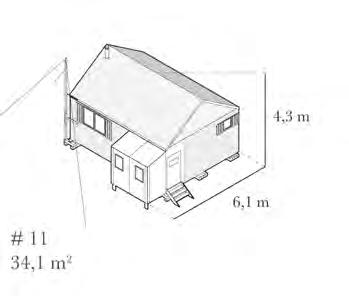
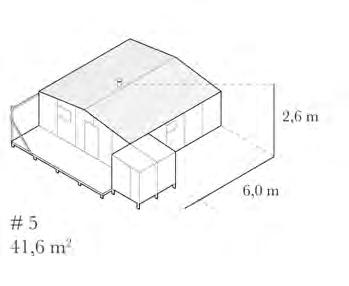 1/2 (f17)
1/2 (f17)
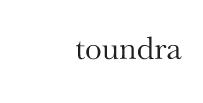

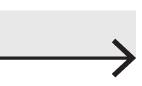

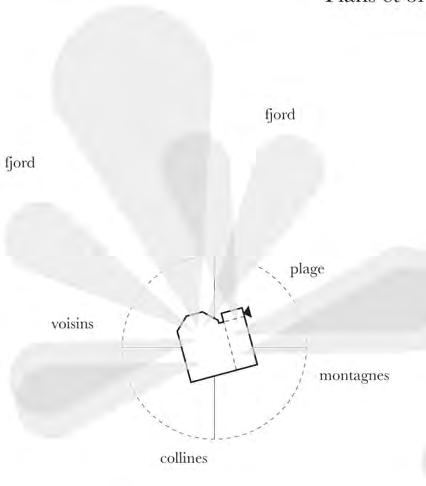
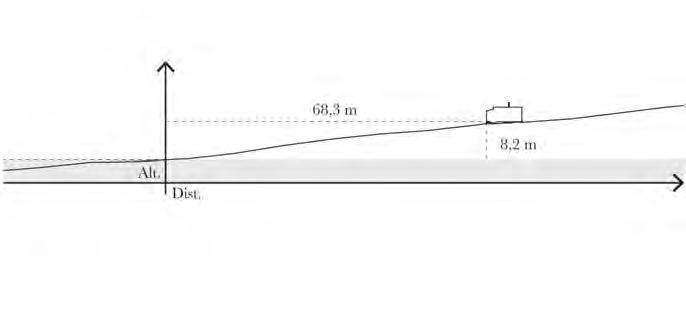
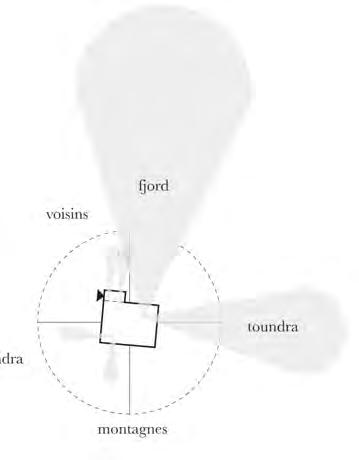
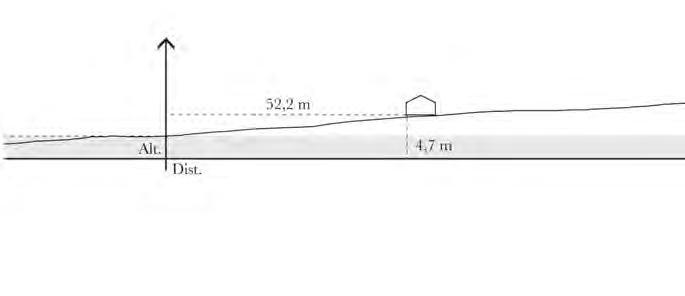
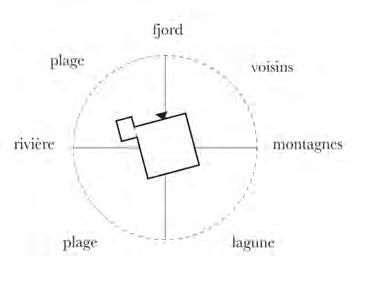
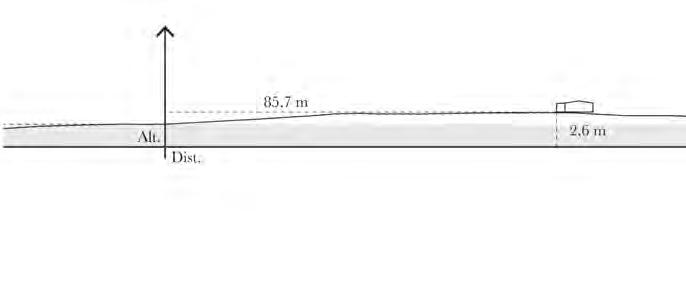


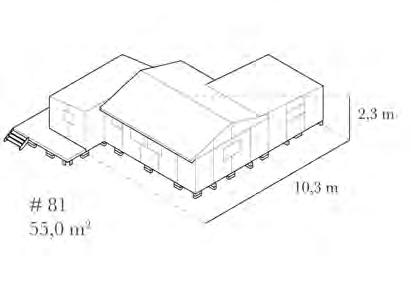
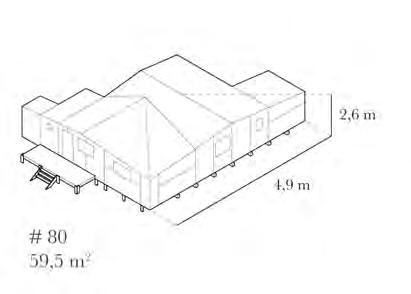
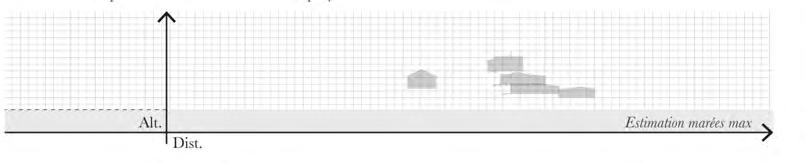
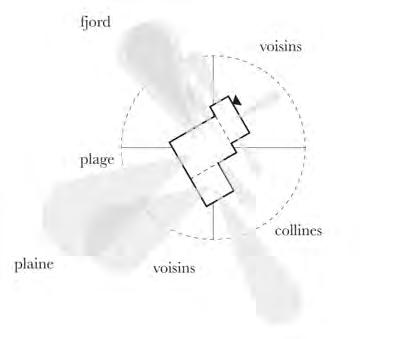
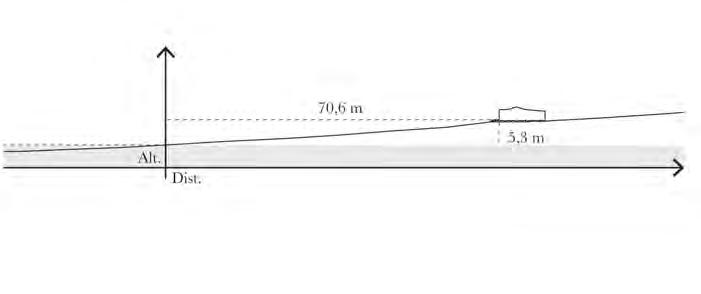
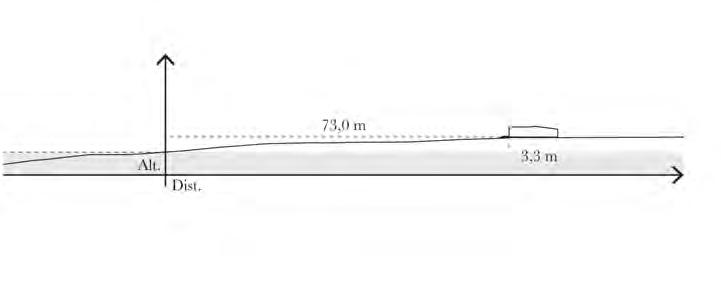
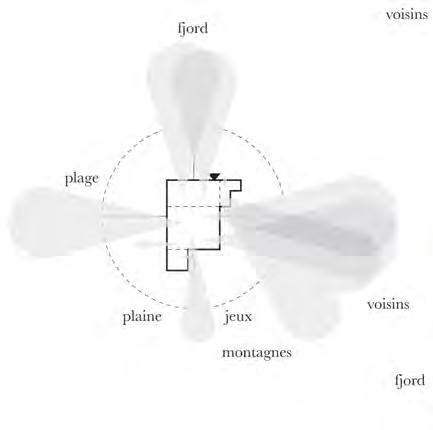

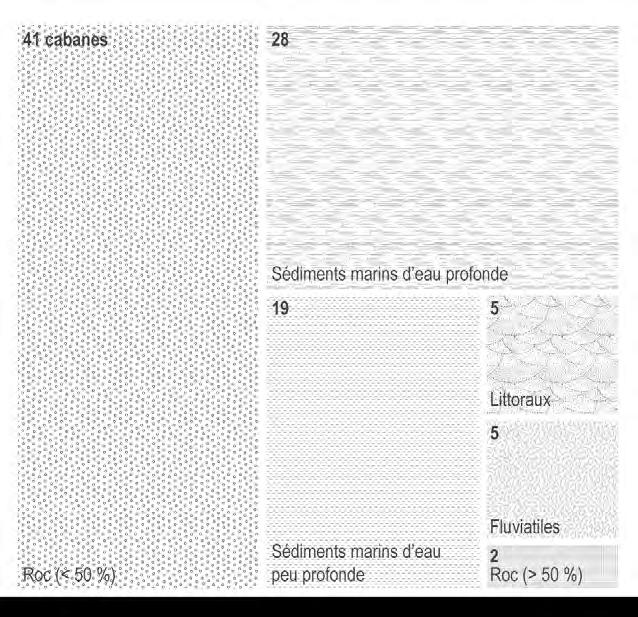
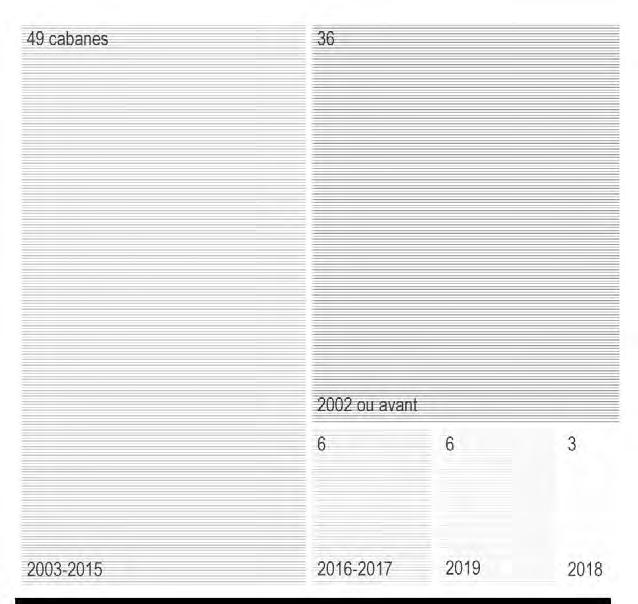 Figure 17. Nombre de cabanes par dépôts de surface répertoriées dans le fjord de Salluit.
Figure 18. Cabanes du fjord de Salluit répertoriées et construites (ou transformées) par périodes estimées.
Figure 17. Nombre de cabanes par dépôts de surface répertoriées dans le fjord de Salluit.
Figure 18. Cabanes du fjord de Salluit répertoriées et construites (ou transformées) par périodes estimées.
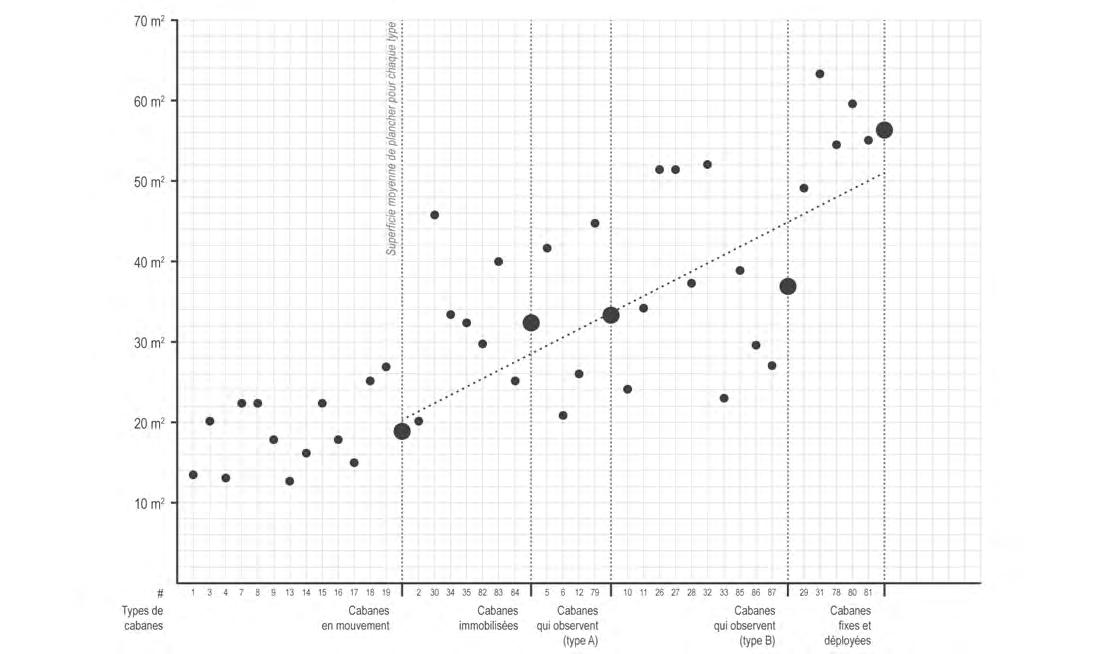
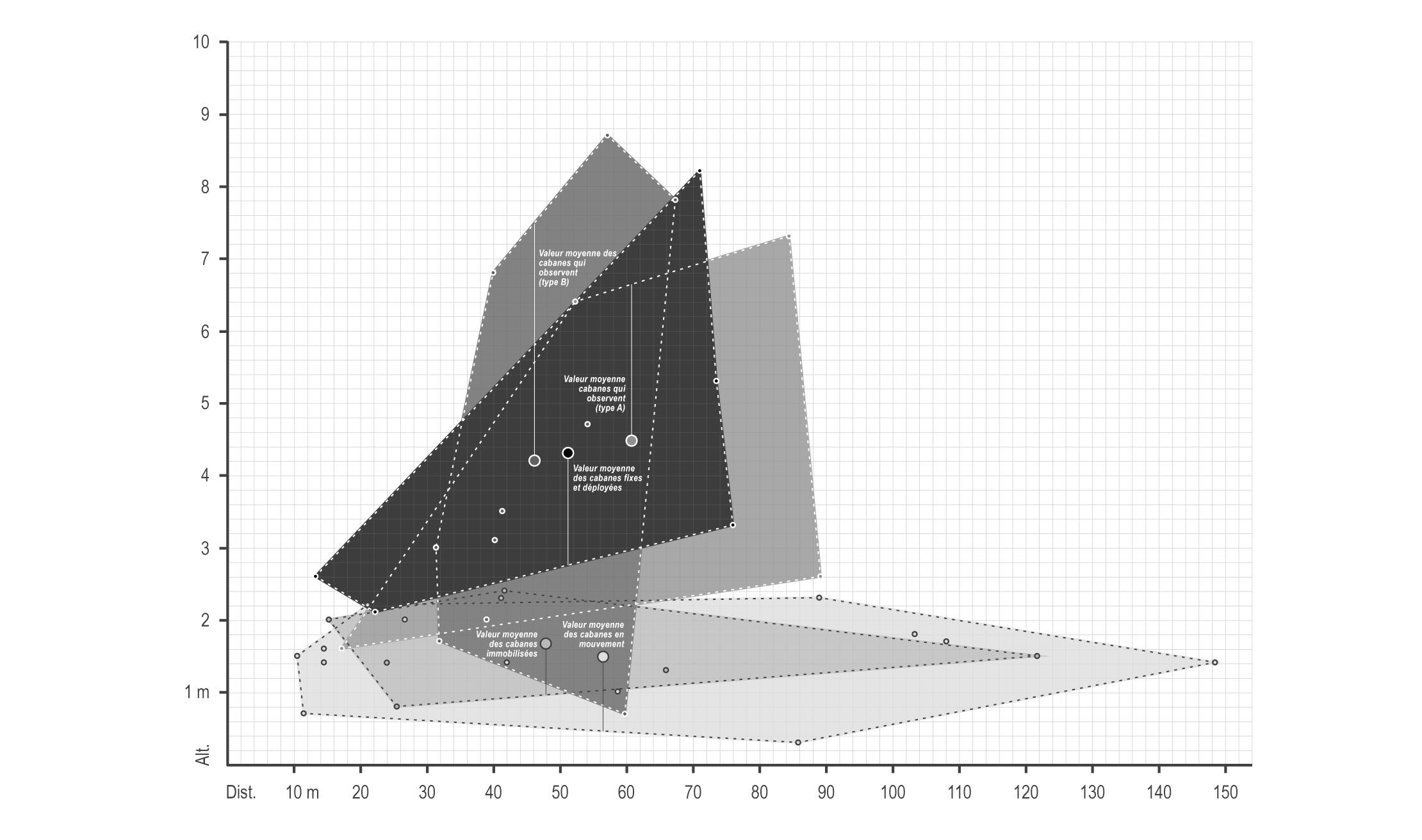 Figure 19. Corrélation entre la position des cabanes (altitude et distance par rapport à la rive) et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 20. Corrélation entre la superfcie de plancher des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 19. Corrélation entre la position des cabanes (altitude et distance par rapport à la rive) et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 20. Corrélation entre la superfcie de plancher des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
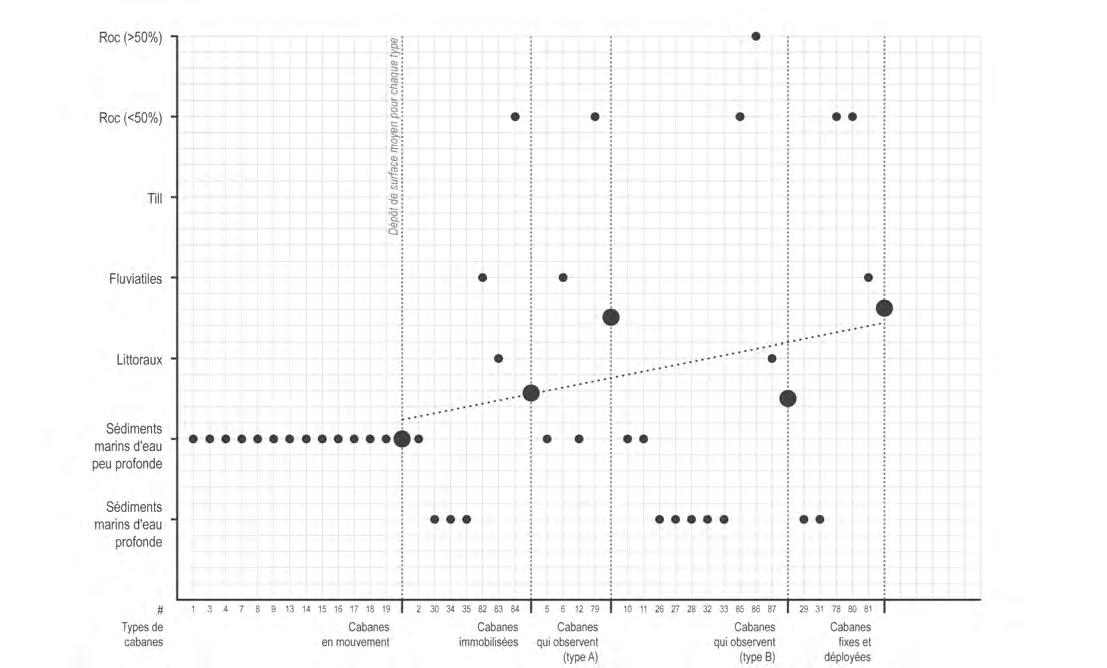
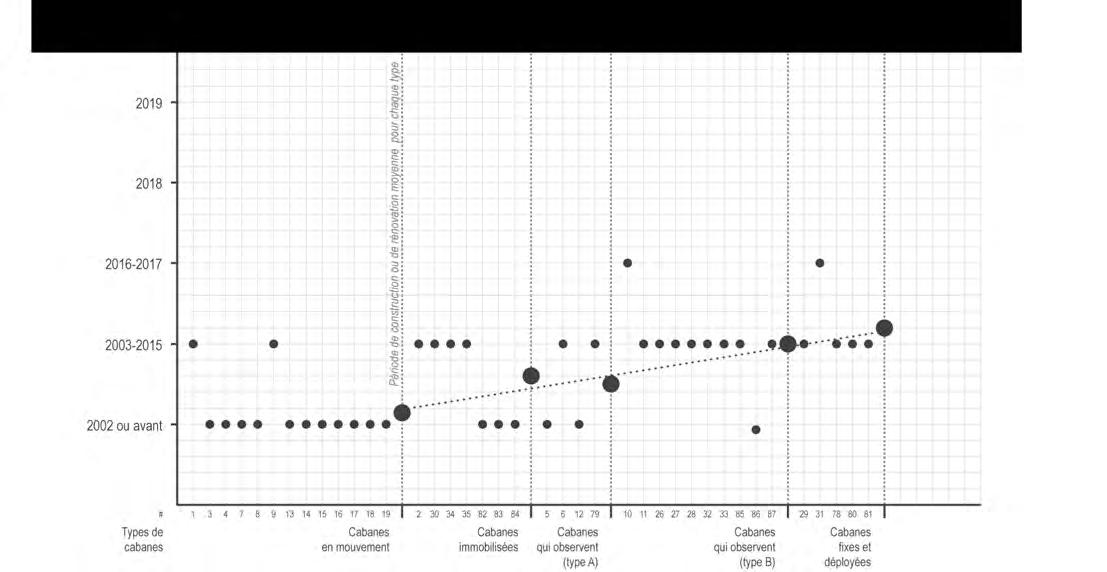 Figure 21. Corrélation entre la période de construction (ou de transformation) des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 22. Corrélation entre les dépôts de surface sur lesquels sont construites les cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 21. Corrélation entre la période de construction (ou de transformation) des cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.
Figure 22. Corrélation entre les dépôts de surface sur lesquels sont construites les cabanes et les cinq différents modèles de cabanes répertoriés dans le fjord de Salluit.




