DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE

CHAPITRE 5
CHAPITRE 6
CHAPITRE 8

LES POISSONS D’EAU DOUCE
80 espèces de poissons vivent dans les eaux douces françaises – 200 en Europe –et beaucoup proviennent d’introductions
Les poissons sont des vertébrés adaptés à la vie aquatique : le corps est plus ou moins fusiforme, couvert d’écailles, la respiration s’effectue par les branchies, les nageoires figurent les membres . Et quelle diversité ! Tant dans les formes (la petite épinoche ne ressemble guère à l’anguille qui diffère fortement de la truite) que dans les habitats (la truite colonise les eaux froides et rapides, la brème vit dans les eaux lentes et tempérées) ou encore dans le comportement (le gardon vit en bancs, le brochet est isolé, le saumon et l’anguille effectuent pour se reproduire des migrations sur plusieurs milliers de kilomètres) .
Le monde des poissons demeure à la fois énigmatique et merveilleux .

QUESTIONS SUR LES POISSONS
Parfaitement adaptés à la vie aquatique
Le poisson vit dans un milieu qui nous est inconnu . La densité du corps est identique à celle de l’eau . Il ne pèse rien dans l’eau ! Pour monter ou descendre dans l’eau le poisson applique le principe d’Archimède : il gonfle ou vide sa vessie natatoire, sorte de poche emplie de gaz Sa forme hydrodynamique facilite ses déplacements Sa colonne vertébrale comprend de nombreuses vertèbres, ce qui lui donne une grande souplesse Le mucus qui couvre son corps le protège du milieu extérieur et lui permet de mieux glisser dans l’eau .
Des nageoires
À la manière de la quille d’un bateau, les nageoires anale et dorsale servent à équilibrer le poisson Mue par des muscles puissants, la caudale lui permet de se mouvoir Quant aux nageoires paires, pectorales et pelviennes (aussi appelées « ventrales »), elles correspondent aux membres des autres vertébrés et servent au poisson à demeurer en place ou à changer de direction . Chez les salmonidés et le poisson-chat existe une seconde petite nageoire dorsale (nommée « adipeuse ») .
Locomotion
Les déplacements des poissons sont provoqués par les mouvements alternatifs de la queue Il peut avancer ou reculer Selon la forme, la taille et la position des nageoires, le poisson peut nager rapidement (saumon, chevesne) ou bondir violemment sur une proie (brochet) . Sa vitesse de pointe peut être importante : 5 m/s (saumon), 4,5 m/s (truite), 2,5 m/s (chevesne), 0,6 m/s (ablette), 0,3 m/s pour le brochet et la carpe pourtant capables de démarrages foudroyants Le poisson ne peut guère maintenir longtemps des efforts soutenus
Respiration
Le poisson respire en extrayant l’oxygène dissous dans l’eau . Cela se fait au travers des membranes des branchies . Cette solution le fragilise énormément car l’oxygène dans l’eau est rare (moins de 10 mg/l) et à travers ces membranes passent aussi certains sels et, hélas, les toxiques L’eau entre par la bouche, baigne les branchies qui captent l’oxygène et rejettent le gaz carbonique, et sort par les ouïes
Reproduction
Les poissons n’ont pas d’organes copulateurs . La ponte se déroule dans l’eau La femelle émet une quantité importante d’ovocytes (2 000 pour la truite, plus de 100 000 chez la carpe) en une ou plusieurs fois que le mâle arrose de sa laitance La fraye se déroule en couple (salmonidés, silure) ou en groupe (cyprinidés)
Bien que les spermatozoïdes meurent rapidement au contact de l’eau, la fécondation demeure efficace : plus de 99 % . Les œufs adhèrent au support (plantes, racines des arbres, graviers) ou sont enterrés dans les graviers du fond (truite, saumon) La ponte est hivernale (salmonidés), printanière (cyprinidés, brochet, percidés) ou estivale (carpe, tanche)
à la naissance les alevins sont alourdis par la vésicule vitelline qui correspond aux réserves de l’œuf Les alevins de truite demeurent dans les graviers du fond durant une dizaine de jours avant de sortir (émergence) et de commencer à nager Les alevins de cyprinidés et de brochet demeurent collés au support durant quelques jours, avant de se déplacer et de s’alimenter librement . Sauf accident le taux d’éclosion est très élevé (90 à 95 %) . Mais il faut constater que dans une population en équilibre, un couple de poissons est remplacé par un autre au bout de 3 ans ! Ce qui signifie qu’en 3 ans, seules 2 truites survivront et que sur les 2 000 alevins, 1998 vont disparaître, toutes causes confondues L’essentiel des mortalités intervient à la sortie des frayères par prédation d’autres poissons (truites, anguilles, etc ) Certaines disparaissent de leur belle mort, et un petit nombre (10 à 20) à cause des pêcheurs . Les pertes sont bien plus importantes pour les cyprinidés et autres espèces d’eaux calmes . Cela signifie aussi que les prélèvements par la pêche ne mettent guère en péril les populations de poissons et que pour maintenir un équilibre, les prélèvements sont nécessaires ! En effet, les poissons ne peuvent s’accumuler indéfiniment dans un milieu qui a des capacités de production limitées Le cas des perches qui demeurent naines est bien connu . Elles ne grossissent plus parce que la nourriture est insuffisante . Le fait d’introduire des brochets rétablit souvent la situation .
Le poisson, animal sensible
Il n’est pas aisé de comprendre comment le poisson appréhende son milieu de vie qui n’est pas celui des humains La vue n’est pas déficiente, elle est différente de la nôtre Exception faite du brochet, le poisson n’a pas, comme nous, de vue bilatérale : chaque œil voit de son côté . On peut penser qu’il distingue mal les reliefs . Mais le poisson possède d’autres sens . Par sa ligne latérale et ses pores sensitifs, il repère les courants mais aussi les ondulations et vibrations provoquées par des objets flottants, par d’autres poissons ou encore par des proies éventuelles Le pêcheur aux leurres utilise
cette particularité pour attirer l’attention du carnassier . La principale différence entre poissons et animaux terrestres concerne la perception du goût et des odeurs Les terminaisons sensitives situées sur la tête et dans les barbillons permettent au poisson de repérer une proie (surtout si elle est blessée) ou à l’inverse un danger imminent Ainsi les petits poissons parviennent-ils à déterminer si un brochet est en chasse : en ce cas ils fuient, sinon ils demeurent à proximité de leur prédateur . Les carpes s’habituent à certaines odeurs (les pêcheurs parfument leurs appâts), les anguilles sont attirées par les vers de terre blessés… Le silure semble être le plus apte à repérer des effluves très délicats Sa vue est basse, mais il parvient à détecter le fer de l’hameçon mal caché !
Longévité
Combien de temps vit un poisson ? La modeste épinoche ne connaît qu’un été . La plupart des poissons ne dépassent pas 3 à 5 ans La reproduction, qui affaiblit considérablement les reproducteurs, entraîne des mortalités souvent fortes Le saumon qui a jeûné durant plusieurs mois et s’est blessé en creusant sa frayère dans les graviers ne parvient pas toujours à regagner la mer Les carpes vivent une vingtaine d’années, bien moins que la légende ne le prétend . Les anguilles qui partent en mer ont entre 7 et 15 ans . Le silure semble atteindre une trentaine d’années .
Alimentation et digestion
Le régime alimentaire des poissons varie selon les espèces Quelques-uns sont végétariens (cyprinidés), mais la plupart sont omnivores et consomment des débris végétaux, des algues et aussi des invertébrés (vers, crustacés, mollusques, insectes et leurs larves) .
Les prédateurs (brochet, perche, sandre silure) s’attaquent aux petits poissons, y compris leurs congénères .
Mais il faut remarquer que les alevins de toutes les espèces consomment du zooplancton Le tube digestif des carnassiers est bien différencié et court
Anatomie d’un poisson















































Les dents servent à maintenir ou à blesser les proies qui sont avalées entières, la digestion débute dans l’estomac aux sucs très actifs et se termine dans l’intestin . Les cyprinidés ont au contraire un tube digestif très long et la digestion est peu efficace . Les aliments sont broyés par les dents situées dans le pharynx, l’estomac n’est pas différencié . Et pour digérer graines et végétaux les poissons utilisent les enzymes des proies animales .























Origine des poissons




















En 1960, on recensait environ 65 espèces de poissons ; en 2030, on en comptera une centaine . L’omble chevalier, le brochet, le saumon, la truite existent depuis les temps préhistoriques . La carpe a été introduite par les Romains il y a 20 siècles . Après 1860, les introductions furent nombreuses : truite arc-en-ciel, black-bass, poisson-chat, perche-soleil… Plus récemment firent leur apparition dans nos eaux sandre, silure (qui existait il y a très longtemps mais avait disparu), aspe et aussi un certain nombre de cyprinidés (vimbe, brèmes du Danube, etc .) arrivés avec les achats de poissons en Europe centrale . Quant aux gobies, ils sont venus dans le ballast des péniches en provenance de Roumanie .










LES ESPÈCES






Able












L’un de nos plus petits poissons . D’une rapidité exceptionnelle, il permet au pêcheur d’acérer ses réflexes .




Ablette
Ce petit poisson vif-argent est bien fragile : ses écailles restent souvent collées à la main du pêcheur et sa bouche résiste mal à des gestes un peu brutaux .



NOMS LATIN ET LOCAUX : Lecaspius delineatus , dos vert, eucalyptus .
DESCRIPTION : L’able ressemble à une petite ablette mais s’en distingue par sa bouche nettement dirigée vers le haut et sa ligne latérale incomplète (qui s’étend sur 8 à 14 écailles) . Le dos est vert brunâtre, les flancs argentés sont marqués par une bande bleu acier .






TAILLE : L’able ne dépasse pas 5 à 7 cm .



HABITAT ET COMPORTEMENT : L’able colonise les plans d’eau et les rivières lentes, riches en végétation, où il vit en bancs à proximité de la surface . L’able consomme des crustacés, du plancton, de petites larves et des fragments de plantes . La ponte est printanière . Des replis de la peau permettent à la femelle de déposer une centaine d’œufs sur les végétaux .
GESTION : Les ables sont parfois introduits dans les étangs lors de repeuplements avec d’autres poissons blancs .

NOMS LATIN ET LOCAUX : Alburnus alburnus , blanchet, mirandelle, sardine, Laube, abbé, garlesco, abiette, coureur .

DESCRIPTION : Le corps allongé est comprimé latéralement, ce qui lui permet une grande rapidité de mouvement . La bouche, grande est dirigée vers le haut, la mâchoire inférieure dépasse le maxillaire supérieur, ce qui laisse penser que l’ablette se nourrit en surface . La nageoire dorsale est insérée en arrière des ventrales et la caudale est très échancrée . L’anale est longue . Les écailles sont grandes et peu adhérentes . Les écailles brillantes donnent aux flancs des reflets argentés, le dos est gris-bleu . Les nageoires sont grisées .








TAILLE : 8 à 14 cm pour un poids de 10 à 40 g .
LONGÉVITÉ : 6 à 7 ans .




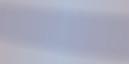

HABITAT ET COMPORTEMENT : L’ablette se plaît dans les eaux courantes des rivières et fleuves de plaine . Elle se trouve aussi dans les lacs profonds . On la trouve souvent à proximité des rejets des stations d’épuration

ou des égouts et des eaux un peu plus chaudes des centrales électriques .
L’ablette a des mœurs grégaires, elle vit en bandes, à proximité de la surface dans les eaux claires . L’ablette semble une proie facile pour les carnassiers : les perches poursuivent longuement les jeunes . Leur vie en bancs constitue leur seule défense avec la fuite éperdue . Le brochet, l’anguille et le silure s’en nourrissent régulièrement . La pollution l’a parfois fait disparaître . Son retour marque une amélioration de la qualité des eaux .
NOURRITURE : Omnivore et opportuniste, l’ablette se nourrit essentiellement de larves et d’animalcules aquatiques (larves, crustacés du zooplancton) . En été, elle capte en surface des insectes et leurs larves ainsi que les insectes aériens qui tombent à l’eau (moucherons, fourmis, etc .) .
REPRODUCTION : La maturité sexuelle intervient à 2 ans . La ponte se déroule durant le printemps dans des eaux à 15 °C . La femelle dépose en plusieurs fois 5 000 œufs sur le sable du fond ou les plantes aquatiques . En cette période, les mâles portent des boutons de noce sur le dos . Les alevins éclosent au bout de 2 à 3 semaines .
DISTRIBUTION : Elle est présente dans toute la France et en Europe .
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
L’ablette vit en bancs . Elle est active à la sortie de l’hiver, lorsque les rivières sont hautes et leurs eaux sales, surtout s’il gèle la nuit et que le soleil brille dans la journée . Elle est attirée par des eaux colorées : l’amorçage sera à base de produits fins et blancs . En été, le soir elle gobe régulièrement, elle se pêche à la fourmi ou avec de minuscules mouches .
Alose
Les aloses sont des poissons migrateurs voisins des harengs et des sardines . On les pêche peu, à tort, à la mouche ou à la cuiller .

NOMS LATIN ET LOCAUX : Alosa alosa, sabre, coulaqua, aloso, joguine, aloson (jeunes) .

DESCRIPTION : L’alose a un corps aplati latéralement, recouvert d’écailles peu adhérentes . La caudale est largement échancrée, les opercules sont marqués de stries et la ligne latérale peu visible . La bouche est largement fendue . L’œil possède 2 membranes . Les écailles de la face ventrale forment une carène caractéristique . Le dos est bleu-verdâtre, les flancs argentés très brillants . Une tache sombre se situe à l’arrière de la tête .







TAILLE : La grande alose mesure de 40 à 70 cm pour un poids de 500 g à 2,5 kg .





COMPORTEMENT : Les aloses vivent en bancs en pleine eau dans leur vie marine .
NOURRITURE : L’alose consomme essentiellement les crustacés du plancton ; de petits poissons complètent son alimentation en mer, surtout en été .
REPRODUCTION ET MIGRATIONS : Les aloses profitent des crues de printemps pour venir se reproduire dans les fleuves entre mai et juillet . La ponte est nocturne et spectaculaire ; elle se produit en groupes . La femelle libère en pleine eau 100 000 œufs qui se collent ensuite aux graviers du fond . Les géniteurs meurent en grand nombre après
la ponte . Les juvéniles descendent vers les estuaires lors des montées d’eau durant leur premier automne .
PROTECTION : L’alose a vu son aire de dispersion se réduire du fait de la pollution et de la construction de barrages bloquant ses migrations . Les aménagements des barrages lui permettent de récupérer des zones où elle avait disparu . L’extraction des graviers dans le lit des fleuves et la présence de gros carnassiers à proximité des obstacles et lors de la reproduction nuisent aux populations d’aloses .
Alose feinte

NOMS LATIN ET LOCAUX : Alosa fallax , feinte, gate, astouna, vérot .

DESCRIPTION : L’alose feinte ressemble à la grande alose . Elle s’en distingue par un corps moins élevé et par la présence de 4 à 8 taches noires sur les flancs . Il existe une variété (Alose du Rhône) inféodée au bassin méditerranéen .






TAILLE : Sa taille ne dépasse guère 30 cm .
HABITAT ET COMPORTEMENT : L’alose feinte demeure à proximité des côtes et remonte les fleuves souvent moins en amont que la grande alose .
REPRODUCTION : La ponte se déroule en début d’été . La femelle pond ses œufs en pleine eau sur des fonds de graviers . La plupart des reproducteurs survivent après la ponte .
Anguille
Ce poisson demeure mystérieux, il traverse l’Atlantique dans les deux sens . L’anguille part pour se reproduire et les jeunes reviennent coloniser nos rivières . Longtemps considérée comme ressource inépuisable, elle est aujourd’hui classée en danger .


DESCRIPTION : L’anguille se distingue aisément à son corps serpentiforme, très allongé et cylindrique . La ligne latérale est bien marquée . La peau lisse semble dépourvue d’écailles (elles sont en fait très petites et insérées profondément) et produit un mucus épais . Les nageoires pelviennes sont absentes et les nageoires dorsale, caudale et anale sont fusionnées en une nageoire unique . La taille des yeux varie en fonction du développement du poisson, petit chez l’anguille sédentaire (jaune), il s’agrandit et s’opacifie lorsque le poisson se prépare à migrer (anguille argentée) . Le dos est sombre noir, brunâtre ou verdâtre selon les habitats . Le ventre est jaune dans la forme sédentaire . Au stade migrateur, le dos s’éclaircit, les flancs ont des reflets argentés et le ventre est blanc .





TAILLE : L’anguille mesure de 30 à 80 cm (exceptionnellement 1 m) pour un poids de 100 g à 2 kg . Les femelles sont en général plus grandes que les mâles . Les poissons qui dépassent 50 cm sont tous femelles .


LONGÉVITÉ : 12 à 20 ans . Les mâles séjournent dans les

eaux douces durant 5 à 10 ans et les femelles durant 10 à 20 ans Les jeunes anguilles qui atteignent nos côtes ont près de 2 ans Il est vraisemblable que les géniteurs meurent après la reproduction, de l’autre côté de l’Atlantique
HABITAT : L’anguille en eau douce se répartit de l’estuaire vers l’amont . Sa densité dépend des habitats disponibles (végétation, arbres, racines, rochers) . Les possibilités de franchissement des obstacles (barrages) déterminent les limites de ses migrations vers l’amont L’anguille se sédentarise pour plusieurs années dans les rivières de plaine, les lagunes, les plans d’eau en relation plus ou moins continue avec les eaux courantes Elle vit également dans les lagunes littorales où la salinité est celle de la mer (20 à 30 g/l) et résiste même dans des eaux hypersalées .
COMPORTEMENT : L’anguille fuit la lumière et a une activité essentiellement nocturne et crépusculaire Elle semble assez sédentaire, ce qui n’empêche pas des déplacements vers l’amont durant le printemps La capacité de reptation des jeunes anguilles en dehors de l’eau est très développée, ce qui leur permet de contourner des obstacles Cette possibilité est utilisée dans les passes à civelles, plans inclinés couverts d’un tapis à poils longs sur lequel est maintenu un filet d’eau et qui permettent aux civelles de franchir des obstacles hermétiques . Le mucus épidermique jouerait un rôle dans la communication entre les membres d’une population d’anguilles
NOURRITURE : Les larves semblent consommer des organismes unicellulaires Les civelles jeûnent, leur tube digestif est fermé . Dès qu’elles se pigmentent, les anguillettes absorbent des organismes du plancton . Les anguilles jaunes consomment des invertébrés et des petits poissons . Au stade argenté, elles cessent de s’alimenter mais et supportent un jeûne prolongé (un an)
REPRODUCTION ET CYCLE BIOLOGIQUE : L’anguille est un
poisson migrateur qui naît en mer et effectue sa croissance en eau douce (amphihalin et thalassotoque) La reproduction s’effectue en mer des Sargasses (dans le golfe du Mexique), c’est-à-dire à près de 8 000 km des côtes européennes ! Inutile de préciser que leurs déplacements continuent de poser de grandes interrogations aux biologistes Les larves qui éclosent (leptocéphales) naissent à une profondeur de 100 à 500 m . Elles mesurent 5 mm et demeurent en pleine eau . Elles sont emportées par les eaux du Gulf Stream et dérivent ainsi à travers l’Atlantique Quand elles atteignent le plateau continental, au bout de 8 à 10 mois, elles mesurent 60 à 70 mm et vont se transformer en civelles au corps allongé transparent Elles parviennent sur les côtes françaises entre décembre (Pays basque) et mars (Seine) et s’aventurent dans les eaux continentales À noter qu’elles demeurent près du fond à marée basse et reprennent leur déplacement à marée haute . Plus à l’amont, alors qu’elles deviennent de plus en plus sombres, elles se déplacent la nuit et demeurent dans le sédiment le jour Quels sont les facteurs qui guident cette migration ? Vraisemblablement la sensibilité aux odeurs La colonisation semble s’effectuer par saturation des sites de l’aval vers l’amont Ensuite, elles demeurent sédentaires Les mâles se tiennent dans les parties basses des cours d’eau alors que les femelles colonisent les parties amont . Une fois atteinte la maturité sexuelle, au bout de 5 à 6 ans pour les mâles et 8 à 15 ans pour les femelles, les anguilles vont se préparer à la migration qui doit les amener dans la mer des Sargasses Des transformations importantes (épaississement de la peau, régression du tube digestif, augmentation de la masse musculaire, modification de la physiologie) vont leur permettre de passer de l’eau douce à l’eau marine La dévalaison des anguilles argentées s’effectue en hiver . Comment les anguilles se dirigent-elles en mer ? La chose demeure inexpliquée à ce jour .
DISTRIBUTION : L’anguille est présente dans l’ensemble des eaux françaises Elle colonise les lagunes littorales, mais on la trouve aussi à quelques centaines
de kilomètres de la mer, pourvu que ces zones soient accessibles .
GESTION : Longtemps considérée comme extrêmement abondante, voire nuisible, l’anguille a été pêchée, vraisemblablement surexploitée, sous ses différentes formes (civelles, anguilles jaunes et argentées) . Elle est en partie protégée depuis 2000 . Quelles sont les causes de sa régression : la surpêche certainement, mais aussi les maux dont souffrent nos rivières (pollutions, obstacles, etc .), et sans doute d’autres facteurs marins .
PROTECTION : Malgré sa protection, l’anguille est classée parmi les espèces en voie d’extinction du fait du morcellement des écosystèmes, de la surpêche, de la pollution et des effets du réchauffement planétaire . Mais elle reste encore pêchée à son stade d’alevin, la civelle .




Barbeau

Les rivières à courant soutenu abritent une population de cyprinidés d’eaux vives au corps fusiforme dont le barbeau qui trouve là un habitat de choix .
le premier rayon de la dorsale dentelé . Le dos est brunvert, les flancs présentent des reflets dorés et le ventre est jaunâtre . Les nageoires inférieures sont orangées .

TAILLE : 30 à 50 cm, pour un poids de 500 g à 3 kg, jusqu’à 70 cm (10 kg) .

HABITAT : Le barbeau fréquente les eaux courantes mais assez tempérées de la zone qui porte son nom . Il préfère les fonds caillouteux .
COMPORTEMENT : Poisson grégaire, le barbeau vit en bancs, dans les courants, à fond rocheux .

NOURRITURE : Le barbeau aspire les insectes et autres animaux vivant sur le fond .











REPRODUCTION : La ponte se déroule en début d’été (juin-juillet), parfois après des déplacements importants (10 à 20 km) . La femelle creuse des dépressions dans les graviers, elle y dépose 3 000 à 5 000 œufs . Elle pond ainsi à 5 ou 6 places .
DISTRIBUTION : Le barbeau est présent partout mais plus rare en Bretagne et dans le nord de la France .
PROTECTION : Le barbeau a beaucoup souffert des pollutions mais a reconquis ses habitats après l’extinction des dégradations .
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
NOMS LATIN ET LOCAUX : Barbus barbus , barbot, barbet, barbu .
DESCRIPTION : Le corps du barbeau a une section cylindrique, il est couvert de petites écailles profondément insérées dans la peau . La bouche aux lèvres charnues est en position infère, elle est garnie de 4 barbillons . Les yeux sont petits . La caudale est fortement échancrée et
































Le barbeau se nourrit activement sur le fond : une amorce lourde s’impose . Sachez aussi qu’il adore le fromage !
› Barbeau méridional

Dans les rivières de semi-montagne du sud de la France vit l’espèce méditerranéenne ( Barbus meridionalis)
appelée souvent « barbeau truité » qui se distingue de son cousin par sa taille plus petite (15 à 20 cm), la couleur dorée de son dos, ponctuée de mouchetures foncées . Il fréquente les eaux à fond de cailloux et de graviers et a le même comportement que le barbeau commun . En été, il parvient à survivre enfoui dans les cailloux des rivières à étiage très sévère . Cette espèce dont la répartition est limitée mérite certainement qu’on la protège .
Black-bass
Tous les pêcheurs n’ont pas eu l’occasion de tenir un black-bass au bout de leur ligne, ceux à qui c’est arrivé se souviennent de cette bombe imprévisible . Tous espèrent en prendre ou en reprendre .

HABITAT : Le black-bass apprécie les eaux stagnantes, fortement enherbées, chaudes durant l’été . Il recherche les habitats bien marqués (obstacles, nénuphars, roseaux) .
COMPORTEMENT : Les jeunes vivent en bancs le long des herbiers alors que les adultes sont solitaires dans les eaux plus profondes . Leur activité dépend de la température ; elle est diurne durant le printemps et l’automne et nocturne en hiver .
NOURRITURE : Carnassier, le black-bass chasse à l’affût des petits poissons mais se montre très opportuniste, consommant aussi vers, grenouilles, écrevisses, etc .




TRUCS POUR LE PÊCHEUR



Le black-bass est un adversaire de choix, un combattant exceptionnel . Il ne se rend qu’épuisé . Laissez-le récupérer (le sac à carpes est parfait) un bon moment avant de le relâcher .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Micropterus salmonides, bass, achigan, perche truitée, perche noire .







DESCRIPTION : Le corps a une forme allongée et trapue . La tête est forte, la bouche large . Le maxillaire inférieur dépasse la mâchoire supérieure, l’un et l’autre sont garnis de petites dents . L’opercule est couvert d’écailles . La dorsale est en deux parties, la première basse est épineuse, la seconde plus haute à rayons mous . Le dos est vert foncé, une bande noire s’étale le long des flancs plus clairs sont marqués d’une bande noire . Le ventre est blanc .






TAILLE : 35 à 50 cm pour un poids de 0,5 à 2 kg .

LONGÉVITÉ : 6 à 10 ans .
REPRODUCTION : La ponte se déclenche en mai-juin . Le mâle creuse dans les graviers du fond une cuvette dans laquelle la femelle dépose ses œufs . Le mâle garde farouchement la ponte durant l’incubation et après la naissance des alevins .
DISTRIBUTION : D’origine nord-américaine, le blackbass est parvenu en Europe en 1878 . Il est présent en France dans l’ouest, le sud et ponctuellement là où il a été introduit .
GESTION : La réussite des introductions dépend des souches . Sous nos climats les poissons d’origine canadienne donnent de meilleurs résultats que ceux du sud des États-Unis . Une réglementation (ouverture tardive) de la pêche s’impose car le poisson est très vulnérable à l’époque de sa reproduction .
Brème















En argot, les cartes à jouer portent le nom de « brèmes », en référence au corps aplati de ces poissons .


REPRODUCTION : La ponte se déroule entre avril et juin . La femelle dépose 30 000 à 50 000 œufs sur les plantes aquatiques .
DISTRIBUTION : La brème est présente partout en Europe, essentiellement dans les eaux de plaine .
GESTION : La brème est particulièrement abondante dans les eaux eutrophisées . Dès qu’elle atteint une taille importante, elle n’a plus guère d’ennemis, sauf les gros silures .

NOMS LATIN ET LOCAUX : Abramis brama , plaquette (petite), bramen, brémo, brème carpée (grosse) .





DESCRIPTION : Le corps de la brème est haut et très aplati latéralement, il est couvert de grandes écailles enduites d’un mucus abondant et précédé par une petite tête . La bouche dépourvue de barbillons peut s’allonger en forme de tube . Les yeux sont petits . La caudale est fortement échancrée et l’anale est longue . Le dos est vert-bronze, les flancs sont argentés, les nageoires grises . Les plus gros sujets ont des reflets jaunesbronzés (on les appelle parfois « brèmes carpées ») .






















TAILLE : 30 à 50 cm, pour un poids de 500 g à 3 kg, jusqu’à 60 cm (3 kg) .
LONGÉVITÉ : 20 à 25 ans .









HABITAT : La brème apprécie les eaux calmes des rivières de plaine (zone à brème) et les étangs riches en végétaux et à fond de vase .
COMPORTEMENT : Poisson grégaire, les brèmes vivent en bandes d’individus de taille voisine .


NOURRITURE : La brème aspire dans les premiers centimètres du sédiment animalcules et des fragments végétaux .


TRUCS POUR LE PÊCHEUR
La brème vit en groupes . La stratégie d’amorçage doit s’adapter à ce fait . Chaque prise doit être suivie d’un rappel important, sinon le banc, ayant nettoyé la table, va abandonner le coup .
› Brème bordelière
Cette espèce (Blikka bjoerkna) ressemble fortement à la brème commune . Elle s’en distingue par sa livrée très argentée, son œil très grand et sa taille qui ne dépasse pas 30 cm . Elle vit dans les étangs envasés et dans les rivières très lentes . Son abondance peut se gérer par l’introduction de carnassiers (brochet) .

Brochet


Assurément le roi de nos plans d’eau et de nos rivières lentes . Il occupe le sommet de la chaîne alimentaire, puisqu’il se nourrit d’autres poissons . Aujourd’hui le roi est vulnérable ; sa position qui semblait bien assise se trouve remise en question pour diverses raisons .
TAILLE : Les poids les plus fréquents vont de 1 à 4 kg (60 à 80 cm) . Les sujets d’un mètre (10 à 12 kg) ne sont pas rares, ceux de plus de 120 cm (15 à 20 kg) exceptionnels . Le brochet est le plus grand des carnassiers indigènes .

LONGÉVITÉ : 10 à 20 ans . Les femelles vivent plus longtemps que les mâles .


HABITAT : Le brochet fréquente les eaux douces lentes ou stagnantes, tempérées . L’abondance des obstacles (arbres tombés, rochers, végétation) où il peut s’embusquer favorise ses populations .
UN BROCHET AQUITAIN
NOMS LATIN ET LOCAUX : Esox lucius , brocheton, filaton, lanceron (jeunes), brouché, breuchet, bec de canard, luceau .


DESCRIPTION : Le corps très allongé, cylindrique lui permet de glisser rapidement dans l’eau . Il débute par une tête longue aplatie . La dorsale se situe à l’aplomb de l’anale, très en arrière . L’ensemble des nageoires impaires se comporte comme un battoir qui permet au brochet des accélérations violentes caractéristiques d’un chasseur à l’affût . La bouche est largement fendue (d’où son nom de « bec de canard ») avec une mâchoire inférieure proéminente . L’intérieur est pavé de quelque 700 dents acérées et recourbées vers l’arrière . Les pores sensoriels s’ouvrent sur la tête et sous les mâchoires . De grands yeux sont disposés au-dessus de la tête, ce qui lui permet de situer les proies avec précision . Le vert est la couleur dominante du brochet . Le dos est vert foncé, les flancs plus clairs marqués de bandes transversales brunâtres et de taches jaunes . Le ventre est blanc-jaunâtre . Les nageoires paires sont rougeâtres à orangées . La coloration varie selon les habitats et les souches . Le mimétisme permet au brochet de se camoufler au milieu des obstacles et de la végétation aquatique .





Grâce à la génétique, le Muséum d’histoire naturelle de Paris a récemment découvert une espèce de brochet endémique du sud-ouest de la France (bassins de la Charente, de la Garonne, de la Leyre et de l’Adour) : le brochet aquitain (Esox aquinaticus) . Il présente une robe marbrée, avec moins d’écailles sur la ligne latérale, et un bec plus court que celui de son cousin, Esox Lucius, avec lequel il peut s’hybrider . L’éventuelle disparition de cette espèce pourrait être un facteur supplémentaire dans la dégradation des populations de brochet de cette région .
COMPORTEMENT : Sédentaire et solitaire, le comportement du brochet est territorial et ce dès son plus jeune âge . Selon sa taille, il occupe un poste bien délimité en bordure d’un herbier, dans les racines ou les branches d’un arbre, le long des rochers . Ce poste est le plus souvent situé à l’obscurité . Le brochet y demeure longtemps, camouflé, immobile . Il occupe aussi un ou plusieurs postes de chasse plus proches de la surface où il attend qu’un poisson s’y aventure . Il fond sur sa proie grâce à sa capacité d’accélération .





NOURRITURE : Le brochet est un carnassier . Les jeunes se nourrissent de plancton mais dès que leur taille augmente, ils recherchent des larves d’insectes puis des alevins Après 8 à 10 semaines, leur régime alimentaire devient piscivore Ils consomment à l’occasion des batraciens, des écrevisses, voire des jeunes oiseaux ou des musaraignes Il est aussi cannibale, quand il est jeune, ce qui lui permet défendre son territoire et de réguler ses populations . Il se nourrit souvent à satiété et rejoint ensuite son poste de repos où il va demeurer plusieurs jours à jeun La prise de nourriture a été bien étudiée et le pêcheur au vif peut suivre les différentes phases par l’évolution de son flotteur Les proies sont repérées à vue, par les vibrations perçues par la ligne latérale et par les substances émises par les poissons, en particulier les sujets blessés Il s’approche lentement de sa proie et bondit sur elle . Il s’en saisit par le travers, la blesse par les dents acérées de ses mâchoires . Le poisson capturé ne peut se dégager en raison de la position des dents Il le relâche pour mieux s’en ressaisir et lorsque la proie agonise, il l’avale la tête la première Surnommé « requin d’eau douce », le brochet n’est pas le goinfre que l’on présente parfois Pour grossir d’un kilo, il a consommé 4 à 5 kg de poissons, dont une bonne quantité de sujets malades ou blessés
REPRODUCTION : La ponte se déroule en début de printemps (mars-avril) dans des eaux dont la température oscille entre 7 et 11 °C . Les géniteurs effectuent parfois des migrations importantes (10 à 30 km) pour trouver des zones favorables à sa reproduction Les prairies inondées constituent les frayères les plus intéressantes Chaque femelle dépose en plusieurs fois de 15 000 à 50 000 œufs, fécondés par plusieurs mâles, et qui adhérent aux herbes immergées . Les alevins éclosent une dizaine de jours plus tard . Ce ne sont que de minuscules larves (8 à 9 mm) qui demeurent fixées aux herbes . Un peu plus tard, la larve se place à l’horizontale, sa bouche s’ouvre et l’alevin commence à s’alimenter La croissance est rapide (il mesure 8 cm à 8 semaines), mais les mortalités sont énormes (moins
de 1 % parvient à cet âge) . Les larves et les alevins sont consommés par les autres poissons (perches, cyprinidés et cannibalisme), des invertébrés de forte taille aussi Le risque le plus important demeure la baisse soudaine des eaux qui laisse œufs et larves à sec
DISTRIBUTION : Le brochet se rencontre partout en Europe (sauf en Norvège, au sud de l’Espagne et de l’Italie) . Il est présent partout en France, un peu moins fréquent au sud . Dans le sud-ouest vit une espèce voisine (brochet aquitain) De nombreuses introductions de poissons en provenance de toute l’Europe se font régulièrement
PROTECTION : Le brochet est depuis toujours très recherché par les pêcheurs qui ont avec sagesse, su instaurer sa protection (fermeture, taille de capture, quotas) . Les causes de sa raréfaction sont à rechercher ailleurs : pollutions, barrages infranchissables et surtout rectification des cours d’eau de manière à éviter les inondations, ce qui a limité les possibilités de reproduction Il est aussi concurrencé par le sandre et le silure qui trouvent des conditions de ponte plus efficaces La création ou la restauration d’annexes hydrauliques améliore la reproduction
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
Le brochet, roi de nos eaux calmes mérite qu’on le traite avec beaucoup de respect Si vous le pêchez au vif, ce qui est parfaitement votre droit, choisissez un montage à ferrage instantané (hameçon sur le dos) et non ces montages avec un hameçon sur le nez du vif qui obligent à décaler le ferrage et vont ramener un brochet pris au fond de l’estomac . Un brochet pris dans la bouche se défend valeureusement . Prenez aussi des précautions lors de sa remise à l’eau, en le maintenant en position normale, assez profondément pour éviter les eaux chaudes
POISSONS D’EAU DOUCE Carassin






L’espèce naturelle est plus fréquente qu’on ne le croit dans les eaux lentes ou stagnantes . De nombreux sujets de la variété colorée tournent dans des bocaux .










Carpe
















La carpe a été dispersée en France au Moyen Âge à des fins alimentaires . Sa pêche fut plus ou moins délaissée entre 1960 et 1985 quand apparut la pêche dite « à l’anglaise » avec un matériel nouveau et résistant . La carpe fait aujourd’hui l’objet d’un véritable culte et sa pêche a ses adeptes .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Carassius carassius, carache, carouche, gibèle .
DESCRIPTION : Au corps trapu et haut, le carassin ressemble à une petite carpe dont la bouche dirigée vers le haut est dépourvue de barbillons . Le dos est brun à reflets verdâtres, le ventre jaunâtre, les flancs brun-jaunâtre .







































































































TAILLE : Le carassin mesure de 15 à 30 cm, parfois 50 cm, il atteint alors 2 kg .






HABITAT : Le carassin est un poisson d’eaux stagnantes et de rivières lentes, bien enherbées .
COMPORTEMENT : Il vit en bancs et cohabite avec la brème qu’il a tendance à supplanter .



NOURRITURE : Omnivore, il consomme des plantes et diverses larves aquatiques .
REPRODUCTION : Les pontes fractionnées sont printanières (avril à juin) . La femelle libère 100 000 à 200 000 œufs qui adhérent aux plantes aquatiques .
GESTION : Longtemps délaissés, les carassins sont introduits dans les étangs lors des repeuplements .

















NOMS LATIN ET LOCAUX : Cyprinus carpio , carpet, carpot, carpeau, carpillon, Karpf . Pour les jeunes : feuille, nourrain .

DESCRIPTION : Le corps de la carpe est massif, moyennement élevé (beaucoup plus haut chez les variétés domestiques), un peu comprimé latéralement . Il est couvert de grandes écailles . L’écaillure est absente chez la « carpe cuir » et limitée à une ou plusieurs lignes chez la variété dite « carpe miroir » . La bouche, qui peut s’allonger en un tube (protractile), est garnie de 4 barbillons . La dorsale est longue, la caudale large fortement échancrée .


Carpe miroir .
Un très grand polymorphisme existe parmi les races sauvages et celles d’élevage ; il porte sur la hauteur et l’épaisseur du corps par rapport à sa longueur, l’écaillure . Le ventre est crème, les flancs, les flancs présentent des reflets dorés alors que le dos est grisvert à gris-brun .









































































TAILLE : Les poids les plus fréquents vont de 1 à 4 kg, mais les sujets de 10 kg, ne sont pas rares . Les spécialistes de sa pêche espèrent des poissons de 20 puis de 30 kg . Mais leur rêve le plus fou est de battre le record établi en 1981 : une carpe de 37 kg, capturée dans l’Yonne près de Montereau !

LONGÉVITÉ : 15 à 20 ans dans le milieu naturel, 30 à 40 ans dans des conditions particulières, soit beaucoup moins que la légende ne l’affirme !





HABITAT : La carpe est un poisson d’étang qui apprécie aussi les zones lentes des rivières et fleuves de plaine . Elle apprécie les eaux bien tempérées à chaudes (20 à 28 °C), riches en végétation et à fond de vase ; mais elle supporte des eaux plus fraîches des lacs de barrage . Dans les fleuves, elle s’aventure dans la zone à salinité moyenne (15 g/l) . Elle supporte des eaux peu oxygénées .
COMPORTEMENT : Poisson grégaire, la carpe vit en bandes, sur le fond . Ses mœurs sont plutôt nocturnes . Chaque soir le banc part à la recherche de sa
nourriture en suivant un itinéraire relativement constant . Le pêcheur, par son amorçage, va essayer de maintenir les poissons sur son coup ou les amener à modifier leurs déplacements . Le jour les poissons demeurent au large, loin du bruit des activités, la nuit tombée ils se rapprochent des bords pour consommer les restes d’amorce délaissés par les petits poissons . En hiver, lorsque les températures sont faibles (moins de 6 °C), les carpes se regroupent dans les zones les plus profondes et cessent de s’alimenter .
NOURRITURE : La carpe fouille la vase sur une profondeur importante (15 à 20 cm) et aspire les insectes et autres animaux vivant sur ou dans le sédiment du fond . Elle ne dédaigne pas les végétaux et les graines des plantes aquatiques . Le pêcheur, à l’instar de l’éleveur, l’habitue à consommer des graines diverses (blé, orge, maïs) ou des aliments composés . Les plus grosses s’attaquent parfois à des petits poissons . Le système sensoriel existant dans les barbillons, sur les lèvres et à l’intérieur de la bouche lui permet de détecter des substances à des doses très faibles . Le marché des produits odorants et attractants est basé sur cette sensibilité exceptionnelle . On notera que la digestion est peu efficace : l’intestin de la carpe est un véritable tube et les amorces sont parfois rejetées quasiment dans le même état qu’elles ont été ingérées .
REPRODUCTION : La ponte se déroule en début d’été (juin-juillet) lorsque la température se stabilise autour de 20 °C durant plusieurs semaines . Les femelles sont généralement plus nombreuses que les mâles . Chacune produit environ 100 000 ovules par kilo de son poids . La ponte se déroule au cours d’ébats bruyants, au milieu des végétaux aquatiques sur lesquels se collent les œufs . Chaque femelle libère ses œufs en 2 ou 3 fois en 2 semaines . Si les températures demeurent trop faibles la ponte n’a pas lieu . Les alevins éclosent 4 à 5 jours plus tard . Leur croissance est rapide mais les mortalités sont énormes .

DISTRIBUTION : La carpe est originaire d’Asie centrale ; elle a été ramenée en Europe par les Romains et disséminée au cours du Moyen Âge par les moines dans les nombreux étangs créés à cette époque . Elle s’est parfaitement acclimatée en France, où elle est présente partout, au point d’être considérée comme faisant partie de notre faune . Elle a été aussi introduite dans toute l’Europe (sauf dans les régions les plus nordiques), en Afrique, en Amérique et en Australie .
GESTION : La carpe est le premier animal sauvage domestiqué par l’homme, il fait l’objet d’élevage en Asie depuis le Néolithique (- 14 000 ans) . Elle est largement élevée en étangs, en France (Dombes, Brenne, Lorraine, etc .) et en Europe centrale où elle est très consommée . La sélection a permis de produire des carpes aux caractéristiques intéressantes pour la production de chair . Les variétés colorées (carpes koï) ornent les bassins, les aquariums, et font l’objet d’un véritable culte en Asie . Attention, les carpes sont victimes de certaines maladies virales et bactériennes qui se transmettent essentiellement lors des transferts de poissons ; elles provoquent des mortalités importantes en particulier au printemps, lorsque les poissons affaiblis sortent de leur léthargie .
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
La sensibilité de la carpe (goût et odorat) fait que ce poisson s’habitue à certaines odeurs, pensez-y en préparant vos amorces ! Pensez aussi que c’est un poisson qui a des habitudes en particulier dans ses déplacements à la recherche de sa nourriture .

Respectez les poissons et surtout ne les transférez pas d’un plan d’eau à un autre, vous pourriez introduire des maladies aux conséquences lourdes .
Chevesne


« Lèche à tout », le chevesne se révèle cependant particulièrement méfiant .

NOMS LATIN ET LOCAUX : Leuciscus cephalus, chevaine, cabot, meunier, chavane .
DESCRIPTION : Le corps cylindrique et fusiforme apparaît robuste . Il est couvert de grandes écailles . La tête est massive, arrondie, la bouche large, dépourvue de dents et de barbillons . La nageoire anale est à bord convexe alors que la caudale large est peu échancrée . Il existe diverses formes selon les régions .












Le dos est brunâtre à reflets verdâtres, le ventre blanc, les flancs brun-jaunâtre . Les nageoires pelviennes et la nageoire anale sont rouges . Un liseré sombre marque la dorsale et la caudale grises .
TAILLE : Le chevesne mesure de 30 à 40 cm, parfois 50 cm ; il atteint alors 2,5 kg .

HABITAT : Classé parmi les cyprins d’eaux vives, le chevesne vit en bancs dans les eaux courantes et fraîches .
NOURRITURE : Omnivore, il consomme des végétaux, les animalcules aquatiques, des petits poissons, des insectes, des fruits qui tombent à l’eau .

REPRODUCTION : Le frai se déroule d’avril à juin . La femelle dépose en plusieurs fois 50 000 œufs sur les plantes .
Corégone
Dans les grands lacs, la recherche de ce poisson qui ressemble à un cyprinidé est une quête compliquée .
Écrevisses
Les écrevisses indigènes sont relativement rares en France et dans beaucoup d’endroits les populations sont considérées comme vulnérables . Des espèces américaines sont aussi présentes et se révèlent envahissantes .
› L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) :



NOMS LATIN ET LOCAUX : Coregonus sp. , lavaret (Le Bourget), féra (Léman) .
DESCRIPTION : Sa forme allongée, son corps couvert d’écailles assez grandes le ferait ressembler à un cyprinidé, s’il ne possédait pas une nageoire adipeuse et une bouche dentée . La caudale est fourchue . Le ventre est gris-bleu, à reflets verdâtres, les flancs sont argentés et le ventre blanc . Il existe un grand polymorphisme, selon les souches et les lacs .





TAILLE : Le corégone mesure souvent 25 à 35 cm .









HABITAT ET COMPORTEMENT : Grégaire, le corégone vit en bancs qui se déplacent régulièrement dans les lacs profonds . Il recherche sa nourriture (plancton, larves, vers, crustacés) à proximité du fond . Il est autochtone dans certains lacs et a été introduit dans d’autres (Saint-Point) .
REPRODUCTION : La ponte hivernale se déroule sur les fonds caillouteux du littoral ou des tributaires .
Elle se reconnaît à la couleur blanche de la face inférieure des grandes pinces . Elle vit dans des eaux courantes et propres, souvent dans la zone à truite . Sa pêche est limitée à quelques jours par an ou interdite .
› L’écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) : Comme son nom l’indique, la face inférieure des pinces est rouge . Elle peut atteindre 15 cm . Elle n’existe que dans l’Est de la France .
› La petite Américaine (Orconectes limosus) :
Introduite en Europe vers 1860, cette écrevisse demeure souvent de petite taille (10 à 12 cm) et se reconnaît aux taches marron sur chaque segment de l’abdomen . Elle est peu regardante sur la qualité des eaux et colonise rivières calmes, canaux et étangs . Elle est omnivore .
› Écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus) :
Aussi appelée « écrevisse signal » en raison de la tache blanche qui marque les pinces très développées et rouges à la face inférieure . Le corps est brun-orangé . Elle atteint 12 à 15 cm . Cette espèce introduite en Suède en 1960 se répand dans toute l’Europe . Elle vit dans les eaux courantes mais supporte parfaitement les eaux calmes et assez tempérées . Elle est plutôt végétarienne . Elle a tendance à étendre son aire de répartition .
› Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) : Cette espèce originaire de Louisiane est très colorée ;
la face supérieure est noir-bleu avec des tubercules rouges, la face ventrale est rouge . Elle atteint 12 à 15 cm . Cette écrevisse colonise les eaux calmes (rivières lentes et plans d’eau) . Elle supporte des eaux chaudes . Omnivore elle consomme végétaux et animaux . Elle creuse des terriers profonds dans les berges . Se reproduisant plusieurs fois dans l’année, elle s’avère envahissante et est considérée comme nuisible . Les écrevisses françaises ont été victimes des pollutions, des aménagements de rivière et de maladies qui ont limité leurs populations . Protégées depuis plusieurs dizaines d’années, leurs populations toutefois ne semblent guère se reconstituer . En revanche, les écrevisses introduites (la petite Américaine, celle du Pacifique et l’espèce de Louisiane), beaucoup plus résistantes mais aussi porteuses de maladies, ont colonisé l’ensemble du réseau hydrographique . Si vous connaissez l’existence de ces espèces : pêchez-les et mangez-les ! Surtout ne les rejetez pas ailleurs, et pas uniquement parce que c’est interdit !

Gardon
C’est certainement le poisson le plus commun de nos eaux calmes ou peu courantes . Il abonde souvent . Il se capture plus ou moins facilement selon les jours et les lieux .

de grandes écailles bien implantées dans la peau . La bouche est petite . La nageoire dorsale se situe à l’aplomb des ventrales . L’iris de l’œil est rouge . Les flancs sont gris argenté, le ventre est blanc et le dos vert foncé à reflets bleuâtres . Les nageoires paires et la caudale sont jaune-orangé, les autres grises .
TAILLE : 10 à 15 cm le plus souvent, jusque 25 à 30 cm . Il pèse de 10 à 300 g, exceptionnellement il peut approcher le kilo .





LONGÉVITÉ : 5 à 10 ans .
HABITAT : Le gardon préfère les eaux calmes des lacs et étangs mais vit aussi dans les zones lentes des rivières . Il possède une forte capacité d’adaptation et survit souvent dans des eaux polluées ou réchauffées .
COMPORTEMENT : Il vit en bandes qui se dissocient et se reconstituent au gré des conditions (température, recherche de nourriture, présence de prédateurs) . Le gardon est une proie classique pour l’ensemble de nos prédateurs . Il résiste lorsque les conditions sont délicates (pollution, absence de frayères) . Une amélioration de la qualité des milieux entraîne un développement de ses populations .
NOURRITURE : Herbivore, le gardon consomme de nombreux végétaux mais il ne dédaigne pas les animalcules aquatiques ou aériens . Le pêcheur l’habitue à de nombreux appâts .

NOMS LATIN ET LOCAUX : Rutilus rutilus, roche, roussette, vengeron, gardèche, échatou .
DESCRIPTION : Le corps est aplati latéralement et couvert



REPRODUCTION : Printanière, la reproduction se déroule dans des eaux peu profondes et bien enherbées lorsque la température atteint 20 °C . Tous les gardons d’un même site se reproduisent en même temps . Les géniteurs effectuent parfois des déplacements conséquents pour trouver des lieux favorables . En période de reproduction les mâles portent des boutons de noce (points blancs sur la tête et le corps) . Les alevins éclosent après 4 à 10 jours .

DISTRIBUTION : Présent dans toute la France, il est remplacé en Europe du Sud par des espèces voisines . Les gardons de notre pays peuvent varier d’un endroit à l’autre en raison des souches locales et des hybridations avec d’autres espèces (rotengle, brème) ou avec des gardons d’Europe centrale .
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
Le gardon s’intéresse à tout ce qui semble consommable . Dans les eaux chaudes, il préfère les végétaux tendres alors qu’en eaux fraîches, ses sorties alimentaires sont courtes, il recherche alors des proies animales . L’amorçage vise à l’accoutumer à certains aliments (chènevis, blé) .
Gobie à grosse tache


Une des dernières espèces parvenues dans nos eaux (en 2015), le gobie à grosse tache annonce l’arrivée de ses cousins en provenance du Danube .
TAILLE : Jusqu’à 20 cm .
LONGÉVITÉ : 3 à 4 ans .
HABITAT : Il supporte des eaux froides (1 °C) mais préfère les eaux chaudes (25 °C) . Il semble rechercher les zones à fond de pierres, ou de graviers .
COMPORTEMENT : Il vit sur le fond, collé aux pierres . Il se déplace par bonds sur le fond ou en s’accrochant aux coques des embarcations .


NOURRITURE : Les larves (vers de vase) et crustacés constituent l’essentiel de son alimentation mais il ne dédaigne pas d’autres invertébrés vivant sur le fond .
REPRODUCTION : Les gobies se reproduisent durant toute la belle saison . La femelle pond entre avril et septembre . Le mâle qui à cette époque est totalement noir garde la ponte .

DISTRIBUTION : Originaire du Danube, le gobie est apparu en Allemagne en 2005 et en France une dizaine d’années plus tard, par le réseau de canaux . Ses pontes multiples favorisent sa dispersion .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Neogobius melanostomus, gobie .
DESCRIPTION : Corps cylindrique, effilé vers l’arrière, précédé d’une grosse tête . Les yeux sont situés sur le haut . Le dos porte deux nageoires séparées, la première est marquée d’une tache noire . Les nageoires pelviennes sont réunies en un disque qui permet au poisson de se fixer sur le support (pierres et caillloux) .




















PROTECTION : Il s’agit d’une espèce nouvellement parvenue dans nos eaux, comme quelques autres gobies (il existe 60 espèces différentes en Europe) . Il est devenu envahissant mais, a priori, sa présence ne pose pas de problème particulier . Il constitue une proie pour les carnassiers (en particulier perches et sandres) .


TRUCS POUR LE PÊCHEUR





Un ver de vase traînant au ras du fond, permet de capturer des gobies . Lors des concours de pêche, ils évitent la bredouille et s’accumulent .

POISSONS D’EAU DOUCE


Goujon
Sans lassitude, les goujons fouillent le banc de sable et de graviers à la recherche d’animalcules divers .
NOURRITURE : Sur le fond, le goujon trouve des insectes, des vers, des larves, des crustacés dont il se nourrit . Il consomme aussi des végétaux . Il aspire sa nourriture ce qui provoque des touches franches pour le pêcheur .



REPRODUCTION : La ponte est printanière dans des eaux dont la température atteint 16 à 20 °C . La femelle dépose 1 000 à 5 000 œufs en plusieurs fois sur les fonds de graviers et de sable . Les alevins éclosent au bout d’une semaine .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Gobio gobio, goisson, moustachu, touret (gros sujet), trigon, Gressling .


DESCRIPTION : Le corps, cylindrique dans sa partie antérieure et médiane, s’aplatit vers la queue . Il est précédé d’une tête forte terminée par une bouche large qui peut s’étirer, formant un tube qui permet d’aspirer les proies que les deux barbillons situés à la commissure des lèvres lui ont fait repérer . Les grands yeux sont placés très hauts . Les nageoires dorsale et anale sont courtes, la caudale est fourchue . La coloration varie selon les milieux et les sous-espèces . Le dos est bleu-vert, les flancs plus clairs ou bruns sont marqués par des taches sombres .


TAILLE : 8 à 15 cm, rarement plus de 20 cm pour un poids de 150 g .
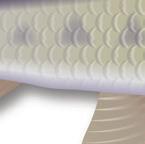
LONGÉVITÉ : 5 à 7 ans .
HABITAT : Le goujon fréquente les eaux courantes ou stagnantes à fonds de graviers ou de sable . Il survit sur les fonds limoneux mais fuit la vase .
COMPORTEMENT : Les goujons vivent en bancs sur le fond . Mauvais nageur, ils adoptent un comportement sédentaire .
DISTRIBUTION : Le goujon est présent dans toute l’Europe, sauf dans le sud de l’Italie . Il existe un certain nombre de sous-espèces dans l’Europe et en France .
PROTECTION : Les populations de goujons, autrefois abondantes, ont reculé en raison des dégradations du milieu : pollutions, réchauffement, envasement . Leur retour est lent et se fait à partir des affluents qui n’ont pas été atteints . L’introduction de nouveaux prédateurs (sandre et silure) a limité ses populations . Le retour du goujon est synonyme d’amélioration des milieux et d’atteinte d’équilibre avec les prédateurs .

TRUCS POUR LE PÊCHEUR
En soulevant un nuage de sable avec leurs pieds les pêcheurs attirent les goujons qui viennent chercher leur pitance dans l’eau troublée .
Grémille




Ce petit percidé est parfois abondant et demeure très discret .
Ide mélanote
L’ide ressemble fortement au gardon . Il atteint des tailles plus fortes, si bien que les gardons au poids record de plus d’un kilo sont souvent des ides .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Gymnocephalus cernuea , perche goujonnière, roi, acérine, frash .
DESCRIPTION : La grémille a le corps relativement haut . Les deux parties de la dorsale sont jointives, l’opercule est garni de plusieurs épines .


Le dos est brun, les fl ancs plus clairs, le corps est marqué par points sombres .
TAILLE : Elle mesure une dizaine de centimètres .










HABITAT ET COMPORTEMENT : La grémille fréquente les eaux lentes et stagnantes à fond de sable . Elle vit en petits groupes, à proximité du fond . Son activité est surtout nocturne .











NOURRITURE : Elle consomme des vers, crustacés et larves diverses .















REPRODUCTION : La ponte est printanière et abondante . La femelle dépose des rubans d’œufs autour des végétaux .
DESCRIPTION : Le corps allongé est aplati latéralement . Le dos est vert foncé, les fl ancs sont argentés . Les nageoires inférieures sont rosées .





TAILLE : Il mesure de 10 à 15 cm, peut atteindre 40 cm et peser 2 kg .
HABITAT : L’ide colonise les plans d’eau et les rivières à courant assez lent, riches en végétation .
COMPORTEMENT : Il vit en bancs et se montre très actif .
NOURRITURE : L’ide recherche ses proies (larves, insectes) en surface . Il ne dédaigne pas certaines algues et des débris végétaux .
REPRODUCTION : La ponte se déroule durant le printemps . La femelle pond ses œufs (100 000) sur les plantes ou sur les cailloux couverts d’algues .
GESTION : L’ide est parfois introduit avec les gardons . Résistant et actif, il est produit pour être utilisé comme vif .
POISSONS D’EAU DOUCE

Omble chevalier
Un corps taillé pour la nage, des couleurs vives : quel superbe poisson que l’omble chevalier !
REPRODUCTION : Elle se déroule en novembre-décembre sur des gravières (omblières) qui se situent en profondeur (60 m) . Les alevins naissent en été . Certaines souches migrent dans les rivières qui affluent au lac pour pondre .
Omble (saumon) de fontaine
NOMS LATIN ET LOCAUX : Salvelinus alpinus, salvelin, truite rouge .
DESCRIPTION : Le corps est fusiforme, couvert de nombreuses petites écailles qui lui donnent un aspect lisse . La tête forte se termine par une bouche largement fendue . Le dos est gris-vert à gris-bleu, les flancs plus clairs sont marqués de taches et de points jaunes ou orangés, le ventre est rose-orangé . De fortes variations existent selon les souches, les lacs et les habitats .






TAILLE : Il mesure de 20 à 30 cm, certains sujets atteignent 50 à 70 cm pour 1,5 à 3 kg .

HABITAT ET COMPORTEMENT : L’omble est l’hôte des grands lacs de montagne aux eaux froides et bien oxygénées où il vit en profondeur (de 30 à 100 m) et en bancs . Il est autochtone dans certains lacs et a été introduit dans d’autres (Annecy, Massif central, etc .) .
NOURRITURE : Carnivore, il mange aussi bien des crustacés du plancton que des larves d’insectes et des poissons . Les sujets piscivores ont une croissance plus rapide que ceux qui demeurent planctonophages . L’activité alimentaire est maximale à la belle saison et très ralentie durant la période de gel .
Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit en France à la fin du xIxe siècle . Il ne s’est guère acclimaté que dans nos lacs de montagne . Ailleurs, il est parfois introduit pour le plus grand plaisir des pêcheurs qui apprécient la beauté de sa livrée et sa combativité .
NOMS LATIN ET LOCAUX : Salvelinus fontinalis, saumon de fontaine, saumon .
DESCRIPTION : Cet omble a la forme des autres salmonidés . Le corps est plus trapu, couvert de petites écailles . Ses couleurs sont vives : dos et flancs verts marbrés de bandes jaunâtres et marqués de points jaunes et d’autres rouges . Le ventre est rouge . Les bords des nageoires inférieures et la caudale sont soulignés d’un liseré blanc .
HABITAT ET COMPORTEMENT : Il apprécie les eaux froides et courantes de montagne . Il est aussi présent dans les lacs d’altitude . Il a un appétit développé et recherche les invertébrés de forte taille et les petits poissons . Sa croissance est rapide en été et lente en hiver .
REPRODUCTION : La ponte se déroule en hiver sur les frayères situées sur la partie littorale des lacs ou dans les tributaires .
Ombre commun




Est-ce parce qu’il est très rapide qu’on l’a appelé ombre ? C’est bien possible car il file très vite s’il a repéré un danger .

NOURRITURE : La bouche dirigée vers le bas, laisse supposer que l’ombre se nourrit des animaux vivant sur le fond : mollusques, crustacés, larves, vers . Durant la belle saison, il se saisit d’insectes tombés à l’eau ou d’autres en cours d’éclosion .

REPRODUCTION : La ponte printanière (mars à juin) se déclenche lorsque les eaux se réchauffent . Les ombres se reproduisent en groupes ; la femelle dépose ses œufs (3 000 à 6 000) de taille réduite (2 à 3 mm) dans plusieurs frayères creusées dans les graviers du fond . Les alevins éclosent au bout de 15 à 20 jours . Ils demeurent dans le sédiment durant 8 à 10 jours, puis se déplacent en pleine eau, vers des endroits peu profonds, au courant atténué .
DESCRIPTION : Le corps fusiforme, élancé est couvert de grandes écailles . Longue et haute, la dorsale précède une adipeuse . La caudale est fourchue . La bouche garnie de courtes dents est petite et se situe nettement sous la tête . La pupille de l’œil étirée vers l’avant lui permet de regarder vers le haut . Selon les habitats, le dos passe du gris argenté au brunvert, les flancs clairs présentent des reflets argentés ou dorés . Les écailles sont marquées de taches brun-noir . La dorsale est striée par 4 à 5 bandes longitudinales .


TAILLE : 30 à 50 cm pour un poids de 300 g à 1,5 kg .
LONGÉVITÉ : 4 à 6 ans .






HABITAT : L’ombre fréquente les rivières courantes et larges de pré-montagne ou de plaine de la zone qui porte son nom . Il s’aventure rarement à l’amont dans la zone à truites ou vers l’aval (zone à barbeau) . Les adultes demeurent dans les courants, alors que les jeunes restent à proximité des bords, le long des touffes de végétaux .
COMPORTEMENT : Grégaire, il vit en bancs d’individus de taille voisine .

DISTRIBUTION : L’ombre est présent naturellement dans certaines rivières du nord-est ; il a été introduit dans d’autres régions .
GESTION : La répartition des ombres est limitée aux eaux courantes et fraîches . Il est protégé par des périodes de fermeture et une taille minimale de capture .





TRUCS POUR LE PÊCHEUR
Attention, il monte en surface en reculant . Un poisson repéré peut très bien se saisir de la mouche plusieurs mètres en aval .
D’EAU DOUCE

Perche
En fin d’été de véritables curées se déroulent dans les plans d’eau : les perches chassent en bandes dans les bancs d’alevins .
COMPORTEMENT : La perche forme des bancs d’individus de même taille qui s’organisent pour la chasse essentiellement à l’aube et au crépuscule mais se dispersent la nuit venue . Elle est beaucoup plus active au début du printemps et à la fin de l’été .










NOURRITURE : Jeune, elle est planctonophage, puis consomme des vers et larves d’insectes . En fin d’été, elle chasse en groupes dans les bancs d’alevins . Les perches qui demeurent dans la zone littorale des lacs se nourrissent de larves et croissent beaucoup moins vite que celles qui, en pleine eau, mangent d’autres poissons .










NOMS LATIN ET LOCAUX : Perca fluviatilis , percot, perchaude, urlin, barche .
DESCRIPTION : Le corps de la perche, élevé dans sa partie antérieure, est aminci à l’arrière . Il est couvert d’écailles profondément insérées, rugueuses au toucher . La dorsale est en deux parties, juxtaposées, la première est portée par des rayons épineux, la seconde par des rayons mous . Une épine se situe sur l’opercule . Les mâchoires sont garnies de petites dents . Le dos est vert foncé, le ventre gris clair . 5 à 7 bandes verticales sombres marquent les flancs . Les nageoires pelviennes, anale et caudale sont rouges, une tache noire se situe à la base de la première partie de la dorsale .




TAILLE : 20 à 35 cm (100 à 500 g), jusqu’à 50 cm pour un poids de 2,5 kg .

LONGÉVITÉ : 15 à 20 ans .





HABITAT : La perche est présente dans les eaux à courant modéré, jusque dans les rivières lentes et dans les plans d’eau de toute nature . Elle se situe près des obstacles immergés (arbres, rochers, végétation aquatique) .
REPRODUCTION : La ponte est précoce (dès mars) . Lors de la reproduction plusieurs mâles arrosent de leur laitance les ovules déposés en un ruban accroché aux plantes aquatiques .

DISTRIBUTION : La perche est présente dans toute l’Europe .
GESTION : On dit parfois que la perche fait du nanisme . Il faut savoir que sa croissance est lente et dépend des proies disponibles . Un équilibre brochet/perche favorise sa croissance en offrant plus de nourriture .
TRUCS POUR LE PÊCHEUR
La perche s’intéresse à tout ce qui bouge . La couleur rouge semble l’exciter, comme les reflets argentés des leurres . Prospecter les bordures des obstacles est souvent un gage de réussite .







Perche-soleil
Ce petit centrarchidé au corps aplati et très coloré a été introduit en Europe vers 1880 . Il fait partie des premières prises des jeunes pêcheurs .
Poisson-chat
Introduit en France à la fin du xIxe siècle, il a été dispersé parce qu’il était susceptible de survivre dans les eaux polluées ! Aujourd’hui, il est considéré comme nuisible . Ainsi va la vie !

.

















DESCRIPTION : La perche-soleil possède un corps plat, très haut . La dorsale longue est épineuse dans sa partie antérieure .














LES COULEURS SONT VIVES : dos vert et bleu, les flancs plus clairs marqués de points rouges, le ventre est orange . Une tache rouge marque l’opercule des mâles .


























TAILLE : Elle mesure de 8 à 12 cm .









HABITAT ET COMPORTEMENT : La perche-soleil vit en bancs dans les eaux calmes ou stagnantes, bien tempérées . Les couples s’isolent au moment de la reproduction .
NOURRITURE : Essentiellement carnivore, elle consomme des larves diverses et aussi les alevins d’autres espèces .





















REPRODUCTION : La ponte s’effectue en mai-juin . La femelle dépose 5 000 œufs dans une cuvette creusée sur le fond de sable . Le mâle surveille la ponte .
GESTION : Classée nuisible en raison de la prédation sur les alevins d’autres espèces .















DESCRIPTION : Le corps, cylindrique dans sa partie antérieure, est comprimé latéralement dans sa partie postérieure . La peau lisse est dépourvue d’écailles et couverte d’un mucus abondant . La dorsale courte porte un aiguillon piquant, elle est suivie d’une petite nageoire adipeuse . Les pectorales sont également munies d’un aiguillon, piquant et venimeux . La tête, grosse et aplatie, porte de petits yeux . La bouche large est garnie de 8 barbillons qui contiennent, comme la peau, de nombreuses cellules sensorielles . Le dos et les flancs sont sombres avec des reflets cuivrés, le ventre est jaunâtre .


























TAILLE : 10 à 30 cm, pour un poids de 20 à 200 g .
LONGÉVITÉ : 5 à 7 ans .












HABITAT : Il fréquente les eaux lentes de la partie basse des rivières mais aussi les étangs et lacs tempérés à fond de vase . Il supporte des eaux peu oxygénées et chaudes .
COMPORTEMENT : Le poisson-chat demeure en bancs


DÉCOUVRIR la diversité des milieux d’eau douce et les principales espèces de poissons qui les habitent ; APPRENDRE ET MAÎTRISER au fil des saisons les techniques de pêche des différentes grandes familles de poissons grâce à des montages ciblés et à un matériel et des appâts appropriés ; CONNAÎTRE l’organisation de la pêche et sa réglementation pour une pratique respectueuse et responsable, ce guide est l’outil indispensable, à tous les pêcheurs, POUR EXERCER L’ART DE LA PÊCHE AUJOURD’HUI.
• Des fiches d’identification de plus de 40 espèces de poissons.
• Des montages et animations clairement illustrés.
• Des astuces et des conseils de bons coins de pêche.
• Des focus sur des pêches dites faciles et amusantes, la pêche en carpodrome, le street fishing, la pêche de compétition, le no-kill ou les voyages de pêche à l’étranger.
LES AUTEURS
Vincent Rondreux, journaliste nature et environnement, a dirigé les rédactions de différents magazines de pêche de loisir. Il développe par ailleurs une spécialité climat/énergie.
Bernard Breton, ingénieur agricole, s’est spécialisé dans l’eau et les poissons. Il a créé la revue Le Pêcheur de France. Il est un spécialiste, reconnu tant au plan national qu’international, des sujets concernant les milieux aquatiques. Son implication dans le domaine de la pêche l’a amené à de hauts postes dans l’organisation de la pêche en France et en Europe.
MDS : VA00137N1
www.vagnon.fr
