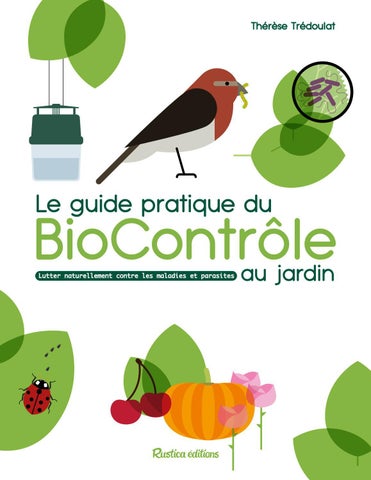5 minute read
DÉFINITION DU BIOCONTRÔLE
Ce terme encore peu utilisé, va remplacer celui de pesticide dans le vocabulaire du jardinier. C’est le contrôle – et non plus l’éradication – biologique des maladies et des parasites.
Utilisé depuis déjà quelques années, le terme biocontrôle est l’abrégé de l’expression anglo-américaine « biological control » employée dans les domaines de la biologie. Le
biocontrôle regroupe différentes méthodes de protection des végétaux qui utilisent des
mécanismes naturels. Ces méthodes d’intervention tiennent compte des interactions entre les plantes cultivées, leurs agresseurs et les autres organismes vivants présents dans le milieu. Elles favorisent la régulation des agresseurs à l’aide d’agents vivants, comme les auxiliaires, ou l’emploi de produits phytopharmaceutiques ciblés contre une maladie ou un parasite. En aucun cas, l’agresseur est totalement éradiqué, mais sa population est contrôlée à un niveau acceptable pour ne pas causer trop de dégâts. Il fait partie d’une chaîne alimentaire. Il nourrit notamment des insectes auxiliaires qui disparaîtraient avec lui. Les produits de biocontrôle sont définis à l’article L.253-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime comme : « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 1° Les macro-organismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale.»
La loi détermine donc quatre possibilités de
biocontrôle pour lutter contre les maladies et les parasites (stress biotiques) des végétaux. Voici ce qu’elles recouvrent.
Les macro-organismes
Les macro-organismes (voir p. 9) qui protègent les plantes sont des invertébrés : insectes, acariens ou nématodes. On les appelle des auxiliaires. Ils aident le jardinier qui doit en prendre soin, favoriser leur présence naturelle ou les introduire s’ils sont peu nombreux face à une population importante de parasites.
Ils interviennent de deux manières différentes: • Par prédation quand les auxiliaires dévorent les œufs, larves et/ou adultes des ravageurs. C’est le cas des coccinelles, chrysopes, punaises, mais aussi des araignées, des grenouilles, des hérissons et des oiseaux. • Par parasitisme quand un auxiliaire s’introduit à l’intérieur du ravageur. Ainsi, une micro-guêpe, le trichogramme pond ses œufs dans ceux du ravageur. Ils s’y développent et s’en nourrissent, les éliminant par la même occasion. Les nématodes sont des vers microscopiques qui s’attaquent aux larves du sol. Ils s’introduisent dans celles du parasite par les voies naturelles, libèrent une bactérie qui dégrade les tissus du ravageur pour s’en nourrir. Les parasites hôtes meurent en 2 à 3 jours. • En préventif, elles stimulent les défenses naturelles de la plante. La bactérie pulvérisée sur le feuillage imite l’attaque d’un champignon. La plante peut ainsi réagir plus vite et plus efficacement en préparant son système de défense. C’est le cas du Bacillus subtilis souche QST 713. Ce mode d’action est efficace principalement contre cinq maladies courantes de nos plantes : mildiou, moniliose, oïdium, pourriture grise et rouille. • En curatif, elles limitent les dégâts d’une maladie ou d’un parasite. Par exemple, une plante qui a reçu du Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki souche ABTS 351 produit une toxine. Si une chenille mange cette feuille, elle va la trouver dans un premier temps peu appétissante, puis elle va mourir après l’ingestion d’une certaine dose.
Les micro-organismes
Ils regroupent les bactéries, les champignons et les virus. Pour l’instant, les champignons ne sont disponibles que pour les professionnels. Ils ne sont donc pas présents dans ce livre. Parmi les virus, celui de la granulose du carpocapse des noyers, poiriers, pommiers, pruniers, efficace également contre la tordeuse orientale du pêcher, appelé Carpovirusine, est disponible par intermittence pour les jardiniers amateurs. Il n’a donc pas été retenu dans les moyens de lutte détaillés pour les arbres fruitiers. Les bactéries (voir p. 14) peuvent agir de deux manières différentes:
Les médiateurs chimiques
Ce sont des « clones » obtenus par synthèse de molécules émises naturellement par des animaux parasites, appelées phéromones (voir p. 15). Utilisée dans un piège adapté, une phéromone spécifique à un ravageur attire les mâles qui croient reconnaître « l’odeur » d’une femelle. Au lieu de s’accoupler, les mâles sont prisonniers dans le piège. Ce piégeage permet: • De limiter la population du ravageur, en diminuant la reproduction. Cela peut être
suffisant dans un jardin, si l’attaque est de faible ampleur. • D’estimer la population du ravageur, par le nombre de prise, et notamment le pic de l’attaque. Il détermine le meilleur moment pour intervenir avec d’autres produits. • De provoquer une confusion sexuelle. La grande diffusion de signaux sexuels par les phéromones perturbe les mâles qui ne trouvent plus de femelles pour s’accoupler. Mais cela suppose la pose de nombreux pièges, sur des surfaces importantes. Cette méthode est plus adaptée à l’agriculture qu’au jardinage.
Les substances naturelles
Ces substances d’origine végétale, animale ou minérale (voir p. 17) sont présentes dans la nature. Elles ont des vertus reconnues pour
lutter contre les maladies, les parasites et les
adventices. Soit elles gênent un processus vital pour l’agresseur, soit elles ont un effet répulsif, en créant par exemple une barrière protectrice des organes de la plante. Ces substances ont généralement une durée de vie assez courte. Elles persistent peu de temps dans l’environnement (air, eau, sol), elles préservent davantage la biodiversité et peu de résidus sont détectés dans les récoltes. Les trois origines: • Végétale. Le pyrèthre est extrait des fleurs d’un chrysanthème (Chrysanthemum cinerariifolium syn. Tanacetum cinerariifolium). Elles sont séchées et réduites en poudre avant d’être utilisées. Autre exemple : pulvérisée, l’huile de colza asphyxie les parasites. • Animale et microbienne. De la farine de sang, de la graisse de mouton et de l’huile de poisson peuvent être utilisés comme répulsifs contre du gibier. Il n’en est pas question dans cet ouvrage. Le spinosad est une bactérie qui paralyse certains insectes (voir p. 19). • Minérale. Le soufre et le bicarbonate de potassium sont utilisés comme fongicides, le phosphate ferrique lutte contre les escargots et les limaces. Il bloque l’alimentation de ces gastéropodes qui s’enterrent pour mourir.