
































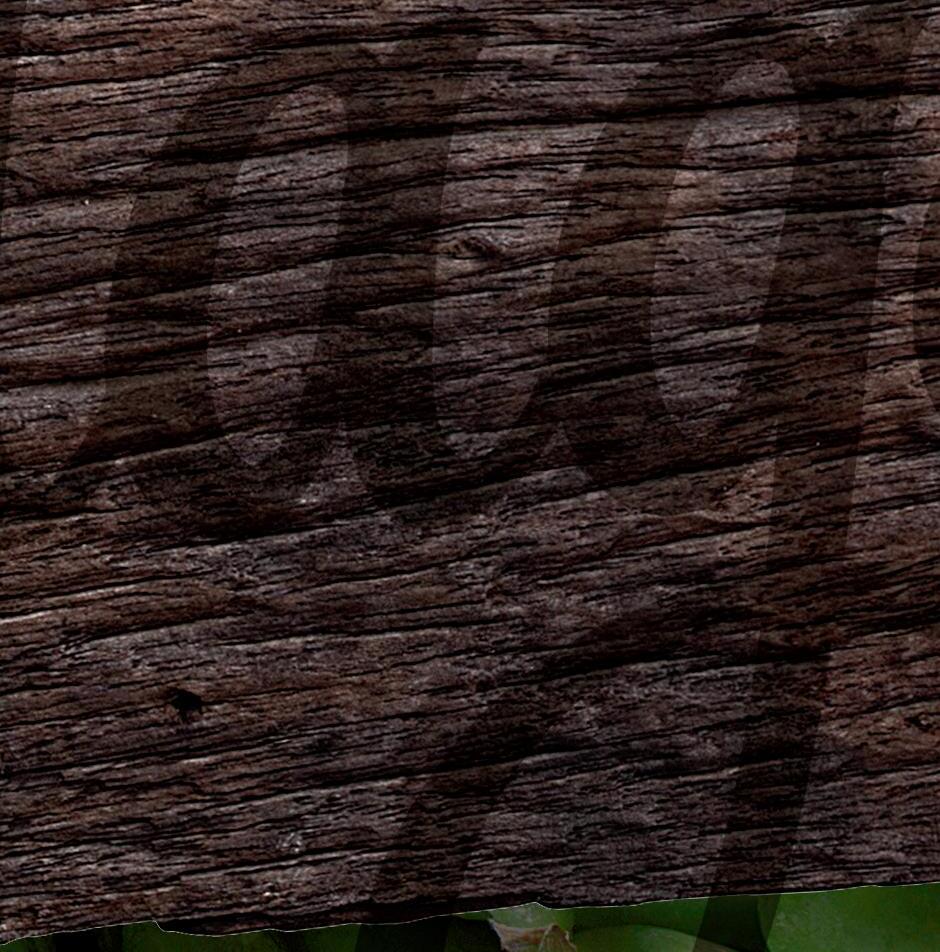






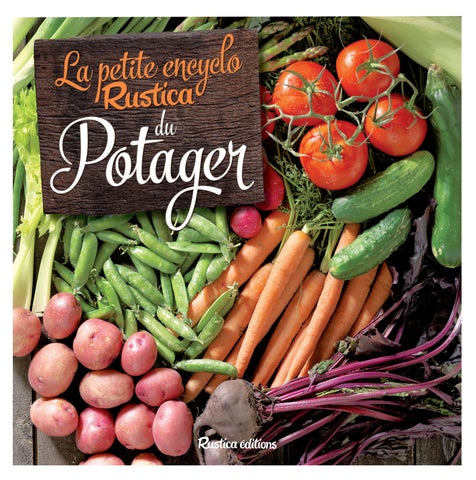

































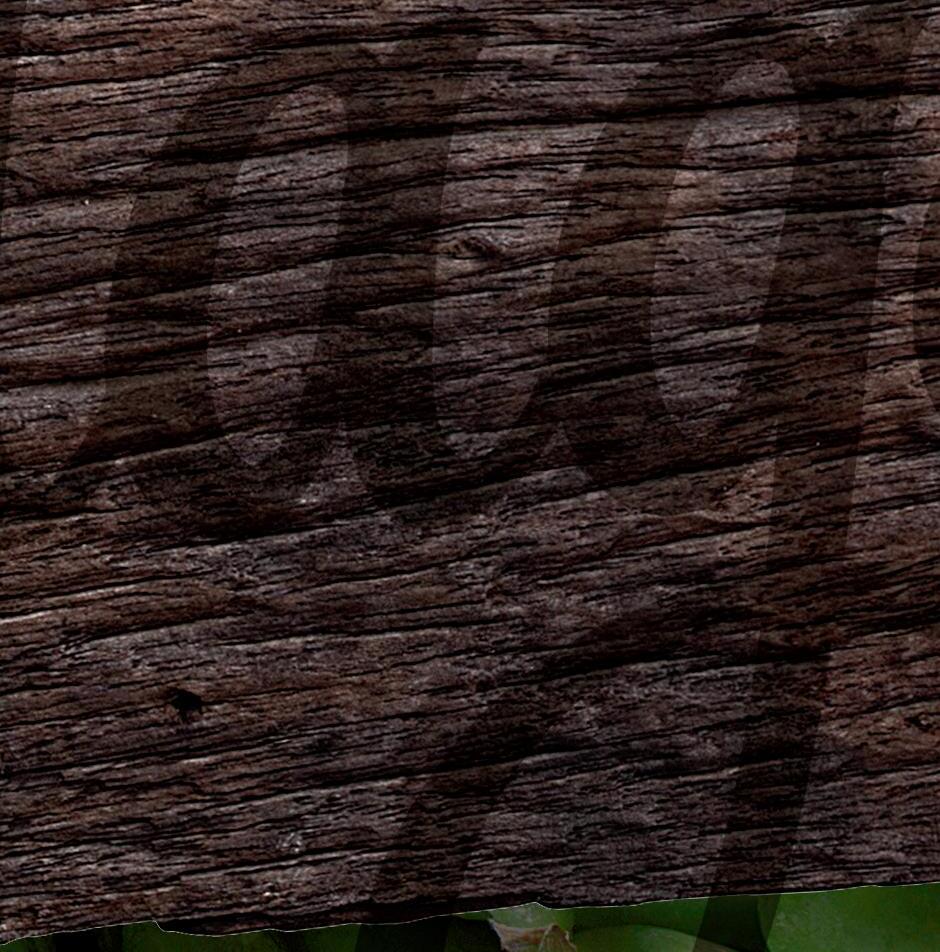













Faites tremper certaines de vos semences (haricots, pois, fèves) 24 heures dans de l’eau tiède, ce qui rendra leur paroi plus tendre. Pour obtenir le même résultat, placez vos graines pendant quelques jours dans une boîte contenant du marc de café humide.
Nivelez bien la terre devant être ensemencée et tracez des lignes horizontales, en utilisant un cordeau et en tenant compte entre elles des distances prescrites pour chaque espèce. Si vous avez semé des graines trop serrées, vos légumes n’auront pas un espace suffisant pour se développer correctement. N’hésitez pas alors à éliminer les plantes superflues lorsqu’elles ont 3 ou 4 feuilles. Cette technique porte le nom d’éclaircissage.
Certains légumes réclament d’être repiqués à un autre endroit, ce qui accélère le développement de leurs racines. Intervenez lorsque les jeunes pieds ont 3 ou 4 feuilles. Extrayez-les délicatement et raccourcissez la longueur de leurs racines et de leur feuillage.
En respectant une distance adéquate, creusez des trous à l’aide d’un plantoir conique afin d’y placer vos sujets. Enfoncez ensuite cet outil à côté de chaque plant et repoussez la terre contre lui, le trou créé servant à recueillir l’eau d’arrosage.
Afin de gagner du temps, ne semez pas certains légumes, mais repiquez directement des plants déjà poussés dans des godets de tourbe du commerce.

Il est recommandé de semer plusieurs graines de certains légumes (potiron, par exemple) au même endroit. Pour cela, creusez de petites cavités, appelées « poquets », de 5 cm de profondeur et, au fond, placez un peu de fumier ou de terreau, à recouvrir de terre, puis 3 ou 4 graines. Plusieurs plantes se développeront et il faudra choisir la plus vigoureuse.
Aussitôt après avoir semé des graines, humidifiez la terre sans excès afin de ne pas les bousculer, d’une façon régulière. Dès que vos plantes commencent à lever, arrosez-les normalement, mais la pomme de votre arrosoir tournée vers le haut.
La réussite des semis est toujours influencée par le satellite de notre planète, ne l’oubliez pas. Ainsi, semez vos légumes-racines (carotte, radis, etc.) et vos légumes-feuilles (comme les salades) en lune décroissante, lors de son dernier quartier, avec une boucle faisant penser à la lettre « d ». En revanche, les légumes-fruits (tomate, courgette, etc.) et les légumes-fleurs (tel l’artichaut) réussissent mieux s’ils sont semés en lune croissante, lors du premier quartier, avec une boucle faisant penser à la lettre « p ».
Vous pouvez utiliser des semences prélevées sur vos dernières récoltes de légumes, après les avoir stockées bien au sec. Ramassez-les lorsqu’elles sont mûres, juste avant leur dissémination par le vent. Mais ne procédez pas ainsi si vous avez cultivé des variétés hybrides, dont les caractéristiques bénéfiques ne se reproduisent pas d’une année sur l’autre.
Il existe des techniques autres que le semis classique pour multiplier certains légumes. Elles présentent l’avantage d’être gratuites, tout en donnant d’excellents résultats.
Il existe des espèces potagères ne pouvant pas être semées par des jardiniers amateurs. C’est par exemple le cas de la pomme de terre. Ce mode de multiplication consiste à faire des trous de 10 à 15 cm de profondeur réalisés en respectant certaines distances, différentes selon les espèces, pour y placer un tubercule et non une ou plusieurs graines. Celui-ci ne tarde pas à développer des racines, puis des tiges et un feuillage.
Certaines plantes potagères, comme le fraisier, produisent des tiges rampantes, appelées « stolons », capables de développer des racines à différents endroits de leur développement. Si vous les coupez, de nouveaux pieds indépendants se formeront, que vous pourrez cultiver dans un autre emplacement. Ne conservez alors que le sujet situé le plus près du pied mère, en éliminant les suivants.
Ce procédé permet de multiplier un grand nombre de plantes florales vivaces. L’oseille et la plupart des plantes aromatiques (ciboulette, estragon, thym, etc.) l’acceptent aussi volontiers. Il consiste à séparer en 2 ou 3 parties, voire plus, un pied devenu trop touffu, chacune possédant quelques racines et de jeunes tiges. Intervenez en automne ou en avril, en dehors des périodes chaudes ou gélives. Pour les diviser, écartelez les plantes à l’aide d’une fourche-bêche. Placez les jeunes plants obtenus à leur nouvel emplacement et arrosez-les souvent, de façon à leur permettre de développer de nouvelles racines.
Cette technique de multiplication donne de bons résultats avec, par exemple, des pieds de romarin et de sauge officinale déjà bien formés. Au printemps ou en été, couchez sur le sol un rameau souple et maintenez-le dans cette position à l’aide d’une petite fourche en métal. Incisez la tige à l’endroit où elle est en contact avec le sol et humectez la plaie produite d’une solution d’hormone d’enracinement du commerce. Des racines vont pousser, conduisant à la formation d’une nouvelle plante. Lorsqu’elle sera assez développée, coupez la tige la reliant au pied mère et plantez-la ailleurs.
Des sortes de bourgeons, appelés « œilletons », se développent au pied des racines de certains légumes, comme l’artichaut notamment. En début de printemps, tranchez-les à l’aide d’une bêche. Enfoncez-les dans la terre à un nouvel emplacement et arrosez-les régulièrement jusqu’à leur reprise.
Votre potager souffrira toujours des effets de la sécheresse, surtout certains de ses légumes. Ne négligez pas les précautions à prendre pour empêcher ses conséquences fâcheuses de se manifester.
« Un binage vaut mieux que deux arrosages », précise un dicton. Cette technique a comme objectif de casser la croûte de terre, empêchant alors l’eau présente dans le sol de s’évaporer trop vite. Elle empêche par ailleurs le développement des mauvaises herbes.
Le fait d’isoler sa surface par la pose d’un matériau protecteur vous permettra de limiter sensiblement vos arrosages. Utilisez pour cela de la paille, des
coupes de gazon provenant d’une pelouse non traitée chimiquement, des frondes de fougères, de la tourbe, des écorces d’arbres, des paillettes de lin ou des coquilles de cacao proposées dans les jardineries. Prévoyez une couche de 3 à 5 cm de ces divers paillis, à mettre en place dès l’arrivée des beaux jours.
La pose sur le sol d’une feuille de plastique noir peut aussi se faire, notamment pour protéger des assauts du soleil une culture de fraisiers.
Cette eau présente plusieurs avantages : elle est gratuite, jamais calcaire et toujours disponible à température ambiante. Préférez son emploi pour arroser vos légumes, plutôt que de faire appel à l’eau du robinet. Selon vos moyens et vos besoins, vous trouverez différents types de cuves (béton, plastique, etc.) et de diverses tailles (300 à 10 000 l) capables de vous donner satisfaction.
Arrosez vos cultures de préférence le matin ou le soir, afin d’empêcher le soleil d’en évaporer tout de suite une partie. N’oubliez pas qu’un arrosage léger ne sert pratiquement à rien, car il ne pénètre pas suffisamment pour entrer en contact avec les racines. En revanche, un arrosage trop important risque d’asphyxier les racines et les graines. Agissez donc toujours avec doigté, en tenant compte des besoins progressifs de vos légumes au fur et à mesure de leur développement, ainsi que des conditions météorologiques. Si votre terre est trop sèche, l’eau que vous apportez s’écoulera sans pénétrer vraiment et, dans ce cas, arrosez plutôt à deux reprises. Vous devez tenir compte également des besoins propres de chaque espèce de votre potager.

Creusez une légère cuvette au pied de vos légumes de grande taille, comme la tomate, de façon à y diriger les arrivées d’eau de pluie. Si vous devez vous absenter quelques jours en été, placez des bouteilles en plastique emplies d’eau, le goulot enfoncé en terre, au pied de vos légumes les plus gourmands en eau (potiron, aubergine, etc.).
Ce procédé comprend divers tuyaux à répartir dans vos massifs, percés à des endroits bien définis et correspondant à vos différents sujets. Il est très facile à mettre en œuvre, peu coûteux et programmable si nécessaire.
Quelques plantes potagères peuvent continuer à produire en hiver ou encore très tôt au printemps, sous forme de primeurs, mais à condition d’être protégées du froid.
Au pied de certains de vos légumes (chou, artichaut, poireau, etc.), disposez un isolant thermique, une couche de 20 à 30 cm de terre, par exemple, en mélange à de la tourbe, de la paille ou des feuilles mortes, à fixer avec un filet en Nylon pour empêcher le vent d’intervenir.
Vous pouvez récolter vos légumes-racines (navet, carotte, etc.) et les conserver en plein air en tas. Arrachez-les avec précaution, afin de ne pas les blesser. Laissez-les se ressuyer pendant quelques heures sur le sol, de façon à ne pas les laisser mouillés lors de leur conservation. Montez un tas de 40 à 50 cm de hauteur, à couvrir d’une couche de 20 cm de paille hachée, de terre et d’une feuille de plastique bien fixée à l’aide de pierres. Prévoyez la pose de cheminées d’aéra-
tion verticales, tous les 50 cm, et faites de fagots de branches de façon à évacuer l’humidité en provenance de la respiration de vos racines. Cette technique peut aussi être mise en œuvre dans votre cave, si elle est saine.
Des films en plastique, d’un poids très faible, existent dans le commerce. Utilisez-les pour couvrir certains de vos petits légumes, notamment si vous désirez les protéger des intempéries ou les faire produire de bonne heure, dès la fin de l’hiver. Il suffit de les étendre sur vos cultures, puis de poser quelques pierres à leurs extrémités, afin qu’ils ne puissent pas se replier. Si la température devient clémente, repliez cette protection, quitte à la remettre en place à la moindre alerte de froid.
n La culture sous tunnel
Cette possibilité ressemble à la précédente, mais la feuille de plastique, un film de polyéthylène traité contre les U.V., doit alors être posée sur des arceaux demi-circulaires, métalliques ou en plastique. Le tout mérite d’être bien arrimé au sol par des fils et des piquets. Ouvrez de tels abris lorsque le temps le permet, quitte à les refermer en cas d’apparition du froid.
Dans les jardineries, vous trouverez des armatures en bois ou métalliques entourées et couvertes de plastique transparent ou de verre, si vous choisissez des modèles plus élaborés et solides.
Emplissez-les d’un mélange de terreau, en laissant un volume libre de 10 à 15 cm sous la vitre. En fonction de la température extérieure, ouvrez ou fermez leur toiture, partiellement ou en totalité. Ces châssis peuvent être utilisés tels quels ou chauffés à l’aide d’une résistance électrique.

Si vous n’y prenez garde, votre pota ger se transformera rapidement friche ! Veillez donc toujours à empê cher les mauvaises herbes (ortie, chiendent, etc.) de faire concurrence vos légumes. Vous pouvez en admettre quelques-unes dans votre potager, mais en en contrôlant la propagation.
Sachez qu’un désherbant efficace sur un légume ne l’est pas obligatoirement sur d’autres. Prenez donc la précau tion de choisir une spécialité conve nant bien à l’intervention que vous désirez pratiquer. Les maraîchers professionnels peuvent assez facilement raisonner de cette façon, compte tenu de la grandeur de leurs différentes parcelles. Pour vous, la situation va être beaucoup plus compliquée à gérer. Ne vous précipitez donc pas vers l’adoption du désherbage chimique de votre potager.

Supprimer à la main toutes les mauvaises herbes présentes dans votre potager est une pratique fastidieuse à mener à bien et, de plus, elle vous réclamera du temps. Prenez plutôt l’habitude, chaque jour pendant quelques minutes, de passer un coup de binette entre vos différentes planches de légumes, de façon à supprimer les toutes jeunes mauvaises herbes. Cette façon de procéder devrait être suffisante pour garder toutes vos cultures bien propres.
n Des astuces faciles à mettre en œuvre
Certains légumes, du fait du volume de leur feuillage, disposent d’une vertu nettoyante, comme la pomme de terre, le potiron, le haricot, la poirée, la tétragone et le cardon. Les cultiver vous permettra de diminuer sensiblement la pression des mauvaises herbes. Par ailleurs, une dizaine de jours avant le semis de vos légumes, arrosez à deux ou trois reprises les planches à ensemencer. Cela fera germer les plantes indésirables, faciles alors à détruire par un léger binage, la veille de votre vrai semis. Le paillage du sol tout autour de vos légumes découragera aussi le développement de mauvaises herbes capables de concurrencer vos légumes.
n Le désherbage thermique
Dans les jardineries, il existe des appareils équipés d’un brûleur et alimentés par une cartouche ou une bonbonne de gaz liquide sous pression. La chaleur qu’ils dégagent provoque un choc thermique capable de faire éclater les cellules des plantes à éliminer, surtout les annuelles, qui meurent au bout de 2 à 3 jours. Ces désherbeurs thermiques sont légers et donc faciles à utiliser dans un potager.
Si vous faites preuve de prudence (respect d’une rotation de vos légumes, bonne gestion des arrosages, etc.), votre potager ne devrait pas connaître de problèmes majeurs liés à des attaques parasitaires.
Prenez l’habitude d’effectuer une visite quotidienne à votre potager, même si elle est rapide, de façon à remarquer l’apparition éventuelle d’un début d’attaque parasitaire. Cela permet d’intervenir, s’il y a lieu, d’une façon préventive.
À ce stade, la suppression de quelques feuilles affectées par la présence de moisissures peut contribuer à juguler une invasion. Si cela ne suffit pas, un


traitement chimique, lui aussi préventif, peut avoir lieu. De tels traitements sont particulièrement conseillés pour protéger les poireaux contre l’attaque d’un petit papillon, la teigne. De même, dès l’apparition de quelques premiers symptômes, ne négligez surtout pas de traiter vos pieds de tomates et de pommes de terre contre des maladies comme le mildiou, surtout par temps humide et chaud.
n Le respect des animaux utiles
Ne chassez pas certaines espèces animales capables de vous aider à protéger vos cultures. C’est le cas d’insectes comme l’abeille, la coccinelle et le scarabée doré, les grenouilles et crapauds, de grands consommateurs de limaces, le hérisson et la plupart des oiseaux, très amateurs de larves.
n La lutte antilimaces
Comme les escargots, ces mollusques constituent un souci permanent pour les jardiniers. Ils sont en effet capables de transformer rapidement toute une rangée de belles laitues en une véritable dentelle peu appétissante. Pour en venir à bout, disposez sur le sol, près de vos légumes-feuilles fragiles, de petits tas de granulés à base d’un produit spécialisé, le métaldéhyde. Mettez ces appâts sous une tuile, de façon à empêcher vos chiens et chats d’y mettre le nez, en risquant de s’empoisonner. Plus simplement, déposez le soir, par temps humide, de vieux sacs mouillés au milieu de vos cultures, des abris à visiter le matin afin de récupérer quelques mollusques.
n La protection contre les oiseaux gourmands
Ces volatiles sont utiles dans votre potager, sauf au moment où les fraises commencent à mûrir. Protégez-les, ainsi que vos parcelles accueillant de fragiles semis, en les couvrant d’un filet en fibres synthétiques du commerce, à maintenir en place grâce à des ficelles et à des piquets.
Si vous décidez de traiter certains de vos légumes, prenez des précautions, cela étant valable également si vous utilisez un désherbant chimique. Respectez à la lettre le mode d’emploi indiqué sur l’emballage du produit choisi. Vérifiez notamment pendant combien de temps il restera actif dans le sol, surtout si vous envisagez ensuite de semer d’autres légumes. Agissez lorsqu’il n’y a pas de vent afin d’empêcher votre produit d’être entraîné vers des végétaux voisins. N’augmentez pas les doses d’emploi prescrites, croyant ainsi augmenter les chances de réussite de votre intervention. Méfiez-vous des terrains en pente, sur lesquels les ruissellements d’eau, en cas de fortes averses, ont tendance à faire partir les produits en contrebas. Ne fumez pas et ne mangez pas pendant votre intervention et ne vous frottez pas les yeux. Enfin, détruisez les emballages vides et jetez le produit inutilisé, ainsi que les eaux de rinçage, dans un trou éloigné d’un puits ou d’une rivière. Il serait très préjudiciable à l’équilibre de votre jardin que vous vous contentiez de ne cultiver que 2 ou 3 légumes, avec alors un risque d’appauvrissement du sol et le développement de maladies difficiles à enrayer. Un potager digne de ce nom est en droit d’accueillir un bon nombre d’espèces différentes. Toutefois, vous pouvez restreindre leur choix en tenant compte de la nature du sol et du climat propres au terrain que vous avez choisi. En effet, l’asperge, par exemple, ne peut pousser que dans une terre sableuse, tandis que l’aubergine a bien du mal à croître dans le nord de la France… Bien sûr, vous pouvez adopter quelques espèces classiques comme la pomme de terre, la carotte et le haricot vert. Il peut également être amusant de redécouvrir quelques légumes anciens moins courants comme l’igname de Chine, le crosne du Japon ou le coqueret du Pérou, en joignant l’utile à l’agréable…


L’ail est une plante vivace à bulbe souterrain, appelé « tête », composé de bulbilles indépendantes portant le nom de « caïeux » et enveloppées dans plusieurs fines enveloppes. Il produit de longues feuilles plates partant de sa base. Ce légume ajoute un goût très apprécié à bon nombre de plats.
Attendez 3 à 4 ans pour le cultiver à nouveau. Le
Ne cultivez pas de l’ail à un endroit qui en a déjà accueilli l’année précédente ; cette recommandation étant également valable pour l’oignon, l’échalote et le poireau.
n La préparation du sol et la fertilisation : ce légume préfère les terres légères et surtout perméables, sans le moindre excès d’humidité, avec du soleil. L’ail blanc donne de meilleurs rendements dans les régions situées dans le Sud, où il peut passer l’hiver sans trop souffrir. L’ail rose résiste mieux au froid et peut donc être cultivé plus au nord. Surtout, ne plantez pas d’ail dans un terrain ayant reçu récemment une fumure organique (fumier, compost), cela afin d’éviter le développement de pourriture. En automne, apportez 10 g/m2 d’un engrais complet riche en potasse, de type 4-6-10. Au printemps, lorsque les pousses atteignent 10 cm, stimulez la végétation avec un engrais « coup de fouet », à raison de 50 g/m2
n La plantation : l’ail se multiplie exclusivement par plantation de caïeux. Intervenez en octobre-novembre (variétés d’automne) ou en février-mars (variétés de printemps). Enterrez les gousses de 2 à 3 cm, la pointe en l’air.
n L’entretien : contentez-vous de biner entre les rangs.
Pro P riétés
Riche en vitamines, l’ail constitue aussi un excellent remède pour soigner les troubles circulatoires et c’est un bon vermifuge.
n La récolte : intervenez dès le mois de juin pour une consommation rapide, sinon attendez que les feuilles soient aux deux tiers jaunes et sèches. Laissez les caïeux se ressuyer sur le sol pendant 2 à 3 jours.
Quelles variétés choisir ?
‘Thermidrome’ est un ail blanc d’automne, rustique et à rendement correct. ‘Germidour’ est un ail violet, également d’automne, à fort rendement. Parmi les variétés de printemps, citons ‘Fructidor’, un ail rose plutôt tardif et de bonne conservation, ainsi que ‘Printanor’, qui produit plus.


fanées, puis placez les bulbes en cais settes, dans un local sec et aéré. La conservation sera meilleure si vous utilisez le feuillage séché pour réaliser des tresses, à suspendre dans un grenier bien ventilé.
En juin-juillet, lorsque le feuillage jaunit, nouez les tiges de vos sujets. Cette pratique permet de réduire l’ascension de la sève et donc d’accélérer la maturation des têtes avant leur complet développement. Si certains pieds ne sont pas suffisamment développés, buttezles plutôt en utilisant un râteau.
Plantez de préférence en lune décroissante.
L’ail apprécie le voisinage de pommes de terre, de carottes, de céleri, de concombre, de laitues, de pieds de tomate et de fraisiers.
25 cm
tempéré déconseillé
assez sensible légère et perméable
Comme l’arroche monte promptement à graines, réalisez vos semis à plusieurs reprises sur 2 à 4 mois. Cela vous permettra d’étaler votre production.
’arroche, surnommée « belle dame », est une plante herbacée annuelle de 0,60 à 1 m de hauteur. ses fleurs estivales sont petites, verdâtres, réunies en grandes grappes composées, mais assez insignifiantes. ses feuilles sont larges et souples, plus ou moins cloquées et de forme triangulaire. Ce sont elles qui se consomment, fraîches, cuites à la façon des épinards ou en salade si elles sont jeunes. on les mélange souvent aux feuilles d’oseille pour corriger leur acidité.
n La préparation du sol et la fertilisation : ce légume pousse dans des sols frais et riches en humus, non calcaires. Il craint la chaleur et la sécheresse. Dans le cadre d’une rotation, il peut être cultivé au même endroit, mais après 3 ou 4 ans seulement. Épandez sur la surface du sol une fumure organique bien décomposée. Effectuez ensuite un labour profond de 20 cm environ, en brisant les mottes et en éliminant les cailloux. Apportez un engrais « coup de fouet » quand vos sujets atteignent 10 cm de hauteur.
n Le semis : semez l’arroche à partir d’avril-mai et jusqu’à début août, en lignes distantes de 50 cm. Couvrez à peine vos graines, avec seulement 1 cm de terre fine, en tassant le sol juste après. Éclaircissez vos plants à 30 cm quand ils ont 4 ou 5 feuilles.
Pro P riétés
L’arroche a des propriétés laxatives et rafraîchissantes.
Ses feuilles, utilisées en cataplasme, sont émollientes, avec une action bénéfique sur les piqûres d’insectes.
n L’entretien : binez et sarclez régulièrement votre culture. Comme l’arroche monte rapidement à graines quand elle manque d’eau, arrosez-la régulièrement. Un paillage peut aussi être conseillé. Pincez l’extrémité des tiges de temps en temps, de façon à obtenir des tiges plus grandes.
Quelles variétés choisir ?
L’arroche blonde présente des feuilles presque jaunes. La rouge est très décorative, ses feuilles brun-rouge tranchant sur les teintes vertes avoisinantes. L’arroche ‘Bon Henri’, enfin, est une plante pouvant être conduite comme une vivace, avec une repousse chaque année.

Vous pouvez, bien sûr, récolter des graines en vue de réaliser de futurs semis. Pour cela, gardez quelques beaux pieds sur lesquels les feuilles n’auront pas été cueillies après l’apparition des fleurs. Laissez monter à graines. Coupez les tiges à maturité et faites-les sécher dans un endroit abrité.
semez de préférence en lune décroissante.
Les bonnes associations
L’arroche apprécie le voisinage de la pomme de terre, des choux, du radis et de la tomate.

30 cm modéré régulier résistante partout
Janv.
Fév. Mars
Avril Mai
Juin Juil.
Août ept. ct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév. Mars
Avril Mai Juin
Juil.
Août sept.
oct.
Nov. Déc.
Le semis
La récolte
Pour déguster des feuilles plus tendres, recouvrez la tête de vos artichauts de papier sulfurisé ou d’un linge assez fin, lorsqu’ils approchent de leur maturité. Le
’artichaut est une plante vivace, à tige robuste, aux feuilles grandes et très découpées, cotonneuses en dessous. Ce légume ressemble assez au cardon, avec des caractéristiques de culture parfois très proches. ses tiges, de 1 à 1,20 m de hauteur, se terminent par un gros capitule qui constitue la partie comestible, avant que ne s’épanouissent des fleurs de couleur bleu violacé. en dehors de ses bractées, ce légume offre également des feuilles au goût amer, mais consommables en infusion.
n La préparation du sol et la fertilisation : l’artichaut préfère les expositions chaudes et les sols argileux et frais. Il redoute les hivers rigoureux, avec la présence d’un excès d’eau et d’une période de gel prolongée. Avant de planter de jeunes pieds, enfouissez 400 à 500 g/m2 de fumier ou de compost, puis 150 g/m2 d’un engrais composé de type 6-9-12. Chaque année au printemps, apportez à votre culture un engrais « coup de fouet » riche en azote.
n La plantation : au printemps, procurez-vous des pieds d’artichaut. Si vous hébergez ce légume depuis quelques années, procédez en mars-avril à une division de vos grosses touffes, âgées de plus de 3 ans et dont le rendement n’est plus satisfaisant. Cette technique porte le nom d’« oeilletonnage ». Prélevez de jeunes pousses, appelées « œilletons ». Raccourcissez leurs feuilles d’un tiers et repiquez-les tous les 80 cm, avec une cuvette à leur pied.
Pro P riétés
L’artichaut est riche en potassium et en calcium. Il présente des effets bénéfiques sur le foie et la vésicule biliaire, surtout les lendemains de bons repas.
n L’entretien : arrosez régulièrement les pieds. Buttez vos sujets avec de la terre, dès l’arrivée du froid. À la même période, taillez les tiges à 25 cm de hauteur et paillez le sol. Renouvelez votre plantation tous les 3 à 4 ans, avec des œilletons extraits sur les pieds.
Quelles variétés choisir ?
‘Camus de Bretagne’ est une plante tardive, de 1,30 m de hauteur, à feuillage ample. « Gros vert de Laon » (80 cm) est rustique et productif. ‘romanesco’ (1,20 m) jouit de gros capitules arrondis, d’un cœur bien fourni et d’une saveur très fine.


80 cm
doux
humidité souhaitable sensible
argileuse et fraîche
Lorsque la tête de vos artichauts a la taille d’un œuf, fendez les tiges dans le sens de la longueur, juste sous chaque tête. Afin que la fente obtenue reste bien ouverte, glissez dedans un morceau de bois de 1 cm de longueur. La circulation de la sève vers les racines diminue alors, ce qui fait grossir la tête.
Plantez de préférence en lune croissante.
Janv.
Fév. Mars
Avril Mai
Juin
Juil.
Août
sept.
oct.
Nov.
Déc.
La plantation
La récolte
Pour ne pas affaiblir vos pieds, attendez la troisième année avant d’effectuer une première récolte et ne prélevez pas tous les turions d’un seul coup. Agir de cette façon permet chaque année d’effectuer des cueillettes toujours plus fournies.
’asperge est une plante vivace qui dépasse 1 m de hauteur. rameuse, elle porte un feuillage plumeux. sa souche, appelée « griffe », forme des racines rayonnantes et charnues. Ce sont ses jeunes tiges, appelées « turions », que l’on consomme, dès leur sortie de terre. Ces turions peuvent être blancs ou verts, avec alors la possibilité de les déguster en mélange dans des salades composées.
n La préparation du sol et la fertilisation : ce légume, qui vit une dizaine d’années, préfère les terrains sableux. Réalisez une tranchée de 50 cm de largeur, sur deux hauteurs de fer de bêche. Enrichissez le sol de 5 kg/m2 de fumier ou de compost. Enfoncez un piquet au niveau de chaque pied pour y attacher le feuillage. Chaque automne, épandez une fumure organique bien décomposée sur le sol, à enfouir superficiellement pour ne pas endommager les griffes.
n La plantation : sur ce monticule de 10 cm de hauteur, installez au printemps des griffes du commerce, espacées de 60 cm, sur des lignes distantes de 1,20 m. Maintenez toujours le sol légèrement humide.
Pro P riétés
L’asperge est riche en vitamines A, B et PP, ainsi qu’en minéraux. Elle est également bien fournie en fibres et facilite donc le transit intestinal.
n L’entretien : votre production n’interviendra que 2 ans après la plantation. Durant ce temps, binez régulièrement le sol. Surveillez la présence d’une mouche et du criocère, un petit coléoptère dont la carapace est marquée de petits points noirs, dont les larves peuvent creuser des galeries dans les tiges. Au besoin, effectuez un traitement préventif, à partir de la sortie des pointes et jusqu’à la ramification des pousses. La troisième année, après la récolte, supprimez toutes les tiges à 10 cm au-dessus du sol.
Quelles variétés choisir ?
‘F1 Fileas’ est un hybride très précoce, très vigoureux, donnant des turions blancs de beau calibre. ‘F1 Primaverde’ produit des turions vert-jaune très décoratifs. ‘Pacific Purple’ donne des asperges pourpres, de gros calibre et à la saveur très douce.

uN ForçAGe HIverNAL PossIBLe
Pour obtenir de petites asperges vertes en hiver, préparez, sous un châssis, une couche chaude de 1,20 m de largeur sur 50 cm de hauteur. Disposez des griffes, âgées de 7 à 8 ans, sur 5 cm de terreau. Fermez votre châssis et couvrez-le, par grand froid, d’un paillasson. La récolte pourra commencer quelques semaines plus tard.

Les bonnes associations Semez des salades, radis, épinards et oignons au cours des 3 années précédant votre première récolte.
60 cm modéré sol bien drainé
résistance normale sablonneuse
Janv.
Fév. Mars
Avril Mai
Juin Juil.
Août sept.
oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév. Mars Avril Mai Juin Juil.
Août sept.
oct.
Nov.
Déc. n La plantation n La récolte


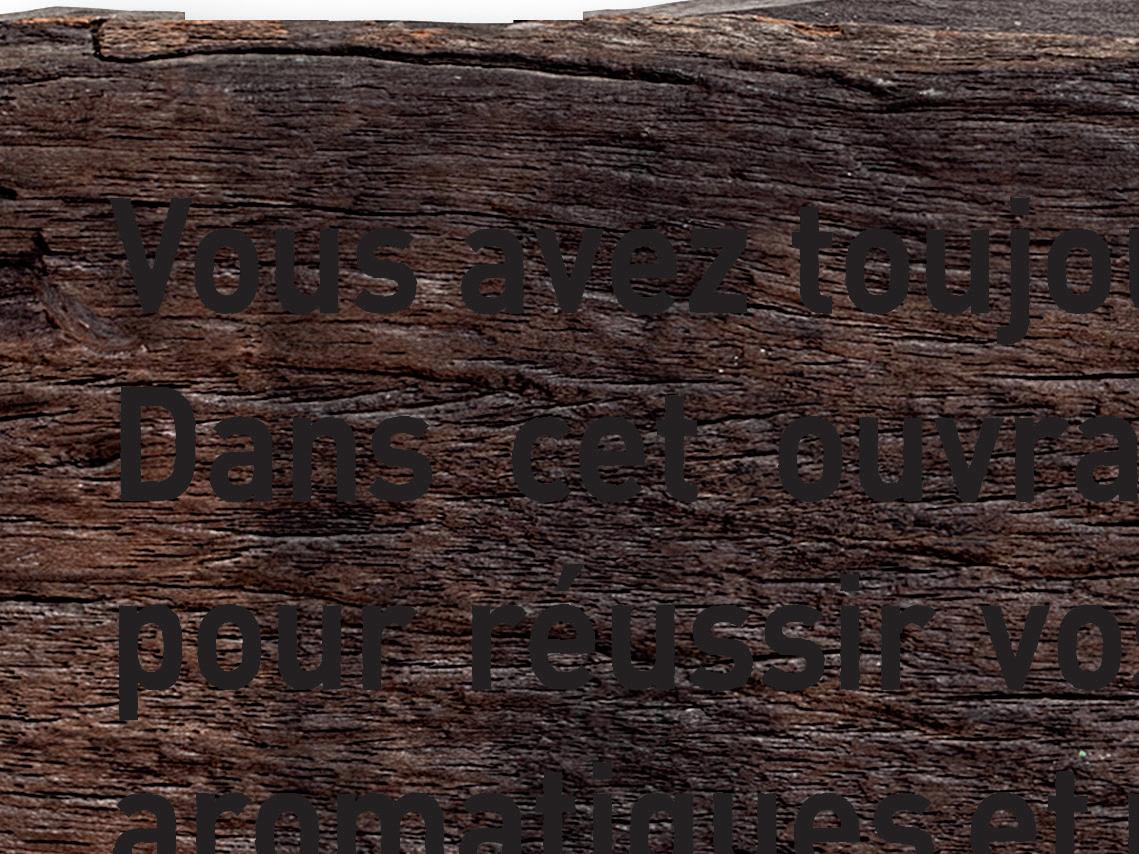
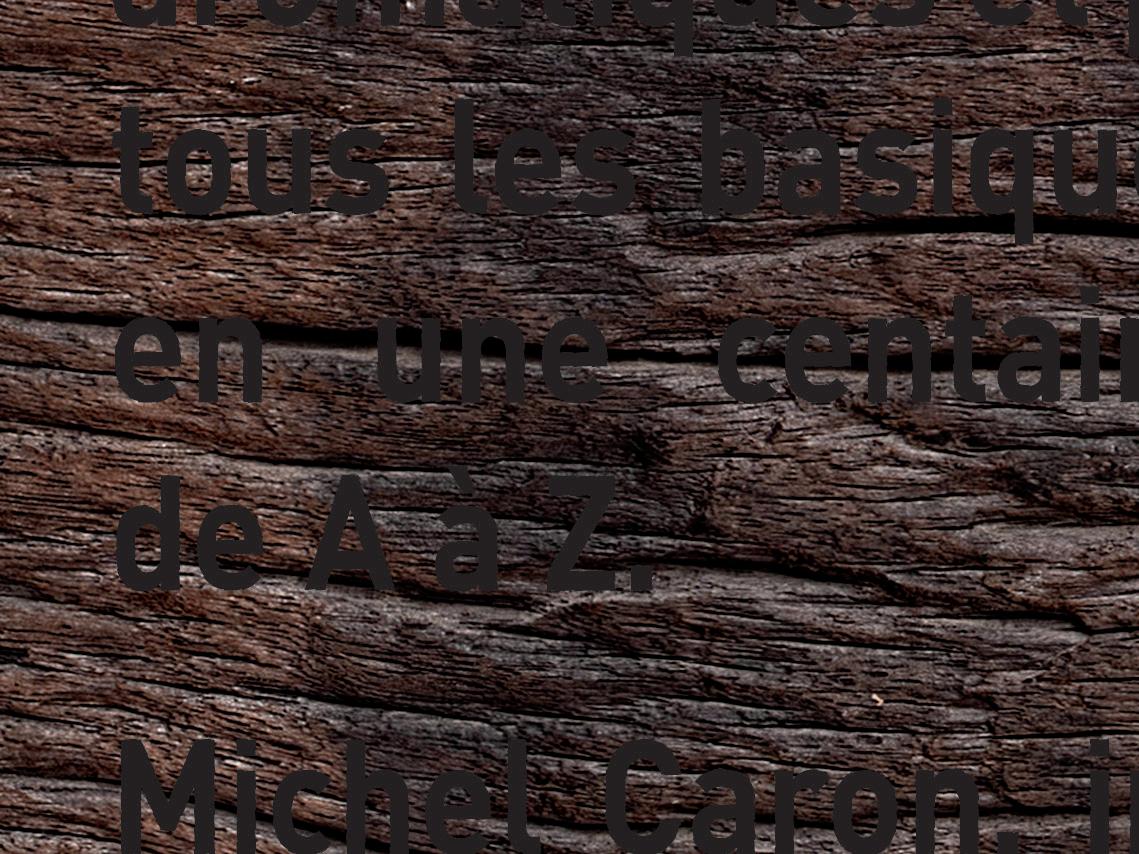



Vous avez toujours rêvé d’un potager facile à vivre ? Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les clés pour réussir vos cultures. Légumes, fruits, plantes aromatiques et plantes médicinales : redécouvrez ici tous les basiques d’un potager réussi, rassemblés en une centaine de fiches techniques classées de A à Z.
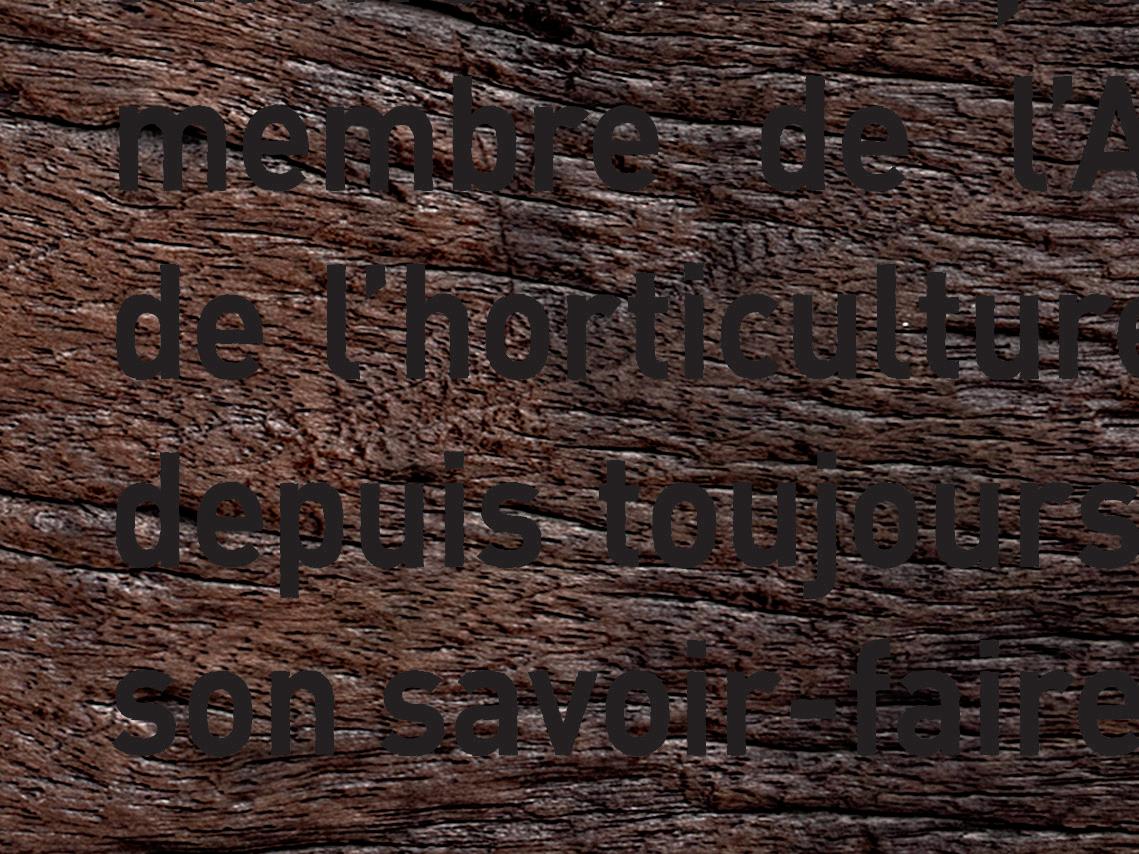

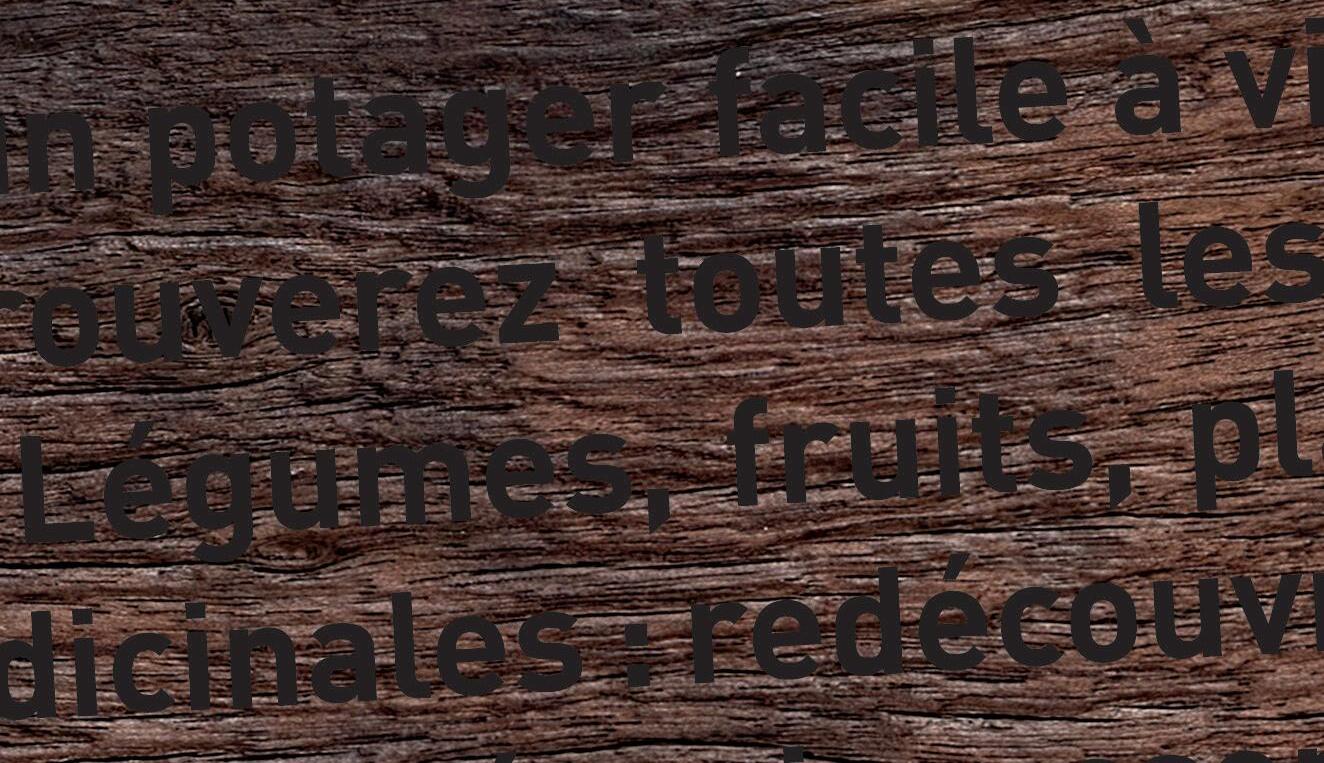

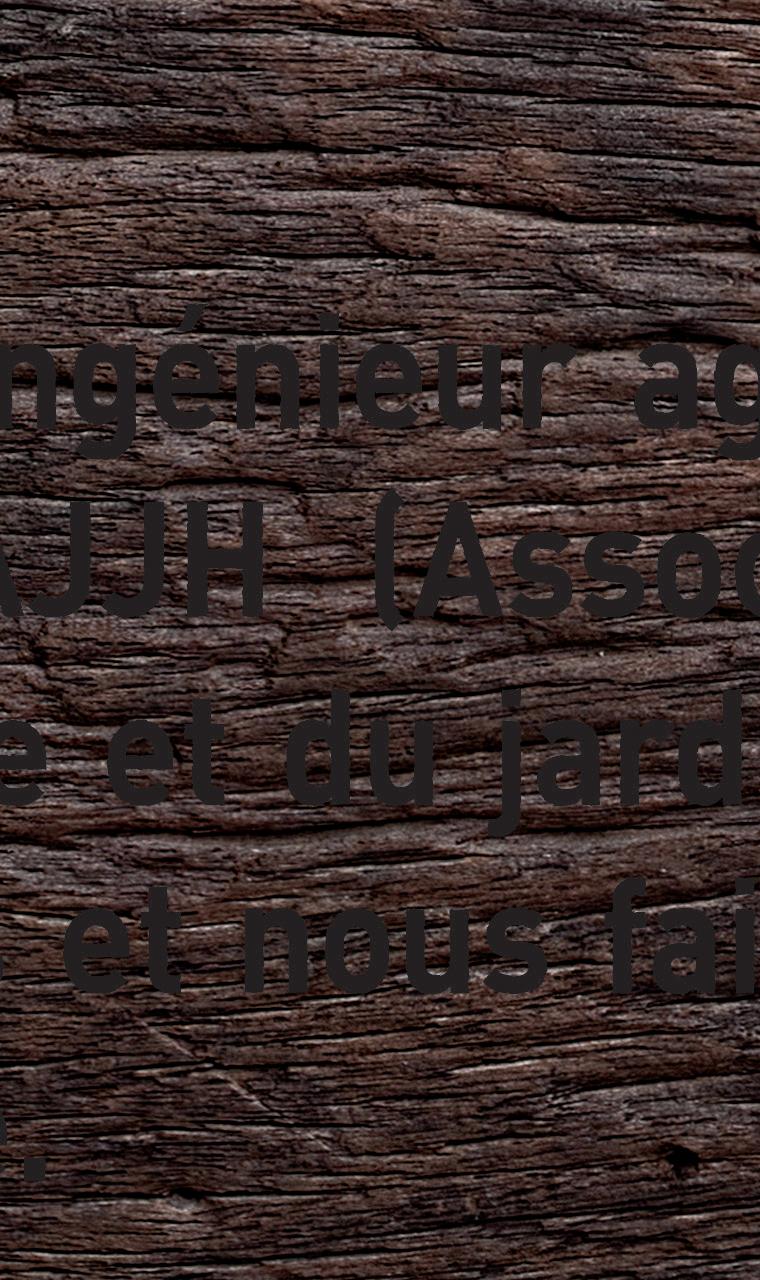

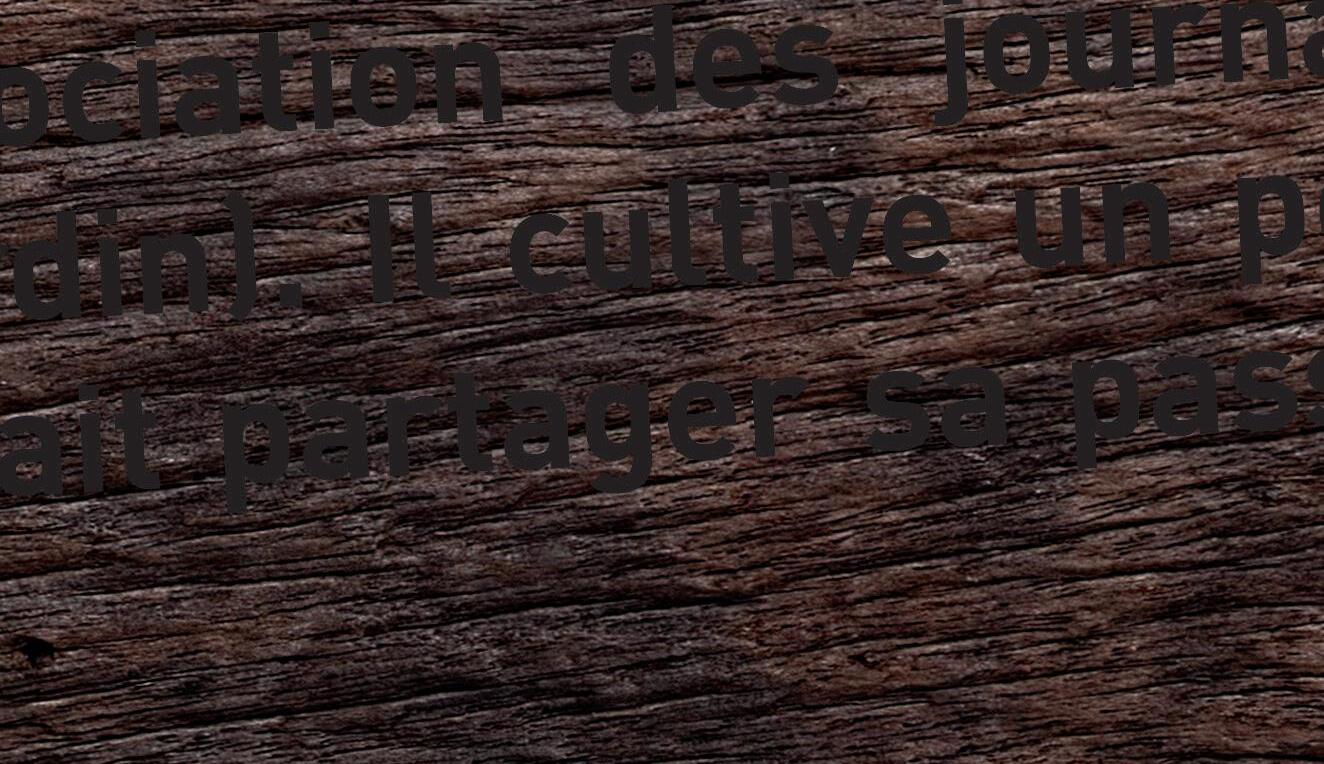

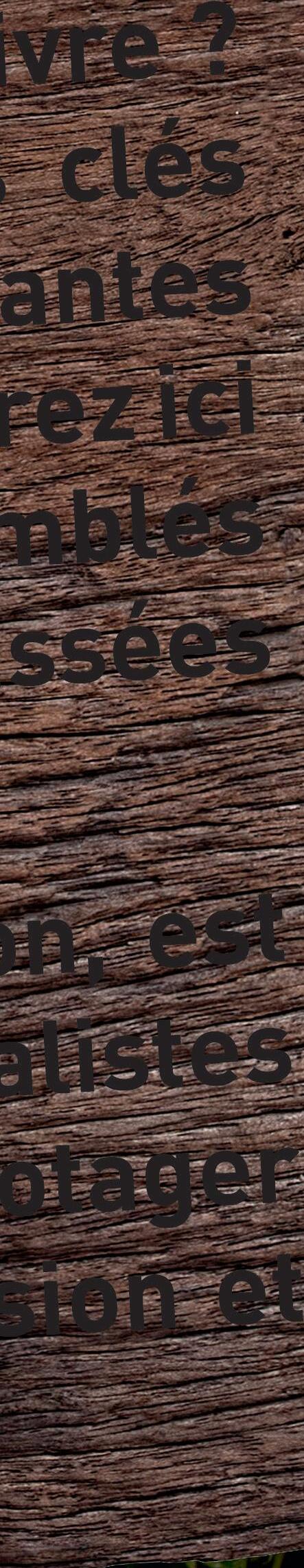
Michel Caron, ingénieur agricole de formation, est membre de l’AJJH (Association des journalistes de l’horticulture et du jardin). Il cultive un potager depuis toujours et nous fait partager sa passion et son savoir-faire.



