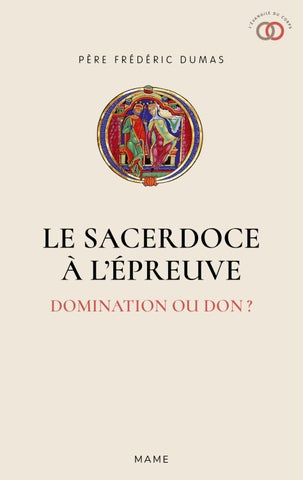LE SACERDOCE À L’ÉPREUVE
DOMINATION OU DON ?
Préface de Mgr Olivier de Germay
Sous la direction d’Yves Semen
MAME
Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sophie Cluzel
Direction artistique : Armelle Riva
Éditeur : Vincent Morch
Direction de fabrication : Thierry Dubus
Fabrication : Marie Dubourg
Mise en pages : Pixellence
© AELF, 2013, pour les textes de la traduction officielle liturgique de la Bible
© Mame, Paris, 2023
www.mameeditions.com
ISBN : 978-2-7289-3375-4
MDS : MM33754
Tous droits réservés pour tous pays.
PRÉFACE
Si vous faites partie de ceux qui pensent que le célibat du prêtre est la cause de nombreux problèmes actuels dans l’Église ou si, étant prêtre, vous doutez de sa pertinence et avez du mal à le vivre, lisez ce livre.
Dans une approche théologique profondément liée à son expérience pastorale, le père Frédéric Dumas expose les fondements théologiques, anthropologiques et spirituels du célibat.
On connaît le reproche qui est fait aujourd’hui au prêtre – ou plutôt, à certains prêtres – d’exercer son rôle de pasteur avec autoritarisme et esprit de domination. Le père Dumas fait remarquer que la configuration du prêtre au Christ Tête et Pasteur ne dit pas le tout de son ministère.
Comme l’indiquait déjà saint Jean-Paul II dans Pastores dabo vobis, le prêtre est aussi configuré au Christ Époux.
Nous avons dans cette image non seulement une clé de lecture du célibat sacerdotal mais aussi la source d’une spiritualité pouvant irriguer la vie du prêtre et lui permettre de vivre son ministère dans la joie de celui qui donne sa vie à ceux qu’il aime.
S’il est, certes, configuré au Christ Tête et Pasteur, le prêtre ne peut se comporter ni comme un donneur
d’ordre ni même comme un super-manager. Étant comme l’époux de la communauté qui lui est confiée, il cherche à imiter le Christ Époux qui a aimé l’Église et s’est livré pour elle (cf. Ep 5, 25). La charité pastorale devient le fil conducteur de sa vie.
Dans cette perspective, le prêtre est à la fois un père, un frère et un époux. La chasteté vécue dans la continence n’est plus un non-sens, une lutte perdue d’avance dans un monde hyper-érotisé, elle devient le lieu de son épanouissement et de sa fécondité pastorale. Elle rejoint l’appel à se donner par amour qui est si profondément inscrit dans le cœur de tout homme, et qui annonce les noces éternelles.
PROLOGUE
Je ne veux pas vieillir ainsi. Au cours d’un conseil presbytéral du diocèse, en 1999, un jeune curé expose la situation des différentes communautés et villages qui vont être regroupés en une seule grande paroisse. À la fin de son exposé, parmi les questions, le prêtre délégué des retraités, âgé de 80 ans, demande des précisions concernant la vie des mouvements : « Il y a quinze-vingt ans, il y avait de multiples équipes de CMR, de JAC et de MRJC. Tu n’en as pas parlé », dit-il. Le jeune curé répond : « C’est parce qu’il n’y en a plus. – Plus du tout ? » reprend le vieux prêtre. Pour ne pas l’attrister davantage, le jeune curé dodeline de la tête et se tait. « Ce n’est pas possible ! marmonne le vieux prêtre, mais qu’est-ce qui nous arrive ? »
Je l’ai regardé ; d’un coup, il s’est tassé. Il m’a rappelé d’autres dialogues de tristesse avec des grands-parents exprimant leur souffrance de voir leurs enfants divorcer, vivre maritalement, leurs petits-enfants n’être pas baptisés, leurs églises se vider. Mais qu’est-ce qui nous arrive ? Comment ? Non, je ne veux pas vieillir ainsi. J’ai
43 ans, je suis prêtre depuis dix ans, et je ne veux pas vieillir les yeux remplis de la décrépitude de l’Église.
« C’est la faute de l’Église, disent certains, elle n’avait qu’à pas tout changer ! Les chrétiens sont partis… Elle est trop archaïque, loin des gens, insignifiante… »
« C’est la faute des curés, disent d’autres, on ne les voit plus ; ils sont devenus des sortes d’administrateurs… »
Ou encore : « C’est la faute du monde et de ses dérives ! Il y a trop de laxisme, de libéralisme, de pluralisme, d’individualisme… »
Au milieu de ce conseil presbytéral, je regarde mon avenir se tasser sur sa chaise en marmonnant : « Qu’est-ce qui nous arrive ? » Non, je ne veux pas vieillir ainsi.
Ce petit événement, je l’ai vécu au seuil du troisième millénaire, et j’ai écrit alors ce petit récit. Et je rajoutais à l’époque dans mon cahier de vie :
Parvenu à la quarantaine, tout m’appelle à changer radicalement de trajectoire. Prêtre, je suis, prêtre, je resterai. Là n’est pas la question. Mais la question est celle de l’Église et de la conscience historique du moment qu’elle traverse. C’est cela qu’il me faut chercher, trouver, prêcher, prendre mon bâton de pèlerin et de toutes les manières possibles, annoncer que l’avenir est beau et grand ! En finir avec la désespérance, oui. Alors, cela vaudra la peine de vieillir.
Aujourd’hui, j’écris ce livre. Il porte les fruits de ces vingt années de recherche.
La crise des abus sexuels manifestée par le rapport de la Ciase met la figure du prêtre à l’épreuve. D’autres événements pourraient avoir lieu à la suite de ce rapport. Parmi toutes les questions qui se posent à l’Église de ce temps, il y a celle des ministères, de l’évêque et du prêtre.
Le ministère du prêtre est aujourd’hui pour le moins incompris, voire malmené, voire attaqué. Il l’est dans trois aspects : dans sa possibilité d’être dominateur, dans son exclusivité masculine, dans son célibat.
Mais la « figure du prêtre », c’est une abstraction ! Peut-on échapper à une dialectique stérile entre un discours théologique un peu théorique et un témoignage personnel tellement singulier qu’il ne peut dire quelque chose d’universel ? Je le crois. Mon propos voudrait tenter une synthèse entre une théologie issue d’une expérience de trente années de ministère diocésain, dans les paroisses françaises, et un témoignage singulier à partir de la découverte des catéchèses de saint Jean-Paul II sur la théologie du corps.
Après sept années d’études supérieures et quatre ans de vie professionnelle, salariée et libérale, j’ai quitté une profession d’ingénieur agricole et d’expert forestier il y a plus de trente-cinq ans pour entrer au séminaire et recevoir le sacrement de l’ordination en 1992. Je suis devenu prêtre du Prado, cherchant, à l’exemple du bienheureux père Antoine Chevrier, comment « me rendre plus efficace pour le salut des âmes », selon ses propres mots. Durant ces trente années, j’ai exercé comme curé de plusieurs paroisses, comme aumônier d’étudiants, de jeunes professionnels et des JMJ ; j’ai été délégué diocésain aux préparations au mariage, responsable du service de formation de mon diocèse, vicaire épiscopal pour la pastorale familiale ; j’ai exercé d’autres responsabilités encore.
Au tournant de l’an 2000, j’ai travaillé le thème de la « Proposition de la foi dans la société actuelle », et je me suis mis en situation de formation permanente, tant les
choses changeaient rapidement. Dix ans après, profitant de la pensée lumineuse de Benoît XVI, j’ai relu et célébré les cinquante ans du concile Vatican II1. J’ai enraciné ma pensée dans ce que Benoît XVI appelle « l’herméneutique de la continuité2 ». Et j’ai découvert la théologie du corps de Jean-Paul II à travers deux citations étonnantes :
« Le mariage est le sacrement primordial » et « le mariage est le prototype de tous les sacrements ». Elle a bouleversé ma vie spirituelle et ma pensée ; elle m’a donné un regard neuf sur ma propre affectivité, mon célibat, ma chasteté, et sur le sens du sacrement d’ordination que j’ai reçu. Dans un petit livre paru en 20183, j’ai commencé à témoigner comment la figure du Christ-Époux était tout à la fois bouleversante et fondamentale dans la vie du prêtre. À ce moment-là, nous vivions, dans la région lyonnaise, le départ du ministère d’un prêtre très médiatisé, qui affirmait : « Dieu m’a appelé à être prêtre, maintenant il m’appelle à être époux et père. » Comme si Dieu changeait de plan ou d’avis, et nous conduisait à des renoncements et à des attachements vocationnels variables et précaires !
Je remercie le cardinal Philippe Barbarin de m’avoir reçu lors de la diffusion de ce petit livre, Mgr Pierre-Yves
1. Remarquable, à ce propos, est l’ouvrage de Joseph Ratzinger, Mon concile Vatican II, Paris, Artège, 2012. Cadeau offert par mon évêque pour mes vingt années de sacerdoce.
2. Voir Benoît XVI, Discours à la Curie, Noël 2005. Selon le Saint-Père, deux interprétations du concile Vatican II se sont développées. L’une, appelée herméneutique de la discontinuité, considère le concile en rupture avec ce qui lui a précédé, apportant une nouveauté radicale. L’autre, l’herméneutique de la continuité, l’interprète dans la logique d’un développement du dogme au cours de l’histoire de l’Église. Benoît XVI admet que le concile Vatican II est à comprendre dans une continuité historique, tout en apportant une certaine rupture.
3. Frédéric Dumas, Prêtre et époux ? Lettre ouverte à mon frère prêtre, Paris, Mame, 2018.
Michel, évêque de Valence, de m’avoir invité à en parler avec les prêtres de son diocèse, ainsi que les évêques français qui l’ont reçu et l’ont transmis autour d’eux. Je remercie aussi le cardinal Robert Sarah de l’avoir cité en référence dans son ouvrage coécrit avec Benoît XVI1, au moment du synode sur l’Amazonie et des débats liés au célibat ecclésiastique et à l’ordination éventuelle de viri probati. Et je remercie les nombreux jeunes prêtres qui, à la lecture de mon livre, ont aimé se recevoir à nouveau dans la figure du Christ-Époux, et pas uniquement dans celle du Christ-Tête et Pasteur. Car l’articulation en nousmêmes de ces trois figures christiques m’est apparue de plus en plus fondamentale.
C’est pourquoi, à plus de 60 ans, je me suis lancé dans l’obtention d’un mastère en théologie du corps2, et j’ai présenté un mémoire intitulé : Prêtre, Époux et Célibataire : la configuration au Christ-Époux au fondement du célibat sacerdotal. Ce travail, je l’ai réalisé tout en assurant, au milieu de la pandémie de Covid, le service sacerdotal de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, mondialement connue parce qu’œuvre du célèbre architecte Le Corbusier. Sur cette colline vénérable, aux pieds de la Vierge Marie priée là depuis le xiiie siècle, et dans le calme des confinements successifs, je suis entré encore mieux dans la profondeur du mystère du sacrement du prêtre, celui que Jésus n’appelle plus « Serviteur » mais « Ami ». Ami de l’Époux, certes,
1. Benoît XVI, cardinal Sarah, Des profondeurs de nos cœurs, Paris, Fayard, 2020. L’ouvrage est cité en note, p. 99.
2. Voir les propositions de l’Institut de théologie du corps à Lyon, présidé par Yves Semen : www.institutdetheologieducorps.org.
mais aussi choisi pour être époux dans l’Époux, et pour l’Épouse qu’est l’Église.
Puis est venue l’explosion de la bombe des affaires pédophiles : le rapport Sauvé de la Ciase. Le choc est grand et l’onde se propage profondément. Impossible de ne pas mesurer combien la réalité de la solidarité sacramentelle qui nous lie les uns aux autres a été atteinte, abîmée.
J’ai aimé que nos évêques révèlent avec humilité, et en pleine sidération, la sponsalité de leur ministère à Lourdes, lors de l’Assemblée plénière en novembre 2021. On pourrait dire : « Il était temps ! », mais ils l’ont fait. Le ton, le regard, la parole ont changé. Et ce n’est pas une simple question de posture. Cela va bien plus loin que ce geste de repentance à genoux devant la croix. Car en recevant le rapport Sauvé, les évêques n’ont-ils pas révélé comment ils voulaient vivre leur ministère ? Comme des époux plutôt que comme des managers ; comme des personnes données plutôt que comme des dominateurs. Selon leur triple configuration au Christ Époux, Tête et Pasteur.
Permettez-moi de citer un petit passage du discours de clôture donné par Mgr de Moulins-Beaufort, à l’issue de l’assemblée plénière de cet automne 2021, qui témoigne de ce changement de ton :
Nous sommes donc obligés de constater que notre Église est un lieu de crimes graves, d’atteintes redoutables à la vie et à l’intégrité d’enfants et d’adultes. Or, cela ne se peut. Cela ne peut pas être l’Église de Jésus, l’Église fondée dans le don de soi du Seigneur Jésus, l’Église qui a grandi de la souche d’Israël et que les Apôtres ont ouverte à toutes les nations. [...]
Ce que la Ciase décrit n’est pas notre Église. Nous ne sommes pas devenus prêtres pour avoir part, même malgré nous, à des actes meurtriers. Nous ne sommes pas chrétiens
pour entretenir un organisme dangereux pour les autres. Notre réaction à nous, évêques, a donc été : ce mal commis, ce mal existant, nous devons l’assumer. Nous devons l’assumer pour en libérer ceux et celles qui l’ont subi et pour en dégager l’Église afin qu’elle puisse être celle de Jésus de Nazareth. Nous ne pouvons plus nous protéger derrière le droit positif. Nous devons nous montrer les disciples et les serviteurs de Jésus, notre Seigneur, de celui « qui n’a pas retenu jalousement le rang qui l’égalait à Dieu mais qui s’est anéanti luimême, obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2, 5). L’un de nous l’a rappelé : notre justice doit dépasser celle des scribes, nous ne pouvons rester cachés derrière la justice de l’État, et moins encore derrière le droit canonique, il nous appartient d’aller au-delà dans un élan vers celles et ceux qui souffrent.
Je partage totalement cette attitude, je me retrouve bien comme collaborateur de leur ministère, et je le leur ai dit.
En envoyant mes vœux aux amis au terme de l’année 2021, j’ai écrit : « Pour moi, l’enfant de Bethléem ressemble cette année à tous les enfants que symbolise cet enfant qui pleure, devant l’image duquel le cœur de nos évêques a fondu comme fondit en 1858 le cœur du curé Peyramale devant la petite Bernadette tout essoufflée lui disant : “La Dame m’a dit : je suis l’Immaculée Conception.” Marie l’Immaculée que j’ai servie pendant deux ans à Ronchamp nous a rappelé à Lourdes cet automne 2019 que l’Église, bien que salie par ces actes ignobles, était aux yeux du Christ son Époux, toujours appelée à devenir ce qu’Elle est : immaculée et sans tache. »
C’est cette conviction que j’espère vous faire partager dans ces quelques pages : les prêtres peuvent trouver dans la figure du Christ-Époux, et dans leur condition
de célibataires, de quoi renouveler leur ministère et témoigner que leur vie et leur ministère ne sont pas domination mais don. Car cette crise est surtout une sorte de kaïros dans l’Esprit Saint, une opportunité pour faire retentir davantage la vérité du sacerdoce ministériel selon l’Évangile de Jésus Christ1, de son incarnation dans des personnes humaines masculines et célibataires. Il serait indigne qu’en assumant les conséquences du rapport Sauvé, et au nom même de cet enfant qui pleure montré en symbole à Lourdes, de ces milliers d’enfants agressés, nous ne rétablissions pas, par notre vie, cette vérité : le prêtre est un don de Dieu pour l’humanité, non un dominateur. Nous serons toujours jugés par l’Évangile : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ce qui ne signifie pas que certains changements ne soient pas nécessaires, dans cette herméneutique de la continuité qui est au cœur du concile Vatican II.
Pour cela, nous commencerons par faire un petit détour théologique sur les trois configurations qui sont celles du prêtre dans le sacrement de l’ordre. Nous le ferons avec l’aide de saint Jean-Paul II et de son exhortation Pastores dabo vobis, que je me souviens avoir reçue à quelques semaines de mon ordination sacerdotale et avec laquelle je m’y étais préparé. Elles éclairent les trois
1. Il n’est qu’à relire le discours du pape François à la Curie pour les vœux de Noël 2020 : « La crise est un phénomène qui investit tout et chacun. Elle est présente partout et à toute époque de l’histoire, elle implique les idéologies, la politique, l’économie, la technique, l’écologie, la religion. Il s’agit d’une étape obligatoire de l’histoire personnelle et de l’histoire sociale. Elle se manifeste comme un événement extraordinaire qui cause toujours un sentiment d’appréhension, de déséquilibre et d’incertitude dans les choix à faire. Comme le rappelle la racine étymologique du verbe krino : la crise est ce tamis qui nettoie le grain de blé après la moisson. »
grandes fonctions du ministère, qu’on appelle les tria munera : annoncer, gouverner, sanctifier.
La charité pastorale est au cœur de la réflexion du Saint-Père. Car, comme pour le mariage, la source de notre vocation et de notre mission se trouve être le don de l’amour de Dieu, que saint Jean-Paul II appelle « amour sponsal ». Mais si, dans le mariage, la charité a la forme d’un amour conjugal, dans la vie du prêtre elle prend la forme de la charité pastorale. Elle entretient un rapport étroit et fécond avec le célibat et la continence pour le Royaume.
Puis, nous nous arrêterons sur la question de la paternité du prêtre. Face à une paternité du prêtre trop critiquée ou trop marquée, est-il suffisant de vivre une simple fraternité ministérielle ? Ne faut-il pas aussi l’articuler à cette condition sponsale ? Nous regarderons ce que peut apporter une articulation entre paternité, fraternité et sponsalité. Enfin, nous tâcherons de regarder comment, par une « subjectivation adéquate1 », il est possible à la personne humaine masculine qu’est le prêtre de s’ajuster à ce donné sacramentel et de devenir prêtre à la manière dont Jésus Christ l’est devenu comme Époux, Pasteur et Tête de l’Église en marche vers le Royaume.
Je vous proposerai quelques intermèdes tirés de mon expérience pastorale et un petit parcours biblique très simple, à partir de quelques passages de l’Évangile qui nous aident à contempler le Christ-Époux et Pasteur.
1. Cette expression fait partie du vocabulaire wojtylien. On la trouve dans son ouvrage de philosophie Personne et Acte, ainsi que dans les catéchèses de la théologie du corps. Nous expliquerons plus loin ce qu’elle signifie.
CHAPITRE PREMIER
LA CONFIGURATION AU CHRIST-ÉPOUX
DANS PASTORES DABO VOBIS
Certains pensent que, en théologie, il faudrait laisser la figure de l’Époux dans la pénombre, car elle serait la source d’une déviance du ministère consistant à se tenir en surplomb, en domination, vis-à-vis de la communauté chrétienne. J’espère que ces lignes aideront à voir qu’il n’en est rien, que c’est tout le contraire, puisque cette figure porte en elle la donation de l’amour sponsal de Dieu. C’est pourquoi elle doit absolument être manifeste dans la vie concrète du prêtre. Mais rappelons en quelques mots ce qu’est la configuration au Christ.
Le sacrement de l’ordre reçu par le prêtre vient imprimer dans son être, de manière mystérieuse et réelle, un sceau. On l’appelle « caractère », et il est donné de manière indélébile et définitive. Il est comme l’impression d’un visage particulier de Jésus qui se révélera à travers la personne du prêtre. Il y a trois visages reçus dans le caractère sacerdotal : celui du Christ-Tête qui renvoie à
sa relation avec le Corps qu’est l’Église qu’il nourrit et à qui il impulse sa direction –, celui du Christ-Pasteur qui renvoie à sa relation avec le peuple de Dieu qu’il conduit et soigne, et celui du Christ-Époux qui renvoie à l’Église comme son Épouse qu’il aime et sanctifie. Toute la vie du prêtre est un appel à rendre visibles ces visages. C’est à la fois un travail et une grâce, un don.
Les trois configurations au Christ
À la suite du concile Vatican II et du décret Presbyterorum ordinis sur la vie et le ministère des prêtres, le texte majeur qui en éclaire l’application est issu du Synode sur la formation des prêtres de 1990. À cette occasion, saint Jean-Paul II donne à l’Église une exhortation apostolique qui expose de manière très complète la constitution du sacerdoce à partir de sa participation au sacerdoce du Christ. Il y développe les différentes configurations au Christ conférées par le sacrement de l’ordre et, par là même, les ressources spirituelles dans lesquelles le prêtre peut puiser pour persévérer sur le chemin de la sainteté dans la fidélité à son engagement.
Elle est datée du 25 mars 1992 et comprend six chapitres. Nous nous arrêterons principalement aux chapitres ii (« La nature et la mission du sacerdoce ministériel ») et iii (« La vie spirituelle du prêtre »). Et d’abord citons longuement le numéro 12 :
« L’identité sacerdotale – ont écrit les Pères synodaux –, comme toute identité chrétienne, prend sa source dans la Très Sainte Trinité », qui se révèle et se communique aux hommes dans le Christ, constituant, en Lui et par l’action de l’Esprit, l’Église comme « le germe et le commencement » du Royaume. [...]
C’est à l’intérieur de l’Église comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire que se révèle toute identité chrétienne, et donc aussi l’identité spécifique du prêtre et de son ministère. En effet, le prêtre, en vertu de la consécration qu’il a reçue par le sacrement de l’ordre, est envoyé par le Père, par Jésus Christ, à qui il est configuré de manière spéciale comme Tête et Pasteur de son peuple, pour vivre et agir, dans la force de l’Esprit Saint, pour le service de l’Église et pour le salut du monde. [...]
On ne peut donc définir la nature et la mission du sacerdoce ministériel hors de cette trame multiple et riche des rapports qui ont leur source dans la Très Sainte Trinité et qui se prolongent dans la communion de l’Église comme signe et instrument, dans le Christ, de l’union des hommes avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain. Ainsi l’ecclésiologie de communion devient décisive pour saisir l’identité du prêtre, sa dignité propre, sa vocation et sa mission dans le Peuple de Dieu et dans le monde. [...]
En tant que mystère, l’Église est essentiellement relative à Jésus Christ ; en effet, elle est, de lui, la plénitude, le corps et l’épouse. Elle est le « signe », le « mémorial » vivant de sa présence permanente et de son action parmi nous et pour nous. Le prêtre trouve la pleine vérité de son identité dans le fait d’être une participation spécifique et une continuation du Christ lui-même, souverain et unique prêtre de la Nouvelle Alliance : il est une image vivante et transparente du Christ prêtre. Le sacerdoce du Christ, expression de sa « nouveauté » absolue dans l’histoire du salut, constitue la source unique et le paradigme irremplaçable du sacerdoce du chrétien, et en particulier du prêtre. La référence au Christ est ainsi la clef absolument nécessaire pour la compréhension de la réalité du sacerdoce1.
Ce passage précise d’abord que l’identité sacerdotale trouve sa source dans la Sainte Trinité. La vie de Dieu
est une vie de communion entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Cette communion se réalise par le don mutuel des personnes divines dans l’amour. Le don de soi est au cœur des relations en Dieu. Dans son encyclique sur l’Esprit Saint, Dominum et vivificantem, Jean-Paul II dit que, « dans l’Esprit Saint, la vie intime du Dieu un et trine se fait totalement don », et que, « par l’Esprit Saint, Dieu existe sous le mode du don »1. Et, en se communiquant par l’incarnation du Christ Jésus, le Dieu-Trinité constitue l’Église dans la même dynamique de don mutuel de soi des personnes. Le Christ, en se donnant à l’humanité, crée l’Église comme son Corps. Corps du Christ, elle est donc une communion qui se réalise par l’échange de don des personnes, à l’image de la Trinité. C’est pourquoi Jean-Paul II la définit dans cette citation comme « mystère de communion trinitaire en tension missionnaire ».
Au cœur de l’Église, le ministère sacerdotal se vit dans cette tension entre communion et mission.
Pour saint Jean-Paul II, seule l’ecclésiologie de communion permet de comprendre, non seulement l’identité chrétienne, mais aussi l’identité sacerdotale, sa dignité et sa mission. Il n’est pas de mon propos de faire un exposé détaillé de cette ecclésiologie. De nombreux ouvrages l’ont fait auxquels il est intéressant de se reporter. J’aimerais simplement mettre l’accent sur un certain renversement de perspective, lorsque l’on passe d’une Église pensée comme une société hiérarchique, dirigée plus ou moins cléricalement par les évêques et les prêtres, à une autre vue comme un Corps vivant, animé par l’Esprit Saint don
de Dieu, sous le mode de relations fraternelles d’échanges de dons. Cela aide aussi à envisager une profonde transformation du sens du sacerdoce et de sa mise en œuvre au cœur de l’Église.
La référence au Christ s’impose comme irremplaçable pour comprendre la nouveauté du sacerdoce de la Nouvelle Alliance, qui n’est pas de même nature que le sacerdoce ancien 1. Elle est signifiée par ces différentes configurations au Christ – Pasteur, Tête et Époux – que le pape rappelle dans son exhortation, et qui indiquent de manière analogique 2 comment le prêtre est appelé à rendre visibles ces visages de Jésus. Bien des événements – et la crise des abus sexuels est significative à cet égard – témoignent qu’il demeure trop différent de Jésus Christ, alors qu’il est appelé à lui ressembler et à l’imiter.
Dans le numéro 12 de l’exhortation, il semble que tout ce qui concerne la nature et la mission du sacerdoce ne puisse se comprendre en dehors du lien indissoluble
1. Sur ce point, les nombreuses publications du cardinal Albert Vanhoye sur la lettre aux Hébreux sont très éclairantes. Citons par exemple : A. Vanhoye, s.j. : « En distinguant…, Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel », NRT, t. 97-3, 1975. Dans cet article, le père Vanhoye réagit à un texte du synode des évêques de 1971 : Le Sacerdoce ministériel. Esquisse des thèmes. Voici notamment ce qu’il conclut : « [L’auteur de la lettre aux Hébreux] observe que le culte ancien était rituel, extérieur, conventionnel. Il lui oppose le culte réel, personnel, existentiel, inauguré par le Christ. La conception ancienne présentait une sanctification négative, réalisée au moyen de séparations rituelles. Le Christ nous présente au contraire une sanctification positive, obtenue dans l’existence concrète. [...] Le sacerdoce commun est culte réel, le sacerdoce ministériel est médiation sacramentelle. »
2. L’analogie permet de mettre en relation deux réalités à la fois semblables et dissemblables. Par exemple : le Christ et le baptisé qui est analogiquement un autre Christ : homme appelé à lui ressembler mais étant vraiment très loin de cette ressemblance.
du Christ et de l’Église, « qui est, de lui, la plénitude, le corps, et l’épouse1 ».
Relevons enfin que sont citées clairement les deux configurations au Christ Tête et Pasteur, alors que celle au Christ-Époux est, en quelque sorte, évoquée par l’Église-épouse. Cette nuance a toute son importance, comme nous le verrons.
Le numéro 13 développe la relation fondamentale du prêtre avec le Christ Tête et Pasteur : « Jésus Christ a manifesté en lui-même la figure parfaite et définitive du sacerdoce de la Nouvelle Alliance2. »
Le Saint-Père évoque la figure de Jésus, médiateur parfait, par l’offrande de lui-même sur la Croix. Il s’agit de la figure du grand prêtre développée dans la lettre aux Hébreux, aux chapitres 8 et 9. Puis il parle du Christ comme du Bon Pasteur,
annoncé à l’avance par les prophètes (cf. Ez 34), celui qui connaît ses brebis une par une, qui offre sa vie pour elles et qui veut les rassembler toutes comme un seul troupeau avec un seul pasteur (cf. Jn 10, 11-16). Il est le pasteur, venu non « pour être servi, mais pour servir » (Mt 20, 28), qui, dans le geste pascal du lavement des pieds (cf. Jn 13, 1-20), laisse aux siens le modèle du service qu’ils devront se rendre les uns aux autres, et qui s’offre librement comme « agneau innocent » immolé pour notre rédemption (cf. Jn 1, 36 ; Ap 5, 6-12) 3 .
1. PDV, n° 12. Ces trois qualificatifs, le Saint-Père les trouve dans la lettre aux Éphésiens. Par exemple, Ep 1, 22-23 : « Oui, il [le Père] a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui [le Christ] la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ. »
2. PDV, n° 13.
3. Ibid.
Magnifique visage de Jésus, fils de David, le Bon Pasteur. Déjà le prophète Ézéchiel dénonçait les faux pasteurs qui vivaient sur le dos du troupeau, se servant de lui au lieu de le servir. Et il annonçait la venue du vrai pasteur : « Voici que moi-même je m’occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je m’occuperai de mes brebis » (Ez 34, 11-12).
Les textes évangéliques reprennent très fidèlement le motif exposé par Ézéchiel, en l’attribuant à Jésus, venu pour servir, cherchant la brebis égarée, rassemblant un seul troupeau dans une seule bergerie. Il y faut un cœur particulièrement plein de charité !
Deux configurations plus une
Pour mieux comprendre comment s’articulent les différentes configurations, le numéro 16 apporte un élément tout à fait important :
La relation fondamentale du prêtre est celle qui l’unit à Jésus Christ Tête et Pasteur : il participe en effet, d’une manière spécifique et authentique, à la « consécration », ou « onction », et à la « mission » du Christ (cf. Lc 4, 18-20). Mais à cette relation-là est intimement liée celle qui l’unit à l’Église. Il ne s’agit pas de « relations » simplement juxtaposées : elles sont elles-mêmes intimement unies par une sorte d’immanence réciproque. La référence à l’Église est inscrite dans l’unique et même rapport du prêtre au Christ, en ce sens que c’est la « représentation sacramentelle » du Christ par le prêtre qui fonde et anime son rapport à l’Église1.
Jean-Paul II distingue entre, d’une part, la relation qui unit le prêtre au Christ-Tête et Pasteur, et d’autre part, celle qui l’unit à l’Église. Ces deux relations ne sont pas juxtaposées mais « intimement unies par une sorte d’immanence réciproque ». Tout ce que le Christ fait pour l’Église lorsque, comme Tête, il la conduit, et lorsque, comme Pasteur, il la rassemble et la nourrit, il le fait comme l’Époux le fait pour son épouse, afin de la rendre sainte et immaculée, de l’aimer comme son propre corps. C’est dans cette ligne-là que la consécration sacramentelle conduit le prêtre à vivre son ministère.
Cette affirmation nous semble conforme à la théologie du corps. C’est bien dans le cadre de la dimension sponsale1 que le prêtre doit vivre sa configuration au Christ-Pasteur.
Il y aurait en quelque sorte « deux plus une » configurations au Christ dans la vie du prêtre. Si elles sont toutes les trois égales en dignité, et totalement une dans le Christ, elles ne sont pas juxtaposées dans la vie du prêtre, car cela permettrait une dérive sacramentelle (le prêtre pourrait choisir quelle figure il voudrait privilégier dans son agir ministériel, au détriment des autres). Leur immanence réciproque interdit toute séparation d’une figure par rapport à une autre.
Ainsi, je ne peux être pasteur sans que cela soit vécu dans l’amour sponsal de l’époux ; je ne peux pas être époux sans agir pastoralement pour que le corps du Christ atteigne sa taille adulte dans sa plénitude (Ep 4, 13).
Je ne peux pas gouverner la portion de peuple de Dieu qui
1. « Sponsal » est un mot typique de la pensée de Jean-Paul II. Issu du latin sponsus, sponsa, qui veut dire « époux », « épouse », il désigne une manière d’aimer tout à fait particulière qui est celle du Christ envers l’Église, et que vivent les époux dans le sacrement du mariage : amour qui est don de soi, exclusif et définitif, indissoluble.
m’est confiée par mon évêque sans l’aimer ni la conduire. Ce serait la brimer, la violenter, l’utiliser.
À la parution de mon premier livre, un confrère prêtre m’avait dit qu’il ne fallait pas trop mettre en avant la figure de l’époux car cela situait trop le prêtre « en face » de l’Église et risquait de développer un mode de domination. Je ne peux donner raison à cette remarque fraternelle : c’est plutôt la figure de la Tête qui entraîne un risque de domination. Au contraire, la figure de l’Époux est celle de la compassion, de la proximité, celle du « Je suis avec vous tous les jours », comme nous le verrons dans les prochains chapitres.
Et c’est en tant qu’il est époux de l’Église que le prêtre s’attache à promouvoir en elle le sacerdoce commun comme un bien pour elle et pour chacun de ses membres :
« Le ministère du prêtre est entièrement au service de l’Église pour promouvoir l’exercice du sacerdoce commun de tout le peuple de Dieu1. » Sacerdoce commun, et non pas individuel, comme le rappelait le cardinal Vanhoye2. Dans cette ligne, Jean-Paul II poursuit au numéro 17 :
Les prêtres, enfin, parce que leur figure et leur engagement dans l’Église ne remplacent pas, mais bien plutôt promeuvent le sacerdoce baptismal de tout le peuple de Dieu, le conduisant à sa pleine réalisation ecclésiale, se trouvent en relation positive et constructive avec les laïcs. Ils sont au service de leur foi, de leur espérance et de leur charité. Ils en reconnaissent et soutiennent, comme frères et amis, la dignité de fils de Dieu et ils les aident à exercer pleinement leur rôle spécifique dans le cadre de la mission de l’Église.
INTERMÈDE
À la suite de la publication de mon précédent ouvrage, j’ai reçu un message d’une jeune femme me disant : « J’ai offert votre livre à mon curé, nous l’avons lu. C’est beau ! Mais c’est difficile ! »
Un dialogue s’installe. Je découvre la situation, semblable à celle de nombreux prêtres en rural : des dizaines de villages, une communauté vieillissante, fidèle mais quasi impossible à faire bouger, un jeune curé désespéré, empli d’un sentiment d’inutilité, ou plutôt d’infécondité.
Alors, arrive ce que la nature a promis à ceux qui veulent répondre, depuis Adam et Ève, à l’appel primordial des noces : ils tombent amoureux. Finalement, au bout de deux ans, ayant déjà franchi ensemble quelques étapes vers une communion plus exclusive, ce jeune prêtre quitte le ministère.
Une épouse à qui je partageais ce fait de vie m’a répondu : « Sa communauté paroissiale ne s’est pas rendue épousable. » Cette parole m’a permis de comprendre mieux les choses en me renvoyant au prophète Isaïe : « Alors, on te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. [...] On ne te dira plus : “Délaissée !”
À ton pays nul ne dira : “Désolation !” Toi, tu seras appelée “ma préférence”, cette terre se nommera “L’Épousée” » (Is 62, 2-4).
Sans porter de jugement sur qui que ce soit, ne peut-on pas penser que soit la communauté paroissiale, par son engourdissement, ne s’est pas rendue apte à être l’Épousée mais est restée la Délaissée, soit que ce prêtre n’a pas suffisamment renforcé sa vie spirituelle d’Époux de l’Église ? Peut-être même y a-t-il un peu des deux ! Dans les paroisses où j’ai servi, j’ai bien vu que dans plusieurs villages la situation était la même.
Le Christ, lui, le seul Époux véritable, aime cette part rurale de l’Église de France un peu engourdie, et souffre sûrement de ces situations nombreuses dans lesquelles la première réalisation des noces ne se fait pas. Comme si l’Époux leur avait été enlevé !
De la même façon, lorsque des baptisés, ayant délaissé la communauté, n’exercent plus leur sacerdoce commun, alors le sacerdoce ministériel, qui lui est relatif, devient compliqué. Suffit-il de dire comme Abraham : « Le Seigneur pourvoira » (Gn 22, 8) ? Dans le quotidien, ce n’est pas toujours simple.
Les noces du Christ et de l’Église se réalisent lorsque tout acte ministériel vécu « in persona Christi Pastoris, Capitis et Sponsi » consiste à promouvoir la participation sacerdotale des fidèles au sacerdoce du Christ.
Ce peut être considéré comme la meilleure expression de son amour sponsal pour l’Église.
Et, tout cela, le prêtre le vit à travers les trois grandes fonctions (les tria munera) de son ministère : sanctification, prédication et gouvernement.