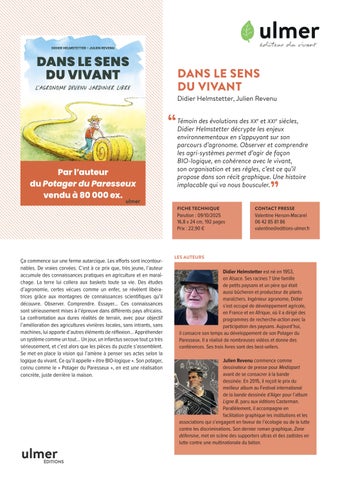DANS LE SENS DU VIVANT
l’agronome devenu jardinier libre
Par l’auteur du Potager du Paresseux vendu à 80 000 ex.
Chapitre 1
LE COMPLEXE DU SAUVEUR
À la fin des années 1950, pour l’auteur, sur la ferme autarcique familiale et le potager professionnel de son père, il y a toujours trop à faire. Les enfants n’ont pas le temps de jouer. Se nourrir est à ce prix ! Cela rend l’auteur allergique à jamais aux corvées jardinières. Heureusement, l’école de la République le tire vers le haut, et il finit ingénieur agronome. Il part alors pour l’Afrique car, depuis qu’il a lu, à 15 ans, un article sur René Dumont, son rêve d’adolescent est de sauver ce continent de la famine. Rien que ça !
Chapitre 2
AFRIQUE : L’AGRONOME À L’ÉPREUVE DU TERRAIN…
Après une douzaine d’années passées dans la brousse africaine, il comprend que dans un système agraire paysan, sans engrais, sans pesticides et avec des pluies erratiques, augmenter la production est très compliqué… Une bonne analyse de la situation est un préalable : d’abord, bien « comprendre tout le système » avant de proposer des solutions réalistes et durables. Cela restera à jamais un réflexe, même aujourd’hui dans son potager ! Les connaissances sont utiles, mais réfléchir globalement se révèle indispensable…
Chapitre 3
TROP DE STRESS NUIT…
MAIS UN INFARCTUS
PEUT SAUVER !
La répétition de situations professionnelles tendues conduit l’auteur à se mettre dans le rouge… Un jour, le cœur dit stop. L’auteur est sauvé, mais il n’a plus la force de continuer comme avant. Heureusement, son cerveau est intact. Il révise alors radicalement sa façon de jardiner, ce qui le mettra sur le chemin d’un potager « presque sans travail ». Le Potager du Paresseux est né ! D’un infarctus.
Chapitre 4
UN PARESSEUX, PARFOIS, ÇA ÉGRATIGNE…
L’auteur met à profit toutes ses connaissances agronomiques et son expérience africaine pour peaufiner une façon de jardiner inédite, qui échappe largement aux modes… C’est une autre vision. Ses réflexions troublent : pas de grelinette, pas de permaculture… Composter, quel dommage ! L’autonomie alimentaire dans un simple potager ? Un leurre ! En revanche, stocker de l’eau et l’utiliser efficacement devient indispensable : normal, le climat change…
Chapitre 5
TOUT CELA EST D’UNE LOGIQUE IMPLACABLE !
La clé transparaît enfin : jardiner paresseusement consiste à se faire épauler efficacement par le vivant. C’est la seule règle. Pour obtenir des légumes en abondance sans effort, plutôt que de le contrarier avec des agitations jardinières inutiles, il s’agit de le comprendre, de l’accompagner, de lui faciliter la vie. C’est ce que l’auteur appelle être « BIO-logique ».
Chapitre 6
RETOUR VERS LE FUTUR
Aujourd’hui, au regard du chemin parcouru, l’auteur se livre à quelques réflexions, celles d’un agronome s’interrogeant sur l’avenir de l’agriculture à l’horizon 2050. Comment imaginer une production agricole sans les énergies fossiles ? Comment, avec le changement climatique, gérer l’eau dont les cultures ont besoin ? Ils sont là, les enjeux majeurs…
Tu vois, produire des légumes plus que bio, sans aucun travail du sol, c’est pas très compliqué...
Pardon. Quel con ! Je ne me suis pas présenté : Didier Helmstetter... …... dit « Did67 » Pfff ! « pas très compliqué », tu parles ! c’est ce que je dis aujourd’hui.
Mais quand je pense que j’ai failli, il y a vingt ans, faire l’énorme connerie d’acheter un motoculteur !
Je m’interdis l’usage de pesticides ou d’engrais. Attention : même ceux autorisés en Bio. C’est pour ça que je dis « légumes plus que BIO ».
Je préfère coopérer avec les organismes vivants. Bien les nourrir. Les gêner le moins possible.
Peut-être faut-il que je vous en dise un peu plus...
Pour tout dire, je les chouchoute.
Je parle là des organismes du sol, bien sûr.
mais aussi de la biodiversité dans mon potager, Et tout autour.
Pour être honnête, il y a douze ans, j’aurais très bien pu faire la connerie de creuser pour confectionner des buttes de permaculture, Et tout chambouler. Mais heureusement, l’infarctus...
... Ça a été ma chance.
C’est vrai : j’ai eu de la chance. Beaucoup…
La première fois en 2007 : l’infarctus… La chance, vous l’aurez deviné, c’est d’y avoir survécu, non sans quelques séquelles : diminution physique, incapacité à entreprendre de gros travaux. Cela ne s’est pas arrangé avec l’âge, et quelques petits bobos en bonus ! C’est ce manque de force physique qui a été ma vraie chance : j’ai été contraint d’arrêter toutes ces bêtises jardinières que je faisais moi aussi avant, et que font encore, en général, beaucoup de jardiniers qui n’ont pas été secoués comme moi. Attention, ne me comprenez pas de travers : je ne souhaite à personne de faire un infarctus. Chacun peut se contenter de réfléchir. Tranquillement, dans un transat en été. L’hiver, c’est mieux près du feu. J’ai été empêché de bêcher, de biner, de charrier de la terre, de transporter du fumier, de construire des carrés, de les remplir… Je n’ai pas acheté le motoculteur dont j’avais rêvé. À la place de tout ça, j’ai mis de l’ordre dans mes idées. Avec le recul, je vois dans les travaux que je viens d’énumérer une sorte d’agitation. S’agiter, c’est faire quelque chose même si ça n’a pas réellement de sens. On fait car on pense que c’est efficace. Ou utile. Voire indispensable. On fait sans réfléchir. Ça occupe. Ça évite de réfléchir (ça tombe bien). On fait parce que tout le monde fait… C’est à l’image d’une mouche dans un bocal. Elle a été piégée là. Et elle tourne. Se heurte contre la paroi de verre. Recommence. Se cogne encore. Et recommence. Comme toute mouche piégée dans un bocal, ou derrière une vitre. Vous voyez le spectacle ? Elle ignore que jamais elle ne pourra traverser le verre. Elle ne sait pas ce que c’est, du verre. Elle voit la lumière de l’autre côté, alors elle continue. L’ignorance est un piège ! Vous, vous le savez très bien : jamais elle ne traversera. Elle aura beau essayer mille fois. Sa seule toute petite chance de s’en sortir serait que quelqu’un rouvre le bocal, ou la fenêtre… Ce serait la seule. Pour éviter de gaspiller cette minuscule chance, elle devrait surtout ne pas épuiser ses forces. Rester immobile. Attendre. Se mettre en veille. Voilà ce qui pourrait la sauver. Vous noterez que c’est l’exact contraire de ce qu’elle fait. Elle ne comprend rien. Elle s’agite, pensant bien faire. Mais peut-être lui manque-t-il juste un transat dans son bocal ?
N’ayant plus la force de m’agiter, j’ai laissé tomber beaucoup de choses. Mon potager, très classique bien que bio jusque-là, avec son sol nu que je bêchais en automne ou au printemps, auquel j’apportais du compost et que je binais tout au long de la saison, est très vite devenu une friche. C’est ce que la nature sait faire de mieux toute seule : cette sorte de bordel exubérant que les hommes appellent péjorativement une friche ! Des herbes
folles, des fleurs sauvages, des ronces, des saules, des insectes, des oiseaux, des sangliers… Une vitalité folle. Elle le fait spontanément. Partout (hormis dans les déserts quand manque l’eau, hormis aux pôles où elle est gelée et où il fait trop froid). Tout le temps. Tout de suite, dès qu’on la laisse faire… Mais il ne faut pas se bercer de vaines illusions : une friche ne produit pas de légumes, tout au plus quelques baies. Dans un potager, on ne peut donc pas se contenter de laisser faire la nature. Ou alors, il nous faudrait nous contenter de ronger du bois. Ou encore, tels des chasseurs-cueilleurs à la fin de la dernière glaciation (il y a douze mille ans), parcourir tous les jours des centaines d’hectares à la recherche de baies ou de gibier. Finis les risques d’obésité ! Finis aussi les problèmes d’âge de départ à la retraite. On mourrait avant. Résolue, l’explosion démographique… Pas de doute, donc : il va falloir diriger ce petit bout de terre que nous appelons notre potager pour l’amener doucement vers la production de nos légumes favoris. L’organiser pour qu’il devienne productif… Éviter qu’il ne devienne une friche, c’est-à-dire empêcher les ronces, maîtriser les adventices, entretenir la fertilité du sol ou même l’améliorer, semer ou planter pour installer nos légumes favoris, maîtriser le parasitisme et parfois, selon la météo, arroser. Et puis, récolter, préparer et conserver… Mais, contrairement aux agités, le paresseux va le faire sans brutaliser le système. Sans tout détruire ou chambouler d’abord. Et puis sans trop se fatiguer non plus. Il a une ambition suprême : paresser !
J’ai souvent été compris de travers. Par des rêveurs parfois, qui osaient imaginer que la nature peut produire des légumes savoureux, en masse, toute seule, sans qu’on intervienne, ou qu’on peut se nourrir de mauvaises herbes. Beaucoup sont effectivement comestibles, mais de là à les trouver bonnes… Et de là à remplir le ventre de tous 365 jours par an… Surtout, j’ai été mal compris par tous ceux qui confondent paresse et fainéantise. La fainéantise peut se définir ainsi : ne pas faire ce que l’on sait qu’il faudrait faire absolument — au potager, dont nous parlons ici, pour produire beaucoup de légumes. On vient de le voir : ce n’est pas une option. Fainéantise rime avec bêtise. Il ne faut pas confondre avec paresse, qui rime avec sagesse. Vous l’entendez, la différence saute à l’oreille !
Dans mon esprit, la paresse, c’est réfléchir avant d’entreprendre une action. Pour bien évaluer tous ses impacts, positifs et négatifs. Souvent, et c’est heureux ainsi, on va constater que ce que l’on pensait utile est en réalité plutôt nuisible. Retourner la terre, par exemple. Ou composter. Parfois, c’est juste inutile. Arroser quand le sol, bien couvert, est encore suffisamment humide. Arroser juste parce que c’est marqué sur l’étiquette ou parce que le voisin le fait ? La paresse, alors, c’est avoir la sagesse de ne pas le faire. Tant pis si les voisins le font, eux. Et se moquent. Le jardinier s’en portera mieux. Moins agité égale moins fatigué. Le potager, et tout ce qui y vit, se porte mieux. Moins maltraité. Moins massacré. Et l’environnement autour du potager… Les voisins rigolent ? Dites-vous que c’est une joie que de faire rire les autres. L’époque est tellement triste. [...]
Je grandis en Alsace Bossue, dans les années 1950. Mon père est maraîcher durant la belle saison et bûcheron en hiver…
Junger, bisch ball fertig* ?
* Fiston, t’as bientôt fini ?
Filsch m’r noch a paar sechser haevele dass ich säye kaan*...
On a aussi une petite ferme…
* Tu me rempliras encore quelques pots de diamètre 6 pour que je puisse faire des semis…
Mach’se wenn‘de d‘milch getraa hasch* !
Yaaa... Ich hann awer noch Ufgawe*...…
* Ouaiiiis… Mais j’ai encore des devoirs…
* Tu les feras après avoir porté le lait !
Mon père devient jardinier professionnel après un apprentissage qui se termine au début de la guerre par un diplôme… allemand. En 1940, l’Alsace est annexée alors qu’il a 19 ans. Deux ans plus tard, il est incorporé de force dans les armées nazies. Au retour des camps russes, bien après la fin officielle de la guerre, il s’installe comme producteur de plants (de légumes, de fleurs), dont il fait commerce tout en produisant aussi les légumes pour la famille. À cette époque, en milieu rural profond, vendre des légumes n’est pas un métier : toutes les familles les produisent elles-mêmes, dans le potager accolé à leur maison. En revanche, savoir forcer les plants, pour cultiver des légumes le plus tôt possible, nécessite une technicité et des équipements que tous n’ont pas… C’est ça, le métier de mon père. Il s’agit des châssis et des couches chaudes… Écologiques, mais pas de tout repos !
Le forçage sous châssis
Je dis châssis… En réalité, il s’agit au début de coffres en planches sur lesquels s’ajustent des cadres en bois enchâssant des vitres en verre, inclinés pour que l’eau s’écoule. Au sens propre, les châssis, ce sont ces cadres vitrés. Des sortes de grandes fenêtres non fixées, mobiles, en quelque sorte, avec une poignée à chaque extrémité pour les porter. Les plastiques n’existent pas encore (on a parfois du mal à s’en souvenir !). Ces châssis avec leurs vitres sont lourds. Et on en prend grand soin car, quand on n’a guère de revenus, c’est un investissement important. Dès qu’on n’en a plus besoin, ils sont empilés à l’abri de la pluie pour éviter que le bois ne s’abîme. Pour cela, il faut être deux, et donc le fiston, moi en l’occurrence, est indispensable. Sinon, ma mère l’aurait fait… comme elle l’a fait avant que j’en sois capable. Mais elle a alors tellement d’autres choses à faire, à la maison et à la ferme. Plus tard, lorsque la situation de mon père s’améliore, il construit des coffres en béton pour qu’ils soient durables avec du ciment, du sable, du gravier et du fer à béton achetés… C’est beaucoup moins écologique mais, à l’époque, nul n’imagine ce que cela pourrait bien être, l’écologie… Dès qu’on en a les moyens, on améliore l’existant. On réduit d’abord le travail. Le bilan carbone en prend un coup. Mais, ça non plus, on n’a aucune idée de ce que c’est. Ces coffres fonctionnent à l’effet de serre. Le jour, les rayons solaires sont piégés : il y fait bien chaud. Les plants poussent. Souvent, par temps ensoleillé, il fait vite trop chaud. Les végétaux risquent de griller. Rien n’est parfait en ce bas monde. Il faut alors soulever les châssis un à un et glisser une cale, plus ou moins haute selon la météo, pour ventiler et rafraîchir. C’est une corvée quotidienne. Et parfois plus, si le temps change dans la journée. Le minimum syndical, c’est ouvrir le matin et refermer le soir. Un travail typique pour des enfants, car cela ne demande pas trop de force. Ça, vous l’aviez vu venir ?

Avec la petite ferme et le potager, il y a toujours trop à faire. Du lever du jour à la tombée de la nuit. Six jours sur sept.
Didier, tu viens jouer ?
Et même le dimanche, les jours fériés : arroser, aérer, nourrir les animaux, traire, porter le lait…
À cette époque, le travail des enfants ne choque personne. Je ne suis pas le seul ! Il n’y a guère de place pour les jeux.
Ich wèse nit ob m’r mischt genu hann*...
* Je ne sais pas si le fumier va suffire…
L’éducation, à l’époque, ce n’est pas un atelier créatif façon Montessori. Il faut manger, d’abord…
Ich mach’s nit so dick, no langt’s*.
* J’en mettrai un peu moins épais, ça suffira.
« Jeter tout ce foin dans la forêt, mais c’est dégueulasse ! »
[…] Je gagne en endurance, et en confiance. Un jour, nous poussons l’exercice un peu plus loin et faisons une boucle d’une bonne demi-douzaine de kilomètres par les hauteurs du village voisin de Rosenwiller. Là, au-dessus des vignes, une vaste prairie a été acquise par le Conservatoire des sites alsaciens, et transformée en espace Natura 2000 pour y préserver la faune et la flore spécifiques, dont une espèce protégée d’orchidées. Cette prairie sèche typique doit cependant être fauchée une fois par an pour rester une prairie et ne pas devenir friche, puis forêt. Il s’agit d’une fauche tardive, une fois que les espèces à protéger ont fleuri et formé leurs graines. À l’époque, c’était fait sous contrat, avec des machines, par un agriculteur. Aujourd’hui, une fauche manuelle, par chantiers participatifs, est privilégiée. Ce foin, fauché tard pour favoriser les fleurs, a perdu sa qualité de bon fourrage. Plein d’épines, il est devenu immangeable pour tout herbivore qui se respecte… autre qu’un chameau, et des chameaux, il n’y en pas beaucoup par ici. Pourtant, vous allez voir qu’assez vite je lui trouverai un autre usage… Un point d’écologie (la science) vous a peut-être échappé dans cette histoire : cette prairie, classée Natura 2000 pour protéger certaines espèces, doit être entretenue ! Vous avez bien lu. C’est un peu contre-intuitif : c’est tout sauf un site naturel, en équilibre biologique. Il faut savoir que chez nous, en Alsace, sous notre climat, un système en équilibre naturel, c’est une forêt, pas une prairie permanente (appelée parfois à tort prairie naturelle), qui, elle, est le résultat de défrichements humains. Jadis, au Moyen Âge sans doute, on a abattu une forêt ici. Ce mouvement a atteint son apogée vers 1850. Le lieu est longtemps resté une prairie parce que l’homme a continué de le faucher ou d’y faire pâturer ses troupeaux (des tondeuses sur pattes). Le milieu qu’on protège aujourd’hui est le fruit d’activités humaines. Depuis, grâce à l’agriculture intensive après-guerre, les forêts regagnent en surface. Ici, avec le déclin du pastoralisme dans les années 1950, le site a commencé à se reboiser… Cette prairie, tout comme mon potager d’ailleurs, est donc clairement un espace « anthropisé », c’est-à-dire installé, géré, dirigé et entretenu par les hommes… Croire que ces espaces sont naturels est une illusion totale, une sorte de cécité écobobologique. En revanche, notez qu’à cet emplacement précis l’action de l’homme a contribué à une augmentation de la biodiversité : d’un côté, dans les bosquets résiduels ou nouvellement colonisés par la nature, c’est un écosystème forestier, avec ses espèces typiques ; dans la prairie sèche, juste à côté, on a des animaux (oiseaux, insectes…) et des plantes spécifiques de ce milieu. Globalement, sur l’ensemble du site, cela fait plus de biodiversité. C’est une évidence. C’est ce que l’homme essaie aujourd’hui de maintenir en luttant. Aujourd’hui, au nom de la préservation de la nature, on maintient l’anthropisation, on empêche la forêt de reprendre ses droits ! Incroyable, non ?
... Ils disent c’est le seul endroit en Alsace où il y a un papillon spécifique qui se reproduit uniquement sur l’anémone...
T’as vu, y’a des bruants zizi ! Quel drôle de nom...
Jadis pâturés, ces espaces ont été reconquis par la forêt à la suite de la mécanisation et de la disparition des animaux de traction.
La disparition de certaines espèces est avant tout la conséquence de la disparition des espaces où ils vivent : si on veut maintenir la flore et la faune typiques de ces prairies sur collines calcaires sèches, il faut les faucher…
Ah les cons ! Ils ont balancé ça ici...
Je me demande bien pourquoi ils le jettent...
Ça ne vaut rien comme fourrage... y’a trop d’épines : chardons, ronces, pruneliers... qu’ils me les apportent, j’en ferai du compost !
Vous avez bien lu : compost. Mes réflexions sont encore assez basiques. Comme beaucoup, je pense alors que le compost est ce qu’il y a de mieux dans un potager. Dans ma tête, j’ai encore bien du chemin à faire…
Ça commence sur une ferme autarcique. Les efforts sont incontournables. De vraies corvées. C’est à ce prix que, très jeune, l’auteur accumule des connaissances pratiques en agriculture et en maraîchage. La terre lui collera aux baskets toute sa vie. Des études d’agronomie, certes vécues comme un enfer, se révèlent libératrices grâce aux montagnes de connaissances scientifiques qu’il découvre. Observer. Comprendre. Essayer… Ces connaissances sont sérieusement mises à l’épreuve dans différents pays africains. La confrontation aux dures réalités de terrain, avec pour objectif l’amélioration des agricultures vivrières locales, sans intrants, sans machines, lui apporte d’autres éléments de réflexion… Appréhender un système comme un tout… Un jour, un infarctus secoue tout ça très sérieusement, et c’est alors que les pièces du puzzle s’assemblent. Se met en place la vision qui l’amène à penser ses actes selon la logique du vivant. Ce qu’il appelle « être BIO-logique ». Son potager, connu comme le « Potager du Paresseux », en est une réalisation concrète, juste derrière la maison.

À paraître le 9 octobre 2025 16,8 x 24 CM - 192 PAGES
ISBN : 978-2-37922-398-3
,!7IC3H9-ccdjid!
PRIX TTC FRANCE : 22,90 €
éditeur du vivant
Service de presse : Valentine Herson-Macarel valentine@editions-ulmer.fr 06 42 85 81 86
DIDIER HELMSTETTER est né en 1953, en Alsace. Ses racines ? Une famille de petits paysans et un père qui était aussi bûcheron et producteur de plants maraîchers. Ingénieur agronome, Didier s’est occupé de développement agricole, en France et en Afrique, où il a dirigé des programmes de recherche-action avec la participation des paysans. Aujourd’hui, il consacre son temps au développement de son Potager du Paresseux. Il a réalisé de nombreuses vidéos et donne des conférences. Ses trois livres sont des best-sellers.
JULIEN REVENU commence comme dessinateur de presse pour Mediapart avant de se consacrer à la bande dessinée. En 2015, il reçoit le prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d’Alger pour l’album Ligne B, paru aux éditions Casterman. Parallèlement, il accompagne en facilitation graphique les institutions et les associations qui s’engagent en faveur de l’écologie ou de la lutte contre les discriminations. Son dernier roman graphique, Zone défensive, met en scène des supporters ultras et des zadistes en lutte contre une multinationale du béton.