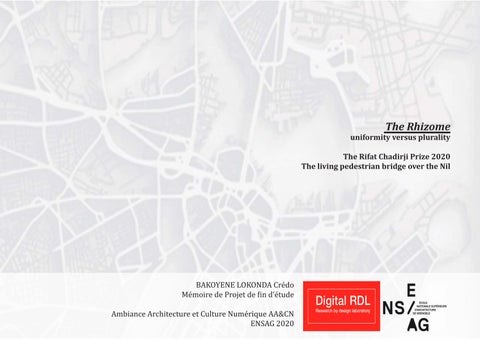7 minute read
LA CULTURE FACE À LA MONDIALISATION/MÉTROPOLISATION
Les normes et les valeurs d’une société sont en perpétuelle construction sous l’influence des échanges entre les groupes sociaux au sein d’une société mais aussi des échanges entre les cultures des différentes sociétés. D’ailleurs “le passé des civilisations n’est d’ailleurs que l’histoire d’emprunts continuels qu’elles se sont faits les unes aux autres, au cours des siècles, sans perdre pour autant leurs particularismes, ni leurs originalités”34 disait Fernand Braudel. Ainsi, le processus d’acculturation ne se fait pas que dans un seul sens. La culture occidentale utilise aujourd’hui nombreux éléments culturels d’autres sociétés. “L’usage du tabac, du café, de la pomme de terre, mais aussi des mangas japonais, des séries télévisées brésiliennes, du judo, des musiques africaines sont autant de traits culturels qui transforment en permanence la culture des pays dominants”.35 Au lieu d’une uniformisation des cultures mondiales, on constate des recompositions permanentes par réappropriation d’éléments venant des autres cultures. “L’acculturation est donc un phénomène d’hybridation culturelle appelé encore métissage culturel ou syncrétisme culturel”36 écrit l’historien.

Advertisement
Cependant, les cultures dominées ont une capacité d’agir sur la culture dominante. “Les sociétés peuvent accepter un certain nombre d’éléments culturels de la société occidentale mais elles les sélectionnent et elles les réinterprètent. Ainsi le cadre africain, formé à l’occidentale, adopte les comportements professionnels des cadres occidentaux dans l’entreprise mais revient au mode de vie africain lorsqu’il rentre à la maison. Enfin, un immigré accepte les coutumes du pays d’accueil mais continue à parler sa langue ou à manger les plats de son pays à la maison. Il y a donc un phénomène de multiculturalisme qui se crée donc”.37 Alors, quand est-il de la culture Cairote ?
34 Fernand Braudel, 1963, “Jadis, hier et aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel”, in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le monde actuel. Histoire et civilisations”, p.48
35 Fernand Braudel, 1987, Grammaire des civilisations, Flammarion, paris, p. 28
36 Ibid.
37 J.P.Langellier, 1999, Le Monde, cité dans l’article mondialisation et spécificités socio-culturelles.
Le caire est la capitale politique et économique de l’Egypte moderne. Elle est aussi la plus grande agglomération du continent africain derrière “Lagos”, avec environ 19 millions d’habitants, soit 43 % de la population urbaine du pays, sur 1300 km2 bâtis au sein d’une aire métropolitaine d’environ 4 300 km2.38 Elle est le berceau d’une longue histoire fascinante des grandes civilisations dont témoignent ses nombreux bâtiments et monuments, même si la grande majorité du bâti actuel est du XIX et du XXe siècle, y compris dans la ville historiques.39 Son noyau


39 Mercedes Volait, 2001, “Le Caire : portrait de ville”, Paris : cité de l’architecture et du patrimoine, p.12 historique reste tout de même, l’un des plus impressionnants conservatoires d’architecture, avec plus de 500 monuments classés, la plupart antérieurs à la conquête ottomane de l’Égypte en 1517, d’autres datant de l’ère préhistorique et couvrant toutes les typologies : architecture militaire, culturelle, commerciale, résidentielle40.
Cette ville a toujours été connue pour sa grande diversité culturelle que l’on peut déceler à travers son patrimoine architectural mais aussi à travers ce récit du comte de Chambord en 1861 : “Une foule de tous les pays et dans tous les costumes se profile dans les rues : fellahs, bédouins armés de toutes pièces, coptes à turbans bleus (nerval et flaubert les voyaient noirs), juifs, grecs, arnaoutes en rouge avec des armes en argent, peuple noire de toutes nuances, chameaux pesamment chargés, ânes au galop montés par des francs, des levantins ou des femmes enveloppés d’un manteau de soie noire qui les recouvre de la tête aux pieds, turcs à cheval cheminant d’un air grave, portefaix, dais…”41. Et Flaubert dans les récits de Mercedes écrit à propos du Caire : “...les premiers jours, le diable m’emporte, c’est un tohu-bohu de couleurs étourdissant, si bien que votre pauvre imagination, comme devant un feu d’artifice d’images, en est tout éblouie (...) vous frôlez tous les costumes de l’orient et vous côtoyez tous ses peuples”42.
- L’influence de la mondialisation dans la ville du Caire

“A vrai dire, dit Christian Cannuyer, c’est la grande majorité (près de 80%) de la population de l’Egypte actuelle, qui descend de l’ancienne race, chrétiens et musulmans confondus. Les ports ethniques extérieurs (grecs, juifs, levantins, arabes, nubiens) ont été limités.”43 La mondialisation a effacé bien des différences et l’orient, à la fin du XXe siècle, semble avoir rejoint l’occident. Le centre-ville du Caire du Caire ou le nouveau Caire est devenu le siècle de la culture occidentale. Habitations, bâtiments publics, espaces publics et populations sont maintenant à l’image de
40 Ibid.
41 Chambord, 1861, “Voyage en Orient”, éditions Tallandier, Paris, p. 38
42 Ravéreau André & Roche Manuelle, 1997, “Le Caire, esthétique et tradition” 1er éd. Arles : Les éditions Actes sud.
43 Christian Cannuyer, 1991, “Les coptes”, éditions Brepoles, Paris, 1991, p.48
Globalization In The City Of Cairo
Legend
Modern districts arabic districts
Desert and slums copte districts l’Europe. “La représentation même que l’on se faisait jadis de la ville a changé ; celle - ci était au nombre des grandes cités historiques dont on admirait les splendeurs patrimoniales ; elle est aujourd’hui perçue comme une métropole en voie de globalisation - un futur “Dubaï - sur - Nil”44. Certes, vu du ciel, de la tour du Caire ou de la Citadelle surplombant les quartiers historiques et les nécropoles qui enserrent leurs flancs oriental et méridional, Le Caire semble offrir un océan apparemment immuable de constructions uniformément terreuses, de moyenne hauteur (6 à 9 étages), parsemé çà et là de quelque grande emprise de mosquée, mall ou gratte - ciel.45 Est - ce là le nouveau visage du Caire ? celle de la modernité ?

- La résistance de la société Copte face à mondialisation/métropolisation
Au Caire et dans l’Égypte en générale, la tradition urbaine endogène est trop forte et occupe une place prépondérante dans le dynamisme de la ville pour que l’on puisse se résigner à la mettre de côté. “La mise à l’écart des modèles locaux y est autant le résultat de changement sociaux (le travail industriel et tertiaire, l’utilisation du numérique, etc.) que de mouvements culturels. Il ne faut pas confondre changements de structure sociale et changements culturels. La première peut se modifier rapidement (ex. : prolétarisation) alors que les changements culturels (ex : de la mentalité paysanne à l’urbanité) sont très lents”.46 Du point de vue matériel, l’identité architecturale du Caire (qui constitue son patrimoine culturelle) est souvent critère de sélection pour les nouveaux projets. Les architectes et les urbanistes par exemple, veille à garder la continuité de l’histoire au travers les nouvelles constructions. C’est ainsi que le projet de restructuration du quartier Maspero a connu une vague de protestation de la part du grand public. “Notre travail, explique un membre du Madd47 Mohamed AboTera, est d’aider les gens à créer une alternative qui leur permet d’exiger quelque chose ou de résister à quelque chose ; de savoir qu’une réalité différente de celle présentée par le gouvernement est possible”.48 On voit là une lutte entre la mondialisation communément appelé progrès ou développement et la question identitaire du Caire.
44 Lucia Tozzi, juin 2010, “Cairo 2050, Dubai sul Nilo = Dubai along the Nile”, In Abitare, n° 503, p.86 - 93
45 Mercedes Volait, 2001, “Le Caire : portrait de ville” Paris : cité de l’architecture et du patrimoine, p.3
46 Gossé Marc, op. cit., p. 90
47 Madd : un groupe indépendant d’architectes et de chercheurs urbains qui croient en la planification participative et son enfermement opposés à ce qu’ils décrivent comme la marchandisation néolibérale de l’espace public en Egypte.

48 Jack Shenker et Ruth Michaelson, le réaménagement de Norman Foster au caire amène les habitants à se demander : où nous situons - nous?, the guardian, (en ligne)

Dans cette lutte ainsi amorcée, naquit un double dynamique, complexe et contradictoire : “les cultures locales tendent à l’universel et la culture internationale (celle reflétée par des médias) s’implante et gagne du terrain. Loin de s’annuler, ces tendances jouent d’une dialectique subtile : jamais en effet les phénomènes régionalistes et la revendication d’identité culturelle n’ont été aussi fortes qu’en ces temps d’uniformisation”.49 Face à cela, devons-nous pas renoncer à la recherche, d’ailleurs illusoire, d’une norme unique, uniformisatrice, négation de la différence ?
- L’alternative à l’uniformisation
Dans l’introduction de leur livre “mille plateaux”, les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari expliquent cette uniformisation du monde en prenant l’image de l’arbre. “L’arbre ou la racine, disent-ils, inspirent une triste image de la pensée qui ne cesse d’imiter le multiple à partir d’une unité supérieure... Les systèmes arborescents sont des systèmes hiérarchiques qui comportent des centres de signifiance et de subjectivation. C’est que les modèles correspondants sont tels qu’un élément n’y reçoit ses informations que d’une unité supérieure, et une affectation subjective, de liaisons préétablies”50. On le voit bien dans le problème actuel de la mondialisation qui confère le pouvoir à une culture ou qui idéalise un modèle. A ce système d’arborescence, les philosophes Deleuze et Guattari opposent le concept du “rhizome”51. Le rhizome est un système acentré où la communication se fait d’un voisin à un voisin quelconque, où aucun modèle ou aucune culture n’est supérieur à l’autre. C’est une nouvelle image de la société destinée à combattre le pouvoir séculaire de l’arbre.
Une pensée qui résonne avec les mots du philosophe Paul Ricoeur disait, je cite, “la mondialisation représente une rupture de l’imaginaire. Elle crée de nouveaux repères. Elle fait apparaître un monde où les sphères économiques, politiques et culturelles ne coïncident
50 Gilles Deleuze & Félix Guattari, 1980, “Mille Plateaux”, 1er éd. Paris : Les éditions de Minuit. p.25
51 Un rhizome : Emprunté à la botanique, le terme est utilisé par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux pour désigner un espace organisationnel abstrait qui est absolument irréductible à toute unification.

Route Map
Heterogeneity of the urban fabric of the city


plus. Elle inaugure une ère d’identités multiples, composites, provisoires. Elle présente des défis à la fois individuels, socioculturels, économiques, politiques et stratégiques. Elle ne marque nullement l’avènement d’un nouveau millénarisme mais plutôt celui du monde dans sa multiplicité, multi - centré et animé par une dynamique inédite qui articule le local et le global”.52 Cela dit, à une idée radicale où règne convergence des modèles, le rhizome oppose la souplesse de la “multiplicité”53. A une idée de filiation, il oppose l’alliance. De ce fait, le rhizome impose d’autre manière d’être dans la société, horizontales et non hiérarchiques donnant ainsi lieu à une société alternative. Cette dernière se présente comme un espace de dissémination dans lequel les entités multiples ; milieux, espaces et villes, sont faites des formes et d’identités diverses entre lesquels se tisse une multitude des liens. Il est indéniable que cette nouvelle société ou plutôt cette nouvelle direction demande un bouleversement des pratiques et une émergence des nouvelles idées dans presque tous les domaines de l’activité humaine. Mais alors qu’en estil de l’architecture ?
52 Jean Tardif, 2008, “Mondialisation et culture : un nouvel écosystème symbolique”, in Questions de communication (en ligne), n°13
53 La multiplicité est une forme de prolifération immanente et autonome. La multiplicité ne peut être artificiellement unifiée et totalisée par une forme surplombante.