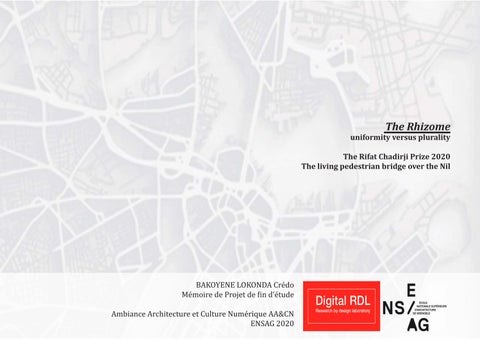14 minute read
LA MONDIALISATION/MÉTROPOLISATION FAVORISE L’OCCIDENTALISATION DU MONDE
Le concept de la mondialisation traduit une volonté généralisée d’abolir les frontières entre nations. La mondialisation est caractérisée par la multiplication, l’accélération et l’intensification des interactions économiques, sociales, culturelles et politiques, entre les acteurs des différentes parties du monde4. De ce fait, les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques des territoires nationaux. Elles se traduisent par l’ouverture des frontières et l’avènement du commerce international, par délocalisation et la libre-circulation des hommes et des biens. Cependant, ce phénomène de diffusion de biens culturels, qui désormais appartient à l’humanité entière, prend aujourd’hui une ampleur singulière et revient au centre des débats. En 1963, l’historien Fernand Braudel s’interrogeait déjà à ce sujet ; “une technique industrielle que l’Occident a créée, s’exporte à travers le monde entier qui l’accueille avec frénésie. Va-t-elle, en imposant partout un même visage : buildings de béton, de verre et d’acier, aérodromes, voies ferrées avec leurs gares et leurs haut-parleurs, villes énormes, qui, peu à peu, s’emparent de la majeure partie des hommes, va-telle unifier le monde ?”5 écrivit - il. Unifier ou uniformiser. Telle est la question.
Aujourd’hui nous découvrons, de manière brusque et choquante, la vérité relative et le dépassement nécessaire de ce concept qui sévit à travers cette civilisation post moderne. “...l’humanité est en train, pour son bien ou pour son mal, d’accéder à une phase nouvelle, celle en somme d’une civilisation capable de s’étendre à l’univers entier”6 écrit le philosophe Raymond Aron. Et aujourd’hui 57 ans après, nous vivons cette nouvelle phase ou du moins nous voyons de manière concrète son aboutissement à travers les grandes métropoles du monde.
Advertisement
En effet, la métropolisation n’est rien d’autres qu’une forme aboutie du concept de la mondialisation. Il faudrait quand même souligner que la métropolisation n’est pas seulement une extension ou agrandissement des villes. Comme le dit si bien Guillaume Faburel, “La


4 Jean Tardif, 2008 “Mondialisation et culture : un nouvel écosystème symbolique”, In Questions de communication (En ligne), n°13.
5 Fernand Braudel, 1963, “Jadis, hier et aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel”, in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le monde actuel. Histoire et civilisations, Paris : Belin. p.148
6 Fernand Braudel, 1993, “Grammaire des civilisation”, Editions flammarion, Paris, p.22 métropolisation représente toutefois un moment particulier de cette longue histoire des desseins économiques et politiques dans et par l’urbain. Elle est le stade néolibéral du capitalisme patriarcal, engagé depuis une quarantaine d’années, d’abord dans les pays tôt convertis à cette doctrine, puis dans toutes les grandes agglomérations mondialisées. Ce stade est celui de la polarisation urbaine des nouvelles filières économiques postindustrielles et d’une conversion rapide des pouvoirs urbains aux logiques de firme entrepreneuriale”7. Mais que penser de ce
Enjeux et modalités de la mondialisation / métropolisation
La mondialisation n’a pas seulement une connotation péjorative contrairement aux sous - entendus que peuvent laisser ces quelques lignes. Grâce à elle, la grandeur géographique ne prévaut plus, l’accès à l’information n’est plus un grand luxe, certaines maladies sont prévenues grâce un bon niveau sanitaire des villes, ou du moins dans certaines villes, les déplacements des humains sont devenus plus fréquents et plus facile, une ouverture à l’altérité, pour ne citer que ceux - là. Néanmoins, les sous-jacents de ce phénomène ne sont pas à mépriser. Face à cela, il convient de se demander jusqu’où peut aller ce phénomène. Mais dans un premier temps, constatons les faits.
Dans cette marche vers l’uniformisation ou l’occidentalisation du monde, je voudrais épingler, dans un premier temps, un aspect ou un mode opératoire très subtile. Subtile, efficace et dangereusement utile à l’uniformisation du monde qui est “le digital”. Ce dernier travail de manière singulière sur l’individu ; grâce à des images projetés, des films, des musiques, des vidéos, des informations, des pratiques, etc. Il transcende les filtres culturels en créant des consensus qui nourrissent à priori cette idée monde et fait converger les individus vers un idéal commun. Et de manière proactive, la politique et l’économie, l’architecture et l’urbanisme, pour ne citer que ceux-là, sont des facteurs qui ont largement favorisés la diffusion d’un modèle culturel occidental dont les valeurs culturelles, matérialistes, politiques et les normes semblent s’imposer au reste du monde.8

La technologie des médias au service de la mondialisation / métropolisation


La technologie des médias ou “Internet” joue un rôle essentiel dans ce phénomène de la mondialisation. “Depuis ses premières apparitions en 1950 aux Etats - Unis ; créé à des fins militaires, jusqu’à sa véritable utilisation à partir de 1980”9, Internet a ouvert la société à des nouvelles possibilités. Comme de nouvelles formes de communication ; les correspondances par mails et réseaux sociaux, les e-commerces, les activités en bourses, les monnaies virtuels, les échanges des biens, des transactions financières, et tant d’autres. De ce fait, on peut dire que l’avènement d’Internet a transformé et accéléré les processus de la mondialisation dans tous les domaines de l’activités humaines. Par la même occasion, Il a aussi permis de propager de manière exponentielle la culture moderne à travers le monde. Aujourd’hui, un peu partout dans le monde, la musique, les émissions et séries télévisés occidentales gagnent du terrain au détriment des cultures locales. Les grandes boîtes industrielles, tributaire de la culture occidentale, renforcent leurs supériorités via une diffusion massive d’information et des publicités. Et grâce à Internet, on assiste à un phénomène sans précédent qui est “les réseaux sociaux”. Le summum de la perfidie de ce phénomène. La question qu’il faut se poser, est de celle de savoir comment en sommes-nous arrivés là.
8 Ignacio Ramonet, mai 1993, mondialisation et ségrégation, in Le monde diplomatique, (en ligne)
9 Bassand, M, 1997, “Métropolisation et inégalités sociales. diversité et fractures, Paris : Anthropos-Economica” in Lausanne, Presses polytechniques romandes, (en ligne)
- Les médias et réseaux sociaux
Les médias sont aujourd’hui les principaux vecteurs de la mondialisation ou du moins de la mondialisation culturelle. C’est à travers eux que s’effectuent les rapports ou échanges qui affectent notre rapport au monde et aussi notre rapport à nous même. C’est le monde en couleur, le monde où l’herbe est toujours verte chez l’autre. On est tout le temps bombardé des images, des vidéos, des paroles et des pratiques, qui nous font savoir combien notre existence est misérable. Combien les autres vivent mieux et sont heureux. Que pour être heureux, il faut faire comme les autres, il faut devenir autre que soi, il faut émigrer, il faut copier ce que font les autres parce que c’est le seul moyen d’être heureux. C’est alors qu’on commence à haïr notre misérable vie et on commence à désirer devenir autres que nous même. Alors on copie sans se demander pourquoi, on laisse les autres nous influencer. Ou pire, on les laisse transformer nos vies, nos espaces, nos villes et par extension, notre culture. Cependant, il convient tout de même de se demander si la mondialisation peut - elle vraiment faire disparaître la diversité culturelle.
La politiques et l’économie au service de la mondialisation / métropolisation

La mondialisation des dernières décennies du XXe siècle se caractérise presque exclusivement par des dynamiques économiques (explosion des flux de capitaux et, au-delà, de toutes les interdépendances économiques) et l’aspect politique est presque mis de côté ou quasi inexistant dans certains discours de la mondialisation. “Or l’économique, la politique, le social, le culturel... ne sont en rien des mondes séparés. Tout ce qui est humain est à la fois économique, politique, social, culturel”10. Ainsi, il est souvent affirmé que les métropoles du monde sont les épicentres économiques et politique de la mondialisation. Certes le cœur de cette métropolisation est l’édification d’un espace propice aux échanges économiques. Mais
10 Morceau Philippe D, 2005, “mondialisation économique et mondialisation politique depuis 1945”, in Relations économiques (en ligne),n° 124, p. 41 à 50 l’organisation des échanges relève tout autant de l’économique que de la politique. C’est ainsi que la politique métropolitaine s’impose aujourd’hui comme l’armature territoriale de la mondialisation. Selon quelques critiques, la métropole est une “concentration du pouvoir économique et politique dans des régions métropolitaines constituées d’agglomérations urbaines et périurbaines qui se détachent de leurs espaces nationaux et qui établissent des liens de collaboration et de concurrence avec d’autres régions métropolitaines”.11 Cela dit, la métropole jouent un rôle majeur dans ce processus d’uniformisation du monde. Elle oblige ses habitants à adapter leurs modes de vie, à la nouvelle règle édictée par la mondialisation. Cette règle n’est rien d’autre que cette société capitaliste dans lequel prévaut une seule règle ; “la rentabilité”. Et pour être rentable, il faudrait concentrer une grande partie de la population au même endroit, parler le même langage, faire les choses de la même manière, détruire la diversité, avoir le même système politique et économique partout dans le monde.


- L’hégémonie de la politique et de l’économie occidentale
Un seul monde métropolisé et une seule politique. C’est ainsi que la mondialisation pousse les Etats à se préoccuper des mêmes problèmes et à les résoudre de la même manière. Selon le chercheur et sociologue Thierry Delpeuch, “certains y voient la domination d’un modèle idéologique, le “libéralisme”, d’autres, les contraintes imposées par les marchés financiers”12. Il existe aujourd’hui une plateforme de recherche sous l’appellation “PTS”13 les policy transfer studies qui mène des recherches sur le phénomène de la mondialisation dans les transferts internationationaux de conception des politiques publiques. Dans ces recherches, la dynamique d’expansion des transferts de politiques publiques se fait suivant trois facteurs principaux à savoir : l’émulation résultant de la concurrence accrue entre les nations du fait de la mondialisation économique et financière ; les mouvements d’harmonisation dans le cadre de processus
11 J.-M., Klein, J.-L. et D.-G. Tremblay, 1999, “Entre la métropolisation et le village global. Sainte-Foy, Qc” in Presses de l’Université du Québec; (en ligne)
12 Delpeuch thierry, 2009, “Comment la mondialisation rapproche les politiques”, in “l’économie politique”, n° 43, p.79 d’intégration régionale ou de développement de régimes internationaux à l’instar de l’union européenne; puis l’essor, depuis le milieu des années 1990, de programmes internationaux d’aide au développement ou à la transition démocratique menés par les institutions internationales comme le Fonds monétaires international (FMI) ou la Banque mondiale, centrés sur l’exportation de standards de “bonne gouvernance””14.
13 Les policy transfer studies est l’ensemble des travaux sur l’apprentissage des approches centrées sur la dimension exogène du changement et implicitement axées sur l’action rationnelle.
L’examen de ces travaux récents appartenant à ces différentes orientations de recherche révèle, selon Thierry, “un mouvement d’atténuation des modèles économiques, voire de disparition des divergences”15. Il souligne aussi que les PTS évitent d’attribuer une place prépondérante à un seul type de facteurs explicatifs (les institutions, la rationalité du décideur, l’hégémonie de la culture occidentale), et ne placent pas la focale sur une dimension particulière des processus de transfert (la décision, la diffusion, l’apprentissage). Par ailleurs, dit - il, “les policy transfer studies reconnaissent, de manière générale, l’influence des grands mouvements d’idées et des “ structures “ dans les phénomènes de diffusion et de convergence des modèles”16. Eu égard de ce qui précède et à l’image des différents événements historique dans le monde (la colonisation, la démocratie, la modernité, la métropolisation, etc.), on peut affirmer qu’il y a bien une influence, direct ou indirect, de la culture occidentale dans le reste du monde. Et aujourd’hui, grâce à la technologie, la diffusion de ces modèles économiques et culturelles occidentales ont pris une ampleur astronomique et se répand un rythme effréné.
- L’essor des assujettis
De ce point de vue, on peut affirmer que la mondialisation oblige d’une manière stratégique et subtile, les institutions à se redéfinir : la politique et l’économie ne peuvent plus désormais fonctionner comme des systèmes fermés ou prétendre à l’autarcie.17 C’est ainsi que les plus démunies c’est à dire les civilisations non occidentales, se retrouve aliéné à ce système

14 Delpeuch thierry, 2009, “Comment la mondialisation rapproche les politiques”, in “l’économie politique”, n° 43, p.79 constitué des firmes multinationales, le FMI, l’OMC, et autres. Condamnés à voir leur espace de souveraineté de plus en plus réduit par les règles commerciales du “libre” échange et les déréglementations touchant l’ensemble des services publics et des activités privées.18 Ils se retrouvent déposséder face aux nouvelles formes d’hégémonie économique, technologique et culturelle. C’est la nouvelle ligne de conduite et il faut s’en tenir. Il faut se hisser au même niveau que l’occident (avec l’aide de la FMI) c’est à dire métropoliser. Ce dernier est synonyme d’urbanisation, de modernisation et d’un grand mouvement migratoire de la population dans la ville, etc.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Mahfoud Calloul, 2002,” la culture face aux défis de la mondialisation”, In Mélanges de l’école française de rome, Italie et méditerranée, p 444.
L’Urbanisme et l’architecture au service de la mondialisation / métropolisation
- L’urbanisation diffuse


Les processus d’intensification des échanges à l’échelle du monde (mondialisation) ont donné leurs caractéristiques aux villes et aux formes actuelles de la métropolisation, mais ils marquent tout autant une nouvelle manière de faire la ville. Cette nouvelle manière s’accompagne des modèles internationaux reproductibles, normés et susceptible de générer une grande concentration de la population. On parle là d’une révolution urbaine où “tout authenticité est implacablement évacué”19 comme le dirait l’architecte Rem Koolhaas. L’urbanisation diffuse “est une ville libérée de l’emprise du centre, du carcan de l’identité. Elle rompt avec ce cycle destructeur de la dépendance : elle n’est rien d’autre qu’un reflet des besoins actuels et des moyens actuels. Elle est la ville sans histoire. Elle est assez grande pour tout le monde. Elle est commode. Elle n’a pas besoin d’entretien. Si elle devient trop petite, elle s’étend, simplement. Si elle devient vieille, elle s’autodétruit et se renouvelle, simplement. Elle est partout aussi attirante, ou sans attrait. Elle est superficielle comme un studio hollywoodien, elle peut produire une nouvelle identité du jour au lendemain”20.
18 Ibid. p. 442
19 Rem Koolhaas, 2001, “Junkspace”, Paris : Editions Payot & Rivages, p.51
20 Ibid.
Cette ville s’est étendue de manière effroyable partout dans le monde. “Qu’on en juge : en 1960, les plus grandes villes étaient nord-américaines et européennes. Vingt ans plus tard, sur les 20 agglomérations mondiales de plus de 10 millions d’habitants, 16 se situent dans les pays en développement. Tous les continents sont atteints par la révolution urbaine : la population urbaine est désormais largement majoritaire ; elle dépasse partout 70 % de la population totale, sauf en Afrique, mais celle-ci connaît parmi les taux de croissance les plus élevés et les plus rapides au monde. Durant le siècle prochain, un nouvel urbain sur deux sera africain.21
Aujourd’hui dans certaines villes du tiers mondes tel que ; Le Caire, Lima, Mexico, Pékin, Nairobi, Kinshasa, etc. certains quartiers sont construits selon le modèle occidental, porteur d’une sorte d’universalité. Ainsi, le phénomène de l’urbanisation de la planète devient un fait de civilisation. Cette forme diffuse est sans doute une des conséquences de ce que l’on appelle aujourd’hui la mondialisation. Mais ce modèle suffit - elle à décrire, sinon à nier, la diversité des structures urbaines locaux dans le monde ? ne sert-elle pas d’une certaine manière à imposer (au prix de l’expulsion des plus démunis) un modèle uniforme présenté comme un modèle générique ?22
- La gentrification et l’urbanisme informel
Dans les métropoles où cette ville diffuse est dominante, on assiste à la multiplication des « villes privées » (gated-communities), sortes de lotissements-ghettos de luxe sécuritaires, produits de la ségrégation urbaine23. Les classes populaires sont de plus en plus expulsées des centres villes, qui finissent par abriter très majoritairement des classes éduquées et aisées façonner par le modèle urbain. De manière générale, l’espace métropolitain n’est pas égalitaire. Les ségrégations et relégations y sont légion. Mais avec néanmoins une ampleur inégalée des exclusions et évictions sociales. “Au point d’interroger ce que la pensée dominante a longtemps défendu comme vertus intégratives de la grande ville : mélange et brassage, anonymisation et émancipation. A en juger par le sort réservé aux migrants, les métropoles ne sont pas les lieux idoines de l’urbanité ou encore de l’hospitalité”.24 Mais dans ces quartiers « riches » eux-mêmes, les zonings résidentiels, de bureaux et d’usines, où règne la spéculation, portent la marque d’un échec grave, d’ordre social et culturel. Les « privilégiés » qui les hantent sont des inconscientes victimes d’une aliénation économique et politique, qui s’exprime par la pauvreté culturelle et la solitude.25
22 Ibid.

“Nous savons que le développement de la mondialisation se décline en termes urbains, mais les villes peuvent aussi déboucher sur la barbarie et l’oppression ; elles peuvent devenir synonymes d’exclusion, de pauvreté, de solitude, de pollution et d’inhabitabilité. Dans les bidonvilles du Caire, de Tunis, de Casa, de Dakar, Abidjan, Nairobi, Lagos ou Kinshasa, urbanité mondialisée signifie aussi déchéance et misère, échec du développement et de la modernité. Dans ces pays du Tiers-monde, cette tendance est d’autant plus forte qu’elle donne naissance à la ville informelle : l’habitat irrégulier y constitue la ville majoritaire”.26 Cette urbanisation a souvent été présentée comme informelle. C’est ainsi que ce qu’on appelle les « périurbains » acquièrent de nouvelles centralités, à cause de leur poids démographique et de leur dynamisme27 et devient de ce fait, une nouvelle facette de la métropole dans laquelle le verbe “habiter” est réduit à son strict nécessaire ; “être à l’abri”.
- L’absence d’architecture
Peut-on poser la question d’un monde « habitable », produit du développement durable, sans questionner son architecture ? “Dans les textes sur la stratégie urbaine, les organisme monétaires tel que les banques, utilisent le concept d’habitabilité” mais sans jamais se préoccuper de l’objet matériel que constitue l’habitat : il s’agit de promouvoir des villes


24 Faburel Guillaume, 2019, “Une métropolisation heureuse est - elle possible”, in Marianne, (en ligne)
25 Gossé Marc, 2000, “la crise mondiale de l’urbanisme, quels modèles urbains?, in : les annales de la recherche urbaine, N°86, Développement et coopération, p. 85 habitables et non des manières d’habiter. Nulle part il n’est question d’architecture (en tant que dimension culturelle et sociale), de formes de l’habiter et de formes urbaines”.28 Pourtant l’architecture, en tant qu’expression de la culture et du bien-être de la population, devrait constituer un axe autour duquel s’organise le développement. Il faudrait par ailleurs souligner qu’on parle ici d’architecture en tant qu’art transcendantale d’une culture et d’une société.
Ainsi, la problématique des modèles urbains, en tant qu’enjeu culturel du développement, est donc au centre de la crise urbaine. “Celle-ci résulte, dans une certaine mesure, de la reproduction, le plus souvent inconsciente, de modèles occidentaux, où la part d’innovation ne réside que dans l’adaptation fonctionnelle d’un modèle passe-partout (accessions à la propriété de la maison) à la topographie et aux contextes politiques, socio-économiques locaux. Souvent pressé par la rapidité et l’ampleur du phénomène démographique naturel et migratoire, l’aménagement urbain contemporain ne consiste trop souvent qu’en l’application de recettes géométriques, de simulations statistiques, de règles hygiénistes et de normes techniques. La maîtrise urbaine se limite à une estimation de la croissance, au dimensionnement et au tracé de voiries et réseaux dont l’ensemble est baptisé de l’un de ces termes qu’affectionnent les techniciens comme “trame d’accueil” ou “lotissement””.29

Jusqu’où la mondialisation
Tout n’est pas et ne sera pas mondialisé, du moins pas encore. Bien que la mondialisation la mondialisation a tendance à homogénéiser les cultures mondiales. Bien que certaines particularités culturelles tendent à disparaître au profit de la mondialisation. Bien que certaines cultures s’imposent et d’autres disparaissent. La diversité culturelle reste tout de même bien présente. Les filtres culturels permettent à chaque individu ou chaque société de vivre différemment les choses et font barrière à certaines lois de la mondialisation. “Les négociations du Gatt qui se sont achevées en décembre 1993 ont donné lieu à un affrontement direct entre l’Union européenne et les États-Unis sur la question de “l’exception culturelle”, qui s’est soldée par l’exclusion pure et simple des productions audiovisuelles et culturelles des accords de libreéchange30. Pour justifier leur opposition à la clause de l’exception culturelle, ces derniers ont tenu un discours du genre : “laissez les gens regarder ce qu’ils veulent. Laissez les libre d’apprécier. Faisons confiance à leur bon sens. La seule sanction appliquée à un produit culturel doit être son échec ou son succès sur le marché”.31 C’est alors que certaines firmes internationales ne sont plus “globales”32 mais devienne “glocales” . Par exemple, “l’implantation de Mcdonald dans le monde entier n’a pas entamé les habitudes culinaires, les façons de manger, propres à chaque peuple. Mc Donald a dû en tenir compte, pour enrayer une certaine désaffection de sa clientèle, en introduisant des plats nationaux à ses menus”33.
Enfin, relativisons un peu. Tout le monde n’accède pas à la culture occidentale. La mondialisation culturelle ne touche pleinement qu’une minorité de la population mondiale. De nombreux pays à l’instar de l’Egypte et une grande partie des pays du tiers ne monde, trainent encore le pas et ne consomment pas ou très peu de produits mondiaux. Alors comment explique-t-on ce maintien des spécificités socio - culturelles ?
28 Ibid. p88
29 Ibid. p. 85
30 A.Mattelart, juillet 1997, “Vers la communication-monde”, In Sciences humaines, Hors série n° 17, (en ligne)
31 Ibid.
32 Glocale : compromis entre le concept de la marque globale et celui de la marque locale

33 Renaud Chartoire, Mondialisation et spécificités socioculturelles, (en ligne)