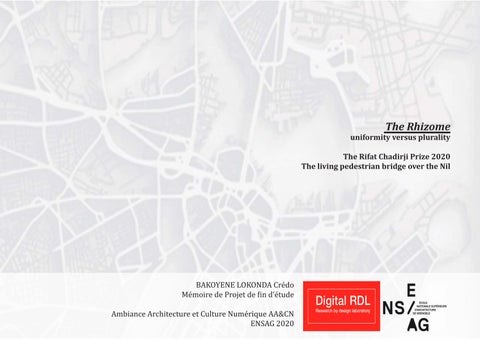2 minute read
PARTIE THEORIE
La mondialisation désigne une nouvelle phase dans l’intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. Caractérisée par une uniformisation des modèles et répandu par les biais des médias et des échanges internationaux, elle s’impose aujourd’hui comme idéal dans tous les pays du monde1. En 1993, dans l’article mondialisation et ségrégation, le journaliste Ignacio Ramonet en dressait déjà le portrait en ces termes “... De la Paz à Ouagadougou, de Kyoto à Saint Petersbourg, d’Oran à Amsterdam, mêmes films, mêmes informations, mêmes chansons, mêmes vêtements, mêmes urbanismes, mêmes architectures, même type d’appartements souvent meublés et décorés d’identique manière… Dans les quartiers aisés des grandes villes, l’agrément de la diversité cède le pas devant la foudroyante offensive de la standardisation, de l’homogénéisation, de l’uniformisation. La vitesse a fait exploser la plupart des activités et singulièrement celles liées aux transports et à la communication. Des pratiques propres à une culture s’impose comme modèles universels. Ces modèles sont aussi politiques, économiques et culturelle ; par exemple, l’architecture moderne, la démocratie parlementaire et l’économie de marché, admises désormais presque partout comme “rationnelles”, “naturelles”, et qui participent, de fait à l’occidentalisation du monde”2.
Aujourd’hui, aucun pays du monde n’échappent à ce phénomène qui s’accompagne de la métropolisation des grandes villes. La ville du Caire n’échappe pas à ce périple, qui de manière systématique, remodèle ses territoires, normalise la ville et transforme les modes de vies urbaines. L’essayiste Robin Rivaton dans son livre “la ville pour tous” souligne que, “La métropolisation conduit à une convergence des modes de consommation et des représentations collectives entre ces différents espaces, au-delà de leur attachement national”3. Face à cela, devons - nous craindre un éventuel phénomène d’acculturation de la ville du Caire dominé par la culture de la modernité?
Advertisement

1 Bertrand BLANCHETON, 2008, “mondialisation - histoire de la mondialisation”, in Encyclopædia Universalis (en ligne)
2 Ignacio Ramonet, mai 1993, “mondialisation et ségrégation”, in Le Monde diplomatique, (en ligne)
3 Robin Rivation, 2009, “la ville pour tous”, in L’observateur, (en ligne)
La ville du Caire et l’Egypte dans sa globalité, a toujours été reconnu par leur grande diversité culturelle. De l’Egypte des pyramides à l’Egypte moderne, en passant par les mamelouks et les ottomans, la multiplicité culturelle a toujours modelée la ville. Ainsi, la ville du Caire se présente comme un espace de dissémination dans lequel coexiste plusieurs entités culturelles interconnectées mais indépendantes les unes des autres. Cette multiplicité culturelle qui forme l’identité Cairote, saura t - elle faire face à cette culture de l’uniformisation et de la normalisation des modes des vies ; manière de s’habiller, de parler, d’habiter, de circuler, etc.? En d’autres termes, comment la culture cairote réagit face au phénomène de la mondialisation ?
Dans les lignes qui suivent, nous aborderons en premier les questions liées au phénomène de la mondialisation. Nous verrons les modalités et enjeux de la mondialisation ainsi que les différentes phases ou facteurs qui ont favorisés cette uniformisation du monde à travers la mondialisation, entre autres la technologie des médias, l’économie et la politique ainsi que l’urbanisme et l’architecture. En deuxième lieu nous évoquerons l’influence de la culture dans ce phénomène de la mondialisation et vice versa. Cette partie sera consacrée à l’image actuelle de la ville du caire c’est à dire à la dualité entre Le caire modernisé résultant de ce phénomène de la mondialisation et Le caire médiéval tributaire d’une longue période multiculturelle de la ville. Ce qui aboutira à un modèle alternatif à ce phénomène qui est potentiellement fait d’une multiplicité composée de singularités proactives. Enfin, la troisième partie sera consacrée aux nouveaux enjeux architecturaux liées à la mondialisation qui servira d’amorce à notre projet du pont habité sur le fleuve Nil.