
23 minute read
Vers une Francophonie sportive transculturelle
La plus grande richesse d’une discussion internationale ne tient pas dans la différence des mots utilisés par chacun, mais dans les différents angles d’attaque de la réflexion des participants raisonnant chacun selon la structure de sa syntaxe. Ce sont ces différentes façons de penser qui enrichissent la pensée universelle (G-R Jabalot, 2016, Francophonie et Sport : quelques pistes de réflexions, Gazette Coubertin n°46-47)
A moins de deux ans des Jeux de Paris 2024, la francophonie sportive se met en ordre de bataille à l’initiative de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en lien avec la tenue de trois événements multisports organisés dans des pays francophones au cours des quatre ans à venir : les Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2023, les Jeux de Paris 2024, puis les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026. De son côté, le CFPC, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du CIPC qui s’est tenue le 2 juillet 2022, souhaite, avec satisfaction, la bienvenue à l’Association des Comités Nationaux Pierre de Coubertin d’Afrique qui a vu le jour le 28 juin 2022 ! De la même façon, le CFPC apprécie les initiatives prises par le Centre Africain d’Etudes Olympiques qui démontre sa proactivité au sein de la 6ème édition du Magazine Afrik Olympia paru en août 2022 ! Gilles Lecocq C’est l’occasion pour le CFPC de donner la parole à Nelson Todt, et à Daniel de la Cueva et Cecilia Bollada afin de favoriser les contours de ce que peut devenir une francophonie sportive transculturelle.
Advertisement
Réinvention du sport et des Jeux Olympiques après la pandémie de Covid-19 : une opportunité pour se rapprocher de l’héritage de Pierre de Coubertin
par Nelson Todt Président du Comité Brésilien Pierre de Coubertin, Vice-Président du Comité International Pierre de Coubertin
Au milieu de l’année 2020, le Musée Virtuel du Sport au Brésil et le Comité Brésilien Pierre de Coubertin (CBPC) avec le soutien du Comité International Pierre de Coubertin, ont organisé une exposition internationale virtuelle, cherchant à fournir une base historique aux débats actuels sur la réinvention du sport et les Jeux Olympiques dans une ère post-pandémique, là où se télescopent plusieurs crises socioéconomiques et géopolitiques.
Le CBPC a identifié et invité des experts internationaux dans le domaine du Mouvement olympique et de l’éthique sportive afin que ceux-ci présentent leurs analyses tirées des expériences passées de Pierre de Coubertin, notamment lorsque celui-ci fut confronté à des crises et des conflits d’intérêts et dû s’adapter à des situations diplomatiques inédites. Il s’agissait ainsi d’identifier de quelles façons le Mouvement olympique fut amené à faire face à des défis majeurs dès sa naissance, en s’adaptant constamment à des situations psycho-sociales complexes.
A l’heure où aujourd’hui la planète est confrontée aux incertitudes provoquées par les conséquences d’une pandémie répétitive dont les effets ne sont pas encore tous connus, les perspectives proposées par Pierre de Coubertin en son temps semblent encore plus actuelles. Il est donc pertinent de revenir aux valeurs du passé pour organiser le présent en fonction du futur que l’on souhaite construire. Compte tenu de ces circonstances,
les objectifs proposés pour le développement de cet article ont été inspirés par les expositions qui furent mises en place par le CBPC et le Musée Virtuel du Sport au Brésil :
a) Établir des points de référence pour comprendre les enjeux complexes des prochains débats sur la nouvelle ère du sport, en raison des effets incrémentaux de la pandémie de COVID-19, qui touche désormais les cinq continents.
b) Récupérer des récits des écrits de Pierre de Coubertin qui ressemblent quelque peu aux thèmes actuels liés au sport et aux Jeux Olympiques.
c) Proposer des actions et des recommandations qui permettent en 2022 de faire œuvre de changement et de renouveau, en lien avec une approche transhistorique des visions de Pierre de Coubertin.
Nous avons ainsi choisi trois thèmes majeurs qui apparaissent comme des points de compréhension de ce que vivent aujourd’hui les organisations sportives face à des événements inédits :
- Associer des perspectives transhistoriques pour favoriser la compréhension des processus où l’internationalisme et le sport au service de la paix sont convoqués en situation de crise.
- Interroger les fondements des valeurs olympiques afin de les mettre au service d’un temps présent confronté à des nouvelles formes de situations critiques. - Interpeller le gigantisme des Jeux et le décalage qui s’est instillé au sein de ceux-ci, lorsque le toujoursplus de paraître oublie l’essentiel de ce qui fonde l’être d’un athlète.
Internationalisme et sport pour la paix : perspectives transhistoriques
Le Mouvement olympique est né à la fin du 19ème siècle, inspiré d’une part par la renaissance des Jeux Olympiques et d’autre part par l’idéologie de l’internationalisme qui a favorisé la coopération entre les pays, tout en maintenant le renforcement du patriotisme dans chaque nation. Pour Lamartine DaCosta (2020), Pierre de Coubertin était à l’époque un militant de l’internationalisme, en proposant de structurer le Comité International Olympique dans le style des Expositions Universelles et du Mouvement de la Croix-Rouge. Pierre de Coubertin a justifié ce pragmatisme opérationnel comme un moyen d’obtenir des garanties de coopération, d’autonomie et de paix. Le résultat attendu d’une entente cordiale et solidaire entre les Nations était associé à la compréhension des effets d’une « géographie olympique » sur le développement d’une internationalisation du sport. DaCosta (2020) considère que ce modèle organisationnel a connu des succès et des échecs, mais a réussi à survivre à la pandémie de 1918, à deux guerres mondiales, à des guerres continentales et à une guerre froide de quatre décennies qui a suivi la seconde guerre mondiale. Leonardo Mataruna (2020) souligne de son côté que Pierre de Coubertin prévoyait également d’unifier les pays séparés par la guerre. En lien avec le CIO, depuis la fin des années 1890, les Jeux Olympiques entretenaient des relations étroites avec le Bureau international de la Paix, dont la naissance date de 1891. Ainsi, plus de la moitié des 78 délégués honoraires inscrits au programme officiel du Congrès olympique tenu à la Sorbonne en 1894 étaient directement impliqués dans le mouvement pour la paix. Cinq de ces personnes (Frédéric Passy, Prix Nobel de la Paix en1901 ; Élie Ducommun, Prix Nobel de la Paix en 1902 ; Arthur Gundaccar von Suttner, Prix Nobel de la Paix en 1905 ; Fredrik Bajer, Prix Nobel de la Paix en 1908, Henri La Fontaine, Prix Nobel de la Paix en 1913) représentaient une seule organisation, le Bureau international de la Paix, et furent nommées parmi les 13 premiers lauréats du prix Nobel de la paix, dont la première édition eut lieu en 1901. Ils ont soutenu le baron Pierre de Coubertin parce qu’ils ont reconnu les dimensions de paix et de concorde présentes dans une vision olympique du sport mondialisé. Dans une autre perspective, en utilisant la trêve olympique des Jeux antiques et les aspects humanistes associés, Pierre de Coubertin a développé une vision de la paix mondiale qui incluait également le concept de paix sociale.
En 2022, les niveaux de résilience des personnes et des nations sont testés une fois de plus dans une période où les effets de la

mondialisation économique, diplomatique, financière, industrielle et technologique sont actuellement questionnés. Ce questionnement prend son sens lorsque la tentation est forte de s’isoler et de se protéger, tant au niveau des nations que des personnes. Pour ces raisons, DaCosta (2020) n’est pas surpris qu’au Forum économique mondial 2020 de Davos (le sommet économique mondial), Yuval Harari ait présenté le modèle des Jeux Olympiques comme une solution pour le retour de la coopération multilatérale entre les pays. Cette proposition a été présentée comme un moyen pour les nations de remettre en question la mondialisation actuelle dominée par les intérêts financiers et de recourir à des accords de coopération avec des avantages mutuels et égaux. Il y a donc toujours, en 2022, à apprendre et à comprendre des idées énoncées par Pierre de Coubertin, il y a plus de cent ans, même si le contexte historico-social est différent.
Cela signifie que l’héritage internationaliste du fondateur de l’Olympisme a toujours une valeur actuelle et qu’il est potentiellement utile face à la crise postpandémique qui devrait nécessiter des limitations dans l’exploitation commerciale des méga-événements olympiques. En d’autres termes, DaCosta (2020) affirme que l’internationalisme de Coubertin n’est pas seulement une solution au déclin de la mondialisation économique : c’est surtout un tremplin idéal pour réinventer le sport mondial dans une ère postpandémique.
Les valeurs olympiques au service d’un temps présent dominé par les incertitudes.
Pour Gustavo Pires (2020), les valeurs fondamentales du sport moderne résident dans la pensée de Pierre de Coubertin, où l’essence de l’Olympisme se révélait à l’aune de la maxime du moine Henri Didon – « Citius, Fortius, Altius » – comme catalyseur d’une eurythmie qui garantit l’équilibre dynamique du Mouvement olympique lui-même. De l’avis de Pires (2020), Pierre de Coubertin déclarait qu’« aucune éducation n’était digne de ce nom si, en tant que principe essentiel, elle n’avait pas l’intention de développer toute la force de l’individu » (Pierre de Coubertin, 1913). Cette idée devrait être le moteur central du développement du sport d’aujourd’hui, en fonction de la vision de l’avenir que nous voulons construire réellement ensemble !
Dans cette perspective, il est important de rappeler que le Mouvement olympique a pour mission de promouvoir l’Olympisme dans le monde entier afin de contribuer à la construction d’un monde pacifique et meilleur, en éduquant les jeunes à travers le sport pratiqué selon l’Olympisme et ses valeurs. Ainsi, Ian Culpan et Susannah Stevens (2020) nous rappelle que Pierre de Coubertin considérait que ressentir la joie associée à la pratique d’une activité motrice était d’une importance primordiale et une condition préalable pour devenir un athlète olympique. Cette vision de Pierre de Coubertin n’était pas uniquement une formule romancée. Elle était le fondement de ce qui permet à un corps en mouvement de ressentir la joie d’être vivant et d’éprouver le plaisir de ressentir l’épanouissement humain comme la résultante d’une ouverture vers soi et d’une ouverture vers les autres. Ainsi, l’activité sportive n’est pas une fin en soi, c’est un moyen éducatif qui permet à un être humain d’accepter d’être différent des autres tout en s’épanouissant de façon holistique.
Et pourtant, dans le monde d’aujourd’hui, tout notre modus operandi est souvent caractérisé par la construction de cloisons et de murs binaires. Par exemple, la guerre des sexes est une réalité quotidienne tandis que le sport pour le développement humain durable rentre en collision avec les logiques d’excellence prônées par le sport de haute performance. De la même façon une éthique sportive se trouve sans cesse bousculée par des pratiques culturelles corrompues tandis que les valeurs de l’Olympisme sont constamment page
22
interrogées par l’évolution du gigantisme des Jeux Olympiques. Paco Iglesias (2020) ajoute que le mot Gymnasia, associé au terme Gymnos qui signifie nudité, peut également être compris comme un espace-temps d’où sont exclues les mensonges et les hypocrisies. Culpan et Stevens (2020) n’hésitent pas à affirmer que le Mouvement olympique a tendance à développer et à créer des frontières qui excluent plutôt que de s’intéresser à la construction de ponts qui relient. Ainsi, à la lecture des 40 Recommandations de l’Agenda 2020, une perspective de reliance est à envisager alors que des tendances à l’exclusion sont à interroger. Les notions de joie et d’épanouissement vécues par les acteurs sportifs sont remarquables par leurs absences. Dès lors, comment pouvons-nous, à l’instar de Pierre de Coubertin remettre sur la scène olympique les expériences physiques vécues joyeusement par les athlètes selon une perspective à la fois hédonique et eudémonique ?
Face à cette question, Marcio Turini (2020) se demande comment les moments que nous vivons après cette pandémie peuvent nous aider à réfléchir de plus en plus à l’importance de l’éducation olympique en tant qu’outil éducatif de préservation et de diffusion des valeurs olympiques? Comprendre les différentes facettes d’une crise contemporaine transnationale est une occasion unique pour guider et soutenir les actions humaines positives axées sur la sensibilisation à l’environnement et la répudiation de la corruption et de la violence. Pour Daniel de la Cueva et Cecília Bollada (2020), nous sommes heureusement confrontés à une opportunité inédite, car les effets de la crise sanitaire ont permis une intensification de l’expression des émotions et des réflexions sur la condition humaine, tant du point de vue de ses forces que de ses fragilités. Les expériences de privation et de frustration sont des merveilleux moments pour favoriser l’émergence de nouvelles représentations sociales qui consolide la pratique sportive dans la vie quotidienne, produise un champ favorable à la multiplication des pratiquants et favorise un accès de plus en plus démocratique aux pratiques sportives.
Ainsi, comme nous le dit Paco Iglesias (2020), est-il temps de réaliser un vieux rêve de Pierre de Coubertin. Celui-ci nous a laissé en effet les clés pour accomplir une révolution éducative où l’épanouissement d’une personne se met au service de buts sociaux supérieurs. Iglesias (2020) nous invite à accompagner cette révolution éducative où la nondiscrimination, l’amélioration biopsychosociale de l’être humain et la recherche de la paix ne seraient plus de belles utopies !
Le gigantisme des Jeux Olympiques n’est plus l’avenir de l’Olympisme
Il y a une centaine d’années, la grippe espagnole a fait entre quinze et trente-cinq millions de morts, peu après la Première Guerre mondiale. Pour Christian Wacker, nous sommes dans une situation pandémique qui peut se rapprocher d’un contexte historico-social complexe, confronté à la fin de la première guerre mondiale à des enjeux politiques et économiques inédits. Les Jeux de Tokyo en 2020 furent reportés comme le furent pour d’autres raisons les Jeux de Tokyo en 1940. En 2022, le monde olympique doit réfléchir à un moyen de réorganiser et de réformer les Jeux. Peut-être que nous ne pouvons plus parcourir le monde pour nous rencontrer lors de ces événements sportifs. Peut-être devrions-nous réfléchir davantage à l’origine des Jeux Olympiques, qui ont eu lieu en 1896 à Athènes. Pierre de Coubertin voulait organiser ces Jeux dans le monde entier, mais à l’époque beaucoup de gens pensaient déjà organiser des jeux plus petits au même endroit afin de préserver une éthique originelle de l’Olympisme. Comme les Jeux Antiques, les Jeux Modernes ne sont pas voués à l’éternité !
Márcia Neto-Wacker et Christian Wacker (2020) dit que nous devrions saisir cette occasion pour repenser le Mouvement olympique dans son ensemble; rediscuter de la

2ème Semestre 2022 réalisation de méga-événements sportifs, repenser les lignes directrices fondamentales de l’Olympisme. Selon ces auteurs, il ne faut pas oublier que les compétitions des Jeux Olympiques durent deux semaines, mais en fait les Jeux Olympiques durent quatre ans, au cours desquels plusieurs actions ont lieu. Neto-Wacker et Wacker (2020) se pose la question : n’est-il pas temps de penser à des compétitions plus petites et de créer des stratégies virtuelles innovantes plus efficaces ? Au-delà de cette question, un autre regard nous est proposé : celui qui permet de se concentrer sur une vision panoramique des Jeux Olympiques, afin de considérer que le temps des Jeux Olympiques n’est qu’une infime partie de ce qui constitue l’essence de l’Olympisme.
Considérations finales
Après tout, en lien avec ce qui précède, Mataruna (2020) nous rappelle que tous les efforts à fournir ont pour objectif majeur de s’impliquer dans le plus grand défi de l’humanité : « sauver des vies humaines». Ainsi, la perception contemporaine de la paix est à associer au maintien de la santé, à la promotion d’un bien-être biopsycho-social et à l’optimisation de pratiques sportives adaptées aux besoins spécifiques de chaque personne. Les concepts de mouvement, de danse et de routine d’entraînement auront alors réellement une place centrale lorsque des valeurs telles que l’égalité, la justice et la solidarité seront authentiquement partagées ENSEMBLE.
Dans cette perspective où les situations de crises sociales s’inscrivent dans la pérennité, il est temps de redéfinir le sport pour promouvoir une nouvelle perception du sentiment collectif mondial de paix. L’utilité sociale de l’héritage de Pierre de Coubertin est à notre disposition pour dépasser des crises sociales, ensemble, avec nos forces et nos fragilités, au service d’une humanité sportive sans cesse à reconstruire !
Nelson Todt
Références Culpan, I., & Stevens, S. (2020). DaCosta, L. (2020). De La Cueva, D., & Bollada, C. (2020). Iglesias, P. (2020). Mataruna, L. (2020). Neto-Wacker, M., & Wacker, C. (2020). Pires, G. (2020). Turini, M. (2020).
In N. Todt, A. Miragaya, & L. DaCosta (Org.), Reinventing Sports and Olympic Games after Covid-19: return to Pierre de Coubertin (pp. 99-108). Rio de Janeiro, RJ: Editora Gama Filho. Le Français comme langue olympique est-il menacé ? Oui mais...
par Daniel de la Cueva & Cecilia Bollada
Charte olympique Article 23 de la Charte olympique: Langues (Version du 8 août 2021. Charte olympique (olympics.com)
1 - Les langues officielles du CIO sont le français et l’anglais.
2 - À toutes les Sessions, une interprétation simultanée doit être fournie en français et en anglais. L’interprétation dans d’autres langues peut être fournie lors d’une Session.
3 - En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais de la Charte olympique et de tout autre document du CIO, le texte français fera foi sauf disposition expresse écrite contraire.
L’article 23 de la Charte olympique exprime la pensée et l’héritage de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. La langue française fut historiquement la première langue officielle et historique du Comité International Olympique (CIO), jouissant ainsi d’une position préférentielle dans les façons de communiquer des acteurs sportifs. Le Mouvement olympique reste attaché à la langue de Molière, par respect pour l’héritage transmis par le fondateur de l’Olympisme, le Baron Pierre de Coubertin. L’olympisme et la langue française sont
indissociables. Et pourtant depuis la fin du 19ème siècle, ce respect s’est progressivement érodé entre des réalités culturelles antagonistes qui ont compris que la diffusion d’une langue est une arme essentielle pour assurer l’emprise hégémonique de logiques économiques et politiques. En ce sens, les politiques linguistiques menées par les autorités françaises depuis la fin du XXème siècle reflètent un travail systématique de promotion et de développement de programmes visant à repositionner la langue française dans le contexte mondial.
Tout au long de l’histoire, la distribution des langues à l’échelle planétaire a induit la répartition d’un pouvoir économique et politique dans le monde (Claude Hagège, 2000). Face à une érosion de la désirabilité sociale de la langue française, les autorités françaises cherchent à trouver les moyens pour permettre à la langue française de conserver une position privilégiée au sein du Comité International Olympique. Ainsi, le gouvernement Français a envoyé un délégué à chaque olympiade depuis les Jeux d’Atlanta en 1996, chargé d’évaluer la place de la langue française lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cependant, les athlètes, les dirigeants et les commentateurs ont continué à privilégier la terminologie anglaise. L’influence de la langue française a diminué ainsi au cours des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques.
Ainsi, malgré cette tentative de promouvoir la langue française, celle-ci est-elle condamnée à disparaître aux Jeux ? A priori, oui. En 2008 à Pékin, il a fallu insister auprès des « partenaires olympiques » pour se faire entendre à tous points de vue. En 2012, à Londres, la presse anglaise s’est offusquée que les annonces concernant les compétitions soient d’abord faites en français avant l’anglais. A Rio, en 2016, le problème semblait définitivement réglé : on ne parle plus et on ne lit plus le français (Bonamy, 2016). La langue française était devenue introuvable et Tokyo 2020 n’a pas fait exception. L’influence prépondérante des sponsors et des leaders d’opinion anglophones dans le sport international et aux Jeux Olympiques et Paralympiques semble inéluctable. Alors que Michael Attali en 2004, nous rappelle que le sport a été l’un des premiers domaines à se mondialiser, ce phénomène a facilité une forme de suprématie de la langue anglaise comme langue olympique dominante. La langue de Marcel Proust et d’Alexandre Dumas a été reléguée au second plan, alors que l’utilisation de l’anglais a grimpé en flèche au cours des dernières décennies.
Les organisations internationales francophones sont confrontées à des mutations où il devient nécessaire pour elles de reconnaître qu’elles appartiennent à des bassins linguistiques, où se confrontent pour s’enrichir, différentes formes de latinités. Si les espaces méditerranéens sont le creuset de la langue française, celui-ci ne concerne qu’un aspect des langues latines. Ces idiomes sont en effet présents sur différents continents et méritent d’être reconnues par les défenseurs d’une langue française vivante. Ainsi, l’Amérique latine, audelà du bassin méditerranéen, est un territoire où la langue française ne peut que s’enrichir au contact d’autres langues qui permettent de penser et de voir le monde de façons un peu différentes. En cela, l’héritage de Pierre de Coubertin, à travers sa langue d’origine, mérite d’être interprété aux prismes d’autres langues que la langue française.
Alors, au-delà du cas particulier de la langue française, il est très important de maintenir et de favoriser le multilinguisme au sein du Mouvement olympique. Sinon, nous passerions à une seule pensée, incarnée par une seule langue. Le multilinguisme doit être défendu sinon il sera difficile de faire cohabiter un mélange de points de vue et de cultures dans l’univers olympique. Paradoxalement, la survie de la langue française dans l’univers olympique suppose la défense d’un multilinguisme, qui va au-delà d’une logique binaire
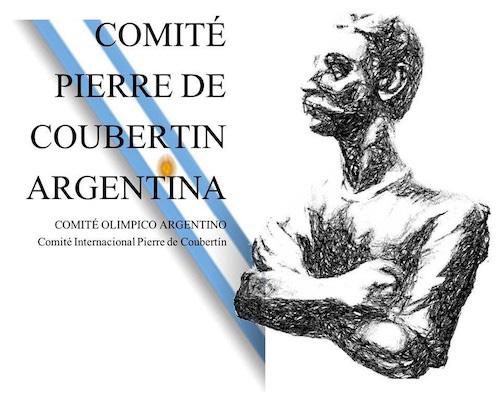
qui oppose la langue française et la langue anglaise ! C’est à cette condition que l’universalité de l’olympisme peut s’incarner, dans la construction de réalités interculturelles qui valorisent les différences linguistiques, au lieu de les combattre.
Tant que le Mouvement olympique, avec le CIO en premier lieu, respectera l’héritage de Pierre de Coubertin, la langue française ne disparaîtra pas. Il est nécessaire cependant, que les défenseurs de la langue française acceptent de prendre en compte l’évolution du mouvement sportif international et les nouveaux enjeux qui interrogent les notions d’universalité et de mondialisation. Paris 2024 est une occasion unique, même historique, de remettre la langue française à une place de choix au sein du mouvement olympique. C’est en ce sens que les valeurs des mots français dans l’œuvre de Pierre de Coubertin nécessitent d’être resituées dans d’autres contextes linguistiques, historiques et géographiques que ceux où ils ont vu le jour pour la première fois. En 2022, il est fondamental d’entendre et d’écouter l’interprétation que nous pouvons en faire, du point de vue latino-américain, afin d’établir des relations incrémentales entre des cultures hispanophones et des cultures francophones qui se rencontrent au sein et autour des enceintes sportives.
D’un point de vue sud-américain, nous pouvons interpréter d’une certaine manière, les pensées philosophiques qui ont encouragé Pierre de Coubertin à partager un projet comme celui de l’Olympisme avec d’autres personnes ne parlant pas la même langue que lui.
C’est ainsi que dans le contexte argentin, nous nous sommes appropriés les principes de l’Olympisme, depuis sa genèse et jusqu’à aujourd’hui. C’est dans ce contexte que nous proposons plusieurs mots pour caractériser ce qui peut être l’essence de l’œuvre concrète de Pierre de Coubertin. Ces mots sont corrélés à ce que nous pouvons percevoir de l’idéal olympique et de ces dimensions éducatives. Cette perception témoigne de la riche diversité déployée par Pierre de Coubertin afin de permettre à la jeunesse de ressentir l’eurythmie associé à la pratique d’activités physiques.
Cette contribution est ainsi le résultat d’une compréhension du travail de Pierre de Coubertin, tel qu’il est compris en Argentine. Cette compréhension est une invitation à un voyage de réflexion et d’analyse de l’héritage de Pierre de Coubertin qui est proposé aux lecteurs francophones :
- Les efforts de Pierre de Coubertin sont orientés vers les Jeux Olympiques, l’éducation et la paix, guidés par son engagement, son renoncement et surtout sa foi (fe). Sa vie durant, Pierre de Coubertin fut animée d’une foi en la capacité du sport à influer sur les relations entre les peuples et à entretenir la fraternité et la solidarité, par le biais de contacts et d’interactions entre les athlètes et les dirigeants sportifs.
- L’Olympisme propose, en utilisant le mot altérité (alteridad ; otredad) la reconnaissance commémorative de ce qui rend les personnes si différentes les unes par rapport à l’autre. La reconnaissance des différences est une invitation à cultiver celles-ci sur le chemin partagé de l’excellence.
- Plus que l’organisation d’un immense événement sportif, sa proposition de paix, d’éducation, de coexistence multiculturelle, est l’expression d’un humanisme (humanismo) moderne, qui se manifeste dans l’Olympisme, qui est né de la rencontre de Pierre de Coubertin avec d’autres cultures que la sienne.
- L’interculturalité (interculturalidad) est présente et comprise comme l’incarnation du quatrième mot du slogan olympique, car la vie sportive ne se révèle que dans des phénomènes humains et sociaux qui sont animés par des logiques de complexité, d’interdépendance et de complexité.
- Pierre de Coubertin déjà en son temps nous rappelait que le sport favorise la conquête de la paix (paz). Reconnaissons avec lui que cet objectif, l’humanité sportive ne l’a pas encore atteint.
- Pierre de Coubertin propose de surmonter les interdictions, boycotts et suspensions qui peuvent favoriser la disparition
partielle ou totale des Jeux Olympiques. Les crises sanitaires, les crises économiques, les crises politiques, renforcent les valeurs (valores) qui permettent à l’Olympisme de s’adapter à des situations extrêmes en affirmant une raison d’être : l’éducation et la transmission de ces valeurs.
- Alors que l’histoire relie les cultures anciennes du mouvement olympique avec celle du monde moderne, l’Olympisme est une vision constamment renouvelée qui unit la jeunesse et la tradition. C’est ainsi que l’héritage (legado) est un processus qui conjugue de façon harmonieuse ce qui appartient au temps présent et aux temps passés.
- L’Olympisme s’inscrit dans l’histoire du sport comme la convergence d’un processus de leadership (liderazgo) que Pierre de Coubertin a su mettre au service de l’Olympisme en acceptant de n’être jamais seul lorsqu’il s’agissait de mettre en actes des intentions.
Finalement, ce n’est qu’ensemble (juntos) que nous pouvons penser le monde dont Pierre de Coubertin rêvait. Cette pensée consiste à découvrir des champs du possible plutôt que de parvenir à des conclusions définitives. Dans cette ouverture, nous essayons d’éclairer (iluminar) ce qui n’a pas encore été dit, ce qui n’a pas été assez dit, ou ce qui a été dit d’une seule manière et qui exige des langues ou des itinéraires alternatifs. Tout ce qui se passe entre les acteurs du monde sportif concerne l’entièreté du Monde. Face à l’immensité de cette entièreté, les langues comme la rencontre des autres nous unissent (Lévinas, 2004). C’est par le contact avec les autres que se reconnaissent les différences, les diversités et les inégalités.
Éduquer à la différence (Educar para la diferencia) et se reconnaître dans la diversité sont des défis qui permettent au dernier mot de la devise olympique de devenir le ciment d’un héritage qui se conjugue au temps présent. Il appartient aux défenseurs de la langue française de faire preuve d’intelligences afin de ne pas refuser ces défis et d’accepter de se concevoir, comme l’a plusieurs fois montrés Pierre de Coubertin, des chevaucheur de frontières.
C’est l’une des conditions qui permettra à la langue française d’affirmer son utilité sociale au sein de l’Olympisme, non seulement dans le contexte de Paris 2024, mais aussi dans ceux de Milano-Cortina 2026 et de Los Angeles 2028.
Daniel de la Cueva & Cecilia Bollada Références bibliographiques Attali, M. (2004). Le sport et ses valeurs. Paris : La Dispute. Bonamy, E. (2016). JO 2016 : le français sifflé hors-jeu, Gazette Coubertin, 46-47.
Coubertin, P. (1997). Mémoires Olympiques. Lausanne. Comité International Olympique. Zimmermann Asociados (España) Durry J., (2018). El verdadero Pierre de Coubertin. Buenos Aires. Editorial Medrano. (Argentina) Hagège, C. (2000). Halte à la mort des langues. Paris : Odile Jacob. Lévinas, E. (2004). El tiempo y el otro. Barcelona: Paidós.

