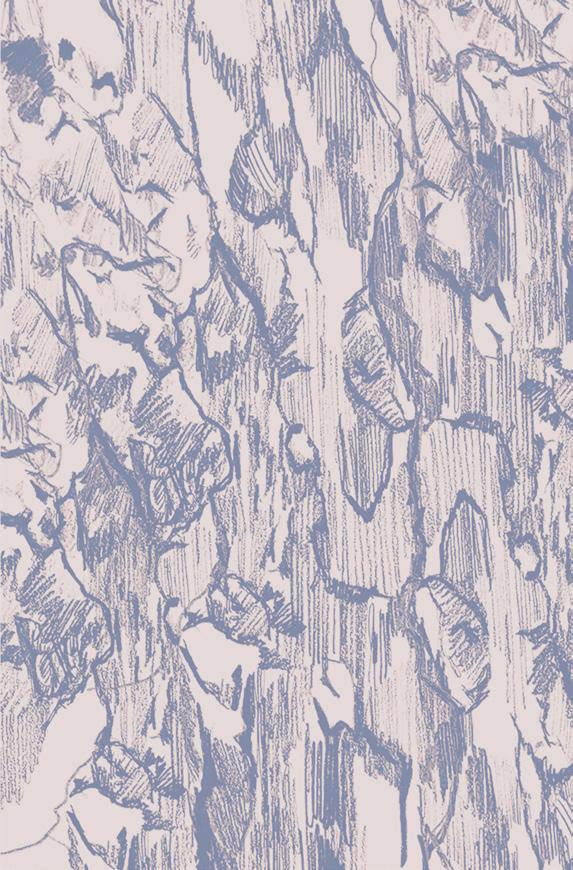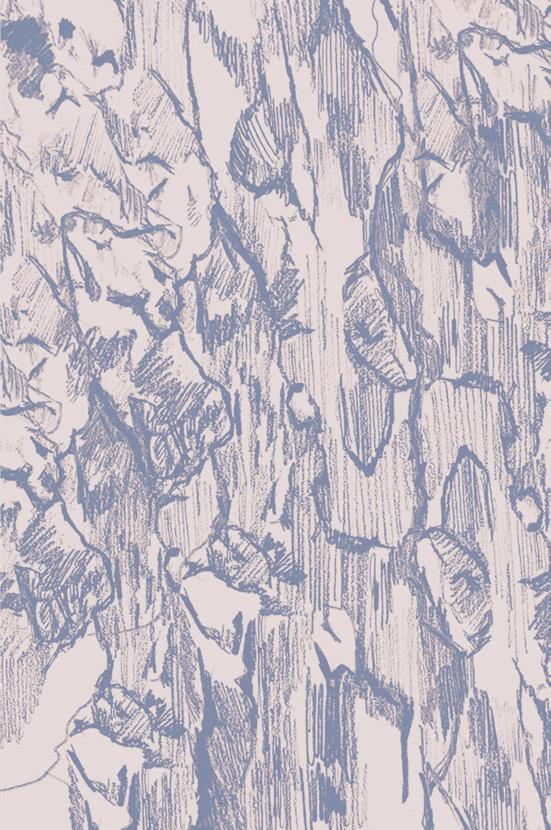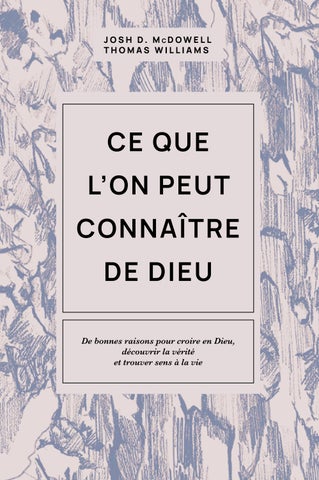UNE CHOSE ÉTRANGE S’EST
PRODUITE LORSQUE NOUS NOUS
SOMMES DÉBARRASSÉS DE DIEU
Pouvons-nous nous épanouir dans le monde désenchanté du sécularisme postmoderne ?
C’est le premier jour de Mélissa au bureau après avoir passé une semaine dans une chambre d’hôpital avec son mari gravement blessé. La nuit de l’accident, il était tombé dans le coma et les médecins n’avaient aucun espoir qu’il survive jusqu’au matin. Cependant, après quatre jours sous assistance respiratoire, il s’est soudainement réveillé. Ses signes vitaux se sont stabilisés et les médecins, stupéfaits, ont annoncé qu’il allait se rétablir complètement.
Alors que Mélissa expliquait cette épreuve éprouvante à la pausecafé du matin, un ami lui a demandé ce que les médecins avaient fait pour provoquer le revirement spectaculaire de son mari.
— Ce n’étaient pas les médecins, a-t-elle répondu. C’était la prière. Toute notre église a prié pour Robert. C’est un miracle qui a guéri mon mari.
Les collègues de Mélissa semblent soudain complètement absorbés par le contenu de leurs tasses de café. L’un d’eux finit par répondre.
— Nous sommes tous heureux que ton mari se rétablisse, Mélissa. Et tu as le droit de croire ce que tu veux. Mais il y a sûrement une explication plus rationnelle.
— Merci, Jim, a répondu Mélissa. J’apprécie ta gentillesse. Mais n’est-ce pas plus logique de croire que Dieu répond à nos prières ?
— Eh bien, c’est juste que, de nos jours, un Dieu qui fait des tours de magie à la demande paraît à peu près aussi crédible qu’un génie dans une lampe.
— D’accord, Jim, dit son supérieur. Ce n’est probablement pas le bon endroit ni le bon moment pour ce genre de discussion.
La conversation cordiale ne reprit jamais et, peu après, chacun trouva une excuse pour retourner au travail.
Pourquoi le fait de parler de Dieu semble-t-il gênant, intrusif, voire offensant dans les conversations de tous les jours ? Cette question a été posée récemment sur un site web chrétien. Une femme a répondu : « Il est assez difficile de parler de ce que l’on ressent à propos de Dieu et de Jésus parce que beaucoup de gens ignorent aujourd’hui ce que signifie être une personne croyante ». Elle a ajouté que ses amis faisaient souvent des commentaires du genre « Arrêtez de parler de bêtises qui ne sont pas arrivées1 ». Une autre personne a écrit : « C’est étrange, n’est-ce pas ? Vous pouvez parler du temps qu’il fait ou du travail, mais si vous dites « Dieu », tout le monde vous fuit2 ! »
La raison sous-jacente de la réticence actuelle à parler de Dieu n’est pas un mystère. Une croyance solide dans le christianisme est tellement étrangère à la culture actuelle que le simple fait de l’évoquer dans une conversation revient à commander un hamburger lors d’un déjeuner Weight Watchers. Les réactions les plus courantes face à la croyance religieuse sont les suivantes : « Comment peut-on être arriéré au point de croire à un tel conte de fées ? »
« Comment peut-on placer une foi aveugle au-dessus de la raison et des preuves scientifiques ? » « À notre époque, aucune personne sensée ne croit à la création plutôt qu’à l’évolution. »
Les forces dominantes de la culture occidentale n’approuvent plus la croyance au surnaturel. Le concept d’un royaume transcendant existant au-dessus du monde naturel est perçu comme un écho creux du passé immature de l’humanité, lorsque la superstition permettait aux dieux de régner et aux anges d’errer. Les voix dominantes de la culture moderne ont largement discrédité l’idée d’un Dieu surnaturel, la considérant comme une fable enfantine. Richard Dawkins a exprimé l’antipathie moderne à l’égard de la religion en des termes encore plus forts : « [La foi] est capable de conduire les gens à une folie si dangereuse qu’elle me semble pouvoir être considérée comme une sorte de maladie mentale3. » La laïcité sature aujourd’hui l’atmosphère culturelle, ne laissant que peu d’espace à la religion pour respirer et vivre.
Le passé enchanté de l’humanité
Il fut un temps où ces positions étaient inversées. Avant l’avènement de la modernité, Dieu ou les dieux ont imprégné l’histoire de l’humanité. Comme le dit le philosophe canadien Charles Taylor, « les gens vivaient dans un monde enchanté, un monde chargé de présences, ouvert et vulnérable, et non clos et autosuffisant ». Il ajoute que dans un tel monde, « l’athéisme est presque inconcevable4 ».
Taylor explique que dans le monde antique, la religion était si omniprésente que l’incrédulité était presque impensable. Dès le début, les Hébreux de l’Antiquité ont cru avec ténacité en une divinité unique et omnipotente. Dans les siècles préchrétiens, les dieux abondaient et la croyance en leur existence était le mode de fonctionnement par défaut de presque toutes les sociétés connues. Les Grecs et les Romains avaient un dieu pour chaque action et attribut humain connu : Mars, le dieu de la guerre ; Vénus, le dieu
de l’amour ; Pallas Athéna, la déesse de la sagesse ; Apollon, le dieu de la poésie. Les Grecs athéniens du premier siècle craignaient tellement d’offenser les divinités par inadvertance qu’ils ont érigé un monument « au dieu inconnu » pour s’assurer qu’ils les honoraient toutes. Puis le christianisme est arrivé avec son concept de Dieu unique, balayant une grande partie du monde antique et finissant par dominer l’Occident. En conséquence, à la fin de l’époque médiévale, la croyance en une divinité suprême était si étroitement ancrée dans le tissu de la réalité qu’il était quasi impossible de ne pas y croire. La religion chrétienne était l’atmosphère dans laquelle les gens vivaient, respiraient et existaient.
Presque tout le monde admettait que le monde naturel n’était pas la somme de la réalité. La nature est recouverte d’une dimension supérieure, surnaturelle, dont elle tire son sens. La croyance la plus répandue était que la nature était créée, entretenue et guidée par un être surnaturel omnipotent. Des intelligences vivantes et invisibles assistaient cet être, franchissant à volonté la frontière entre les domaines naturel et surnaturel et influençant les affaires des humains pour le meilleur ou pour le pire. Comme l’a dit Taylor, en utilisant un terme engageant que nous emprunterons tout au long de ce chapitre, le monde naturel était « enchanté ».
Tout au long de l’histoire de l’humanité, la croyance en l’enchantement de la nature par des présences surnaturelles, d’une forme ou d’une autre, était universelle, tenue pour acquise, considérée comme la structure évidente de la réalité. Pour le chrétien comme pour le païen, il était difficile d’imaginer une alternative viable à la foi en Dieu ou aux dieux.
L’émergence du sécularisme
Vous savez sans doute que ce n’est pas le monde dans lequel nous, Occidentaux, vivons aujourd’hui. La croyance en Dieu n’est plus la position par défaut. La forêt enchantée a été abattue par la hache du sécularisme. Le christianisme, qui a longtemps été le
principal défenseur de Dieu en Occident, bat en retraite, menant un combat d’arrière-garde et défensif contre une culture dominée par des institutions qui ne trouvent plus Dieu crédible ou pertinent. Comment le christianisme a-t-il perdu son emprise sur l’Occident ? On pourrait croire que le changement s’est produit rapidement, au cours des dernières décennies. En réalité, il s’agit d’un changement qui s’est produit il y a longtemps et qui a été influencé par de nombreux facteurs et événements complexes. Il serait impossible de couvrir ici toutes les influences de manière exhaustive, et nous reconnaissons que d’autres pourraient les interpréter un peu différemment de nous. Toutefois, pour jeter les bases de notre discussion, il sera utile d’examiner brièvement les facteurs qui nous semblent les plus significatifs.
L’enchantement, cette perception d’un monde imprégné de transcendance surnaturelle, fut particulièrement affaibli par l’essor des philosophes des Lumières au xviiie siècle. René Descartes, John Locke, Emmanuel Kant et d’autres promurent la raison comme principal outil pour déterminer la vérité. Ce glissement relégua peu à peu la foi au rang de simple croyance infondée. Puis, au milieu du xixe siècle, les théories de l’évolution de Charles Darwin rendirent Dieu superflu, même en tant que Créateur, permettant ainsi aux êtres humains de concevoir un monde totalement affranchi de tout besoin du surnaturel. Comme le dit Richard Dawkins : « Darwin a rendu possible le fait d’être un athée intellectuellement accompli5. »
Aux xixe et xxe siècles, la science et l’industrie ont continué à dissiper l’enchantement du monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont produit un volume sans précédent d’armes, d’avions et de navires, et ont développé l’énergie atomique en une force décisive qui mit fin au conflit. Portée par cette puissance nouvelle, l’industrie du pays en plein essor s’est immédiatement tournée vers la production de richesses et d’opportunités économiques pour ses citoyens. En quelques décennies, presque chaque garage avait sa voiture, chaque foyer son téléviseur, et des
dizaines d’appareils électroménagers prenaient en charge les tâches pénibles qui occupaient autrefois l’essentiel du temps éveillé de l’humanité. La médecine moderne a presque doublé l’espérance de vie. Aujourd’hui, la science, la technologie et l’industrie nous offrent non seulement les besoins essentiels, le confort et la santé, mais aussi des luxes et des divertissements que nos ancêtres n’auraient même pas osé imaginer dans leurs rêves les plus fous.
Ces accomplissements spectaculaires ont hissé la science sur un piédestal, que les autorités scientifiques dominantes ont utilisé comme tribune pour proclamer que la nature est un système clos. Bientôt, l’idée selon laquelle rien n’existe en dehors du monde naturel s’est imposée comme un savoir établi dans l’éducation laïque. Comme l’a affirmé Carl Sagan : « Le Cosmos est tout ce qui est, tout ce qui fut, et tout ce qui sera6. » Cette croyance que la nature est tout ce qui existe est devenue prédominante. La plupart des scientifiques ont alors exprimé avec assurance leur conviction que les mystères qui semblent aujourd’hui surnaturels finiront, tôt ou tard, par être expliqués comme un rouage de plus dans cette machine auto-créée et auto-entretenue qu’est la nature. (Nous reconnaissons, bien entendu, qu’il existe de nombreux scientifiques croyants, et même certains scientifiques laïques, qui ne partagent pas cette vision.)
Les principales institutions de l’Occident ont, dans l’ensemble, accepté ce désenchantement du surnaturel comme une réalité. L’éducation l’a distillé dans ses programmes et l’a diffusé comme un savoir établi. Dieu est devenu superflu à mesure que l’homme affirmait sa puissance pour prendre en main son propre destin. Les esprits ayant ainsi été chassés de la machine qu’est la nature, nous vivons désormais dans un monde mécaniste, isolé du surnaturel. Grâce au travail acharné de la science et de l’industrie, il nous suffit d’appuyer sur un interrupteur, de presser un bouton, de tourner un cadran ou de taper sur un clavier pour obtenir tout ce qu’il nous faut pour rendre la vie agréable, sans avoir à faire référence au Dieu ou aux dieux de nos ancêtres. L’enchantement est rompu.
Vivre dans un monde désenchanté
Avec un monde ainsi désenchanté, nous percevons la nature différemment de nos ancêtres. L’univers n’est plus désormais qu’une machine née d’un accident, avançant aveuglément. Privé de Créateur pour lui donner un sens, il ne peut être investi d’aucune signification. Il n’a ni but ni destination. Il se contente de tourner, au rythme des orbites des atomes, des planètes et des galaxies. Il ne va nulle part. Ainsi, nous ne pouvons plus envisager les éléments de la nature en fonction de leur finalité, le pourquoi de leur existence. Il ne peut y avoir de pourquoi dans un univers accidentel. Avec Dieu écarté, nous voyons désormais toute chose uniquement sous l’angle de son fonctionnement mécanique.
Cette perte de sens a entraîné un changement majeur, non seulement dans notre manière de percevoir la nature, mais aussi dans notre façon de vivre. Avant le désenchantement, une grande partie du monde occidental trouvait un sens dans la promesse d’une éternité transcendante faite par le Dieu chrétien. Vivre sous cette promesse impliquait des responsabilités, et nous n’osions pas vivre comme si nous nous appartenions entièrement. Nous considérions la vertu, la vérité et la morale comme voulues par Dieu, et nous croyions que nos vies devaient être ordonnées en fonction de cette réalité. Malgré nos innombrables, et souvent spectaculaires, échecs à vivre selon cet idéal, nous restions convaincus que l’amour de Dieu demeurait intact, et que son plan de rédemption couvrait notre culpabilité. Lorsque la modernité a rejeté l’idée d’un Dieu surnaturel, elle a éteint cette espérance chrétienne de l’éternité, nous laissant chercher un sens uniquement dans le système mécanisé de la nature et dans la brève trajectoire de la vie humaine, de la naissance à la mort.
On pourrait penser que ce changement aurait été traumatisant pour l’humanité. Nous sommes désormais isolés, seuls, exposés et sans protection dans un univers froid, qui nous a engendrés aveuglément et se désintéresse totalement de notre destin, un univers
qui ne va nulle part et ne nous offre aucun lieu vers lequel aller. A disparu le réconfort de savoir que nos vies reposent dans les bras d’un Créateur aimant, qui promet un avenir glorieux et éternel. L’humanité n’est plus qu’un rassemblement d’individus épars, sans système de croyance commun, sans voie vers une existence pleine de sens, évoluant dans un univers accidentel, sans but ni signification. Ce sentiment de perte devrait être écrasant.
Un sentiment de perte s’est bien fait ressentir, mais il a été contrebalancé par un profond sentiment d’accomplissement. En abolissant le domaine surnaturel transcendant, l’humanité a eu le sentiment d’avoir accompli un acte de courage. Cela nous libérait pour choisir notre propre chemin, sans être entravés par les contraintes imposées par une divinité. Le bannissement de Dieu nous affranchissait du fardeau de la vertu, des restrictions de la morale et du poids de la vérité. Nous n’avions plus de limites dans la poursuite de nos désirs. Nous étions désormais libres de chercher un sens selon nos propres termes et de reconstruire le monde à notre image, selon notre bon plaisir. C’est pourquoi des athées célèbres, comme George Bernard Shaw, ont pu plaisanter : « Je suis athée, et j’en remercie Dieu7. »
Pour préparer le terrain à cette nouvelle tour de l’humanisme, la modernité s’est transformée en postmodernité. En tant que philosophie, le modernisme tendait déjà à s’éloigner de la croyance au surnaturel et fondait son idée de la vérité sur la raison appliquée aux découvertes de la science et à la pensée des Lumières. La postmodernité a érodé le modernisme en remettant en question la validité de toute affirmation de vérité, affirmant que notre capacité de raisonnement est trop limitée et que nos récits fondateurs sont trop subjectifs pour être vraiment fiables. Avec l’avènement de la postmodernité, toute autorité et toute forme de contrainte sur nos croyances et nos actions ont été remises en cause. Les vérités absolues sont désormais perçues comme des formes d’intolérance. L’homme se pose alors comme seul juge de la vérité. La loi morale
a perdu son autorité et est devenue une entrave à notre droit de poursuivre n’importe quel plaisir. Presque tous les désirs humains ont été normalisés, et la liberté sexuelle est devenue le grand étendard de ce nouvel ordre. Les restrictions morales qui pesaient sur la littérature, le cinéma, la télévision et Internet ont été allégées, voire supprimées. La cohabitation, la pornographie, l’homosexualité, le mariage homosexuel et le transgenrisme se sont débarrassés de leur stigmate vieux de plusieurs siècles et ont intégré la norme sociale. Le droit à l’avortement est devenu un pilier essentiel de cette liberté sexuelle, destiné à protéger des conséquences que la morale cherchait autrefois à prévenir.
Au début du xxie siècle, ce nouvel ordre séculier s’était profondément enraciné dans les institutions les plus influentes de l’Occident : gouvernement, éducation, médias, divertissement, sport et monde des affaires. Ces institutions ont largement contribué à éradiquer Dieu de la culture occidentale, ouvrant ainsi la voie à l’affirmation de l’homme comme maître de son propre destin et capitaine de son âme. En conséquence, toute idée selon laquelle l’humanité poursuivrait un but ultime a été en grande partie éclipsée par l’idée que ce monde peut être organisé pour notre propre bénéfice, sans devoir attendre quelque récompense céleste future.
Le revers du désenchantement
Alors que ce monde nouveau et audacieux s’exaltait sous le soleil de sa liberté nouvellement acquise, dans l’ombre, un vide inconfortable rôdait, un vide que le sécularisme ne parvenait tout simplement pas à combler. Le sens et la finalité, si faciles à trouver sous la protection d’un Dieu transcendant, ont disparu dans l’univers clos de la modernité. Il est vite devenu évident que, dans le nouvel ordre séculier, le sens n’existe tout simplement pas. Beaucoup ressentent aujourd’hui ce vide, qui engendre une hausse de la désillusion, de la dépression et du suicide. Peut-être l’as-tu ressenti toi-même dans ta propre vie, ou l’as-tu observé chez ceux qui t’entourent.
La hausse de la dépression et des suicides est désormais bien documentée. Selon une étude de l’Université Columbia, « la dépression a significativement augmenté aux États-Unis entre 2005 et 2015, passant de 6,6 % à 7,3 % de la population. Il est à noter que l’augmentation la plus rapide a été observée chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, passant de 8,7 % en 2005 à 12,7 % en 20158. » En 2020, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont rapporté que le taux de suicide aux États-Unis avait augmenté de 35 % entre 1999 et 20189. Actuellement, le suicide est la douzième cause de décès aux États-Unis10.
Pour contrer la tentation de rechercher du sens et une finalité en revenant à la foi religieuse, le nouvel ordre s’est employé avec assiduité à renforcer la valeur du sécularisme. Il le fait en promouvant le stoïcisme, l’indépendance et le consumérisme.
Stoïcisme : faire face avec courage
Pour ceux qui s’orientent vers la philosophie, le sécularisme propose une forme de stoïcisme. Oui, nous dit-on, l’univers séculier peut manquer de sens et de finalité. Il est vrai que nos vies n’ont aucune véritable signification et ne mènent nulle part, mais il vaut mieux affronter et accepter cette dure réalité plutôt que de chercher un faux réconfort dans les illusions qu’offre la religion. Comme l’a exprimé le philosophe britannique Julian Baggini : « La raison d’être athée n’est pas que cela nous rende plus heureux ou nous procure une vie plus épanouissante. La raison d’être athée est simplement qu’il n’existe pas de Dieu, et nous préférons vivre en pleine conscience de cette réalité, en en acceptant les conséquences, même si cela nous rend moins heureux11. »
Nous admirons une telle dévotion stoïque à une croyance peu réconfortante. Pour maintenir cet engagement, les séculiers doivent fournir un effort constant. Ils doivent sans cesse se rappeler que la modernité a discrédité la religion et que l’univers naturel est tout ce qui existe. Ainsi, finalité et sens n’existent pas : ils ne sont que
des illusions que la religion a tenté de nous imposer. Les séculiers ne doivent jamais cesser de se répéter que l’athéisme est la réalité. Il faut l’affronter. Se le redire encore et encore. Nous devons désormais être assez forts pour vivre dans un monde sans sens, un monde qui ne mène nulle part.
Indépendance : soyez vous-même
Le sécularisme renforce également le désenchantement en proposant l’indépendance comme alternative à la recherche de sens et de finalité. Affirmez votre individualité. Soyez vous-même. Créez la personne que vous souhaitez être en exerçant votre liberté face aux limites restrictives imposées par la religion. Puisque les valeurs n’existent plus, c’est le choix lui-même qui est valorisé, bien plus que ce qui est choisi. Il n’est pas important que vous choisissiez ce qui est juste (existe-t-il seulement quelque chose de juste ?) ni même que vous choisissiez la vérité (existe-t-il seulement une vérité ?). Ce qui compte, c’est que vous choisissiez quelque chose, afin de vous définir vous-même et de vous donner un sentiment de contrôle. « Je choisis, donc je suis. » Choisissez votre politique, vos causes, votre morale, votre vérité, votre orientation sexuelle, voire votre propre sexe. Par le choix, on tente de valider l’individu indépendant, faisant de chaque personne l’agent de sa propre existence, sans se conformer à un idéal imposé d’en haut.
Nous découvrons cependant assez vite que l’autonomie individuelle ne suffit pas à donner un véritable sens à l’existence. Il semble que nous ayons non seulement un besoin inné d’indépendance, mais aussi un besoin tout aussi profond de communauté. Le vieux tissu d’une croyance transcendante partagée, qui nous unissait autrefois, a été déchiré, et il est difficile de trouver des substituts.
Ce besoin double, à la fois d’autonomie et de communauté, a ouvert une immense opportunité commerciale pour les entreprises et les publicitaires. Pour répondre à cette demande (et gonfler leurs revenus), ils nous incitent à choisir librement la conformité.
La publicité a réussi à nous faire croire que nous affirmons notre indépendance en choisissant d’être comme presque tout le monde. Nous sommes manipulés pour accepter l’illusion de l’individualité, alors que, de manière subconsciente, nous adoptons la conformité dictée par la mode, non seulement dans nos vêtements, nos aliments, nos voitures ou nos coiffures, mais aussi dans nos croyances et nos causes du moment. Remarquez comme les causes populaires vont et viennent : des causes auxquelles toute personne ayant une conscience sociale « se doit » d’adhérer tant qu’elles sont en vogue. L’année prochaine, les causes qui passionnent aujourd’hui perdront de leur éclat, et ceux qui cherchent à affirmer leur autonomie se rueront massivement vers de nouvelles tendances. La mode imite la communauté en nous attirant dans une conformité artificielle. Le terrain d’entente offert par la mode nous permet de faire des choix « personnels » en reproduisant simplement les choix du groupe dont nous souhaitons obtenir l’approbation. Soyez vous-même ! Détachez-vous du troupeau et affirmez votre individualité en achetant le même produit que tout le monde.
Consumérisme : mangez, buvez et réjouissez-vous
Le camouflage de la conformité généralisée sous l’apparence du choix indépendant conduit à la tentative la plus répandue pour bannir l’enchantement de la vie moderne : le consumérisme. Le consumérisme se nourrit d’un cycle accéléré de désirs éphémères et de satisfactions passagères. Il offre une distraction prolongée face au vide laissé par la perte de la transcendance. Mangez, buvez et réjouissez-vous. Remplissez votre existence de sensations pour tenter d’effacer la conscience de ce vide lancinant qui ronge votre vie. La prise de conscience de ce manque de sens a commencé à émerger lors des rébellions de la jeunesse dans les années 1960. En 1969, la légendaire Peggy Lee enregistre son tube Is that all there is ? (Est-ce tout ce qu’il y a ?). Chaque couplet exprime une profonde désillusion face à des événements où elle s’attendait à trouver un
sens profond. Enfant, elle voit sa maison brûler ; plus tard, son père l’emmène au cirque ; elle grandit et tombe amoureuse. Mais aucun de ces événements ne lui apporte la profondeur de signification qu’elle espérait. Ainsi, après avoir décrit chacun de ces épisodes, elle chante inlassablement le refrain morne et répétitif : « Est-ce tout ce qu’il y a ? Si c’est tout, mes amis, alors continuons à danser. Ouvrons les bouteilles et faisons la fête. Si c’est tout ce qu’il y a12. »
Dans un monde désenchanté, le mieux que nous puissions faire est de noyer notre soif de sens dans un océan de sensations. Le professeur de philosophie James K. A. Smith, de l’Université Calvin, l’exprime plus précisément : « La plupart du temps, le meilleur salut auquel nous puissions aspirer se trouve dans des comportements qui nous engourdissent face à cette réalité : drogues, sexe, divertissements de toutes sortes13. » Ces comportements, cependant, reviennent à remplir d’emballages en plastique un espace destiné à contenir un trésor. Tout ce que nous tentons d’entasser dans ce vide se révèle aussi creux que le vide lui-même. Avec la perte de la transcendance, nous restons privés de sens et de direction, comme des navires, sans cargaison, à la dérive.
La persistance tenace de la transcendance
La plupart des séculiers prennent rapidement conscience qu’en bannissant la transcendance, ils ont perdu tout espoir de trouver une véritable notion de sens et de finalité. Comme nous l’avons vu, leur réponse à cette perte peut être admirable et courageuse : l’affronter et continuer leur chemin. Ils pensent que la liberté de l’humanité, affranchie des chaînes de la religion, ainsi que son indépendance dans un monde sans Dieu, devraient suffire à ensevelir le désir de trouver un sens et un but.
Le problème, comme beaucoup l’ont constaté, est que ce désir refuse de rester enfoui. Bannir Dieu de la réalité peut être un accomplissement majeur, mais cela nous a laissés avec un vide
béant. Comme l’a malicieusement formulé le romancier Julian Barnes : « Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque14. »
Charles Taylor a observé que ce vide se fait souvent sentir avec le plus d’intensité lors des événements que nous reconnaissons comme les passages les plus marquants de la vie : la naissance, le mariage et la mort. La profondeur de sens que nous espérons trouver dans ces étapes fondamentales manque souvent à l’appel, nous laissant dans une forme de platitude émotionnelle. Comme Peggy Lee*, nous nous demandons : « Est-ce tout ce qu’il y a ? » Les séculiers convaincus peuvent chercher un moyen d’attribuer un sens à de tels événements, mais leur immersion dans le monde désenchanté de la postmodernité les en empêche. Elle ne leur permet de voir que la machine de la nature avançant aveuglément dans son cycle dénué de sens, produisant mécaniquement de nouvelles vies tout en rejetant sans fin les anciennes.
Et pourtant, la mort suscite inévitablement des pensées d’éternité, même dans les cœurs les plus séculiers. La perte d’un ami cher ou d’un membre de la famille plonge souvent les séculiers dans un état de confusion circulaire, accompagnée d’un sentiment persistant que la vie qui vient de s’éteindre ne peut tout simplement pas s’arrêter là. Ils peuvent être intellectuellement convaincus que l’existence de leur être aimé a cessé pour toujours, mais quelque chose en eux résiste à une telle conclusion fataliste. La conviction qu’elle a été anéantie à jamais entre violemment en conflit avec l’impossibilité intérieure de la penser comme définitivement inexistante. Et le sentiment que son existence avait un sens heurte de plein fouet le déni postmoderne de toute signification.
Il n’est pas rare que la mort représente un problème sérieux pour les athées. Une femme, cherchant des conseils pour faire face à la mort, a écrit à un site web athée, en disant :
* N.d.É : chanteuse, auteur-compositrice et actrice américaine (1920-2002), associée aux grandes voix du jazz et du blues.
« J’ai peur de mourir. J’ai tellement peur de mourir que si je pense à ce que cela signifie, ne serait-ce qu’une seconde, je deviens obsédée par cette idée et je fais une crise de panique, au point de presque perdre connaissance. Cela ne m’arrive que de temps en temps, et je suis une personne pleinement fonctionnelle, mais si j’y pense, je deviens incapable de fonctionner… Au fond de moi, j’aimerais pouvoir croire en un dieu, simplement pour faire disparaître cette peur… J’ai envisagé une thérapie, mais cela voudrait dire affronter cette peur, et je ne pense pas en être capable, car quel serait le résultat ? Soit je me berce d’illusions en pensant qu’un paradis ou une autre vie m’attendent, soit je continue à enfouir cette connaissance au plus profond de moi, toujours prête à ressurgir, comme elle l’a fait toute ma vie15. »
Face à de telles peurs, nous aspirons à bien plus que ce que le sécularisme peut offrir. Cette femme ne parvient ni à affronter la mort, ni à ignorer la question qu’elle soulève sur l’au-delà auquel elle ne croit plus. Peter Steele, défunt chanteur du groupe de metal gothique Type O Negative, l’a exprimé ainsi : « Quand tu commences à penser à la mort, tu te mets à penser à ce qu’il y a après. Et alors, tu commences à espérer qu’il existe un Dieu16. »
Dans de tels moments, un désir d’éternité refait surface, et ce désir témoigne du fait que l’aspiration à la transcendance n’est ni puérile ni superficielle, contrairement à ce que proclame le sécularisme. Nous devons soit l’accepter comme une possibilité réelle, soit la rejeter comme une illusion qui hante l’humanité depuis ses débuts et refuse obstinément d’être exorcisée.
Le sécularisme peut enterrer le désir humain de transcendance, mais il ne peut pas l’anéantir. Nous ne pouvons pas non plus creuser une tombe assez profonde pour empêcher son retour. Tôt ou tard, il ressurgira, s’imposant comme un sérieux défi au désenchantement séculier. Le moi ne peut supporter indéfiniment le système
clos de la modernité. À terme, la frustration de vivre une existence privée de sens et de finalité devient insupportable.
Le conflit entre le sécularisme et le christianisme
Le christianisme a toujours offert un chemin clair et rationnel vers le sens et la finalité. Mais le problème est que les principes du christianisme sont radicalement en décalage avec le nouvel ordre séculier. Cela signifie que ses attraits doivent être discrédités et son influence limitée pour que le sécularisme puisse prospérer. Pour éviter que des âmes désillusionnées en quête de sens et de but ne fassent défection, les séculiers savent qu’ils doivent extirper le christianisme des principales institutions de la société, en le réduisant au silence ou en le confinant aux marges.
Cela explique pourquoi l’opposition au christianisme est devenue de plus en plus intense au cours des dernières décennies. Cela explique pourquoi la prière, la Bible, Noël, les Dix Commandements et toute référence positive au christianisme ont été exclues des écoles publiques, des universités, des gouvernements, des tribunaux, du monde du divertissement, et même de nombreuses entreprises. Dans les lycées et les universités, les majors de promotion se voient interdire de mentionner leur foi. Beaucoup d’établissements interdisent aux organisations chrétiennes de se réunir dans leurs locaux. Les employés chrétiens qui expriment ou vivent leur foi à l’école ou au travail s’exposent souvent à des sanctions disciplinaires, des amendes, des licenciements ou à des poursuites judiciaires. Certaines entreprises ont été boycottées, poursuivies en justice, voire forcées de fermer lorsque leurs convictions ne correspondaient plus aux normes changeantes du moralisme séculier.
Si l’on adopte le point de vue du séculier, il est facile de comprendre pourquoi le christianisme est si vigoureusement combattu. Le christianisme est dénoncé comme faux parce que la majorité des scientifiques affirme que le surnaturel n’existe pas. Il est dénoncé
comme irrationnel parce qu’on l’accuse de fonder ses croyances sur une foi aveugle. Il est dénoncé comme mauvais car perçu comme subordonnant les femmes, ignorant la justice sociale, s’opposant à la liberté sexuelle et discriminant les personnes homosexuelles et transgenres. Il est dénoncé comme intolérant parce qu’il n’approuve pas l’authenticité des autres religions. Il est dénoncé comme politiquement incorrect parce qu’il affirme que la vérité est réelle et absolue, ce qui entre en conflit avec le climat postmoderne actuel de vérité changeante et de morale autodéterminée.
Les séculiers s’opposent au christianisme parce qu’il va à l’encontre des principes fondamentaux qu’ils considèrent comme réels ou comme des objectifs désirables : la révolution sexuelle, l’autonomie individuelle, la confiance absolue dans les déclarations scientifiques, la variabilité de la vérité et de la morale. Le sécularisme est aujourd’hui l’air intellectuel, politique et religieux que nous respirons. Et pour maintenir l’atmosphère culturelle « pure », il faut traiter le christianisme comme un polluant.
Sortir du rang
Aujourd’hui, les principales institutions de la société occidentale s’emploient activement à promouvoir l’évaluation négative du christianisme que nous avons évoquée plus haut. De plus, elles réussissent de mieux en mieux à rallier la population à leur point de vue. Il est vrai que le christianisme défend de nombreux principes que le sécularisme n’approuve pas, et qu’il rejette bien des principes que le sécularisme soutient. Cependant, nous vous assurons que le christianisme authentique n’a rien à voir avec la caricature déformée que le sécularisme en présente. Comme cela arrive avec toute religion, organisation politique ou conviction culturelle, certains individus qui prétendent défendre leur cause la représentent en réalité très mal. Les chrétiens qui se comportent mal amènent naturellement les gens à valider la condamnation actuelle du christianisme. Mais les croyances fondamentales du christianisme ne
contiennent aucun des préjugés, de l’intolérance ou de l’esprit de jugement dont on l’accuse. Si les informations biaisées véhiculées par les médias, le divertissement et l’éducation vous ont amené à envisager de rejeter le christianisme, nous ne pouvons pas vous en tenir rigueur. Si leurs affirmations reflétaient réellement la vérité sur le christianisme, nous le rejetterions nous-mêmes. Nous comprenons pourquoi beaucoup aujourd’hui se contentent d’accepter ce que leur transmettent les institutions séculières dominantes et ne ressentent pas le besoin d’approfondir la question. Sans informations précises pour les guider, ils rejoignent naturellement le mouvement général de condamnation contre ce qu’ils perçoivent comme une religion obstinée et tournée vers le passé, incapable de monter à bord du train du progrès. Pourtant, à un moment donné, beaucoup de passagers de ce train finissent par réaliser qu’il ne progresse vers aucune destination véritable. Il ne mène nulle part.
Si vous êtes une personne de foi, peut-être avez-vous envisagé d’abandonner votre ancien système de croyances pour monter à bord du train du progrès. Si c’est le cas, dans les pages qui suivent, nous vous rassurerons en affirmant que Dieu est réel, et nous vous donnerons des raisons solides de continuer à lui faire confiance. Ou peut-être n’avez-vous jamais adhéré à un système de croyances chrétien, mais ressentez-vous un vide dans votre vie qui vous amène à douter des promesses du sécularisme. Dans les pages suivantes, nous vous montrerons que le Dieu du christianisme existe, et nous vous guiderons à travers des raisons solides de croire en cette vérité fondamentale. Nous comprenons que vous puissiez ressentir une forte résistance à ce que l’on vous a culturellement conditionné à rejeter. L’une des tâches les plus difficiles que chacun de nous puisse entreprendre est de réexaminer honnêtement ses croyances fondamentales. Pourtant, si le besoin persistant de trouver un sens et une finalité commence à vous ronger, et si vous prenez conscience que le sécularisme n’offre aucun accomplissement véritable, qu’avezvous à perdre à explorer les fondements de la foi en Dieu ?
Contrairement à ce qu’affirme notre culture, le Dieu du christianisme ne demande pas une foi aveugle. Croire en son existence est défendable rationnellement. Cette foi repose, ou s’effondre, sur la cohérence logique et la validation rationnelle. Nos affirmations selon lesquelles Dieu existe, que la vérité est réelle, et que le sens est inscrit au cœur de la réalité sont testables. Nous vous lançons le défi de les mettre à l’épreuve par vous-même, de vous éloigner, ne serait-ce qu’un instant, du quai du train du progrès pour reconsidérer la possibilité que la transcendance surnaturelle soit une réalité. Le christianisme offre un chemin qui vous ramènera du néant du sécularisme à la réalité véritable. Un chemin qui ouvrira devant vous des horizons de sens et de finalité, et vous révélera le destin plein d’espérance qui vous attend.
Dans les pages qui suivent, nous présenterons et expliquerons les preuves d’une croyance parfaitement rationnelle en un Dieu transcendant. Nous montrerons comment son existence donne toute sa légitimité à notre quête de sens. Nous prouverons que la foi en Dieu n’est ni un saut irrationnel dans l’obscurité ni un espoir désespéré sans fondement. Au contraire, elle est entièrement rationnelle, solidement étayée, intellectuellement défendable et émotionnellement épanouissante. Nous démontrerons que le Dieu créateur est la seule réponse complète et cohérente aux grandes questions religieuses et philosophiques de l’humanité, et que ce n’est qu’en nous alignant sur sa vérité que nous pouvons réellement comprendre la réalité que nous expérimentons. Vous n’avez pas besoin de laisser votre intelligence à la porte de l’église pour devenir croyant ; vous n’avez pas non plus à renoncer aux joies de la vie. Bien au contraire, nous sommes profondément convaincus que la foi en Dieu est le seul remède au malaise actuel de notre société et la seule source véritable de contentement et de joie.
Au cas où vous seriez de ceux qui sautent la préface d’un livre, nous répétons ici une promesse que nous avons faite plus tôt : si vous craignez que nous allions vous bombarder de versets bibliques
pour soutenir nos arguments, soyez rassuré, ce ne sera pas le cas. Nulle part dans ces pages nous ne fondons nos arguments sur des références bibliques, conscients qu’elles seraient sans portée pour un lecteur sceptique vis-à-vis de la religion. Nous nous appuierons uniquement sur la raison, l’observation, les preuves et le bon sens pour étayer nos propositions.
Notre espoir ultime est que ce livre vous aide à percevoir les éclats de transcendance qui percent la barrière du sécularisme postmoderne. Nous identifierons la source de ces éclats, tenterons de vous convaincre de leur réalité et, nous l’espérons, ouvrirons votre esprit à la vérité d’un univers enchanté, baigné de sens, de beauté, d’amour et de joie.
QUESTIONS POUR APPROFONDIR LE SUJET
1. Pourquoi le fait de parler de Dieu et du christianisme suscite-t-il souvent de l’hostilité dans la culture actuelle ?
2. Pourquoi l’incrédulité envers Dieu ou envers des dieux était-elle si rare dans les siècles passés ?
3. Comment les avancées industrielles et scientifiques du milieu du xxe siècle ont-elles favorisé le développement du sécularisme ?
4. Pourquoi le fait de se débarrasser de Dieu a-t-il privé l’humanité d’un sentiment de sens et de finalité ?
5. Quelles sont certaines des façons dont les gens tentent de faire face à la perte de sens et de but ? Avez-vous déjà ressenti ce vide ? Comment l’expliquez-vous ? De quelles manières tentez-vous de le compenser ?
6. Pourquoi l’essor du sécularisme a-t-il entraîné une augmentation de la dépression, de l’anxiété et des suicides ?
7. En quoi des événements marquants tels que le mariage, la naissance ou la mort ébranlent-ils notre confiance dans le sécularisme ?