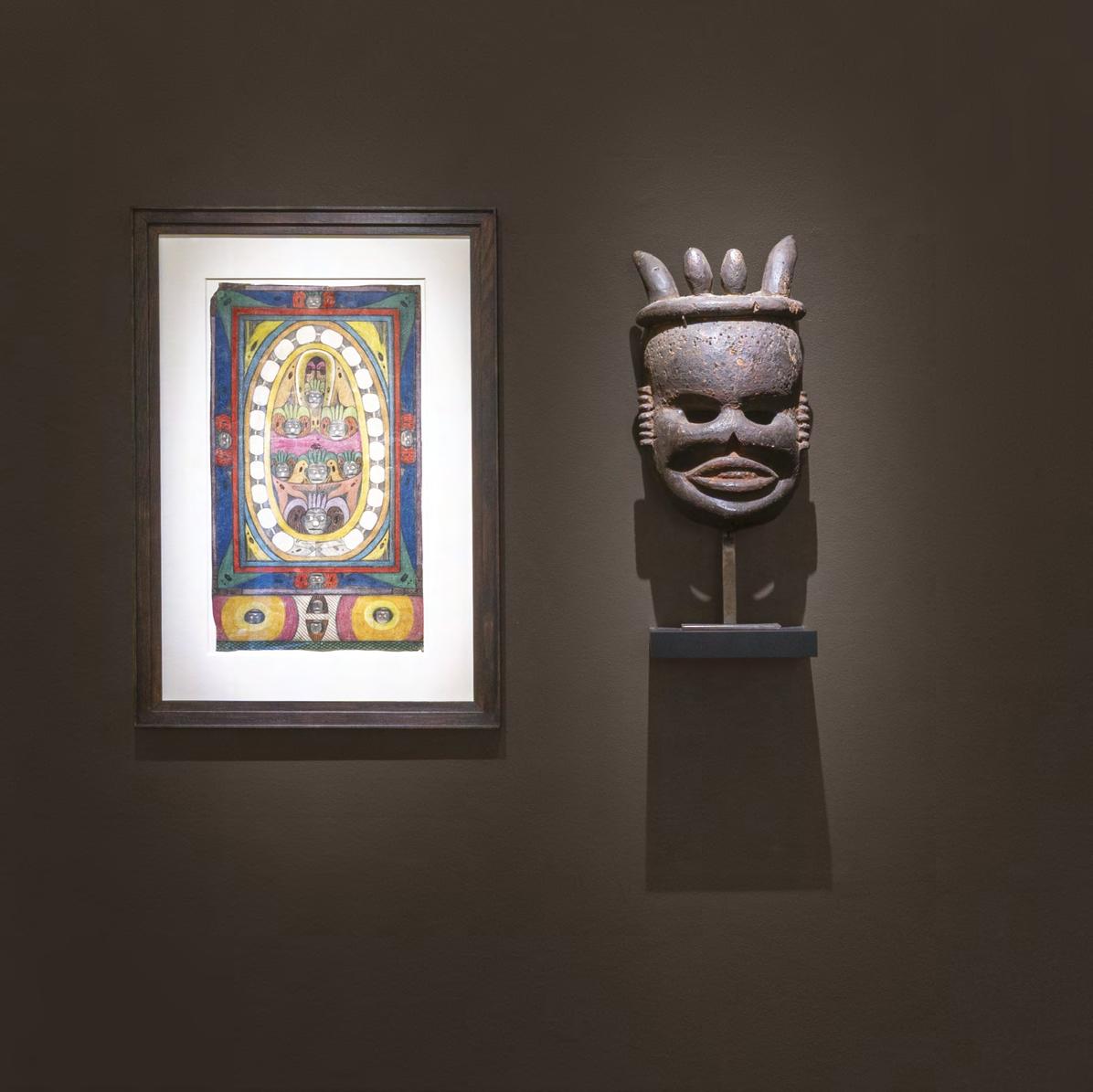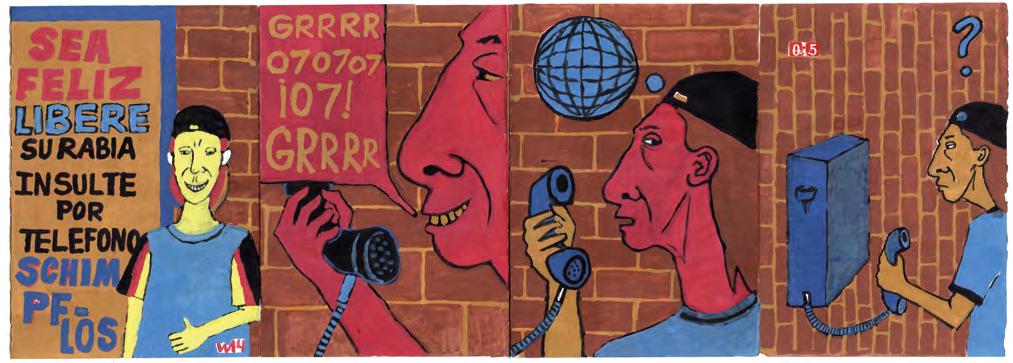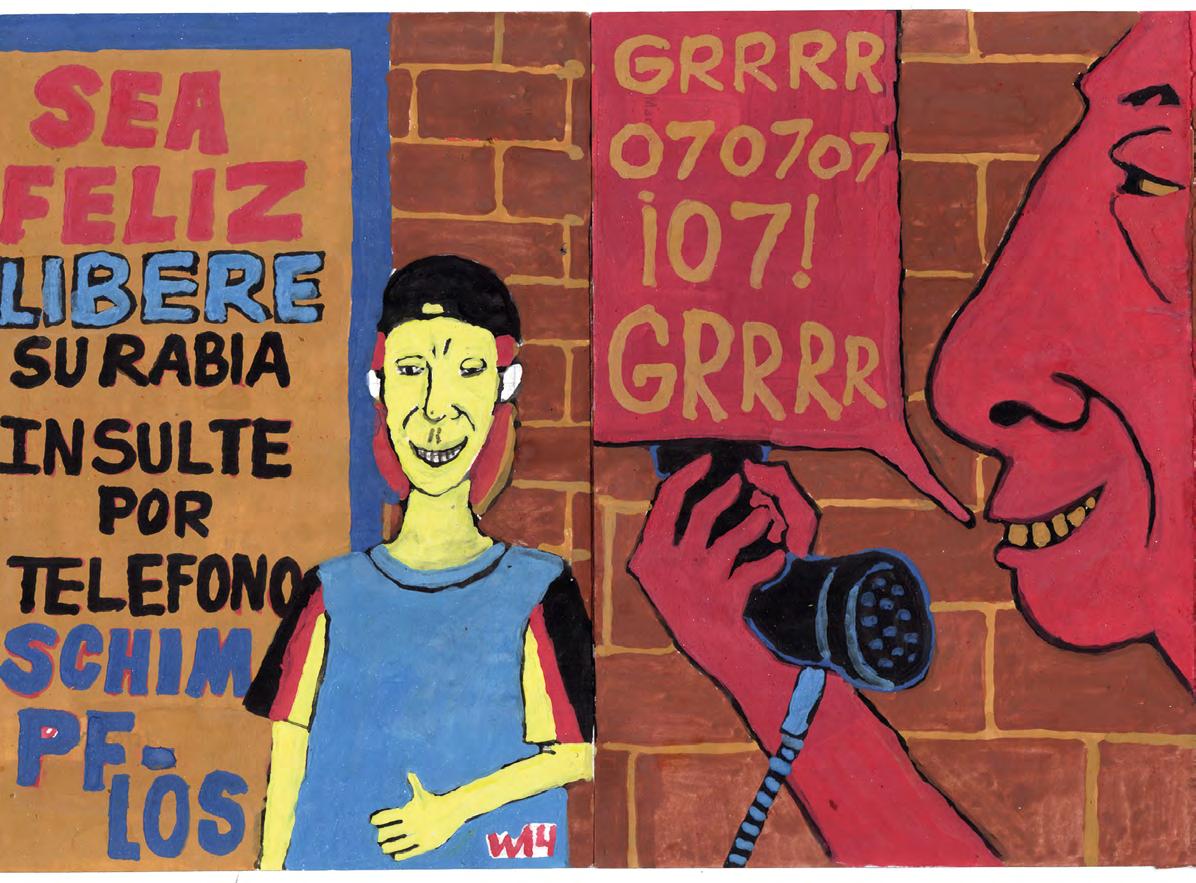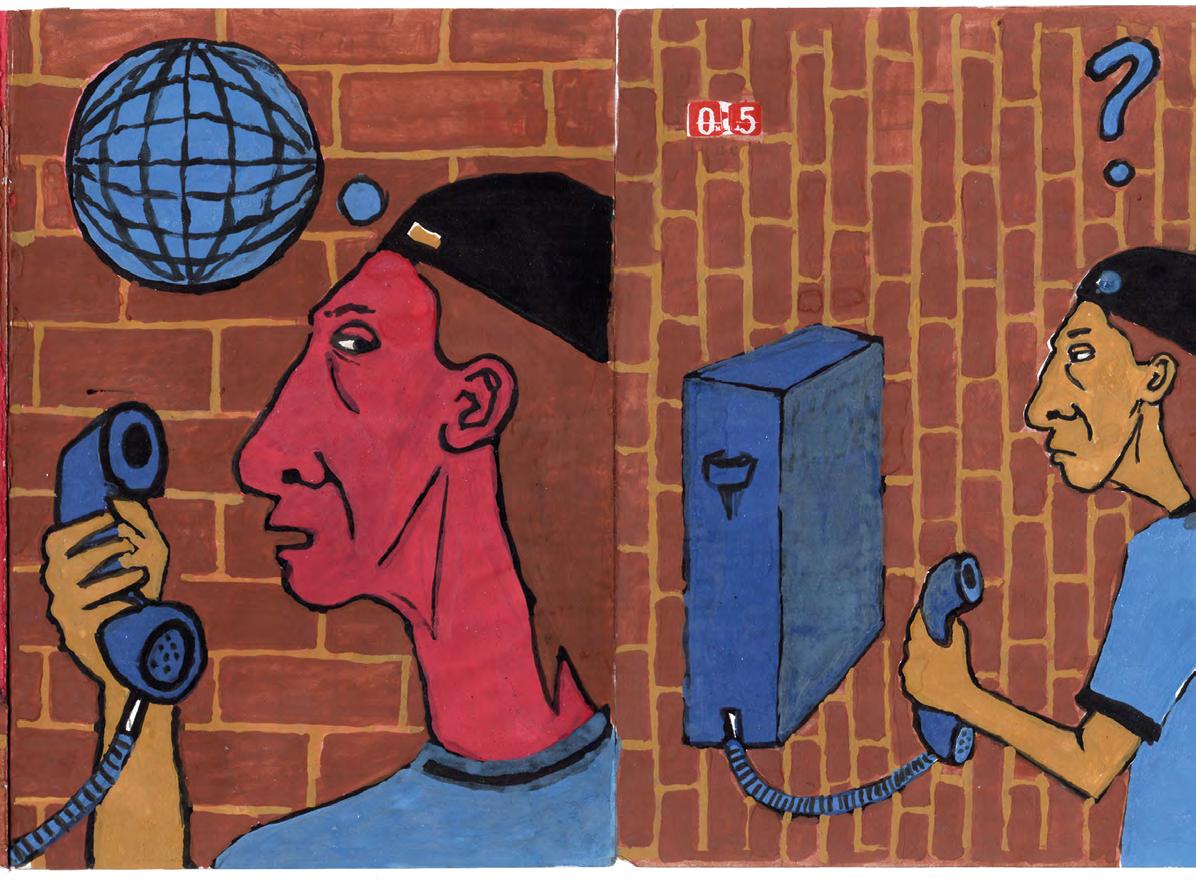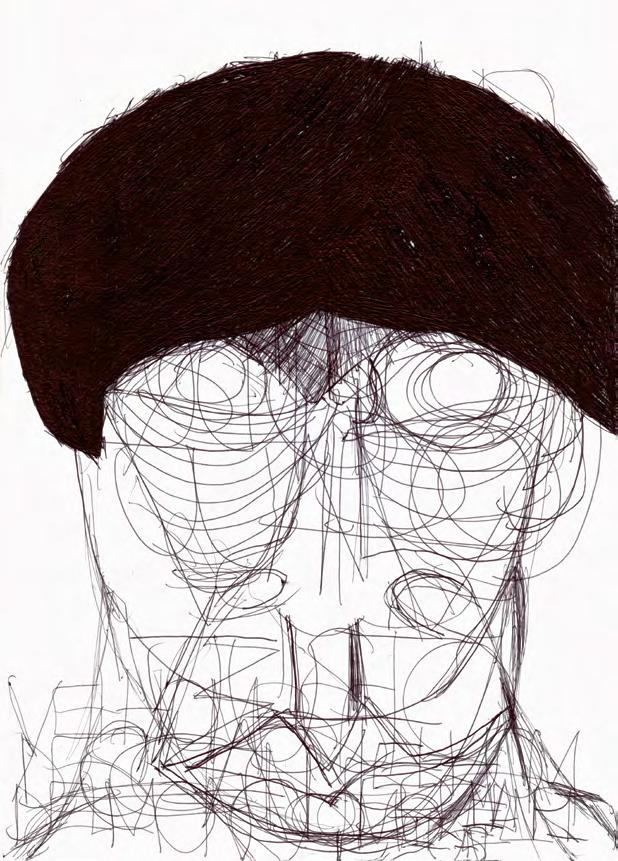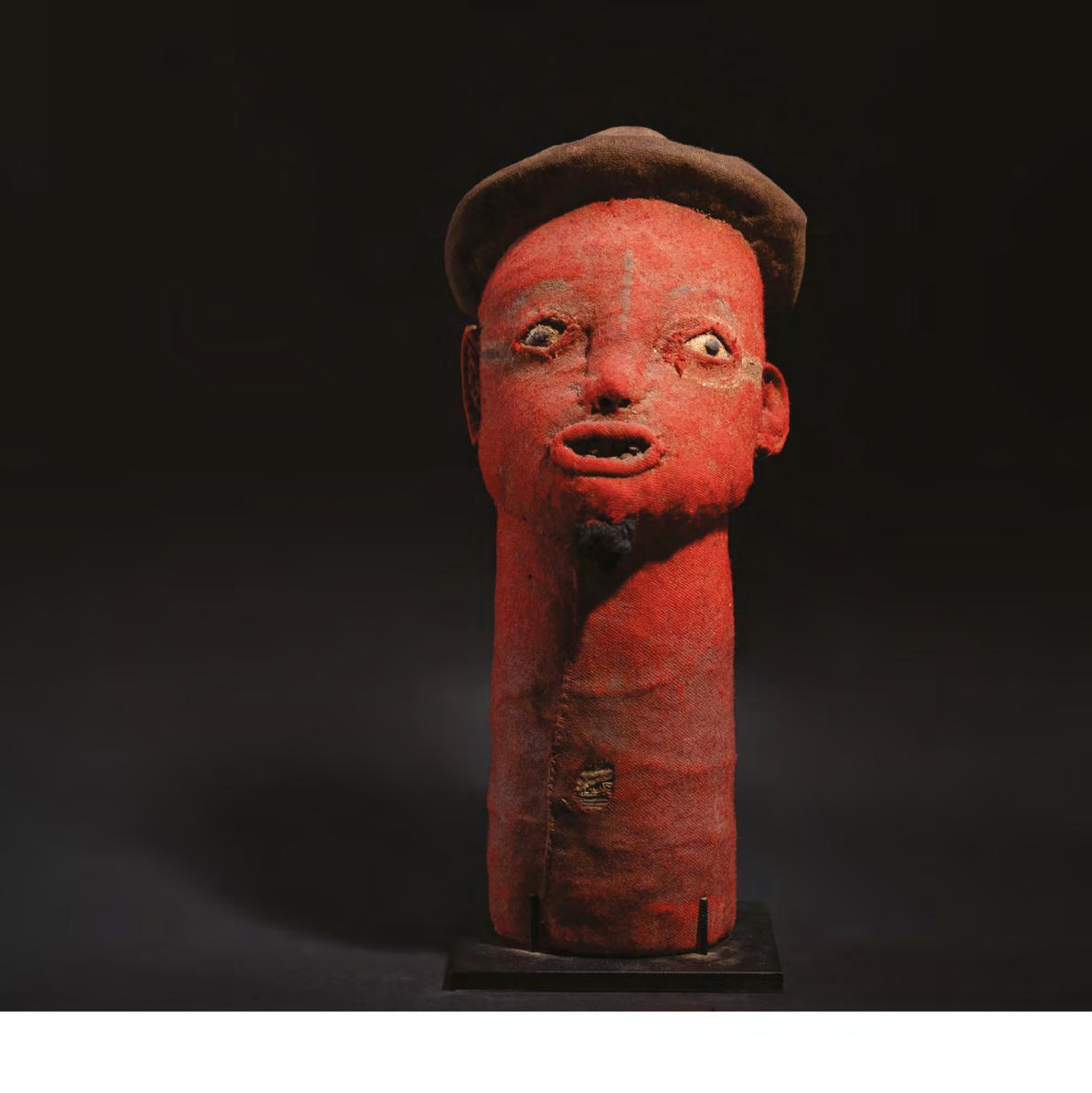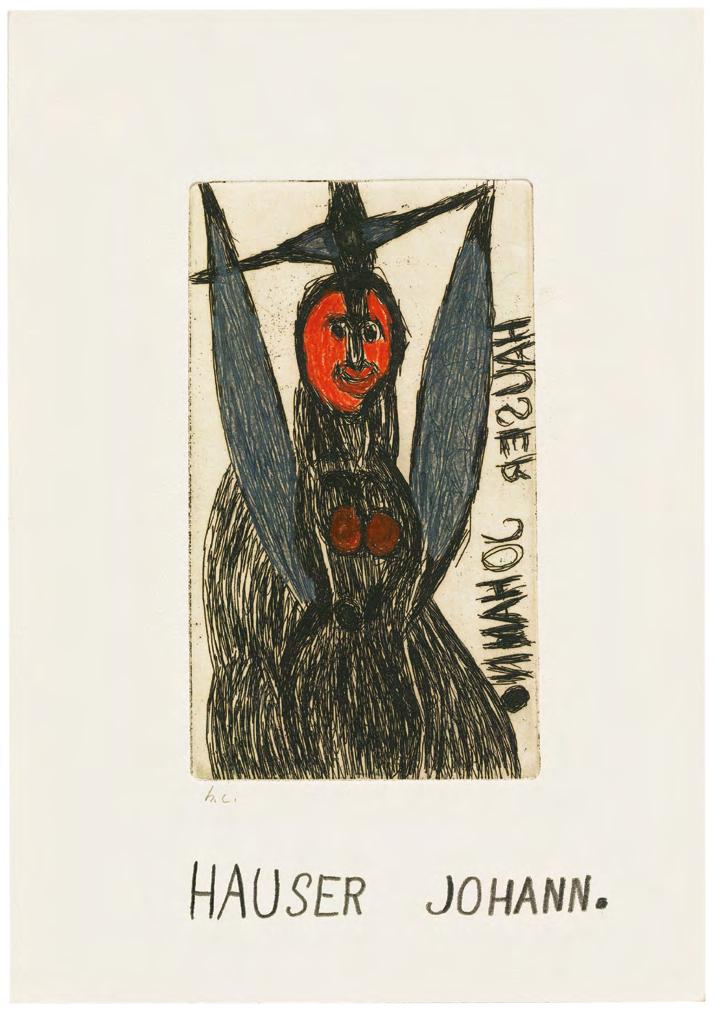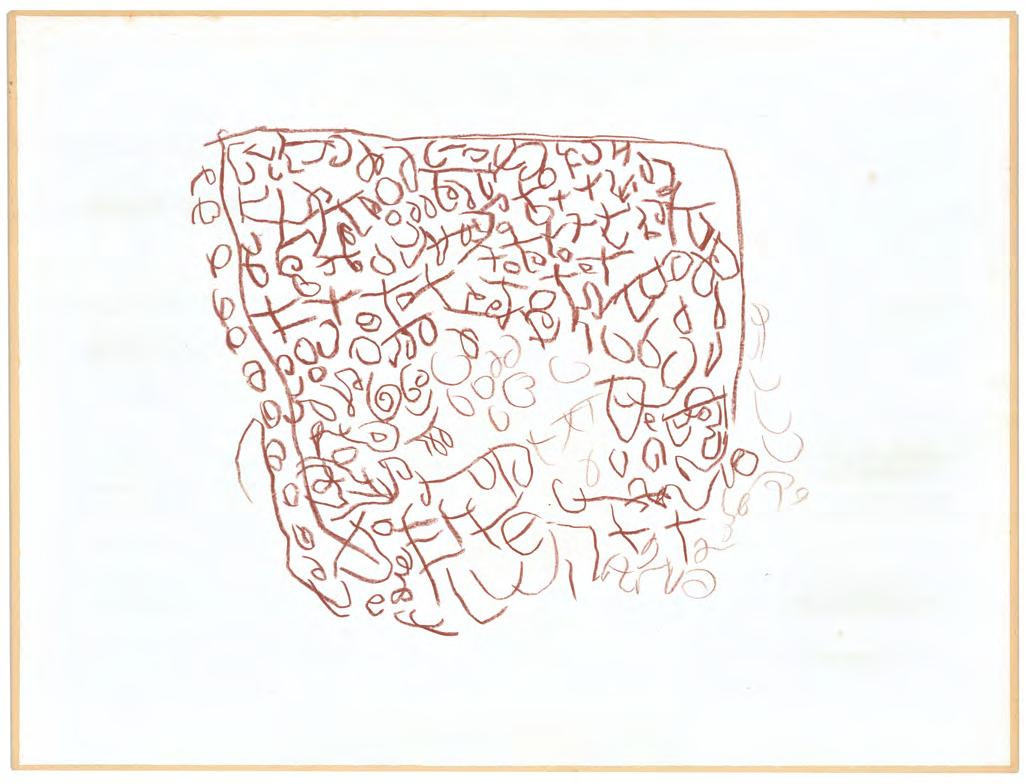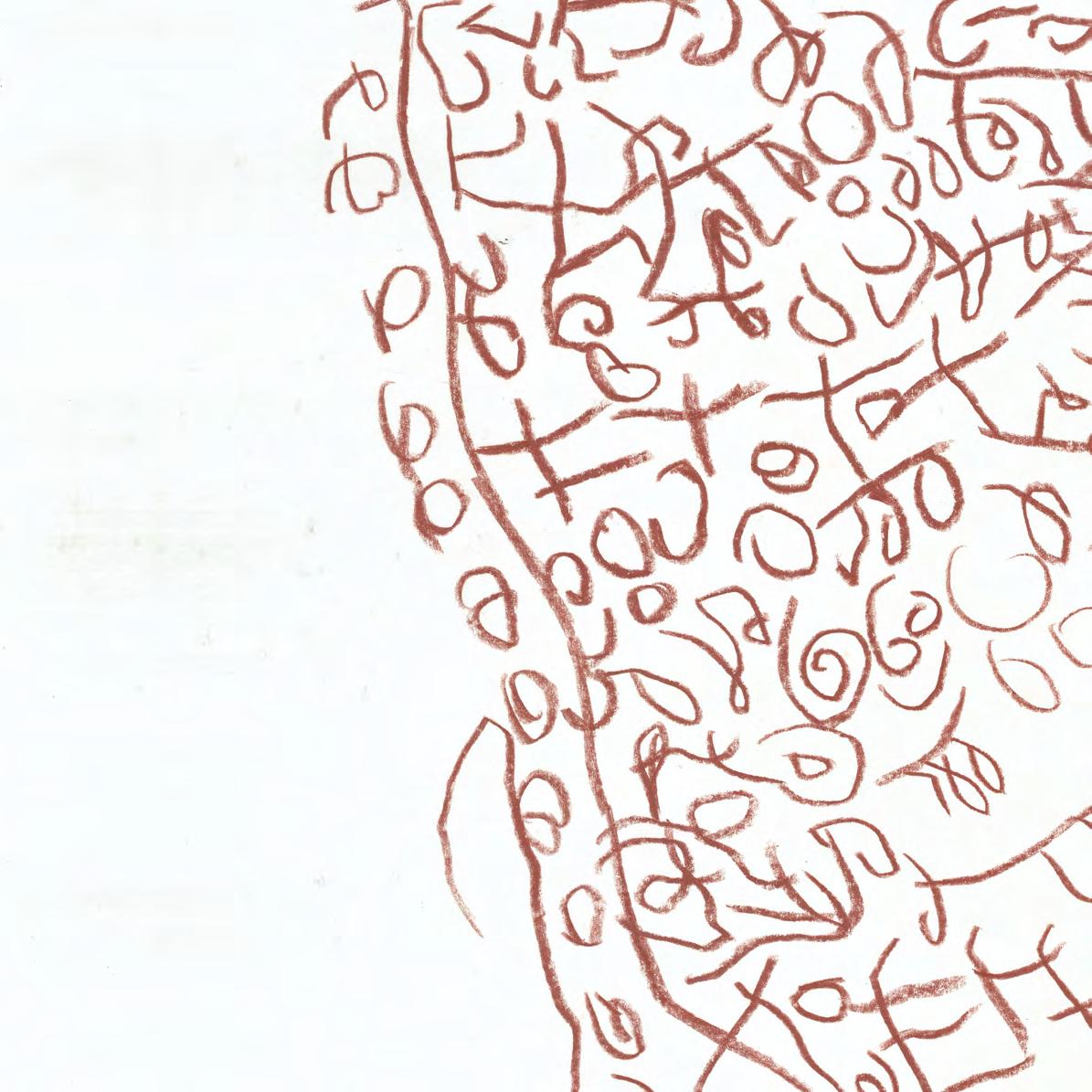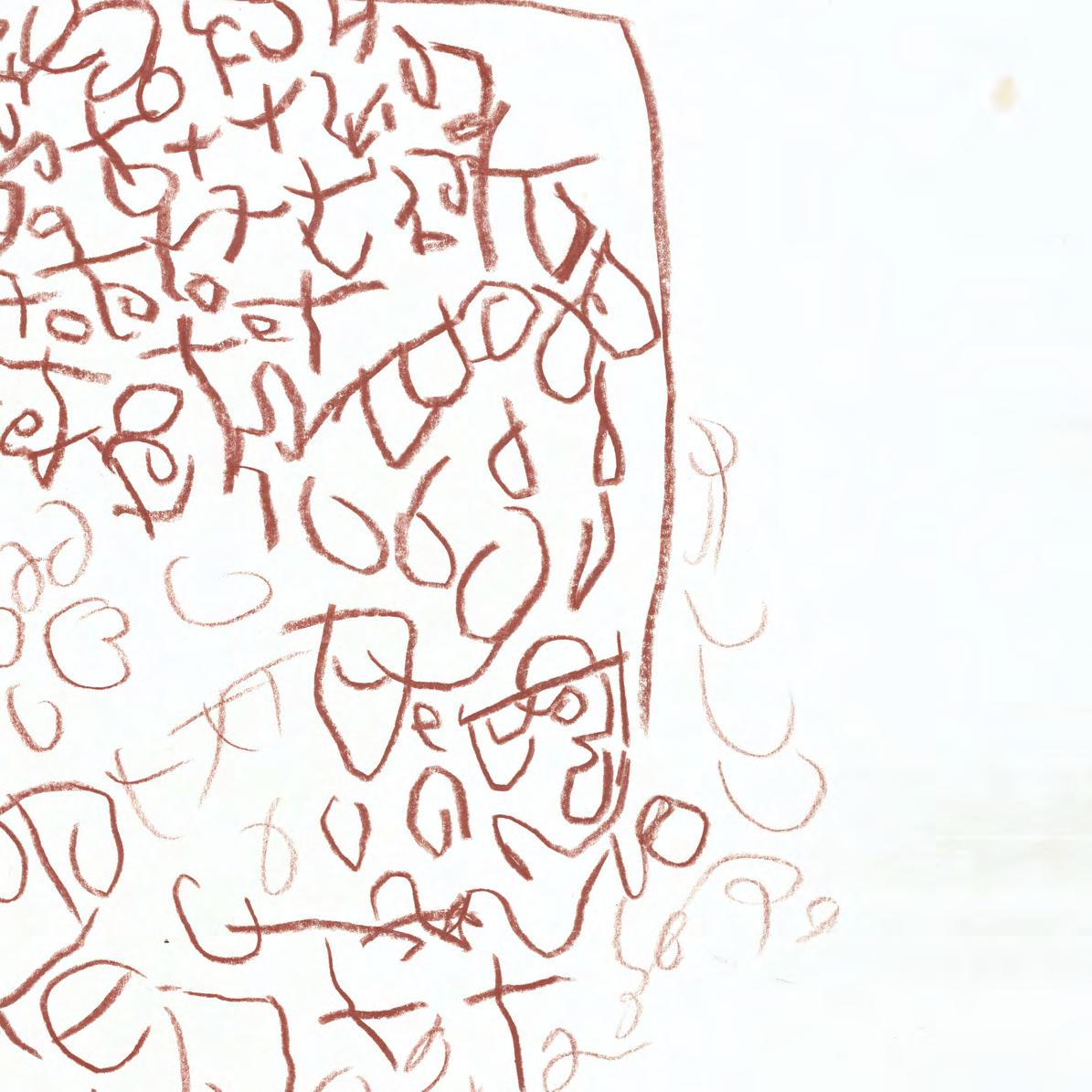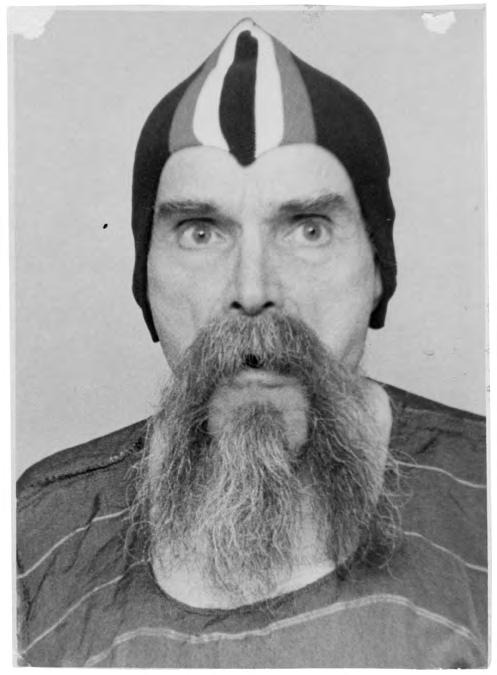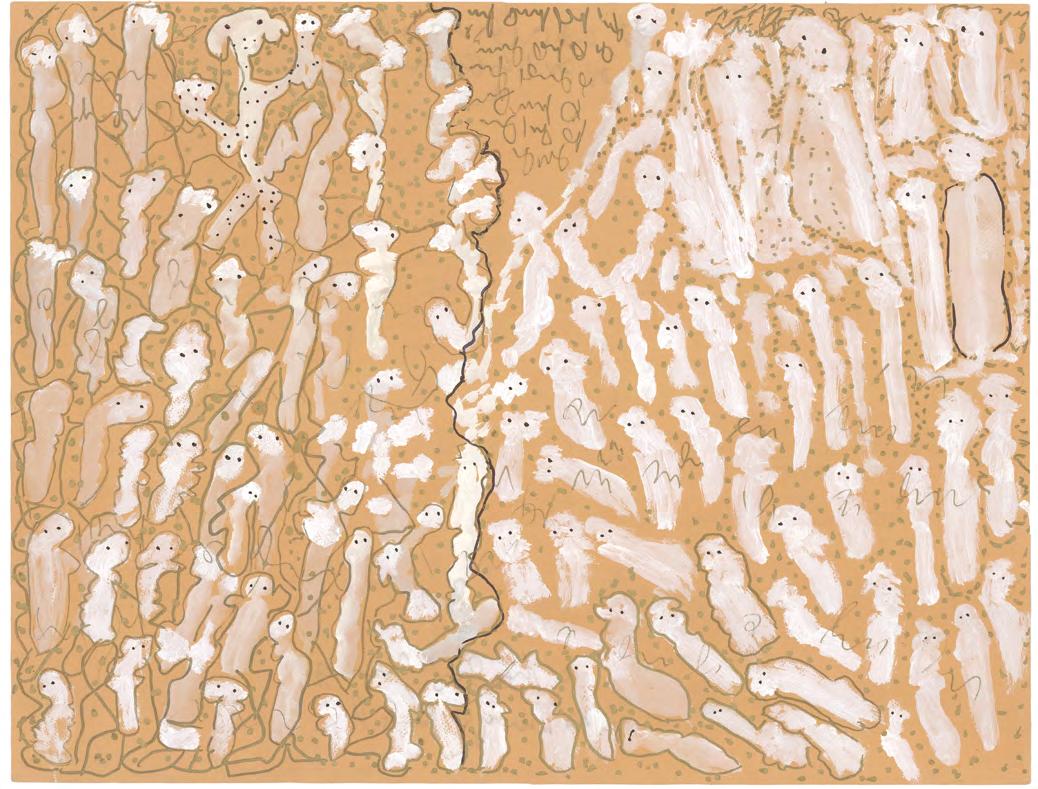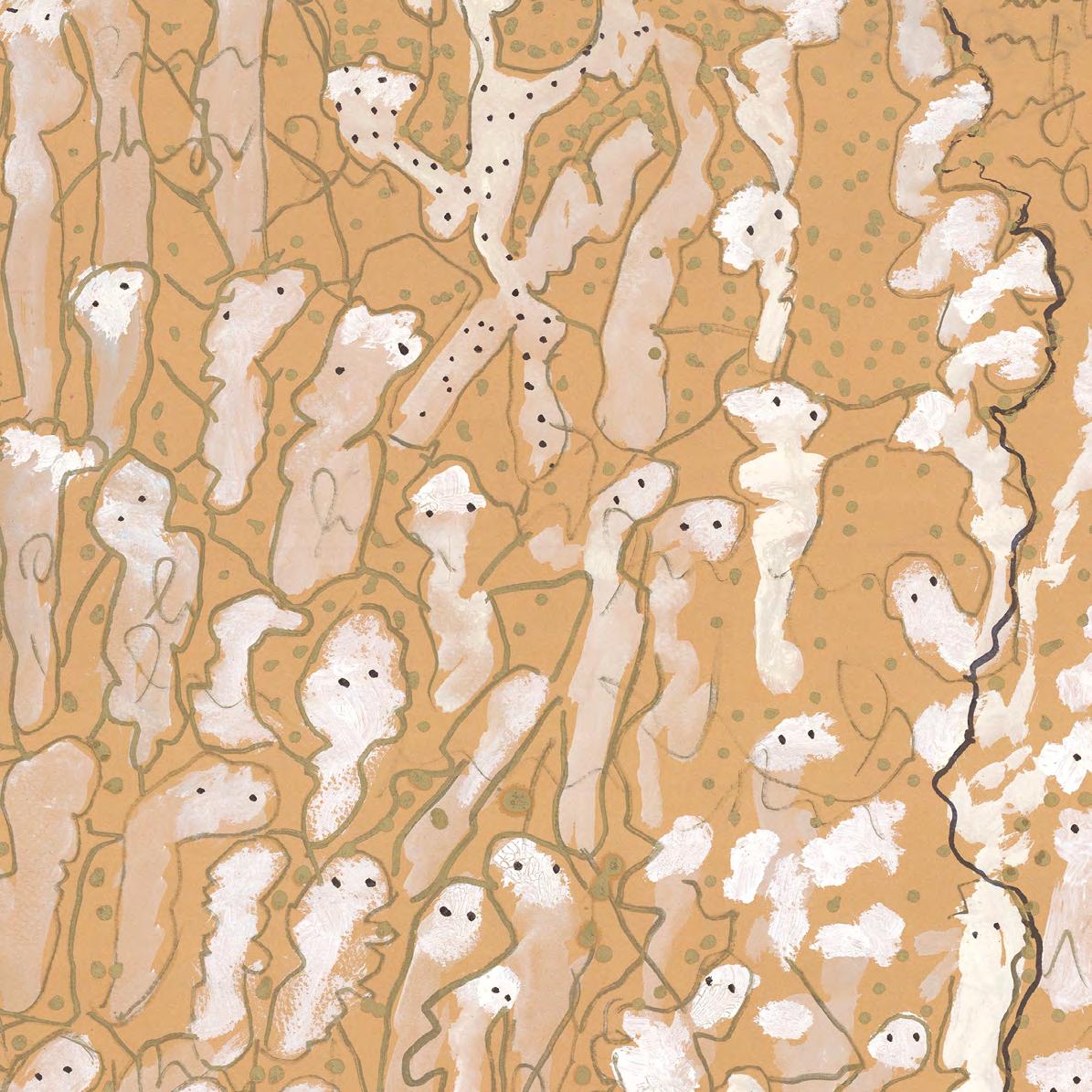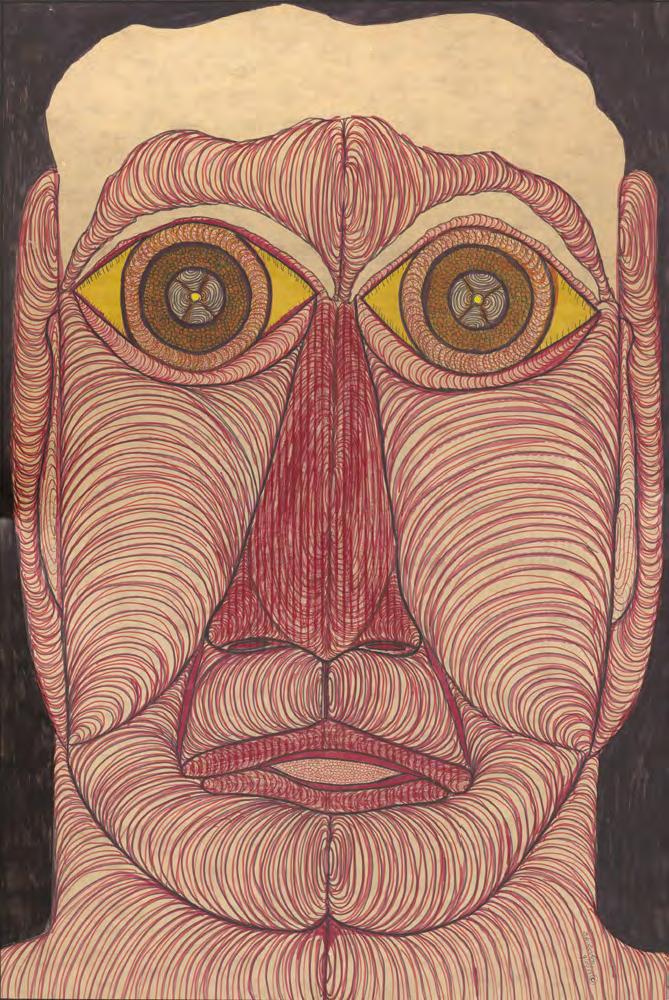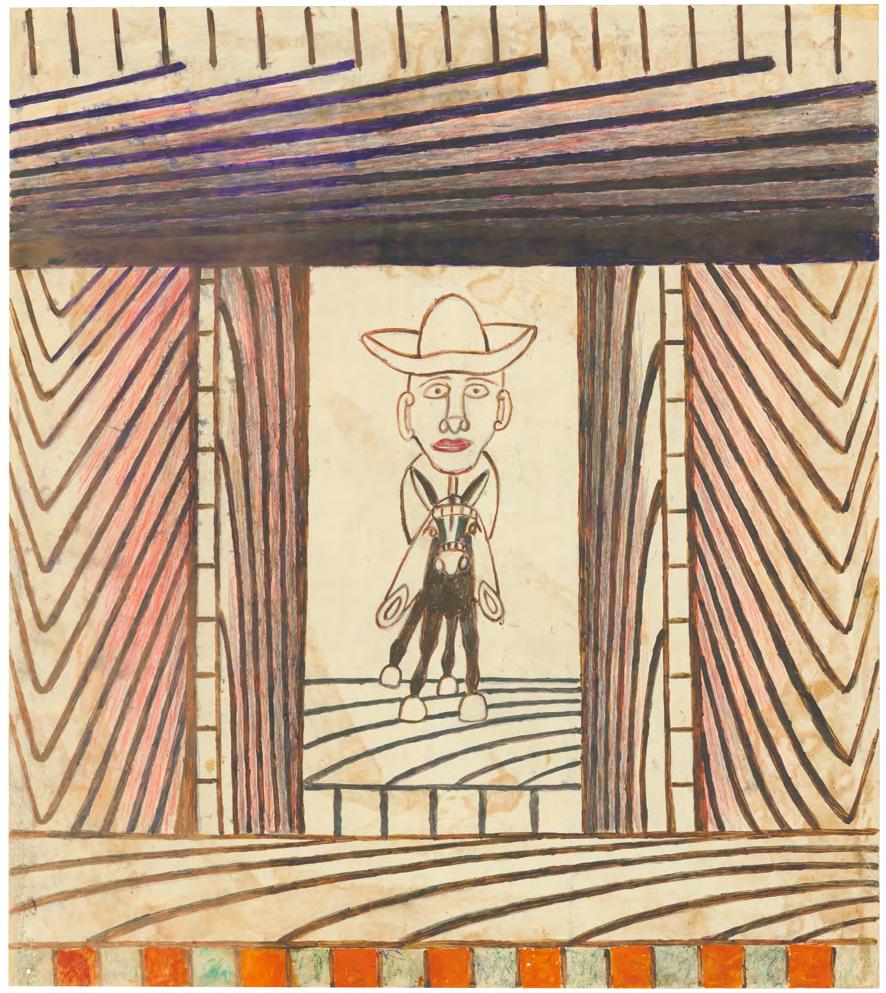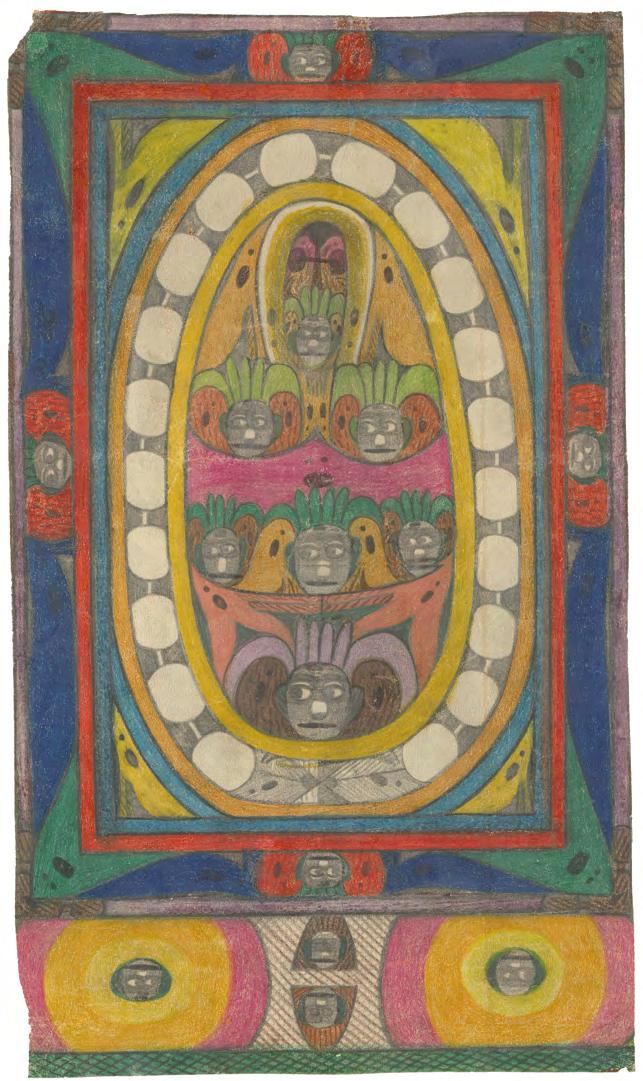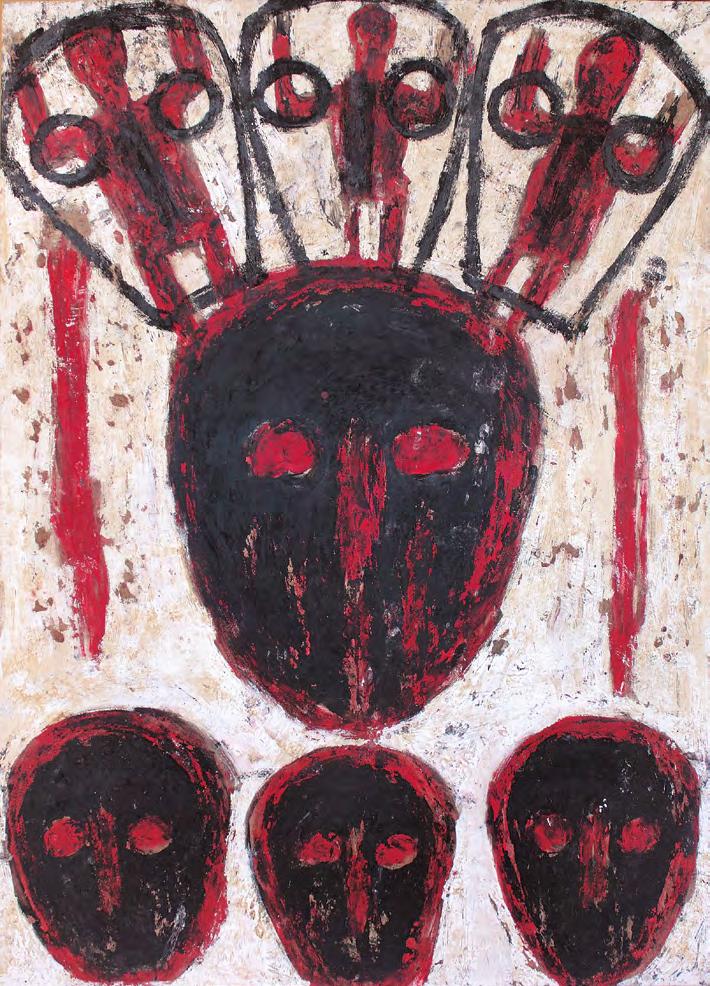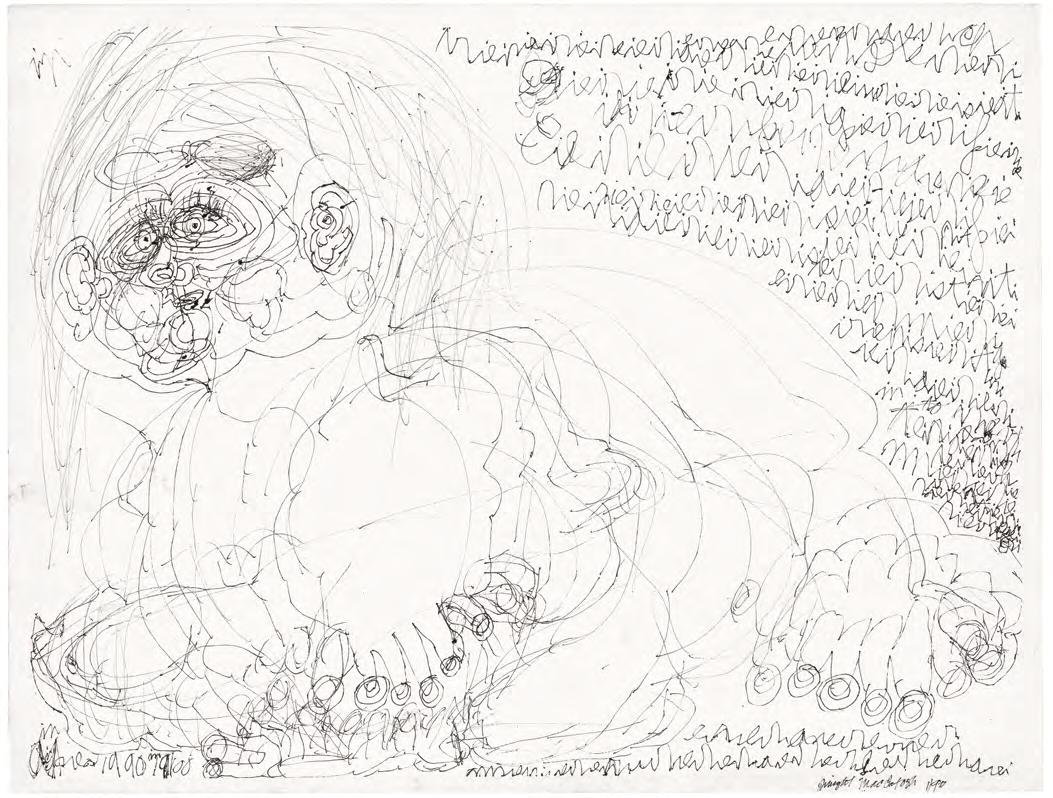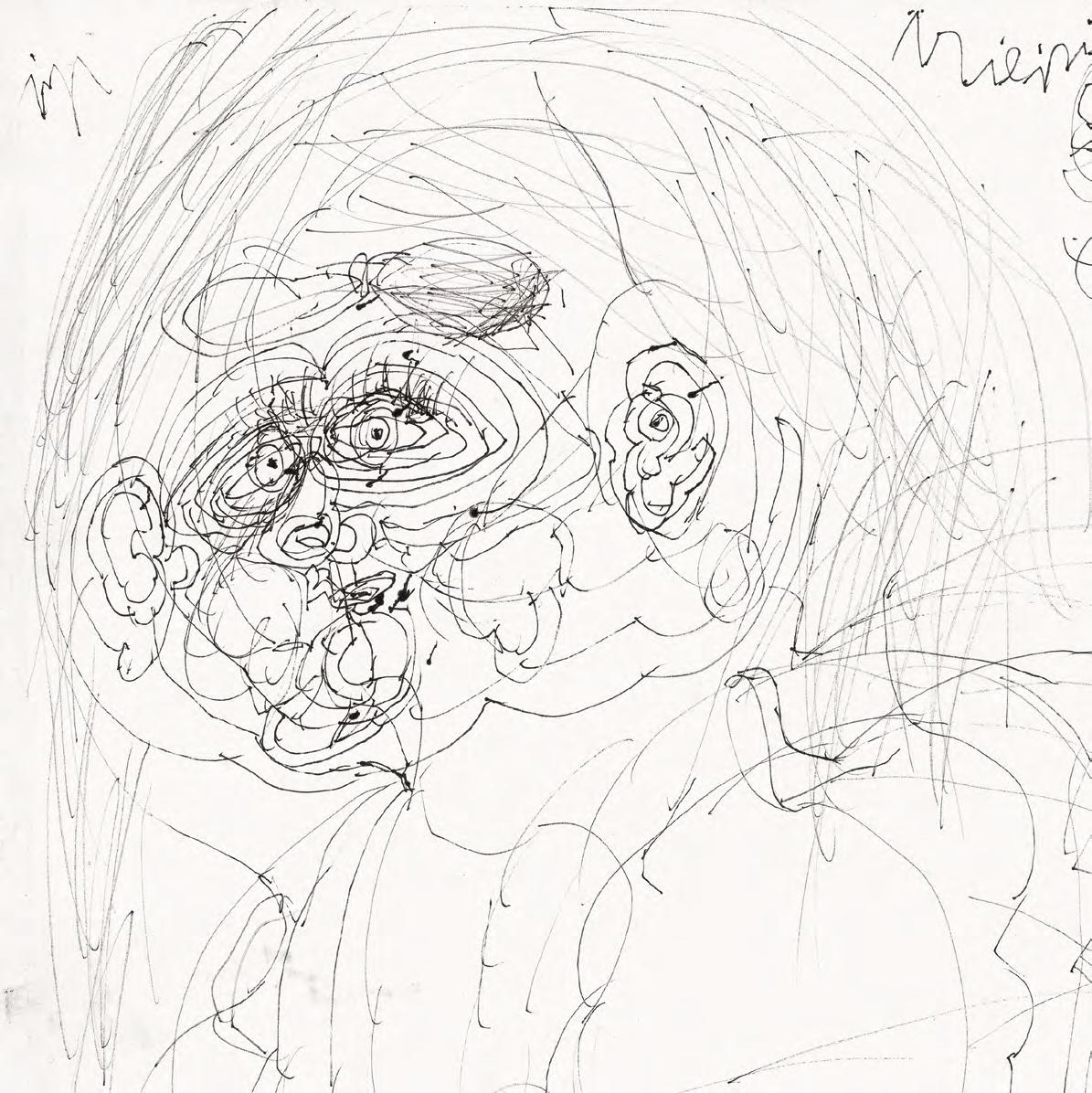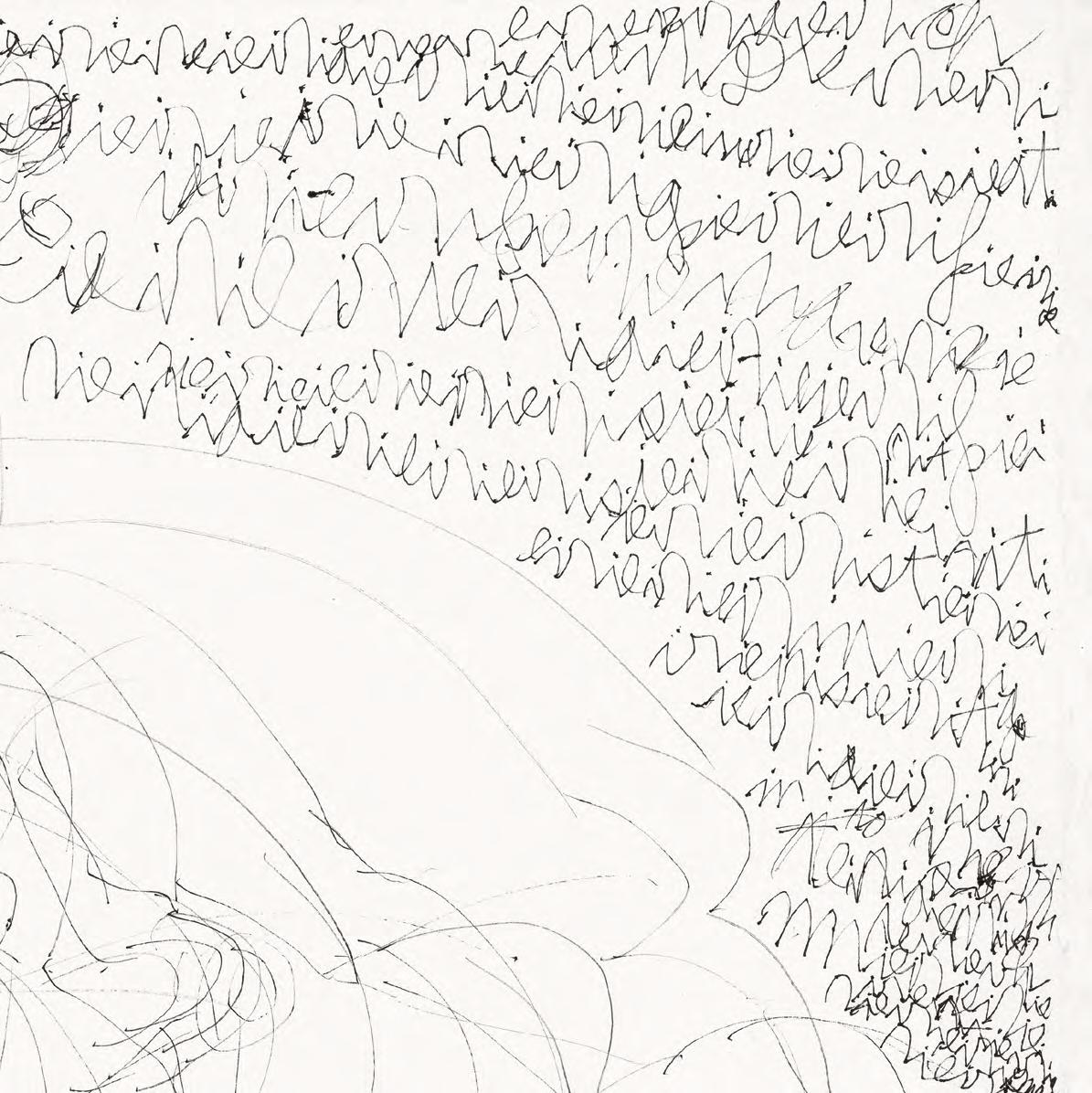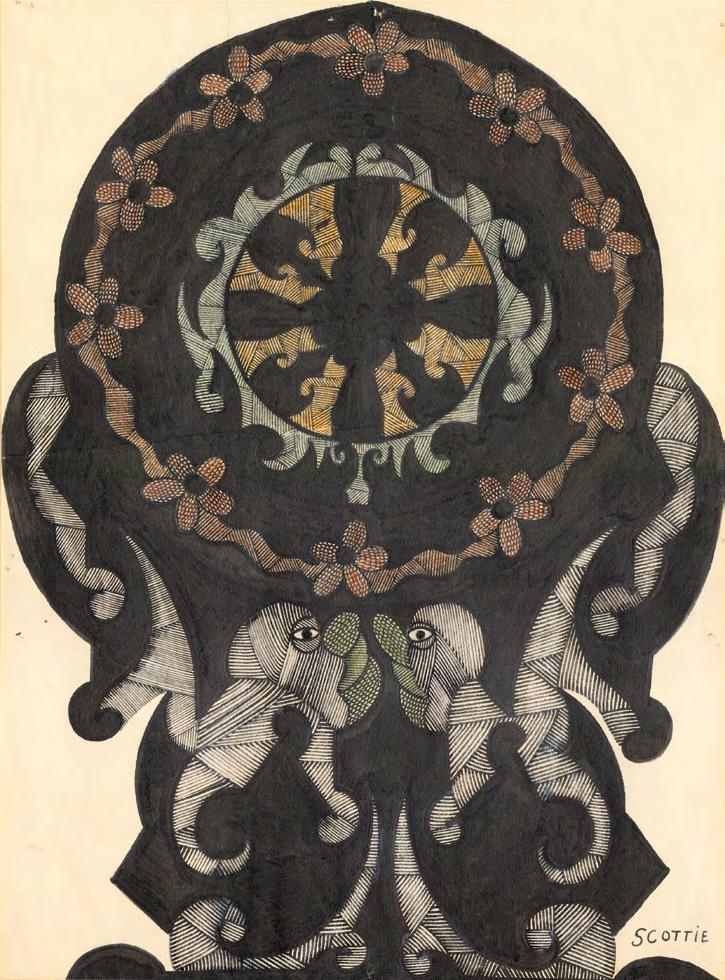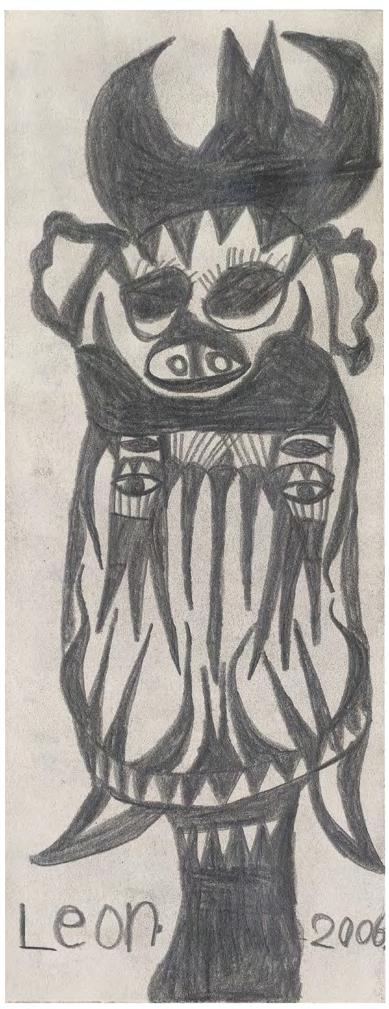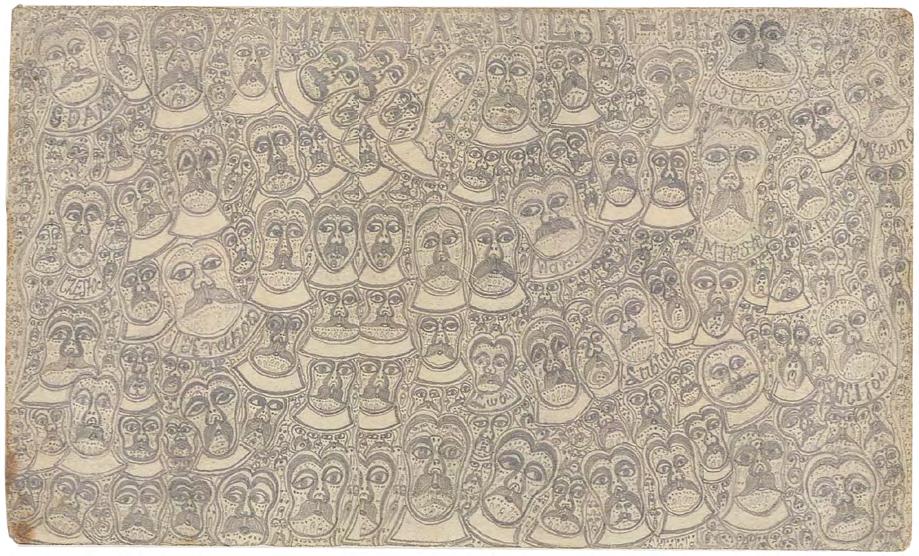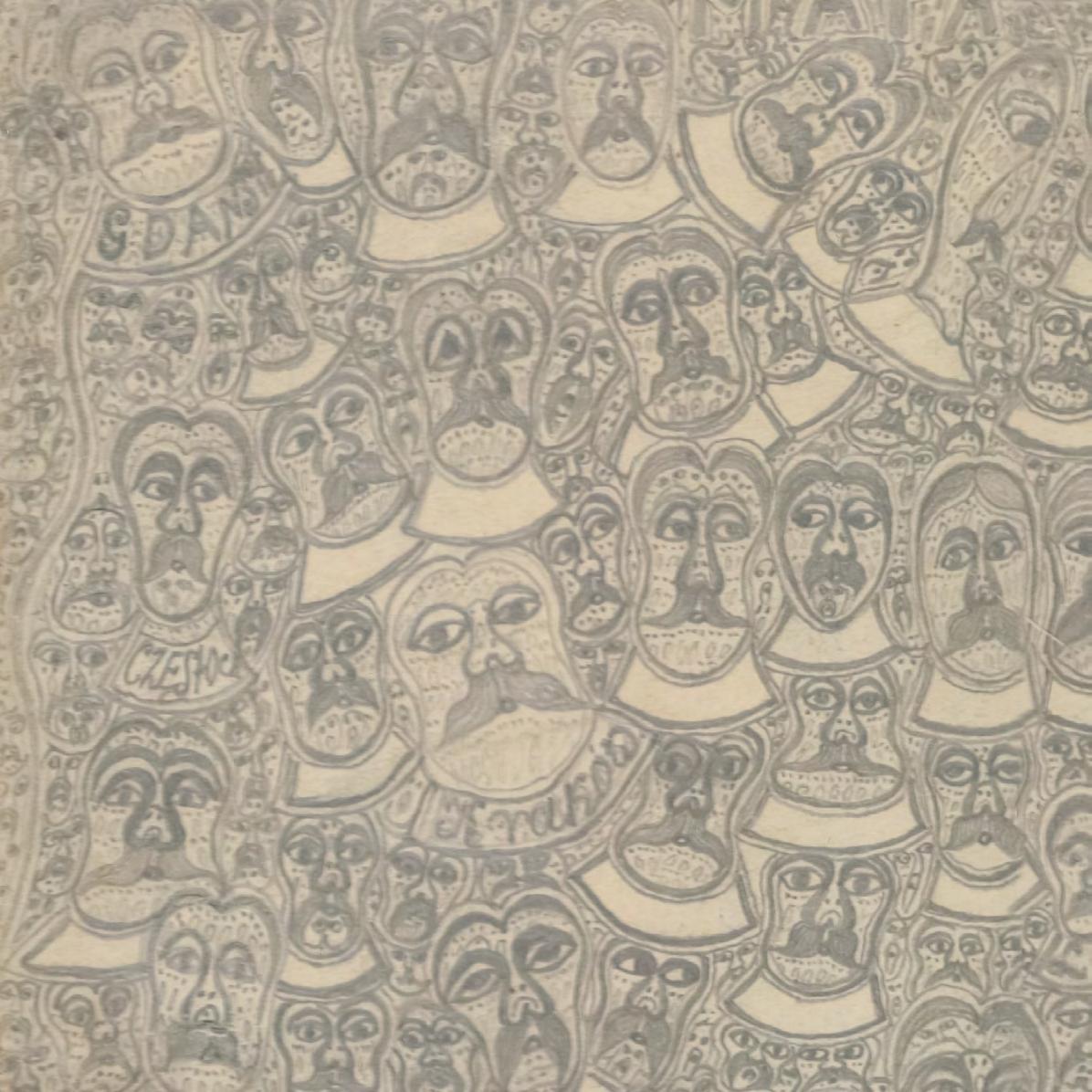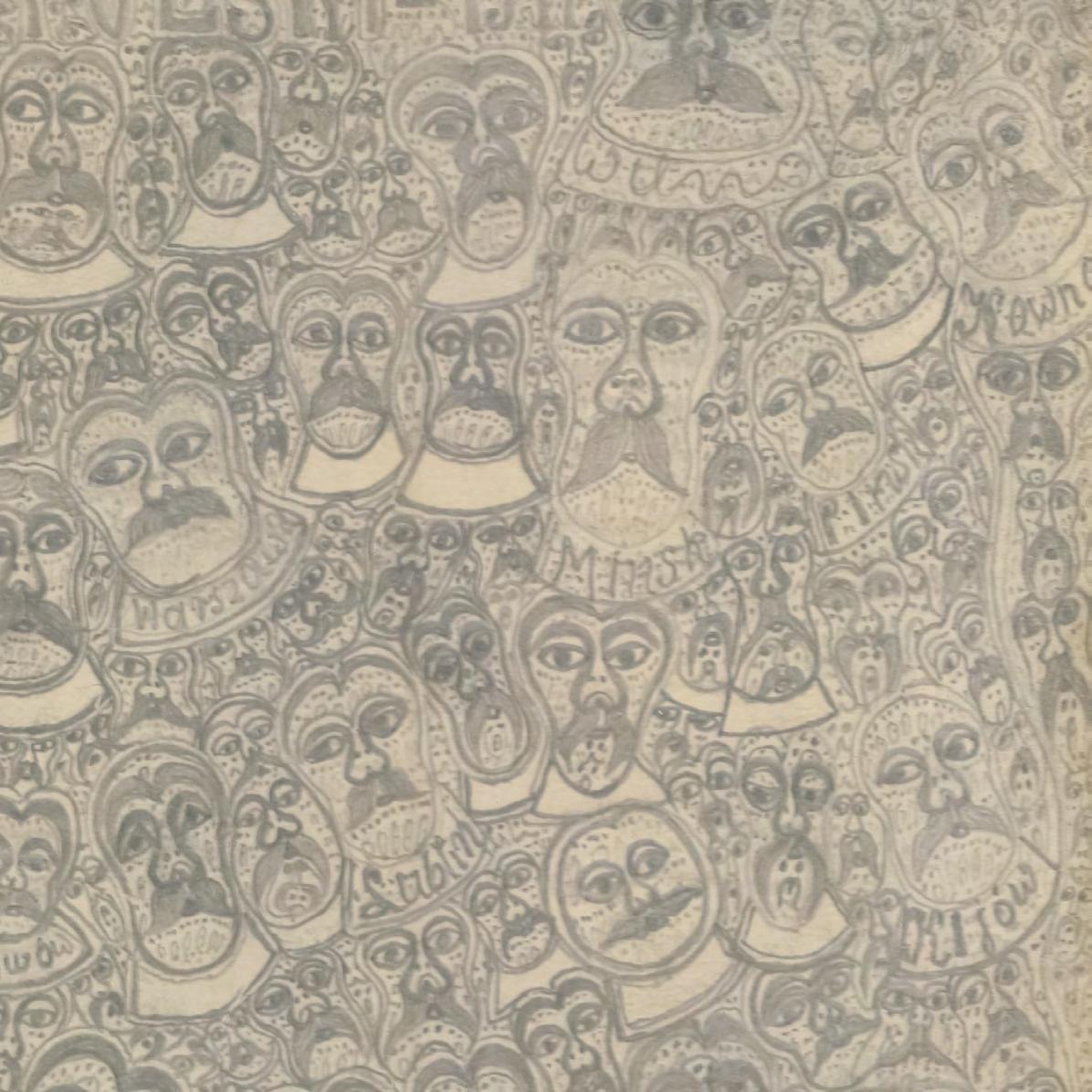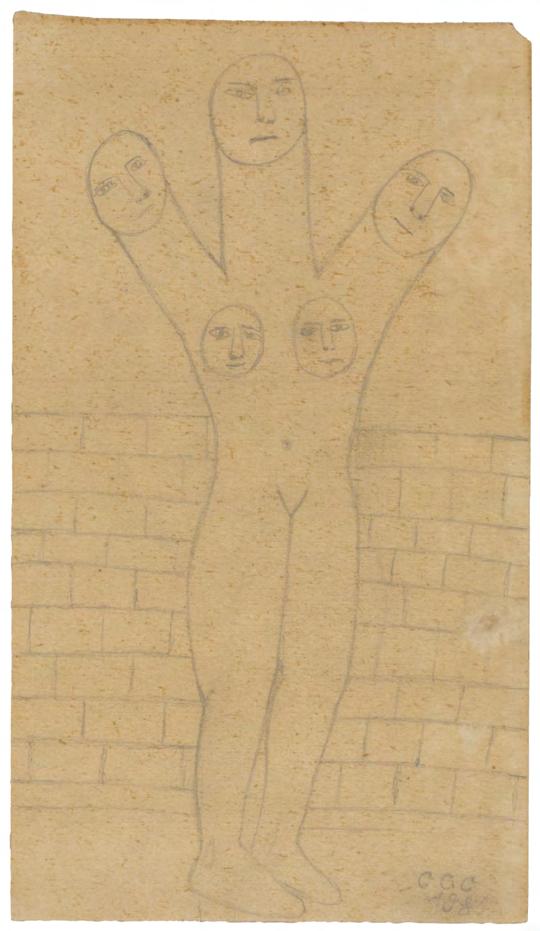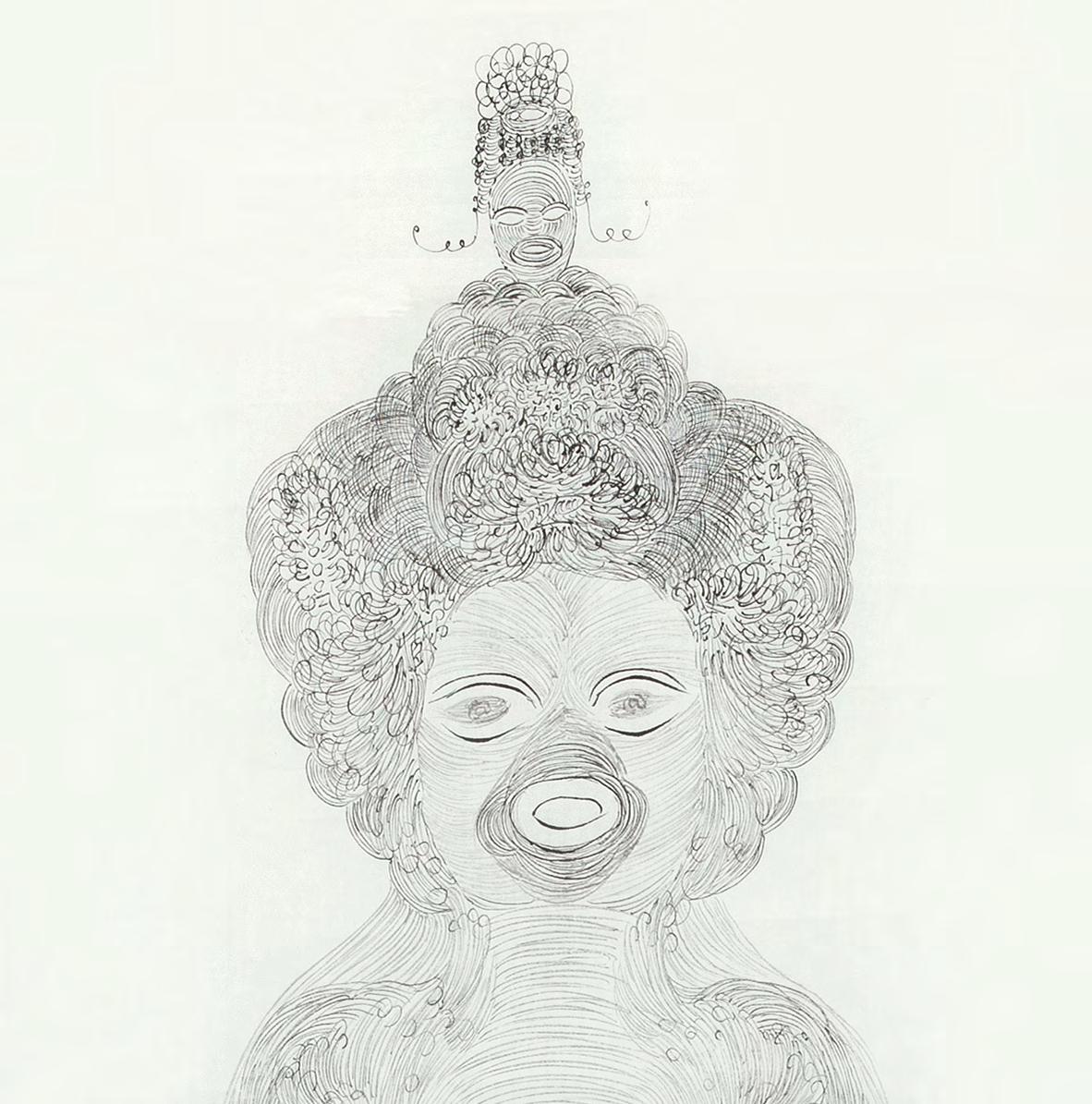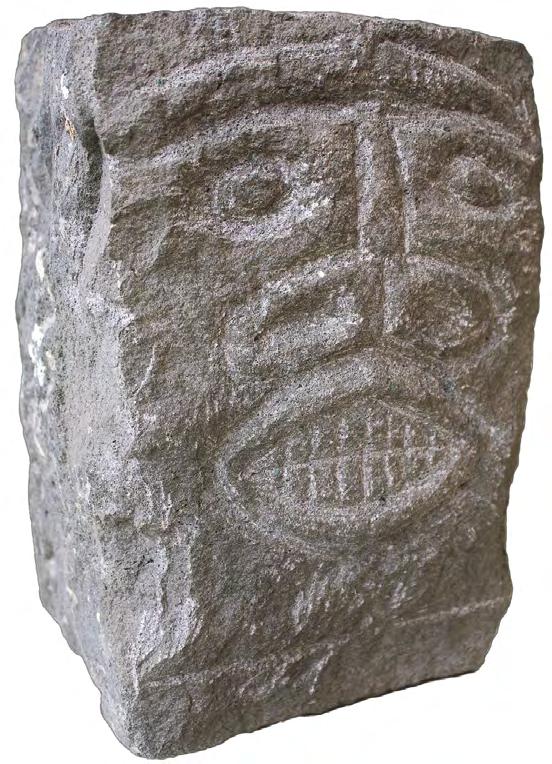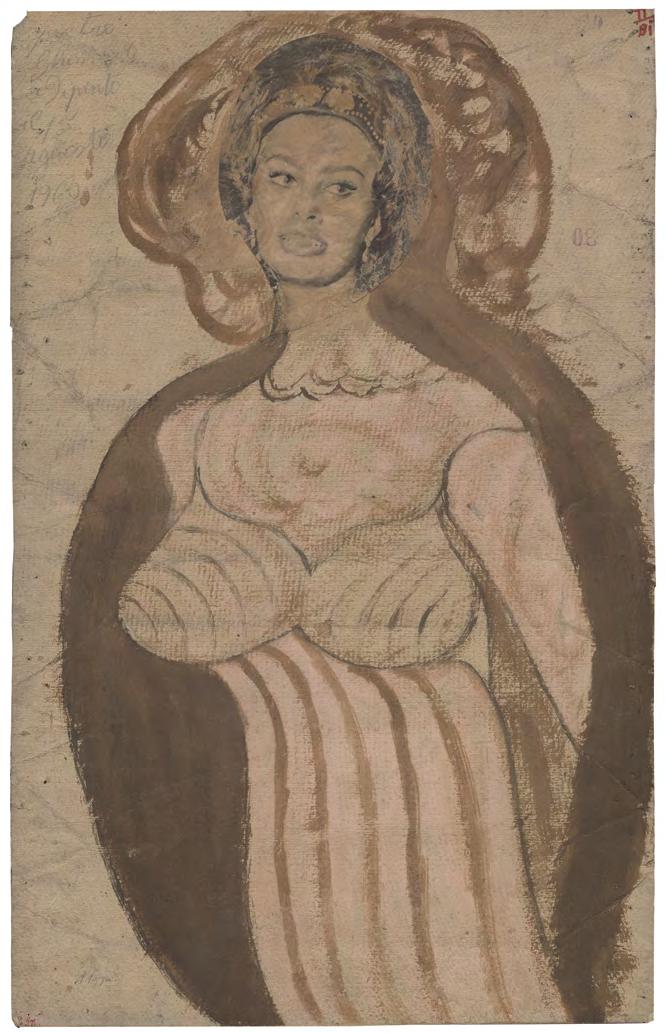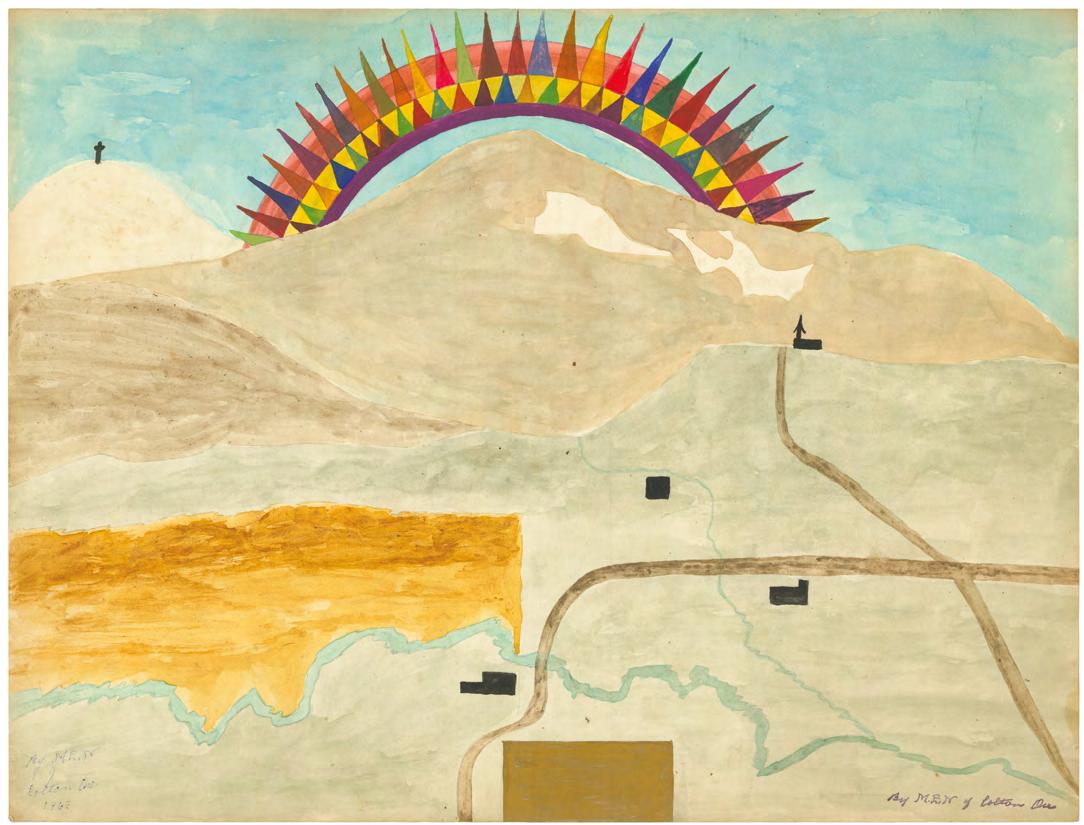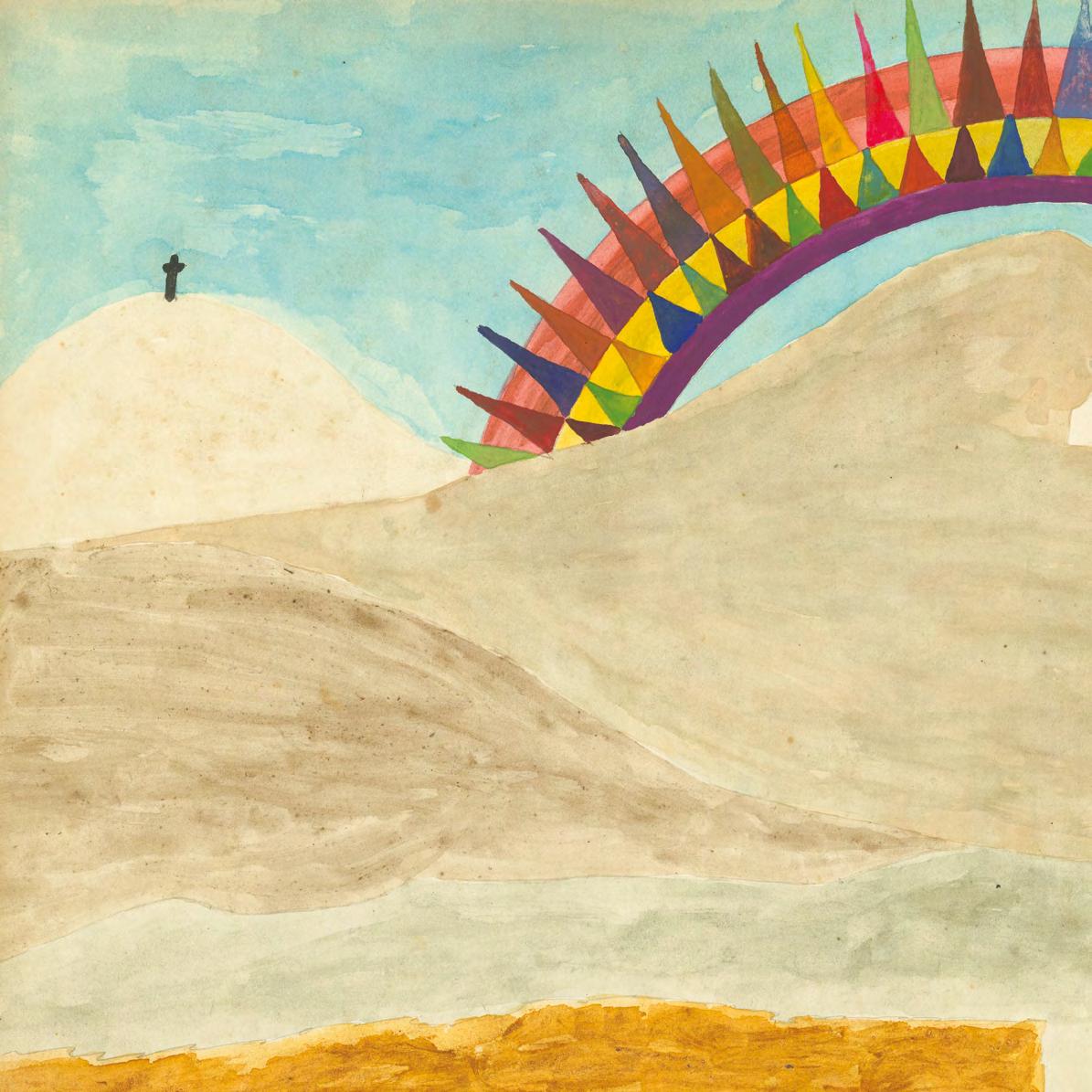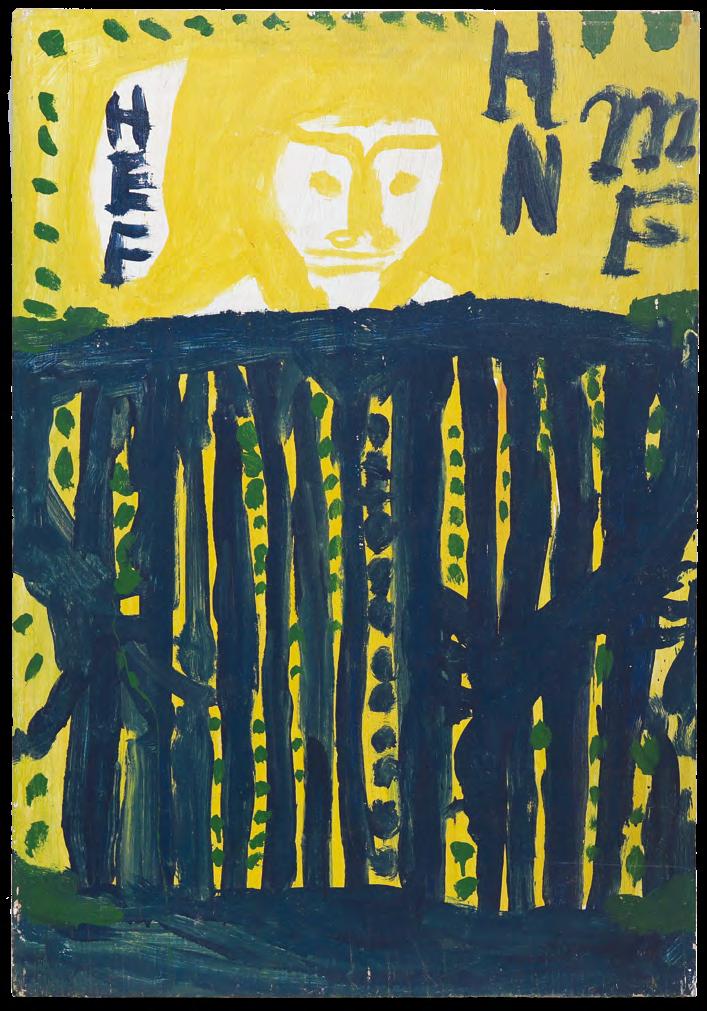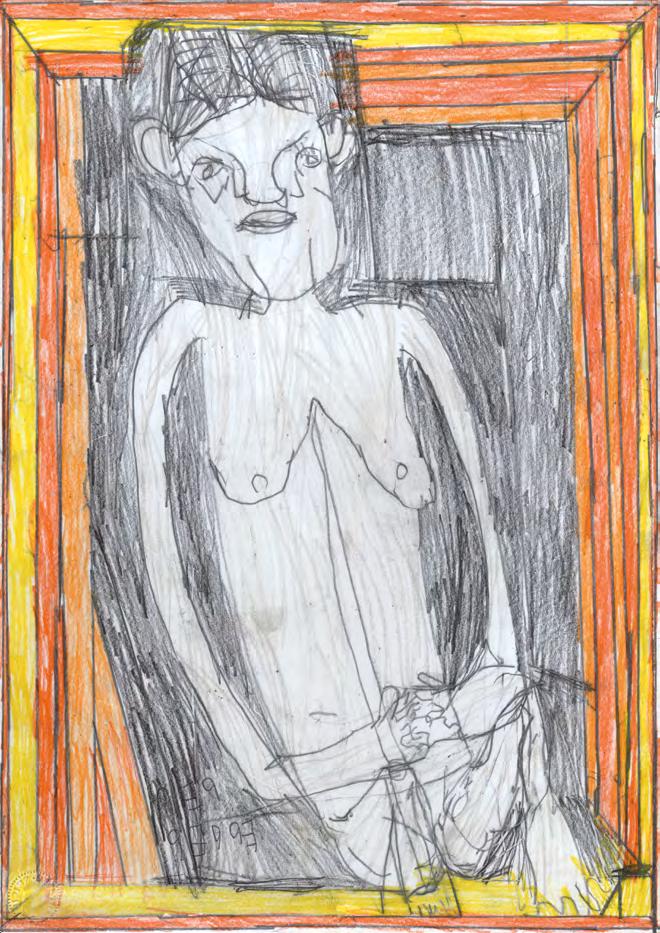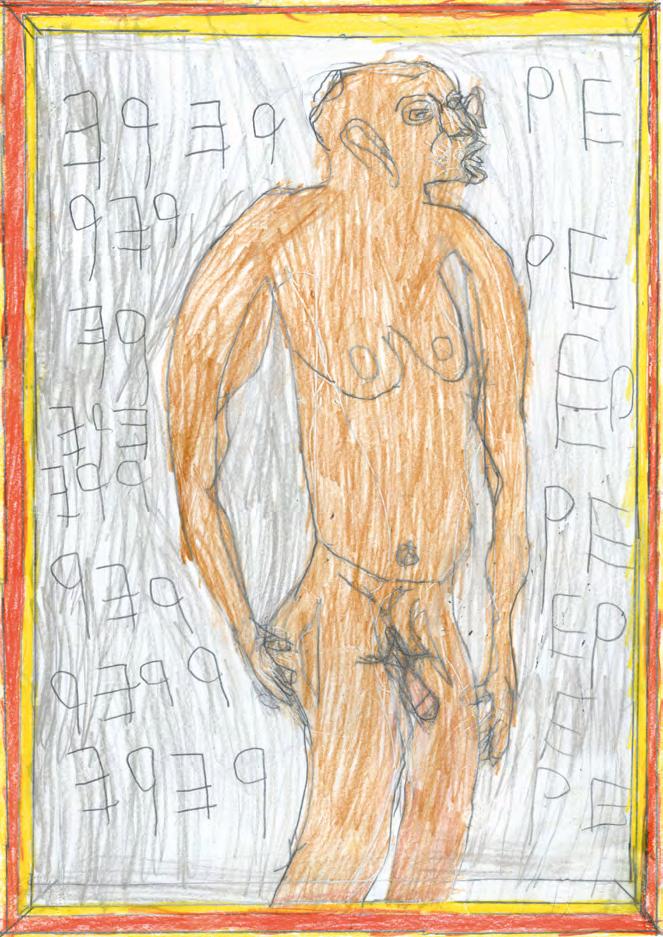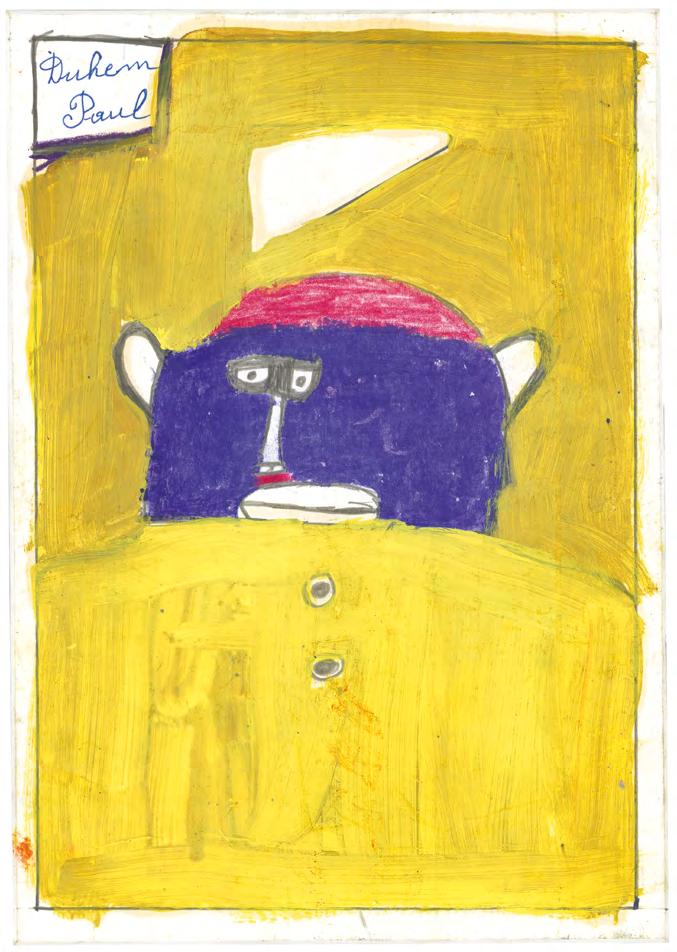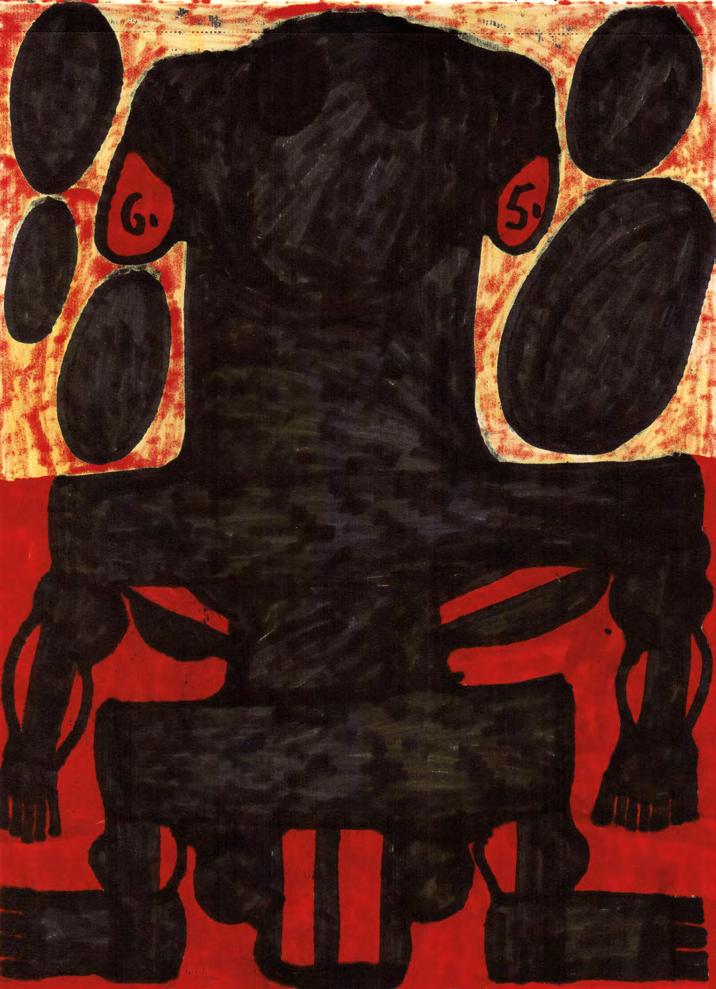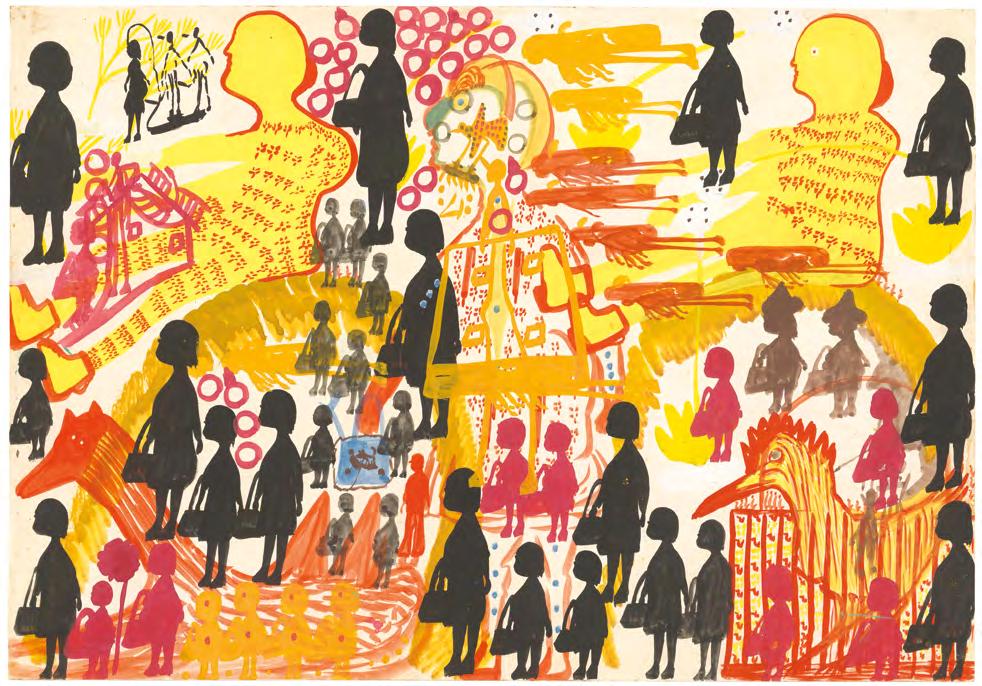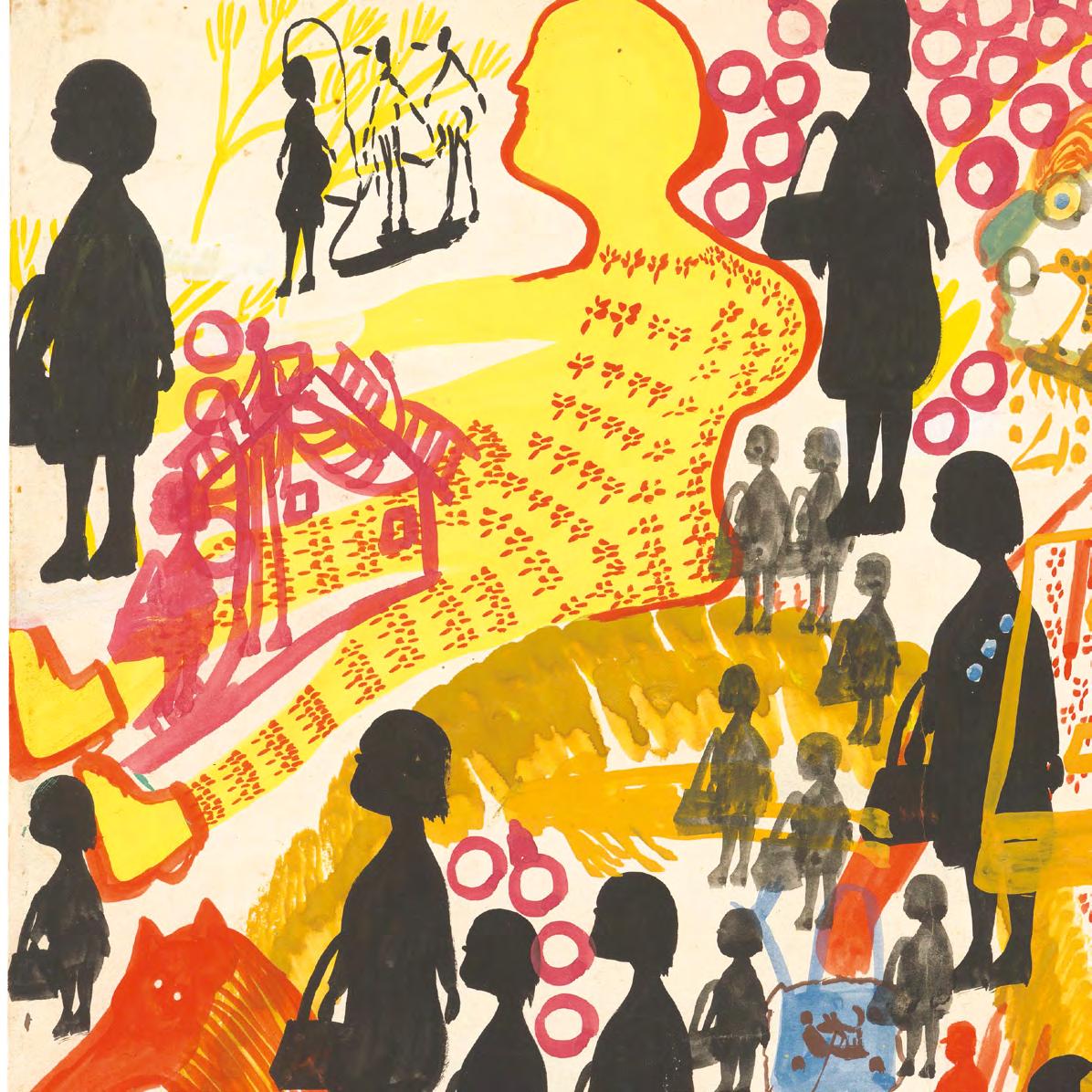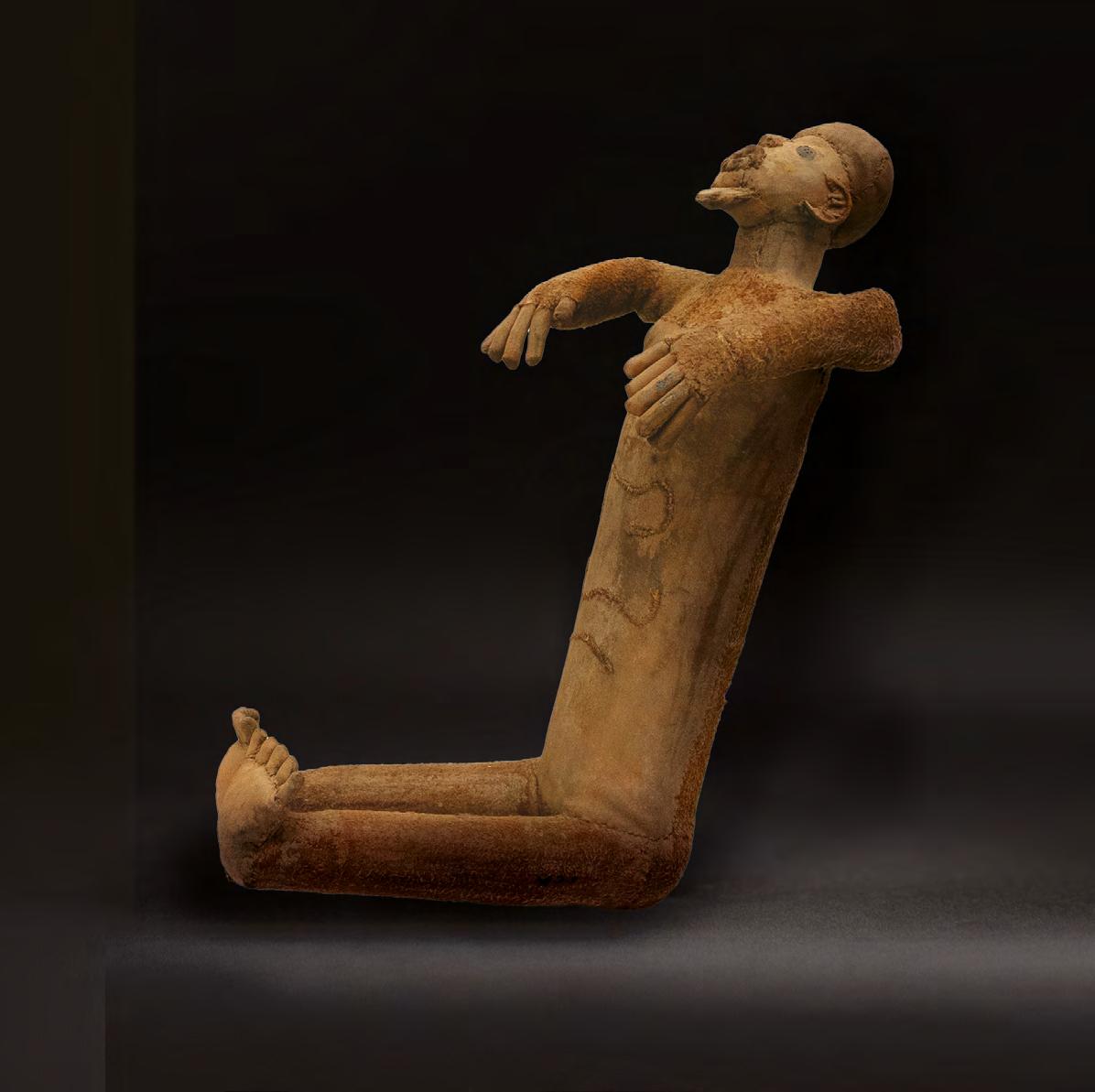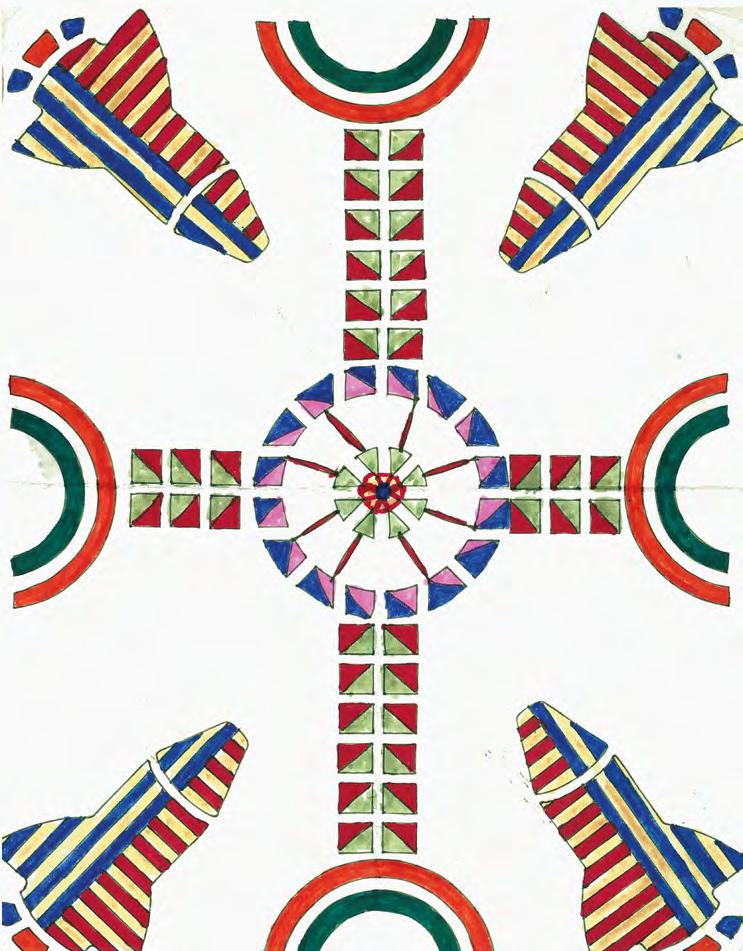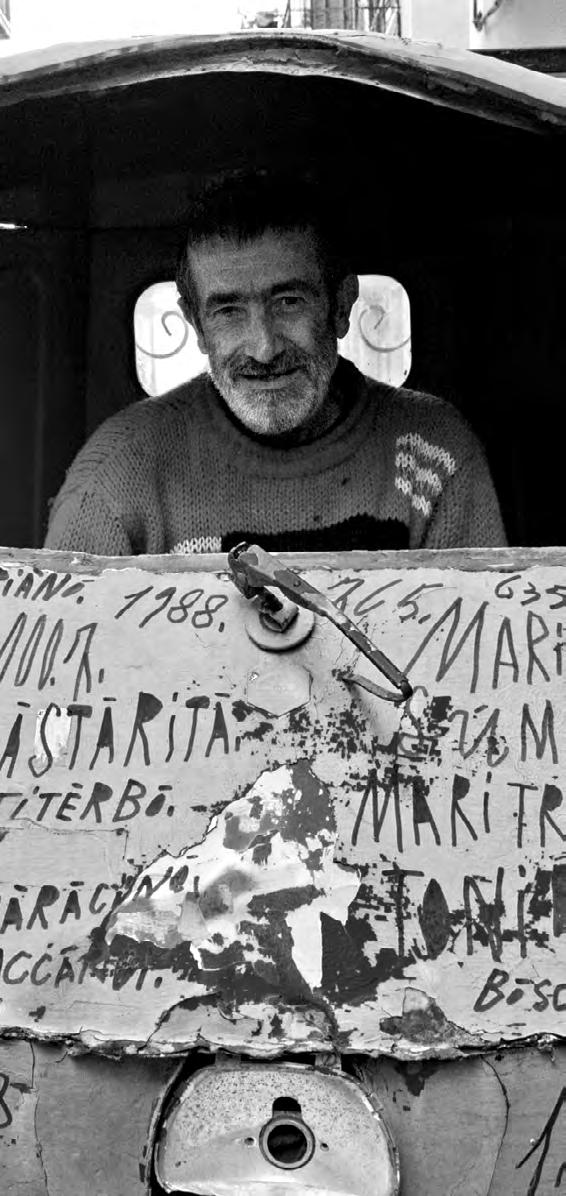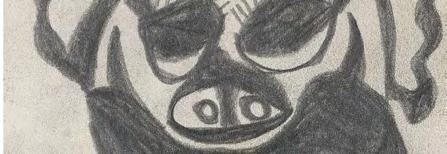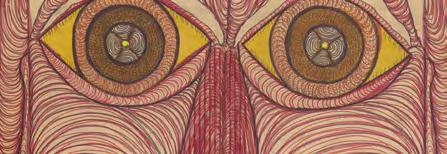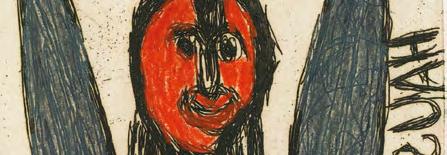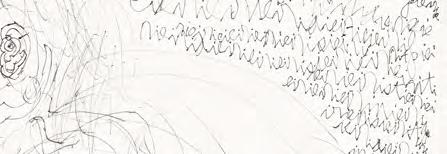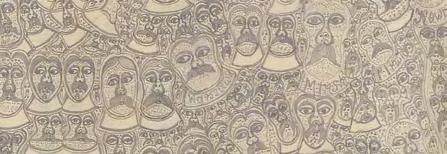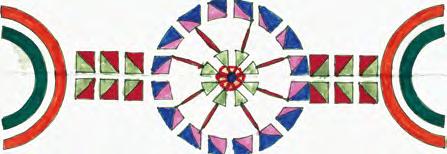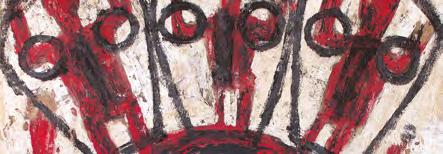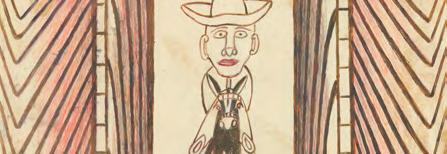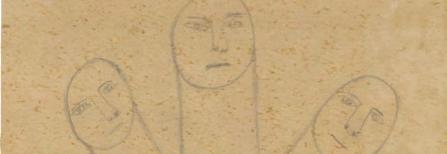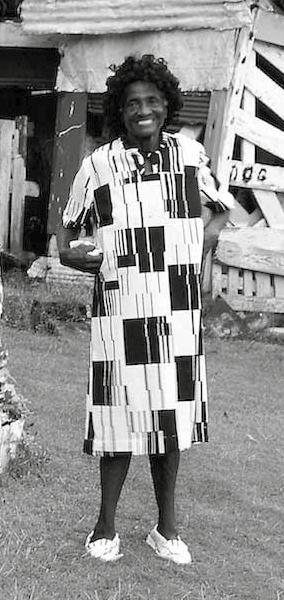christian berst avant-propos
Il n’est pas rare que les gens confondent les termes d’art brut et d’art premier. J’y vois deux raisons principales : l’une tient aux qualificatifs brut et premier, qui semblent signaler que nous sommes en présence de productions originelles, à l’état natif. La seconde tient au fait que ces arts induisent un décentrement du regard occidental et invitent à prendre en compte une altérité souveraine, qu’elle soit culturelle ou intime.
L’art brut comme l’art premier ont en commun de se situer à la marge des normes et de l’académie. Bien que l’institutionnalisation de l’art premier ait près d’un siècle d’avance sur celle de l’art brut, les « ailleurs » que ces champs mettent en lumière nous obligent à élargir l’horizon de l’histoire de l’art et, par conséquent, à reconsidérer la définition même de l’art.
Bien sûr, là où l’art premier témoigne de mythologies collectives - ce que souligne l’anonymat de ces artistes -, l’art brut rend visibles des mythologies individuelles - ce qui est mis en relief par l’insularité de ces auteurs. Et s’il se peut que certaines parentés visibles ne soient que fortuites, les analogies formelles sont en revanche nombreuses qui trahissent un terreau commun, qui laissent deviner une source archétypique semblable. Les artistes du XXe siècle ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, collectionnant les uns comme les autres avec l’impression diffuse de revenir à un stade édénique de l’art.
Il est en tout cas notable que l’art brut comme l’art premier paraissent procéder de la même quête de réponses aux grands enjeux existentiels. Ces créateurs attribuent à l’art le pouvoir « d’habiter le monde », de le réparer, de construire des passerelles vers l’inconnu, le surnaturel, le sublime. « Premiers » et « bruts » exaltent la notion de secret et de sacré, c’est pourquoi ces œuvres nous paraissent profondément habitées. Habitées par les esprits pour les uns et par leurs auteurs pour les autres.
Les 20 ans de la galerie, plus qu’une occasion de célébrer, m’ont encouragé à vouloir confier ce commissariat à Daniel Klein et Antoine Frérot, deux très chers amis collectionneurs - en plus d’être des soutiens historiques de la galerie. L’un comme l’autre animés de la volonté de décloisonner les catégories, l’un comme l’autre nourrissant au sein même de leurs collections ces dialogues et ces confrontations, comme des révélateurs édifiants auxquels je suis moimême si attaché.
entretien
daniel klein, antoine frérot & christian berst
Daniel Klein, collectionneur passionné, s’est d’abord intéressé à l’art populaire équatorien et aux arts premiers. En 2010, avec son épouse Carmen Viteri, il fonde La Casa del Alabado, installée dans l’une des plus anciennes demeures coloniales du centre historique de Quito. Ce musée accueille leur collection privée d’art précolombien, riche de plus de 5 000 œuvres. Restés fidèles à leur intérêt pour les arts premiers mais aussi à l’art contemporain, le couple a surtout constitué depuis 20 ans une collection d'art brut de tout premier plan et a permis de découvrir de nombreux artistes sur le continent sud-américain, aujourd'hui représentés par la galerie.
Antoine Frérot s’est fait connaître comme dirigeant de Veolia, mais aussi comme collectionneur averti. Sa passion l’a d’abord conduit vers l’art moderne, avant qu’il ne se tourne également vers les arts premiers. En 2014, il est nommé président d’honneur de la 13e édition du Parcours des mondes, principal salon international des arts premiers. La même année, la découverte de l’art brut à l’occasion de l’exposition qui lui était consacré à la Maison Rouge constitue pour lui une véritable révélation. Cette rencontre le submerge au point que l’art brut occupe désormais une place centrale dans sa vie de collectionneur. Depuis, il a réuni plusieurs centaines d’œuvres et cherche à identifier ce que cette passion lui révèle sur sa perception du monde et sur lui-même. En 2025, il a rejoint le conseil d’administration de la Halle Saint-Pierre.
Daniel Klein comme Antoine Frérot sont partenaires de la galerie.
J'aimerais que chacun me raconte comment il s'est mis à collectionner l'art premier, et puis l'art brut, dans quel ordre et s'il parvient à en définir les raisons.
— antoine frérot
Je ne sais pas si j'arriverai à en définir les raisons, mais je suis venu à l’art premier à partir de l’art moderne, car c'est vraiment la peinture moderne qui m'attirait depuis que j'étais jeune.
J'ai même commencé à m'acheter des œuvres avec ma première solde de service militaire.
C’était une petite gouache, en Allemagne, je m’en souviens très bien. Et puis la rencontre de l'art premier, d’un seul coup, m’a fait un flash. On sait bien le lien qui existe entre l'art premier et l'art moderne et les deux se mêlaient, jusqu’à une nuit d'insomnie. J’en fais de temps en temps. Je me lève, je fume une cigarette, je bois un verre d'eau avant de me recoucher. Et là, je me suis surpris à parler avec une sculpture d'art premier. Je n'avais jamais parlé à un tableau. Bon, ça m'a fait un petit peu peur.
C’était dans un demi-sommeil. Et je me suis demandé pourquoi ? Pourquoi y avait-il une différence entre les deux ? En fait, j’ai compris que ce qui m'attirait dans l'art moderne, c'était surtout la forme. Et j'avais tort de penser que c'était ça qui m'attirait, mais c'est le fait que les œuvres soient habitées, et la forme vient en second rideau. Elle masque le côté habité de l'œuvre, alors que pour l’art premier, c'était plus frappant. Et un jour, j'ai rencontré l'art brut, et là aussi, immédiatement, le côté habité des œuvres m'a frappé, m'a sauté à la figure.
Très rapidement, l’art brut est venu en partie remplacer mon attrait pour l'art moderne et l’art premier. C'est comme ça que j'ai commencé à collectionner de l'art brut. Et progressivement, je n'ai presque plus collectionné que ça. (Au point d'ailleurs de juxtaposer des œuvres d'art brut avec des œuvres d'art moderne ou contemporaines.)
Et très rapidement, je me suis aperçu que l’art brut écrasait complètement lesdites œuvres modernes ou contemporaines – que j'ai d’ailleurs parfois revendues. Et j'ai revendu aussi un peu d'art premier lorsque la juxtaposition me faisait la même impression, c’est-à-dire la différence d'intensité, de profondeur.
On pourra revenir sur cet aspect particulier, c'est-à-dire à la fois les spécificités de l'un et de l'autre.
Là, j'ai envie d'entendre Daniel sur la manière dont il a commencé à collectionner l'art premier et puis comment il en est venu ensuite à l'art brut et comment les choses peut-être entrent en dialogue.
— daniel klein
Comme Antoine, j'étais attiré depuis ma tendre enfance par l'art. J'ai des souvenirs de moi en train de dessiner, de regarder des livres. J'avais cette sensibilité, alors que mes parents n'avaient aucun intérêt pour l'art. Adolescent, j'avais développé un intérêt important pour les expressionnistes abstraits américains, pour l'art abstrait en général. J'étais fasciné par ce qu'ils faisaient, par leur énergie, par tout ce
monde. Quand je suis arrivé en Équateur j'ai eu la chance d'épouser la fille d'un artiste important et grand collectionneur. Je pense que ça a été un facteur qui a déclenché un intérêt pour les arts populaires. Avec mon épouse, on a commencé à collectionner l'art populaire équatorien et puis ensuite l'art précolombien et, après l'art précolombien, les arts premiers. Puis je me suis concentré pendant de longues années sur l'art du Congo. C'est ce que je trouvais le plus habité aussi. Et puis je suis tombé par hasard sur l'art brut et on a commencé à le collectionner.
En fin de compte, je pense que c'est tout à fait une démarche esthétique. Une même expression plastique qui sort dans l'art populaire, l'art précolombien, les arts premiers, etc. Il s’agit de dessins ou d'objets habités, comme disait Antoine. J'ai exactement la même sensation.
Puisque nous sommes sur le terrain de l’émotion et de la réception, pourriezvous préciser, chacun, dans quel ordre les choses vous parviennent et comment elles agissent sur vous ? Est-ce d’abord la forme de l’objet qui s’impose, ou bien ce qu’il dissimule mais que l’on sent pourtant présent ? Quelle est la part de l’univers visible, de la forme sensible, et celle d’une présence invisible mais perceptible, capable de toucher et même d’ébranler ?
— antoine frérot
Je pense que la forme, c'est ce qui frappe au premier abord, c'est la surface de l'œuvre, mais je pense qu'elle ne fait que refléter une puissance supérieure, et elle n'est là que pour l'illustrer. Et alors, pour revenir sur l'ordre : art moderne, puis art premier, puis art brut, je pense
que ces types d'œuvres sont de plus en plus éloignées de la culture dans laquelle j'ai grandi, ma civilisation. Mes parents n'étaient pas très art moderne, ils s’intéressaient à l’art classique et l'art moderne avait déjà un côté hors du cadre dans lequel j'étais éduqué.
Donc je suppose que c'est cette distance qui m'a attiré dans l'art moderne. Et l'art premier est encore plus distant de cette culture et je pense que l’art brut est encore plus distant que l’art premier parce que l’art premier a quand même imprégné un peu l’art moderne et puis un petit peu notre civilisation culturelle, notre vision culturelle.
Je pense que l'éloignement du bain dans lequel j'ai grandi et d'où venaient ces créations est sans doute la raison de mon attrait. Plus c’est éloigné, plus c'est alter, plus c'est surprenant ou choquant, plus ça me donne l'impression de l'existence d'un autre monde. Et quand je dis « habité », c'est ça que ça veut dire, je crois. Il y a curieusement un autre monde, donc il y a des habitants dans cet autre un monde et des habitants que je ne connais pas puisque c’est un monde que je ne connais pas.
Alors le mot « habité », il est un peu galvaudé, quand même. On peut parler d'intensité, mais c'est certainement le fait qu’un autre univers se découvre à moi, qui n'était pas le mien et qui m'attire et que j'ai envie d’agglomérer à ma conscience, à ma raison. Donc avec des morceaux qui ne m'étaient pas conscients, que j'ai envie d'intégrer à ma conscience progressivement et donc élargir celle-ci hors des mondes initiaux dans lesquels j'ai grandi.
C'est un peu l'étymologie de comprendre, d'une certaine manière.
— a. f.
Alors avec le fait que maintenant le mot comprendre a un sens quand même beaucoup plus restreint.
Mais initialement, c'était prendre à soi, c'est-à-dire assimiler.
— a. f.
C’est vrai, et c'est ce qui m'attire dans l’art et dans l’art brut notamment. C'est, quelque part, d'assimiler dans les deux sens, les œuvres à moi, soit rentrer les œuvres dans moi, soit moi rentrer dans ce monde qui m'était inconnu. Et donc le monde devient plus vaste, plus large, plus grand.
— daniel klein
C'est une très bonne question, que je me pose à chaque fois que je suis en face d'une œuvre qui me transmet quelque chose, et je me demande pourquoi elle me touche et pourquoi il y en a d'autres qui ne me transmettent rien. On a un certain bagage fait de tous les langages qu'on a acquis avec le temps et qui forme une certaine structure, une manière de regarder une œuvre d'art. On est formaté, évidemment.
Et il y a autre chose qui est très difficile à expliquer, car les œuvres d'art premier, ce sont en général des œuvres qui ont été manipulées, qui sont créées pour des connexions avec l'au-delà. Avec les esprits, surtout. C'est magique, c'est religieux.
Les œuvres qui me transmettent quelque chose, peut-être que pour la plupart des gens, elles ne transmettent rien. Et c'est une vraie question.
Je pense qu'il y a là un facteur de communication qui fait appel à plusieurs aspects internes
du conscient, de l'inconscient, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Dans mon cas, c’est une réaction immédiate. On peut me raconter des histoires sur l'artiste, sur l'œuvre, soit le courant passe, soit il ne passe pas. Voilà.
Je rebondis parce que tout à l'heure, Antoine parlait de l'étrangeté, que peut-être ça incarnait quelque chose de l'étrange. On connaît la notion d'inquiétante étrangeté, mais c'est aussi l'autre. Parce que, quand on entend vos histoires respectives, en fait, rien ne vous prédisposait puisque vous n'êtes pas issus d'un milieu qui vous a baignés et bercés dans l’univers des musées. Mais en revanche, la constante, c'est que vous allez toujours vers l'étrange, l'autre, et vous avez cette capacité à vous ouvrir à un monde qui n'était pas le vôtre initialement. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez développé une sorte d'attrait pour ce qui est différent de vous ?
— antoine frérot
Je disais tout à l'heure que ce qui m'attirait, c'était un monde hors de moi et le choc que je ressentais, la surprise. Et c'est ça qui me plaisait en fait dans l’œuvre. C'est également une impression sans doute un peu superficielle. Pour que ça me plaise, pour que ça m'émeuve, ça ne peut pas m'être totalement, en fait. Ces autres mondes dans lesquels je n’'ai pas été éduqué, il y en a, au moins en partie, qui existaient déjà. Je n'ai pas encore tout à fait éclairé cette choselà, mais je suis persuadé que, avant d'avoir acquis le sentiment d'exister, le principe de réalité, on va dire...
... la conscience d'être au monde ?
— a. f.
La conscience d'être au monde et la conscience de distinguer mon existence du reste du monde. J'ai baigné dans quelque chose qui était plus large, me semble-t-il. Et je me demande si ce que me disent ces œuvres ne me rappelle pas cette période d'avant, ce moment où je me suis rendu compte, comme beaucoup d'êtres humains - la presque totalité - qu'ils existent et qu'ils distinguent leur corps du reste du monde. Il y a un moment, avant, où on baigne dans une espèce de plénitude, où on est un avec les choses, on est chose parmi les choses, on est avec le monde. Une forme de sentiment édénique où rien ne peut faire de mal.
Ce moment-là, on a dû l'oublier pour pouvoir vivre en collectivité et pouvoir devenir progressivement un être humain parmi les autres, et devoir maîtriser ses désirs et ses pulsions. Eh bien ces œuvres, elles réveillent peut-être en moi ce que j'ai dû enfouir pour ça, et qui n'est pas totalement perdu. Alors est-ce que c'est uniquement ce que j'ai vécu étant tout petit, donc de l'acquis ?
Est-ce qu'il y a encore plus que ça derrière, dans l'existence de l'espèce humaine, qui se transmet aussi par les gènes ? Ce n’est pas impossible. On retrouverait éventuellement des archétypes de Jung. Mais ça peut être uniquement de cette période bénie – que j'imagine bénie, plus exactement – que j'ai dû abdiquer pour pouvoir faire face à la réalité et acquérir une forme de conscience que j'ai distinguée de l'inconscient. Et donc ça me replonge peut-être dans mon inconscient. Et ça en fait surgir à la conscience des mots. Et ça me les fait agglo-
mérer à cette conscience, laquelle s'élargit de nouveau.
Daniel, quand tu entends ça, est-ce que tu souscris ? Cette introspection et le fait de retrouver comme une sorte d'Éden perdu, de paradis qui n'est du coup pas perdu complètement puisqu'on a la capacité de le retrouver à travers des œuvres...
— daniel klein
D'une certaine manière, oui, parce que quand on atteint cette connexion, on a une sensation de plénitude. Donc on retrouve cet aspect élémentaire, disons. Je pense aussi qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a celui qu'indiquait Antoine, génétique d'une certaine manière. On est formaté, mais après il y a un trajet. Et moi je pense que on a une sensibilité génétique ou on ne l’a pas. Après ça se développe, et je pense que, plus on est exposé à certains langages, plus on développe cette sensibilité.
Alors, parce qu'on a acquis plusieurs formes de langage, on peut faire des associations et ces associations, ça crée d'autres énergies sur moi, internes. Je me pose la question au sujet de cette sensibilité pour l'art.
J'ai un peu la même réaction avec la nature, les mêmes sentiments. Quand je suis exposé à un paysage, un arbre, je perçois parfois la nature de la même manière que je vois une œuvre d'art et je crée cette même connexion, mentalement. Je sens les mêmes énergies, d'ailleurs, dans tous les espaces, pas seulement les paysages. Je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a des espaces où on se sent bien, des espaces où on se sent moins bien. Je sens cette plénitude de la même manière. C'est le même résultat.
Intéressant. Parce que je trouve que ça renvoie à ce que vous dites l'un et l'autre. Le mot enchantement n’a jamais été prononcé jusqu'ici, face au beau, à l'idée du beau, de la beauté. Alors, on peut remonter à Platon, le beau, le bon, qui est un peu équivalent, mais vous n’avez jamais employé le terme de beau. Or, on a l'impression qu'elle est présente en filigrane cette notion de beau.
— antoine frérot
Ce qu'on cherche à expliquer de ce qui nous séduit dans une œuvre, c'est ce qu'on appelle chacun le beau.
Mais il n'y a pas de définition définitive, objective du beau. Tu m’interrogeais tout à l'heure sur le rapport à l'autre et cette curiosité d'aller voir au-delà, voir l'autre. Et effectivement, l'autre est consubstantiel de la prise de conscience de soi, non ? Et il y a un prix à payer pour ça.
Le fait d'abdiquer cette fameuse plénitude que j'évoquais tout à l'heure, et je pense que si c'est l'autre effectivement que je reçois par ses œuvres, en fait, je ressens aussi que l'autre c'est moi et moi c'est l'autre. Je veux rompre cette distance que mon ontologie humaine a dû créer entre moi et le reste du monde, et le reste des autres aussi, des choses comme des êtres. En fait, je pense que j'aimerais que l'autre et moi soient fondus. Et c'est plutôt le fait de les refondre que de vouloir les découvrir. Je les découvre par hasard et aussitôt j'ai envie de me refondre dedans ou de me les incorporer.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va dans les deux sens.
— a. f.
Oui, sur le beau, il y a eu tellement de réflexion. Kant disait: « le beau n'a pas d'utilité », et Kant se trompe. La beauté – et ça, c'est plutôt François Cheng qui me l’a révélé – la beauté aide à vivre. Le beau a une utilité et si il m'aide à vivre, c'est justement pour agrandir mon champ de perception ou de conscience, ou de perception consciente, plus exactement. Et de ne jamais considérer cette extension comme suffisante, et de toujours chercher à l'élargir – plus ou moins facilement parce que les rencontres d'altérité sont parfois telles qu'il faut du temps pour les incorporer. D'ailleurs, il y a des œuvres dans lesquelles je ne rentre pas tout de suite et qui, plus tard, d'un seul coup, me plaisent et je me demande « pourquoi je n'avais pas été séduit dès le début alors que c'est maintenant évident ? ». Cette altérité, elle peut heurter un mur, à un moment ou un autre. Mais je pense que l'idée de suspendre cette distance entre moi et le reste, – ce qu'on pourrait appeler le soi ou le ça – est pour moi un besoin, plaisir, bonheur, je ne sais pas comment le dire. Une nécessité pour me sentir être au monde. Plus le monde que j'englobe dans moi et moi dans le monde, plus je me sens être au monde.
Bien sûr, c'est une notion hautement subjective, la notion du beau. Mais dans tout ce qu'Antoine disait, finalement, ça rejoignait un peu l'idée platonicienne, c'est-àdire que le beau est subordonné au bon. Il y a un lien entre les deux.
— a. f.
Il y a de la transcendance chez Platon. Il y a un autre monde dans lequel le beau et le bon sont objectifs. Chez moi, il n'y a aucune transcendance. Tout est dans l'immanence. Il n'y a pas d'autres mondes, il n'y en a qu'un, celui dans lequel on est.
Et le beau, ce n'est pas au-dessus du monde qu’il faut le trouver. C’est à l’intérieur.
Daniel, comment tu réagis à ça, toi ?
— daniel klein
Je ne sais pas ce que c'est le bon et le beau... Il faudrait peut-être que je lise Platon (rires) Ça pourrait peut-être me donner la clé de la solution. Mais je n'analyse pas, disons que cela fait partie de moi. Ou je sens cette connexion ou je ne la sens pas.
Qu'est-ce que c'est le beau ? Je suis très sensible aux œuvres qui évoquent le chaos, à celles qui sont considérées comme en dehors des canons esthétiques classiques. C'est ce qu'on trouve avec l'art brut, des œuvres qui ne sont pas nécessairement belles, au sens conventionnel du terme.
— antoine frérot
Il y a dans la philosophie orientale des choses qui me séduisent. Cette idée que le beau, c'est le souffle vital entre les choses ou les êtres, c’est le entre. Comme si la dualité moi/le reste, le sujet, l'objet n'était pas satisfaisante et que c'était bien ce qui se passait entre qui était important et que le beau se trouvait là. Quand je disais que je cherchais à supprimer les distances entre moi et le reste, c'est sans doute ce qu'il y a entre,
le souffle, que je veux apprivoiser. Et du coup, les penseurs asiatiques, pour moi, ont une idée plus pertinente de cette idée du beau que les penseurs occidentaux.
Donc le beau serait une forme de lien qui s'établit entre soi et l'autre et l'altérité. Et c'est ce qui se passe entre les deux, c'est cette connexion et ça encourage presque à glisser vers Romain Rolland et le « sentiment océanique ».
—
a. f.
Bien évidemment, le sentiment océanique, c'est ce sentiment de plénitude qui vous surprend comme une fulgurance, un moment où rien ne le laisse apparaître. C'est très rare dans une vie. D'un seul coup, sans que rien ne l'annonce, vous vous sentez bien. Il n’y a plus de passé, plus de présent, plus d'avenir. Le coin de cette bibliothèque là, d'une banalité affligeante, d'un seul coup, elle me libère l'esprit de toute pesanteur de devoir être. Il n’y a plus de devoir, il n’y a plus que du flottement...
... Affranchi ? Libéré ?
— a. f.
Libéré, oui, de toute contrainte, de toute peur aussi. Avec la question de savoir ce qu'on fait de tous ses désirs dans ces cas-là, puisqu'ils sont libres aussi. Et on comprend bien que si l'espèce humaine est devenue ce qu’elle est, c'est parce que la juxtaposition de toutes ces libertés ne pouvait pas lui permettre de survivre. Il a fallu que génétiquement on se discipline et puis, à un moment, ça revient, il y a un flash. La plénitude n'est pas définitivement perdue.
Elle est enfouie, cachée, et de temps en temps, elle surgit. Le fameux sentiment océanique, ça peut être pour n'importe quoi. L'œuvre d'art peut, je ne dirais pas le recréer, mais le singer, un peu. L'œuvre d'art redonne le goût de ce qu'on a pu percevoir et qui s'est échappé aussi vite qu'il est arrivé.
Daniel, est-ce qu'il t'arrive d’avoir comme ça – ce que décrit Antoine – presque une forme d'épiphanie, des moments de révélation au contact d'une œuvre d'art, de quelque chose qui est enfoui en elle et que soudain on saisit, puis qui vous révèle peut-être à soi, au monde, et qui vous permet de revenir à une sorte d’état édénique qui précédait ?
Est-ce que tu as des fois des sentiments de révélation ?
— daniel klein
Tout à fait. J’ai souvent cette sensation quand je suis en face de quelque chose qui m'émeut, – une œuvre d’art, un paysage – de me connecter avec l'univers, d'être présent et de sentir que je suis présent. C'est un échange d'énergie d'une certaine manière. Donc il y a un côté un peu métaphysique et spirituel qui fait qu’on se sent en connexion, définitivement. Malheureusement ça ne dure pas longtemps, comme souvent certaines bonnes choses dans la vie. J'ai vraiment cette sensation de me déconnecter et en même temps de me connecter.
Est-ce que, dans ce cas, collectionner n'est pas une quête de ce moment ?
— antoine frérot
Bien évidemment ! Quand on retrouve une œuvre d'art, on recherche d'abord cette impres-
sion qu'on a eue. Quand l’œuvre est bonne, l'impression revient, l'œuvre ne s'épuise pas. Quand l’œuvre s'épuise c'est qu'elle est moins forte. Donc là, on peut peut-être s'en séparer, mais quand ça rejoue la même chose... C'est bien pour ça que moi, je les collectionne. J’en ai besoin.
Je reviens deux minutes sur le beau, quand même, parce que je me méfie beaucoup de ce terme. Je ne voudrais pas essentialiser la chose, de même qu’il ne faut pas essentialiser l'art, ni même l'art brut, même si le mot "essentiel" est source de malentendu.
Quand Daniel disait qu’il y a un côté métaphysique ou spirituel, je le ressens tout à fait comme ça. Et j'insiste, pour moi, ce côté spirituel, est hors toute transcendance. Il y a un monde de l'esprit dans l'immanence, et dans l'athéisme. Jamais le sentiment d'un Dieu ne m'assaille ou même ne me percute. Je suis certain que ça n'existe pas. Et pourtant, cette vie spirituelle me sort de mon corps pour me projeter non pas au-dessus du monde, mais dans le monde. Le mot extase veut dire « sortir » ou « se mettre au-dessus du monde », alors que ce serait plutôt dans le monde, c’est le mot d’enstase qui conviendrait...
Ce n’est donc pas forcément à l’extérieur...
— a. f.
Mais il n'y a pas d'extérieur, il n'y a qu'un monde et c’est donc dans ce monde, à la limite au centre de la Terre, que ça m'emmène. Et c'est bien ce monde spirituel. Et donc métaphysique.
Ça nous emmène à un point où ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous parliez de transcendance...
— a. f.
Non, justement, on contestait la transcendance.
Oui, enfin vous évoquiez la question de la transcendance, et notamment de la spiritualité. La spiritualité, tu as rappelé qu'elle pouvait se former dans l'immanence. Si on se réfère à l’art premier par exemple, on peut aisément imaginer qu'à l'origine, l'homme a produit des œuvres comme des objets d'intercession entre lui et quelque chose qu’il n'arrivait pas à expliquer, quelque chose qui le dépassait, en soi, au-dessus de soi. Je n'ai pas la réponse, mais certainement ça devait opérer comme une tentative d'établir un lien. Vous en avez parlé tous les deux. Donc, en bon athée que certains d'entre nous sommes, ça rejoint quand même l'idée du religare, du religieux, c'est-à-dire créer un lien. Est-ce que dans l'art brut on retrouve selon vous des mécanismes similaires à ce qui a pu se produire aux origines, dans la genèse de l'art, de l'histoire de l'humanité avec l'art, de sa production de formes et d'objets qui devaient répondre au mystère d'être au monde ?
— a. f.
Toutes les grandes œuvres d'art sont comme ça. Les grandes œuvres de la Renaissance aussi sont comme ça. Les grandes œuvres de tous les temps sont à mon avis faites pour ça. Pour créer un lien afin d'abolir la distance entre soi et le reste du monde, avec une puissance extérieure. Voilà pour la religion, mais c'est vrai aussi pour des puissances intérieures. Je pense que toutes les grandes œuvres d'art, quelles qu'elles soient, sont faites pour intercéder entre soi et le reste. Ça peut être terrestre ou extra-terrestre.
Daniel, je pense à l'exposition qu'on avait eu le plaisir de voir dans ton musée à Quito, qui portait sur ces questions-là, du rapport au sacré dans l’art précolombien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe, entre ces objets d'art précolombien et ton goût, qui est venu plus tard, pour l'art brut ?
— daniel klein
Je ne pense pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est une connexion naturelle. On a l'avantage avec les créateurs d'art brut de trouver une multitude de langages qui sont personnels, qui leur sont propres. Et c'est ça qui m’interpelle. Je ne mets pas de hiérarchie dans ce que j'observe, aussi bien dans l'art précolombien que dans l'art brut. Je les mets au même niveau, c'est le résultat qui m'intéresse. Je ne fais pas nécessairement la relation entre l'œuvre elle-même et le sacré.
C'est intéressant, parce que tu as évoqué la question que l'on n'avait pas encore abordée de la mythologie personnelle, individuelle et qui évidemment pourrait, superficiellement, s'opposer à ce qu'on peut appeler les mythologies collectives telles qu’elles s'expriment dans des œuvres d'art tribales, dites d'art premier, etc. Et finalement, quand on vous entend, il n'y a peut-être pas un si grand antagonisme entre mythologie collective et mythologie individuelle.
— antoine frérot
Non, il n'y en a pas. Et pourquoi il n’y en a pas ? Tu parlais de ce musée de Quito qui est un lieu magique où on sent que respirent l'esprit et le sacré aussi... Mais pour moi, sacré et secret – qui viennent, je crois, de la même racine –, sont synonymes. Ce que les uns appellent sacré, je l’appelle secret, c'est-àdire quelque chose de caché qui se révèle à moi.
Des créateurs d’art premier qui cherchent à intercéder et interpeller l'au-delà, donc dans une relation au sacré, je le ressens comme s’ils cherchaient à interpeller en moi, au fond de moi, cette chose cachée que j'avais dû oublier, ou que j'avais héritée, mais dont je n'étais pas conscient, qui était mon secret. Et ce secret révélé, c'est le sacré qu'ils recherchent.
Et du coup, la mythologie individuelle, pour revenir à cela, qui est un peu l'équivalent de mon secret est l'équivalent de la mythologie collective qu'on peut appeler le sacré.
Et là, tu nous renvoies à nouveau un peu à Jung et à une forme de ressuscitation de l'inconscient collectif.
— a. f.
Oui, je n’ai pas définitivement tranché quant à savoir si ce « caché » que les œuvres peuvent révéler à ma conscience, il est commun à beaucoup d'hommes, ce qui voudrait dire qu'il est collectif, cet inconscient – ou qu'il est relatif à ce que j'ai vécu dans ma prime enfance et qui serait seulement de l'acquis. Eh bien je pense qu'en fait, il y a de l'acquis et de l'inné, et je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison que depuis 50 000 ans qu’Homo sapiens existe – voire sans doute avant avec Néanderthal –, les expériences humaines ne se soient pas traduites aussi dans les gènes qui fabriquent les pensées dès lors qu'elles se sont traduites dans les gènes qui fabriquent la physiologie. Donc oui, il y a des deux. Ce n'est pas que de l'inconscient collectif, il y a certainement des morceaux d'inconscient individuel.
Dany, tu penses toi aussi que finalement la frontière est fine, voire totalement poreuse entre ce qu'on appelle la mythologie individuelle et la mythologie collective ?
— daniel klein
Pour moi c'est le résultat qui compte. Et après, la source qui aboutit au résultat... Évidemment, il y a de multiples chemins...
— antoine frérot
Ça fait deux fois que Dany le dit : « pour moi, c'est le résultat qui compte ». Eh bien, en y réfléchissant, pour moi ce nest pas suffisant. Parce que quand il y a le résultat, ça me fait des choses. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi ça me fait des choses. La première voie pour le comprendre c'est d'imaginer ce qui s'est passé dans celui qui l'a fait, pour voir s'il n'y a pas une analogie entre ce que je ressens et ce qu'il a ressenti.
Je ne peux pas me contenter du résultat. Je cherche peut-être de manière totalement illusoire à repérer une éventuelle analogie entre ce qui s'est passé chez le créateur et ce qui se passe chez le regardeur. Est-ce que c'est illusoire ? Je ne sais pas.
C'est un peu parfois la présomption de l'intellect sur l'émotion. Quand l'intellect pense pouvoir expliquer toutes les émotions.
— a. f.
D'ailleurs, si on est là tous les trois, c'est qu'on essaie de vérifier s'il y a des concordances entre ce que ça nous fait à moi, à toi, à lui. Donc là, on ne parle pas du créateur, on parle de trois regardeurs, mais on cherche quand même des points communs.
Ce qui compte, c'est également ce que ça fait, ce que le résultat fait chez d’autres.
— daniel klein
Bien sûr. Je te comprends parfaitement et je voulais savoir si le fait de percevoir d'autres dimensions quand tu es en face d'une œuvre, de comprendre l'artiste, de comprendre parfois ce qu'il a voulu montrer, de comprendre sa démarche, crois-tu que ça puisse augmenter cette énergie, cette émotion ? Ou est-ce juste une question intellectuelle ?
— a. f.
Mais je crois qu'il n’y a rien à comprendre dans l'œuvre. Ce que je cherche à comprendre, c’est ce qui a poussé l’artiste à faire l’œuvre.
— d. k.
Par exemple, je fais une analogie avec l'émotion que recherchent certaines personnes devant une œuvre d'art contemporain. Ils ressentent un certain attrait, mais pas nécessairement pour l'œuvre en elle-même, ni pour sa forme, mais pour l'idée, le concept de cette œuvre.
Et alors, ma question serait : lorsque tu ressens ce type d’émotion profonde, la compréhension, notamment du contexte de l’œuvre accroît-elle ton émotion ?
— antoine frérot
Je suis maintenant persuadé que toutes les grandes œuvres, celles qui me font le plus d'effet, ne sont pas le résultat d'un projet de l'artiste. Il n'a pas voulu faire ça consciemment, ça s'est imposé à lui. Les artistes commencent par quelque chose, mais les belles œuvres, elles dirigent la main de l'artiste. Comme souvent ils l’ont dit : « Je commence et puis, soudain, c’est l’œuvre qui me guide ». Dès lors qu'il y a un projet, il n'y a plus de projection d'inconscient de l'artiste.
Donc je ne cherche pas à comprendre ce qu’il a voulu, parce que je pense qu’il n’a rien voulu. Ou alors ce n'est pas une bonne œuvre. En revanche, ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui l’a poussé. Qu'est-ce qui sort de lui dans son œuvre et qui pourrait ressembler à moi ? C’est d’essayer de comprendre l'état dans lequel il était quand il a voulu pondre ce truc qui me fait quelque chose. Si je pouvais sentir l'état dans lequel il était, je pourrais comprendre le mien et détecter quelque chose que je n'avais pas détecté. Parce que sinon, j'aurais peut-être fait l'œuvre moi-même si j’avais détecté quelque chose.
Je n'ai pas fait l’œuvre. Lui l’a faite et si ça me fait quelque chose, c'est qu'il me parle de moi. Et qu'est ce que c'est que cette chose de moi ? Le mieux, c'est de regarder dans lui pour voir si je la reconnaîs.
C'est comme un miroir tendu finalement?
— a. f.
Absolument, un miroir tendu.
Daniel, penses-tu aussi que ce qui peut échapper à un artiste dans l'œuvre qu'il a réalisée est de nature à pouvoir révéler quelque chose de toi ? Ce qui échappe chez l'autre.
— daniel klein
Sans en être conscient, peut-être.
Le fait d'avoir le contexte de l’œuvre est très intéressant. Connaître l'artiste et dans quelles circonstances il a créé son œuvre et pourquoi lui donne évidemment une autre dimension. C'est intéressant au point de vue intellectuel, mais au point de vue de l'interconnexion énergétique, ce n'est pas là que ça se passe pour moi.
— antoine frérot
Mais c'est peut-être une bonne idée ça, de vérifier que les énergies reçues, les énergies émises concordent.
C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore développée mais que l'un et l'autre vous avez abordée, celle de la puissance émettrice et la puissance réceptrice. À la fois, l'œuvre émet quelque chose à une certaine fréquence, et celui qui la reçoit peut, s'il est réglé sur la même fréquence, recevoir quelque chose. S'il est réglé sur une autre fréquence, il ne reçoit rien ou il est réglé sur la fréquence de l'œuvre d’à côté. Peut-être que quelque chose d'intéressant se joue là sur la hauteur de fréquence de celui qui émet, de l'œuvre qui émet et de celui qui reçoit.
— a. f.
C'est tout à fait possible. L'image des fréquences et des longueurs d'onde est peut-être un peu abusive, mais c'est une métaphore qui peut être tout à fait intéressante pour m'aider à comprendre ce que me fait l’art brut. Peut-être que j'essaie de régler ma fréquence pour entrer en résonance avec l'émission, puisque ça m'a fait des choses et en entrant en résonance, découvrir, me rendre conscient de ce que je ressens et de pourquoi je le ressens. Ce n’est pas impossible du tout.
Tu en penses quoi Dany ? Tu te sens réglé sur l'œuvre aussi?
— daniel Klein
Oui, complètement.
Tu parlais beaucoup de connexion...
— d. k.
De connexion, oui évidemment.
Maintenant que vous avez confronté vos regards pour trouver des analogies de différentes natures entre des oeuvres d'art premier et d'art brut, pour cette exposition Les Habités, est-ce que cela vous a révélé des choses dont vous n’étiez peut-être pas conscient, ou est-ce que ça a juste confirmé ce que vous pensiez ?
— d. k.
Ça ne m'a rien révélé parce que c'est exactement la démarche qui est la mienne depuis que je collectionne. Ce que je cherche d'une manière peut-être consciente et inconsciente. Et tu posais la question au préalable sur la manière de collectionner, sur ce que signifie collectionner. Définitivement, pour moi, c'est créer. Je sens vraiment cette nécessité de créer. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui choisis l'œuvre, c'est un monde illimité. Il y a tellement de facettes, de manières de collectionner. Il y a des gens qui vivent avec leurs œuvres, d'autres non. Moi, je trouverais frustrant de ne pas vivre avec mes œuvres parce que j'aime bien les faire dialoguer entre elles.
C’est pour ça que, pour moi, cette exposition, ce face-à-face entre art premier et art brut, ce n’est pas une révélation. C’est juste une façon naturelle de m’exprimer à travers ma manière de collectionner. Quand plusieurs œuvres sont réunies, j'ai l’impression qu'elles se connectent entre elles, qu’elles se parlent.
Depuis des années, quand on voyage avec mon épouse et les enfants, on ramasse des pierres, je les collectionne. Elles sont un peu partout. La démarche de ramasser une pierre c'est symbolique, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie ?
— antoine frérot
Parce que ce n'est pas au-dessus du monde, c'est dans le monde, c'est dans la terre. C'est l'immanence pure, la pierre, tu as raison là-dessus. C'est de se fondre avec la terre.
— d. k.
Tu as peut-être raison, mais pour moi, c'est une autre démarche. C'est-à-dire qu'il y a des pierres partout. Mais alors pourquoi j'ai choisi ce chemin jusqu'à cette pierre ? Pourquoi je l'ai choisie cette pierre ? Je l’ai sortie de son espace, de son contexte, je l'ai ramenée chez moi et après je l'ai posée. Et après j'ai choisi une autre pierre à un autre endroit. Je les ai connectées, j'ai fait vivre ces deux pierres ensemble. Je trouve que c'est ça la vie en fin de compte. Pour moi, le dialogue entre les objets est très important, je sens que la collection est aboutie quand je sens que j'ai établi ce dialogue.
Sinon, je ne me suis pas réalisé. D’où cette frustration de ne pas vivre avec les objets.
— a. f.
Quand tu dis que la collection est aboutie, elle n’est jamais aboutie. Tu as envie de continuer, non ? Quand la connexion est réussie, la collection avance bien, mais elle n'est jamais finie.
— d. k.
Je voulais surtout exprimer ce besoin de vivre avec mes oeuvres car j'ai besoin de cette connexion pour vivre et pour respirer.
— antoine frérot
Ce travail qu'on a fait ensemble, je n'ai pas été surpris que ça fonctionne bien parce que, encore une fois, je suis venu de l'un à l'autre dans mon histoire.
En juxtaposant autant de pièces d'art brut et d'art tribal, d’art premier, j'ai été quand même un peu surpris du fait qu'il y avait beaucoup d'émissions sur la même longueur d'onde, plus que je n'imaginais sans doute.
Souvent, ces objets émettent sur une fréquence proche. Et il me semble que la fréquence des auteurs d'art brut est sans doute quand même plus proche des miennes, enfouies, que celle des auteurs d’art premier. C'est pour ça que l’art brut m'attire sans doute plus que l’art premier. Mais il y a quand même pas mal d'émissions sur la même longueur d'onde. Et quand je réfléchis à des artistes classiques, occidentaux, quels sont ceux qui émettent sur les mêmes fréquences ? Évidemment, ils sont assez peu nombreux.
Tout à l’heure, on disait la difficulté de décrire le beau qui n’existe pas. Je pense qu'on aura bien du mal à définir l'art et l’art brut aussi, mais je m'entête à penser que l'art brut ce n'est pas la même chose que l’art non brut. Le bon art brut ce n'est pas la même chose que même le bon art. Il y a une différence de fréquence. L’absence de projet me semble important dans l’art brut. Dans l'art non brut – même si la grande œuvre n'est pas le fruit d'un projet – au départ, il y a un vouloir. Ce vouloir est totalement différent chez les auteurs d’art brut, me semble t-il. Il y a un cri, il y a un besoin d'expulser.
Alors que moi, je veux me l'incorporer, ce qui est quand même curieux : on expulse quelque chose que moi je veux avaler. Un besoin d'expulser, que je ne ressens pas dans l’art non brut. Et je pense que le créateur d'art premier non plus, je ne pense pas qu'il expulse quelque chose hors de lui. Et cette expulsion fait que la stridence de la fréquence est forte. Plus qu'ailleurs.
Comment tu ressens les choses, Daniel ?
— daniel klein
Antoine n'a peut-être pas tort. Comme je l’indiquais au préalable, il n'y a pas de hiérarchie pour moi dans le sens où je peux exactement avoir la même réaction devant une œuvre d'art brut, comme une œuvre d'art premier, voire d'art populaire, ou d'art moderne, ou d'art classique. J'ai un peu plus de mal avec l'art classique parce qu’il me relie moins à l'inconscient et à la pulsion créatrice que d'autres formes d'expression. Et donc j'ai moins de sensibilité, je suis moins réactif.
Antoine n'a pas rebondi sur quelque chose qui me paraissait très intéressant dans ce que tu disais : « j'ai le sentiment de créer ». J'ai rencontré un certain nombre de collectionneurs, des typologies très différentes, et beaucoup m'apparaissent comme des bâtisseurs, des gens qui construisent quelque chose, pièce après pièce. Et toi en ramassant des pierres, tu construis des connexions nouvelles qui, à un moment donné, modifient ta perception du monde.
— antoine frérot
C'est vrai. Et moi, je le dirais un peu différemment. Quand je collectionne, j'ai l'impression de me créer. Pas de créer quelque chose d'extérieur à moi, mais de me découvrir, d'élargir mon moi et donc de me créer. C'est pour ça que je le fais.
En guise de conclusion, maintenant, renseignés sur l'expérience de faire ce type de commissariat, est-ce que vous avez pensé à une autre exposition que vous aimeriez faire et sous quelle forme ?
— a. f.
Moi, ce n'est pas la première fois que ça me vient cette idée-là, mais c'est la première fois que je le fais. Au passage, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre d'aspects matériels qui n'étaient pas des moindres pour faire un truc de qualité.
Mais oui, j'ai envie d'exposer ma collection d’art brut et peut-être pas d’art brut seulement, mais un mélange. Donc ça viendra sûrement. Pour l'instant, je n’ai pas tout à fait le temps de le faire. Mais quand je l'aurai davantage, j’essayerai sûrement de poursuivre.
Daniel ? Une envie nouvelle de faire quelque chose, à Paris ?
— a. f.
Il a fait un musée splendide, à Quito, où il montre une partie de sa collection.
— daniel klein
Merci Antoine Moi, ce qui m'intéresse c'est les connexions. J'aurais du plaisir à pouvoir exposer ma collection. Mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas tout déplacer, recréer les espaces de la même manière. Quand j'ai dû considérer récemment de repenser un espace d'accrochage que j'avais construit pendant de nombreuses années d'une manière organique, ça m'a posé vraiment de gros problèmes. Il faut de l'énergie pour défaire et refaire et puis c'est un peu tuer ce qu'on a créé.
Après, qu'est-ce que ça veut dire de créer ?
C'est pour soi ? C'est pour les autres ? Parfois les
artistes, les grands artistes ils ne créent pas pour les autres. C'est parfois ce qui fait la profondeur de l'œuvre.
D’une certaine manière, ils se créent, ils sortent le plus profond d’eux-mêmes.
Les Lacaniens rebondiraient sur ce que tu viens de dire, "ils se créent" : "secret ".
— antoine frérot
J'ai constaté que quand on met une œuvre chez soi, au fur et à mesure on s'habitue à la voir. Et si pour une raison ou une autre on la déplace, on la redécouvre autrement. Et quand c'est une très grande œuvre, elle se réveille. Elle se re-révèle parce que nous avions l'habitude de la voir au même endroit. La première fois qu'on avait choisi de la placer là ça fonctionnait super bien, mais l'habitude lime l'émotion. Si on la déplace dans un autre endroit, ça la réactive et d'un seul coup la magie revient. Donc pour bouger les œuvres, c'est sûr, il faut de l'énergie parce qu’elles dialoguent entre elles et si on en déplace une, il faut tout changer. Mais ça les régénère et ça les revitalise, je trouve.
— daniel klein
Oui, ça leur donne d'autres connexions et d'autres liens, d'autres destins. Je crois beaucoup au destin, le nôtre, celui de l'Homme en général, mais aussi le destin de ce qui nous entoure.
Et notre capacité, comme les œuvres, à nous recréer. Finalement.
— a. f.
Ou nous créer tout simplement.
C'était riche, dense, c'était super. Merci.
— a. f.
Merci à vous.
— d. k.
Merci à toi de nous avoir invité à participer à l'exposition parce que c'était très enrichissant de partager avec Antoine la responsabilité de ce commissariat.
Ça m'a paru tellement naturel par rapport à vos parcours, à nos relations, à la manière dont on échange finalement de façon dicible ou intelligible autour des œuvres. Et puis en même temps, toutes les choses qui ne se disent pas, que l'on n'arrive pas forcément à formuler...
Je me rappelle comment j'avais incité Antoine à écrire pour le colloque de Cerisy, et c'était très inspirant. Parce que comme disait Jean Grenier : « Ecrire, c'est remettre en ordre ses obsessions ».
guillermo rigoberto casola marcos sans titre, c. 2012. gouache sur papier, 20 x 58 cm
boîte anthropomorphe Mangbetu
R. D. du Congo, fin 19e – début 20e s., bois, écorce, 39 cm.
courtesy galerie Bernard Dulon
franco bellucci sans titre, 2013. technique mixte, 16 x 62 x 8 cm
fétiche vaudou Fon
Bois, corde, tissu, 10 x 8 cm collection particulière
josé manuel egea . sans titre, 2014. stylo à bille sur papier, 35 x 25 cm
statuette Babembé Congo.
Raffia et tissus, 38 x 14 cm collection particulière
statue Dogon. Mali. bois, 34 cm.
courtesy galerie Olivier Castellano
hauser sans titre, 1980.
crayon gras sur gravure sur papier cartonné, 24 x 16 cm
johann
tribu hill korwa lahangi korwa, Inde, 1996. feutre sur papier, 54 x 71 cm
réceptacle Coolamon
Australie, 1950. Bois, 32 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
tomasz machciński sans titre, 2005. photographie argentique, tirage unique sur papier baryté, 11 x 8 cm
sculpture Sepik. Papouasie-Nouvelle Guinée, cours inférieur du fleuve Sepik, 19e-20e s. bois, coquillage, fibre végétale, 85 x 15 cm collection particulière
masque de Joker. Ouest du Népal, c. 1850. Bois, 30 x 11 cm. courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
bunion murray sans titre, c. 1970. encre et gouache sur papier, 49.5 x 64.8 cm
ted gordon sans titre, 1978.
marqueur et stylo à bille sur carton, 90 x 60 cm
masque de Phagli
Inde, c. 1800. 33 cm.
courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
martin ramirez sans titre, c. 1960. gouache, crayon de couleur et graphite sur papier, 57 x 50 cm
cavalier Senoufo Djimini.
Côte d'Ivoire, bois, 40 x 12 cm
courtesy galerie Olivier Castellano
[...] This face-to-face between works of tribal art and art brut is not a revelation. It’s simply a natural way for me to express myself through my way of collecting.
When several works are brought together, I feel as if they connect with each other, as if they are in conversation.
[...] Ce face-à-face entre des œuvres d'art premier et d'art brut, ce n’est pas une révélation.
C’est
juste
une façon naturelle de m’exprimer à travers ma manière de collectionner.
Quand plusieurs œuvres sont réunies, j'ai l’impression qu'elles se connectent entre elles, qu’elles se parlent.
adolf wölfli sans titre, recto verso, c. 1925.
graphite et crayon de couleur sur papier, 54 x 31 cm cm
masque Idiok - Ekpo. Ibibio, Nigéria, XIXe s. Bois mi-dur à épaisse patine brun foncé noir, trace de pigments, 42 cm.
courtesy galerie Schoffel de Fabry
michel nedjar sans titre, 1994.
technique mixte sur carton, 106 x 77 cm
masque funéraire médiéval.
Oural, Sibérie, c. 10e siècle. alliage très majoritairement argentifère, autrefois cousu sur un linceul, 16 cm.
courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
masque. Vallée de Kathmandu (Népal), c. 1900. Amadouvier, 21 x 24 cm. courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
dwight mackintosh
sans titre, c. 1980 encre et marqueur sur papier, 51 x 66 cm
scottie wilson sans titre, c. 1945. encre et crayon de couleur sur papier, 37 x 27 cm
bouclier cérémoniel Kahel Katu. Laos, Vietnam. Bois laqué, bambou, fer, diamètre 55 cm collection particulière
leonhard fink sans titre, 2006. graphite sur papier, 29 x 11 cm
bouclier. Bornéo, Indonésie, circa 1850.
Bois polychrome, 113 x 30 cm.
courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
frise Malangan. archipel Bismarck, Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle Guinée, Mélanésie. fin 19e-début 20e s. bois, pigments, coquillages, 215 x 25 cm collection particulière
alexandro garcia
mundos intraterrenos, 2014. peinture à l'huile sur papier, 34 x 49 cm
michel nedjar sans titre, (chairdâme), c. 1980. vêtement, technique mixte, 40 x 11 x 21 cm
extrémité de tambour Garamut
Nouvelle-Guinée,
Bas Sepik. Papouasie
XXe s. Bois, 49 x 10 x 22 cm
courtesy galerie Schoffel de Fabry
masque peuple Lega. R. D. du Congo. 19e s.. Bois, patine brune, kaolin, 23 cm. courtesy galerie Bernard Dulon
edmund monsiel
sans titre, c. 1950. graphite sur papier, 10.2 x 16.5 cm
A.C.M. sans titre, c. 1980.
assemblage en métal, 14 x 10 cm
cloche Kongo
Bois laqué, 26 x 7 x 7 cm collection particulière
sifflet Bakongo. Kongo fin 19e s. Bois laqué, 19.5 x 3 cm collection particulière
sava sekulić sans titre, 1981. graphite sur papier, 32.5 x 18 cm
guo fengyi sans titre, 2002. encre sur papier de riz, 219 x 68 cm
statue fétiche Songye. R. D. du Congo, fin 19e – début 20e s. Bois à patine noire et suintante, clous, corne, 33 cm.
courtesy galerie Bernard Dulon
joseph barbiero sans titre, c. 1980.
pierre de lave de Volvic, 28 x 18 x 16 cm
statue Mambila Nigeria, Bois, 63 cm.
courtesy galerie Bernard Dulon
[...] This work we did together didn’t surprise me in terms of how well it worked, because in my personal journey I moved from tribal to art brut. But I was surprised by the fact that there were so many transmissions on the same wavelength, at a similar frequency.
[...] Ce travail que l'on a fait ensemble, je n'ai pas été étonné que ça fonctionne bien parce que je suis venu de l’art premier à l'art brut dans mon histoire.
Mais j'ai été surpris du fait qu'il y avait autant d'émissions sur la même longueur d'onde, sur une fréquence proche.
pietro ghizzardi sans titre, r-v, 1960. pigments naturels, suie et collage sur carton de récupération, 78 x 50 cm
couple Baoule
Côte d'Ivoire. Bois, 32,5 et 28,5 cm.
courtesy galerie Olivier Castellano
melvin edward nelson sans titre, c. 1965. aquarelle sur papier, 45.5 x 60 cm.
masque Dan. Côte d'Ivoire. bois, coquillages, perles, 30 x 23.7 cm.
courtesy galerie Bernard Dulon
mary t. smith sans titre, c. 1987.
peinture acrylique sur panneau de bois, 91 x 61 cm
cage miniature (maquette) ?.
Civilisation mochica-wari ou chancay, Pérou.
Cordelettes de laine ou de coton, 12 x 25 cm. collection particulière.
protectrice. Ouest
divinité
du Népal, c. 1850. Bois couvert de mousse, 61 x 23 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
hofer sans titre, 2015.
crayon de couleur et graphite sur papier, 42 x 29 cm
joseph
hofer sans titre, 2014. crayon de couleur et graphite sur papier, 42 x 29 cm
joseph
masque de singe, ethnie Rajbanshi, sud-est du Népal. bois à patine d'argile blanche ("mato"), 25 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
qöqöle Katsina. Figure sculptée. Hopi, Arizona, États-Unis.
Bois sculpté (racine de cottonwood) et pigments, 14x 4.5 cm
courtesy galerie FLAK
paul duhem
sans titre, c. 2010. gouache, crayon de couleur et graphite sur papier cartonné, 29 x 20.5 cm
giovanni bosco sans titre, c. 2008. marqueur sur papier, 33 x 24 cm
ivoire Inuit.
Ivoire de morse, 14 x 6.5 x 2.5 cm collection particulière
[...] It is, in any case, noteworthy that both art brut and tribal art seem to stem from the same quest for answers to the great existential questions. These creators attribute to art the power to “inhabit the world,” to heal it, to build bridges toward the unknown, the supernatural, the sublime.
[...]
Il est en tout cas notable que l’art brut comme l’art premier paraissent procéder de la même
quête de réponses aux grands enjeux existentiels.
Ces créateurs attribuent à l’art le pouvoir « d’habiter le monde », de le réparer, de construire des passerelles vers l’inconnu, le surnaturel, le sublime.
christian berst
carlo zinelli sans titre, c. 1958. gouache sur papier, 34.8 x50 cm
collection particulière
statuette Babembé. Congo. Tissus, raffia et os (reliquaire), 62 x 37 x 29 cm
albert moser
sans titre, c. 1995. marqueur sur papier, 26 x 21 cm
bouclier. Peuples aborigènes du désert central australien, c. 1950. Bois, 55 x 21 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond
Dan Miller © Leon Borensztein
guillermo rigoberto casola marcos
A.C.M.
France 1951 - 2023
A.C.M est le nom d'artiste de Francis Marié. Initialement destiné à devenir peintre en bâtiment, il entre à l'école régionale supérieure d’expression plastique de Tourcoing en 1968 et y reste pendant 5 ans. Dépressif, il détruit alors la plupart de ses réalisations. Avec sa compagne, il s'installe dans l'ancienne manufacture du père de Francis et reprend son activité artistique. D'abord réticent à montrer ses œuvres il accepte petit à petit de participer à des expositions. Ses sculptures sont à présent connues internationalement.
Ses sculptures consistent en assemblages minutieux de petites pièces métalliques, électroniques et plastiques extraites de divers appareils, dégradées par l'acide, la rouille et l'enduit. Il compose des machines et des architectures imaginaires qu'il retravaille sans cesse.
A.C.M is the artist name of Francis Marié. Initially destined to become a house painter, he entered the École Régionale Supérieure d’Expression Plastique in Tourcoing in 1968 and remained there for five years. Struggling with depression, he destroyed most of his works from that period. Later, with his partner, he settled in his father’s former factory and resumed his artistic practice. At first reluctant to let his works leave his studio, he gradually accepted invitations to exhibit. Today, his sculptures are recognized internationally.
His sculptures are meticulous assemblages of small metal, electronic, and plastic components salvaged from various devices, corroded by acid, rust, and coating. From these, he creates imaginary machines and architectures populated with strange figures. Often reworked, some of his pieces are in perpetual evolution.
Joseph Barbiero
Italie 1901 - 1992 France
Dans son garage du Puy-de-Dôme, Joseph Barbiéro a taillé dans la pierre volcanique d’inimitables sculptures, souvent des visages à l’exécution fruste, au trait rustre. Cet œuvre saisissant d’authenticité, issue de la pierre, est chargée d’une force expressive remarquable.
Joseph fuit son Italie natale à l’arrivée au pouvoir de Mussolini et se réfugie en Auvergne où il exerce le métier de maçon. C'est à l’âge de la retraite que son inventivité prend son essor : entre deux coups de bêche dans son potager, il taille, chantonne et boit du vino rosso dans son garage. Mais c’est aussi au dessin qu’il se livre, à l’aide d’une mine de plomb, il recouvre des cartons de boîtes de biscottes.
Joseph a 84 ans lorsqu’il expose pour la première fois. Ses créations figurent dans les plus importantes collections d’art brut dont celle de Lausanne.
In his garage in Puy-de-Dôme, Joseph Barbiéro carved volcanic stone into inimitable sculptures— most often faces, marked by a raw execution and a rugged line. Born of unpolished matter, his work radiates a striking authenticity and an elemental expressive power.
Barbiéro fled Mussolini’s rise to power and found refuge in Auvergne, where he worked as a mason. It was only upon retirement that his creative spirit truly emerged: between tending his vegetable garden, he would carve, hum to himself, and sip vino rosso in his garage. He also turned to drawing, covering rusk-box cardboard with graphite sketches. At the age of eighty-four, Barbiéro exhibited for the first time. Today, his creations feature in major Art Brut collections, including the renowned Collection de l’Art Brut in Lausanne.
Franco Bellucci
Italie
1945 - 2020
Bellucci a commencé à créer des objets à la fin des années 70, canalisant ainsi ses pulsions destructrices et les conciliant – par l’emploi fréquent de jouets – avec l’état d’enfance auquel une encéphalite l’avait assigné dès le plus jeune âge. Privé de parole, il s’est alors mis à produire, par hybridation, des objets que l’on perçoit tantôt comme transitionnels, tantôt comme fétiches. Révélées par l’artiste Riccardo Bargellini, ses sculptures hybrides forment un langage mystérieux où les destinées se croisent et se répondent. Ses œuvres, intégrées aux collections du Musée national d’Art moderne (Pompidou) ou du Museum für Moderne Kunst de Francfort, ont été exposées dans nombres de manifestations majeures.
« Ces œuvres sont douées d’une puissance symbolique que bien des artistes ‘professionnels’ sont incapables d’atteindre. » (Ph. Dagen, Le Monde).
Bellucci began creating objects in the late 1970s, channeling his destructive impulses and reconciling them—through the frequent use of toys—with the state of childhood to which encephalitis had confined him from a very young age. Deprived of speech, he started producing hybrid objects, perceived at times as transitional, at other times as fetishes. Brought to light by artist Riccardo Bargellini, his hybrid sculptures form a mysterious language in which destinies intersect and echo one another. His works, now part of the collections of the Musée National d’Art Moderne (Centre Pompidou) and the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, have been shown in numerous major exhibitions.
“These works possess a symbolic power that many ‘professional’ artists are incapable of achieving.”
(Ph. Dagen, Le Monde)
Franco Bellucci
Giovanni Bosco
Italie 1948 - 2009
Ce berger sicilien sombra dans la psychose suite à l’assassinat de deux de ses frères. L’institution psychiatrique et la prison à laquelle il fut condamné à la suite d’un vol de bétail, ne lui ôtèrent ni son sourire désarmant, ni la propension à transformer son existence démunie en un acte de poésie pure.
Ses journées furent alors rythmées par les chansons populaires et les peintures d’une inventivité rare qu’il exécutait sur les murs de sa ville ou sur des matériaux de fortune. Corps démembrés ou "surmembrés", serpenteaux, cœurs céphaliques, mots scandés dans l’intervalle du dessin, tel est l’alphabet pictural de Bosco. Inventeur d’un langage plastique sans pareil, l’artiste fait aujourd’hui partie de prestigieuses collections dont celles d’Antoine de Galbert ou d'abcd/Bruno Decharme (France).
This Sicilian shepherd fell into psychosis following the murder of two of his brothers. Neither the psychiatric institution nor the prison, where he was sentenced after a cattle theft, managed to take away his disarming smile or his ability to transform his destitute existence into an act of pure poetry. His days were then punctuated by folk songs and paintings of rare inventiveness, which he created on the walls of his town or on makeshift materials. Dismembered or "over-membered" bodies, serpentine creatures, cephalic hearts, and words punctuated between drawings—this was Bosco’s pictorial alphabet.
As the creator of a unique visual language, the artist is now part of prestigious collections, including those of Antoine de Galbert and abcd/Bruno Decharme (France).
Giovanni Bosco
Paul Duhem
Belgique 1919 - 1999
Étonnante trajectoire que celle de ce fils naturel, rebelle et querelleur, rejeté par sa famille et quittant l’école à 13 ans pour devenir garçon de ferme. Après guerre, une fois diagnostiquée sa déficience mentale, il sera d’abord interné puis redeviendra ouvrier agricole. C’est en 1978 que Paul a intégré le centre de la Pommeraie où il s’est adonné sans relâche à son œuvre, trouvant dans la couleur les moyens de révéler les sensations qu’il lui était difficile de communiquer par les mots, brisant ainsi la solitude de sa condition. Plus de vingt heures par semaine, il dessinait sans relâche des visages et des portes, de manière répétitive et obsessionnelle.
Paul Duhem a connu de son vivant les honneurs d’une rétrospective à la Collection de l’Art Brut, à Lausanne en 1990.
Devenu la figure majeure de l’art brut belge, il a désormais rejoint les meilleures collections au monde.
An astonishing trajectory for this illegitimate son, rebellious and quarrelsome, rejected by his family and leaving school at the age of thirteen to become a farmhand. After the war, once his mental disability was diagnosed, he was first institutionalized before returning to work as an agricultural laborer. In 1978, Paul entered the Pommeraie center, where he devoted himself tirelessly to his art, finding in color a means of revealing the sensations he could not easily express in words, thus breaking through the solitude of his condition. More than twenty hours each week, he obsessively and repetitively drew faces and doors.
During his lifetime, Paul Duhem was honored with a retrospective at the Collection de l’Art Brut in Lausanne in 1990. Having become a leading figure of Belgian Art Brut, his work has since entered major collections worldwide.
José Manuel Egea
Espagne 1988
Ce jeune artiste madrilène, convaincu de sa lycanthropie, se plaît à faire surgir la part d’animalité qui réside en chaque être en affublant au crayon d’attributs monstrueux les personnes des pages de magazines, parfois annotées de mots ou de phrases. Ici, une œuvre rare tant par son format que par l’omniprésence du texte. José Manuel Egea s’adonne à un jeu libérateur puisque, tout en malmenant notre humanité, en s’émancipant de la norme, il nous révèle les grandeurs de l’altérité dans un geste artistique pur et sans retenue.
Défendu par la galerie depuis 2016 il a fait l’objet, la même année, d’une vaste présentation lors de la Biennale de l’Image possible, à Liège. Il est désormais présent dans de grandes collections européennes comme celles d’Antoine de Galbert ou de Laurent Dumas (France).
Convinced of his magical ability to become a wolf, this young artist from Madrid is fascinated by the Kafkaesque metamorphosis found in the world of comics and mythology. As polymorphic as he is, his work consists of drawings, sculptures and performances, and urges us to accept our own repressed gifts for shape-shifting.
Promoted by the gallery since 2016, he had a major show that same year by the Biennale de l’image possible in Liège, Belgium. His work is now part of several major European collections of contemporary art such as those of Antoine de Galbert, or Laurent Dumas.
Guo Fengyi
Chine 1948 - 2009
En vivant sa spiritualité à travers les voies du QiGong, c'est à l’aube de ses 40 ans que Guo Fengyi se met à réinterpréter les croyances populaires chinoises dans des dessins réalisés à l’encre et au pinceau. Sur des rouleaux de papier de riz, pouvant atteindre les 10 m, se déploient des entités relevant tantôt du panthéon, tantôt du pandémonium, et qui semblent flotter dans un vide spatio-temporel. Technicienne dans une usine de caoutchouc, elle souffrait de terribles crises d’arthrite, qui l'a contrainte de cesser toute activité professionnelle à trente-neuf ans. Pour soulager ses crises, Guo s’initie au Qi-Gong, qui lui ouvre de nouvelles portes, notamment spirituelles.
Ces rouleaux hérétiques ont notamment été exposés lors de la 55e Biennale de Venise, sous le commissariat de Massimiliano Gioni.
Living her spirituality through the practice of QiGong, Guo Fengyi began, at the dawn of her forties, to reinterpret Chinese popular beliefs in ink and brush drawings. On rice paper scrolls that can reach up to 10 meters, entities emerge—sometimes drawn from the pantheon, sometimes from the pandemonium—seemingly floating in a spatio-temporal void.
A technician in a rubber factory, she suffered from severe arthritis, which forced her to stop working at the age of thirty-nine. To relieve her pain, Guo turned to Qi-Gong, which opened new doors for her, particularly on a spiritual level.
These unorthodox scrolls were notably exhibited at the 55th Venice Biennale, curated by Massimiliano Gioni.
Leonhard Fink
Autriche 1982 -
Leonhard Fink travaille à l’atelier de Gugging depuis 2001 où il dessine volontiers des femmes voluptueuses aux allures parfois guerrières, des vélos énormes, des monstres hybrides au nez crochu et des édifices saugrenus. Son trait est rapide et impulsif, puis il remplit ses formes de textures mixtes, de structures ornementales très riches, sujettes à de brusques altérations, auxquelles se mêlent des éléments organiques. Ses créations ne subissent aucune influence artistique extérieure ; il choisit seul ses sujets et dessine de manière spontanée. Il est capable de s’immerger si totalement dans le flux de sa créativité que le résultat peut paraître confus pour lui-même et pour son entourage. Mais cette impression d’un assemblage hasardeux de fragments pendant le processus de création aboutit presque chaque fois à une composition des plus harmonieuses.
Leonhard Fink has been working at the Gugging Art Studio since 2001, where he readily draws voluptuous women with sometimes warrior-like appearances, enormous bicycles, hybrid monsters with hooked noses, and whimsical buildings. His line is quick and impulsive, later filled with mixed textures and richly ornamented structures, often subject to sudden alterations and interwoven with organic elements. His creations are free from external artistic influence; he chooses his subjects independently and draws spontaneously. He can immerse himself so completely in the flow of his creativity that the result may seem chaotic both to himself and those around him. Yet this impression of a haphazard assembly of fragments during the creative process almost always culminates in a composition of remarkable harmony.
Alexandro Garcia
Uruguay 1970
Jardinier uruguayen, Alexandro García s’est mis à retranscrire ses visions éthérées à la suite d’une rencontre du 3e type dont il a fait l’expérience, enfant. Digne héritier du réalisme magique, il en dépasse cependant le cadre et nous parle d’un ailleurs offert à nos projections et à la colonisation d’une humanité nouvelle aux travers d’architectures habitées et saturées. Ses dessins d’un graphisme méticuleux mêlent cités fantastiques – comme en apesanteur ou sur le point de s’élancer dans l’infini sidéral – et ballets de constellations venues à leur rencontre. Il y est question d’un ailleurs offert à nos projections et à la colonisation d’une humanité nouvelle : « nous ne sommes pas seuls », a-t-il l'habitude de dire.
Uruguayan gardener Alexandro García began translating his ethereal visions following a childhood encounter of the third kind. A worthy heir to magical realism, he transcends its bounds, presenting a realm open to our projections and to the colonization of a new humanity through inhabited, saturated architectures. His meticulously rendered drawings combine fantastical cities—sometimes floating, sometimes poised to soar into the cosmic void—with ballets of constellations that come to meet them. His work constantly evokes an elsewhere open to our imagination and the emergence of a new humanity: “we are not alone,” he often says.
Pietro Ghizzardhi
Italie 1906-1986
Pietro Ghizzardi est l’un des artistes emblématiques de l’art brut italien. Né dans une famille de modestes paysans, il connut une vie difficile. Il perdit son père jeune, et dut vivre seul avec une mère à l'influence malsaine, et un frère qui se plaisait à ridiculiser et contrarier ses inspirations artistiques. Il n’a exercé que des métiers très modestes qui lui permettaient tout juste de subsister, balayeur des rues, domestique, ouvrier agricole. Ghizzardi commença a créer à trente-six ans, du dessin tout d’abord, puis dix ans plus tard, s’initia à la peinture. Trop pauvre pour acheter des toiles, il peignait sur du carton ondulé qu’il trouvait dans une usine voisine, et fabriquait lui-même ses couleurs à base de suie de cheminée, de plantes et de minéraux. Le portrait domine dans son œuvre, avec une obsession pour la femme, mère, épouse, qu’il peint d’un trait fiévreux ; les corps se contorsionnent, les sourires grimacent, les regards sont brûlants
Pietro Ghizzardi is one of the emblematic figures of Italian art brut. Born into a humble peasant family, he endured a difficult life. He lost his father at a young age and had to live with a mother who exerted a harmful influence on him, and a brother who took pleasure in ridiculing his artistic impulse. Ghizzardi held only menial jobs that barely allowed him to survive—street sweeper, domestic worker, farm laborer. He began creating at the age of thirty-six, starting with drawing, and ten years later turned to painting. Too poor to buy canvases, he painted on corrugated cardboard he found in a nearby factory, making his own paints from chimney soot, plants, and minerals. Portraiture dominates his work, with an obsession for women—mothers, wives—depicted with feverish strokes; bodies contort, smiles grimace, and gazes blaze with intensity.
Ted Gordon
États-Unis 1924 -
Rejeté par sa mère, Ted Gordon est élevé par ses grands-parents d’origine lituanienne, qui le considèrent comme une réincarnation de son frère décédé pendant la Première Guerre mondiale. À quatorze ans, profondément marqué par le suicide de son père, il dessine alors des caricatures en son hommage. Après une brève incursion à l’université, il traverse le pays, gagnant sa vie dans des emplois divers. La rencontre avec sa future femme lui donne un point d’ancrage. En parallèle de son travail d’employé dans un hôpital, Ted Gordon mène une activité artistique intense. Ses dessins jusqu’alors réalisés sur de petits bouts de papier - caricatures ou griffonnages automatiques - évoluent vers des autoportraits, sur des formats sensiblement plus grands.
Ses l’œuvres font notamment partie du fonds du centre national d'art et de culture (Pompidou), Smithsonian American Art Museum. etc.
Rejected by his mother, Ted Gordon was raised by his Lithuanian-born grandparents, who considered him a reincarnation of their son who had died during the First World War. At the age of fourteen, deeply affected by his father’s suicide, he began drawing caricatures in his memory. After a brief stint at university, he traveled across the country, supporting himself through various jobs. Meeting his future wife eventually gave him a point of stability. Alongside his work as a hospital employee, Ted Gordon pursued an intense artistic practice. His drawings—at first made on small scraps of paper, as caricatures or automatic doodles—gradually evolved into self-portraits on much larger formats. His works are now part of several major collections, including the Centre Pompidou in Paris, theSmithsonian American Art Museum...
Johann Hauser
Tchécoslovaquie 1926 - 1996 Autriche
Johann Hauser est très tôt dirigé dans une école spécialisée dont il ne dépasse pas la seconde année. Considéré comme « faible d’esprit », il entre à 17 ans à l’hôpital psychiatrique de Mauer-Ohling pour être transféré, cinq ans plus tard, à Gugging. Là, le Dr Navratil l’encourage à dessiner. Puisant son inspiration dans les magazines illustrés, Johann malaxe l’image, la transfigure jusqu’à en extraire sa patte d’artiste on ne peut plus inimitable. Les femmes qu’il représente, agressives et dépouillées, ont leurs attributs sexuels outrageusement exhibés tandis que leurs poils et cheveux envahissent l’image. Les feuilles que Johann utilise portent la trace de la fougue créatrice qui l’anime : le papier est gaufré par le passage du crayon, relief qui, retraçant la genèse de l’œuvre, en redouble la puissance. Ses l’œuvres font notamment partie du fonds du centre national d'art et de culture (Pompidou).
Johann Hauser was directed at an early age to a special school, which he left after only two years. Considered “feeble-minded,” he entered the psychiatric hospital of Mauer-Öhling at the age of seventeen, and five years later was transferred to Gugging. There, Dr. Navratil encouraged him to draw. Drawing inspiration from illustrated magazines, he kneaded and transfigured the images until he extracted an utterly inimitable artistic mark. The women he depicts—aggressive and stripped bare—have their sexual attributes outrageously exposed, while hair and body hair invade the image. The sheets Johann used still bear the imprint of his fervent creative drive: the paper is embossed by the force of his pencil, a relief that retraces the genesis of the work and doubles its intensity. His works are held in several major collections, including that of the Centre Pompidou in Paris.
Josef Hofer
Autriche 1945
Pensionnaire depuis 1992 d’une institution autrichienne, Josef Hofer ne parle pas, il dessine. Inlassablement. Dans le miroir qu’il se tend et qu’il nous tend, les personnages tentent de prendre leur essor dans le carcan du cadre avec une grâce érotisée, indomptée. Ses productions - auxquelles Michel Thévoz a consacré plusieurs essais - mettent en images une dualité fondatrice entre le corps et la psyché.
Il est notamment présent dans le Musée national d’Art moderne (France), et dans des collections privées dont celles d'Antoine de Galbert et d’Arnulf Rainer (Autriche) qui le considère comme « l’un des plus grands artistes d’art brut contemporains ».
A resident of an Austrian institution since 1992, Josef Hofer does not speak—he draws. Tirelessly.
In the mirror he holds up to himself and to us, his figures strive to break free from the confines of the frame with a raw, erotic grace. His works—on which Michel Thévoz has written extensively—visually express a fundamental duality between the body and the psyche.
Hofer's art is featured in the Musée National d’Art Moderne (France) and in private collections, including those of Antoine de Galbert and Arnulf Rainer (Austria), who considers him “one of the greatest contemporary art brut artists.”
Josef Hofer
Tomasz Machciński
Pologne 1942-2022
Orphelin de guerre, Tomasz Machciński a grandi en croyant être le fils d'une actrice américaine. Dix ans avant Cindy Sherman, cet ouvrier s’est lancé dans une quête d’identité effrénée, à travers plus de 22 000 autoportraits incarnant une multitude de figures – stars, icônes pop, personnages historiques, durant 50 ans de sa vie. Refusant artifices et maquillages, il intègre dans son travail les marques du temps et développe ses clichés dans sa salle de bain avant de travailler la couleur avec un appareil photo numérique acquis au début des années 2000.
Découvert récemment, ce grand œuvre a été acclamé aux Rencontres d’Arles, à Paris Photo, au Musée d’art moderne de Varsovie et à l’Independent Art Fair, à New York.
A war orphan, Tomasz Machciński grew up believing he was the son of an American actress. Ten years before Cindy Sherman, this factory worker embarked on a relentless quest for identity through more than 22,000 self-portraits embodying a multitude of figures—stars, pop icons, historical characters—over the span of fifty years. Rejecting artifice and makeup, he incorporated the marks of time into his work, developing his prints in his bathroom before moving to color with a digital camera acquired in the early 2000s.
Recently rediscovered, this monumental body of work has been acclaimed at the Rencontres d’Arles, Paris Photo, the Museum of Modern Art in Warsaw, and the Independent Art Fair in New York.
Dwight Mackintosh États-Unis 1906-1999
Mackintosh commence à créer à 72 ans, après avoir passé 56 années en institutions psychiatriques. Il produit alors une multitude de dessins caractérisés par l’omniprésence d’écritures inintelligibles qui semblent couler sur la page.
Ses sujets de prédilection oscillent entre personnages masculins, bus, trains, anges et animaux fantastiques. Les lignes des contours sont souvent redoublées – peut-être juste pour le plaisir du geste, ou manière de s’affirmer, en tant qu’artiste.
Son œuvre fait partie des collections permanentes de la collection de l’art brut à Lausanne - qui lui a déjà consacré une retrospective-, du centre Pompidou, de l’American Folk Art Museum à New York ou du Madmusée de Liège.
Mackintosh began to create at the end of his life, after spending 56 years in psychiatric institutions. At the age of 72 he produced a multitude of drawings, paintings, prints and ceramics. His work is characterised by the omnipresence of unintelligible writing that seems to flow across the page.
His favourite subjects oscillate between male characters, buses, trains, angels and fantastic animals. The lines of the contours are often redoubled - perhaps just for the pleasure of the gesture, or as a way of asserting himself as an artist.
His work is part of the permanent collections of the Collection de l'Art Brut in Lausanne - which has devoted a retrospective to him -, of the Centre Pompidou, of the American Folk Art Museum in New York and of the Madmusée in Liège.
Edmund Monsiel Pologne 1897-1962
Edmund Monsiel quitte l'école sans diplôme et ouvre une échoppe dans un village que les Allemands lui confisquent en 1942. Il se réfugie chez son frère à Wozuczyn, petite ville de la province de Lublin persuadé que les nazis le recherchent et reste caché dans le grenier pendant 20 ans, jusqu'à sa mort. En 1943, alors que la guerre bat son plein, il commence à dessiner.
Ce n'est qu'après sa mort que l'on trouve ses quelques 500 créations « inspirées » de l’iconographie traditionnelle, populaire et religieuse. Des myriades de visages, souvent barbus, couvrent la totalité de la page, en une répétition obsédante. Les plus petits sont difficiles à distinguer, quelques fois jusqu'à 3 000 figures sont représentées sur le même dessin.
Edmund Monsiel left school without a diploma and opened a small village store that the Germans took over in 1942. He took refuge at his brother’s home in Wozuczyn, a small city in the Lubin province, convinced that the Nazis were after him, and remained hidden in the attic for 20 years, until his death. In 1943, at the peak of the war, he began to draw.
It was not until after his death that some 500 of his creations were found, “inspired” by traditional, popular and religious iconography. Myriads of faces cover the entirety of the page, obsessively repeated. The smallest ones are difficult to distinguish; sometimes, up to 3000 figures are represented in the same drawing.
Albert Moser
États-Unis 1928-2022
Cet artiste américain, autiste, a vécu la majeure partie de sa vie chez ses parents, avant de rejoindre le foyer d’accueil du New Jersey où il vécut jusqu'à sa mort. Moser a d’abord obtenu la reconnaissance pour ses panoramas photographiques bricolés, puis pour ses dessins géométriques aux relents psychédéliques. Mais quel que soit le médium, ses travaux témoignent de la même obsession de l’espace. Ils rendent compte, à leur manière, du vertige au travers duquel il tente de trouver sa place dans le monde.
Exposé en 2019 aux Rencontres de la photographie d’Arles, son travail fait notamment partie des collections d’Antoine de Galbert (France), ou encore Treger Saint Silvestre (Portugal).
This American artist, who was autistic, lived most of his life with his parents before moving to a care home in New Jersey, where he remained until his death. Moser first gained recognition for his makeshift photographic panoramas, and later for his geometric drawings with psychedelic overtones. Whatever the medium, however, his work reflects the same obsession with space. It conveys, in its own way, the vertigo through which he sought to find his place in the world.
Exhibited in 2019 at the Rencontres de la Photographie in Arles, his work is held in several major collections, including those of Antoine de Galbert (France) and Treger Saint Silvestre (Portugal)..
John Bunion Murray États-Unis 1908-1988
J.B. Murray, métayer afro-américain illettré de Géorgie, ne se tourne vers la création qu’à la fin de sa vie. Dans les années 1970, après une vision mystique du soleil et d’un aigle, il affirme recevoir des messages divins qu’il transcrit sous forme d’« écriture spirituelle », illisible sans un rituel impliquant l’« eau bénite » de son puits. Ses œuvres, d’abord tracées sur des papiers de fortune, se densifient : signes compacts, portails vibrants, champs colorés où le rouge incarne le mal, le bleu la protection et le jaune le divin. Son art, à la croisée de la prière, de la vision et de l’incantation, témoigne de la puissance créatrice d’un langage intérieur, conçu hors des cadres établis et nourri par une foi ardente. Son œuvre fait partie du fonds des musées American Folk Art Museum, Smithsonian American Art Museum ou Metropolitan Museum of Art.
J. B. Murray, an illiterate African American sharecropper from Georgia, only turned to art at the end of his life. In the 1970s, after a mystical vision of the sun and an eagle, he claimed to receive divine messages, which he transcribed in a form of “spirit script” legible only through a ritual involving the “holy water” drawn from his well. His works, first made on scraps of paper, soon grew in complexity: dense signs, vibrating portals, and chromatic fields where red embodied evil, blue offered protection, and yellow signified the divine. His art, at the crossroads of prayer, vision, and incantation, bears witness to the creative power of an inner language, conceived outside established frameworks and nourished by fervent faith. His work is represented in the collections of the American Folk Art Museum, the Smithsonian American Art Museum, and the Metropolitan Museum of Art.
Michel Nedjar
France 1947
Il est l’artiste brut vivant le plus exposé et publié et pourtant la trajectoire extraordinaire de ce Français pose une question rarement abordée : celle de l’impermanence de l’art brut. Découvert par Jean Dubuffet, au moment où il travaille sur la résurgence du corps symbolique, il s’autorise alors à devenir l’artiste protéiforme que l’on connaît et qui, dans la création, incarne une absolue liberté. Présent dans d’innombrables collections, il est le premier « brut » à être entré dans les collections du Musée national d’art moderne (France). Depuis 2008 il s’est vu consacrer six expositions monographiques par Le Mahj (Paris), le LaM (Lille), le musée Gugging (Vienne) et la galerie.
Though Frenchman Michel Nedjar is the most widely exhibited and published living representative of art brut, his extraordinary trajectory poses a rarely-adressed question – namely, the impermanence of art brut. Discovered by Jean Dubuffet when the latter was working on the resurgence of the symbolic body, Nedjar became the protean artist whom we know today and who embodies absolute freedom in creation.
Present in countless collections, he is the first brut artist whose works were included in the collections of Beaubourg (France). Since 2008, he has had no fewer than six solo shows at such venues as Le Mahj (Paris), LaM (Lille), the Gugging Museum (Vienna), and the gallery.
Melvin Edward Nelson
États-Unis 1908-1992
Melvin Edward Nelson se fait appeler MEN « Mighty Eternal Nation ». Il est un temps électricien avant de quitter sa femme et ses enfants pour s’installer en 1948 dans l’Oregon. En 1958 il achète un terrain au sud-est de Portland où il vit en ermite refusant, entre autres, de se laver. Entre 1961 et 1966, il développe ses recherches « scientifiques » qui prennent forme en une production picturale abondante. Il prélève des échantillons de terre et de roches de son terrain qui selon lui ont été modifiés par la présence fréquente d’OVNIS, ces échantillons chargés de forces magnétiques et d’énergies de l’univers servent de pigments pour ses peintures. Les images qui en résultent représentent des paysages imaginaires qui reflètent l’immense étendue du temps et de l’espace et témoignent de ses voyages astraux.
Melvin Edward Nelson called himself MEN –“Mighty Eternal Nation.” For a time he worked as an electrician, before leaving his wife and children in 1948 to settle in Oregon. In 1958, he purchased a plot of land southeast of Portland, where he lived as a hermit, refusing, among other things, to wash. Between 1961 and 1966, he pursued his “scientific” research, which took shape in a prolific body of paintings. He collected soil and rock samples from his property which, he claimed, had been altered by the frequent presence of UFOs. These samples, charged with magnetic forces and energies from the universe, served as pigments for his paintings. The resulting images depict imaginary landscapes that evoke the vast expanse of time and space and bear witness to his astral journeys.
Martin Ramirez Mexique 1895-1963 États-Unis
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Ramírez s’installe aux États-Unis en 1925 pour y travailler dans les mines et les chemins de fer californiens jusqu’à ce qu’il soit arrêté par la police en 1931. Il est finalement déclaré schizophrène et interné à l’hôpital d’État de Stockton, puis à celui de DeWitt à Auburn, où il passera le reste de sa vie. C’est là qu’il découvre l’art et crée les dessins et collages complexes et fascinants qui ont fait sa renommée. Il dessine sur des morceaux de papier récupérés sur lesquels il étale une pâte confectionnée à base de crayons, charbon, jus de fruits, cire à chaussures, salive... Son œuvre, à la fois narrative et abstraite, circonscrit tout en les détournant des représentations de sa culture (le bandito mexicain, la madone, le train, etc.) dans des entrelacs formels.
Son œuvre est présente dans les collections du Guggenheim, du MoMA et de Pompidou.
To provide for his family, Ramírez moved to the United States in 1925, working in California’s mines and railroads until his arrest in 1931. He was eventually diagnosed with schizophrenia and confined to the Stockton State Hospital, later transferred to DeWitt State Hospital in Auburn, where he would spend the rest of his life. It was there that he discovered art, producing the intricate and mesmerizing drawings and collages for which he is now renowned. Working on scraps of paper, he spread a homemade paste made from crayons, charcoal, fruit juice, shoe polish, and even saliva. His work, at once narrative and abstract, reinterprets and subverts motifs from his culture—such as the Mexican bandito, the Madonna, or the train— through dense and formal entanglements. His œuvre is represented in the collections of the Guggenheim, MoMA, and Centre Pompidou.
Guillermo Rigoberto Casola Marcos
Cuba 1961-2025
Cet artiste, né à La Havane, est plus connu sous le nom de Rigo. Comme lui, ses parents et sa fratrie souffraient de troubles mentaux. Rigo dessine depuis l’enfance et, lorsqu’il n’offrait pas ses dessins, il les jetait. Ses gouaches cherchent à exprimer son quotidien : le ressenti d’un Cubain pauvre, mi-artiste, mi-fou, mais non dénué d’humour. À mi-chemin entre peinture pop et illustration, ces saynètes se déploient comme un story-board horizontal, composé de petites feuilles de papier de récupération assemblées. Son langage graphique très affirmé doit beaucoup à ses talents de coloriste. Bien qu’il ait été interné à deux reprises en hôpital psychiatrique, Rigoberto travailla comme gardien dans un service de l’État, jusqu’à l’accident tragique qui lui coûta la vie en 2025.
This artist, born in Havana, is best known as Rigo. Like him, his parents and siblings suffer from mental disorders.
Rigo has been drawing since childhood, and when he doesn’t give his drawings away, he throws them away. His gouaches attempt to express his daily life—the experience of a poor Cuban, half-artist, half-madman, yet not without humor. Somewhere between pop painting and illustration, his scenes unfold like a horizontal storyboard, composed of small scraps of recycled paper pieced together. His strong graphic language owes much to his talent as a colorist.
Although he has been hospitalized twice in psychiatric institutions, Rigoberto now works as a guard in a state service.
Sava Sekulić
Croatie 1902-1989 Serbie
Sava Sekulic n’est jamais allé à l’école. Son père meurt l’année de ses dix ans, le laissant avec sa mère, ses trois petites sœurs, et ces dernières paroles : « Apprends par toi-même, dessine et écris avec une pierre dans la main ». Abandonné par sa mère qui se remarie, il travaille dans un château puis est envoyé sur le front austro-italien en 1917 où il est blessé et perd un œil. Il se marie mais sa femme meurt peu de temps après le décès de leur enfant. Il apprend à lire et à écrire seul et commence à écrire des poèmes. Sa première peinture date de 1932, mais il ne se livre à plein temps à son activité artistique qu’en 1962, au moment où il prend sa retraite. À travers ses visions, il a élaboré une définition picturale unique, réduisant la thématique à une métaphore et préfigurant une symbiose des figures anthropomorphes et zoomorphes, où toute l’alchimie de son expression picturale se révèle avec évidence.
Sava Sekulić never went to school. His father died when he was ten, leaving him with his mother, his three younger sisters, and these last words: “Learn by yourself, draw and write with a stone in your hand.” Abandoned by his mother who remarried, he worked in a manor house before being sent to the Austro-Italian front in 1917, where he was wounded and lost an eye. He married, but his wife died soon after the death of their child. He taught himself to read and write and began composing poems. His first painting dates from 1932, but he only fully devoted himself to his artistic activity in 1962, when he retired. Through his visions, he developed a unique pictorial definition, reducing the subject matter to a metaphor and anticipating a symbiosis of anthropomorphic and zoomorphic figures, where the full alchemy of his pictorial expression becomes evident.
Mary T. Smith
États-Unis 1925 - 2007
Enfant pauvre du Mississippi contrainte aux labeurs les plus durs, cette Afro-Américaine a entamé, au soir de sa vie, un œuvre qui s’apparente à un véritable blues graphique. Mary T. Smith donnait corps à sa cosmologie personnelle en peignant sur des panneaux de tôle et de bois disposés autour de sa maison. Son “esthétique solaire” — dixit Daniel Soutif — et ses modes de représentation puissamment élémentaires ont fait forte impression sur JeanMichel Basquiat.
Aujourd’hui considérée comme une figure emblématique de l’art brut américain, ses œuvres sont entrées au Metropolitan Museum of Art (New York), au Smithsonian Museum of American Art (Washington) ou encore au High Museum of Art (Atlanta).
A poor child of Mississippi condemned to the hardest work, this African-American woman began, at the dawn of her life, a work that resembles a real graphic blues. Mary T. Smith gave shape to her personal cosmology by painting on sheets of corrugated iron and wooden panels arranged around her house. Her “solar aesthetic”—says Daniel Soutif—and her powerfully elementary modes of representation made a strong impression on Jean-Michel Basquiat.
Now considered an emblematic figure of American art brut, her works have been added to the Metropolitan Museum of Art (New York), the Smithsonian Museum of American Art (Washington) and the High Museum of Art (Atlanta) collections.
Mary T. Smith
Scottie Wilson
Grande Bretagne 1888-1972
Collectionné par Picasso, André Breton et Jean Dubuffet, Scottie Wilson est un artiste majeur du XXe siècle. Ses œuvres naissent d’une multiplication de traits finement appliqués.
Analphabète, à 10 ans, il vend des journaux dans les rues de Glasgow, à 16 ans, il s’engage dans l’armée et sert aux Indes et en Afrique du Sud. À Londres, il ouvre une échoppe ambulante avant de tenir une brocante au Canada. Il commence à dessiner dans son arrière-boutique à l'âge de 44 ans. En 1943 a lieu sa première exposition à Toronto. De retour en Angleterre, il cède ses œuvres à bas prix mais en 1947, il fait partie de l'exposition surréaliste à la galerie Maeght à Paris, puis est montré à Bâle, New York et Londres.
Collected by Picasso, André Breton, and Jean Dubuffet, Scottie Wilson is recognized as a major artist of the twentieth century. His works are born from the multiplication of finely applied lines.
Illiterate, at the age of ten he sold newspapers on the streets of Glasgow; at sixteen, he enlisted in the army and served in India and South Africa. In London, he ran a street stall before moving to Canada, where he kept a second-hand shop. It was in the back of this shop, at the age of fortyfour, that he began to draw. His first exhibition took place in Toronto in 1943. Back in England, he sold his works at low prices, but in 1947 he took part in the Surrealist exhibition at the Galerie Maeght in Paris, and was later shown in Basel, New York, and London.
Adolf Wölfli
Suisse 1864-1930
Adolf Wölfli a construit un univers personnel, où il réinvente son passé et projette un avenir utopique La richesse et la démesure de cet œuvre provoquent le vertige, à l’image de sa présence dans les collections : musée national d’art moderne, collection Prinzhorn, LaM... Comme le soulignait déjà André Breton, c’est là « une des trois ou quatre œuvres capitales du XXe siècle ».
Wölfli connaît une enfance rude. Son père noyait sa paye dans l’alcool. Miséreux, Wölfli et sa mère sont placés comme manœuvre dans des fermes où il connaît d’âpres traitements. En 1890, il est incarcéré pour attentat à la pudeur. Cinq ans plus tard, il est interné à la clinique psychiatrique de Waldau près de Berne, où il mourra en 1930.
Adolf Wölfli built a personal universe in which he reinvented his past and projected a utopian future. The richness and excess of this œuvre provoke a sense of vertigo, reflected in its presence within major collections: the Musée National d’Art Moderne, the Prinzhorn Collection, LaM... As André Breton already observed, it is “one of the three or four most important works of the twentieth century.”
Wölfli endured a harsh childhood. His father squandered his wages on alcohol. Reduced to poverty, Wölfli and his mother were placed as farmhands, where he suffered harsh treatment. In 1890, he was imprisoned for indecent assault. Five years later, he was committed to the Waldau Psychiatric Clinic near Bern, where he would remain until his death in 1930.
Carlo Zinelli
Italie 1919-1974
Interné définitivement à l’âge de 31 ans après avoir participé à la guerre d’Espagne avec le contingent italien, Carlo Zinelli est aujourd’hui considéré comme une figure phare de l’art brut. Sortes de contes illustrant des épisodes ayant précédé son internement, ses dessins itératifs et disloqués dans lesquels la perspective est abolie au profit d’écritures interstitielles, semblent annoncer le concept de « modernité ». Mis à l’honneur dans nombre d’expositions internationales, Carlo Zinelli a été exposé au Giardini lors de la Biennale de Venise de 2013 et nous avons le plaisir de présenter ses œuvres à l’occasion d’Art Basel Paris 2024. Un ensemble important de ses œuvres a rejoint en 2021 les collections du Centre Pompidou.
Committed at 31 years old after participating in the Spanish Civil War, Carlo Zinelli is now seen as a major figure of art brut. Like tales illustrating episodes of his life before his internment, his iterative and dislocated drawings in which perspective is abandoned and replaced by interstitial writings aligned with the concept of “modernity”. Honored in many international exhibitions, Carlo Zinelli was exhibited in the Giardini at the 2013 Venice Biennale and we are pleased to present his work at Art Basel Paris 2024. Many of his works were donated to the Centre Pompidou in 2021.
Carlo Zinelli
john patrick mckenzie
christian berst foreword
It is not uncommon for the terms art brut and primitive art to be conflated. Two reasons may explain this. The first lies in the adjectives brut and primitive, which both appear to point toward works in an original, unmediated state. The second is that these forms of art compel a displacement of the Western gaze, inviting us to engage with a radical otherness—whether cultural or deeply intimate.
Like art brut, primitive art stands at the margins of norms and the academy. Although the institutional recognition of primitive art preceded that of art brut by nearly a century, the “elsewheres” illuminated by these fields compel us to broaden the horizon of art history and, in doing so, to reconsider the very definition of art
Of course, where primitive art bears witness to collective mythologies—as underscored by the anonymity of its makers—art brut reveals individual mythologies, highlighted by the insularity of its authors. And while certain apparent affinities may be purely fortuitous, formal analogies abound, betraying a common ground, a shared archetypal source. The artists of the twentieth century understood this well: by collecting both, they were animated by the diffuse impression of returning to an Edenic stage of art.
In any case, it is striking that both art brut and primitive art appear to arise from the same
quest for answers to the great existential questions. These creators ascribe to art the power to inhabit the world, to mend it, to construct bridges toward the unknown, the supernatural, the sublime. “Primitive” and “brut” alike exalt the notions of secrecy and the sacred—hence why their works seem so profoundly inhabited: by spirits, in the one case, and by their authors, in the other.
The gallery’s twentieth anniversary, more than an occasion for celebration, inspired me to entrust this curatorship to Daniel Klein and Antoine Frérot, two dear friends and long-standing supporters of the gallery. Both are driven by a desire to dismantle categories, both foster within their own collections dialogues and confrontations that act as revelatory markers— markers to which I myself am profoundly attached.
interwiew
daniel klein, antoine frérot & christian berst
Daniel Klein, a passionate collector, first turned his attention to Ecuadorian folk art and the arts of Africa and Oceania. In 2010, together with his wife Carmen Viteri, he founded La Casa del Alabado, housed in one of the oldest colonial residences in Quito’s historic center. The museum showcases their private collection of Pre-Columbian art, comprising more than 5,000 works. Remaining faithful to their interest in both the arts of non-European cultures and contemporary art, the couple has, over the past twenty years, built a major art brut collection and helped bring to light numerous South American artists, many of whom are now represented by the gallery.
Antoine Frérot is best known as the former CEO of Veolia, but also as an astute and passionate collector. His journey began with modern art, before extending to the arts of Africa and Oceania. In 2014, he was named honorary president of the 13th edition of Parcours des mondes, the leading international fair dedicated to non-European arts. That same year, his discovery of art brut at the exhibition devoted to the abcd/Bruno Decharme collection at La Maison Rouge proved to be a true revelation. This encounter profoundly transformed his outlook, placing art brut at the very heart of his life as a collector. Since then, he has gathered several hundred works and continues to explore what this passion reveals about his vision of the world and of himself. In 2025, he joined the board of directors of Halle Saint-Pierre.
Daniel Klein and Antoine Frérot are both partners of the gallery.
I would like each of you to tell me how you started collecting tribal art, and then art brut— in which order, and whether you can define the reasons behind it.
— antoine frérot
I don’t know if I’ll be able to define the reasons, but I first came to tribal art through modern art, because it was really modern painting that attracted me when I was young. I even started buying works with my very first military service pay. It was a small gouache, in Germany—I remember it very well. And then suddenly, the encounter with tribal art was like a flash. We all know the link between tribal art and modern art, and the two overlapped—until one sleepless night. I have those from time to time. I get up, smoke a cigarette, drink a glass of water before going back to bed.
And then, that night, I found myself speaking to a piece of tribal sculpture. I had never spoken to a painting. Well, it scared me a little. It was in halfsleep. And I asked myself, why? Why was there a difference between the two? In fact, I realized that what drew me to modern art was mainly the form. And I was wrong to think that was what attracted me—it was really that the works were inhabited, and form only came as a kind of backdrop. Form masks the inhabited quality of the work, whereas in tribal art, it was much more striking. And one day, I came across art brut, and again, immediately, the inhabited nature of the works hit me, jumped out at me.
Very quickly, art brut partly replaced my attraction to modern and tribal art. That’s
how I began collecting art brut. And gradually, I collected almost nothing else. (To the point, in fact, of juxtaposing works of art brut with modern or contemporary works.)
And very soon I realized that art brut completely overshadowed those so-called modern or contemporary works—which I sometimes resold, by the way. And I also sold some tribal art when the juxtaposition gave me the same impression, namely the difference in intensity, in depth.
We can come back later to this particular aspect—namely, the specificities of each. For now, I’d like to hear Daniel talk about how he began collecting tribal art, and then how he later came to art brut, and how the two might enter into dialogue.
—
daniel klein
Like Antoine, I was drawn to art from a very young age. I remember myself drawing, looking through books. I had this sensitivity, even though my parents had no interest in art at all. As a teenager, I developed a strong fascination with the American Abstract Expressionists, and with abstract art in general. I was captivated by what they were doing—their energy, that whole world.
When I arrived in Ecuador, I had the good fortune to marry the daughter of an important artist and major collector. I think that was a decisive factor in sparking my interest in folk art. Together with my wife, we began collecting Ecuadorian folk art, then pre-Columbian art, and later tribal art. For many years, I focused on
the art of the Congo—that’s what I found most inhabited as well. And then, by chance, I came across art brut, and we began collecting it too.
In the end, I think it is really an aesthetic approach. The same plastic expression runs through folk art, pre-Columbian art, tribal art, and so on. These are drawings or objects that are inhabited, as Antoine said. I feel exactly the same sensation.
Since we are speaking about emotion and reception, could you each clarify the order in which things reach you and how they act upon you? Is it first the form of the object that asserts itself, or rather what it conceals but that one nevertheless feels to be present? What is the share of the visible universe, of the sensible form, and that of an invisible but perceptible presence—capable of moving and even shaking you?
—
antoine frérot
I think form is what strikes you first—it’s the surface of the work—but I believe it only reflects a higher power and is there merely to illustrate it. And to go back to the order: modern art, then tribal art, then art brut—I think these types of works are increasingly distant from the culture I grew up in, from my own civilization. My parents were not really into modern art; they were more interested in classical art, and modern art already had a sense of being outside the framework in which I was raised.
So I suppose it was that distance that drew me to modern art. And tribal art is even further removed from that culture, and I think art brut is even more distant than tribal art—because
tribal art has nevertheless seeped somewhat into modern art, and into our cultural world, our cultural vision.
I think this distance from the environment in which I grew up, and from where these creations come, is probably the reason for my attraction. The more distant it is, the more other it is, the more surprising or shocking—it gives me the impression of the existence of another world. And when I say “inhabited,” that’s what I mean, I think. There is, curiously, another world—so there are inhabitants in that other world, inhabitants I don’t know, since it is a world unknown to me.
So the word “inhabited” is perhaps a little overused. We might also speak of intensity—but it is certainly the fact that another universe is revealed to me, one that is not mine, and that attracts me and that I want to graft onto my own consciousness, my own reason. With fragments that were not previously conscious to me, fragments I want gradually to integrate into my awareness—and thus expand it beyond the original worlds in which I grew up.
It’s a bit like the etymology of the word to understand, in a way.
— a. f.
Except that now the word understand has a much narrower meaning.
But originally it meant “to take into oneself,” that is, to assimilate.
— a. f.
That’s true, and that is what attracts me in art, and in art brut in particular. It’s about assimilation in
both senses: either taking the works into myself, or entering into this world that was unknown to me. And so the world becomes broader, wider, greater.
— daniel klein
That’s a very good question, one I ask myself every time I stand before a work that transmits something to me. I ask why it touches me, and why others transmit nothing at all. We all carry a certain baggage, made up of the languages we’ve acquired over time, which forms a certain structure, a way of looking at a work of art. Of course, we are conditioned. But there is also something else, which is very hard to explain. For instance, works of tribal art are usually pieces that have been handled, created to connect with the beyond— with spirits above all. It’s magical, it’s religious. The works that transmit something to me may not transmit anything to most other people. And that’s a real question. I think there is a factor of communication here that draws on several inner aspects of the conscious, the unconscious, and so on. In fact, it’s much more complex than we think.
In my case, it’s an immediate reaction. People can tell me stories about the artist, the work—either the spark happens, or it doesn’t. That’s it.
Let me jump in here, because earlier Antoine spoke about strangeness, that perhaps these works embodied something of the strange. We know the notion of the uncanny, but it’s also about the other. Because, listening to your respective stories, nothing predestined you—since neither of
you came from an environment steeped in museums.
And yet the constant is that you always turn toward strangeness, toward the other, and you have this ability to open yourselves to a world that was not originally yours. So, isn’t it perhaps because you developed a kind of attraction for what is different from you?
— antoine frérot
I said earlier that what attracted me was a world outside myself, and the shock I felt, the surprise. And in fact, that’s what pleased me in the work. But it’s also, no doubt, a slightly superficial impression. Because in order for it to move me, it can’t be totally alien to me. These other worlds in which I was not raised—well, at least in part, they already existed within me.
I haven’t quite clarified this yet, but I’m convinced that before one acquires the sense of existing— the principle of reality, let’s say…
…the consciousness of being in the world?
— a. f.
The consciousness of being in the world, and the awareness of distinguishing my own existence from the rest of the world. I feel that I once bathed in something larger than myself. And I wonder if what these works are telling me is a reminder of that earlier period—before the moment when, like most human beings, I realized that I existed and that I could distinguish my body from the rest of the world. There is a time, before that, when one is immersed in a kind of fullness, when one is one with things—simply a thing among
things, being with the world. A kind of Edenic feeling, where nothing can harm you. That moment, we had to forget in order to live in society, to gradually become human beings among others, and to learn to master our desires and impulses. Well, perhaps these works awaken in me something I had to bury for that reason—something not entirely lost.
So I wonder: is it only what I experienced as a very small child, something acquired? Or is there even more behind it—something rooted in the existence of humankind itself, carried within us through genes? It’s not impossible. One might even rediscover Jung’s archetypes.
But perhaps it is simply that blessed period—or rather, the period I imagine as blessed—which I had to renounce in order to confront reality, and to acquire a form of consciousness distinct from the unconscious. And so perhaps these works plunge me back into that unconscious, and bring words up to the surface of my awareness. They then become part of my consciousness, which expands once more.
Daniel, when you hear this, do you agree? With this kind of introspection, and with the idea of recovering a sort of lost Eden, a paradise that isn’t entirely lost after all, since we have the ability to find it again through works of art.
— daniel klein
In a way, yes. Because when you reach that connection, you do feel a sense of fullness. So, in a way, you recover that elementary aspect, let’s say. I also think there are several factors. There’s the one Antoine mentioned, genetic in a certain
sense. We are conditioned, but then there is a journey. And I believe one either has a genetic sensitivity or not. After that, it can be developed, and the more one is exposed to certain languages, the more that sensitivity grows.
So, because we’ve acquired different forms of language, we can make associations, and these associations generate other energies within me. I often ask myself about this sensitivity to art. In my case, I have a similar reaction with nature, the same kind of feelings. When I’m faced with a landscape, a tree, I sometimes perceive nature in the same way as I perceive a work of art, and I form that same connection, mentally. I sense the same energies—in fact, in all kinds of spaces, not only landscapes. I think this happens to everyone. There are places where we feel good, and places where we feel less at ease. For me, that fullness comes in the same way. It’s the same outcome.
Interesting. Because I find it echoes what both of you have been saying. The word enchantment has never yet been mentioned, in relation to the beautiful, to the idea of beauty. Of course, one can go back to Plato—the beautiful and the good, which are somewhat equivalent—but you have never actually used the word beauty. And yet it seems to be there in the background, as an underlying notion.
— antoine frérot
What we’re trying to explain about what seduces us in a work is precisely what each of us calls beauty. But there’s no definitive, objective definition of beauty.
You were asking me earlier about the relation to the Other, and about this curiosity to look beyond, to seek out the Other. And indeed, the Other is consubstantial with self-awareness, isn’t it? And there’s a price to pay for that. It requires renouncing that sense of plenitude I mentioned earlier. And I think that if it is indeed the Other that I receive through these works, I also feel that the Other is me, and I am the Other. I want to break down the distance that my human ontology has had to create between myself and the rest of the world—and the rest of others, whether things or beings. In fact, I think what I really want is for the Other and myself to merge. And it’s more about re-fusing than discovering. I stumble upon them by chance, and immediately I want to melt back into them, or incorporate them into myself.
Yes, that’s exactly what you were saying earlier, it works both ways. — a. f.
Yes, there has been so much reflection on beauty. Kant said: “the beautiful has no utility.” And Kant was wrong. Beauty—and this was revealed to me above all by François Cheng— beauty helps us to live. The beautiful does have a use, and if it helps me to live, it is precisely because it enlarges my field of perception or of consciousness—or more exactly, of conscious perception. And never to consider this expansion as sufficient, but always to seek to broaden it—sometimes more easily, sometimes less, because encounters with otherness can be such that it takes time to incorporate them. Indeed, there are works that I don’t enter into immediately, but later on, suddenly, they appeal to me, and I ask myself: “Why wasn’t I touched from the start, when now it seems so obvious?” This encounter with other-
ness can run into a wall at a given moment. But I think that the idea of suspending this distance between myself and the rest—what one might call the self or the id—is, for me, a need, a pleasure, a joy… I don’t quite know how to name it. A necessity, in order to feel that I am in the world. The more the world I take into myself, and myself into the world, the more I feel that I am in the world.
Of course, it’s a highly subjective notion, the idea of beauty. But in everything Antoine was saying, it ultimately echoes a bit of the Platonic idea—that beauty is subordinate to the good. There is a connection between the two.
— a. f.
There is transcendence in Plato. There is another world in which the beautiful and the good are objective. For me, there is no transcendence. Everything lies in immanence. There are no other worlds—there is only one, the world in which we exist. And beauty is not something to be found above the world. It is within.
Daniel, how do you react to that?
— daniel klein
I don’t know what the good and the beautiful are… Maybe I should read Plato (laughs). It might give me the key to the solution. But I don’t analyze it—let’s just say it’s part of me. Either I feel this connection, or I don’t. What is beauty? I am very sensitive to works that evoke chaos, to those considered outside the classical aesthetic canons. That’s what you find in art brut: works that are not necessarily beautiful in the conventional sense.
— antoine frérot
There are aspects of Eastern philosophy that appeal to me. This idea that beauty is the vital breath between things or beings—that it is the between. As if the duality of self/the rest, subject/object, were not satisfactory, and that what matters is what happens between. And that’s where beauty is found. When I said I sought to erase the distances between myself and the rest, it’s probably that in-between, that breath, that I want to grasp. And so, for me, Asian thinkers have a more relevant conception of beauty than Western thinkers.
So beauty would be a kind of bond established between oneself and the other, and with otherness. And it’s what happens between the two—it’s this connection— and it almost invites one to drift toward Romain Rolland and the “oceanic feeling.”
— a. f.
Of course, the oceanic feeling is that sense of fullness that surprises you like a flash, a moment when nothing prepares you for it. It’s very rare in a lifetime. Suddenly, without any warning, you feel completely at ease. There is no past, no present, no future. That corner of this library, so depressingly ordinary, suddenly liberates my mind from all the weight of obligation. There is no must, there is only floating…
… Freed? Liberated?
— a. f.
Liberated, yes, from all constraint, from all fear as well. With the question of what to do with all your desires in such moments, since
they are free too. And you understand that if the human species has become what it is, it’s because the juxtaposition of all these freedoms could not allow us to survive. Genetically, we had to discipline ourselves—and then, at some point, it returns; there’s a flash. Fullness is not permanently lost. It is buried, hidden, and from time to time, it surfaces. The famous oceanic feeling can come from anything. A work of art can—not recreate it exactly—but mimic it, in a way. A work of art restores the taste of what we were able to perceive, which escaped as quickly as it appeared.
Daniel, do you ever experience—like what Antoine describes—almost a form of epiphany, moments of revelation in contact with a work of art, something buried within it that you suddenly grasp, which perhaps reveals you to yourself, to the world, and allows you to return to a kind of Edenic state that preceded it? Do you sometimes have moments of revelation?
— daniel klein
Absolutely. I often have this sensation when I am facing something that moves me—a work of art, a landscape—of connecting with the universe, of being present and feeling that I am present. It’s an exchange of energy, in a way. So there’s a somewhat metaphysical and spiritual aspect that makes you feel connected, definitely. Unfortunately, it doesn’t last long, as is often the case with certain good things in life. I really feel both disconnected and connected at the same time.
Isn’t collecting, in that case, a quest for that moment?
— antoine frérot
Absolutely! When we come across a work of art, we first seek that impression we had. When the work is good, the impression returns; the work doesn’t exhaust itself. When a work does exhaust itself, it’s because it’s less strong. Then maybe we can part with it, but when it recreates the same experience… that’s exactly why I collect them. I need to.
I’ll return for a moment to the idea of the beautiful, because I am very wary of that term. I wouldn’t want to essentialize it—just as one shouldn’t essentialize art, or even art brut, even though the word essential can be misleading.
When Daniel spoke of a metaphysical or spiritual aspect, I completely feel it that way. And I insist: for me, this spiritual dimension exists entirely outside of transcendence. There is a world of the spirit in immanence, and in atheism. I never feel the presence of a God assailing me, or even impacting me—I am certain it doesn’t exist. Yet this spiritual life lifts me out of my body, not to project me above the world, but into the world. The word ecstasy means “to go out” or “to rise above the world,” whereas it would be more accurate to say enstasis—to be within the world…
So it’s not necessarily outside…
— a. f.
But there is no outside; there is only one world. And it’s within this world—perhaps at the center of the Earth—that it takes me. And that is indeed the spiritual world. And therefore, metaphysical.
This brings us to a point where what’s interesting is that you were talking about transcendence…
— a. f.
Exactly, we were questioning transcendence.
Yes, well, you were speaking about transcendence, and in particular about spirituality. You reminded us that spirituality can be formed within immanence. If we refer, for example, to art premier, it’s easy to imagine that, at the origins, humans produced works as objects of intercession between themselves and something they couldn’t explain, something that transcended them, was above them. I don’t have the answer, but surely it must have functioned as an attempt to establish a connection. You both mentioned this. So, as good atheists as some of us are, it still ties into the idea of religare, of the religious—meaning to create a link.
Do you think that in art brut we find similar mechanisms to those that may have existed at the origins, in the genesis of art, in the history of humanity with art, with the production of forms and objects intended to respond to the mystery of being in the world?
— antoine frérot
All great works of art are like that. The great works of the Renaissance, too. Great works of all times, in my opinion, are made for that: to create a link, to abolish the distance between oneself and the rest of the world, with an external power. That’s for religion, but it’s also true for inner powers. I think all great works of art, whatever they may be,
are made to intercede between oneself and the rest. It can be earthly or extra-terrestrial.
Daniel, I’m thinking of the exhibition we had the pleasure of seeing in your museum in Quito, which dealt with these questions of the sacred in Pre-Columbian art. Is there a connection between what happens there, with these Pre-Columbian art objects, and your later interest in art brut?
— daniel klein
I don’t think so. That is to say, for me, it’s a natural connection. With creators of art brut, we have the advantage of finding a multitude of languages that are personal, that belong to them alone. And that’s what strikes me. I don’t place a hierarchy on what I observe, whether it’s Pre-Columbian art or art brut. I put them on the same level; it’s the result that interests me. I don’t necessarily relate the work itself to the sacred.
It’s interesting, because you brought up the question we hadn’t yet addressed: that of personal, individual mythology, which might superficially seem opposed to what we can call collective mythologies, as expressed in tribal artworks, so-called art premier, etc. And ultimately, when we listen to you, perhaps there isn’t such a strong antagonism between collective mythology and individual mythology.
— antoine frérot
No, there isn’t. And why isn’t there? You mentioned that museum in Quito, which is a magical place where one can feel the spirit and the sacred also… But for me, sacred and secret— which I believe come from the same root—are synonymous. What some call sacred, I call secret: something hidden that reveals itself to me.
Creators of art premier, who seek to intercede and appeal to the beyond, thus in relation to the sacred, I feel as if they are seeking to appeal within me, deep inside me, to that hidden thing I had to forget, or inherited, but of which I wasn’t aware, which was my secret. And this revealed secret is the sacred they are seeking.
And so, individual mythology, to return to that, which is somewhat equivalent to my secret, is equivalent to collective mythology, which we might call the sacred.
And here, you bring us back again a little to Jung and a kind of resurrection of the collective unconscious.
Yes, here I haven’t definitively decided whether this “hidden” that works of art can reveal to my consciousness is something common to many humans—which would mean it’s collective, this unconscious—or whether it’s relative to what I experienced in early childhood and is purely acquired. Well, I actually think it’s both acquired and innate, and I am convinced that there’s no reason why, over the 50,000 years that Homo sapiens has existed—or perhaps even before, with Neanderthals—human experiences wouldn’t also have been encoded in the genes that shape thought, once they were encoded in the genes that shape physiology. So yes, it’s both. It’s not just the collective unconscious; there are certainly fragments of individual unconscious as well.
So, Dany, do you also think that the boundary, ultimately, is thin—or even entirely porous—between what we call individual mythology and collective mythology?
—
daniel klein
For me, it’s the result that matters. And after that, the source that leads to the result… Obviously, there are multiple paths…
— antoine frérot
That’s the second time Dany has said it: “For me, it’s the result that matters.” Well, thinking about it, for me that’s not enough. Because when there is the result, it affects me. I can’t help but try to understand why it affects me. The first way to try to understand that is to imagine what happened in the person who made it, to see if there’s an analogy between what I feel and what they felt. I can’t be satisfied with just the result. I may be seeking, in a completely illusory way, to detect a possible analogy between what happened in the creator and what happens in the viewer. Is it illusory? I don’t know.
Sometimes it’s a bit the presumption of intellect over emotion. When the intellect thinks it can explain all emotions.
— a. f.
Moreover, if the three of us are here, it’s because we’re trying to see if there are correspondences between what it does to me, to you, to him. So here we’re not talking about the creator; we’re talking about three viewers, but we’re still looking for common points. What also matters is what it does—what the result does in others.
— daniel klein
Of course. Can I ask you a question, Antoine? I completely understand you, and I wanted to know: do you think that perceiving other dimen-
sions when you are in front of a work, understanding the artist, sometimes understanding what they wanted to show, understanding their approach—do you think that can increase this energy, this emotion? Or is it just an intellectual matter?
— a. f.
But I don’t think there’s anything to understand in the work itself. What I seek to understand is what drove the artist to make the work.
— d. k.
For example, I draw an analogy with the emotion that some people seek when confronted with a contemporary artwork. They feel a certain attraction, but not necessarily for the work itself, nor for its form, but for the idea, the concept of the work. And so my question would be: when you feel this type of deep emotion, does understanding—especially the context of the work—enhance your emotion?
— antoine frérot
I am now convinced that all great works— the ones that affect me most—are not the result of the artist’s conscious plan. They didn’t consciously intend to make that; it imposed itself on them. Artists start with something, but beautiful works guide the artist’s hand. As they often say: “I start, and then suddenly, it’s the work that guides me.” Once there’s a plan, there’s no projection of the artist’s unconscious.
So I don’t try to understand what they wanted, because I think they didn’t want anything. Or else it’s not a good work. What I do try to un-
derstand is what drove them. What comes out of them in their work that could resemble me? It’s about trying to understand the state they were in when they created this thing that moves me. If I could feel the state they were in, I could understand my own and detect something I hadn’t noticed. Because otherwise, I might have made the work myself if I had noticed something.
I didn’t make the work. They made it, and if it affects me, it’s because it speaks to me about myself. And what is this thing about me? The best thing is to look inside them to see if I recognize it.
It’s like holding up a mirror, in the end?
— a. f.
Absolutely, a mirror held up.
Daniel, do you also think that what might escape an artist in the work they’ve created can reveal something about you? What escapes in the other.
— daniel klein
Without being conscious of it, perhaps. Having the context of the work is very interesting. Knowing the artist and the circumstances in which they created their work and why obviously gives another dimension to the work. It’s interesting from an intellectual point of view, but in terms of energetic interconnection, that’s not where it happens for me.
— antoine frérot
But maybe it’s a good idea, to check that the energies received match the energies emitted. It’s interesting that you say that because there’s a notion we haven’t yet explored,
but that both of you have touched on: the idea of emitting power and receiving power. On one hand, the work emits something at a certain frequency, and the person receiving it can, if tuned to the same frequency, receive something. If they are tuned to a different frequency, they receive nothing—or they are tuned to the frequency of the work next to it. Perhaps something interesting happens there with the frequency of the emitter, the work that emits, and the receiver.
— antoine frérot
That’s entirely possible. The image of frequencies and wavelengths may be somewhat figurative, but it’s a metaphor that can be very useful for helping me understand what art brut does to me. Perhaps I try to tune my frequency to resonate with the emission, since it affected me, and in resonating, to discover, to become aware of what I feel and why I feel it. That’s not impossible at all.
Do you feel the same way, Danny? Are you tuned in to the work as well?
— d. k.
Yes, completely.
You were talking a lot about connection…
— d. k.
Connection, yes, obviously.
Now that you have compared your perspectives to find analogies of different kinds between works of tribal art and art brut for this exhibition Les Habités, has it
revealed anything to you that you were perhaps not aware of, or has it just confirmed what you already thought?
— d. k.
It hasn’t revealed anything to me because it’s exactly the approach I’ve had since I started collecting. What I’m seeking, perhaps consciously and unconsciously… And you asked earlier about what it means to collect. Definitely, for me, it’s about creating. I really feel this need to create. Why? Because I choose the works myself, it’s an unlimited world. There are so many facets, so many ways to collect. Some people live with their works, others don’t. I would find it frustrating not to live with my works because I like having them interact with each other.
That’s why, for me, this exhibition, this face-toface between tribal art and art brut, isn’t a revelation. It’s just a natural way for me to express myself through my method of collecting. When several works are brought together, I feel like they connect with each other, that they speak to one another.
For years, when traveling with my wife and children, we’ve collected stones; I collect them. They are scattered everywhere. The act of picking up a stone is symbolic—it’s life. Why is it life?
— a. f.
Because it’s not above the world, it’s in the world, it’s in the earth. It’s pure immanence—the stone, you’re right about that. It’s about merging with the earth.
— d. k.
You may be right, but for me, it’s a different approach. There are stones everywhere. But then,
why did I take this path to this stone? Why did I choose this stone? I took it out of its space, its context, I brought it home, and then I placed it. And after that, I chose another stone somewhere else. I connected them; I made these two stones live together. I find that’s what life is, ultimately. For me, the dialogue between objects is very important. I feel that a collection is complete when I sense that I have established this dialogue. Otherwise, I haven’t realized myself. Hence the frustration of not living with the objects.
— antoine frérot
When you say a collection is complete, it’s never really complete. You always want to continue, right? When the connection works, the collection progresses well, but it’s never finished.
— daniel klein
I mainly wanted to express this need to live with my artworks because I need this connection to live, to breathe.
— antoine frérot
This work we did together—I wasn’t surprised that it worked well, because, again, I’ve moved from one to the other in my own history. By juxtaposing so many pieces of art brut and tribal art, so-called art premier, I was still somewhat surprised by how many emissions were on the same wavelength—more than I probably imagined. Often, these objects emit on a close frequency. And it seems to me that the frequency of art brut creators is probably closer to my own buried frequency than that of art premier creators. That’s likely why I’m drawn to art brut more than art premier. But there are still quite a few emissions on the same wavelength. And when I think about classical Western artists, which ones emit
on the same frequencies? Obviously, there are very few.
Earlier, we talked about the difficulty of describing beauty, which doesn’t exist. I think we’ll struggle to define art and art brut as well, but I stubbornly believe that art brut is not the same as non-brut art. Good art brut is not the same as even good art. There’s a difference in frequency. The absence of a plan seems important in art brut. In non-brut art— even if a great work isn’t the result of a conscious project—there is initially a “wanting.” This wanting is completely different in art brut creators, it seems to me. There’s a cry, a need to expel. Whereas I want to incorporate it, which is curious: they expel something that I want to swallow. A need to expel, which I don’t feel in non-brut art. And I don’t think art premier creators do either; I don’t think they expel something out of themselves. And this expulsion makes the frequency’s stridency strong—stronger than elsewhere.
How do you feel about things, Daniel?
— daniel klein
Antoine may not be wrong. As I mentioned earlier, there’s no hierarchy for me, in the sense that I can have exactly the same reaction to an art brut work as to a piece of art premier, or even folk art, modern art, or classical art. I’m a bit less responsive to classical art because it connects me less to the unconscious and the creative drive than other forms of expression. So my sensitivity is lower; I react less.
Antoine didn’t pick up on something I found very interesting in what you said: “I feel like I’m creating.” I’ve met a number of collectors, very different types, and many of them seem like builders to me, people who construct something piece by
piece. And you, by collecting stones, you create new connections that at some point change your perception of the world.
Antoine didn’t pick up on something I found very interesting in what you said: “I feel like I’m creating.” I’ve met a number of collectors, very different types, and many of them appear to me as builders, people who construct something piece by piece. And you, by collecting stones, create new connections that at some point change your perception of the world.
— antoine frérot
Yes, that’s true. And I would put it a bit differently. When I collect, I feel like I’m creating myself. Not creating something outside of me, but discovering myself, expanding my self, and thus creating myself. That’s why I do it.
As a conclusion, now that you’ve experienced curating this kind of exhibition, have you thought about another exhibition you would like to organize, and in what form?
— a. f.
For me, it’s not the first time this idea has come to me, but it’s the first time I’m actually doing it. In the process, I realized that there are quite a few material aspects that are not negligible when it comes to putting together something of quality. But yes, I want to exhibit my collection of art brut, and perhaps not only art brut, but a mix. So it will surely happen. For now, I don’t quite have the time to do it. But when I do, I will probably try to pursue it.
Daniel? Any new desire to do something in Paris?
— a. f.
He opened a splendid museum in Quito where he shows part of his collection.
— daniel klein
Thank you, Antoine. What interests me is the connections. I would enjoy being able to exhibit my collection. But it’s difficult because you can’t move everything, you can’t recreate the spaces in the same way. Recently, when I had to reconsider an exhibition space I had built organically over many years, it really caused me major problems. It takes energy to undo and redo, and it’s a bit like killing what you’ve created. Then, what does it mean to create? Is it for oneself? For others? Sometimes great artists do not create for others. That’s sometimes what gives the depth of the work. In a way, they create themselves; they bring out the deepest part of themselves.
— antoine frérot
I’ve noticed that when you place a work of art in your home, over time you get used to seeing it. And if, for one reason or another, you move it, you rediscover it in a new way. And when it’s a very large piece, it awakens. It reveals itself again because we had grown accustomed to seeing it in the same spot. The first time we chose to place it there, it worked perfectly, but habit dulls the emotion. If you move it to another location, it reactivates, and suddenly the magic returns. So yes, moving works takes energy because they interact with each other, and if you move one, you have to change everything. But I find that it regenerates and revitalizes them.
— daniel klein
Yes, it gives them other connections, other links, other destinies. I strongly believe in destiny— ours, humanity’s in general, but also the destiny of what surrounds us.
And our capacity, like the artworks, to recreate ourselves. Ultimately.
— a. f.
Or simply to create ourselves.
It was rich, dense, and wonderful. Thank you.
— d. k.
Thank you for inviting us to participate in the exhibition, because it was very enriching to share with Antoine the responsibility of curating it.
It felt so natural given your paths, our relationships, and the way we ultimately exchange, in ways that can be spoken or made intelligible, around the works. And at the same time, all the things that are left unsaid, that one can’t necessarily articulate…
I remember how I encouraged Antoine to write for the Cerisy colloquium, and it was very inspiring. Because as Jean Grenier said, “To write is to put your obsessions in order."
christian berst art brut
catalogues bilingues publiés depuis 2009
published catalogues since 2009
le manque sophie calle et christian berst entretien : a. bustamante, l. barrera et l. sáez, 100 p., 2025
do the write thing read between the lines #4
textes : e. dussert, j.-m. gallais, h. guette, m. thévoz, 215 p., 2018
josé manuel egea luna llena entretien : a. bustamante, l. barrera et l. sáez, 100 p., 2025
john kayser
texte de bruno dubreuil, 164 p., 2025
josé gabriel mendoza la palabra del mudo
textes de luz ascarate & m. anceau, 114 p., 2024.
little venice aloïse corbaz, madge gill, leopold strobl, anna zemánková, 78 p., 2024.
tomasz machcinski american dream
textes de z. płoska-czartoryska & k. karwanska, will heinrich et marc donadieu, 154 p., 2024.
les mots pour le dire #1
texte de laurianne melierre, 86 p., 2024.
ken grimes space oddity
texte de alejandra russi, 72 p., 2023
luboš plný body language
texte de ph. comar, c. margat et l. žabokrtská, 88 p., 2023
sebastiàn ferreira megalopolis
texte de christophe le gac, 100 p., 2023
joaquim vicens gironella paradis perdu
texte de guillaume oranger, 130 p., 2023
in abstracto #3
texte de raphaël koenig, 130 p., 2023
hans georgi noah’s plane
texte de françois salmeron, 200 p., 2022
alexandro garcía architectura sagrada cosmica
textes de p. thiago rocca, m. layet, 198 p., 2022
james edward deeds the electric pencil #2
texte de philippe piguet, 154 p.,2022
jesuys crystiano a contrario
textes de t. scheuermann & m. anceau, 180 p., 2022
do the write thing read between the lines #3
texte de jean-marie gallais, 160 p., 2022
josef karl rädler la clé des champs
textes de c. delavaux & f. altnöder, 150 p., 2022
les révélateurs débordement #1
textes de anaël pigeat et yvannoé krüger, 200 p., 2021
mary t. smith mississippi shouting #2
textes de daniel soutif et william arnett, 172 p., 2013 - 2021
julius bockelt ostinato
textes de ch. cuticchio et sven fritz, 300 p., 2021
anna zemánková hortus deliciarum #2
textes de t. zemánková et m. anceau, 300 p., 2021
franco bellucci beau comme... #2
texte de gustavo giacosa, 188 p., 2021
carlos augusto giraldo codex
textes de jaime cerón et manuel anceau, 200 p., 2021
le fétichiste anatomie d'une mythologie
textes de marc donnadieu et magali nachtergael, 250 p., 2020
zdeněk košek dominus mundi
textes de b. safarova, j. typlt, m.anceau, 250 p., 2020
in abstracto #2
texte de raphaël koenig, 264 p., 2020
albert moser scansions
textes de bruce burris et philipp m. jones, 200 p., 2020
jacqueline b. l’indomptée
texte de philippe dagen, 280 p., 2019
jorge alberto cadi el buzo
texte de christian berst, 274 p., 2019
japon brut la lune, le soleil, yamanami
textes de yukiko koide et raphaël koenig, 264 p., 2019
anibal brizuela ordo ab chao
textes de a.-l. peressin, k. busto, f. imola, c. del rio, 240 p., 2019
josé manuel egea lycanthropos II
textes de graciela garcia et bruno dubreuil, 320 p., 2019
au-delà aux confins du visible et de l’invisible
texte de philippe baudouin, 220 p., 2019
éric benetto in excelsis
texte de christian berst, 212 p., 2019
anton hirschfeld soul weaving
texte de nancy huston et jonathan hirschfeld, 300 p., 2018
lindsay caldicott x ray memories
texte de marc lenot, 300 p., 2018
misleidys castillo pedroso fuerza cubana #2
texte de karen wong, 300 p., 2018
jean perdrizet deus ex machina
textes de j.-g. barbara, m. anceau, j. argémi, m. décimo, 300 p., 2018
do the write thing read between the lines #2
texte de éric dussert, 220 p., 2018
giovanni bosco dottore di tutto #2
textes de eva di sefano et j-llanoux, 270 p., 2018
john ricardo cunningham otro mundo
180 p., 2017
hétérotopies architectures habitées
texte de matali crasset, 200 p., 2017
pascal tassini nexus
texte de léa chauvel-lévy, 200 p., 2017
gugging the crazed in the hot zone 204 p., 2017
in abstracto #1
texte de raphaël koenig, 204 p., 2017
dominique théate in the mood for love
texte de barnabé mons, 200 p., 2017
michel nedjar monographie
texte de philippe godin édition, 300 p., 2017
marilena pelosi catharsis
texte l.quénehen, entretien l. danchin, 230 p., 2017
alexandro garcía no estamos solos II texte de pablo thiago rocca, 220 p., 2016
prophet royal robertson space gospel texte de pierre muylle, 200 p., 2016
josé manuel egea lycanthropos
textes de graciela garcia et bruno dubreuil, 232 p., 2016
melvin way a vortex symphony
textes de l.derobert, j. gorney et and. castrucci, 268 p. 2016
sur le fil par jean-hubert martin
texte de jean-hubert martin, 196 p., 2016
josef hofer transmutations textes de elisabeth telsnig et ph. dagen, 192 p., 2016
franco bellucci beau comme... texte de gustavo giacosa, 150 p., 2016
soit 10 ans états intérieurs
texte de stéphane corréard, 231 p., 2015
john urho kemp un triangle des bermudes textes de gaël charbau et daniel baumann, 234 p., 2015
august walla ecce walla
texte de johann feilacher, 190 p., 2015
sauvées du désastre œuvres de deux collections de psychiatres espagnols (1916-1965)
textes de g. garcia et b. chemama steiner, 296 p, 2015
beverly baker palimpseste
texte de philippe godin, 148 p., 2015
peter kapeller l’œuvre au noir
texte de claire margat, 108 p., 2015
art brut masterpieces et découvertes carte blanche à bruno decharme entretien entre b. decharme et ch. berst, 174 p., 2014
pepe gaitan epiphany
textes de j. calle gregg & j. perez navarrete, 209 p., 2014
do the write thing read between the lines textes de phillip march jones et lilly lampe, 2014
dan miller graphein I & II
textes de tom di maria et richard leeman, 2014
le lointain on the horizon
122 p., 2014
james deeds the electric pencil
texte de philippe piguet, 114 p., 2013
eugene von bruenchenhein american beauty texte de adrian dannatt, 170 p., 2013
anna zemánková hortus deliciarum textes de t. zemánková et m. anceau, 146 p., 2013
john devlin nova cantabrigiensis texte de sandra adam-couralet, 300 p., 2013
davood koochaki un conte persan texte de jacques bral, 121 p., 2013
albert moser life as a panoramic textes de phillip m. jones, andré rouillé et christian caujolle, 208 p., 2012
josef hofer alter ego
textes de elisabeth telsnig et philippe dagen, 2012
rentrée hors les normes 2012 découvertes et nouvelles acquisitions
pietro ghizzardi charbons ardents
texte de dino menozzi, 2011
guo fengyi une rhapsodie chinoise
texte rong zheng, 115 p., 2011
carlo zinelli une beauté convulsive
texte par daniela rosi, 72 p., 2011
joseph barbiero au-dessus du volcan
texte de jean-louis lanoux, 158 p., 2011
henriette zéphir une femme sous influence
texte de alain bouillet, 2011
alexandro garcia no estamos solos
texte de thiago rocca, 2010
back in the U.S.S.R figures de l’art brut russe
texte de vladimir gavrilov, 2010
harald stoffers liebe mutti
texte de michel thévoz, 132 p., 2009
made in holland l’art brut néerlandais
texte de nico van der endt, 2009
american outsiders the black south texte de phillip march jones, 2009
remerciements acknowledgements
les commissaires d'exposition : antoine frérot & daniel klein
les galeristes : olivier castellano, christophe de fabry, bernard dulon, julien flak, frédéric rond, judith schoffel
l'atelier Obermant (scénographie de l'exposition) : catherine et jérôme clermont
ainsi que : manuel anceau, enki berst, sylvain berst, adriana bustamante, elena cloupet, alejandro labrador, juliette lefebvre, lucas mathieu, jeanne rouxhet
christian berst art brut
Ce catalogue a été publié à l’occcasion de l’exposition : les habités, l'art premier et l'art brut en dialogue commissaires d'exposition : daniel klein & antoine frérot, à christian berst art brut, du 6 septembre au 26 octobre 2025.
This catalog has been published to mark the exhibition : the enspirited, tribal art and art brut in conversation, curators : daniel klein et antoine frérot, at christian berst art brut from september 6 to october 26, 2025.
design graphique et réalisation graphic design and production élisa berst & lucas mathieu
photographies œuvres art premier enki b. production
3-5 passage des gravilliers 75003 paris contact@ christianberst.com
Il n’est pas rare que les gens confondent les termes d’art brut et d’art premier. J’y vois deux raisons principales : l’une liée aux qualificatifs brut et premier qui semblent signaler que nous sommes en présence de productions originelles, à l’état natif.
La seconde liée au fait que ces arts induisent un décentrement du regard occidental, la prise en compte d’une altérité souveraine, qu’elle soit culturelle ou intime. [...]
Les artistes du XXe siècle ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, collectionnant les uns comme les autres avec l’impression diffuse de revenir à un stade édénique de l’art.
Christian Berst
It is not uncommon for people to confuse the terms art brut and tribal art. I see two main reasons for this: the first lies in the adjectives brut and tribal, which seem to suggest that we are dealing with original, primal forms of creation. The second lies in the fact that both of these arts entail a decentering of the Western gaze and invite us to take into account a sovereign otherness, whether cultural or intimate. But this is no backdrop, merely an impression, a glimpse into his state of mind. [...] Twentieth-century artists recognized this, collecting both kinds of work with the diffuse sense of returning to an Edenic stage of art.