La rédaction
77

La rédaction
77
Responsable de projet et rédactrice en chef : Camille Barbe, professeure
Rédacteurs :
Terminale : Sophia Angeloglou, Côme Boutet, Arthur Brault-Garin, Ali Emre Bugay, Anna Coles, Eryn Flambert, Romane Kalfa, Emma Kermiche, Jacob Laugier-Claude,StanislasLecocq,ArnaudLlinares,Meryl Lorougnon, Elsa Perez, Chloé Perrone, Paul Pitman, Marie Ruchon
Première: Victoria Attias, Lou Bilhouet, Mathieu Dong, Damla Dogan, Oliana Ducos-Nourisson, Adrien Guebey, Maribel Hage, Antoine Jacheet, Célénie Jaegler, Kallisté Jomin, Lili-Mei Lacascade-Mignerot, Stanislas Leclère, Gabriel Leoveanu, Yasmine Mabrouk, Lucas Malaussena, Louise Miniconi, Kristofer Orfila, Faostina PeléPajanacci, Ina Penone, Rosanna Pergament, Alexandre Raynaud-Lacroze, Alrick Servais, Wendy Su, Elie Surman, David Toutoundjian, Margaux Vermeulen, Martin Vinet, Lou Vonnet, Liesel Wang, Laurine Zheng
Seconde :Charlie-RoseAmico-Gas,RamyBelhadj,Tessa Ben Ayoun, Thomas Chapelain, Manon Chevallet, Bulle Cheyrouze,BenjaminChilton,LenaCorrea,EveCuvelier, Capucine Darmouni, Mia Farrugia, Aksel Fenouil, Roma Gignoli Roilette, Adrien Guillamot, James Lin, Lucie Maslard, Amy Essoue Adama Gaye Ndong, Victoria Olive, Jana Partouche,Léo Playez, Chloé Robinson, Alice Salla, Liv Sisley, Louise Soistier, Julie Stark, Apolline Williams, Sofia Zunigo-Cucalon
Dessinateurs/Illustrateurs : Zoé Mara Crisan, Maxence Le Bris-Barbleu, Cécile Pailloncy
Sont promues pour la prochaine édition 2024-2025 :
Rédactrices en chef adjointes : Victoria Attias et Lou Vonnet
Directrice artistique : Cécile Pailloncy

L’historien (avec un grand H)
J-N Jeanneney : (Pi)politique et transparence
Antoine Jacheet & Martin Vinet
« Pour vivre heureux, vivons cachés » … Le célèbre adage vaut-il en politique ? L’historien, ancien président de Radio France et homme politique JeanNoël Jeanneney répond à nos questions. Rencontre.
Page 7

Dans l’entretien qu’elle nous a accordé au cours de ce deuxième numéro de Casse Ton Cliché, la docteure en sciences politiques et spécialiste du Sahel-Sahara, Niagalé Bagayoko, pointait le fait que les premières victimes de l’insécurité dans la région n’étaient pas les femmes mais les enfants. Alors que, de nos jours, les Occidentales se battent principalement pour obtenir l’égalité des salaires, les médecins Danielle Hassoun et Jacqueline Valensi nous ont raconté de leur côté les années 70, la lutte pour l’accès à l’avortement avec son lot de manifs, d’actions au long cours et de solidarité. Jean-Philippe Mignerot, père au foyer, insistait quant à lui sur l’importance de ne pas stigmatiser les hommes qui s’occupent de leurs enfants L’espace-temps de l’injustice est à géométrie variable Néanmoins, il y a un dénominateur commun à tous ces combats et bien d’autres L’urgencepourlesindividusàdisposerd’eux-
mêmes et à voir leurs droits protégés. « Homme au boulot, femme aux fourneaux » … Tenter de déconstruire le célèbre adage opposant si vivement les genres, scindés en deux mondes bien distincts, n’est pas une mince affaire Sortir de la hiérarchisation des forces et sensibilités soi-disant propres à chacun des sexes n’est pas simple non plus Sans certitude d’avoir réussi, nous avons au moins constaté que les réalités des femmes et des hommes confondus sont multiples, différentes, parfois identiques Les qualités humaines ne sontpas l’apanage des unes ou des autres. Les avancées et acquis sociaux ne devraient donc pas l’être.
Faudrait-il prendre un cliché pour en casser un autre, « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est peut-être le rare sensé Et le seul digne de transformer les frontières en horizons.
Elles y étaient…
Les années 70 et la lutte pour l’avortement
Lucie Maslard
Danielle Hassoun, gynécologue obstétricienne et Jacqueline Valensi, généraliste nous parlent de leur combat pour les droits des femmes à disposer de leur
corps
Page 11
En scène !
Sans blague
Mia Farrugia
Le rire est-il le propre de l’homme ? Pour l’acteur, réalisateur et producteur Dominique Farrugia, faire rire appartient à tous et depuis longtemps.
Entretien
Page 28
Page 1
Williams – 2de2
Au pays du Soleil-Levant, les émotions sont en berne. D’après un sondage réalisé en 2023, 34,1 % des Japonais disent n’avoir jamais eu de relations amoureuses. Ce taux, le plus élevé jamais atteint, n’est pas sans conséquence sur la société la plus vieillissante du monde.
Les Japonais se croisent mais ne se rencontrent plus.
Sur l’archipel nippon, la nouvelle génération semble bel et bien avoir rejeté les normes rigides du mariage traditionnel au bénéfice de l’individualisme.
Dans un sondage réalisé en 2023, 46 % des hommes dans la vingtaine déclaraient n’avoir « jamais été en couple ». Ce célibat concerne 29,8 % des femmes
Chez les deux sexes, la tendance est à la hausse.
Autre chiffre alarmant : 40 % des célibataires âgées de 18 à 34 ans affirmaient être encore vierges.
Chez les hommes, ce phénomène social qui a émergé dans les années 2010 porte un nom L'expression sōshoku danshi, littéralement « hommes herbivores », désigne au Japon les hommes désintéressés des relations physiques,qu’ils considèrentsouventcomme une simple satisfaction de pulsions, sans véritable désir Ces individus représentant jusqu’à 71% des trentenaires sont perçus par les générations précédentes comme apathiques, paresseux et peu enclins à s'engager. Mais qu’en est-il réellement ?
Le célibat, un phénomène aux multiples causes
Peur de l'épouse, fatigue du travail, difficultés de communication, raisons financières… Les causes du désintérêt envers l’amour sont multiples. D’autant plus qu’à l’origine, le Japon est empreint d’une culture où cacher ses sentiments et éviter les conflits sont enseignés dès l'enfance. Une mentalité qui tend à engendrer timidité, masques sociaux et manque d'initiative. Internet a accentué ce phénomène en offrant une évasion vers un monde virtuel avec personnages fictionnels, où le plaisir est trouvé sans effort. Un contraste criant avec le monde réel qui nécessite lutte et contemplation. Du côté des femmes, le rejet du mariage réside surtout dans la difficulté à concilier carrière et vie de famille au sein d’une société qui ne laisse le choix. Sur le marché du travail, les Japonaises font en effet face à la discrimination dans le recrutement, les promotions et les opportunités. Jugées inefficaces, les

Considérés comme un “troisième sexe” en Polynésie, les Māhū transcendent les catégories binaires conventionnelles.
Littéralement, leur nom signifie « au milieu ». Incarnation d’une transidentité qui prend ses racines dans des coutumes ancestrales, les Māhū de Polynésie sont des personnes de sexe masculin de naissance, dotées d’une expression de genre féminine. Ni homme, ni femme, ceux que l’on nomme également les « hommes douceur » sont totalement acceptés dans leur communauté et font partie intégrante de la société Expression d’un équilibre entre les énergies masculine et féminine, les Māhū représentent la fusion des opposés, symbole d’unité et de complétude. Ils se distinguent aussi par leur gentillesse et serviabilité.
Dans les récits ancestraux, les Māhū occupent souvent des rôles sacrés et sont respectés en tant que gardiens de traditions spécifiques. L'arrivée d’influences extérieures a parfois remis en question cette acceptation. De nos jours, ils sont très appréciés dans les domaines de l'hôtellerie, de l'art, de la danse. En2019,lagalerieTemplonexposaitàParisunesérie de portraits de l'artiste américain Kehinde Wiley consacrés aux transgenres de Tahiti. L’envie ? Célébrer la richesse des identités, rappelant que la compréhension occidentale d’autres sociétés peut souvent être erronée. Un appel au respectde l’autre et à l’ouverture d’esprit
Page 2
intentions progressistes du gouvernement japonais peinent à pallier la pression sociale et professionnelle liée à la maternité
Une évolution des normes traditionnelles vitale
Une évolution des normes traditionnelles est néanmoins vitale pour ce pays de 127 millions d’habitants, aux prises d’un déclin démographique sans précédent et dont les plus de 65 ans représenteront plus de 33% de la population en 2035.
Dans un sursaut, quelques initiatives incitant aux rencontres, telles que le Konkatsu ou speed dating, s’efforcent de promouvoir une approche plus libre et paisible du lien amoureux, basé sur le respect mutuel
Tout pour susciter le Koi No Yokan. Difficilement traduisible en français, cette expression définit l’état particulier dans lequel hommes et femmes se sentent, lorsqu’ils sont sur le point de tomber amoureux avec une personne tout juste rencontrée.
Aksel Fenouil – 2de2
En Corée du sud, l’obsession de la beauté
Au pays du matin calme, être belle est plus un critère de survie sociale qu’un idéal.
Dans une société où les apparences jouent un rôle majeur dans la réussite sociale et professionnelle, la beauté n’a pas de prix.
En Corée du Sud, les femmes passent plus de deux heures par jour à se maquiller. Une femme sur trois a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. La minceur est également très importante. L’objectif ? Répondre aux diktats de la beauté : peau pâle, grands yeux, sourire éclatant, à l’image des stars de K-Pop qui s’imposent à la jeunesse comme un standard de beauté parfait à imiter.
Face à ces normes de beauté étouffantes qui déterminentlavaleurd’unindividuetdontleshommes sont aussi victimes, des mouvements de lutte contre la dictature de l’apparence émergent en Corée du Sud. L’un des derniers en date ? « Escape the corset » créé en 2018. Le collectif féministe entend en effet lutter contre cette pression au conformisme
Sur X, l’hashtag « sans corset » s’est répandu comme une traînée de poudre. Des photos publiées montrent des Sud-coréennes détruisant leurs produits cosmétiques ou encore se coupant les cheveux. Dans un pays patriarcal où le mot « féministe » est considéré comme une insulte, les avancées se font lentement.Atitred’exemple,depuis2018,leshôtesses de la compagnie aérienne Jeju Air sont autorisées à porter des lunettes. Les hôtesses de la compagnie aérienneAsianaont,quantàelles,enfinledroitd’avoir les cheveux courts.


Elle est docteure en sciences politiques, diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, enseignante à Sciences Po Paris, et actuellement présidente du Think Tank African Security Sector Network. Niagalé Bagayoko nous parle de son parcours et nous éclaire sur les enjeux en cours dans la région Sahel-Sahara.
Casse Ton Cliché (CTC) : Quel est votre parcours ?
Niagalé Bagayoko : J'ai fait des études de sciences politiques qui ont été sanctionnées par un doctorat en relations internationales. Ensuite, j'ai entamé une carrière de chercheur au Royaume-Uni, où j'ai travaillé à l'Institut of Development Studies. C’est l'un des premiers centres de recherche sur les questions de sécurité et de développement.
J’ai par la suite travaillé comme fonctionnaire internationale à l'Organisation internationale de la francophonie. J’y ai développé les relations avec les Nations Unies pour permettre des déploiements plus fréquents de troupes francophones dans les missions onusiennes de maintien de la paix.
Enfin, j'ai rejoint le centre que je dirige actuellement et qui travaille sur les questions de sécurité enAfrique. Maspécialité porte essentiellementsurles armées d'Afrique francophone et sur la zone sahélienne. Je suis régulièrement sollicitée par les médias pour analyser ce qui se passe dans cette zone qui a été sous le feu des projecteurs au cours des dix dernières années et qui a connu de nombreux déploiements de la France partenaires internationaux
CTC : Pourquoi avez-vous décidé d'étudier dans ce domaine ?
Niagalé Bagayoko : J'ai toujours été très intéressée par les questions internationales. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir secrétaire générale des Nations Unies. En analysantces questions-là, je me suis aperçue que c'est vraiment ce pour quoi j'étais faite.
Encore aujourd'hui, j'achète des livres quiportentsurce que j'étudiais quand j'avais dix-huit ou vingt ans.
CTC : Avez-vous rencontré des difficultés ou subi des discriminations dans votre expérience professionnelle parce que vous étiez une femme ?
Niagalé Bagayoko : À titre personnel, j'ai expérimenté très peu de discriminations sur ma condition féminine ou sur mes origines. Je suis métis, mon père était d'origine malienne et ma mère corse. J’estime plutôt qu'on m'a toujours donné ma chance dans mon parcours alors que j'ai beaucoup travaillé dans des environnements très masculins.
Comme je l'ai indiqué, je suis spécialiste des questions de sécurité et de défense. J'ai côtoyé beaucoup de militaires, que ce soit des militaires occidentaux ou des militaires africains. Je n'ai jamais eu de difficultés à cet égard. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des personnes qui ont considéré que j'avais des choses à dire oudeschosesàfaire,hommesetfemmesconfondus.Celaapermisquelesénormes efforts que j'ai fournis, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, soient finalement récompensés. Je pense donc que lorsqu'on travaille énormément, on réussit.
CTC : Dans la thématique que vous traitez, notamment les conflits dans la région Sahel-Sahara, quelle est la place que la femme occupe au sein des débats ?
Niagalé Bagayoko : Justement, la femme est placée au cœur de très nombreuses politiques internationales et, à mon avis, elle l’est peut-être de manière excessive, en tout cas décalée par rapport aux enjeux de la région.
Ce qui est important à dire, c'est que dans cette zone en conflit, ce sont avant tout les enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, qui sont les victimes de l'insécurité. Ce sont les hommes plutôt jeunes qui sont ciblés, avant les femmes, dans la zone sahélienne. En revanche, si on regarde ce qui se passe dans l'Est du Congo, il y a très clairement un ciblage des femmes qui ont été les victimes notamment de cette pratique atroce qui consiste à utiliser le viol comme arme de guerre. Oui, les femmes constituent une catégorie fragile mais parfois, on en oublie d'autres qui souffrent aussi beaucoup.
Il ne faut donc pas regarder la gestion des conflits, à mon avis dans cette zone, sous le prisme unique du statut de la femme, mais se rendre compte que les victimes sont de nature extrêmement diverse.
CTC : Est-ce que la place de la femme est la cause ou la conséquence de la géopolitique actuelle ?
Niagalé Bagayoko : Non, moi je ne le pense pas, très sincèrement. Il y a eu très fréquemment des femmes qui ont accédé au pouvoir Malheureusement, elles en ont abusé tout autant que les hommes.
Il ne faut pas considérer que les femmes seraient différentes des hommes par essence. Au contraire, je pense que c'est très important de se rendre compte qu'ils appartiennent à une humanité commune.
CTC : La place de la femme est-elle un problème de premier plan ou y a-t-il d'autres urgences politico-sociétales à traiter d'abord ?
Niagalé Bagayoko : Jepensequ'ilya d'autresurgencespolitico-sociétalesà traiter, notamment la montée des haines et de la violence indiscriminée dans toutes les sociétés du monde, y compris les sociétés occidentales.
CTC : Quelle est votre vision du féminisme ? Vous sentez-vous rattachée au mouvement ?
Niagalé Bagayoko : Non. Je me sens proche du féminisme lorsqu'il prône le droit absolu à l'égalité mais je m'en sens très éloignée lorsqu'il considère que toutes les questions de société doivent être considérées avant tout par son propre prisme et lorsqu'il suppose une supériorité ontologique des femmes sur les hommes.
3
En 2024, les relations homosexuelles sont toujours illégales dans plus de 60 pays. Être homosexuel est passible de la peine de mort dans douze. Les affirmations ci-dessous font état de l’évolution des droits des LGBT+ à travers le temps et le monde. A toi de retrouver la nationalité des opprimés...
1/ Dans mon pays, les agressions contre les personnes homosexuelles sont en hausse de 30% Je suis…
2/ Je suis autorisé à me marier avec un partenaire du même genre depuis 2006. Mon pays fait figure d’exception sur le continent que j’habite. Je suis…
3/ Dans mon pays, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 etunemaladie mentale jusqu'en 1999. Depuis 2013, une loi punit d'amendes et de prison tout acte de "propagande" homosexuelle auprès des mineurs Je suis…
4/ Evoquer l'homosexualité devant des mineurs est passible d'une amende depuis 2021 Je suis… 5/ En février dernier, mon parlement a durci la loi et expose à une peine allant jusqu’à trois ans de prison toute personne s’identifiantcomme LGBT+. Je suis… 6/ J’ai connu les premiers gays et lesbiens à la fin des années1960. Je suis… 7/ 7/ Là où j’habite, l’homosexualité est dépénalisée depuis 1982 Je suis… 8/ 8/Monpaysa institué lemariage pour tousenpremier, en 2001. Je suis… 9/ 9/Dans mon pays, l’homosexualité est punie de la peine de mort. Je suis… 10/ 10/ La première gay pride a eu lieu dans mon pays en 1970. Je suis…
A. Ghanéen
B. Russe
D. Français
E. Emiratis
F. Israélien
G. Néerlandais
I. Français
J. Hongrois
K. Sud-africain
L. Américain

Alexandre Raynaud-Lacroze – 1ère5
Depuis le début de la guerre en 2022, de nombreuses Ukrainiennes ont été victimes de violences sexuelles de la part des soldats russes. Atroce et persistant, le crime devenu arme de guerre n’est malheureusement pas nouveau.
Le but est d’humilier, détruire, prendre le pouvoir et briser l’identité d’une nation. En Ukraine, les viols commis par les soldats Russes sont utilisés de manière stratégique. En décembre 2023, 257 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées dans le pays, les victimes étant âgées de 4 à 82 ans. Le phénomène, hélas, n’est pas nouveau. Si le viol dans la guerre a toujours existé, sa reconnaissance comme outil de la guerre s’est affermie ces dernières décennies. En 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution
1820, reconnaissant les violences sexuelles. Des tribunaux internationaux, tels que la Cour pénale internationale, ont également été mobilisés sur la question Historiquement, c’est en 1992, avec le conflit en ex-Yougoslavie, que le viol commence à être reconnucommeunearme en tempsdeguerre.Un procès historique avait ensuite lieu en 1998. Pour la première fois, le tribunal pénal international pour le Rwanda reconnaissait l’auteur d’un viol, coupable de crime contre l'humanité. Concernant l’Ukraine, l’enquête est en cours.
Page 4
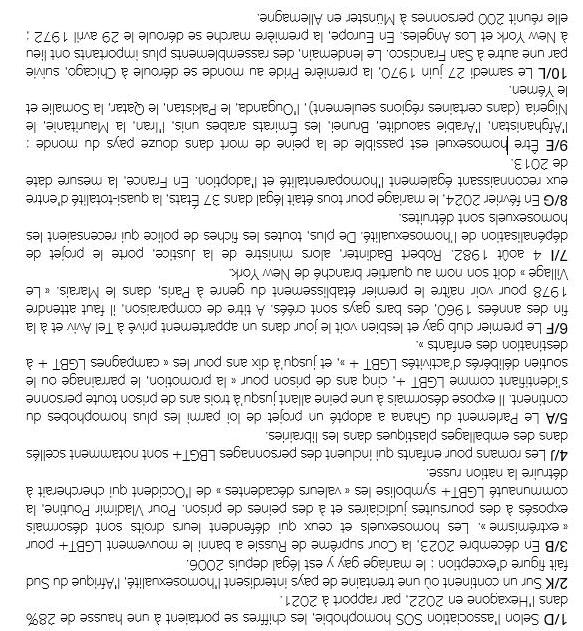
Eve Cuvelier & Roma Gignoli Roilette – 2de1 Argentine : Javier Milei, attention danger
L’élection du candidat extrémiste et ultralibéral à la présidence du deuxième plus grand pays d’Amérique Latine, en décembre 2023, s’annonce comme une menace pour les droits des femmes.
Le féminisme est pour lui l’ennemi public n°1. Durant sa campagne, le président argentin Javier Milei, élu il y a bientôt six mois, avait promis des mesures alarmantes concernant les droits des femmes dans la société, faisantreculer ainsitous les acquis obtenus ces dernières années
L’une de ses ambitions les plus inquiétantes : l’abrogation par référendum du droit à l’IVG, obtenu en 2020à l’issue d’un long combatpourlesArgentines et qui légalise l’avortement des plus de 16 ans jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée
Des mesures d’égalité pour plus d’inégalités Milei souhaite également supprimer les ministères des Femmes, du Genre et de la Diversité, déclarant croire à l’égalité devant la loi Egalité que le président argentin souhaite appliquer aux féminicides afin d’abroger la circonstance aggravante prévue par le codepénal,lorsquelegenreestlemotifducrime.Dans ce pays où les autorités ont recensé en 2022 un féminicide toutes les 35 heures, cette notion est essentielle, selon les féministes.
De la même manière, Javier Milei a expliqué dans les médias qu’il ne croit pas en l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes L’absence de majorité parlementaire du président argentin pourrait entraver la mise en œuvre de son programme, cependant La pression sociale s’annonce aussi un facteur déterminant pour les droits des femmes en Argentine.
Ali Emre Bugay – Tale6, Eryn Flambert – Tale2, Emma Kermiche – Tale6
L'amica geniale di Elena Ferrante

L'amica geniale di Elena Ferrante offre una visione complessa e sfaccettata della donna attraverso le diverse esperienze e percorsi dei suoi personaggi femminili. Le donne de L'amica geniale dimostrano un'incredibile forza interiore e resilienza di fronte alle sfide della vita. Si trovano di fronte a ostacoli sociali, economici e familiari, ma trovano modi per affermarsi e perseverare nonostante tutto. Inoltre, il romanzo esplora la complessità delle relazioni tra donne, mettendo in luce sia la solidarietà che la rivalità che possono esistere tra amiche, sorelle, madri e figlie.
I legami tra Elena e Lila, in particolare, sono ricchi di sfumature, con momenti di intimità profonda ma anche di gelosia e risentimento. Per aggiungere a ciò, i personaggi femminili de L'amica geniale lottano contro le aspettative sociali restrittive che loro vengono imposte come donne. Aspirano all'indipendenza, all'educazione e alla realizzazione di sé, ma si scontrano spesso con barriere culturali ed economiche. Il romanzo esplora le diverse sfaccettature della femminilità, dalle tradizionali aspettative di matrimonio e maternità ai desideri individuali di carriera e autonomia. I personaggi femminili sono presentati in tutta la loro diversità
Las maravillas di Elena Medel

Las maravillas di Elena Medel è un romanzo che offre uno spaccato della vita a Madrid attraverso le vicende di tre donne della classe operaia, molto distanti tra loro, ma appartenenti allo stesso ceppo familiare. Sebbene il sangue sia l'unico filo che le lega attraverso gli alti e bassi della vita, è soprattutto la loro condizione di donne ad accomunarle in un paese in cui il dogma cattolico è parte integrante della vita intima e sociale. Passando da una generazione all'altra nel raccontare le storie di queste donne, Elena Medel racconta al lettore come ognuno dei personaggi femminili affronta quotidianamente la propria epoca. Ciò che hanno in comune è che non si conformano alla norma, la prima rifiutando di sposarsi, l’altra rifiutando l'evidenza della maternità. Queste storie di emancipazione sottolineano anche l'importanza della mancanza di denaro che determina il destino di una persona (nessuna istruzione, un lavoro precario in cui si può essere sostituiti da qualsiasi persona...). Il romanzo esplora temi come la povertà femminile, lo sradicamento, il femminismo, la maternità e la complessità delle relazioni familiari.
The Handmaid's Tale di Atwood
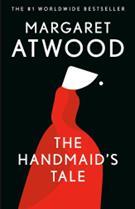
Margaret Atwood è una scrittrice e critica letteraria canadese che ha scritto oltre sessanta libri, molti dei quali interrogano la società su questioni contemporanee, che vannodallapoliticaaidiritti umani.Isuoilibrisonomolto importantiperlacomunitàletterariainquantospessosono codificati con previsioni di eventi futuri.
La sua capacità di prevedere le permette di immaginare scenari, spesso distopie, cheavvertono i lettori sul futuro verso cui ci stiamo dirigendo. I suoi libri spesso portano idee femministe estremamente importanti come il diritto di avere voce sul proprio corpo o il diritto al lavoro. L'iconico abito rosso e bianco che Atwood descrive nel
suo libro più famoso, Il racconto dell'ancella, è stato addirittura indossato nelle proteste che lottavano per il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Nonostante le sue preoccupazioni per la causa femminista, Atwood è turbata dal termine «femminista»
Infatti, accusa il femminismo di idealizzare le donne piuttosto che renderle più
Sottolineando le terribili condizioni in cui le donne devono vivere, Atwood sottolinea le conseguenze di spingere le società patriarcali e puritane agli estremi. Le condizioni disumane che Atwood sviluppa nel suo libro sottolineano la fragilità del ruolo delle donne nella società odierna e quanto facilmente tutti i progressi che le donne hanno raggiunto in società possano essere riportati indietro. Questo mostra perché, come società, non possiamo mai smettere di lottare per i diritti delle donne perché nel momento in cui smettiamo di combattere, i progressi cominciano a deteriorarsi.
La scrittura di Atwood offre una prospettiva nuova e cruciale sulle esperienze delle donne, una che va oltre le rappresentazioni idealizzate per presentare una visione più sfumata e umanistica. Affrontando verità scomode e sondando le profondità dell'ingiustizia sociale, Atwood incita i lettori a rivalutare la propria comprensione delle dinamiche di genere e a rimanere vigili nella lotta in corso per i diritti delle donne.
In questo modo, non solo arricchisce il panorama letterario, ma anche catalizza l'azione collettiva verso un futuro più equo e giusto per tutti.
Delle opere che si parlano e si completano
LeoperediElenaFerrante,ElenaMedeleMargaretAtwoodoffronotreprospettive uniche sulla condizione femminile, connettendo in modo intricato la loro rappresentazione al ruolo delle donne nella letteratura mondiale e nel mondo stesso.
L'amica geniale di Ferrante si immerge nell'intimità della Napoli degli anni '50, offrendo un ritratto realistico delle lotte di due amiche per l'indipendenza e la realizzazione personale in un contesto di povertà e tradizione oppressiva. Qui, la forza e la resilienza delle donne emergono attraverso le sfide quotidiane e le relazioni complesse, riflettendo le aspirazioni e le contraddizioni della femminilità nel contesto sociale e politico dell'epoca.
In Las maravillas di Medel, il romanzo spagnolo svela le vite interconnesse di tre donne appartenenti a generazioni diverse, tutte lottando contro la povertà, il declassamento sociale e l'oppressione patriarcale nella Madrid contemporanea. Attraverso le loro esperienze distinte, Medel esplora le implicazioni della povertà femminile, dello sradicamento e della ricerca di emancipazione in una società intrisa di tradizioni e norme restrittive.
Infine, The Handmaid's Tale di Atwood presenta una distopia in cui le donne sono ridotte a ruoli riproduttivi in una società totalitaria dominata da uomini estremisti religiosi. Qui, Atwood illumina le conseguenze estreme dell'oppressione delle donne, sottolineando la fragilità dei progressi ottenuti nell'uguaglianza di genere e la necessità di rimanere vigili nella lotta per i diritti delle donne. Insieme, queste opere esplorano la complessità della femminilità, offrendo una visione ricca e sfaccettata delle lotte, delle aspirazioni e delle relazioni delle donne nel mondo contemporaneo e oltre.
Confrontando queste tre opere, vediamo che ognuna offre una prospettiva unica sulla condizione femminile, evidenziando le lotte, le aspirazioni e la resistenza delle donne in contesti diversi. Nonostante le differenze di impostazione e tono, tutti e tre celebrano la forza, la resilienza e la diversità delle esperienze femminili, invitando le lettrici ed i lettori a riflettere sulla complessità della condizione femminile e sull’importanza della solidarietà nella lotta per l’uguaglianza e la giustizia.
5
Damla Dogan – 1ère5, Kallisté Jomin –1ère1 & Faostina Pelé-Pajanacci– 1ère5
Una visione demistificata della maternità attraverso il monologo di Sofia nel film
Due Partite è una commedia dolce-amara sul mondo femminile. Tuttavia, dietro il riso che provoca il film si nasconde una riflessione sulla condizione materna. La maternità, da sempre celebrata come uno dei momenti più sacri e gratificanti della vita di una donna, è spesso avvolta da un velo ideale che nasconde la sua realtà più cruda e disillusa. Questa illusione romantica viene efficacemente smascherata nel monologo di Sofia, un personaggio che, con franchezza e brutalità, getta luce sulla vera natura diquesta esperienza. Attraverso le sue parole taglienti e provocatorie, Sofia strappa via il velo di idealizzazione che spesso circonda la maternità, mettendo in discussione le convenzioni sociali e culturali che la glorificano. Infatti, attraverso Sofia, che si è ritrovata ad avere un bambino che non voleva, scopriamo la realtà della maternità, i suoi aspetti bestiali e il sacrificio della sua propria libertà.
La riflessione di Sofia sulla maternità, ci fa capire qual èilmitointornoalla gravidanza,costruitodallasocietà. In effetti, partorire è il solo atto a poter dare la vita. Quindi, quest’atto è stato sacralizzato da una società principalmente maschilista al punto che le donne erano prima di tutto viste come madri. Perciò, le donne sono state illuse con questa visione magica e idealistica della maternità creata dalla società, e sono dunque state spinte ad avere bambini. È questa visione che Sofia smonta attraverso le sue parole.
Sofia suggerisce che la maternità, anziché essere un’esperienza sublime, può essere vissuta come una forma di «barbarie», un’esperienza primitiva e dolorosa che mette in luce la condizione umana nella sua forma più elementare. Leievoca la realtà delparto denunciando la sua brutalità e le conseguenze fisiche serie sulcorpodelle donne. Inoltre, ilmonologo rivela gli aspetti più disturbanti e scuri della maternità. In particolare, l’allattamento e dunque il latte «che esce dal capezzolo» viene associato a quello di una capra, ed il bambino è paragonato ad un Alieno. Perciò la condizione ideale della maternità è in realtà annichilente e tragica. Questo rifiuto dell'immagine idealizzata della maternità evidenzia lo sforzo diSofia nel mostrare la realtà cruda di questa esperienza. Sofia critica la tendenza della società a idealizzare e romanticizzare la maternità, ignorando la realtà e i sacrifici che le donne devono affrontare. Infatti, pensa che le donne si sottomettano ad un legame con un figlio che le strozza. Si basa sull'esperienza delle sue amiche che sono state, anche loro, costrette a questo sacrificio, una dovendo rinunciare a suonare il pianoforte, l’altra sopportando di essere tradita. Opportunità limitate, perdita di autonomia e di realizzazione personale… Secondo Sofia, le donne devono avere il diritto di perseguire i loro talenti e di godere di una piena autonomia.
Lasuacriticamostrailbisognodiadottareunavisione più onesta e inclusiva della maternità. Dalla verità nasce la libertà.

Pour lire les articles en français, scannez le QR Code cicontre !
Nel testo - Monologo di Sofia
E va bene, abbiamo smesso di giocare. Ma io vi voglio dire una cosa, una verità.
Io penso che questa cosa -sopportabile – del parto che sta per affrontare Beatrice sia una barbarie… ora Beatrice non ti mettere a piangere per favore… L’abbiamo affrontata tutte e siamo tutte qua…Ma perché non dire che una bella scopata senza conseguenze è più piacevole? Sì sì, certo… è triviale, è il punto di vista di un uomo, di un amante ma è superiore al nostro. È moderno, essenziale. E perché no? Piacevole. Ma non è questo il punto.
Perché si deve soffrire in questo modo, rinunciare a suonare il pianoforte, sopportare di essere tradite? Dov’è la ragione di tutto questo? Non c’è! Non c’è! Noi siamo delle creature primitive, questa è la ragione. Abitiamo ancora nelle caverne. Noi non vogliamo ciò che è semplice, efficiente.
No, noi amiamo le cose contorte, complicate, come il tormento che Gabriella dà a Sandro. Non possiamo diventare moderne, ha ragione Claudia. Se diventiamo moderne, smettiamo di essere donne.
Ma come si può essere moderne quando l’utero si deve aprire di dieci, dodici centimetri per far passare la testa del bambino -scusa, non piangere Beatrice, è la pura verità… Quando ti verrà da pisciare e cacare senza vergogna in faccia al dottore!
Noi siamo la barbarie del mondo: facciamo l’esperienza più antica che c’è, l’unica rimasta, contenere un altro. Il latte esce dal capezzolo che è simile a quello di una capra!
La mia portiera, quando ho partorito, ha chiesto a mio marito: “Ha sgravato la signora?”. Noi godiamo a vedere il nostro corpo gonfio come un pallone, a essere abitate da un alieno, a rinunciare al talento, alla libertà.
Noi vogliamo essere legate a qualcuno anche se ci strozza. Vogliamo essere di qualcun altro. E non c’è fine, non c’è rimedio…A chi toccava dare le carte?


« Pour vivre heureux, vivons cachés » … Le célèbre adage vaut-il en politique ? L’historien, ancien président de Radio France et homme politique Jean-Noël Jeanneney répond à nos questions.
Casse Ton Cliché (CTC) : En politique, qu’est-ce que la « peopolisation » ?
Jean-Noël Jeanneney : C’est l'intrusion de la curiosité publique dans la vie privée des acteurs de la vie politique, hommes et femmes confondus. Le terme nous vient des Etats-Unis et avec lui cette aspiration à tout connaître des acteurs à qui les citoyens délèguent le pouvoir de décider et d'agir en leur nom, en démocratie. Les Etats-Unis sont marqués par le protestantisme, donc par une certaine aspiration au moralisme, y compris dans la sphère privée. En France, et dans une large mesure en Europe, la tradition est toute autre. La « peopolisation » conduit à se demander s’il est légitime que la vie privée des politiques soit offerte à la curiosité, souvent malsaine, de leurs compatriotes.
Plus largement, est ainsi posée la question de la transparence de la vie publique. D'un côté, il paraît légitime et même nécessaire que les citoyens sachent ce qui motive les prises de décisions des gouvernants et surtout qu’ils puissent, par l'intermédiaire des journalistes en particulier, avoir connaissance des éventuelles turpitudes des élus aux dépens de l'intérêt général ; d’un autre côté, il faut se demander jusqu'où la transparence doit aller. Car, absolue, elle peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients.
CTC : S’intéresser à la vie privée des politiques, est-ce un phénomène nouveau?
Jean-Noël Jeanneney : Il y a toujours eu une grande curiosité pour la vie privée des hommes et des femmes de la vie publique. C'est une tendance naturelle que l’on retrouve dans tous les régimes, y compris la monarchie.
La curiosité populaire pour l’intimité des rois, par exemple, tout au long du XVIIIᵉ siècle, était éclatante. Elle se traduisit par une foule de rumeurs, souvent infâmes, sur Marie-Antoinette et l’impuissance de son mari, ses amours pour tel ou tel. Là, c'est la « reine scélérate », comme dit Chantal Thomas, qui est mise au pilori, à coups de pamphlets répandus sous le manteau, de chansons grivoises, etc. De nos jours, la curiosité populaire s’exprime à travers beaucoup de petits journaux, souventvulgaires,etpresquesans limite. Selonles époques, elle aévolué en fonction de deux facteurs : la capacité de savoir, c'est à dire la possibilité d'écouter les conversations et de prendre des photos à distance ; et l'intensité du désir de faire savoir dans le désir de faire scandale. Or l’indignation évolue dans le temps, selon l’état des mœurs. Le fait, par exemple, que l’homosexualité d’un ministre ne constitue plus un sujet de scandale est évidemment le signe d'une modification de l'état des esprits (et, à mes yeux d’un progrès). Décidément, il faut séparer la vie publique de la vie privée. N’excluons jamais au surplus qu’une prétendue transparence puisse conduire à l’infamie.
CTC : Un exemple emblématique ?
Jean-Noël Jeanneney : Voyez le cas de l’affaire Markovic qui devint une affaire d’État mettant en cause la femme de Georges Pompidou. En octobre 1968, Pompidou a quitté ses fonctions de Premier ministre du Général de Gaulle depuis quatre mois. Il était à Matignon depuis six ans. Candidat potentiel à la présidence de République pour la prochaine élection de 1969, il n’a pas que des amis. Des rumeurs infâmes, lancées par quelque officine fétide, relayées dans la presse, courent alors sur sa femme Claude et sa prétendue participation à des orgies. Des photos, en réalité des montages grossiers, circulent. Pompidou en est infiniment meurtri. Il est tenu d’abord dans l’ignorance de ce bruit qui le touche de près et il conservera une rancune tenace contre tous ceux qui ne l’ont pas averti et soutenu. Une rancune qui le déterminera à se présenter à l’élection présidentielle de 1969
CTC : Peopolisation et transparence ont-elles donc un impact sur la façon de faire de la politique ?
Jean-Noël Jeanneney : La question est simple et la réponse difficile. En démocratie, le poids de l'opinion publique est toujours capital pour les dirigeants politiques, qui doivent forcément la prendre toujours en compte dans leurs prises de décision. La « peopolisation » a des conséquences sur les hommes, leurs jugements, leur réputation, donc sur leur autorité. Par ce détour-là, effectivement, l’impact se fait sentir sur la marche de la démocratie. François Hollande photographié en scooter n'a pas rencontré l'idée que les Français se faisaient du charisme d'un président et il en est sorti affaibli.
CTC : Le fait que les citoyens soient avides de transparence en politique représente-t-il un danger pour la vie démocratique ?
Jean-Noël Jeanneney : En démocratie, il est légitime que l’élaboration des décisions élaborées en amont ne se déroule pas systématiquement sous le regard descitoyens.«entempsréel»,commeonditbizarrement.Lesélusdoiventpouvoir réfléchir librement, sans qu’immédiatement tombe le couperet de la critique. Vient ensuite la question de la temporalité du dévoilement… Selon quels délais l’accès à la connaissance par tous, donc à la critique républicaine ? Presque aussitôt ? Peu après ? Plus tard ? très tard ? Jamais ? Question capitale. On rejoint ici la question de la date d’ouverture des archives nationales à la recherche scientifique et à l’intérêt des citoyens : délai toujours discuté.
CTC : Faut-il une investigation systématique sur l’argent des élus ?
Jean-Noël Jeanneney : Depuis quarante ans s’est affirmé le principe d’une déclaration de patrimoine pour les acteurs politiques au moment de leur entrée en
7
fonction (parlementaires, hauts fonctionnaires, ministres).Unprincipe déjà débattu dans l’Histoire. En 1924, un amendement fut adopté par la Chambre des députés, stipulant que ces derniers devaient afficher leurs revenus et leur patrimoine en mairie. Le Sénat enterra la chose qui lui paraissait, alors, saugrenue… De nos jours, si la déclaration de patrimoine est une bonne idée, sa publication ne l’est pas, à mes yeux. Il suffit qu’une commission spécialisée recueille ces données et en tire des conséquences éventuelles. Il y a eu dans l'histoire de France quantité de gens honnêtes ! Il faut aussi faire confiance. Le cardinal de Retz avait cette formule que j'aime beaucoup : « On est souvent plus trompé par défiance que par confiance ». Les quelques escrocs et personnages louches sauront toujours échapper plus ou moins aux contrôles et frauder. Les autres, ceux qui sont honnêtes, pâtiront de l’investigation, souvent de la jalousie, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Or, discrédit injustifié et généralisé de tout le personnel politique constitue un grand péril pour la démocratie.
CTC : Quid des fonds de campagnes des partis politiques lors des élections ?
Jean-Noël Jeanneney : Là, le secret est néfaste. Autant la transparence absolue de la vie privée des politiques est dangereuse, autant celle concernant le fonctionnement des élections constitue un progrès précieux pour la vie démocratique. Connaître l’origine des fonds de campagne (en même temps qu’on les limite) est très sain - donc indispensable. Le cas des Etats-Unis, qui est contraire, donne des résultats inquiétants.
CTC : Peut-on approfondir cette question du secret, par-delà les situations individuelles ?
Jean-Noël Jeanneney : C’est le sujet de l’ouvrage, paru en mars dernier, de Sébastien-Yves Laurent, État secret, État clandestin : essai sur la transparence démocratique.
«L'Étatsecret»estlégitime,àconditionqu'unjour–celapeutêtredanslasemaine, ou trente ans plus tard) – les citoyens puissent accéder aux informations. « L'État clandestin », lui, ne peut jamais avouer des actions apparemment inadmissibles en démocratie, mais qui peuvent parfois relever de l'intérêt public. C'est ce que l'on appelle depuis longtemps la « raison d'État ».
A titre d’exemple, certaines révélations de François Hollande, président de la République,ontposéunproblèmecarlesactionsconcernéesn'étaientpasdestinées à être dévoilées. Il a expliqué en particulier qu'il avait donné son accord pour que soient tués par nos services secrets un certain nombre de personnages complotant contre la sécurité de la France. Il serait au demeurant naïf de nier que l'État dispose et use de certains pouvoirs opaques - et voilà l’État clandestin.
Dans un registre généralement moins dramatique, on peut s’intéresser aux fameux « fonds secrets » de l’État que les ministres, jusqu’au début de ce siècle, avaient la liberté de dépenser à leur guise pour des actions parfois honorables (en « lubrifiant » les circuits administratifs) mais pas toujours, loin de là. Ils contribuaient, notamment, pour les partis au pouvoir, aux frais considérables des campagnes électorales, avant que le financement- limité- de celle-ci ait été, ce qui a été très bienvenu, prévu et organisé, notamment aux frais de l’Etat.
CTC : Le « cas » de la santé de François Mitterrand aurait-il dû relever de l’État secret ?
Jean-Noël Jeanneney : Il s’agissait de son cancer, connu par lui dès la fin de 1981 et non dévoilé. Intéressante interrogation en effet. Faut-il vraiment imposer de publier tous les six mois un bulletin de santé officiel ? Je ne le crois pas. Preuve a été faite alors qu’il était difficile d’échapper au mensonge. Car dire la vérité aurait affaibli l’autorité du président. Mais ce même mensonge, forcément découvert, après coup, était en soi délétère.
A l’inverse, la révélation dans la presse, tardive, de l’existence de la fille du président Mazarine Pingeot, n’a pas eu de conséquences sur son action politique. Les temps étaient en train de changer.
Cinquième bulletin de santé de M. Mitterrand : " Résultats dans les limites de la normalité ", Le Monde, 30 juin 1983
L'Élysée a publié, le mercredi 29 juin, dans la matinée, le bulletin de santé semestriel de M. François Mitterrand. " A la demande de M. François Mitterrand, président de la République, est-il noté, un bilan de son état de santé a été établi à la fin du quatrième semestre de son septennat. Ce bilan a comporté un examen clinique et des investigations biologiques habituelles. Les résultats sont satisfaisants, dans les limites de la normalité. "
Ce bulletin est le plus court de ceux qui ont été publiés depuis mai 1981. En décembre 1981, le président de la République avait présenté une " cruralgie droite ". Depuis cette date, tous les bulletins de santé font état de résultats normaux.
CTC : De nos jours, les politiques ont tendance à mettre en scène leur vie privée dans les médias…
Jean-Noël Jeanneney : Encore une influence américaine ! Utiliser sa vie privée
pour gagner des points en politique m’a toujours paru malsain.
Au débutdes années70,Giscard d’Estaing candidats’estaffiché dans lesrues avec l’image de l’une de ses filles. J’ai trouvé cela incongru. Mais le premier, sauf erreur, à s’y être employé a été Jean Lecanuet, candidat démocrate-chrétien lors de l’élection présidentielle de 1965 contre de Gaulle.
Se voyant lui-même comme un « Kennedy à la française », il conduisit une campagne qui se voulait à l’américaine, avec l’aide d’une agence de communication. Le candidat se fit photographier chez lui avec sa famille. Malgré cette campagne « moderne », il n’arriva qu’en troisième position (16 %), derrière François Mitterrand (32 %) et de Gaulle, comme vous le savez, fut reconduit à la présidence au deuxième tour. Si le Général avait fini par accepter de mauvaise grâce un exercice télévisuel plus intimiste, avec le journaliste Michel Droit, vous ne l'imaginez pas un instant se montrer avec son fils, sa fille ou ses petits-enfants… A partir de là, néanmoins, la vie intime des candidats a pris plus de place, dans les magazines « people » : terme anglo-saxon, pas par hasard… Je redis que je trouve cela malheureux.

CTC : A ce titre, comment la femme d’un président de la République doit-elle ou peut-elle exister en politique ?
Jean-Noël Jeanneney : Sur le statut de la femme du président en France, j'ai l'impression que la période, chez nous, est au flottement. Aux Etats-Unis, la « première dame » a un rôle important, quasi-constitutionnel : après avoir été omniprésente dans la campagne électorale. En France, c’est différent. Le concept de « Première dame » n’existe pas. D’ailleurs, je déplore cette malheureuse transposition d’une formule américaine, laide et assez absurde chez nous.
En France, la femme du président a, certes, un rôle à jouer mais elle n'a pas de fonction officielle.
S’intéresser à la conjointe du chef de l’État ou au conjoint, un jour, me paraît normal, à condition de laisserla vie privée de côté, sauf exception : dans les années 1950, la femme du président René Coty, Germaine, acquit une popularité rare du fait de sa gentillesse et de sa conduite « modeste ». Elle posa en couverture de Paris-Match, en train de servir debout sa soupe à son mari. Lorsqu’elle mourut pendant le mandat de son mari, en 1955, beaucoup de Français en furent peinés Toute une époque !
Le magazine américain Life publia un papier dans son numéro du 28 novembre, sousle titre « Homage to a Lady ». Mais pas de rôlepolitique ! Et pasde «première dame » !
Retrouvez Jean-Noël Jeanneney dans l’émission « Concordance des temps », le samedi de 10h à 11h sur France Culture

Antoine Jacheet – 1ère3
« Liberté, égalité, fraternité » ... Derrière les fondements de la République se cache une structure juridique stricte qui contribue à protéger et encadrer les individus. Tour d’horizon de ce que dit la loi.
Le terme d’égalité désigne « l’absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits ». Juridiquement, le principe d’égalité englobe une série de principes inaliénables. Qu’il s’agisse d’une égalité des genres, une égalité des chances, une égalité politique ou d’accès aux soins, ce droit fondamental structure la société au sein de laquelle le pouvoir s’organise. Dès lors, le droit et la loi jouent un rôle fondamental dans la mise en application du principe d’égalité.
Le principe d’isonomie
Le socle du principe d’égalité au sein de notre démocratie ? L’isonomie, « système d’égalité devant la loi » Ce principe, constitutionnalisé le 4 octobre 1958, est également renforcé au sein du Code Pénal Français. L’article 225-1, entré en vigueur en 1994, soumet en effet à sanctions tout individu qui exercerait des actions considérées comme discriminantes.
Dès lors, le droit contribue à encadrer l’égalité en ce qu’il sanctionne toutes distinctions, qu’elles soient liées à l'apparence physique, le sexe, la grossesse…
Autre texte de loi : l’Article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme en son
sein que : « chaque individu est égal en droit ». Néanmoins, derrière ces deux textes de droit se cache la nature inexacte d’une loi, qui ne peut s’appliquer strictement et sans interprétation d’une situation dans laquelle des inégalités seraient nécessaires et admises pour rétablir une égalité insuffisante.
Le principe d’équité
Comment une augmentation des inégalités pourrait en réalité réduire ces mêmes inégalités ? Ces différences de traitements admises par la loi pour rétablir une égalité insuffisante sont fondées sur un principe d’équité, droit « naturel » en opposition avec le principe de droit « positif » qu’est l’égalité.
Par ailleurs, une deuxième limite semble s’imposer dans le cadre de la relation qu’entretiennent le droit et l’égalité. Si, en vertu des fondements juridiques français, chaque individu doit être traité de manière égale, d’où sontissues les inégalités salariales entre les hommes et femmes ? Dans quel contexte est-il légitime et utile de parler d’égalité et de différences, et des liens qui gouvernent ces deux concepts ? Les questions s’imposent, nous invitant à réfléchir sur la possibilité d’une égalité parfaite au sein des sociétés.

Anna Coles & Marie Ruchon – Tale2
Les tenues des femmes politiques font régulièrement l’objet de débats et de critiques. Mais quelle est la frontière entre discrimination sexuelle et rappel à la convenance ?
"Tout le monde était étonné de la voir en robe. Elle a manifestement changé de look, et si elle ne veut pas qu’on s’y intéresse, elle peut ne pas changer de look. D’ailleurs, peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu’on écoute ce qu’elle avait à dire." A l’issue d’une séance à l’Assemblée nationale en 2012, c’est par ces mots que Patrick Balkany, député des Hautsde-Seine et maire de Levallois-Perret, commentait la tenue de la ministre du Logement Cécile Duflot. La robe bleue et blanche, parfaitement appropriée pour lafonctiongouvernementale,luiavaitvaluàl’époque des remarques à caractère sexiste de la part de certains députés des rangs de droite, en séance
parlementaire. Les femmes politiques, telles queValérie Pécresse ou Roselyne Bachelot, commentent régulièrement l’influence de leur tenue sur leur crédibilité. Dernièrement, Ersilia Soudais, députée de la France Insoumise(LFI),asubilacritiquesurTwitterd’Alain Jakubowicz, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), au sujet de sa tenue : un short en jeans agrémenté de collants et de baskets. Plusieurs collègues députés avaient dénoncé la remarque jugée misogyne, ce dont l’homme s’estdéfendu,expliquantqu’iltrouvaitcette tenue « indigne » de l’Assemblée Nationale.
Page 9
Des fondements subjectifs
Les fondements d’une égalité dans le droit sont considérablement subjectifs, soumis à l’interprétation de chaque peuple et gouvernement Dès lors, tandis que le principe d’égalité s’établit comme un pilier sur lequel de nombreuses nationsse fondentafin deconstruire leur corpus juridique, il n’est pas toujours appliqué et souhaité Il faut donc laisser place à une interprétation du contexte afin de faire prévaloir l’égalité, lorsque cela est nécessaire.

Camille Barbe – Questionneuse
A l’Assemblée, un code vestimentaire à respecter
Interrogé sur la question de la décence à l’Assemblée nationale, l’historien et homme politique Jean-Noël Jeanneney a tranché
Casse Ton Cliché (CTC) : A l’Assemblée nationale, le respect de certains codes vestimentaires est-il important afin de bien représenter la fonction parlementaire ?
Jean-Noël Jeanneney : Mon avis est radical. Il faut respecter un certain code vestimentaire. Je déplore le débraillé. Les députés incarnent une chose très noble : la démocratie. La vie collective est faite de signes… La tenue est un signe de respect de la fonction parlementaire, et par conséquent de ses électeurs. Les codes évoluent avec le temps, cependant. A l’heure actuelle, le bureau de l'Assemblée n’impose plus le port de la cravate tout en rendant obligatoire le port de la veste pour les hommes. Le port de short et de bermuda a été officiellement interdit…
CTC : Quels sont les moments emblématiques de « transgression vestimentaire » à l’Assemblée ?
Jean-Noël Jeanneney : A la fin du XIXe siècle, sous la IIIe République, Christophe Thivrier, député socialiste de l’Allier, siégea en blouse pour mieux souligner sa condition d’élu du peuple. Et l’abbé Lemire en soutane.
Sous la Ve République, en 1985, à une époque où on ne pouvait rentrer sans cravate dans l’hémicycle, Jack Lang, ministre de la Culture sous François Mitterrand, était arrivé avec une veste à col Mao signée Thierry Mugler, dans un style extrêmementchic.On ditque les huissiers lui imposèrent une cravate… Pour le pantalon féminin, c’est autre chose. En 1972, Michèle Alliot-Marie, à l'époque conseillère politique RPR, s'était vu refuser l’entrée de l’Assemblée car elle portait un pantalon, alors prohibé pour les femmes : inconcevable aujourd’hui ! Ce à quoi elle aurait répondu : « Si c’est le pantalon qui vous gêne, je l’enlève. » L’humour contre le machisme obtus…
Congé menstruel, gratuité des protections hygiéniques, douleurs pelviennes, endométriose… Depuis une dizaine d’années, les tabous liés au cycle qui rythme la vie des femmes se lèvent petit à petit. Un vrai enjeu de société mis au grand jour.
Depuis des siècles, les règles ont été reléguées au rang de tabou et considérés comme une affaire de femmes qu’il ne faudrait aborder qu’en chuchotant. « Dis-moi, aurais-tu une serviette ou un tampon à me dépanner ? », « Je suis désolée, je ne suis pas en forme, j’ai mes… », « Permettez, j’ai besoin de m’asseoir un instant » … Denos jours, lorsque le sujet doit être évoqué, d’autres noms sont souvent utilisés pour le contourner, voire pas de noms du tout Historiquement du domaine de l’impur, issu d’une vision très masculine et influencé par les religions monothéistes, les règles des femmes concernent pourtant directement plus d’un individu sur deux et indirectement l’ensemble des hommes et des femmes dans la société. Au travail, à l’école, au sport, à la maison… Les menstruations s’invitent tous les mois dans toutes les sphères du quotidien. Depuis une dizaine d’années, des campagnes de sensibilisation initiées par les associations féministes ont pour but de « désinvibiliser » le cycle des femmes et son impact Interrogés sur la question du tabou, des élèves de l’EIB expliquent qu’ils en parlent de plus en plus entre eux, « les garçons étant un peu plus ouverts sur le sujet ». Néanmoins, la plupart pensent aussi que les femmes ne sont pas assez soutenues socialement « La douleur et les handicaps liés aux menstruations sont constamment minimisés par la société patriarcale », confie une des élèves.
Un sentiment qui fait écho à celui des femmes en général, dans la sphère professionnelle. En effet, 68% d’entre elles jugent que les règles sont « un sujet tabou en entreprise », 65 % des femmes salariées « ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail » et 35 % jugent que leurs douleurs « impactent négativement leur travail » Des douleurs aléatoires et inégales, dont il est difficile de tirer une généralité, car souvent propres à chacune. Prendre en compte les individualités au sein du groupe… Là réside peut-être la lenteur des avancées. En février 2024, leSénatdébattait d'une propositionde loi visant à instaurer, comme plusieurs collectivités le font déjà, un arrêt de travail facilité de deux jours et sans jour de carence pour les femmes souffrant de règles douloureuses et « incapacitantes ». Défendu par les sénateurs socialistes, le texte a été rejeté par la majorité et par le gouvernement, qui ont argué que la mesure pourrait porter atteinte au secret médical et ouvrir la voie à une possibilité de discrimination à l’embauche. Si le ministre de la Santé Frédéric Valletoux a déclaré que « ce sujet ne restera pas lettre morte », la France ne fait pas figure d’exception par rapport au cadre de la loi. En Europe, l’Espagne est le premier et le seul pays à avoir adopter un congé menstruel intégralement financé par l’État en 2023 Sujet intime devenu sociétal, les règles sont désormais aussi un sujet éminemment politique

Image libre de droit
Stanislas Lecocq – Tale 6
La contraception, une affaire de femmes ? Les effets indésirables de la pilule et dispositifs intra-utérins ont relancé le débat sur la question. D’aucuns appellent à une responsabilité partagée entre les sexes.
Moins développée que celle reposant sur le corps de la femme, la contraception masculine se résume actuellement en deux méthodes : les préservatifs, la seule et unique méthode de contraception qui protège aussi contre toutes les infections sexuellement transmissibles (IST) et la vasectomie, contraception définitive, aussi appelée « stérilisation masculine » Dans un appel lancé en 2022, le journal Libération demandaitauxpouvoirs publics etauxlaboratoiresde développer de vraies solutions pour que la contraception soit aussi une affaire d’hommes. Le but ? Alléger la charge pesant actuellement sur les femmes, quant aux préoccupations liées à la santé sexuelle et à la reproduction. L’idée semble faire son
chemin. Selon un sondage Opinion Way, 37 % des hommes de 18 à 30 ans seraient prêts à recourir à une pilule remboursée, 22 % à la vasectomie et 12 % sont prêts à tester le slip chauffant. Cette dernière méthode de contraception thermique n’est cependant pas sans inconvénients. A l’heure actuelle, de nouveaux produits contraceptifs sont en développement, parmi lesquels le gel hormonal NES/T. Les résultats, encourageants, seront bientôt rendus public. Dans cette affaire de contraception, une autre question est en débat… Faut-il laisser la main aux hommes ? Selon une enquête financée par la Fondation Gates, la majorité des femmes se disent prêtes à faire confiance à leur compagnon.
Page 10
Les règles en chiffres
Une femme a ses règles en moyenne entre 2 555 et 3 000 jours dans sa vie, soit plus de 8 ans au total
Le cycle menstruel d'une femme est de 28 jours en moyenne. La durée des règles est de 2 à 7 jours
Une femme perd entre 20 à 80 ml de sang pendant un cycle 40 ml correspondent à 7 cuillères à soupe
Les femmes commencent à avoir leurs règles entre 11 et 14 ans et finissent d'en avoir vers l'âge de 50 ans
Un rapportdel’ONG PlanInternationalestime queplus de 500 millions de filles et femmes dans le monde sont en situation de précarité menstruelle, soit 1 sur 4
En 2021, en France, 2 millions de personnes n’avaient pas de quoi s’acheter des protections menstruelles. Le chiffre a doublé en 2 ans, approchant les 4 millions de personnes en 2023.
En France, le budget alloué aux règles par une femme tout au long de sa vie est estimé entre 8000 et 23000
euros
En 2018, le marché global des protections hygiéniques représentait un chiffre d’affaires de 34,24 milliards d’euros. 50 milliards de tampons ou de serviettes sont jetés en Europe chaque année
Les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire pourront bénéficier de la prise en charge des culottes et coupes menstruelles par l’Assurance maladie, à partir du 1er septembre 2024.
Meryl Lorougnon – Tale3
Pilule du lendemain : mode d’emploi
La pilule du lendemain, c’est quoi ?
La pilule du lendemain est une contraception hormonale d’urgence, elle permet un retardement de l’ovulation et perturbe ainsi la nidation de l’œuf éventuel. En d’autres termes, elle permet, après le rapport à risque, d’éviter une grossesse non désirée. Il existe deux types de pilule du lendemain, qui sont toutes deux accessibles sans ordonnance : La NorLevo doit être prise dans un délai maximum de 72 heures après le rapport et son prix se situe entre 3 et 7 euros. LaEllaOne,quantàelle,peutêtreprisejusqu’à5jours. Son prix est de 18€ mais elle est remboursable à 65% par la Sécurité Sociale.
Comment ça marche ?
La pilule du lendemain doit être prise le plus rapidement possible car plus le temps s’écoule, plus l’efficacité diminue.
Dans les heures qui suivent la prise des comprimés, les effets ressentis peuvent être des nausées, voire des vomissements, dans un quart des cas.
En cas de vomissement, il est fortement recommandé de reprendreun comprimé dans les trois heures suivant la prise du premier
La pilule du lendemain n’est à utiliser uniquement qu’en cas d’urgence. Elle n’est en aucun cas une méthode de contraception régulière car elle perturbe le cycle hormonal féminin.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’assurance maladie : www.ameli.fr

Lucie Maslard – 2de2
pour l’accès à l’
Danielle Hassoun, gynécologue obstétricienne et Jacqueline Valensi, médecin généraliste nous parlent de leur combat pour les droits des femmes à disposer de leur corps.
Casse Ton Cliché (CTC) : Pouvez-vous revenir sur vos carrières respectives ?
Danielle Hassoun : Après mes études de médecine, j’ai travaillé à partir de 1978 à la maternité des Lilas en tant que gynécologue obstétricienne et je me suis installée en cabineten 1981.A partir de là, j’aiarrêté l’hôpitalpour me tourner vers la santé publique. Pendant une vingtaine d’années, je jonglais entre mon cabinet, un centre d’interruption volontaire de grossesse (IVG) dont j’étais responsable ; j’effectuais aussi des missions de formation et d’évaluation de programme IVG à l’étranger, pour des organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore des organisations non gouvernementales (ONG) américaines, dédiées à la santé des femmes
Au sein de ces structures, nous avons beaucoup travaillé dans les pays de l’Est, où les avortements ne se pratiquaient que par aspiration et où la contraception était très peu usitée. J’ai aussi formé des médecins en Afrique anglophone, dans une moindre mesure
Toujours dans les années 1980, j’ai participé aux premiers essais cliniques sur l’IVG médicamenteuse, avant la commercialisation en 1989. Je suis devenu sorte d’experte sur le sujet aux Etats-Unis.
Jacqueline Valensi : De mon côté, je me suis installée en cabinet en 1974. Je me suis battue tout au long de mon parcours pour la médecine générale, surtout en cancérologie ainsi que pour la place des femmes en médecine. J’ai ensuite fait des vacations à la police, étant diplômée de réparation juridique du dommage corporel J’ai terminé ma carrière à l’hôpital de Saint-Denis, en tant que médecin du travail
CTC : Comment avez-vous lutté pour l’accès à l’avortement ?
Danielle Hassoun : Avant 1975, je n’ai pas pratiqué d’avortements clandestins J’ai fait des avortements illégaux, après la dépénalisation. A la maternité des Lilas, nous estimions que la loi n’était pas suffisante et donc nous faisions des avortements plus tardifs que la loi ne l’autorisait Les femmes enceintes de plus de douze semaines d’aménorrhée qui se présentaient à nous étaient toujours dans des situations épouvantables… Il s’agissait de femmes dans la précarité, qui ne connaissaient pas les réseaux pour aller avorter. Souvent des étrangères mais aussi de très jeunes filles, mineures
Jacqueline Valensi : Il faut savoir qu’à l’époque, la maternité des Lilas était tout à fait exceptionnelle, à la pointe en termes d’accouchement
Danielle Hassoun : Oui parce que c’était une maternité où l’on se disait que le bien-être des femmes était important. Beaucoup de gens qui y travaillaient étaient féministes Il s’y pratiquait déjà des avortements avant la loi Veil. Mais moi, je n’y étais pas encore à cette époque. J’étais encore interne. Sur la question des avortements illégaux, nous pouvions pousser les délais à 20-22 semaines Je précise que le ministère de la Santé était parfaitement au courant. J’avais fait deux voyages en Hollande, un en Angleterre pour me former. Là-bas, les avortements étaient autorisés jusqu’à 24 semaines
Jacqueline Valensi : Pour ma part, quand je me suis installée en cabinet de médecine générale, la loi n’était pas encore passée. Je me suis sentie lâche par
rapport au manifeste des 343. Les médecins pratiquant des avortements clandestins risquaient gros : des peines de prison, une interdiction d’exercer Nous n’avions même pas le droit de donner des adresses à l’étranger. Même si c’était moins dangereux au début des années 1970, du fait du débat très présent dans la société autour de l’avortement, je craignais trop de braver la loi.
« Le Manifeste des 343 »

Un appel de 343 femmes
Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiqué sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement libre.
La célèbre pétition signée par 343 femmes, dont Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Delphine Seyrig et Gisèle Halimi, parue le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur
A l’époque, Simone de Beauvoir publie les chiffres de 800 000 avortements clandestins par an en France, et de 5 000 femmes mortes des suites de complications.
CTC : Vous dites que le débat était très présent…
Danielle Hassoun : Ah oui ! Nous sommes descendues dans la rue je ne sais combien de fois. Page 11
Jacqueline Valensi : Oui. La solidarité féminine a aussi fait que je n’ai jamais abandonné mes patientes. Je les envoyais en Hollande pour celles qui avaient les moyens. Les femmes se faisaient aussi avorter en Angleterre. De manière générale, les adresses couraient entre copines, c’était un vrai réseau. Pour les plus précaires cependant, en France, il y avait deux types de médecins qui pratiquaient les avortements clandestins : d’une part, les militants qui le faisaient pour presque rien et d’autre part, des beaux salauds qui s’arrangeaient pour que les femmes soient mal dans leur peau, qui pouvaient demander jusqu’à 4000 francs de l’époque. Moi, je connaissais un copain médecin qui était militant et pratiquait des avortements gratuitement.
Danielle Hassoun : Parmi les médecins militants, il n’y avait quasiment que des hommes. Il faut dire que n’étions que 30% de femmes médecins.
Au départ militante d’extrême-gauche – nobody is perfect – j’ai ensuite rejoint des groupes féministes, dits des groupes de conscience au sein desquels il n’y avait que des femmes et où nous racontions nos histoires personnelles
Il existait aussi des groupes qui, même après la loi de 1975, continuaient de pratiquer des avortements illégaux. Il faut savoir que l’accès à l’avortement n’était toujours pas facile.
La plupart des gynécologues obstétriciens, plutôt réactionnaires, se sont opposés à créer des centres d’IVG dans les services de gynécologie. Ce sont les médecins généralistes, plus progressistes, qui ont ouvert les premiers centres d’IVG.
CTC : Lors de vos études de médecine, avant 1975 donc, vous est-il arrivé de voir arriver à l’hôpital des femmes qui s’étaient fait avorter clandestinement ?
Danielle Hassoun : Oui, j’ai le souvenir d’une jeune fille en particulier, quand j’étais externe à l’hôpital Bichat. Elle a fini en réanimation, à la suite d’une septicémie à perfringens, une complication de manœuvres abortives.
Je m’en souviens car le chef de service de l’époque avait été relativement gentil avec elle.
CTC : Justement, avez-vous été témoin de violence gynécologique, de la part de médecins, sur des patientes qui s’étaient fait avorter clandestinement ?
Jacqueline Valensi : J’en ai vu quand j’étais externe en chirurgie, à l’hôpital Cochin. Les chambres étaient de grandes pièces pour 50 personnes. Exprès, le chef de service faisait un toucher vaginal à ses patientes, à la vue de tous.
Je me rappelle aussi les internes grattant exprès à la curette jusqu’à ce que l’on entende « le cri de l’utérus », c’est-à-dire qu’ils foutaient en l’air la muqueuse utérine, ce qui causait la stérilité. Le tout sans anesthésie, en insultant les patientes
CTC : Le jour où la loi Veil est passé, le 17 janvier 1975, a donc été marqué d’une pierre blanche…
Danielle Hassoun : Ah oui, on a fait la fête ! Les manifestations féministes étaient très joyeuses car nous avions le sentiment d’avancer ensemble, pour nous Il faut cependant savoir que les mouvements Birth control ont commencé à partir des années 1930, surtout dans les pays anglosaxons et qu’ils étaient focalisés sur la santé des femmes. Ils ont gagné la France dans les années 1950
En 1956, s’est créé le mouvement « La maternité heureuse » qui s’est transformé, en 1962, en « Mouvement français du planning familial » qui existe toujours Les revendications pour la santé des femmes étaient, au départ, un sujet de santé publique sur lesquelles s’est greffé un discours politique et féministe.
CTC : En France, comment s’inscrit le procès de Bobigny en 1972 dans la lutte pour la dépénalisation de l’avortement ?
Danielle Hassoun : Bobigny a été le point charnière mais c’était aussi la fin de l’histoire. Madame Halimi a montré que la loi était obsolète, qu’elle ne correspondait plus à la réalité sociale et que l’opinion publique avait avancé. 66% des Français étaient pour la légalisation de l’avortement. En 1975, Mme Veil a aussi été extrêmement intelligente car elle a demandé à tous les courants politiques leur opinion sur le sujet.
Nous, militants, trouvions la loi Veil trop restrictive. Néanmoins, ce qui était formidable était qu’elle permettait l’avortement sur demande des femmes, c’est-àdire que le médecin n’a pas son mot à dire sur la décision à prendre. Les points négatifs étaient d’une part, le délai de 12 semaines d’aménorrhée, trop court [Ndlr : le délai est de 16 semaines depuis mars 2022] et d’autre part, l’obligation pour une jeune fille mineure d’avoir l’autorisation de ses parents pour avorter [Ndlr : l’autorisation des parents n’est, de nos jours, plus requise]. Ce qui était une catastrophe. Il y avait aussi obligation d’avoir un entretien social qui, théoriquement, ne devait pas être dissuasif. Sauf que ça pouvait l’être. Et le dernier point, les huit jours de réflexion entre la demande et l’acte. Depuis, tout ceci a sauté.
CTC : Quels ont été les effets, sur le terrain, des modifications successives de la loi ?
Danielle Hassoun : Entre 1975 et 2001, quel que soit la couleur du gouvernement, nous avons toujours eu une écoute favorable sur la question de l’avortement En 1992, le gouvernement a obligé tous les hôpitaux à ouvrir un centre d’IVG. Petit à petit, l’accès a été facilité. Actuellement, nous ne sommes pas en danger. Néanmoins, la démographie est l’élément essentiel de l’histoire de l’avortement.
Le procès de Bobigny
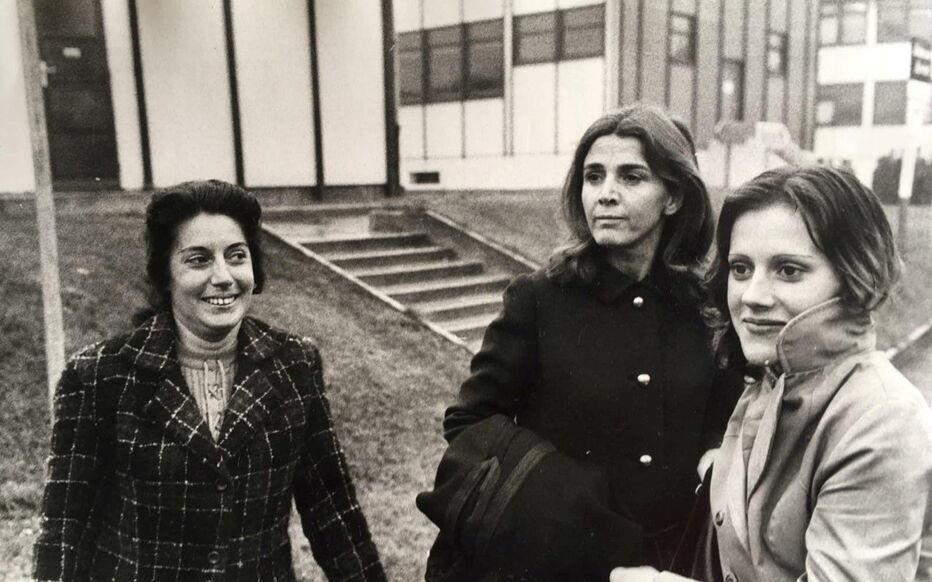
Ici en 1972, Marie-Claire Chevalier, 17 ans (à droite), Me Gisèle Halimi (au centre) et Michèle (à gauche), la mère de l'adolescente, pendant le procès de Bobigny. DR Une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, avait avorté à la suite d’un viol. Sa mère, Michèle Chevalier, l'avait aidée dans sa démarche. Dénoncée par l'auteur même de ce viol, la jeune Marie-Claire est inculpée, tout comme sa mère et deux de ses collègues, pour complicité, Une quatrième est inculpée pour avoir effectué l'acte illégal. Octobre 1972. L'avocate Gisèle Halimi prend le pari avec l’accord de ses clientes de transformer ce « fait divers » en véritable procès politique. Après une plaidoirie historique, Marie-Claire est relaxée, Michèle Chevalier est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Ses deux collègues sont relaxées. La quatrième prévenue est condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir pratiqué l'avortement.
Extraits de la plaidoirie de Gisèle Halimi
[…] Nous n’avons pas le droit de disposer de nous-mêmes.
S’il reste encore au monde un serf, c’est la femme, c’est la serve, puisqu’elle comparaît devant vous, Messieurs, quand elle n’a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous. N’est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression ? Pardonnezmoi, Messieurs, mais j’ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes… Et pour parler de quoi ? De sondes, d’utérus, de ventres, de grossesses, et d’avortements !...[…]
Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ?... Cela est démentiel ! […]
L’acte de procréation est l’acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi, Messieurs, personne n’a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire.
Ce fut le cas avec la loi de 1920 condamnant sévèrement l’avortement, après les pertes de la guerre 14-18. La démographie française étant en baisse à l’heure actuelle, inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution serait un plus symbolique. [Ndlr : L’entretien a eu lieu avant le 4 mars 2024, date à laquelle la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse.]
CTC : Quelle définition donnez-vous de l’IVG ?
Danielle Hassoun : C’est le fait de ne pas vouloir une grossesse. Je ne dis pas un enfant mais bien une grossesse, à ce moment précis de votre vie. Mon idée est qu’il n’y a que la femme qui peut décider. C’est son corps, c’est son utérus. A partir de là, ça lui appartient.
CTC : Comment a évolué la société par rapport à l’avortement ?
Danielle Hassoun : L’avortement reste un tabou. Je ne pense pas qu’on se vante de ses avortements. En général, les femmes ont honte « d’avoir merdé », dans un pays où la contraception est légale, où elle est remboursée par la Sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’autres pays
C’est une espèce de dévalorisation de soi Or – et c’est très important – ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on ne contrôle pas tout dans la vie. Les erreurs ne sont pas automatiquement des fautes. Il est important de déculpabiliser les patientes. Parmi les grossesses non prévues, un avortement est demandé dans la majorité des cas Seul un tiers des grossesses non prévues sont gardées.
A ce sujet, les chiffres sont intéressants… Il y a environ 220 000 avortements par an en France et c’est un chiffre qui ne bouge pas depuis 30 ans. Qu’est-ce que ça nous dit ? Et bien que l’on ne peut pas avoir une maîtrise totale de la fertilité. On ne supprimera pas l’avortement. Il fait partie de la vie des femmes. Essayez d’interdire son accès, comme en Pologne ou en Hongrie… Vous n’aurez pas plus de naissances. Vous aurez juste plus d’avortements clandestins.
12
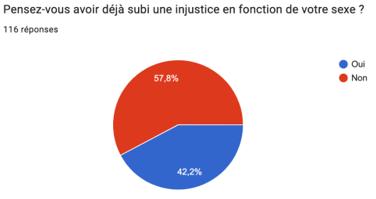
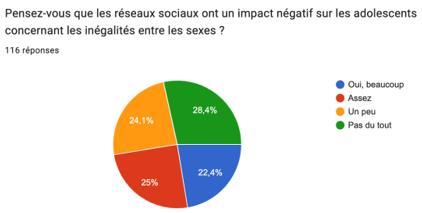


Résultats du sondage « Les inégalités entre les sexes vues par les lycéens » », réalisé au sein du lycée EIB Etoile, dans le cadre du club développement durable, basé sur un échantillon de 116 élèves
Sophia Angeloglou & Romane Kalfa – Tale1 et Tale 4
inégalités entre les sexes, vues par
Inégalités dans le milieu scolaire garçons-filles, impact des réseaux sociaux… Le club développement durable a sondé les élèves de l’EIB Etoile sur la question. Voici les résultats.
Comment les adolescents de notre génération sont confrontés aux discriminations en fonction du genre ? Afin de se rendre compte des inégalités entre les sexes dans le quotidien des élèves du lycée EIB Étoile, nous avons réalisé un sondage, dont les résultats obtenus nous ont permis d’avoir une meilleure idée de la place des inégalités au sein du lycée mais également dans un contexte plus général
Les filles sont littéraires, les garçons sont matheux
Dès l’enfance, certains traits de caractères sont plus associés aux garçons, comme le fait de s’imposer, et certaines caractéristiques sont davantage considérées comme féminines, par exemple le fait de se restreindre. Du fait de cette socialisation genrée, les filles vont généralement être beaucoup moins à l’aise pour s'exprimer etprendre la parole que lesgarçons. En effet, on peutsouventremarquer lors d’un cours que lorsque la fille attend patiemment son tour en levant la main, legarçonvaprendrelaparoledemanièreplusspontanée.Cettesocialisationgenrée associe également des filières aux garçons et des filières aux filles, ce qui peut décourager les filles à suivre certaines filières scientifiques.
D’après le sondage effectué au sein du lycée, “les spécialités littéraires sont quand même majoritairement féminines tandis que les spécialités scientifiques paraissent tout de même plus masculines”, et plusieurs filles ont affirmé qu’elles ne se sentaient pas capables de poursuivre des matières scientifiques à cause d’un manque de confiance en elles. Les spécialités comme NSI (Numérique et Sciences Informatiques) ou Physique-Chimie sont beaucoup plus choisies par les garçons alors que les filles suivent des cours plus littéraires comme HLP (Humanités, Littérature et Philosophie).
Cela mèneà la faible présence de femmes dans les études supérieures scientifiques. En effet, d’après le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les femmes constituent seulement 29% des formations d’ingénieur. En 2021, 7 étudiants dans les filières langues, lettres et sciences humaines sur 10 étaient des femmes.
L’impact des réseaux sociaux sur les inégalités, un résultat mitigé
D’aprèslesondage,seulement28,4%desélèvesinterrogéspensentquelesréseaux sociaux n’ont pas du tout d’impact négatif sur les adolescents concernant les inégalités des sexes. Parmi elles, le sexisme est surabondant sur ces plateformes qui sont au cœur de la formation des avis des plus jeunes générations. En effet, les agressions en ligne sont hautement dirigées vers les femmes : d’après une enquête nationale en 2022, 84% des victimes de cyber violences étaient des femmes. 74% des personnes à la source de ces agressions étaient des hommes
Ces violences peuvent prendre plusieurs formes : publications de propos ou d’images sexistes par exemple, pouvant évoluer au point de cyberharcèlement en cas de répétition. A savoir : 92% des contenus sexistes signalés n’ont pas été supprimés par les plateformes
De plus, les réseaux sociaux étant une instance de socialisation principale pour les adolescents, une socialisation genrée peut y être véhiculé, de par la diffusion d’influenceurs instituant certains idéaux, comme l’indique le témoignage suivant : « Je pense que les réseaux montrent des images faussées des genres, notamment avec une sexualisation croissante du corps de la femme ou, à l’inverse, la nécessité d’être fort lorsqu’on est un homme ».
L’égalité entre les sexes, un objectif du développement durable
Un des piliers des objectifs du développement durable concerne l’égalité entre les sexes. Selon l’ONU, « l’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable ». Or, dans le cas de la France, les adolescents sont fortement concernés par les inégalités entre les sexes. Plus d’un élève sur deux, d’après le sondage, ressent que le traitement par les autres élèves diffère selon le sexe. Page 13
Lili-Mei Lacascade-Mignerot – 1ère3
Selon l’Insee, le nombre des pères au foyer est de 1,5 % quand 65% des hommes seraient prêts à le devenir. Père au foyer pendant cinq ans, Jean-Philippe Mignerot nous raconte son expérience.
Casse Ton Cliché (CTC) : Depuis quand êtes-vous père au foyer ?
Jean-Philippe Mignerot : Durant notre expatriation en Chine et en Angleterre, entre 2012 et 2017, j'ai effectivement réduit mon activité pour me concentrer sur l'éducation de mes filles. J'ai donc pu expérimenter le rôle de père au foyer et la vision que le monde avait de celui-ci. Cependant, je ne me qualifierais pas exactement en ces termes… Je suis plutôt un père en charge du quotidien. Tout simplement.
CTC : Quelles raisons ont motivé ce choix ?
Jean-Philippe Mignerot : L'accompagnement de mon épouse dans sa carrière professionnelle et la nécessité de la présence d'un des deux parents dans le foyer au quotidien.
CTC : Le fait que votre femme subvienne aux besoins financiers du foyer, cela a-t-il été un problème ?
Jean-Philippe Mignerot : Cela n'a jamais été le cas pour nous. Je gérais mes entreprises avec plus de tempérance, ce qui m'octroyait le temps nécessaire de présence dans le foyer et ses activités connexes.
CTC : Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti
seul, dans un rôle qui "normalement" incombe à la femme ?
Jean-Philippe Mignerot : Je n'ai jamais déterminé un rôle spécifique à la femme ou à l'homme. Notre quotidien, notre couple, nos enfants et notre foyer se sont bâtis dans le temps avec ses propres besoins et nécessités du moment. Je ne me suis jamais senti seul, mais plutôt comme sur un bateau. Chacun tient son bord pour faire face à la vie du foyer ensemble, peu importe sa présence physique au sein du foyer. Néanmoins, je suis père avec deux filles et cela doit être le cas aussi pour une mère avec des fils. Les vestiaires de la piscine, le choix ou l'accès aux toilettes pour les accompagner n’est pas simple. La solution : les toilettes PMR pour se changer.
CTC : Être un père en charge du quotidien est-il un choix de vie que vous avez regretté ?
Jean-Philippe Mignerot : Jamais ! J'aurais peut-être pu évoluer plus rapidement professionnellement parlant mais les moments merveilleux de partage, d'éducation et de découverte qui ont faits grandir mes enfants, je ne les échangerais pour rien au monde.
CTC : Lorsque vous emmeniez vos enfants à l’école, avez-vous fréquemment rencontré d'autres pères ?

Alrick Servais – 1ère4
La charge mentale, ou le chaos-tidien
Jonglant entre vie pro et vie perso, les femmes se retrouvent souvent confrontées à une réalité invisible mais écrasante : la charge mentale. Focus sur ce fardeau qui pèse lourdement sur le quotidien et l’équilibre personnel
Entre la gestion des tâches domestiques, des enfants, et des obligations professionnelles, les femmes doivent constamment jongler avec une multitude de pensées et de décisions. Près de 70% des femmes actives ressentent en effet ce que l’on nomme une charge mentale, liée à leur double rôle de travailleuse et de gestionnaire de foyer. Cette pression constante peut entraîner un stress chronique, une fatigue, voire des troubles de santé mentale, tels que l'anxiété ou la dépression. Les hommes ne sont pas non plus épargnés par le phénomène (50 %).
Cette tendance met en lumière l’importance de sensibiliser à la question de manière inclusive, en reconnaissantque la chargementale ne connaîtpasde genre. Face à cette réalité, des initiatives émergent pour alléger le fardeau au travail. Des politiques d'entreprise favorisant la flexibilité et la conciliation travail-vie personnelle sont de plus en plus adoptées. De même, la sensibilisation à l'importance du partage équitable des responsabilités domestiques et familiales gagne du terrain, encourageant ainsi une redistribution des tâches au sein du foyer.
Page 14
Jean-Philippe Mignerot : Rarement. Le plus souvent, c'est lors du passage exceptionnel du père parce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour le foyer.
CTC : Quels sont les avantages et les inconvénients d'être un père, plutôt qu'une mère au foyer ?
Jean-Philippe Mignerot : Je ne saurais vous répondre. Nousavonstousdesqualitésdifférentes.Selonmoi,être une femme ou un homme ne détermine pas d'avoir des prédispositions à la gestion d'un foyer. Le foyer est une entreprise comme une autre, une organisation sociale différente pour chaque individu.
CTC : Pensez-vous que la société contemporaine reconnaît davantage le statut de père au foyer sans stigmatisation ?
Jean-Philippe Mignerot : J'avoue n'en avoir aucune idée, si ce n'est au travers des films que l'on peut voir et qui valorisent ce rôle de père 2.0 multitâches. Beaucoup trop de questions, de stigmatisation et pas assez d'être. Mais pour moi, un foyer, c'est avant tout une maman et un papa qui s'aiment.
CTC : Un cliché sur le père au foyer à déconstruire ?
Jean-Philippe Mignerot : Un mâle endormi ou trop éveillé face à l'évolution nécessaire de la société.
Homme-femme : les chiffres clés
Unevued’ensemblechiffréedeshommesetdes femmes dans la société française
D’après les chiffres de l’Insee, en 2020, les femmes représentaient 51,7 % de la population en France.
Les hommes deviennent largement minoritaires aux âges avancés : ils représentent seulement 43,1 % de la population des65 ans ou plus et38,9 %des 75 ansou plus
Début2020, 18 300 femmesétaientcentenaires, contre seulement 3 600 hommes.
L’âge médian au premier emploi est de 20 ans pour les femmes et de 19 ans et demi pour les hommes.
50% des femmes ont connu une première relation amoureuse importante avant 18 ans et demi, contre 20 ans pour les hommes.
16 % des femmes et 24 % des hommes n’ont pas eu d’enfant à 40 ans.
Sur 2millions de familles monoparentales,1,6million ont à leur tête une femme.
52 % des hommes sans enfant sont à nouveau en couple au bout de six ans (50 % pour les pères), contre 36 % des femmes (30 % pour les mères).
8 salariés sur 10 exercent un métier non-mixte
En2022,leshommesgagnaientenmoyenne14,1%de plus que les femmes
Une femme est 2 fois plus exposée au sous-emploi qu’un homme dans la fonction publique.
La pension de retraite moyenne s’élève à 1178 euros pour les femmes contre 1951 euros pour les hommes. 38,5 % des femmes ont été victimes au moins une fois de comportement sexiste ou sexuels au cours de leur vie professionnelle contre 14% des hommes.
Les personnes mises en cause pour des violences sexuelles sont à 97% des hommes.
Les femmes réussissent mieux au diplôme du baccalauréat (93,0 %) que les hommes (88,8 %).
1 femme sur 10 serait concernée par l'endométriose

Emma Kermiche – Tale6
Etymologiquement, le maïeuticien, nom équivalent de sage-femme au masculin, désigne la personne qui « a la connaissance de la femme ». Cyrille Catalan exerce cette profession depuis 30 ans. Il nous raconte son métier.
Casse Ton Cliché : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Cyrille Catalan : C’est un peu compliqué. Cela remonte à très longtemps. J’ai découvert le métier de sage-femme à l’occasion de la naissance de ma première fille. Je me suis dit que ce serait bien de faire de la médecine, en ayant affaire à des gens en bonne santé. C’estendevenantpère que ma vocation s’est dévoilée.Avant, je faisais des études qui n’avaient rien à voir avec la médecine.
CTC : Avoir affaire à un homme sage-femme, est-ce naturel pour les patients ?
Cyrille Catalan : Cela dépend beaucoup. Si l’on omet l’aspect religieux, il n’y a pas de problème d’être sage-femme homme ou sage-femme femme, au même titre que le rapport des médecins hommes et femmes, avec leurs patients. Si, aujourd’hui, la proportion des gynécologues hommes et femmes est en train de s’inverser (Ndlr : D’après les chiffres de 2022, 58% des gynécologuesobstétriciens sont des femmes), ce ne fut pas toujours le cas. Les femmes ne sont donc pas très étonnées d’être prises en charge par des hommes.
CTC : Les patientes ne sont donc en général pas gênées d’avoir affaire à un homme plutôt qu’à une femme ?
Cyrille Catalan : Non. On peut être confronté à un non catégorique d’emblée mais pour la plupart, il n’y a pas de gêne. Dans le cas où les patientes refusent, la question religieuse est souvent au centre. Mais quand elles viennent en couple, c’est d’avantage le mari qui s’exprime que la femme.
CTC : Vous est-il arrivé d’essayer de les faire changer d’avis ?
Cyrille Catalan : Quand ce sont des questions religieuses, c’est très difficile de les faire changer d’avis parce que, surtout si le mari est là, nous exerçons un métier au sein duquel il est très important d’avoir un échange en confiance. A partir du moment où la confiance ne peut pas s’établir, où l’on me rejette en quelque sorte, je préfère passer la main à quelqu'un d’autre.
CTC : Au cours de votre carrière, le fait d’être maïeuticien vous a-t-il valu des remarques désobligeantes de la part des patientes ou encore de vos collègues ?
Cyrille Catalan : Plus maintenant J’ai néanmoins fait partie des premiers à faire ce métier et cela a suscité beaucoup de curiosité, voire un peu de malveillance parfois. Mais bon, je pense que j’ai vécu la même chose que les femmes qui, à l’inverse, allaient faire des études pour rentrer chez les pompiers ou dans les métiers militaires. Globalement, j’ai tout de même connu plus de bienveillance
CTC : Exercez-vous votre métier d’une manière différente par rapport à une femme sage-femme ? Le genre importe-t-il ?
Cyrille Catalan : Dansvotrequestion,deuxchosessontimportantes.Toutd’abord,
oui, le genre importe, de plus en plus d’ailleurs, depuis quelques années car nous sommes soumis à des pressions législatives. Des patientes ont porté plainte contre des sage-femmes hommes pour viol parce qu’elles avaient été examinées sans consentement. Du coup, moi, en tant qu’homme, je passe un contrat de confiance avec la patiente Je ne fais aucun acte sans luien avoir parlé au préalable etluiavoir demander l’autorisation de le faire. Ce n’est pas toujours le cas pour mes collègues femmes qui n’ont pas cette question du genre à prendre en compte
CTC : Votre démarche vous sert donc à vous protéger face à de potentiels accusation d’agression sexuelle ?
Cyrille Catalan : Oui mais d’abord et surtout par conviction. J’estime qu’on ne peut pas faire quelque chose à quelqu’un sans lui en parler et sans lui dire ce qu’on va faire. Même dans l'extrême urgence, et cela nous arrive souvent, il faut que les gens comprennent ce qui leur arrive afin de faire des choix en toute conscience. Si on leur dit « on va faire ça » mais qu’on ne leur explique pas, on les prive de leur libre arbitre. Sinon, ce n’est plus de la médecine, c’est du vétérinaire.
CTC : Quelles qualités faut-il posséder pour être un bon sage-femme ?
Cyrille Catalan : A partir du moment où l’on exerce un métier de soins, l’on se doit été dans l’empathie Encore plus quand il s’agit d’accouchements. Le rôle du ou de la sage-femme est d’aider une mère à donner la vie à son enfant. Nous ne sommes là que pour les aider, nous ne pouvons pas faire les choses à leur place.
CTC : Quid de la délicatesse, largement perçue comme un attribut féminin ?
Cyrille Catalan : Sur ce sujet, beaucoup de patientes m’ont dit qu’ils trouvaient les hommes plus doux, moins brusques que les femmes, justement. Mais je ne suis pas sûr que la délicatesse puisse être genrée. Attention aux amalgames.
CTC : Dans ce métier, qu’est-ce qui constitue le plus beau et le pire moment à vivre ?
Cyrille Catalan : Le plus beau, c’est que les jours se suivent et ne ressemblent pas On n’aide jamais à mettre au monde le même enfant Chaque patiente amène une nouveauté, une nouvelle expérience. Mais ce qui est vraiment le plus beau, c’est la rencontre d’une mère avec son enfant et avec le deuxième parent
Le pire, c’est la mort inopinée d’un enfant au moment de l’accouchement. Et je pense qu’être un homme ou une femme ne change pas grand-chose ici. On appréhende tous ces moments difficiles.
CTC : Un cliché que vous aimeriez casser sur votre métier ?
Cyrille Catalan : Oui. Les hommes sage-femmes ne sont pas tous homosexuels C’est la première chose que mon père m’a demandé quand je lui ai dit que j’allais devenir sage-femme
Page 15
Charlie-Rose Amico-Gas – 2de1
Fabien Joly, président de l’ADFH, nous raconte son expérience de père. une femme accepte de porter, pour une personne célibataire ou pour un couple, un enfant auquel elle n’est pas liée biologiquement. Le coût est variable selon les pays dans lesquels cette pratique est autorisée. Ils peuvent varier de 70 000 USD au Mexique à 250 000 USD aux Etats-Unis. La GPA est une technique relativement onéreuse qui se révèle être la seule disponible pour les couples d’hommes et pour les femmes, célibataire ou en couple, qui ne peuvent pas porter d’enfant.

Casse Ton Cliché (CTC) : Pour avoir des enfants, vous avez dû avoir recours à la gestation pour autrui (GPA). Cela a-t-il été un parcours du combattant ?
Fabien Joly : Le souhait d’avoir un enfant est apparu telle une évidence après la rencontre avec celui qui deviendrait mon époux. Il a été un souhait réfléchi, pensé et construit et s’est révélé, in fine pas si difficile à concrétiser, que ce soit aux Etats-Unis ou en France.
CTC : A quelles difficultés avez-vous dû faire face ?
Fabien Joly : En réalité, nous ne nous sommes heurtés à aucune difficulté, ni pour l’obtention du passeport français/CNI, ni pour l’assurance maladie, ni pour la reconnaissance de la double filiation paternelle de notre fille. Le seul point compliqué a été de faire reconnaître, par l’employeur de mon époux, que ce dernier avait droit à tous les avantages auxquels peuvent prétendre les pères.
CTC : Qu'est-ce que la GPA ?
Fabien Joly : La GPA, gestation pour autrui, est un mode de conception d’un enfant dans le cadre duquel
CTC : Quels sont, en France, les autres alternatives pour avoir un enfant, pour un couple homosexuel ?
Fabien Joly : En France, la seule voie légalement envisageableestl’adoption.Maiscettevoieestlongue et peu concluante, en raison du faible nombre d’enfants adoptables en France. Quant à l’adoption à l’étranger, elle est devenue pratiquement impossible pour les hommes seuls ou en couple avec un autre homme.
CTC : Où en est la France, selon vous, par rapport à la parentalité des couples homosexuels ?
Fabien Joly : Aujourd’hui plus personne ne pense à remettre en cause la loi de 2013 ayant ouvert le mariage aux couples de même sexe. C’est cette loi qui fut fondatrice, en droit français, de la famille homoparentale, puisqu’elle a autorisé l’adoption des enfants au sein des couples de même sexe mariés. Même s’il demeure des voix discordantes, la remise en cause de cette loi ou de l’adoption par les couples de même sexe, mariés ou non, ne constituent plus des thèmes politiques.
CTC : Avez-vous subi, avec votre famille, des discriminations à cet égard ?
Fabien Joly : Mon époux, ma fille et moi-même
n’avons jamais été victimes de discriminations. Au contraire, toutes les structures (crèches, écoles, etc.) ont fait en sorte que la famille de ma fille, qui a aujourd’hui 8 ans, ne soit pas une question pour les autres membres de la collectivité. Je précise que nous habitions en plein cœur de Paris, que notre fille a été scolariséedansdesétablissementsprivésbilingues,de sorte que son exemple n’est peut-être pas le plus représentatif.
Toutefois, elle a clairement assimilé le fait que sa famille était différente des autres et que cette différence ne devaitpour autantnullementfaire débat.
Ce que dit la loi
La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France. La loi sur la bioéthique de 2021 n’a pas remis en cause cette interdiction.
La loi du 2 août 2021 relative à la transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est limitée au seul parent biologique (le parent d'intention devant passer par une procédure d'adoption)
En décembre 2022, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement visant à harmoniser à l'échelle de l'Union les règles de droit international privé relatives à la filiation, au nom de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant.
Selon les termes de cette proposition, une filiation reconnue dans un État membre le serait aussi dans tous les autres États membres, sans procédure spéciale. Elle prévoit ainsi la création d'un « certificat européen de filiation »
Dans un entretien accordé au magazine Elle, le 8mai dernier, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué vouloir améliorer l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) mais s’est dit défavorable à la gestation pour autrui (GPA).

Bulle Cheyrouze – 2de5
Depuis quelques années, une tendance mode floute les frontières traditionnelles entre vêtements masculins et féminins.
Harry Styles, Timothée Chalamet… Chanteur pour l’un, acteur pour l’autre, ces stars sontaussiconnuespourredéfinir les frontières de lamasculinité, à travers leur façon de s’habiller. Pionniers du no gender, ils ont contribué à mettre à la mode cette nouvelle ère vestimentaire aspirant à s’affranchir des stéréotypes de genre Ce mouvement ne se limite plus aux seules icônes de la pop et du cinéma. De plus en plus de personnes « ordinaires » adoptent cette approche libératrice de la mode. Les magasins s'adaptent également, offrant des collections unisexe ou gender fluid qui suppriment les étiquettes. Marginal ou mainstream ? La mode no gender transcende en tout cas les stéréotypes, dans la mesure où elle ne cherchepas à dissimuler les différencesentre les genres, mais à célébrer la diversité. C'est une déclaration de liberté, où chacun est encouragé à s'habiller comme il ou elle le souhaite Pour Harry Styles, portant une robe sur scène, ou pour Timothée Chalamet, mélangeant habilementdes pièces considérées comme féminines et masculines, la mode devient un terrain d’expres-
sion artistique et de revendication Si, à ses débuts, la mode no gender était perçue comme marginale, elle gagne aujourd'hui du terrain. Des marques renommées intègrent ces principes dans leurs lignes, et les jeunes générations, plus enclines à rejeter les normes, l'adoptent avec enthousiasme. Cependant, malgré cette expansion, des défis persistent. Certains secteurs restent conservateurs, et les préjugés restent très présents autant dans le monde de la mode, que dans la société. Mais chaque pas vers une mode plus inclusive est une victoire.
En définitive, la mode no gender n'est pas simplement une question de vêtements. C'est un mouvement socioculturel qui redéfinit la façon dont les individus perçoivent et expriment le genre. C'est l'acceptation que les frontières entre le masculin et le féminin sont fluides, changeantes, et parfois même inexistantes.
C'est un appel à la liberté individuelle et à la diversité, où les vêtements deviennent un moyen d'affirmer son identité, au-delà des catégories préétablies. Cependant, toute mode est marquée par la tendance. Reste à savoir si celle-ci durera.
Page 16

François-Xavier Martin, professeur de Sciences Economiques et Sociales à l’EIB, nous éclaire sur la place des femmes dans le monde du travail.
Casse Ton Cliché : De nos jours, quelle est la place des femmes dans le monde du travail ?
François-Xavier (FX) Martin : Notons, pour commencer, que les femmes ont toujours (et beaucoup) travaillé, mais leur travail était de l'ordre du domestique, non valorisé et non rémunéré. Longtemps, les statistiques ont mal saisi l’activité féminine, particulièrement celle des femmes non salariées, considérées comme des auxiliaires de leur mari. Ce n’est qu’au début du XXe, avec notamment leur contribution à l’effort de guerre – je pense notamment aux « munitionnettes », ces femmes qui travaillaient à la chaîne dans les usines d’armement – que l’activité féminine progresse en bouleversant les rapports entre les hommes et les femmes dans la société.
En 50 ans, la participation des femmes sur le marché du travail a fortement augmenté, se rapprochant de celle des hommes : en 2020, plus de deux femmes âgées de 15 à 64 ans sur trois sont actives, contre trois quarts des hommes. Néanmoins, elles n’étaient que 41% dans ce cas en 1975 !
En revanche, la répartition des sexes selon les secteurs et les métiers reste très inégale. Parmi les actifs, les femmes sont notamment moins souvent cadres que les hommes (19 % contre 24 %), plus souvent employées que les hommes (75% des employés sont des femmes) et elles sont sur-représentées dans des secteurs peu rémunérateurs (commerce de détail, service à la personne, action sociale, travail administratif…).
CTC : De manière générale, les femmes sont minoritaires à la tête de l'entreprenariat. A quoi cela est-il dû ?
FX Martin : Le taux d’entreprenariat féminin en France est un des plus faibles de l’OCDE. En 2022, un entrepreneur sur trois est une femme, selon le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette proportion stagne depuis quelques années alors qu’elle augmentait progressivement depuis 30 ans.
En outre, ce taux diminue avec la taille de l’entreprise : si 32% de microentrepreneurs sont des femmes, il y a seulement 3% de femmes à la tête des entreprises du CAC40, selon Multinationale.org. Enfin, les secteurs de l’industrie de l’habillement et la fabrication de textile concentrent plus de trois quarts des entrepreneures en 2021, selon une étude publiée par Les Echos
Pour une femme, le premier obstacle à la création d’entreprise est un accès discriminatoireauxfinancements:lesbanquesonteneffetdeuxfoisplusdechance de refuser un prêt à une femme qu’à un homme, selon l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)
Ensuite,ilyal’inégalerépartitiondestâchesdomestiquesentrehommesetfemmes qui pèsent sur leurs engagements professionnels : 15 % des femmes mettent fin à leur entreprise à cause d’une évolution de leur situation personnelle et familiale, contre 8 % des hommes.
Enfin, les femmes s’auto-censurent, victimes du syndrome de l’imposteur, du fait d’une socialisation genrée qui donne peu le goût de la « gagne » aux petites filles. Finalement, elles rencontrentdonc des obstacles liés aux préjugés et stéréotypes de
genre véhiculés par la société.
CTC : L'idée selon laquelle les femmes travaillent gratuitement à partir de début novembre, qu'en est-il ?
FX Martin : Le calcul du site « Les Glorieuses » est symbolique, mais il dit beaucoup des inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. En effet, si l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 15,4%, selon Eurostat et qu’il y a 251 jours ouvrés en 2023, alors il y a bien 39 jours qui sont « non rémunérés ».
CTC : Concrètement, une femme coûte-elle plus chère à l’entreprise (congés maladies, maternité) ?
FX Martin : Les congés maternité sont un droit pour les femmes enceintes et sont essentiels pour la santé de la mère et du bébé. Bien géré par l’entreprise, le congé maternité est peu couteux et favorise la rétention des talents féminins.
Le salaire des femmes en congé maternité est pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale, si le salaire ne dépasse pas le plafond fixé 3 864 € par mois en 2024. Il n'y a donc pas un double salaire à payer de la part de l'employeur pour le même poste de travail, comme on l’entend trop souvent.
Cependant, les coûts indirects liés au genre sont plus complexes à évaluer. Le fait de moins rémunérer et« promotionner » les femmes – le fameux « plafond de verre ») – réduit les coûts salariaux de l’entreprise.
Mais d’un autre côté, la plus faible valorisation du travail féminin et la mauvaise adéquation des postes ont sans doute un effet négatif sur la productivité. Il a été montré dans les années 1990 que la discrimination raciale sur le marché du travail aux Etats-Unis, soit le fait d’embaucher quelqu’un plus selon sa couleur et non selon ses compétences, coûtait un point de croissance par an à l’économie américaine, soit des centaines de milliards de dollars !
CTC : De quels pays la France pourrait-elle s’inspirer pour être plus équitable dans la sphère professionnelle ?
FX Martin : La Norvège fait actuellement partie des pays qui respectent le plus l’égalité hommes-femmes dans le mondedutravailavecun congé parentalpartagé, des quotas d’hommes dans des secteurs traditionnellement féminins, des quotas de femmes de 40% dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, une valorisation égalitariste des sports, un service militaire obligatoire et mixte … mais ils ne sont que 6 millions, les consensus sont plus faciles à trouver que dans un grand pays latin !
CTC : Selon vous, quelle est la chose la plus urgente à changer pour plus d’égalité au travail en France ?
FX Martin : Il faut sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Augmenter leur imposition est facile à mettre en place et très incitative notamment pour les plus grandes entreprises. Page 17
Dans l’imaginaire collectif, les hommes et le shopping ne font pas bon ménage. Pourtant, la mode se vit aussi au masculin. Si un homme sur deux déclare ne pas aimer faire les magasins, 88 % estiment pourtant qu'il est important de se sentir bien habillé au quotidien.
Qui a dit que les hommes ne s’intéressaient pas à la mode ? Selon uneenquête réalisée par l'institutOpinea en 2019, ¾ des sondés affirmaient avoir acheté des vêtements au cours de l’année et consulter régulièrement sites, blogs et magazines de mode. Une tendance à l’achat confirmée par les ventes record d'habillement masculin au deuxième semestre 2022 (+11,3% par rapport à l’année précédente) Clientèle dotée d’un pouvoir d’achat supérieur à celui des femmes, la gent masculine est devenue une cible marketing privilégiée, autour de laquelle de nouvelles gammes de produits ne cessent de se développer des classiques comme les chaussures, les montres et les costumes ou des innovants, tels les soins cosmétiques, voire esthétiques L’un des derniers exemples en date
? Le brotox, contraction des mots brother et Botox, injectionsdetoxinebotuliqueayantdéjàcourschezles femmes.
S’adresser à une audience plus restreinte pour mieux cibler son public en termes de publicité, voilà le but du gender marketing. Exit les publicités aux stéréotypes « testostéronés » ! Place à la nuance des tons et à un style plus sobre et épuré, permis par l’évolution des mentalités. Les hommes prenant soin de leur apparence sont, en effet, de moins en moins perçus de façon péjorative dans la société. Malgré ces avancées, il existe des soins que les hommes ne s’achètent toujours pas. L’épilation et les séances de bronzage sont encore vues comme « moins conformes aux normes de masculinité ». Lesmodes de consommation

Rosanna Pergament – 1ère2
Le body positive, un marché d’imposture
En 2020, près de 25 % des Françaises s’habillaient en 46 et plus. Alors que de nombreuses marques se font les chantresde l’inclusivité à coupsdecampagnes marketing body positive, la réalité du marché est tout autre.
A la fin des années 90, le body positive émergeait comme un mouvement social et culturel visant à promouvoir l'acceptation de tous les types de corps, considérés comme imparfaits selon les normes sociétales, en mettant l'accent sur l'estime de soi et la valorisation de la diversité corporelle. Le fait d’inclure les femmes de différents poids et tailles incarnées par les mannequins plus size, Ashley Graham en tête, est aujourd’hui considéré comme un marché à part entière pour l’industrie de la mode.
En effet, en 2020, près de 25 % des Françaises s’habillaient en 46 - et plus - selon une étude menée par la marque de prêt-à-porter Kiabi. Depuis une vingtaine d’années, les campagnes publicitaires de dizaines de marques affichent un changement de stratégie commerciale à des fins plus inclusives. Dove, H&M, Etam, Nike, Misguided, Zalando… Toutes semblent promouvoir et capitaliser sur l’importance du body positive au détriment du culte de la minceur, à renforts de photos non retouchées, cellulite apparente et messages de self-love En réalité, peu de marques propose des vêtements au-
dessus de la taille 44 qui nécessite une adaptation du modèle mais aussi des coûts de production et de stockage plus importants. De même, sur les podiums automne-hiver 2023-2024, seuls 3,8 % de mannequins de taille médium ont défilé. Un chiffre qui chute à 0,6 % pour les plus size
Cette incohérence entre le discours et les actions conduit à une perception de body positive washing, les marques cherchant à se présenter comme progressistes sans réellement adapter leur offre aux besoins des consommatrices
Concernant le body positive en tant que tel, en 2019, dans un livre intitulé Chairissons-nous, la linguiste Stéphanie Pahud dénonçait l'absurdité d'un tel projet, plus clivant que solidaire et accordant trop d’importance au corps. « Le body positive laisse entendre qu'il existe un soi-même figé, définitif, à identifier et auquel adhérer. Or, nous nous inventons et nous réinventons sans cesse » La linguiste insistait aussi sur l’importance, « pour s'aimer, non pas de détruire les idéaux, mais l'emprise que les idéaux ont sur nous »
Page 18
sont néanmoins en constante évolution. Pour preuve, la communication actuelle des entreprises se dirige plutôt vers un message unisexe, les marques jouant sur la tendance du marketing non genré.

Consommatrices en chiffres
Une femme sur quatre confie qu'elle a du mal à boucler les fins de mois, contre seulement 15% des hommes
Le budget mode moyen des femmes s’élève à 118 euros par mois, selon les derniers chiffres. En 2022, 56% des femmes affirmaient avoir acheté moins de vêtements que d’habitude, contre 42% pour les hommes. Les raisons invoquées ? Les salaires qui n’ont pas suivi la même courbe que l’inflation et la différence de rémunération avec les hommes (15%). 78% des Françaises achètent leurs vêtements d’abord en fonction du prix, suivi de près par la qualité et la coupe (56%).
Les femmes possèderaient en moyenne 72 articles de mode dans leur dressing en France, mais n'en porteraient que les deux tiers.
Seulement 39% des consommatrices sont prêtes à payer plus cher pour un produit plus responsable.
Le poids de la mode d’occasion est estimé à plus de 6 milliards d’euros en2022 contre seulement1milliard en 2018. Au niveau mondial, le marché de la mode d’occasion est estimé à 177 milliards de dollars en 2022, et il devrait quasiment doubler à l’horizon 2027 pour atteindre 350 milliards de dollars.
Leboncoin est le deuxième site e-commerce le plus visité en France derrière Amazon, avec 6,6millions de visiteurs·euses français.es chaque jour
40 % des femmesplébiscitentle paiementen plusieurs fois
Les ventes en ligne ont progressé de 80% tandis que la fréquentation en magasin a baissé de 17%.

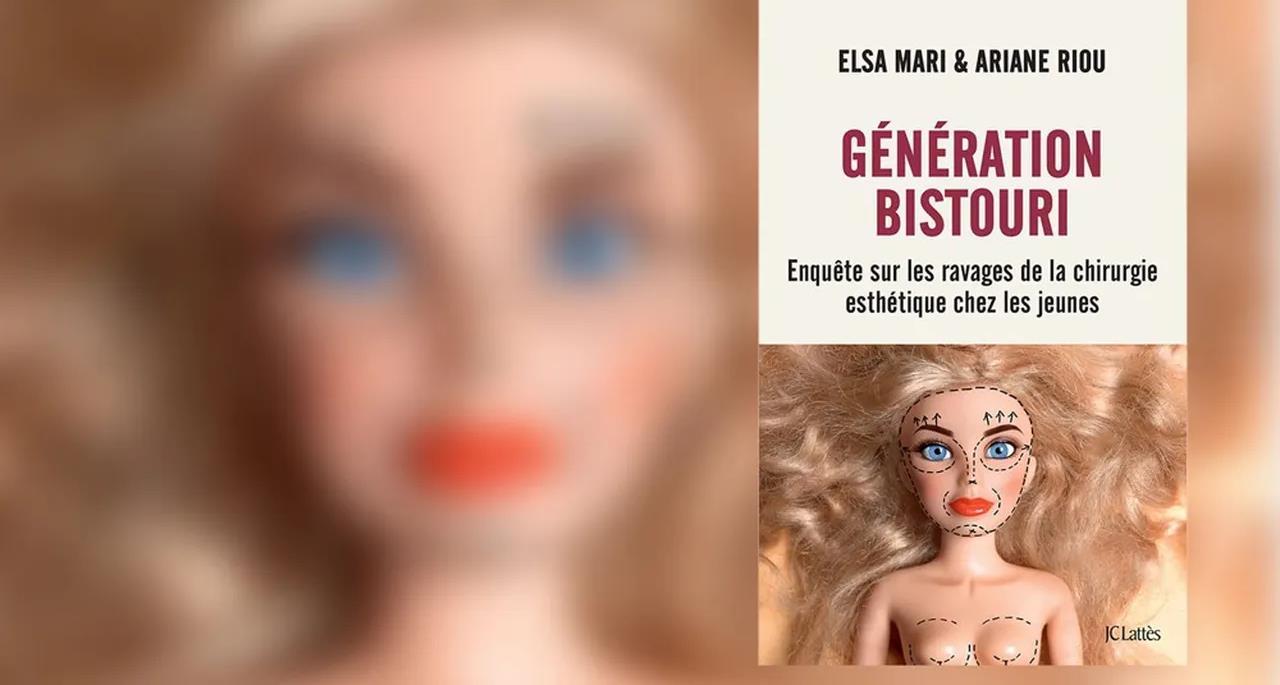
Depuis 2019, les 18-34 ans consomment plus d’actes esthétiques que les 50-60 ans. En juin dernier, Elsa Mari, journaliste au Parisien , co-autrice du livre Générationbistouri , était venue à l’EIB expliquer son enquête aux élèves de Culture Générale et alerter sur les dérives de la chirurgie esthétique chez les jeunes.
« De nos jours, la chirurgie esthétique à un peu réponse à tout chez les jeunes, face à la pression de l’apparence ». Exit la lutte contre les ravages du temps, place à l’effet de mode. Dans leur ouvrage Génération Bistouri. Enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes, paru en 2023 aux éditions JC Lattès, Ariane Riou et Elsa Mari, journalistes au Parisien, alertent sur ce phénomène devenu de société.
« Il y a tout un système qui donnent aujourd’hui aux jeunes l’envie de se modifier. On leur fait croire qu’ils ne sont pas comme ils devraient être et que la seule façon de se conformer à ce modèle va être de passer par le bistouri », expliquait Elsa Mari aux élèves de Culture Générale de l’EIB, lors d’une conférence en juin dernier Les chiffres, de fait, sont alarmants : 70% des rhinoplasties effectuées dans le monde concernent les 18-34 ans, suivi de près par les liposuccions et les augmentations mammaires. « Il y a deux catégories de personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique… Ceux qui ont un complexe physique profond et qui considèrent la chirurgie comme un besoin ; et ceux qui y cèdent par mode, évoquant une tentation, une envie ». Un attrait, dans ce cas, aux raisons multiples.
L’impact néfaste des réseaux sociaux
Pour Elsa Mari, la raison de la multiplication des actes chirurgicaux chez les 18-34 ans est claire : « L’expansion des réseaux sociaux et la place des influenceurs qui promeuvent et leurs interventions comme ils le feraient d’une séance de manucure ou d’un rendez-vous chez le coiffeur ». Vient ensuite l’usage des selfies avec filtres en tout genre. « Les filtres, et les canons de beauté qui les accompagnent, modifient la perception que les jeunes peuvent avoir d’eux-mêmes. Ils créent un complexe que ces derniers n’avaient pas forcément, induisant que pour être beau, la seule solution, c’est de se retoucher ».
De nombreux jeunes arrivent dans les cabinets d’esthétiques, leur smartphone en main, demandant au chirurgien de les faire ressembler à leur propre avatar. Depuis 2018, on parle de « dysmorphie Snapchat ». Des pratiques chirurgicales banalisées
Les journalistes dénoncent une banalisation des pratiques esthétiques, dont il est nécessaire de rappeler les risques sur la santé. Or, sur ce point, certains chirurgiens dévoilent une information tronquée.
Si les chiffres manquent pour la France, à l’échelle mondiale, la croissance de la chirurgie esthétique devrait être multipliée par 3 entre 2014 et 2025, passant de 5,7 à 17 milliards d'euros. A titre d’exemple, les injections de Botox coûtent entre 250 et 500 euros, à réitérer tous les six mois. Soit80 000 euros dans une vie
La santé physique et mentale des jeunes en danger
Avec le low-cost se pose la question des conséquences, sur le long terme, d’actes chirurgicaux non encadrés « La pose de facettes dentaires par exemple est très appréciée par cette génération sans patience. L’acte de poser des couronnes sur des dents saines est illégal en France, considéré comme de la mutilation. En Turquie ou en Tunisie, où l’intervention est quatre fois moins chère, elle est possible. Or, les jeunes ne savent souvent pas, qu’ils n’auront plus de dents à 50 ans ».
Autre grande question : La chirurgie esthétique devenant un phénomène de mode, comment faire quand la mode, devenue has been, est inscrite dans sa chair ? « Sur ce point, les chirurgiens esthétiques ne savent pas comment ces jeunes pourront revenir en arrière. Cette génération bistouri est aussi une génération cobaye ».
Liv Sisley – 2de5Dans un contexte où la lutte pour l’égalité des sexes est devenue un enjeu majeur de notre société, de nombreuses entreprises cherchent à s’associer au féminisme pour améliorer leur image de marque. des femmes ou la lutte contre le travail précaire.
Stratégie marketing de grande ampleur, le feminism washing consiste à exploiter les idéaux féministes à des fins purement mercantiles et commerciales, sans réel engagement envers la cause.
« I've got the power », « Girl Power », « The Future is Female »… Des campagnes publicitaires aux slogans accrocheurs, les entreprises n’hésitent pas à mettre en avant l’émancipation des femmes, la diversité ou l’autonomisation pour vendre leurs produits, tout en éloignant les consommateurs des réels problèmes auxquels les femmes font faces au quotidien. Or, promouvoir des femmes fortes et indépendantes pour vendre des rouges à lèvres sont autant de techniques d’empowerment qui ne servent
non seulement pas la cause mais dénature et banalise le propos, voir le combat.
Pire, en agissant ainsi, les secteurs de la mode et des cosmétiques fixent des normes de beauté irréalistes, favorisant une insécurité grandissante allant à l’encontre des principes mêmes du féminisme. Les exemples de feminism washing abondent dans le monde de la publicité et du divertissement. Le phénomène, malgré ses dérives, a apporté de la visibilité au mouvement
De plus en plus, les grandes enseignes plus scrupuleuses s’engagent et utilisent leur influence pour soutenir des causes importantes, telles que l'accès à l'éducation, l'autonomisation économique
Page 19
Si le lien entre féminisme et capitalisme est indéniable, il est essentiel de rester vigilant et critique face aux messages véhiculés, au même titre qu’il est impératif que les entreprises prennent conscience de leur responsabilitéenmatièred’égalitéetqu'ellesagissentde manière authentique, concrète et significative pour soutenir le véritable empowerment des femmes,bien audelà des discours et des symboles.

Stanislas Leclère – 1ère6
L’écoféminisme, quesaco ?
Quand féminisme et écologie font bon ménage…

« Les femmes se révoltent moins encore à cause du tort qu’on leur fait qu’à cause du tort qui est fait à la Nature ». Dans un livre publié en 1974, Le féminisme ou la mort, Françoise d’Eaubonne inventait le terme écoféminisme.
L’idée ? Associer dans une même lutte la dénonciation du patriarcat et celle du capitalisme, cause de désastres écologiques, abrité sous le même toit de la violence du système
Vite oublié en France, le mot resurgit aux États-Unis dans les années 1980 pour désigner toute une série de mouvement rassemblant des femmes autour de luttes écologistes très diverses : marches antimilitaristes et antinucléaires dont la plus célèbre est la Marche des Femmes sur le Pentagone en novembre 1980
communautés agricoles lesbiennes, mobilisations de riveraines contre la pollution des sols… Ces engagements de femmes dans des luttes écologiques se sont répandus un peu partout dans le monde, particulièrement dans les Suds, Inde, Afrique, Amérique du Sud en tête.
Les principaux fers de lance ? La déforestation, le climat et la justice environnementale. Plusieurs grandes figures sont emblématiques des différentes causes…
Wangari Maathai, « la femme qui plantait des arbres »

Une des principales exploitations de la Nature est la déforestation, dont une figure de l’écoféminisme surnommée « la femme qui plantait des arbres » s’y opposait fermement.
La professeure Wangari Maathai fonde en 1977 l’organisation Ceinture verte ou Green Belt Movement, avec l’aide du Conseil National des Femmes auKenya (NCWK),en réponse à la politique de déforestation du gouvernement Kenyan qui provoquait l’érosion des sols.
L’objectif de Ceinture Verte estde planter de millions d’arbres pour contrer les effets de la déforestation ; plus de 51 millions d’arbres ont été plantés depuis sa
fondation. Prix Nobel de la paix en 2004, la professeure Maathai, malheureusement morte en 2011, avait aussi à cœur d’éduquer les nouvelles générations car elle parcourait le monde pour partager et inciter des systèmes en faveur de l'environnement Vandana Shiva, « la gardienne de la Terre »

Directrice de la Fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles (Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy), elle a reçu le prix Nobel alternatif en 1993
Face à la dégradation de l’environnement et les différentes catastrophes liées au réchauffement climatique, elle exhorte chaque citoyen à s’engager, à participer à la vie publique et à prendre le pouvoir pour inverser la tendance et faire de la planète un espace vivable et respectueux de tous. En 2018, elle déclarait à la revueHorizonsPublics : « Pour inverser la tendance et créer un cercle vertueux, nous devons réaliser que cette planète, assure notre survie. La détruire n’est pas une option. Nous devons créer des économies basées sur la reconnaissance des biens communs et la capacité de chacun de réaliser un travail créatif, porteur de sens. »

Chevallet – 2de1
Zara, H&M, Shein et tant d’autres… Les marques de fastfashionpeuvent sortir jusqu’à 36 collections par an, contre 4 pour une marque de mode classique. Le but est simple : susciter l’achat de vêtements vite renouvelables et pas chers. Une pratique de consommation qui n’est pas sans conséquences pour la planète.
Les chiffres de la fast fashion
Le coton est le 1er consommateur d’eau. Pour produire un tee-shirt, il faut 2 700 litres d’eau, soit l’équivalent de 70 douches. Le polyester pollue tout autant car principalement produit à partir du pétrole
L’industrie textile est considérée comme responsable de 20% de la pollution des eaux.
Les enfants exploités par les marques de fast fashion travaillent entre 14h et 16h par jour en étant payé 80 euros par mois. Les principaux pays concernés sont le Pakistan, l’Inde, le Bangladesh
Les alternatives à la fast fashion la mode éthique
Privilégiez la mode éthique : les matières utilisées ont un faible impact environnemental. On mise donc tout sur le lin, le coton bio, le cuir végétal, le cachemire, afin de limiter la surproduction. Les conditions de fabrication garantissent également le respect des minima sociaux, c’est-à-dire que la mode respecte les conditions de travail général et n’exploite donc pas les enfants.
Les actions à faire, avant un nouvel achat ? Prendre soin de ses vêtements actuels, se poser la question « en ai-je vraiment besoin ? » et acheter en seconde main afin de réduire l’empreinte carbone. Page 20
Couverture du livre Leféminismeoulamort , de Françoise d’Eaubonne Image libre de droit Manon Casse Ton Cliché Chloé Robinson & Sofia Zunigo-Cucalon – 2de2Face à la menace posée par le dérèglement climatique, 36 % d’Occidentaux parmi la génération Z disent ne plus vouloir faire d’enfants.
La baisse de la natalité, solution au changement climatique ? Dernièrement, il est apparu dans le débat public l’idée que transmettrela vie seraitmauvais pour la planète, les enfants constituant une source d’émission carbone disproportionnée. Face à une population qui atteint déjà 8 milliards de personnes et qui émettent en moyenne 35 milliards de tonnes de CO2 par an, le mieux serait, en effet et selon certains, de ne pas mettre au monde un enfant. D’après une étude menée par l’université de Lund en Suède, éviter de faire un enfant serait le geste le plus écologique qui soit, permettant ainsi d’éviter approximativement60tonnesdeCO2paran,bienplus que de supprimer la voiture ou de devenir végétarien. Or, d'après l’ingénieur Emmanuel Pont, « ce chiffre devrait être oublié, car il s’agit d’une espérance de vie moyenne multipliée par le bilan carbone moyen annuel d’un individu ».
Les Ginks, un nouveau phénomène
L'intensification des sécheresses, des pénuries d’eau et des incendies à grande échelle est de plus en plus ressentie par les jeunes. Ces problèmes qui semblent à première vue impossibles à résoudre incitent de nombreux couples à repenser leur désir d'avoir des enfants. Selon un sondage, 71% des Français de 15 à 17 ans ont peur face à l'avenir. En effet, quel monde pourrait-on imaginer pour nos enfants lorsque les jeunesd'aujourd'huiconnaissentuneffondrementdela confiance en l’avenir ?
Tel est l’argument avancé par certains des jeunes atteints d'éco-anxiété. Aux Etats-Unis, ces derniers sont nommés Ginks acronyme pour Green Inclination, No Kids
Pays du Nord versus pays du Sud

Face aux problématiques environnementales, ce sont les populations les plus vulnérables qui s’avèrent les plus touchées.
Les aléas climatiques, générateur d’inégalités à travers le monde ? D’après les résultats du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), il est clair que les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées seront les plus touchées. Parmi elles, les femmes, qui, selon les Nations Unies, constituent 70 % des 1,3 milliards de personnes vivant dans des conditions de pauvreté. Dans les milieux urbains, 40% des familles les plus pauvres ont une femme comme chef de famille. Le changement climatique amplifie les conséquences de la marginalisation des femmes dans le secteur agricole. Possédant moins de 10 % des terres selon l’ONU, elles ont aussi moins accès à l’éducation, aux formations et aux informations que les hommes. Les femmes s’adaptent aussi moins rapidement aux risques, tel au Burundi, dans la culture de bananes exposée aux risques de maladies. Pourtant, elles jouent un rôle clé dans l’agriculture en Amérique latine, en Asie, en Afrique et sont majoritairesdanscertainescultures,parexempledans
la culture de riz au Bangladesh. Le changement climatique augmente aussi les violences subies par les femmes. Selon l’ONU, une femme sur cinq déplacées dans des « conditions humaines difficiles » est victime de violence ou de viol. Une étude publiée en 2007 après le Cyclone Sidr au Bangladesh, l’un des cyclones le plus dévastateurs dans la région, a démontré une corrélation entre les désastres naturels et la traite des êtres humains. Peu après le désastre, les réseaux criminels de la région avaient en effet commencé à s’attaquer aux veuves et à les forcer à se prostituer le long de la frontière avec l’Inde.
Enfin, le changement climatique met la santé des femmes en péril, en Europe y compris. Selon Les Echos, lors de la canicule de 2003, l’excès de mortalité a été supérieur de 80 % chez les femmes par rapport aux hommes. Les raisons ? Une moyenne d’âge plus élevée mais aussi une sensibilité aux affections pulmonaires ainsi que des inégalités de traitement la prise en charge médicale.
Page 21
Les études récentes reflètent toutes une baisse de la fécondité dans le monde, avec un taux de fécondité qui est passé de 1,6 enfants par femme en 2023, contre 5 en 1950. Une baisse de la natalité engendre néanmoins de lourdes conséquences économiques et sociales. Dans la mesure où l’on ne pourra pas arrêter la croissance démographique mondiale d'ici 2080, d'après les Nation Unies, la solution ne serait-t-elle pas plutôt d'agir sur nos modes de vie afin d’être plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité ?
Sur ce sujet, de nombreux Occidentaux pointentle doigt vers les pays en voie de développement et leur fort taux de natalité, qui serait à la cause de ce problème écologique. Néanmoins, il a été démontré que le poids écologique de l’humanité vient principalement des pays riches, au faible taux de natalité. 10% de la population mondiale sont ainsi responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre.
Maribel Hage – 1ère5
Le plus grand pollueur du monde est…
Le Russe Roman Abramovitch
Le milliardaire russe Roman Abramovitch, âgé de 57 ans,détientlapalmedela pireempreintecarbone,avec 31 199 tonnes de CO2 émis sur l’année 2018, soit 4 457 fois la moyenne d’une personne quelconque. En mai 2021, sa fortune était estimée à 15,4 milliards de dollars, faisant de lui la 124e personne la plus riche du monde.
La pollution excessive que l’homme d’affaires émet est, pour la plus grande partie, due à son super-yacht Eclipse, le secondplus grandyachtdumonde. S’ajoute à cela son Boeing 767 personnel, véritable palace volant, qui dispose notamment d’une salle de banquet pouvant accueillir une trentaine de personnes.
Les industries de pétrole et de gaz de Roman Abramovitch ainsi que ses nombreux voyages en hélicoptère et en sous-marin participent aussi énormément au désastre écologique qu'il émet.
Selon un rapport de l’ONG Oxfam, publié en novembre 2023, les 1 % les plus riches de la planète, soit 77 millions de personnes, émettent autant de gaz à effet de serre que les 66 % les plus pauvres, soit environ 5 milliards de personnes.
En France, les 1 % les plus riches auraient émis autant de carbone en un an que les 50 % les plus pauvres, en dix ans.
Basé sur les données d’une étude de deux anthropologues américains, Richard Wilk et Beatriz Barros, le Français Bernard Arnault arrive en 4e position des plus grands pollueurs au monde, derrière Roman Abramovitch, le magnat des affaires et producteur américain David Geffen, enfin le financier américain, magnat de l'immobilier et des jeux d'argent, Sheldon Adelsona.

Victoria Attias – 1ère1
Ce n’est un scoop pour personne, les jeunes sont de plus en plus exposés aux écrans. Selon l’INSEE, 54% des enfants âgés de cinq ans les utilisent déjà. Justine Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance, nous parle de l’impact sur notre santé mentale et de la nécessité de bien gérer ses contenus.

Casse Ton Cliché (CTC) : Les études montrent que la surexposition aux réseaux sociaux est nocive pour la santé mentale et physique. Qu’en est-il vraiment ?
Justine Atlan : En réalité, il n’y a pas d’études scientifiques probantes du lien de causalité directentre l’exposition aux réseaux sociaux et la nuisance sur la santé. Néanmoins, ce que nous savons est que, depuis les révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, les réseaux sociaux et en particulier Instagram ont réalisé des études en interne qui démontrent que sur des adolescentes vulnérables, la consommation excessive du réseau social va avoir un impact néfaste
sur leur santé mentale, notamment en termes d’estime de soi et de dépression. Concernant les impacts sur la santé physique, le temps passé sur les écrans est un temps qui n’est pas consacré à une activité physique, pourtant essentiel à la santé.
De même, nous savons que lalumière bleue des écrans numériques retarde l’endormissement et prive de tempsdesommeil.Deplus,laconsultationdanslenoir peut favoriser la myopie. Enfin, cela nuit également à la posture du corps et peut créer des douleurs articulaires.
CTC : Avez-vous remarqué des changements dans la manière dont les jeunes communiquent, vivent en société depuis la naissance des réseaux ?
Justine Atlan : Nous remarquons que les jeunes ont manifestement une santé mentale et physique qui se dégrade depuis un certain nombre d’années. Est-ce dû aux réseaux sociaux ? Probablement car les jeunes ont davantage accès à des droits comme l’information et l’expression, grâce aux réseaux sociaux. Leur champ des possibles estplus ouvert et accessible. ils peuvent faire entendre davantage leurs voix afin de changer le monde. Donc, aujourd’hui, l’enjeu est de reprendre la maîtrise des usages numériques pour garder le meilleur et se départir du pire. Ainsi, cela vient interroger l’organisation de la société plus globalement, dans laquelle les réseaux se sont ancrés.

Depuis la révolution du smartphone en 2007 par Apple, l’outil qu’est le téléphone portable s'immisce de plus en plus dans notre vie quotidienne.
En janvier 2024, la marque américaine de yaourt Siggi proposait à des consommateurs de ne plus toucher à leur smartphone pendant 30 jours, avec 10 000 dollars à la clé Ce défi, par sa seule existence et la publicité qui en a découlé dans les médias, montre bien le rapport de dépendance que peut entretenir l’être humain avec son téléphone.
D’après le baromètre des addictions réalisé par Ipsos en 2022, 41% des jeunes, soit un peu plus de 2 jeunes sur 5, passent plus de 6 h par jour devant un écran.
Cette dépendance, jugée indispensable pour certains
dans un monde connecté, peut être multiple Nécessité professionnelle, accès à l’information, aux divertissements, à la consommation Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas se séparer de son smartphone et ainsi éviter l’angoisse ou la peur. On parle alors de « nomophobie », qui concerne particulièrement les jeunes femmes Dans le sondage de Casse Ton Cliché de 2023, 77.3% des garçons du lycée jugeaient faisable « le fait de vivre une semaine sans technologie », contrairement aux filles, pour qui ilétaitplus difficile de se projeter dans cette situation.
Page 22
CTC : Quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous protéger, en tant que jeunes étudiants ?
Justine Atlan : Les vols de données peuvent être liés à une mauvaise protection des comptes. Il faut être très vigilantetne jamais partageridentifiantetmotde passe. Je conseil de changer régulièrement les mots de passe. Pour cela, des applications existent et gèrent vos identifiants et mots de passe pour vous.
La méfiance reste la meilleure protection en la matière. Il est important d’avoir toujours en tête le risque, afin d’avoir un esprit critique sur ce que l’on reçoit et ce que l’on donne comme information.
CTC : Selon vous, quelles sont les bonnes pratiques à adopter lorsque l’on publie du contenu (photos, vidéos…) sur les réseaux sociaux ?
Justine Atlan : Selon moi, l’une des bonnes pratiques à adopter constamment en tête que la publication de contenus est une façon de rendre publique le contenu, c'est-à-dire de le partager à tous. Ces derniers pourront en faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Ainsi, nous devons être prêts à assumer pleinement et pour toujours ce contenu. En ce qui concerne un tiers, il est important de lui demander son consentement au préalable. Le droit à l’image est devenu fondamental aujourd’hui. Il doit être connu de tous, maîtrisé par chacun et respecté de façon réciproque.
Jana Partouche & Tessa Ben Ayoun – 2de3 L’appli de rencontre est-elle has been ?
Selon les derniers chiffres de 2022, 24% des couples se sont rencontrés sur Internet. L’utilisation des applis de rencontre est à la baisse, néanmoins.
Hinge, Tinder, Bumble, Meetic… Si 48% des 18-30 ans avouent s’être déjà connecté au moins une fois sur un site de rencontre, la fréquentation est en baisse, notamment chez la Gen Z. Avec 44 % des utilisateurs français se disant insatisfaits, on est en droit de se demander si la tendance n’est pas à la saturation numérique. On parle de dating burn-out « Après cette période du tout-écran, beaucoup d'utilisateurs ont ressenti le besoin de revenir au monde réel », explique Pascal Lardellier, auteur de S'aimer à l'ère des masques et des écrans (2022).
Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?
Impression de devoir « se vendre », temps consacré, manque d’alchimie, conformité aux normes, prévisibilité… L’utilisation des applications de rencontre amène les consommateurs à la lassitude et à la désillusion.
Le sentiment de solitude chez les 18-30 ans (41%) et la difficulté à nouer de nouveaux liens amoureux et amicaux (31%) explique le fait que les applis de rencontre deviennentdes espacesde discussion dénués de toute perspective de rencontre, selon une enquête IFOP Paradoxalement, les opportunités de rencontre dans la vie réelle semblent de plus en plus restreintes. En effet, les 18-30 ans sont 38 % à moins sortir en soirée Les Français veulent pourtant toujours de l’amour dans leur vie. Ils sont 71 % à souhaiter être en couple, y compris les plus jeunes : 43% des 18-24 ans affirment vouloir une relation sérieuse. Leur idéal ? Une rencontre inattendue.
Margaux Vermeulen – 1ère2
Les IST, c’est quoi ?
Chaque jour, plus d’un million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible (IST) dans le monde

Image libre de droit
Il existe plus de 30 infections différentes qui se transmettent par contact cutané, lors d’un rapport sexuel vaginal, anal ou oral.
Néanmoins, les IST les plus fréquentes sontliées à sept agents pathogènes. Trois peuvent être guéries :
La gonorrhée
Cette infection affecte environ 82 millions de personnes chaque année et touche principalement les hommes de moins de 30 ans. Les symptômes sont souvent minimes, se manifestant principalement par des picotements ou des brûlures en urinant. Toutefois, sans diagnostic ni traitement approprié, cette infection peut conduire à l'infertilité.
La chlamydiose
Souvent asymptomatique, elle affecte environ 129 millions de personnes chaque année. En raison de son diagnostic fréquemment retardé, elle constitue la principale cause d'infertilité chez les femmes en France.
La trichomonase
Elle touche 156 millions de personnes par an et les symptômes ne se manifestent généralement que vingt jours environ après l'exposition. Ces derniers peuvent inclure des démangeaisons, inflammations, une odeur désagréable des sécrétions vaginales ou des douleurs pendant les rapports.
Quatre autres infections sont incurables.
L'hépatite B
Elle touche 296 millions de personnes dans le monde et l’âge de décès moyen est de 65 ans. Les symptômes peuvent varier et la maladie peut passer inaperçue. Mais on dispose dorénavant d’un vaccin, obligatoire en France pour tous les nourrissons et recommandé chez les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 16 ans.
L’herpès (HSV)
Le virus de l’herpès (HSV) touche 500 millions de personnes dans le monde et bien que certaines personnes puissent vivre avec le virus sans symptômes apparents, d'autres peuvent présenter des poussées récurrentes. En France, on estime à 10 millions le nombre d’individus porteur du virus de l’herpès (HSV) dont 2 millions atteints d’un herpès génital, ce qui en fait l’une des principales causes d’infection sexuellement transmissible (IST).
Le VIH
Également connu sous le nom de sida, il affecte 40 millions de personnes. Malgré les avancées dans les soins aux patients séropositifs, cette infection reste l'une des principales causes de décès chez les adolescents et les femmes dans le monde. Les symptômes varient selon le stade de la maladie et affaiblissent progressivement le système immunitaire.
Le papillomavirus humain (PVH)
Il affecte 80% des adultes et majoritairement les femmes. C’est la principale cause de cancer du col de l’utérus et de cancer anal chez les hommes. Il n’existe pas de test sanguin permettant son dépistage. C'est pourquoi il est recommandé de réaliser un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans chez la femme. Depuis 2006, l’apparition du vaccin contre le papillomavirus chez les filles et garçons a marqué une avancée majeure dans le ralentissement de ce virus. Comment se protéger des IST ?
A utiliser correctement et constamment, les préservatifs constituent l’une des méthodes de protection les plus efficaces contre les IST. Pour rappel, certains préservatifs masculins et féminins pour les moins de 26 ans sont entièrement gratuits en pharmacie ou centres de santé sexuelle et de dépistage anonyme.
Une grande partie des IST étant asymptomatiques, il est très important, dès le moindre doute, de se faire dépister. Vous pouvez vous faire dépister sur prescription d’un médecin traitantdans un laboratoire, dans les centres de dépistages gratuits et sans autorisation parentale (CeGidd : 0 800 840 800) ou bien dans les centres de planning familial(0 800 08 11 11), disponibles sans rendez-vous, partout en France.

Oliana Ducos-Nourisson – 1ère4
Selon les chiffres du ministère de l’Education Nationale, les licences de mathématiques sont composées de seulement32%defemmes.Cesdernières neseraient-ellesdoncpas« matheuses » ?

« Les femmes n’ont pas un esprit fait pour les mathématiques. » Bien que l’affirmation semble aujourd’hui absurde, ayant été contrecarrée par de nombreuses recherches et neurosciences, le fait que les femmes ne soient pas « matheuses » est toujours présent dans l’imaginaire collectif.
Aujourd’hui, les jeunes doivent choisir leur parcours d’études dès le lycée, avec le choix de spécialités. A l’âge de 15 ans. Un âge où les stéréotypes genrés sont les plus présents et où les élèves sont en pleine construction sociale et à la recherche de leur identité.
S’affranchir des normes sociales intériorisées peut résulter en une exclusion et/ou intimidation à l'école.
Les élèves ont donc tendance à suivre les règles sans forcément en avoir conscience.
Les femmes poussées vers le littéraire
D’après une étude de l'Observatoire sur la féminisation des métiers du numérique, réalisée par l'école d'informatique Epitech en 2021, avec une moyenne à plus de 14/20 en sciences, seulement 48% des filles pensent pouvoir aller dans une école d’informatique contre 78% des garçons. Le constat est le même dans les autres matières scientifiques. De manière générale, les filles empruntent moins que les garçons la voie scientifique. La faute à de mauvais résultats ? Bien souvent, c’est un environnement chargé de préjugés, qui empêche la confiance en soi et pousse les femmes à ne pas s’aventurer dans les filières scientifiques. En effet, d’après une étude du CNRS menée par Pascal Huguet, directeur de recherche en psychologie sociale et cognitive, avec l'équipe d'une spécialiste des neurosciences, Angela Sirigu, sur une base de 6000 élèves interrogés, les femmes pensent avoir moins de chance de réussir en science dure qu’en littérature.
Quand les stéréotypes impactent les performances
Au cours d’une expérience, des hommes etdes femmes devaient répondre à des questions de calcul mental dans un temps limité, avec le même environnement : une salle vide équipée d’une IRM chargée de scanner leur activité cérébrale. Avant de commencer le test, un message leur étaitindiqué àdeux reprises :d’abordque le taux de réussite était le même pour les filles et les garçons, puis que les résultats étaient différents. Lors de la première série de prise de test, le pourcentage de réussite filles-garçons était le même (75%). En revanche, lors de la seconde série, le taux pour les filles avait diminué de 5 points (70%) quand celui des garçons restait inchangé. L’observation
suivante a démontré qu’une partie du cerveau, le lobe pariétal, utilisé pour faire des calculs mentaux, est d’autant plus stimulé chez les filles en présence de ce stéréotype, possiblement car elles veulent faire plus d’efforts. Le cortex orbitofrontal indique aussi la présence d’une émotion qui, dès lors, affecte négativement la performance.
L’importance des role models
Le manque de role models de femmes mathématiciennes joue inconsciemment sur la capacité des filles à se projeter dans les métiers liés aux mathématiques. En effet, les grandes mathématiciennes sont souvent invisibilisées, peu connues du grand public Pouvez-vous citer une grande mathématicienne ? Alors que vous connaissez sûrement Euclide, Newton ou Archimède, avez-vous déjà entendu parler de Sophie Germain, Katherine Johnson ou Maryam Mirzakhani ? A contrario, dans la littérature, de grandes écrivaines sont connues et reconnues, à l’instar de George Sand, Colette, Marguerite Yourcenar, Jane Austen, Virginia Woolf, ou plus récemment J.K. Rowling. Inconsciemment, les femmes sont donc repoussées des mathématiques et dirigées vers la littérature, « leur place », d’après un modèle sociétal qui est aujourd’hui en pleine évolution.
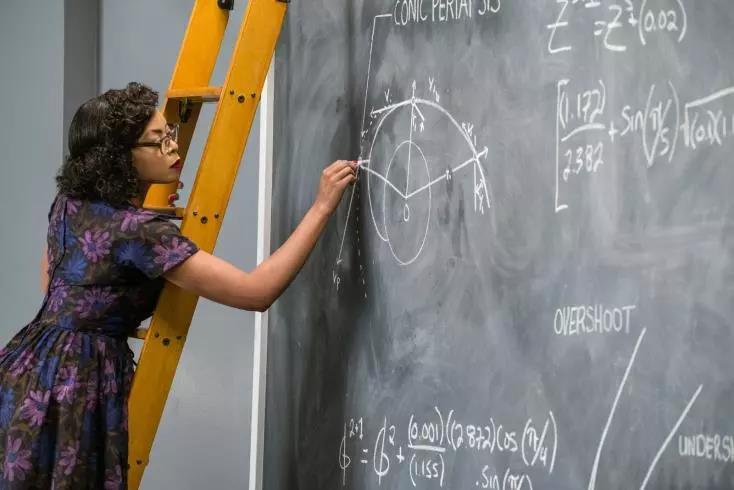
En effet, les femmes sont de plus en plus reconnues et représentées, notamment au cinéma Le film Hidden Figures, réalisé par Theodore Melfi en 2006 évoque par exemple le travail de la mathématicienne américaine Katherine Johnson et de ses collègues, à la NASA dans les années 1960, à un moment où les femmes n'accédaient pas à de tels postes. En France, le film Le Théorème de Marguerite, réalisé par Anna Novion en 2023, raconte l’histoire d’une brillante élève en mathématiques à l'ENS, seule fille de sa promo
Des places réservées ?
En Norvège, un système de quotas en faveur de la parité homme-femme a été mis en place dès 2003 Le sujet est en débat en France, pour les écoles d’ingénieur et les classes préparatoires
En 2011, la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) a créé l’opération Ingénieuses. L’objectif ? Lutter contre les stéréotypes de genre, promouvoir l’égalité femmes-hommes à l’école et dans la sphère professionnelle, et favoriser l’orientation des jeunes filles vers les formations scientifiques et technologiques et les carrières d’ingénieur·e·s.
L’opération prend la forme d’une campagne de communication nationale etd’un concours s’achevant par une remise de prix. Des conférences sont égalementorganisées, adressées à tous lesniveaux, du CP à la 3ème , agrémentées de jeux, ateliers, etc.
Laissons le mot de la fin à Marie Curie : « La vie n’est facile pour aucun de nous. Mais quoi, il faut avoir de la persévérance, et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose, et que, cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte ».
Page 24
Thomas Chapelain – 2de1
Patrimoine génétique : un héritage dur à porter
Il existe une disparité subtile mais significative dans la façon dont les maladies affectent les hommes et les femmes. Un fait dont le domaine de la recherche et de la médecine peine à s’emparer, certains traitements n’étant pas adaptés au métabolisme des deux sexes et les femmes étant largement sous-représentées dans les essais cliniques.
Génétiquement, si l’idéal d’égalité semble séduisant, la réalité en est autrement. En effet, diverses maladies présentent des préférences distinctes pour un sexe donné. Certaines pathologies, troubles et handicaps, comme l’Alzheimer (2 cas sur 3), la dépression (12% contre 9% des hommes en France en 2022) ou encore l’ostéoporose (2 à 3 fois plus), touchent majoritairement les femmes. A l’inverse, l’autisme (4,3 garçons pour une fille) ou encore les tumeurs du cerveau (2 fois plus), du pancréas (20 à 30 % de plus que les femmes) impactent plus les hommes.
Les raisons de ces disparités ? Le métabolisme mais aussi les comportements et attentes sociaux.
De nombreux facteurs en cause
Les statistiques révèlent que les hommes sont plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les hommes ont un risque plus élevé de développer une maladie coronarienne que les femmes. Cette prédisposition est due à des facteurs biologiques, tels que les niveaux d'hormones et la composition corporelle qui expliquent aussi d’autres maladies, comme le cancer de la prostate. D'un autre côté, les femmes sont plus sujettes à certaines maladies, notamment les troubles autoimmunes comme le lupus érythémateux systémique (LES). En effet, selon l'Alliance mondiale des maladies chroniques, le LES touche environ neuf femmes pourunhomme.Lesraisonsdecette disparité sont complexes et impliquent différents facteurs : hormonaux, génétiques et environnementaux. Pour des raisons sociales, les femmes sont également plus susceptibles de souffrir de dépression et d'anxiété. La pression due aux attentes culturelles, mise sur les femmes, contribuent à cette prédisposition. De plus, les fluctuations hormonales, en particulier pendant les cycles menstruels et la ménopause, jouent un rôle dans la santé mentale des femmes.
Le cancer du poumon préoccupant chez les femmes
Chez les femmes, le cancer du poumon est passé de 16 % en 2000 à 34,6 % en 2020, selon les données des hôpitaux généraux (KBP 2020) publiées dans le Lancet Regional Health « Il y a un gros signal d’attention sur la mortalité par cancer du poumon chez la femme, qui, dans les deux-trois ans à venir, va dépasser la mortalité par cancer du sein », a souligné le Pr Norbert Ifrah, président de l’Institut national contre le cancer (Inca), lors d’une conférence de presse enjuillet2023.Si letabac estlepremier facteur de risque, d’autres causes peuvent aussi entrer en compte : la sociologie et la biologie de la femme qui, jusqu’ici sont moins étudiées. Les risques liés aux professions et aux activités traditionnellement féminines et le rôle des hormones sont des pistes à explorer pour la recherche. Dans la manière dont les maladies affectent les hommes et les femmes, comprendre et accepter ces disparités est crucial et essentiel pour garantir à chacun des soins de santé adaptés à ses besoins spécifiques. Et ainsi faire avancer la science
Lucas Malaussena – 1ère5
JO 2024 : la parité hommesfemmes, une course de fond ?
« Ouvrons Grand les Jeux » …

Alors que les Jeux Olympiques de 2024 se profilent à l'horizon, l'engagementpour la parité hommes-femmes dans le monde du sport atteint un niveau sans précédent.
Les efforts du Comité International Olympique (CIO) pourinstaureruneégalitéentrelessexessemanifestent à travers des initiatives et des ajustements réglementaires, promettantun événementoù la balance de la représentation s'équilibre presque parfaitement.
Le même nombre de places de qualification pour les femmes et pour les hommes sera en effet attribué.
Dans le détail, d'autres initiatives clés menées en coopération avec les Fédérations Internationales (FI) de sport et les Comités Nationaux Olympiques (CNO) ont pour ambition d’offrir aux athlètes femmes et hommes des chances égales de participer aux Jeux Olympiques, notamment un programme sportif plus
équilibré entre les hommes et les femmes, avec 28 sports sur 32 totalement paritaires à Paris
La parité dans le sport, enfin ?
Alors qu'elles ne représentaient que 2,2 % des participants aux Jeux de Paris 1900, où elles concouraientpourla première fois, les femmesontété de plus en plus nombreuses par la suite, jusqu'à atteindre 23 % à Los Angeles 1984, 44 % à Londres 2012 et 48 % à Tokyo 2020.
Dans cette perspective, les JO de Paris 2024 visent à marquer l'histoire avec une participation quasi égale des hommes et des femmes, une première dans l’histoire des Jeux
Au total, près de 11 000 athlètes, répartis de manière équitable entre les deux sexes, représenteront leurs nations respectives.
L’ambition paritaire se concrétise aussi par une augmentation du nombre de disciplines mixtes et un ajustement des quotas, permettant ainsi une représentation plus équilibrée des genres.
Cependant, si la parité en termes de participation est en bonne voie, les disparités de récompenses financières entre hommes et femmes demeurent préoccupantes. Bien que les athlètes olympiques ne reçoivent pas de salaire pour leur participation, les primes attribuées pour les médailles varient grandement d'un pays à l'autre, et souvent entre les sexes. Par exemple, aux Jeux Olympiques de Rio 2016, la prime attribuée aux médaillés d'or masculins était en moyenne de 44 000 dollars de plus que celle des médaillées d'or féminines.
Certains pays ont fourni des efforts louables pour
égaliser ces primes mais le tableau global reste disparate, soulignant le besoin d'une action plus unifiée et globale pour garantir l'équité financière.
Petit pas ou pas de géant ?
Au-delà de la simple participation et des récompenses financières,l'égalitédessexesauxJOde2024englobe également l'accès équitable aux ressources, telles que l'entraînement, le soutien médical ainsi que la visibilité médiatique. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour valoriser les performances des athlètes féminines, bien qu'une couverture équitable reste un objectif à atteindre.
De plus, le CIO a initié des programmes destinés à augmenter le nombre de femmes dans des rôles de décision au sein des instances sportives. Des efforts visant à promouvoir l'égalité sur le terrain, mais aussi à assurer une représentation féminine dans les processus décisionnels
Si les JO de 2024 se présentent comme un modèle d'égalité des sexes dans le sport, la route vers une égalité totale est semée d'embûches, nécessitant un engagement continu des athlètes aux sponsors, en passant par les médias et les supporters.
Seule une approche collective et inclusive pourra venir à bout des derniers obstacles et célébrer véritablement l'esprit olympique dans toute sa diversité et son équité. Les JO de 2024 offrent une plateforme pour avancer vers cet idéal, marquant un tournant décisif dans la quête de l'égalité des sexes dans le sport.

Majoritairement dominé par les hommes, le monde des échecs peine à inclure les femmes. Une inégalité persistante qui empêche la gent féminine de se faire sa place
Les échecs, un monde suranné en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ? Jeu de stratégie millénaire, les échecs peinent à se départir de la « tradition » en termes de démographie, les femmes étantreprésentées en minorité. En 2020, la série Netflix à succès The Queen’s Gambit (Le Jeu de la Dame) mettait en scène une prodige des échecs orpheline tentant de devenir la meilleure joueuse du monde. Si la série a ramené ce jeu à la mode et attiré davantage de femmes, elle dépeint aussi un univers teinté de sexisme ordinaire larvé
En France, seulement 20% des licenciés sont des femmes. À l'international, le chiffre tombe à 10%. Pourtant, l'histoire des échecs regorge de femmes remarquables ayant laissé leur marque, à l'instar de la Hongroise Judit Polgár
Surnommée « La Reine des échecs », la joueuse du top 10 mondial a aussi été la première à battre, en 1991, le record de précocité de l'Américain Bobby Fischer, l’un des plus grands joueurs au monde, qu'il détenait depuis 33 ans.
Défier les conventions, rivaliser avec les meilleurs joueurs… La tâche semble ardue pour les femmes qui doivent se plier à un système phallocrate très critiqué. En effet, aux échecs, il existe une catégorie mixte et une catégorie féminine. Cette dernière a l’avantage de soutenir les joueuses professionnelles en leur offrant des
gains pour les mieux classées mais elle les éloigne aussi de la sphère des meilleurs joueurs masculins. De plus en plus, les joueuses choisissent néanmoins de jouer dans les catégories mixtes, alors qu'elles pourraient être favorites dans les compétitions féminines. En France, les clubs doivent aussi inclure au moins une joueuse dans chaque équipe de 8 joueurs en compétition, afin d’encourager la mixité. Mais au Top Jeunes, la première division française, toujours très peu de filles en vue. Les fédérations s’en tiennent au minimum requis. De même, du côté des entraîneurs, ce sont presque tous des hommes.
Malgré les quelques mesures mises en place, les échecs restent encore un domaine où les stéréotypes de genre et les inégalités persistent, alimentés par des figures emblématiques, telles queBobby Fischerquidéclarait ouvertementque les femmes sont simplement moins intelligentes que les hommes.
Comble de la discrimination… En 2023, la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a exclu les femmes transgenres des compétitions mondiales, à moins d’une « preuve pertinente du changement » de sexe, examinée au cas par cas.
Si la Fédération française d’échecs a annoncé qu’elle ne suivrait pas la nouvelle réglementation, dans le monde des échecs, le roi n’est pas encore mat.
Page 25
Benjamin Chilton – 2de6
Cédric Chilton, élu de la Fédération française de ski (FFS) répond à nos questions.
Casse Ton Cliché (CTC) : Qui êtes-vous ?
Cédric Chilton : Je suis skieur et compétiteur depuis mon adolescence. Je suis élu auprès de la Ligue fédération française de ski (FFS) Paris Nord Centre depuis près de 20 ans et, pour cette mandature, j’ai été nommé Vice-président et Responsable de la Commission Alpine, dont le rôle est de gérer tout ce qui touche au ski alpin au sein de la Ligue : ski alpin adulte, compétition alpine, sélection, entrainement et compétitions nationales des jeunes.
CTC : Le monde du ski connaît-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?
Cédric Chilton : Bien sûr, il y a des inégalités Cependant, ce ne sont pas des inégalités choquantes. Le ski est un sport physique qui nécessite de séparer hommes et femmes en compétition car le développement féminin et masculin n’est pas identique. Comme pour tous les sport, les femmes seraient très pénalisées en termes de résultat si elles concouraient avec les hommes.
Concernant les rémunérations, à haut niveau, comme dans beaucoup de sport depuis peu, les Price Money femmes et hommes sont identiques. Au niveau amateur, la différence principale est le peu de femme compétitrice par rapport au nombre d’hommes
CTC : Y a-t-il des postes à responsabilités tenus par des femmes ?
Cédric Chilton : C’est le principal problème. Le ski reste très masculin au niveau des dirigeants de clubs, ligues, fédérations, entraîneurs.
Le ski est un sport peu médiatisé dans la plupart des pays et ce sont beaucoup de bénévoles en poste depuis des années qui gèrent tout cela. Et, parmi ces bénévoles, très très peu de femmes. Dernièrement, en France, des quotas minimums de 50% de femmes à élire dans les instances ont été établis. Il faudra attendre quelques années pour voir si cela produit un changement significatif concernant la mixité de la représentation féminine dans tous les secteurs du ski.
CTC : Comment les skieuses sont-elles considérées, selon vous ?
Cédric Chilton : Les skieuses, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, sont aussi bien considérées que les hommes, que ce soit médiatiquement ou en termes d’entrainement De ce point de vue, le ski, comme le tennis et contrairement au football par exemple, est un sport où les compétitions professionnelles féminines sont très suivies, probablement presque autant que les compétitions masculines.
CTC : Un cliché sur les femmes et les hommes dans le monde du ski que vous aimeriez déconstruire ?
Cédric Chilton : Le principal cliché qui mérite d’être déconstruit concernant les femmes skieuses concerne cette image de sportives « musclées » et « pas féminines ». Les skieuses actuelles sont de véritables athlètes et tout à fait féminine. Ces deux qualificatifs ne sont absolument pas incompatibles. Mais les clichés ont la vie dure et il faudra quelques années pour que ce type d’images disparaisse.
 Paul Pitman – Tale2
Paul Pitman – Tale2
Quand l’inclusion des personnes transgenres dans le milieu sportif fait débat…
Halba Diouf, jeune athlète transgenre de 21 ans, a été privée de participation aux JO de Paris 2024. Cet événement, très médiatisé, a provoqué questions, soutien mais aussi énervement. Jusqu’où peut-on aller dans l’inclusion des personnes transgenres dans le milieu sportif ?
Le principal problème soulevé par les détracteurs est que les sportives transgenres ont un avantage biologique comparé aux « vraies femmes » ; elles ont un taux de testostérone, une taille, une masse musculaire et une ossature bien plus importante Argumentation justifiée ou transphobie décomplexée ?
Du côté de l’opinion publique, une grande vague de soutien en faveur de l’inclusion se fait sentir Depuis les JO de Tokyo en 2020, plusieurs fédérations intègrent les transgenres en compétitions. En France, la Fédération française de rugby (FFR) a été la première à inclure les athlètes transgenres, sans distinction dans son règlement.
Face à la question des performances, des associations émettent l’idée de créer une catégorie réservée aux sportives transgenres, tel la Fédération internationale de natation (FINA). Une décision pouvant être vue comme un moyen d’invisibiliser le problème et perpétuer la discrimination institutionnelle.
Page 26
Parole de skieuse : le point de vue d’une ancienne élève EIB
Skieuse et ancienne élève de l’EIB, Iloë Pinchart nous expose son point de vue sur la question du sexisme dans le monde du ski.
CTC : Y a-t-il du sexisme dans le monde du ski ?
Iloë Pinchart : Oui, notamment en ce qui concerne les priorités des entraîneurs, pour la plupart des hommes au-dessus de la cinquantaine, qui privilégient les garçons, sous prétexte que les filles sont moins nombreuses ou ont moins de chances de performer.
CTC : As-tu déjà été victime de sexisme ?
Iloë Pinchart : Oui mais une histoire plus intéressante est arrivée à ma sœur aux championnats du monde junior en janvier dernier. Les garçons ont eu droit à une retransmission en live sur trois de leurs quatre courses alorsquelesfillesontétéfilméessuruneseuleetunique épreuve. La Fédération internationale a été par la suite interpellée par de nombreux(ses) athlètes mais n’a apportéaucuneréponsesatisfaisante,malheureusement.
CTC : Que faudrait-il améliorer pour limiter les cas de sexisme ?
Iloë Pinchart : Augmenter le nombre de coach femme et encourager les filles à continuer la compétition car il y a beaucoup moins de filles sur les circuits de haut niveau. Beaucoup abandonnent du fait des structures inadaptées ou parce qu’elle se sentent discriminées.
Elie Surman & David Toutoundjian – 1ère5
Le football féminin à la traîne
Considéré comme moins compétitif que le masculin, le football féminin peine à gagner ses lettres de noblesse
Dans le monde du foot, les préjugés sur les capacités athlétiques des femmes, alimentés par des décennies de stéréotype, ont la vie dure Résultat ? Les matchs féminins ont moins de visibilité dans les médias mais également moins de soutien financier, ce qui se traduit par des salaires des joueuses plus bas et des ressources limitées.
Selon une étude récente de l'Observatoire du football CIES,les revenus desclubs de footballféminin sonten moyenne douze fois inférieurs à ceux des clubs masculins. En termes de salaires, les joueuses ne perçoivent qu'une fraction des sommes versées aux joueurs. En France, le salaire du footballeur le mieux payé de la L1, Kylian Mbappé, est plus de cent fois supérieur à celui de la joueuse la mieux payée du championnat de France féminin, Marie-Antoinette Katoto, évoluant comme lui au PSG.
En moyenne, les footballeurs de L1 ont un salaire 26 fois supérieur à celui des femmes.
De même, selon une enquête menée par le syndicat mondial des joueurs professionnels de football, seulement 3% des joueuses déclarent avoir accès à des installations d'entraînement de haute qualité.
L'écart entre le football féminin et masculin est aussi criant dans l'attribution de récompenses individuelles prestigieuses, telles que le Ballon d'Or. Sur les 64 éditions, seules six ont été décernées à des joueuses Lentement mais sûrement, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA gagne en légitimité. Le succèsest croissant, dû à une meilleure promotion de la compétition qui attire d’ailleurs des audiences record. Le sport, miroir de la société…
Célénie Jaegler – 1ère4
Portée par l’AFéMuse et l’université d’Angers, la création d’un musée dédié aux luttes pour les droits des femmes devrait voir le jour dans la ville des fleurs en 2027
En mars 2023, l’Université d’Angers et l’AFéMuse, association pour un musée des féminismes, ont présenté leur projet de création du premier musée consacré aux luttes pour les droits des femmes, contre les inégalités et les discriminations liées au genre. Initié par Christine Bard, historienne spécialiste du sujet, le musée devrait être abrité dans les locaux du Centre des Archives du Féminisme (CAF), à la Bibliothèque universitaire Belle-Beille d’Angers S’y trouvent en effet tous les ouvrages concernant le féminisme et quelques 80 fonds d’archives. Il s’agit de la plus grande concentration d’archives des femmes en France, pratiquement inaccessibles au grand public à l’heure actuelle. Des exemples ? Les archives personnelles d’Yvette Roudy, ministre des Droits des femmes sous la présidence de François Mitterrand ou
encore celle de Cécile Brunschvicg, femme politique et féministe française du début du 20ème siècle. A l’heure actuelle, il n’existe aucune institution en France qui valorise, avec un projet scientifique et culturel dédié, l’histoire des droits des femmes et des mouvementssociauxquilesontaccompagnés.Pasune seule des 1216 structures labellisées « musée de France » n’en a fait son centre d’intérêt. Un vide que l’Université d’Angers et ses partenaires entendent combler. La création d’un musée des féminismes est à l’image de l’évolution de la société et de l’égalité homme-femme, de plus en plus abordée dans le débat public. D’après les derniers chiffres de 2021, 67 % des musées nationaux sont d’ailleurs dirigés par des femmes, soit 27 % de plus qu'en 2019 et moitié plus qu’en 2015.
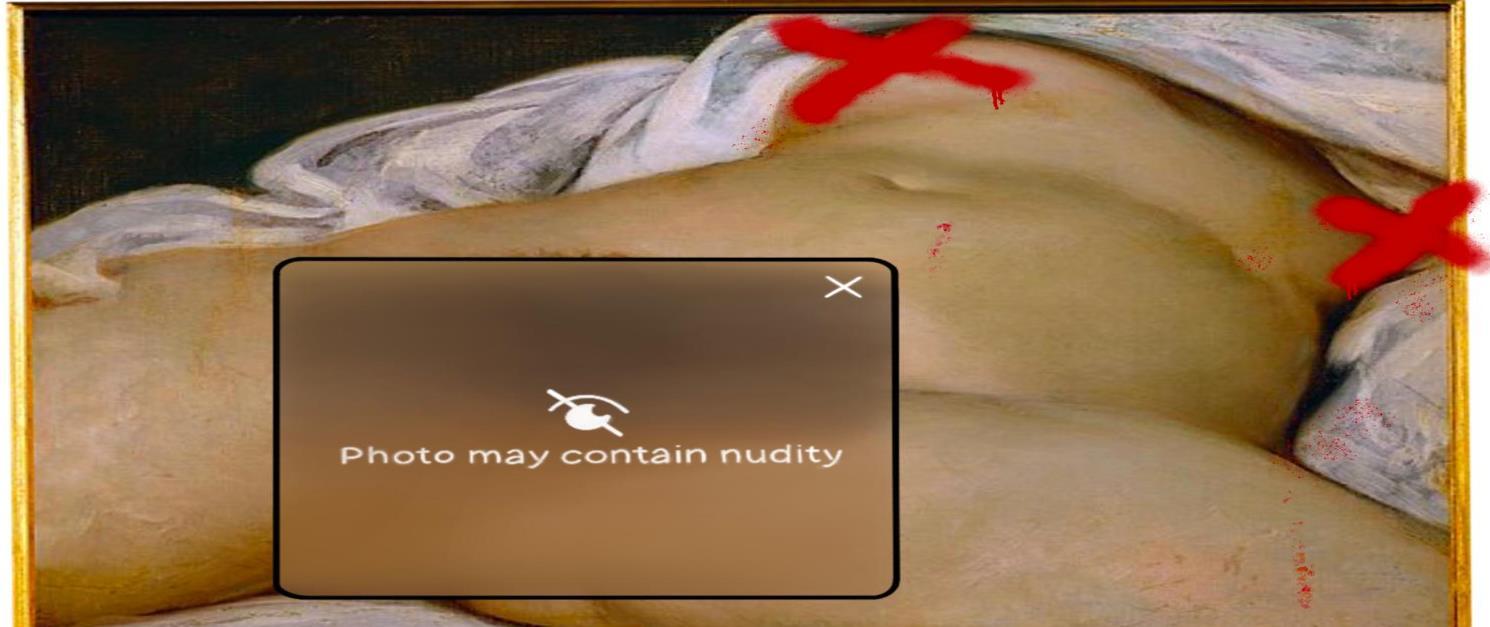
Camille Barbe – Esthète
Couvrez
Prêté au Centre Pompidou-Metz, L’Originedumondede Gustave Courbet a été taguée d’un « Me too » à la peinture rouge. Retour sur l’histoire d’une œuvre qui ne laisse personne indifférente
Il compte parmi les plus célèbres tableaux de l’histoire de la peinture et pourtant, il demeure l’un des moins vus. Uniquement connu des historiens d’art et des connaisseurs pendant longtemps, il faut attendre 1988 pour que L’Origine du monde de Gustave Courbet fasse l’objet d’une première exposition publique, à New York. Possession du psychanalyste Jacques Lacan depuis 1955, les héritiers de ce dernier, mort en 1981, léguèrent l’œuvre par dation à l’Etat français en 1995
L’Origine rejoignaitlesfondsdumuséed’Orsay « Je trouve que les couleurs de la chair sont jolies, c’est tout. » « Rien de dégoûtant là-dedans, monsieur. » « C’est un peu cru. » … Si l’on en croit un microtrottoir de France 2, rien de shocking ! dans L’Origine, pour le public de l’époque
Historiquement, le tableau fut réalisé en 1866 pour le dandy diplomate turco-égyptien, Khalil Bey, détenteur d’une éblouissante collection d'art dédiée à la célébration du corps féminin, qui finit ruiné par ses dettes de jeux. Bey maintenait la toile cachée derrière un rideau, le dévoilant seulement à ses visiteurs d'exception.
Qu’elle choque ou fascine, L’Origine du monde ne laisse pas de marbre au XIXe siècle. En 1878, le critique d’art conservateur Maxime Du Camp dira de Courbet : « Il est un mot qui sert à désigner les gens capables de ces sortes d’ordures, dignes d’illustrer les œuvres du marquis de Sade ; mais ce mot n’est guère usité qu’en charcuterie. » Une dizaine d’années plus tard, alors que le tableau est chez un antiquaire parisien - qui le masque lui aussil’écrivain Edmond de Goncourt s’enthousiasme : « Devant cette toile que je n’avais jamais vue, je dois faire amende honorable à Courbet : ce ventre est beau comme la chair d’un Corrège. » Jusqu’en 1945, L’Origine du monde passe des bras des marchands aux mains des collectionneurs La peinture vit des jours tranquilles jusqu’en 2011 Facebook désactive alors des comptes d’utilisateurs postant des images du tableau, pour cause de nudité La censure fait tollé, portant atteinte à la liberté d’expression. Le débat, d’importance, a aussi le mérite de relancer la question qui tache : Qu’est-ce qui, en art, rend un nu obscène… La patte de l’artiste ou l’œil du curieux ?
Page 27
Les musées sont très importants pour préserver l’histoire et refléter les évolutions des sociétés Concernant le musée des féminismes, ce dernier vise à être un lieu de partage de connaissances. Il donnera à voir et à comprendre les luttes pour l'émancipation des femmes et les discriminations liées au genre. Enfin, pour certain(e)s, il représente l’aboutissement d’un combat politique massif, commencé il y a plus de cinq décennies
Une première exposition temporaire est d’ailleurs d’ores et déjà programmée pour la rentrée 2024. Son thème ? « Les femmes sont dans la rue ».
Le commissariat de cette exposition a été confié à l’historienne Ludivine Bantigny, spécialiste des mouvements sociaux. L’ouverture permanente du musée est, quant à elle, prévue pour 2027
Le coin expo
Quelques idées pour la saison printemps-été
Brancusi : « Et ma matière est si belle en ses lignes sinueuses qui brillent comme de l'or pur et qui résument, en un seul archétype, toutes effigies féminines de la terre ». Brancusi est au Centre Pompidou, pour la première exposition rétrospective consacrée à l’artiste en France depuis 1995 Le point d’orgue ? La reconstitution à l'identique de son atelier
Jusqu’au 1er juillet 2024, place Georges-Pompidou, 75004 Paris.
Paris 1874 : XIXe siècle. Une bande de copains dans la capitale. Ils barbouillent. Entre Paris moderne et plein-air verdure, la peinture académique vacille
Jusqu’au 11 août 2024 au musée d’Orsay, esplanade
Valéry Giscard-d ’Estaing, 75007 Paris
Torlonia : Ou comment la collection de marbres de princes romains du XIXe siècle a éclos en un véritable musée. Une fleur de l’histoire à admirer, des pétales jusqu’aux racines
Du 26 juin au 11 novembre 2024, musée du Louvre, 75001 Paris.
Taïnos et Kalinagos des Antilles : 1994, Chirac, le Petit Palais et les Caraïbes avant Christophe Colomb. La première exposition coup de projecteur sur les arts premiers reprend du service
Du4juinau30octobre2024aumuséeduQuaiBranly, 75007 Paris.
Duels.L’art ducombat : « D’Artagnan, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir quelqu’un ; pendant qu’il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avait besoin de son aide, il surprit un coup d’œil d’Athos. Ce coup d’œil était d’une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d’appeler au secours ; mais il pouvait regarder, et du regard demander un appui ». Quandlesbravesbravent les interdits Une exposition flamboyante, à l’image des Trois Mousquetaires de Dumas ! Jusqu’au 18 août au musée de l’Armée-Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris.


Le rire est le propre de l’homme… et de la femme. Depuis une dizaine d’années, la scène de l’humour se voit dynamiser par la gent féminine Plus massif que par le passé, le phénomène n’est cependant pas nouveau. Le réalisateur, acteur, scénariste, producteur de cinéma et dirigeant de télévision français Dominique Farrugia, nous parle de l’évolution de ce monde en soi.
Casse Ton Cliché (CTC) : Comment la comédie a-t-elle évolué depuis les années 80 ?
Dominique Farrugia : La comédie a beaucoup changé car les supports ont beaucoup changé et les gens qui veulent rire sont différents aujourd’hui. Lorsque j’ai commencé à faire de la comédie en 1987, j’ai travaillé pour Canal+ et nous avions un espace de liberté absolument fou. Nous pouvions faire tout ce que nous voulions, rire de tout. Il n’y avait pas les réseaux sociaux, donc pas de « caisse de résonance » qui, aujourd’hui, ne nous permet plus de rire de tout et de tout le monde. Ce qui est intéressant aujourd’hui néanmoins, c’est que la comédie existe sur YouTube et bien moins sur les chaînes normales.
CTC : Quelles sont, selon vous, les principales tendances qui ont marqué le paysage de l'humour au cours de cette période ?
Dominique Farrugia : Comment parler de 40 ans d’humour ? Oui, ça change avec le temps, c’est toujours pareil. On ne rigolait pas des mêmes blagues en 1930. Les tendances, elles sont multiples et sont passées par mille canaux. Aujourd’hui existe un humour qui va cibler les plus jeunes sur les réseaux. Quand j’ai créé la chaîne Comédie+, en 1997, nous avons fait éclore de nombreux comiques.Aujourd’hui,ilyadesmilliardsdepossibilités des’amuseretderigoler. Par exemple, le stand up n’existait pas dans les années 80.
CTC : Comment l'avènement des nouvelles technologies et des plateformes de streaming a-t-il influencé la manière dont le public consomme et apprécie l'humour aujourd'hui ?
Dominique Farrugia : Il y a beaucoup de comédie sur les nouvelles plateformes, essentiellement sur Netflix et Amazon Prime Ces dernières captent beaucoup de one man show et de stand up, donc s’adressent à un public qui paye pour les voir. Ça, c’est vraiment important parce que ces gens-là s’amusent à regarder des comiques qu’ils aiment. Ils ne vont pas écouter ou regarder n’importe quoi ou qui.
CTC : Quid de la place de la femme dans le monde de la comédie ?
Dominique Farrugia : Elle a beaucoup évolué. Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de femmes font du stand up. J’ai eu la chance de travailler avec une femme qui s’appelle Chantal Lauby et, grâce à elle, nous avons féminisé nos vannes. Dans les années 80, et même 90, nous avions « un humour de couilles ».
Cela a beaucoup changé grâce à elles.
CTC : Quels défis les femmes humoristes ont-elles dû relever pour se faire une place dans un domaine souvent dominé par les hommes ?
Dominique Farrugia : Jusqu’au début des années 2000, l’humour été totalement tenue par les hommes. Une femme comme Valérie Lemercier s’est très vite imposée dans les années 90. Elle a fait rire beaucoup de monde mais malheureusement, elle n’a jamais voulu enregistrer un de ses spectacles. Donc, on ne connaît que ses films alors que, sur scène, elle est vraiment très drôle.
Pour les femmes humoristes, le défi majeur, c’est de se faire connaître.
CTC : Comment voyez-vous le rôle des femmes dans l'avenir de la comédie, tant sur scène que dans la production et l'écriture ?
Dominique Farrugia : Je vais prendre un exemple que je connais bien moimême… Si je produis l’histoire d’une femme, je vais demander à une femme de l’écrire et pas à un homme. C’est ce qui a changé aujourd’hui. Avant, c’était des hommes qui écrivaient les histoires de femmes.
Aujourd’hui, énormément de femmes autrices travaillent sur des séries ou sur des spectacles. Plusieurs comiques s’écrivent également elles-mêmes leurs spectacles, se produisentelles-mêmes. Dans le futur, le rôle des femmes va être de plus en plus fort, j’espère, et de plus en plus important, parce que c’est là où on doit aller. Ça ne sera pas à moi de le définir, ça sera à elles.
CTC : Des grands noms de femmes qui ont apporté quelque chose de particulier à la comédie ?
Dominique Farrugia : Dans les années 70 et au début des années 80, Jacqueline Maillan était une actrice formidable qui faisait rire la France entière. On l’a un peu oublié aujourd’hui, mais c’était une actrice dingue et, au théâtre, elle faisait beaucoup rire. Je parlais aussi de Valérie Lemercier tout à l’heure.
Ce sont des femmes comme elles qui ont permis à d’autres femmes de se produire, d’écrire leurs spectacles, d’être sur scène et de monter au créneau.
Aujourd’hui, il y a énormément de femmes qui font rire, qui s’expriment, et heureusement.
CTC : En tant que producteur, miser sur une femme pour un premier rôle, estce risqué ou, au contraire, une valeur sûre ?
Dominique Farrugia : C’est une question compliquée… Je ne vais pas miser sur une femme et n’importe laquelle. Je vais miser sur quelqu’un qui a un énorme potentiel et qui va me permettre de produire ma série.
Il y a des actrices qui sont extrêmement bankable, ce qui veut dire qu’elles peuvent rapporter de l’argent et conforter les plateformes à acheter ces séries. Si l’on demande à une de ces actrices de venir et de jouer avec nous, oui, on va miser sur elle en quelque sorte. Cependant, on ne mise pas sur un homme ou une femme. On mise sur un talent et c’est ça qui est le plus important.
CTC : En tant que figure emblématique de la comédie, quel conseil donneriezvous aux jeunes humoristes, en particulier aux femmes qui cherchent à percer dans ce milieu ?
Dominique Farrugia : Surtout travailler. Il faut travailler et toujours travailler. C’est le meilleur conseil que je puisse donner. Il y a des dizaines de manières de se faire connaître, donc prenez la meilleure et faites-vous connaître. Il faut surtout écrire et ensuite tester.
Casse Ton Cliché

Capucine Darmouni & Alice Salla – 2de6
« Jelevis,jerougis,jepâlisàsavue;Untroubles'élevadansmonâmeéperdue» … A l’acte I, scène 3 de la célèbre tragédie de Racine, le dilemme amoureux que connaît Phèdre fascine les femmes et, bien souvent, reste incompris des hommes. Professeur de Littérature à l’EIB, David Bissonnet nous éclaire sur les passions incarnées par la tragédienne au théâtre.
Casse Ton Cliché (CTC) : Au théâtre, qu’est-ce qu’une grande tragédienne ?
David Bissonnet : Par définition, une tragédienne est une actrice qui interprète des tragédies, en opposition à la comédienne qui interprète des comédies, même si, dans une acception plus large, elle interprète également des drames, des rôles graves qui convoqueraient un registre lyrique et tragique.
Une tragédienne joue des héroïnes tragiques, c’est-à-dire des personnages nobles, victimes de leur hubris (l’excès, la démesure, l’orgueil), des monstres fous qui inspirent à la fois la terreur et la pitié, mais aussi, dans une dimension cornélienne, l’admiration.
La tragédienne est donc une actrice dont la présence sur scène impressionne et touche. Elle incarne une forme de paradoxe car elle est à la fois force et fragilité, puissance et failles. Par ailleurs, la tragédie est liée étymologiquement au chant et à la poésie. Elle est, depuis l’Antiquité, rédigée en vers Le public attend donc d’une grande tragédienne une maîtrise, voire une virtuosité, de la voix et de la diction. D’ailleurs, on qualifie aussi de tragédiennes des cantatrices comme Maria Callas ou des chanteuses comme Edith Piaf.
CTC : Quels sont les grands rôles tragiques dont rêvent les comédiennes ?
David Bissonnet : Il est difficile de répondre à cette question à leur place. Toutefois, on peut facilement lister les grands rôles féminins de tragédie, souvent les premiers rôles : Phèdre, Médée, Bérénice, Hermione, Andromaque, Agrippine, Camille, Roxane dans Bajazet, Iphigénie, Cléopâtre dans Rodogune
A l’inverse, il n’y a pas de rôle décevant au théâtre, c’est à l’acteur et au metteur en scène de donner du relief à des rôles qui, en apparence, semblent lisses. Mais il est peut-être plus difficile de donner à voir sa virtuosité dans ce qu’on appelle les rôles de jeunes premiers, personnages souvent secondaires, contrepoints plus gentils, et donc peut-être moins intéressants, des premiers rôles de tragédiennes. C’est le cas de personnages comme Junie dans Britannicus ou Aricie dans Phèdre
La tragédienne a donc une forme de maturité, une complexité intérieure qui est peut-être moins présente dans ces rôles-là.
CTC : Quand naît la femme tragique au théâtre et quelle est son évolution ?
David Bissonnet : Il y a toujours eu des personnages féminins dans les tragédies mais ils n’ont pas toujours été interprétés par des femmes. En effet, dès l’Antiquité, les femmes sont exclues de la représentation théâtrale. Elles ne peuvent jouer sur scène en France qu’à partir de la fin du XVIe siècle, les rôles féminins étant jusque-là interprétés par des hommes travestis. Isabella Andreini, comédienne italienne, est connue pour être la première femme à avoir obtenu le droit de monter sur scène en France, en 1603.
Il faut bien comprendre que le métier d’acteur était réprouvé par l’Etat et l’Eglise. Malgré l’affirmation de la dignité des acteurs par Louis XIII dans un édit de 1641, les comédiens étaient excommuniés et frappés d’opprobre jusqu’au XVIIIe siècle. La capacité du comédien à dissimuler et transformer son caractère, son apparence, était perçue comme une infamie.
De plus, le métier d’actrice a longtemps été associé à la prostitution. Mlle des Œillets et Mlle de Champmeslé au XVIIe siècle ; Mlle Raucourt et Mlle Dumesnil au XVIIIe siècle sont de grandes tragédiennes qui ont souvent été présentées, à juste titre ou non, comme des courtisanes. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’Église refusa un enterrement chrétien à la tragédienne Adrienne Lecouvreur, ce qui révolta Voltaire qui lui consacra un poème.
Souvent enfants de la balle, les tragédiennes doivent réussir et faire carrière avant l’âge de 30 ans. Comme aujourd’hui, l’injonction de la jeunesse pèse plus sur les femmes que sur les hommes. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la stigmatisation des comédiens disparaisse et que la tragédienne devienne une vedetteàl’instardeRachelFélix.Puis,auXXesiècle,Cocteauinventel’expression célèbre « monstre sacré » pour décrire Sarah Bernhardt.
La grande tragédienne devient ainsi une star, une diva dont la présence et la renommée dépassent la scène et la France. Ses excentricités intriguent le public qui l’associe volontiers à ses rôles, comme si ceux-ci semblaient la suivre, la poursuivre.
Selon la légende, Sarah Bernhardt faisait souvent ses siestes dans un cercueil à côté d’une chauve-souris empaillée et d’un véritable crâne humain offert par Victor Hugo. Elle ramenait également de ses nombreuses tournées internationales divers animaux exotiques (perroquets, singe, guépard, et autres serpents et reptiles) qui provoquaient l’embarras de ses voisins parisiens.
Sarah Bernhardt incarne donc la figure de LA tragédienne. Aujourd’hui, des grandesactricesdethéâtreetdecinémacommeIsabelleAdjaniouIsabelleHuppert correspondent peut-être encore à cette image, mais il n’y a plus de tragédiennes au sens stricte du terme, plutôt des actrices. Cela va de pair aussi avec l’émergence et le développement du cinéma ; la tragédienne était la star d’une époque où les salles de théâtre étaient plus remplies qu’aujourd’hui.
CTC : Les femmes ont-elles l’apanage de la tragédie ? Quid des hommes ?
David Bissonnet : La tragédie n’est pas un genre théâtral féminin. Il y a beaucoup de grands rôles masculins tragiques (Néron, Oreste, Thyeste, Œdipe...) mais il est vrai que la réduction maladroite de la tragédie aux souffrances du cœur et de l’amour a pu entraîner un emploi plus fréquent du mot « tragédienne » que « tragédien ».
Ainsi, lorsqueVictorHugo théorise le mélangedes genres théâtraux à l’œuvredans le drame romantique, il associe volontiers la tragédie au public féminin. De la même manière, l’emploi péjoratif de ce terme, pour qualifier le comportement excessif d’une personne, est plus fréquent au féminin qu’au masculin. On entend plus souvent « Quelle tragédienne ! » que « Quel tragédien ! ».
La sensibilité du cœur, l’excès et le mensonge du jeu, l’hystérie du monstre : il faut bien reconnaitre que cet usage du mot brasse avec lui tout un héritage sexiste. D’ailleurs, aujourd’hui, cet emploi péjoratif est concurrencé par son équivalent anglais « drama queen » qui n’existe pas au masculin
Ainsi, qualifier un homme de « drama queen » c’est aussi le déviriliser, le féminiser, et donc l’humilier. Sexisme toujours. Page 29
Victoria Attias – 1ère1
Amoureux, filial, amical… Sur le grand écran, l’amour prend toutes les formes.
La Chimera, Alice Rohrwacher
Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c'est un rêve d’argent facile, pour d'autres, la quête d’un amour passé… Dans l'Italie des années 1980, Arthur, un jeune britannique, retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina… Un film déroutant.
Simple comme Sylvain, Monia Chokri
Sophia, professeure d'université à Montréal, mène une vie confortable et vit une relation stable mais peu excitante avec Xavier depuis une dizaine d'années. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Sylvain, un ouvrier du bâtiment que le couple engage pour rénover leur chalet d'été. Entre Sophia et Sylvain, c’est le coup de foudre ! Mais cela pourra-t-il durer ? Le César du meilleur film étranger 2024
C'è ancora domani, Paola Cortellesi 1946, Rome. Delia est mariée à Ivano, qui la bat régulièrement, la harcèle et l'humilie. Le couple a trois enfants dont Marcella, l’aînée, sur le point de se
marier. Devant la passivité de sa mère quant à sa situation, le mépris s’installe. Mais comment s’émanciper de la violence et devenir libre quand on est femme, pauvre et isolée ? Heureusement, il reste encore demain… Un film essentiel.
Black Tea, Abderrahmane Sissako
Le jour de son mariage, Aya, une jeune femme ivoirienne d’une trentaine d’année rejette son époux. Elle déménage alors enChine ettrouveun emploidans un magasin d'exportation de thé. C’est ici qu’elle y rencontre Cai, âgé de 45 ans et d’origine chinoise. Progressivement, les protagonistes tombent amoureux l’un de l’autre mais leur relation est vite confrontée aux défis de leur histoire et des préjugés des autres. Un filmsurl’immigration, l’amour, sa perte, explorant les thèmes de l’identité, de la culture et de la différence
20 000 espèces d’abeilles, Estibaliz Urresola Solaguren
Coco, 8 ans, est un petit garçon aux cheveux longs qui se sent fille dans son corps. Il-elle veut qu'on l'appelle Lucia. En vacances au Pays basque espagnol, chez sa grand-mère avec sa grand-tante, sa mère, son frère et sa sœur, son trouble éclate au grand jour. Avec sa grand-tante apicultrice, Coco comprend que s’il y a 20 000 espèces d’abeilles, il doit bien exister un genre

Adrien Guillamot – 2de6
Quand les héroïnes de films font leur cinéma…
Zoom sur quelques-uns des personnages féminins les plus badassdu grand écran
Ellen Ripley (Alien, Ridley Scott, 1979) : Lieutenant de 1ère classe, Ellen est à bord du Nostromo vaisseau interstellaire en mission de routine Mais un corps étranger s’infiltre dans le vaisseau cargo. A Ellen garder son sang-froid
Erin Brockovich (Erin Brockovich, seule contre tous, Steven Soderbergh, 2000) : Mère célibataire, Erin décroche un job dans un cabinet d’avocat. Elle se penche alors sur ce qui devient l’affaire de pollution des eaux potables à Hinkley en Californie par le géant Pacific Gas and Electric Company (PG&E) Une histoire vraie.
Black Mamba (Kill Bill, Quentin Tarantino, 2003) : Beatrix Kiddo est une jeune femme enceinte qui a survécu à une balle de revolver tirée dans la tête par Bill, le jour de sa répétition de mariage, dans une petite chapelle à El Paso, au Texas. Sortie du coma, elle décide de retrouver et tuer toutes les personnes qui lui ont fait du mal ce jour-là Une mère louve.
Scarlett O’Hara (Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1950) : Géorgie, 1861. Scarlett, belle jeune fille gâtée, est amoureuse. L’élu, Ashley Wilkes, est cependant fiancé à la douce Mélanie Hamilton. Tout n’est pas perdu… Le cynique Rhett Butler semble charmé mais… Taratata ! Une salamandre à la robe verte. La puissance faite femme.
Elizabeth 1ere d’Angleterre (Elizabeth, Shekhar Kapur, 1998) : « J’ai beau avoir le corps d’une faible femme, j’ai le cœur et l’estomac d’un homme ». Sur le champ de bataille en armure ou à sa table de travail en vêtements de cour, la « reine vierge » d’Angleterre nefléchitpas Unanimalpolitique.UnÂged’oràelle seule.
Polly Gray (Peaky Blinders, Steven Knight, 2013) : Tante et bras droit d’Arthur Shelby, chef du gang de Birmingham, elle gère la famille, les affaires et les problèmes sans en avoir l’air. Une main de fer dans un gant de velours.
Page 30
pour il-elle. A l’écoute mais perturbée, sa mère vit avec son enfant cette crise d’identité. Ce moment ravive en elle des fêlures familiales. La mère et son enfant vont donc avancer dans cette phase, grandir et apprendre ensemble
Côté série, le bonus...
Lessons in chemistry, Lee Eisenberg (Apple TV+)
Brie Larson incarne le rôle d’Elizabeth Zott dans les années 60 où elle voit son rêve de devenir scientifique s’effondrer dans une société patriarcale qui réduit les femmes à la sphère domestique. Mère célibataire, caressant toujours l'espoir de devenir une grande scientifique renommée, Elizabeth accepte un emploi dans une émission de cuisine télévisée. Une belle incarnation de force sensible.

Wonder Woman, LA référence
Carte d’identité de la super héroïne
Nom : Diana de Themyscira, alias Wonder Woman (ou Diana Prince).
Première Apparition : All Star Comics #8 (1941) Pouvoirs et Capacités : Super-force (force physique extraordinaire, comparable à Superman) ; invulnérabilité (grande résistance aux dommages physiques et aux attaques magiques) ; vol ; agilité et réflexes accrus ; combat au corps à corps (expertise en arts martiaux et techniques de combat des Amazones) ; armes magiques (utilisation du Lasso de Vérité, des Bracelets d'Argent, du Tiara-boomerang et de l'Épée de Wonder Woman).
Histoire et Origines : Diana est la princesse des Amazones, une race de guerrières immortelles vivant sur l'île cachée de Themyscira. Elle quitte son île pour explorer le mondedes hommes ety promouvoir la paix et la justice
Costume : Armure rouge, bleue et or avec un aigle doré sur la poitrine, une jupe étoilée, des bottes rouges, un diadème doré, et des bracelets indestructibles.
Adjectifs : Empathique, fort sens de la justice et de l'équité, sage (grande connaissance et compréhension des cultures et de l'histoire), altruiste (toujours prête à aider les autres, même au détriment de ses propres besoins), indépendante.
Symbolique : Le pouvoir féminin, la diversité culturelle, l'Amour et la compassion, l'égalité des sexes.
Lors d’une rupture amoureuse, elles font souvent office de baume au cœur. Paradoxe, s’il en est, les chansons tristes font du bien.
Chansons solides pour cœurs cassés Lors d’une rupture amoureuse, iln’estpas rare de segaverjusqu’à plus larmes de mélodies tristes, mouchoir en main. Le réflexe, bien que paradoxal, est humain. D’après le magazine Psychology Today, une étude menée à l’université du Kenta révélé les bénéfices des musiques éplorées en montrant que « lorsque des personnes étaient en proie à la tristesse, l’écoute d’une musique belle mais triste améliorait leur humeur ». La raison ? « C’est le plaisir de se faire mal. On veut s’approcher de la douleur. C’est une étape du deuil, explique Joseph Agostini, psychologue et psychanalyste. Les chansons d’amour ont toutes un noyau mélancolique et nous permettent de communier avec notre sensibilité. On ne peut pas écouter une chanson d’amour très forte si on a peur de nos émotions »
En somme, la chanson d’amour triste est un miroir limpide d’émotions pas encore clairement identifiées. Elle cueille l’éconduit qui, se sentant compris et entendu, est amené à extérioriser ses affects en toute
liberté, jusqu’au pathos le plus intense et sans crainte d’être jugé. Pas besoin de tricher.
Effet d’écho
Si elle moins lyrique et grandiloquente que la poésie, lachansontristerenouenéanmoinsavecleromantisme littéraire, apportant une note théâtrale aux sentiments intériorisés.
Brève, directe, incarnée par une voix, elle favorise l’indentification et permet de renvoyer chacun à sa propre expérience, ni de trop loin, ni de trop près. La chanson triste révèle à la fois un désir d’aimer et un besoin de certitude. Même cliché, l’émouvant appelle l’émotion.
Amoureux pétris
En moyenne, les Français connaissent deux grandes histoires d’amour dans leur vie En 2022, une enquête menée par Once révélait que 8 Français sur 10 croient au coup de foudre. Néanmoins, ces derniers se séparent plus, le nombre de ruptures ayant bondi de
 Amy Essoue Adama Gaye – 2de2
Amy Essoue Adama Gaye – 2de2
Il arrive que la musique transcende les genres, les lieux et les époques.
Le Jazz et le Blues sont des genres musicaux qui ont traversé les décennies avec une puissance et une influence inégalée Transcendant les barrières de genre, ils rassemblent hommes et femmes dans un esprit de tolérance, d'universalité et de soutien mutuel.
Le Jazz, en particulier, a été un catalyseur pour la promotion de l'égalité des genres, offrantaux femmes un prisme pour s'exprimer et montrer leur talent.
Bessie Smith, Billie Holiday et Ella Fitzgerald ont marqué l'histoire de la musique depar leur talentmais
également les thèmes de société abordés dans leurs chansons. Les chansons comme "Strange Fruit" de Billie Holiday ont mis en lumière les horreurs du lynchage racial, tandis que d'autres chansons ont abordé des problèmes spécifiques aux femmes, tels que la violence domestique, le racisme et la discrimination Bien que le Jazz et le Blues aient évolué au fil du temps, leur influence continue de se faire sentir dans la musique contemporaine. De nombreuses artistes féminines contemporaines s'en sont inspirées, telle Amy Winehouse.
Page 31
63 %, depuis les années 1990. Si les chiffres témoignent d’une certaine universalité de la question, que les amants déçus se rassurent… La colère, le chagrin ou la nostalgie ne sont pas l’apanage des ruptures amoureuses. Même les cœurs heureux écoutent des chansons tristes Souvent, « il y a des ombres dans Je t’aime » (Jean-Jacques Goldman)

Adrien Guebey – 1ère3
Ou la gent féminine vue à travers les paroles des chansons
Vous avez probablement déjà entendu votre mère râler enentendantlesparolesdurapquevousécoutezàfond la caisse dans votre chambre. « Quelle vulgarité ! », clame-t-elle régulièrement. Et souvent à juste titre. Car en effet, le rap d’aujourd’hui a tendance à dénigrer, ou plutôt réduire à certaines facettes la femme. De quoi choquer les aînés
Nous partons de très loin, plus précisément du Moyen Age. Sujet majeur artistique, la femme était vantée ; symbole de pureté, son éloge était de premier plan Les siècles suivants emboîteront le pas.
Les chants décrivent souvent un amour pur dont la femme, presque intouchable, est l’objet. Il faut attendre le XIXe siècle et avec lui la modernisation de la société pour qu’une culture populaire émerge et se propage Parmi la musique populaire du XXe siècle, après le rock et le reggae, c’est le rap qui éclot Le genre se voit rapidement dominé par une dimension profondément misogyne, objectivant la femme sans pudeur. Il suffit de voir un clip de rap américain pour comprendreletopo…Lesfemmesapparaissentcomme un trophée, belle, sexy et souvent dénudée.
La principale raison, c’est la commercialisation, la recherche de buzz Le sexe fait vendre, paraît-il… Toutefois, ilexiste des rappeurs quin’exploitentpas ce filon, tels Mac Miller ou encore Luv Resval en France. Si, de manière générale, le rap exploite la femme, il arrive que la femme exploite le rap.
Nicki Minaj en est l’incarnation parfaite Fondamentalement ambivalent, le rap surfe sur les clichés. Féminins, d’abord ; masculins, ensuite. En effet, grosses voitures et liasses de billets ne sont jamais très loin

Liesel Wang – 1ère3
« Non,non,moncheramour,jenevous aimaispas! »,Cyrano de Bergerac.
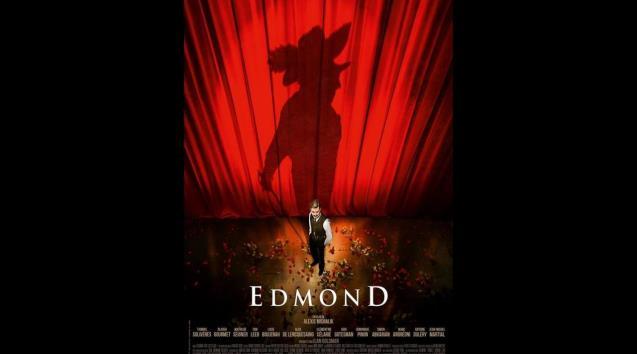
Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
A la cour d’Athènes, Egée impose à sa fille Hermia comme mari Démétrius alors qu’elle aime Lysandre. Les amants se réfugient dans la forêt, poursuivis par Démétrius. La forêt est en fait le royaume de tout un peuple d’elfe et de fée.
Roméo et Juliette de William Shakespeare
En Italie, à Véron, les Montaigu et les Capulet se haïssent. Lors de la rencontre entre Roméo Montaigu et Juliette Capulet, ils tombent follement amoureux. Néanmoins, leurs deux familles sont rivales depuis des générations
Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac, un mousquetaire complexé par
son nez, est amoureux de sa cousine Roxane. Elle aime le beau mousquetaire Christian de Neuvillette. Le physiquemanque chezCyrano etl’intelligence n’y est pas chez Christian. Roxane et Christian engagent donc une correspondance dans laquelle Cyrano intervient de manière significative. Un triangle amoureux tragique
Savannah bay de Marguerite Duras
« Tu ne sais plus qui tu es, où tu es, sont tes enfants, tu ne sais pas quoi jouer, ni qui tu dois jouer mais tu sais que tu dois jouer et que la salle a payé. Tu es la comédienne de théâtre, la splendeur de l'âge du monde, son accomplissement, l'immensité de sa dernière délivrance.
Tu as tout oublié sauf Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay c'est toi. »
Le Cid de Pierre Corneille Rodrigue et Chimène sont sur le point de se marier mais une grave querelle oppose leurs pères : à la suite d'une rivalité, le Comte, père de Chimène, gifle Don Diègue, père de Rodrigue.
L'affrontnepeutêtreréparéqueparlamortduComte, mais Don Diègue, trop vieux, remet son épée à Rodrigue pour venger son honneur. Rodrigue doit alors faire face à un douloureux dilemme : perdre Chimène ou son honneur.
Ondine de Jean Giraudoux
Ondine, fille des eaux, confiante dans la puissance de l'amour qu'elle éprouve pour le chevalier Hans von Wittenstein zu Wittenstein, accepte le pacte du roides Ondins : elle partira et vivra son amour humain, mais, si Hans la trahit, il mourra et Ondine retournera au Lac, perdant jusqu'au souvenir de son existence terrestre.
On ne badine pas avec l’amour d'Alfred de Musset
Perdican revient au village de son enfance où il doit épouser sa cousine Camille, mais la jeune fille, tout juste sortie du couvent, est prévenue contre l’amour. Par dépit, Perdican séduit alors Rosette, une petite paysanne, et dans un décor de fraîcheur bucolique. L’orgueil de Perdican et Camille va leur empêcher de déclarer leur amour.
Andromaque de Jean Racine
La guerre a réduit la ville de Troie en cendres et ses héros sont morts. Mais leur souvenir reste au cœur d’un enchaînement passionnel : Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, quirestefidèleàsonpremierépoux,tombéaucombat.
Orphée de Jean Cocteau
Eurydice, épouse d’Orphée,meurtd'une morsure d’un serpent. Déterminé à la récupérer, Orphée se rend aux Enfers, le pays des morts. Eurydice ne reviendra des Enfers qu'à condition qu'Orphée, son bien-aimé qui vient la chercher, ne la regarde pas avant d'être sorti du royaume des morts. Mais ce qui devait arriver... arrivera. Pourquoi diable Orphée s'est-il retourné ?

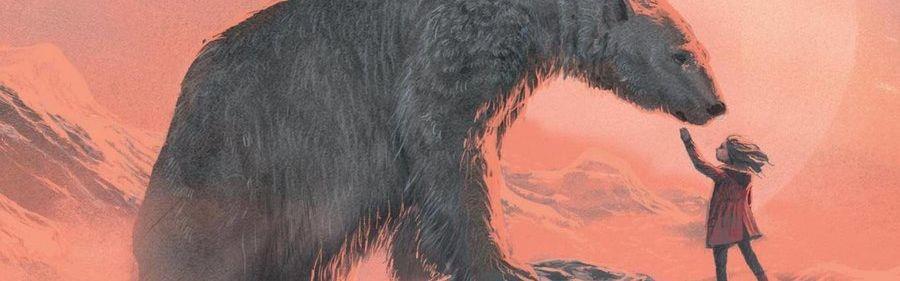
Notre top 10 des livres à bouquiner, au gré des envies, est de retour. Le thème de cette année ? Le meilleur de la nature humaine dans la littérature.
Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa : Lorsque la personne qui partage un court moment avec nous, éclaire toute notre vie.
Robinson Crusoé, Daniel Defoe : Quand il ne nous reste plus que l’ingéniosité, la persévérance et le courage pour survivre sur une île sauvage.
Le tatoueur d’Auschwitz, Heather Morris : Un homme bon qui, telle une bougie dans l’obscurité, illumine et aide ses prochains dans un endroit inhumain et cauchemardesque
Le Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien : Combattez en héros en faveur du bien dans un monde épique pleins de créatures magiques et maléfiques.
La métamorphose d’Helen Keller, Margaret Davidson : La biographie inspirante d’une jeune fille sourde et aveugle qui a changé la vie de millions de personnes.
Le Rouge et le Noir, Stendhal: « J’ai assez vécu pour voir que différence engendre haine. »
Le passeur, Lois Lowry : Dans une société censée être parfaite, seul le passeur possède les souvenirs d’une vie pleine de couleuravantqu’elle ne soit régie par des règles strictes et ternes. Jonas, 12 ans, est le nouveau passeur…
La rue qui nous sépare, Célia Samba : Noémia, étudiante et Tristan, sans abri, se plaisent, et ils vont apprendre à s’aimer malgré le froid instauré par la société.
Le chevalier à l’armure rouillée, Robert Fisher : Une aventure personnelle métaphorique sur la découverte de soi et l'importance de lâcher prise.
April et le dernier ours, Hannah Gold : Une amitié indéfectible entre un ours et une jeune fille, seuls, sur une île du cercle polaire.
Page 32
Lou Vonnet– 1ère4
Qu’elles soient autrices ou lectrices, la gent féminine est plus férue de romans policiers que les hommes. Les femmes seraient-elles dangereuses ?
C’est un fait, les femmes lisent le plus. Leur taux de lecture est de 93% contre 89% des hommes. En 20203, leprofildesgrandslecteursdelivrespapierrestaitcelui de la femme, diplômée, assez âgée. Parmi les genres littéraires les plus plébiscités, règne le roman policier… 70% des lecteurs des polars sont en réalité des lectrices.
Quand la fiction rejoint la réalité
De nombreux arguments expliquent l’engouement féminin pour les romans policiers. Selon certains spécialistes, lors de meurtres, les femmes passent généralement moins à l’acte que les hommes (en
moyenne dix fois moins) mais, lorsqu’elles le font, elles le font mieux ! Les meurtres féminins sont donc généralement plus inventifs et sophistiqués, à l’image des romans policiers
De même, dans le polar, la réalité rejoint souvent la fiction. Par exemple en Europe, les meurtrières se rabattent sur les armes blanches ou l’étranglement et aux Etats-Unis, sur les revolvers… comme le font aussi les romancières dans leurs intrigues. Les assassines tuent principalement leurs proches dans les livres ou dans la réalité, et, comme elles font rarement le poids physiquement, il leur faut développer toutes sortes de stratagèmes pour compenser leur force moindre et s’arranger pour que leur victime se retrouve sans défense : donnant un aspect plus complexe à l’histoire.
Enfin, il ne faut pas non plus oublier que les romans policiers au féminin se sont développés dans une période d’activisme où l’on se battait pour les droits des femmes et, en général, les écrivaines sont plus engagées sur les questions sociétales tel que le sexisme car elles sont plus touchées.
Un besoin cathartique
Alors que les écrivains de polars écrivent souvent sur un héros solitaire, les écrivaines utilisent l’entourage
du ou de la détective afin qu’il soit plus riche, réaliste ou complexe. Les intrigues, souvent psychologiquementpluscomplexe,répondentdoncau besoin des lectrices, non pas de sang et de violence mais d’identification et de catharsis.
En effet, le genre littéraire permet de se mettre à la place du héros ou de l’héroïne mais aussi de son antagoniste, à savoir le meurtrier. Deux points de vue qui poussent les lectrices à se poser des questions sur le bien et le mal, les limites morales, elles-mêmes… Cela explique le succès retentissant d’autrices telles qu’Agatha Christie dont les ventes atteignent environ quatre milliards de livres dans le monde.


Jacob Laugier-Claude – Tale1
Publié en 2006, l’ouvrage de Virginie Despentes compte comme l’un des essais majeurs de la pensée féministe contemporaine.
King Kong Théorie, c’est le récit d’une femme, Virginie Despentes, qui s’est octroyé le pouvoir de braver tous les interdits sociétaux.
Son écriture directe, rythmée, choquante en constitue la traduction parfaite et met en lumière un parcours atypique
Dansce livre,Despentes raconte son internementen hôpitalpsychiatrique à 15 ans, son viol à 17, son adolescence bercée par la culture punk-rock ou encore ses expériences de prostitution occasionnelle. La puissance d’un tel récit réside avant tout dans sa capacité à raconter la position de soumission au sexe masculin, le « sexe susceptible », auquel la femme est constamment ramenée.
Lorsqu’une femme est trop âgée ou trop laide, on lui fait savoir qu’elle doit être exclue en société ; lorsqu’elle se fait violer, on la contraint à se taire, à relativiser et à souffrir en silence, c’est « Damoclès entre les cuisses ». Lorsqu’elle se prostitue, au cœur d’une société où la femme esthypersexualisée, on la marginalise car elle a refusé de jouer le rôle de la « femme respectable » qui laisse le domaine du désir et du pouvoir aux hommes. C’est toute une série de chaînes, créées par les hommes, pour les femmes, que Virginie Despentes met en lumière.
L’originalité de son analyse tient aussi dans le fait qu’elle dénonce un « affaiblissement consenti » des femmes, et surtout des haut-placées qui ont su se hisser en haut de l’échelle sociale en acceptant de « courber l’échine et sourire sous la domination » du plus fort. Or, Virginie Despentes appelle précisément à s’affranchir du rôle que chacun,
homme comme femme, se voit attribuer selon son sexe. Elle écrit : « Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette (...) et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth. » Autrementdit, Despentes rêve d’une société à l’image de la figure de King Kong dans le film éponyme, « métaphore d’une sexualité d’avant la distinction des genres (...) au-delà de la femelle et au-delà du mâle (...). Hybride, avant l’obligation du binaire. » Pour y parvenir, il faut encore acter l’émancipation féminine mais aussi masculine, dépasser le mensonge machiste de « l’éternel féminin » Rompre l’épée de Damoclès, c’est comprendre le système en place pour le renverser.Etpourentrevoirsesrouagessousunnouvelangle,ilfautlireDespentes.
Dans le texte
« J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires : je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerais ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. »
33
Historien spécialiste de l’histoire de l’Islam, Adrien de Jarmy est venu parler de ses travaux de recherche aux élèves de Terminale en Culture générale. Nous avons pu l’interroger sur la question de la femme
Casse Ton Cliché (CTC) : Dans l’histoire du monde musulman, la place de la femme est-elle définie à partir du Coran ou en fonction des différents courants de pensées ?
Adrien de Jarmy : Le sujet est tellement vaste qu’il pourrait être l’objet d’un cours de semestre à l’université. Pour résumer ce sujet complexe, dans le Coran, la place de la femme est derrière l’homme, subordonnée à l’homme.
Pourquoi ? Parce que le Coran est un texte qui est le produitdesonépoque,l’Antiquitétardive.S’ilyabien des références à des figures d’autorité féminines, comme la reine de Saba, dont le royaume se serait étendu du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée, globalement, dans le Coran, la femme doit obéissance à l’homme.
CTC : Qu’en est-il de la législation ?
Adrien de Jarmy : Dans le Coran, il y a des éléments législatifs qui stipulent que la femme a le droit de contester et de revendiquer un certain nombre de choses, comme sa part de l’héritage par exemple. Mais, de façon générale, les droits des femmes sont plus restreints dans les sociétés médiévales comparées à aujourd’hui
La source de la loi n’est pas que le Coran néanmoins. Il y a également la tradition islamique, le hadith, qui témoigne des batailles juridiques autour des droits de la femme à travers les siècles
CTC : Sur la question du voile, que disent les textes ?
Adrien de Jarmy : Au Moyen Âge, le voile esttrès peu mentionné car… toutes les femmes le portent. Une femme ne se découvre pas. Cela fait partie de la bienséance. D’ailleurs, si vous regardez des représentations, des enluminures de l’époque en Europe, vous constatez que, d’une manière ou d’une autre, les femmes aussisontcouvertes. Lorsqu’elles ne le sont pas, il s’agit en général de représentations de la femme fantasmée, imaginés. Pour revenir au monde musulman, la question du voile se pose essentiellement à partir du moment où, en Europe, les femmes se découvrent. Si l’on peut identifier quelques rares textes à l’époque médiévale, lesécritssurcesujetsemultipliententrelafinduXIXe et le début du XXe siècle.
En Égypte, les savants de l’université al-Azhar débattent sur la question relativement tard, au regard de l’histoire du temps long.
CTC : Dans l’Islam médiéval, les femmes ont-elles le droit de divorcer ?
Adrien de Jarmy : Pour divorcer, traditionnellement, il faut prononcer trois fois de suite et à des moments espacés dans le temps, la formule du divorce, aussi appelée le « talāq ». Dans les premiers textes, les savants musulmans disent que c’est à l’homme de le dire. Plus tard, d’autres savants disent néanmoins que la femme a également le droit. Il est important de souligner que les débats sont vifs autour de la place de la femme et que celle-ci n’est pas figée. Dans l’Islam, il n’y a pas une place de la femme mais des question-

Louise Miniconi – 1ère5
Badinter au Panthéon
Mort le 9 février dernier, à l’âge de 95 ans, Robert Badinter entrera au Panthéon. L’annonce avait été faite à l’issue de l’hommage national rendu à l’ancien ministre de François Mitterrand.
Il refusa toute décoration de son vivant. Son corps rejoindra le Panthéon. La famille de Robert Badinter a en effet donné son accord de principe avant l’hommage national qui avait été rendu à l’ancien garde des Sceaux, en février dernier. Robert Badinter, né en 1928 à Paris, était un avocat, universitaire et homme politique français. Principalementconnupoursonengagementenfaveur de l'abolition de lapeinedemortenFranceenoctobre 1981 – « Monsieur Abolition » –, lors de son ministère sous la présidence de François Mitterrand. Badinter a défendu des causes importantes en tant qu'avocat, notammentdes affaires de justice pénale et les droits de l'homme. Son engagement politique fut, quantàlui, marquéparsoncombatpourla réinsertion des détenus, une série d’évolutions du code pénal et
sa lutte contre l’antisémitisme et l’homophobie. De.1986 à 1995, il présida le Conseil constitutionnel, puis siégea en tant que sénateur des Hauts-de-Seine jusqu’en 2011
Robert Badinter fut une figure éminente et respectée de la scène politique et juridique française. Véritable « conscience morale », il a rendu « la justice plus humaine, l’humanité plus juste », pour reprendre les mots d’Emmanuel Macron.
L’Abolition, Robert Badinter – Extrait
Je regardais l’horloge : il était douze heures et cinquante minutes, ce 30 septembre 1981. Le vœu de Victor Hugo –« l’abolition pure, simple et définitive de la peine de mort » était réalisé. La victoire était complète.
Page 34
nements, des évolutions nourries par les débats des savants ou encore les contacts avec les Européens. CTC : Dans le Coran, la question de l’égalité des droits se pose-t-elle ?
Adrien de Jarmy : Récemment, des courants comme le féminisme islamique ont eu tendance à soulever l’idée d’une égalité des droits entre les hommes et les femmes présente dans le Coran. C’est en fait une relecture un peu trompeuse d’un texte religieux qui date du VIIe siècle. Clairement,vousnetrouverezpasdepassagesoù il est écrit que la femme a les mêmes droits que l’homme. A l’inverse, il n’est pas spécifiquement écrit que l’homme est supérieur à la femme. Dans le texte, cette dernière lui doit cependant obéissance… C’est un trait de l’époque, voire des sociétés méditerranéennes, plus qu’un trait islamique à proprement parler.
CTC : Peut-on parler de misogynie au sens stricte ?
Adrien de Jarmy : C’est assez difficile. La misogynie est un terme qui relève de la morale. Or, le rôle de l’historien n’est pas de répondre à la morale mais d’analyser les sociétés à travers le temps. J’évite d’employer ces termes dans mes travaux. Toutefois, si l’on se penche sur le sujet à la lueur de nos sociétés actuelles, c’est de la pure misogynie, oui. Comme c’est le cas dans l’histoire du christianisme ou, pire encore, en Chine médiéval, où la place des femmes est encore plus réduite
Gabriel Leoveanu – 1ère5
Amazone, le mythe
Entre fantasme et réalité historique, il n’y a qu’un pas.
Les Amazones, ces guerrières légendaires de la Grèce antique, captive l'imagination depuis des siècles.
Libres, chastes et conquérantes, les Amazones constituaient dans la mythologie, un peuple fabuleux de femmes guerrières et cavalières.
Selon la légende, elles vivaient dans des sociétés exclusivement féminines, se battant avec autant de bravoure que les plus grands héros de l'époque. Leurs exploits, tels que leurs affrontements avec des figures mythologiques comme Héraclès et Achille, ont été narrés à travers les âges, alimentant le mystère et l'admiration pour ces guerrières.
Cependant, derrière le voile du mythe se cache une réalité historique plus complexe. Les preuves archéologiques et historiques suggèrent que les Amazones pourraient être basées sur des tribus nomades des steppes eurasiennes, où les femmes étaient parfois impliquées dans des activités militaires. Les récits mythologiques ont souvent exagéré leurs exploits pour des raisons dramatiques et symboliques. Pourquoi, alors, ce mythe en particulier ? Il existe plusieurs théories sur l'origine du mythe des Amazones. Certains historiens suggèrent qu'il pourrait refléter les tensions entre les sexes dans la société grecque antique, où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles domestiques. Les Amazones représentaient alors une inversion des normes de genre, incarnant la liberté et le pouvoir des femmes. D'autres théories avancent que le mythe des Amazones aurait pu servir à justifier l'expansionnisme grec en Asie Mineure, en dépeignant les peuples autochtones comme des ennemis redoutables à vaincre. Les Amazones restent un symbole de l'altérité, du pouvoir et de l’identité, toujours vibrant aujourd’hui
Déconstruction des expressions toute faite.

L’amour effeuille-t-il la marguerite ?
Je t’aime « un peu, beaucoup, passionnément… » et l’amoureux de croiser ses doigts, pour que le dernier pétale lui soit favorable ! Comme s’il existait des degrés dans l’amour, comme il en existe dans l’amitié (c’est mon meilleur ami ! »). On peut en douter, si l’on accepte de voir en l’amour un affect de nature essentiellement passionnelle. Or, si un sentiment peutêtre plus ou moins intense, si une émotion plus ou moins forte, une passion, quant à elle, est excessive, ou n’est pas une passion. « Toutes les passions sont exagérées, et elles ne sont passion que parce qu’elles exagèrent », écrivait Chamfort. On n’est donc pas « plus ou moins » passionné, et il ne semble exister, en ce sens, que « d’amour fou » La passion déborde toujours, elle n’est jamais tempérée : l’amant ne seraitil légitimement vexé par un « Je t’aime, mais avec mo-
dération » ?
Reste que, comme chacun sait, l’extase des débuts s’épuise avec le temps. Mais justement, est-ce la fin de la passion ? Pas vraiment, ou bien il ne s’agissait pas d’une vraie passion. Car s’il est une différence entre passion et désir, c’est bien que la passion, elle, s’inscrit dans la durée. Ne peut-on pas alors suggérer que nos passions s’entretiennent, comme s’entretient la flamme d’un bûcher ? Mais alors, ne sommes-nous pas toujours en partie responsables de nos passions ? Se demander pourquoi on aime l’autre permet-il de le savoir ?
« Mais qu’est-ce qu’elle lui trouve ? », vous demandez-vous peut-être, au sujet de la nouvelle liaison de votre ami(e). Allez savoir ! Et pour ça, demandez-le-lui : pourquoi l’aimes-tu ? Peut-être ne s’est-elle jamais posé la question, mais qu’importe, puisque l’amoureux « n’est pas comme les autres » Car il n’est pas absurde de supposer que nos choix amoureux ne sont pas raisons. N’est-ce pas ce que suggère Pascal, quand il écrit que « le cœur », lui aussi, « a ses raisons » ? Et de fait, n’importe qui ne tombe pas amoureux de n’importe qui. Ce qui le prouve, c’est d’ailleurs que nous avons chacun nos « critères » : Avoir trouvé le bon ou la bonne, n’est-ce donc pas avoir trouvé celui ou celle qui « coche toutes les cases » ? Peut-être, mais il arrive justement que l’on puisse rencontrer quelqu’un qui les coche toutes, ces cases, mais que l’on n’aime pourtant pas. C’est donc que les raisons proclamées de l’amour en sont peut-être moins les causes que les motifs. On voit la part d’irrationalité que comporte l’amour. Mieux : la part de liberté, au sens où l’acte réellement libre est celui qui, bien qu’il ne s’effectue
pas en dehors de toute condition (Sartre disait qu’il est toujours ensituation) n'estjamais causépar rien,sinon lui-même.
Peut-on être l’ami de son amant ?
Quoique l’on puisse déclarer aimer ses amis, l’amour ausenspropren’estpasl’amitié.C’est,d’abord,qu’on peut aimer d’amour sans être aimé en retour, là où une amitié non réciproque est moins probable. Bien plus, l’amitié n’est pas l’amour en ceci qu’elle est moins intense (l’ami ne se donne pas « corps et âme » mais sait rester mesuré dans sa générosité) et moinsexclusive(sil’amitiéestélective,onpeutquand avoir plusieurs amis) que la passion amoureuse. Enfin, l’amour implique la sexualité, que l’on exclut ordinairement de l’amitié. Il est donc probable que, si l’amour s’ajoute à l’amitié, l’amitié disparaisse. Toutefois, l’inverse est-il vrai ? Est-il que possible que l’amitié s’ajoute à l’amour, sans annuler l’amour ?
C’est fort probable, et même souhaitable, si l’on remarque que l’amitié authentique se caractérise aussi par le souci de bienveillance. Or, la bienveillance a ceci de spécifique qu’elle ne se réduit pas au souci de faire plaisir, mais qu’elle suppose d’être en mesure de regarder l’autre avec lucidité etde l’exhorter à devenir meilleur. Or l’amour seul repose bien souvent sur l’idéalisation d’autrui. C’est le thème stendhalien de la cristallisation : aimer passionnément, c’est projeter sur l’autre des qualités qu’il ne possède… pas toujours ! Dès lors, les amoureux qui se veulent du bien ne sont-ils pas ceux qui savent fuir la complaisance, pour se considérer aussi comme amis ?

Est-ce que le beau, c’est relatif ?
Qu’est-ce qui différencie un chef d’œuvre d’une production médiocre ? Petit éclairage sur la question.
À chacun ses goûts ! Et ce, qu’il s’agisse de cuisine ou d’art. Car affirmer que tout n’est pas relatif, que tel artiste vaudrait mieux qu’un autre, n’est-ce pas nier, bêtement, les différences de sensibilité ? N’est-ce pas aller contre l’évidence, chacun pouvant constater que son voisin n’a pas la même playlist sur Spotify ? Il semble qu’on puisse sans difficulté se ranger du côté de Voltaire, qui écrivait à l’article « Beau » de son Dictionnaire philosophique que « ce qui est de mode à Paris ne l’est pas à Pékin », exprimant ainsi la position du « relativisme esthétique » ... Prenons garde toutefois, en imaginant la situation suivante : apprenti dessinateur, vous décidez de croquer votre meilleur ami, avant de présenter votre travail à l’Académie des Beaux-arts. On vous écoute expliquer qu’il s’agit là d’un chef d’œuvre. Il n’est pas sûr qu’on vous fasse entrer…à juste titre ! Car il faut bien que certaines œuvres soient objectivement plus belles que d’autres, pour que l’art soit. Ou encore : si la beauté était vraiment relative, alors n’importe qui pourrait se targuer d’avoir réalisé un chef d’œuvre ; il lui suffirait, pour cela, de déclarer qu’il trouve, lui, son œuvre « magnifique ».
Mais pourrait-on, sans ridicule, soutenir que les chansons de Patrick Sébastien valent – esthétiquement parlant – les compositions d’un Ravel ? Évidemment non.
Ce n’est donc qu’hypocritement que nous défendons la relativité du beau, le jugementdegoût(«c’estbeau!»)ayanttoujours,commeleveutKant, « prétention à l’universalité ».
Et pourtant, nous n’avons pas tous les mêmes goûts. Problème Comment soutenir que la beauté n’a rien de relatif, tout en reconnaissant que nombre d’œuvres consacrées nous laissent franchement indifférents ?
En affirmant que le goût, la sensibilité esthétique s’éduquent. Que tout le monde n’est pas à même d’évaluer la beauté, comme l’esthète ou le critique qui ont beaucoup pratiqué, comparé, évalué. Ne peut-on pas raisonnablement admettre que leur œil et leur vue sont plus aiguisés, un peu comme le palais de l’œnologue est plus apte que d’autres à saisir avec « goût » la qualité d’un vin ?
Il est donc faux d’affirmer que tous les goûts se valent, comme il l’est sans doute de rabâcher qu’ils « sont dans la nature ». Car si le goût peut se raffiner, c’est qu’il s’éduque, et s’il s’éduque, c’est qu’il n’est pas inné, mais acquis. Autrement dit : la capacité à goûter le beau n’a rien à voir avec la nature qui ne nous fait pas même distinguer le beau du joli. Goûter la beauté véritable, cela a rapport à la culture, laquelle suppose un long et patient travail. Page 35
Mabrouk – 1ère5 &
Rosanna Pergament– 1ère2
Souvent incarnés par les femmes, les troubles du comportement alimentaire (TCA) touchent aussi les hommes. Lumière sur une maladie insidieuse et source de souffrance résolument plus masculine qu’on ne le croit.
« Si les femmes sont deux à trois fois plus touchées par les troubles du comportement alimentaire (TCA) que les hommes, ces derniers en souffrent et peuvent en mourir tout autant.
De plus, les chiffres sont donnés par les institutions de soins, et donc ne représente que les personnes diagnostiquées et soignées. On le sait aussi, seul un très faible pourcentage de personnes malades entament des démarches pour se soigner » L’expertise de Camille Cohen, psychologue clinicienne, est sans appel. Bien que minoritaires, les hommes sont aussi concernés par les TCA. De plus en plus de données soulignent l’augmentation des cas masculins. Récemment, une nouvelle étude britannique a confirmé cette tendance, avec une augmentation de 128 % d’hospitalisations entre 20152016 et2020-2021 chezles garçons etjeunes hommes
Si l'insatisfaction corporelle masculine peutse traduire par de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie, desTCAquitouchentlesfemmesdansdesproportions bien plus importantes, les hommes sont sujets à d'autres formes de TCA comme la bigorexie (dépendance au sport), ou dysmorphie musculaire. De « nouvelles formes masculines » de troubles alimentaires qui ont fait l'objet d'une partie d'une conférenceorganiséeparJeanVictorBlanc,psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) et enseignant à Sorbonne Université, en février 2023
Interrogé par le magazine GQ, le médecin explique, au sujetdeshommessouffrantdebigorexie : « L’accèsau soin se fait beaucoup plus tardivement que pour les femmes car il y a une certaine acceptation sociale de ces comportements, contrairement à l'anorexie où la prise de conscience de l'entourage de la personne

L’amitié homme-femme est-elle possible
Un débat vieux comme le monde, sur toutes les lèvres des jeunes...
Vaine pour certains et sûre pour d’autres, l’amitié entre les hommes et les femmes est l’objet de nombreux débats.
Pour éclairer ceux qui doutent de l’éventualité d’une amitié sincère entre les hommes et les femmes ainsi que pour satisfaire les curieux qui liront cet article, faisons le point.
Tout d’abord, l’amitié estunsentimentd'affection, de sympathie qu'une personne porte à une autre et qui n'est fondé ni sur les liens du sang ni sur la passion amoureuse. Beaucoup de personnes ne croient pas en une possible amitié entre les hommes et les femmes, ayant dans l’idée qu’une attirance physique finira par se créer d’un côté ou de l’autre. Résultat : certains évitent ces relations.
Un autre paramètre qui nuirait ou compliquerait ses amitiésestque,laplupartdutemps,lesfemmesentre-
intervient plus rapidement. Si vous faites beaucoup de sport et que vous êtes musclés, on va vous faire des compliments vous dire “Oh tu es vraiment en forme” ». Globalement,lediagnosticestplusdifficileàposerpour leshommessouffrantdecesmaladiesmentales,définies par des comportements ou des pensées sur une durée particulièrement longue et avec une intensité particulièrement forte
« On parle de maladie mentale quand les pensées et les comportements viennent altérer la santé physique et mentale de la personne qui en souffre », précise Camille Cohen.
En France, les TCA représentent la 3ème maladie chronique en importance chez les adolescentsquivivent une période de leur vie où les enjeux sont multiples et souvent source d'incertitudes. Une période qui oscille entre un besoin de repères et un besoin de les rejeter
Comment décrypter l’autre, de la tête aux pieds
Les cheveux : Ou la « parade capillaire ». Alors que l’homme a plutôt tendance à bomber le torse, la femme, elle, a plutôt le réflexe de jouer avec ses cheveux. En les rejetant en arrière, elle montre aussi son cou.
Les yeux : Le contact visuel soutenu et des regards fréquents peuvent indiquer de l'intérêt. Si les émotions sont intenses, la personne regardera vers le sol. Si, au contraire, elle n’éprouve pas d’intérêt, elle aura tendance à regarder au loin vers la droite ou la gauche pour sortir, littéralement, de cette situation.
A savoir… Une dilatation des pupilles peut être un signe d'attraction, mais difficile à constater
Les joues : Un léger rougissement peut trahir un certain embarras ou du plaisir. En tout cas, il trahit.
Le sourire : Un sourire spontané, sincère et chaleureux est de bon augure, contrairement aux sourires forcés ou crispés qui montrent une gêne.
Le corps : Quelqu’un à qui vous plaisez aura tendance à se rapprocher physiquement de vous, à vous laisser pénétrer dans « son espace ». De même, les effets de mimétisme corporel sont de bons signes.
tiennent leurs amitiés autour de discussions assez sentimentales alors que les hommes se rapprochent plutôt lors d’activités communes. Pourtant l’amitié fille-garçon peut être très enrichissante.Moinsteintéederivalité,ellepeutaussi permettre de mieux comprendre le sexe opposé et ainsi être plus à l’aise et compréhensif. Pour maintenir cette amitié sans aucune ambiguïté, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche dit, dans son livre Humain, trop humain publié en 1878 : « Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme ; mais pour la maintenir, il y faut peut-être le concours d'une petite antipathie physique ». Une étude réalisée en 2013 par l’université du Wisconsin tend à lui donner raison, la naissance de sentiments amoureux étant cité comme la deuxième cause de rupture d’amitié, après la distance géographique.
Page 36
Les bras : Les bras croisés indiquent une attitude fermée. Au contraire, lorsque les bras sont tendus, cela signifie que la personne est ouverte et accueillante.
Les pieds : Bouger ses jambes ou ses pieds nerveusement révèle souvent une anxiété.
Si dans la parade amoureuse, vous n’êtes pas sûr de la réciprocité, demandez à l’intéressé(e). La communication orale est encore le meilleur langage !

Avoir des frissons, des papillons dans le ventre, le cœur qui palpite… Tomber amoureux, c’est tout ceci à la fois mais pas seulement…
D’après le Larousse, quelqu’un qui tombe amoureux c’est une personne « qui aime quelqu’un d’autre, qui éprouve de l’amour ». Mais tomber amoureux ne signifie pas seulement avoir de l’attirance pour quelqu’un ni ressentir une forme de désir ou de complicité. C’est beaucoup plus que cela mais en même temps, c’est le tout fusionné.
D’après les neuroscientifiques, il suffirait de moins d’un cinquième de seconde pour tomber amoureux. Durant ce court laps de temps, les douze aires cérébrales du cerveau responsable du sentiment amoureux s’activent. C’est plus précisément dans les noyaux gris centraux, qui gèrent tous les comportementsautomatiquesducorpshumains,quele sentiment amoureux se développe
Les hormones y sont aussi pour beaucoup dans le développement sentimental. Les phéromones sont responsables de l’attirance sexuelle ; les neurotransmetteurs comme la dopamine et l’ocytocine concrétisentcesentiment.Eneffet,l’ocytocinetientun rôle important dans l’attachement envers les autres car elle procure une sensation de bien-être et vient renforcer la confiance en soi, mais aussi en l’autre. Mais tomber amoureux n’est pas seulement quelque chose de scientifique. Les ressentis s’expriment dans le corps mais aussi dans la tête. Soit un déferlement d'émotions méconnues, dans lequel on.. tombe.
De fait, l’amour est quelque chose d’inattendu, auquel on ne s’attend souvent pas. Pour autant, du point de vue de la psychologie, « l’élu(e) » n’est pas choisi au
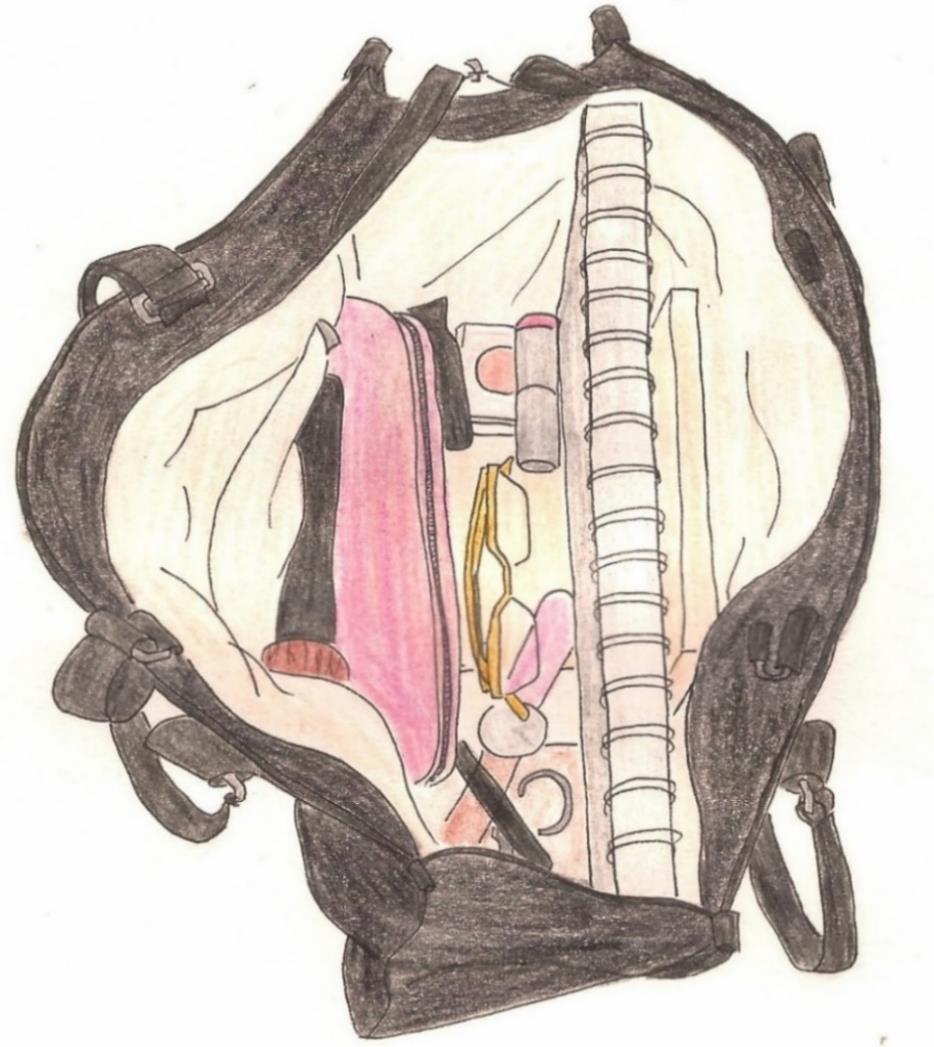 Victoria Olive – 2de3
Victoria Olive – 2de3
Les femmes disent souvent qu’elles ne peuvent pas vivre sans Retour sur un objet indispensable, lourd en symboles.
Le sac à main a toujours été un objet pratique, permettant de stocker tous les besoins d’une femme. À l’origine utilisé par les esclaves dans l’Antiquité pour porter les objets de leurs maîtres, le sac apparaît dans le quotidien au XIXe siècle. La cause de sa démocratisation ? Les vêtements féminins qui ne disposaient pas de poches. Les femmes portaient alors dans leur foyer un tablier mais quand ces dernières étaient mondaines, elles avaient besoin d’un objet à la fois beau est pratique. Sac à main, de soirée, « de Mary Poppins » … Audelà de transporter portefeuille, maquillage, parfum, pansements ou toute la maison, l’objet reflète aussi la personnalitédesfemmes,leuridentitéetleurintimité. En effet, son contenu incarne sa propriétaire et ses
besoins, réels, affectifs ou symboliques
Le sac n’est pas qu’un objet pratique, c’est « une expansion de soi, permettant d’affronter les difficultés quotidiennes tout en se portant garant de la mémoire intime » (Le sac, JC Kaufmann).
Oui, le sac à main est le gardien des secrets. C’est aussi un gage de sécurité, dans lequel « on met tout ».
Quid des It Bags ? Posséder les sacs en vogue permet aux femmes d’entrer dans un cercle restreint.
Ainsi, le sac à main incarne aussi la place des femmes dans la société
Si son usage se démocratise chez les hommes, il demeure néanmoins un objet résolument sexué. A l’image de la charge mentale, ce sont majoritairement les femmes qui le portent.
Page 37
hasard. Qu’ils soient inconscients ou non, les attirances et émotions se portent bien souvent sur des partenaires faisant écho à des personnes ayant joué un rôle impactant dans l’enfance, positif ou négatif. Au contraire, un manque ressenti étant petit(e) peut porter vers des personnes capables de combler cette carence. Pour faire simple, à travers le choc amoureux, ce sont deux névroses qui s’emboîtent.
Néanmoins, une relation amoureuse est toujours unique car chacun l’a construit en fonction de ses aspirations et desonindividualité.Certainschercherontquelqu’unqui pourra les compléter, en leur apportant le soutien ou l’affection dont ils ont besoin. Alors que d’autres chercheront un partenaire qui leur ressemble pour partager le plus de centres d’intérêts possibles.
Ina Penone – 1ère6 Oui, les hommes sont
Difficilement affiliables dans l’inconscient collectif, sensibilité et masculinité vont fondamentalement de pair.
Littéralement, la sensibilité est une caractéristique de l’être vivant qui réagit aux modifications de son milieu. Elle relève aussi de l’aptitude à s’émouvoir, à éprouver des sentiments d’humanité, de compassion et de tendresse. La masculinité, elle, répond à un ensemble de comportements stéréotypés instinctivement associés aux hommes.
La gent masculine est alors obligée de mettre en avant sa force, sa fermeté, sa vigueur ou encore son courage pour répondre à la fonction qui lui a été assignée dès le plus jeune âge et pour se sentir totalement intégrée socialement. En somme, le masculin ne passe pas par le sensible.
Des ruptures amoureuses plus douloureuses
Pourtant, des études montrent que les hommes ont, par exemple, plus dedifficultés à se remettre d’une rupture amoureuse, en comparaison des femmes. En 2015, une étude réalisée par l'université de l'État de New York à Binghamton et par University College London, comprenant un panel de 5705 volontaires à travers 96 pays, interrogés sur leurs histoires amoureuses et leur ressenti après leurs séparations montrent ceci : les femmes sont visiblement les plus touchées (la moyenne de leur douleur émotionnelle, notée entre 1 et 10 tourne autour de 6,84) que les hommes (6,58 en moyenne)
Bien que les femmes souffriraient plus émotionnellement au moment de la rupture, il serait plus facile pour elle de surmonter cette épreuve « Sur le long terme, ce sont les hommes qui ont le plus de mal à tirer les leçons de leurs échecs amoureux, se contentant de passer à autre chose sans se remettre en cause. Les femmes, elles, font davantage ce travail et déclarent au final sortir plus fortes émotionnellement de leurs ruptures amoureuses. », peut-on lire dans un article du Figaro
Si les hommes ne sont pas immédiatement touchés, ils souffrent plus de la rupture sur le long terme. « L'homme va ressentir de plus en plus profondément la perte au fur et à mesure qu'il intègre le fait qu'il doit se relancer dans la compétition pour attirer l'attention des femmes, pour remplacer ce qu'il a perdu. Cela peut être pire s'il comprend que la perte est irréversible », précise l’un des chercheurs de l’étude.
Lou Bilhouet – 1ère3
Œnologue et maître de chai trentenaire, Chloé Doublet nous parle de son expérience du monde du vin.
Casse Ton Cliché (CTC) : Pourquoi œnologue ?
Chloé Doublet : Depuis toute petite, je rêvais de devenir professeur des écoles. Au cours de ma troisième année de licence de biologie, j’ai dû choisir une option ; étant à Bordeaux, j’ai eu la possibilité de choisir une option sur la vigne et le vin, encadrée par des enseignants de l’école d’œnologie de la ville. J’ai été absorbée par cette filière. Etant également fille de viticulteur et sœur d’une œnologue, le chemin était finalement tracé
CTC : Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté dans ce milieu majoritairement masculin ?
Chloé Doublet : Premièrement,laforcephysiquequ’il a fallu que je déploie au cours de mes premières expériences dans un chai, car je n’étais pas sportive. D’autre part, lorsqu’on veut un peu d’autonomie, il faut s’affirmer, adopter une attitude ne laissant aucune ambiguïté afin de se faire respecter. Il faut aussi apprendre à se faire confiance et à bien s’entourer.
CTC : Avez-vous déjà ressenti le besoin de prouver davantage vos compétences parce que vous êtes une femme ?
Chloé Doublet : Oui,biensûr,aucoursdemesanciens postes et même encore sur mon exploitation familiale
CTC : Comment votre entreprise soutient-elle la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail ?
Chloé Doublet : Dans l’entreprise où je travaillais, cela est passé par le fait de m’avoir attribué un poste à grande responsabilité sans que je n’aie d’expériences similaires. Aujourd’hui, au sein de notre entreprise familiale, nous sommes deux femmes, deux sœurs) à la tête, en qualité de gérantes
De manière générale, la présence de femme dans les chais est plus fréquente dans la région bordelaise, à la différence de la Charente. Une femme à la tête d’un chai, c’est assez peu courantdans la région de Cognac. Néanmoins, de plus en plus de filles de viticulteurs reprennent les exploitations familiales et réussissent brillamment Il est important, selon moi, qu’elles témoignent afin de mettre en lumière leur travail.
CTC : Quels conseils donneriez-vous à une jeune fille qui souhaiterait travailler dans le vin ?
Chloé Doublet : Il va falloir s’armer de courage,

Dans le monde de la gastronomie, les hommes règnent sur les grandes tables
La tradition, cependant, est en pleine mutation.
En matière de gastronomie, chef est, traditionnellement, un métier d’homme. Depuis le mouvement de la libération des femmes des années 1970 cependant, les femmes investissent de plus en plus les cuisines étoilées. Les pionnières en la matière sont les « mères lyonnaises ». Dans les années 1920, ces femmes ouvrent leurs propres restaurants et participent à la renommée gastronomique de Lyon Parmi elles, Eugénie Brazier, aussi appelée « la mère Brazier » En 1933, elle est la première femme à décrocher les trois étoiles au guide Michelin. Il faut attendre un demi-siècle pour qu'une autre femme soit récompensée de la même manière. Elle a également formé le grand chef Paul Bocuse. De nos jours, bien que seulement 15 % des hommes cuisinentquotidiennementauseindeleurfoyer,selon
un sondageIFOPpubliéenoctobre 2020,ces derniers représentent 95 % des chefs étoilés par le célèbre Guide Michelin. En France, 52% des élèves des écoles de cuisine sont des filles, mais 94% des chefs sontdeshommes.Enmoyenne,lesbrigadescomptent 3 femmes pour 14 cuisiniers
Pourquoiunetelle différence? Engénéral, les cheffes talentueuses et déterminées telles qu’Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze ou Estelle Touzet ont suffisamment de caractère pour réussir en gastronomie, même si le machisme constitue un obstacle majeur. Pour les autres, elles se heurtent à un double standard : d'un côté, elles se font reprocher de ne pas être assez investies et de l'autre, les horaires et conditions de travail sont difficilement conciliables avec une vie de famille. Un véritable « choix de Sophie ».
Page 38
savoir se faire respecter et poser les bases, dès le début. Il faut aussi apprendre à déléguer, pour ne pas tout porter seule. L’autonomie totale est une façon d’avoir la paix, d’aller vers la « facilité » afin d’éviter toutes confrontations, d’avoir à donner des ordres à des hommes. Si c’est une manière de prouver qu’on mérite notre place, ce n’est pas une solution durable. Or, quand le pli est pris, il est difficile de revenir en arrière.
CTC : Comment envisagez-vous l'évolution de votre carrière dans les prochaines années ?
Chloé Doublet : Jesouhaitegarderunestructureàpetite échelle pour continuer à travailler en autonomie et faire mon vin, pour vivre pleinement ma passion.
CTC : Comment gérez-vous l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle dans un environnement aussi exigeant ?
Chloé Doublet : Là est la difficulté. J’ai justement dû faire des choix pour me recentrer sur moi-même, car je suisconvaincuequelaviepersonnelledoitprimer.Avec un bébé en route, je dois limiter le stress et la fatigue extrême
Laurine Zheng – 1ère3
La cerise sur le gâteau
Des mets aux noms plein de douceur, pour les becs sucrés
La madeleine : Elle porte le nom d’une cuisinière lorraine, Madeleine Paulmier, vivant au XVIIIe siècle. Elle aurait un jour sauvé un dîner donné par le Duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, dans son château de Commercy. Le dîner se déroulait à merveille, tandis que dans les cuisines, l'ambiance tournait mal entre l'intendant et le cuisinier au point que ce dernier partit en emportant le dessert avec lui. Madeleine Paulmier, qui était servante de la Marquise de Perrotin de Baumont, prépara alors à l’improviste des gâteaux en moulant de la pâte dans des coquilles Saint-Jacques.
La charlotte : Inventée au début du XIXème siècle, la Charlotte est un hommage à l’épouse du George III, la princesse Charlotte, grand-mère de la Reine Victoria. Antonin Carême, pâtissier et chef français, adapta la recette anglaise pour se rapprocher de la version actuelle.
Les Lao po bing (老婆饼) : Ou gâteaux de femme
L’une des légendes de ce gâteau raconte l’histoire d’un homme deChaozhouquiallaà Canton pour devenir un grand pâtissier. De retour chez lui, il fit goûter des gâteaux traditionnels de Canton à sa femme, qui trouvait qu’ils n’étaient pas aussi bons que les siens Ainsi, elle prépara ses propres gâteaux. Son mari en apportaàCantonpourlesfairegoûteràd’autresgrands pâtissiers, qui les adorèrent.


Le 8 mars – Dessin de Maxence Le Bris-Barbleu – 2de5
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, les élèves volontaires se sont prêtés à l’exercice suivant : définissez, en une phrase, la femme.
« Selon moi être une femme c’est incarner la diversité, la force, la résilience, et la créativité. Une femme est capable de tout »
« Être une femme, c’est ne pas craindre de s’affirmer devant les hommes »
« C’est être libre et autonome »
« Selon moi, être une femme est la meilleure des choses et pourtant la plus complexe. »
« C’est être libre de choisir par soi-même. »
« Être une femme, c’est disposer librement de son corps. »
« Être une femme c’est être une personne comme les autres »
« C’est quelqu’un de précieux qu’il faut préserver et respecter. C’est quelqu’un d’aussi intelligent qu’un homme et qui mérite tout autant que lui »
« C’est une force de la nature »
«C’estunêtreindépendant.»
« Une femme, c’est une beauté divine »
« Une femme, c’est l’égal de l’homme. »
« C’est chromosome XX. Vive les femmes ! »
« Une femme, c’est un être doté de la plus belle chose sur terre : la maternité »
« Une femme, c’est celle qui donne naissance à l’homme qui ne la considère pas. »
« Être une femme, c’est respecter les gens et se respecter soimême, c’est savoir assumer ses faiblesses, c’est avoir confiance en soi »
« Un être humain avec les mêmes droits que les hommes »
« C’est se battre pour ses droits »
« Une personne avec des émotions qui a le droit de s’imposer et de vivre indépendamment de l’homme »
« Une personne faisant partie d’un groupe représentant la moitié de la population et qui est la cible de multiples discriminations injustes. »
«C’estunehumainedevantêtrelibredes’exprimeretdefaire toutcequ’ellesouhaite.»
« Être une femme, c’est être forte, intelligente, combative, responsable »
« Une femme, c’est celle qui peut donner naissance à un homme. »
« En 2024, il est inexplicable que les femmes ne se sentent plus en sécurité dans les transports tard le soir ou quand elles portent des vêtements qui ne les couvrent pas entièrement. »
« C’est un être sensible qui a besoin de relations saines avec l’homme. »
« Une femme, c’est la moitié de la population. »
« Une femme, c’est un être humain avant tout. Tout simplement. »
Ton Cliché


Nota bene
Aux observateurs qui s’étonneraient de voir le nom de l’auteure de ces mots apparaître de temps à autre au cours de leur lecture, n’y voyez pas qu’une nécessité de « combler les trous » dans la maquette, couplé à un souci d’honnêteté intellectuelle.
Un grand bravo aux élèves qui ont participé à l’édition du journal de cette année, entre devoirs, leçons, DST et épreuves du Baccalauréat.
A tous ceux qui ont donné leur temps, savoir, regard, moments de vie mais aussi contacts et photographies, que ce soit parmi l’équipe pédagogique, les familles des élèves ou les personnes extérieures au lycée, un immense merci !
Une reconnaissance toute particulière est à adresser à M. Poher, M. Khallouk et Mme Pion pour leur confiance aveugle tout au long de l’élaboration du projet. Il en est de même pour l’accord de financement de cette impression papier, qui donne toute sa dimension au travail fourni par les élèves, encore une fois cette année.
Camille Barbesera consacré à « L’enfer, c’est les autres »
Rédacteurs, dessinateurs, photographes… Rejoignez l’équipe !