Article publié à l’origine dans Pathways, Automne 2023. Tous droits réservés 2023, Partenariat canadien du lymphœdème. Diffusé avec la permission de l’éditeur.
Adaptation : Anne-Marie Joncas – Graphisme : Catherine Boily

Article publié à l’origine dans Pathways, Automne 2023. Tous droits réservés 2023, Partenariat canadien du lymphœdème. Diffusé avec la permission de l’éditeur.
Adaptation : Anne-Marie Joncas – Graphisme : Catherine Boily
Après une semaine de chaleur record en Europe et en Amérique du Nord, causée par des vents inhabituels et par le phénomène climatique El Niño, l’influence croissante du changement climatique d’origine humaine est à nouveau mise en évidence. Nous sommes confrontés à des problèmes croissants à l’échelle mondiale en raison de l’augmentation des températures et des changements associés aux phénomènes météorologiques, à l’humidité, etc.2 En parallèle, le nombre de décès en Europe (et probablement ailleurs dans le monde) a augmenté en raison de la hausse des températures maximales et moyennes. Les personnes présentant des troubles cardiovasculaires et respiratoires préexistants sont particulièrement vulnérables3 et la propagation potentielle du lymphœdème lié à la filariose est particulièrement préoccupante.1
Cet article s’appuie sur trois articles récemment publiés dans le Journal of Lymphoedema et Wounds International, portant sur l’impact du climat sur les personnes atteintes d’œdèmes et de lymphœdèmes chroniques et sur les recherches entreprises par Susan Witt, doctorante à la Flinders University, qui travaille actuellement à la clinique Foeldi en Allemagne avec le professeur Thomas Dieterle. Pour plus de détails sur les résultats et les propositions avancées, nous vous invitons à lire les articles originaux. Ce résumé vous donnera une idée de la situation actuelle, des connaissances acquises et de ce que nous (et vous) pourrions faire pour changer le cours des choses !
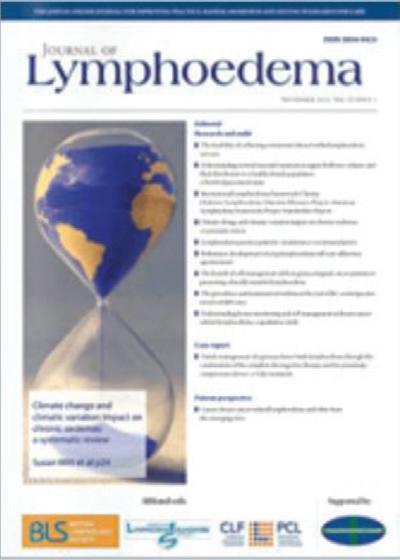
La chaleur et l’humidité peuvent être un problème pour chacun d’entre nous, mais lorsque le système lymphatique est endommagé ou dysfonctionnel, vous pouvez être particulièrement vulnérable à l’aggravation de l’œdème ou du lymphœdème. Cela peut aller du ressenti subjectif de la
tension, de la douleur, de la lourdeur, etc., aux constats objectifs, comme l’augmentation du volume et de la taille des membres, en passant par les problèmes fonctionnels déterminés par les facteurs précités.
La question qui s’impose est la suivante : pourquoi ? Cela tient en gros à une augmentation de la charge vasculaire superficielle associée aux tentatives de l’organisme de maintenir l’homéostasie de la température et à l’incapacité du système lymphatique de gérer cette charge. Il en résulte une accumulation non seulement de fluide, mais aussi des éléments qu’il transporte et pouvant inclure des bactéries et leurs déchets, des médiateurs inflammatoires et une variété d’autres molécules. Ce qui peut favoriser le développement ou la progression du lymphœdème. Le ralentissement de la circulation de la lymphe peut en outre accroître le risque d’infection en raison de l’incapacité du système lymphatique à se défendre normalement contre les bactéries.
Avec l’impact du climat et des changements climatiques qui devraient entraîner une augmentation des températures et des phénomènes météorologiques défavorables, une meilleure prise de conscience de la situation à venir et de son impact probable, et surtout de ce que nous pouvons tous faire pour atténuer les difficultés auxquelles seront confrontées les personnes atteintes d’affections comme l’œdème chronique et le lymphœdème, apportera un soulagement aux patients pour les années à venir.

Examinons quelques-uns de ces articles et voyons où ils peuvent mener nos réflexions et la recherche. Certains extraits
Les études futures portant sur une variété de populations saines et de populations atteintes de lymphœdème permettront de mieux comprendre l’effet des variations climatiques saisonnières sur la taille, le volume et la distribution des fluides au niveau des membres supérieurs.
de ces articles sont reproduits ci-dessous (avec l’autorisation d’Omnia Med). Vous pouvez accéder aux conclusions complètes des articles originaux dans la liste des références.
L’œdème chronique est un problème majeur à travers le monde, qui pèse lourdement sur les services de santé et a un impact majeur sur la qualité de vie des patients. Comme il n’existe pas de remède, l’objectif premier du traitement est de gérer les symptômes et de prévenir la détérioration. Le traitement de référence demeure l’utilisation continue de la thérapie par compression au moyen de vêtements compressifs et de bandages multicouches. D’autres traitements, comme le drainage lymphatique manuel, les soins de la peau, l’exercice et la thérapie au laser, sont également appliqués régulièrement. L’augmentation des températures liée aux changements climatiques est bien documentée, alors que les scientifiques prévoient une hausse de 1,5 à 2,5 % des températures moyennes dans le monde d’ici à 2050. À cela s’ajoutent la proportion croissante de populations occidentales frappées d’obésité et les liens probables entre le poids, la surface corporelle et la thermorégulation. On estime que cette situation posera des défis importants pour la prise en charge continue des œdèmes chroniques. Les températures plus élevées et une humidité accrue entraînent un malaise supplémentaire et des difficultés exacerbées quant au port de vêtements compressifs.
L’observance des recommandations de base en matière de traitement peut s’en trouver amoindrie, ce qui se traduit par une augmentation de l’enflure et une mauvaise prise en charge des symptômes. Il en résulterait un risque accru d’infection.
Dans une étude préliminaire, Witt et coll, (2021) ont recherché dans plusieurs bases de données des preuves de l’impact des conditions climatiques sur l’œdème chronique en appliquant le protocole PRISMA. Ont été retenues les études portant sur la population générale (adultes et/ou enfants) présentant un œdème chronique des membres dû à un lymphœdème primaire ou secondaire, un lipœdème, un éléphantiasis, une insuffisance vasculaire, un traumatisme ou toute autre affection entraînant un œdème chronique. Au total, 3 536 études ont été identifiées et examinées, mais seuls cinq articles répondaient aux critères d’inclusion.
Les articles se répartissaient en trois grandes catégories : difficultés liées aux vêtements compressifs, changements
Les températures plus élevées et une humidité accrue entraînent un malaise supplémentaire et des difficultés exacerbées quant au port de vêtements compressifs. L’observance des recommandations de base en matière de traitement peut s’en trouver amoindrie, ce qui se traduit par une augmentation de l’enflure et une mauvaise prise en charge des symptômes. Il en résulterait un risque accru d’infection.

physiologiques et crises de filariose saisonnières. Malgré les termes de recherche généraux relatifs à l’œdème chronique, tous les articles retenus concernaient le lymphœdème. Les populations étudiées comprenaient le lymphœdème relié au cancer du sein, le lymphœdème lié à la filariose lymphatique et, plus particulièrement, le lymphœdème des membres inférieurs. Les recherches citées ont été menées dans des climats tempérés (Sydney en Australie et Japon), des climats tropicaux (Townsville en Australie et Ghana) et des climats continentaux (Alberta, Canada). Les résultats ont révélé un lien entre les températures plus élevées et les symptômes du lymphœdème. Cependant, le nombre limité d’études effectuées dans ce domaine ne nous permet pas de tirer des conclusions sur l’impact global. Alors que les indications qualitatives ont mis en évidence une corrélation claire avec un climat plus chaud, les mesures physiologiques n’ont pas clairement démontré la même tendance. Nous en avons conclu qu’il faut davantage de preuves quantitatives et qualitatives concernant les variations climatiques et l’œdème chronique. Il est fortement recommandé de poursuivre les recherches à ce sujet. Mais qu’en est-il de l’influence sur les personnes qui ne souffrent pas d’œdème chronique, de lymphœdème ou d’autres problèmes cardiovasculaires ? Qu’en est-il pour la population « normale » ? Matthews et coll. (2021) ont entrepris une étude portant sur une population de femmes en bonne santé vivant à Townsville, dans le Queensland, en Australie. Ils ont relevé des différences marquées concernant la taille des membres, la somme des circonférences anatomiques étant significativement plus importante au printemps qu’en été et en hiver. En outre, la plupart des mesures circonférentielles au niveau des repères anatomiques étaient plus importantes au printemps ! Nous pensons que cette variation peut indiquer que la taille des membres augmente lorsque les conditions climatiques changent et que les températures et les niveaux d’humidité commencent à croître.
Aucune modification significative du volume des membres ou de la répartition des fluides n’a été identifiée lors de la comparaison de trois niveaux d’inconfort différents selon l’indice d’inconfort de Thom.
Là encore, d’éventuelles recherches portant sur diverses populations saines et populations atteintes de lymphœdème permettront de mieux comprendre l’effet des variations
climatiques saisonnières sur la taille, le volume et la distribution des fluides au niveau des membres supérieurs.
Une autre étude a été réalisée pour vérifier les rapports généralement anecdotiques qui suggèrent que la chaleur et le temps chaud peuvent provoquer une exacerbation du lymphœdème relié au cancer du sein (LRCS).5 Cette étude australienne a examiné la relation entre les variations climatiques saisonnières et la taille des membres, le volume, la distribution des fluides et le diagnostic chez des femmes ayant subi un traitement contre le cancer du sein. Les candidates âgées de plus de 35 ans ayant subi un traitement contre le cancer du sein ont été invitées à participer à l’étude. Vingt-cinq femmes âgées de 38 à 82 ans ont été recrutées. Soixante-douze pour cent de ces survivantes avaient subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie dans le cadre de leur traitement.
Le diagnostic de lymphœdème a toutefois varié d’une participante à l’autre tout au long de l’année. Ce constat a des répercussions importantes sur la mise en œuvre/le début du traitement et la prise en charge.
En trois occasions, les participantes se sont prêtées à des mesures anthropométriques, circonférentielles et de bioimpédance, ainsi qu’à un sondage, soit en novembre (printemps), en février (été) et en juin (hiver). Les critères de diagnostic, à savoir une différence de >2 cm et de >200 ml entre le bras atteint et le bras non atteint, ainsi qu’un rapport de bioimpédance positif de >1,139 pour le bras dominant et de >1,066 pour le bras non dominant, ont été appliqués aux trois prises de mesures.
Il est intéressant de noter qu’aucune corrélation significative entre les variations saisonnières du climat et la taille, le volume ou la distribution des fluides pour les membres supérieurs n’a été observée chez les femmes diagnostiquées ou à risque de développer un LRCS.
Nous avons conclu qu’il n’y avait pas de variation statistiquement significative de la taille des membres, du volume ou de la distribution des fluides dans cette population entre le printemps, l’été et l’hiver, bien que des tendances liées à ces valeurs aient été observées.
Le diagnostic de lymphœdème a toutefois varié d’une participante à l’autre tout au long de l’année. Ce constat a des répercussions importantes sur la mise en œuvre/le début du traitement et la prise en charge.
Encore une fois, des recherches plus approfondies sur une plus grande population dans différents climats sont nécessaires pour analyser le sort des femmes en ce qui concerne le LRCS. L’utilisation de critères de diagnostic clinique communs
pour cette recherche n’a pas abouti à une classification diagnostique cohérente du LRCS parmi les participantes à cette étude, ce qui peut également poser problème. Il s’agit d’un problème que nous devrions tous essayer de résoudre.
Il s’agit maintenant de mener d’autres études impliquant non seulement les patients, mais également les groupes de soutien, les thérapeutes du lymphœdème, les experts en changement climatique, les experts en données spatiales et les spécialistes de la météorologie, de la biologie, de la médecine clinique et expérimentale, afin d’utiliser une approche méthodologique solide pour étudier l’interaction entre le climat (et ses changements), la santé et la maladie.
L’une des premières étapes du processus est l’évaluation de patients atteints de lymphœdème pendant un an, à de multiples occasions au cours de chaque saison déterminée, à l’aide d’outils subjectifs tels que le LYMQOL et d’évaluations objectives des fluides par Sozo (une forme de mesure par bioimpédance), et des tissus fibreux au moyen de l’indurométrie/fibronométrie, le tout mené dans un certain nombre de pays à travers le monde, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie, tropicale et tempérée. Une autre étape à mettre en place dès le début est de constituer des groupes de discussion avec des patients atteints de lymphœdème et d’en apprendre davantage sur leurs expériences personnelles, ainsi que l’impact positif ou négatif du climat alors qu’ils vivent avec un lymphœdème ou un œdème chronique. Ainsi, nous pourrons ensemble aider tous ceux et celles qui en sont atteints ou qui risquent de l’être à mieux composer !
Tous ces acquis peuvent nous aider à mieux adapter et à mieux appliquer les approches de gestion du lymphœdème, à développer de nouveaux tissus assurant une meilleure ventilation et évaporation et à mieux éduquer les patients et les professionnels, dont l’importance a été reconnue par le prix de finaliste décerné par le Conseil des premiers ministres sur le changement climatique en Australie-Méridionale.6
Susan Witt est doctorante et chercheuse au département de recherche clinique sur le lymphœdème de la Flinders University, au Collège de médecine et de santé publique de la Flinders University et à la Foeldi Clinic, à Hinterzarten, en Allemagne.


Neil Piller Ph. D est le directeur du département de recherche clinique sur le lymphœdème de la Flinders University, au Collège de médecine et de santé publique de la Flinders University en Australie-Méridionale.

1. Aberdour, S Piller, N, Climate change, global warming and lymphoedemas. Journal of Lymphoedema 2015 10(1) 5
2. Cuff, M. A week of record-Breaking heat, New Scientist 3447 15th July 2023 p. 8
3. Ly, C. Death toll of 2022’s heat waves in Europe finally pinned down, New Scientist 3447 15th July 2023 p 9
4. Matthews, M Gordon, S Witt S and Piller N Understanding normal seasonal variations in upper-limb size, volume and fluid distribution in a healthy female population: a North Queensland study Wounds International 2021 12 (2) 28-33
5. Phillips, J Witt, S Piller N Gordon, S Seasonal Variation in Upper Limb Size, Volume, Fluid Distribution, and Lymphedema Diagnosis, Following Breast Cancer Treatment LYMPHATIC RESEARCH AND BIOLOGY, 2023 DOI: 10.1089/ lrb.2022.0017
6. Witt, S Dieterle, T and Piller, N, Climate and climatic variation impact on lymphoedema 2022 www.environment.sa.gov. au/climate awards.
7. Witt, S, Watt B, Gordon S and Piller N. Climate change and climatic variation impact on chronic oedemas: a systematic review. Journal of Lymphoedema, 2021, 161 (1) 24-32