méthode de français
3 C’est parti !
Magdalena Sowa
Marlena Deckert
Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

COMMUNICATION
Raconter des évènements passés
Tableau des contenus
LEXIQUE
Le vocabulaire relatif au bénévolat : formes, activités, institutions
Présenter l’/les auteur(s) d’une invention
Parler de précurseurs d’une invention – présenter des événements antérieurs
Parler de changements dans nos modes de vie
Fournir des informations sur une personne, un objet, un endroit, un phénomène
Parler de l’influence de différents facteurs sur la qualité de la vie humaine
Le vocabulaire lié aux inventions en sciences exactes : objets, activités, gens
Parler de ses projets professionnels
Présenter un métier/un professionnel
Décrire des qualités professionnelles
Exprimer une obligation, une nécessité, un souhait
Le vocabulaire lié au bien-être et au mal-être
Le vocabulaire relatif aux activités des entreprises, métiers et postes de travail, qualités professionnelles
GRAMMAIRE
L’emploi du passé composé et de l’imparfait
L’infinitif passé
Les conjonctions de temps pendant : il y a, pendant, pour, dès que, au fur et à mesure
La place des adverbes au passé composé
La voix passive
Le plus-que-parfait
Le participe présent
La nominalisation
Les expressions de temps (temps de discours et temps de narration)
Les pronoms relatifs simples : qui, que, dont et où
Les pronoms relatifs composés : pour qui/pour lequel, etc.
Les pronoms relatifs composés contractés : auquel, auxquels, à côté desquels, etc.
L’accord du participe passé avec le verbe avoir
Le subjonctif présent
Le masculin et le féminin des adjectifs et substantifs exprimant les métiers et les qualités professionnelles
CIVILISATION
Le service civique en France
La mode : la biographie de Coco Chanel
La littérature : l’interview avec Marie NDiaye
Les inventions des grandes civilisations : européenne, chinoise, arabe
Les personnes célèbres liées à la réalité tchèque et française
Les associations pour promouvoir le bien-être
La vie étudiante en France
Le bac et le BTS en France
« Métro, boulot, dodo »
Tableau des contenus
COMMUNICATION
Faire des projets d’avenir
Exprimer des hypothèses
Exprimer la simultanéité
Demander/Questionner poliment
Accepter ou refuser poliment
Remercier
Conseiller
Présenter un problème et expliquer ses causes
Proposer des solutions
Rapporter les paroles de qqn
Interroger
Reformuler
Parler des voyages
Exprimer le regret, la déception, le reproche
Transmettre des informations incertaines
S’informer/Informer sur ses erreurs
Présenter ses expériences
Exprimer des regrets
Exprimer des hypothèses concernant le passé
LEXIQUE
Le vocabulaire relatif aux nouvelles technologies, formations universitaires
Les formules de remerciement
GRAMMAIRE
Le conditionnel présent Le gérondif
CIVILISATION
Les différences entre les universités et les Grandes Écoles en France
La Communication Non Violente
Le vocabulaire lié aux problèmes de la civilisation moderne : nature, écologie
Le vocabulaire relatif aux médias et à la presse
Le vocabulaire lié aux : - voyages et monuments - attractions touristiques - catastrophes...
Le vocabulaire lié aux : - erreurs et réussites professionnelles - regrets - succès
La phrase conditionnelle : si + imparfait + conditionnel présent
Les conjonctions de cause (parce que, car, comme, puisque)
Le discours indirect La concordance des temps
Le subjonctif (rappel)
L’infinitif passé (rappel)
Le plus-que-parfait (rappel)
Le conditionnel passé
Les phrases conditionnelles :
si + plus-que-parfait + conditionnel passé
si + imparfait + conditionnel présent (rappel)
La chanson française
La presse française
Les César
Le patrimone culturel et naturel de la France
L’incendie de Notre-Dame en 2019
Edith Piaf, Je ne regrette rien
Quelques entreprises françaises à grand succès international (Danone, BlaBlaCar)
Les plats français inventés accidentellement
Les diplômes DELF et DALF
S’engager pour s’épanouir étape 1
Regarde les photos a – f et associe les activités
1 – 6 avec la photo correspondante. As-tu déjà eu l'occasion de faire ces types d'activité ? Si oui, dis laquelle/lesquelles ?
Les activités effectuées dans le cadre d’un bénévolat
1. Aider une personne âgée dans les tâches ménagères
2. Travailler en tant qu’animateur/animatrice
3. Être volontaire dans un refuge pour animaux

4. Devenir accompagnateur/accompagnatrice des personnes handicapées
5. Être volontaire dans une maison de retraite
6. Donner un cours de soutien à un enfant







Écoute les témoignages de Mathilde, Claire, Ludovic et Karine qui parlent de leur travail de bénévole. Dis dans quel secteur d’activités (A – E) ils ont vécu leur expérience. Fais correspondre le secteur à la bonne personne. Attention, un des secteurs ne correspond à aucune personne.
a. L’aide aux animaux dans un refuge animalier
b. L’aide aux personnes handicapées
c. Les cours de soutien à un enfant
d. L’accompagnement d’un groupe d’enfants
e. Le bénévolat dans une maison de retraite
Écoute les témoignages de Mathilde, Claire, Ludovic et Karine encore une fois et fais correspondre les phrases 1 – 4 aux personnes conformes aux descriptions.
1. Grâce au bénévolat, elle a découvert qu’elle voulait travailler comme institutrice.
2. Le bénévolat lui a permis de participer à des manifestations culturelles qui étaient ouvertes aux actions bénévoles.
3. Elle a hésité à s’engager dans le bénévolat parce qu’elle pensait qu’elle n’était pas compétente.
4. Le bénévolat lui a permis de s’occuper des animaux qui se trouvaient dans un refuge animalier.
4
5
Lis le témoignage de Benjamin qui raconte son expérience d’animateur. Ensuite, dis si les phrases 1 – 5 sont vraies ou fausses.
Benjamin, 17 ans, un mois en colonie de vacances
L’an dernier, j’ai décidé de passer le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Quand j’étais plus jeune, j’ai déjà fait des colonies de vacances comme animateur, et je me suis dit qu’ainsi, je pourrais toujours bosser dans l’animation. Fin juin, j’ai donc passé le stage théorique d’une semaine, à Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. C'était génial, il y avait une super ambiance et, en plus, j’ai fait plein de connaissances. Le premier jour de la colo à Saint-Raphaël, tout était nouveau : les autres animateurs, les enfants, le boulot. La directrice m’a mis à l’aise et, comme je suis très curieux, je me suis très vite intégré.
Je me suis occupé d’enfants âgés de 5 à 10 ans. J’ai trouvé ça difficile car les plus petits demandaient beaucoup de présence. Il fallait les rassurer et jouer un peu le rôle d’un parent… Au cours des activités, il fallait être patient et essayer de comprendre. Je préférais les plus grands, même si certains étaient durs à canaliser et se fâchaient dès qu’on leur disait quelque chose. Peu à peu, j’ai appris à les aborder et ça s’est arrangé.
Quand je travaillais avec les petits, je ne pensais pas trop aux cours théoriques, sauf peut-être pour organiser certaines activités. Donc, de 8 heures à 18 heures, on a fait pas mal d’activités sportives, on a réalisé des travaux manuels, on a joué, on a chanté, on a dansé… C’était vraiment un sacré boulot !
Au final, j’ai compris que l’animation ne m’intéressait pas, que ce n’était pas mon truc ! Je l’ai dit clairement à la directrice. De toute façon, je suis content d’avoir vécu cette expérience : j’ai pris conscience de certaines choses, et j’ai même gagné des sous. J’ai tenu un mois, alors que ça ne me plaisait pas. Je vais quand même valider mon Bafa en faisant le stage d’approfondissement. J’aime aller au bout des choses.
Vocabulaire difficile
bosser fam.* – pracovat boulot fam. – práce mettre quelqu’un à l’aise – pomoct někomu, aby se cítil pohodlně
* style familier – hovorový jazyk
1. Avant de s’engager dans l’animation, Benjamin a eu son diplôme pour exercer la fonction d’animateur.
2. Il avait du mal à s’intégrer au sein de l’équipe d’animateurs car tout était nouveau.
3. La directrice de la colonie de vacances a aidé Benjamin dans son travail.
4. Il s’est occupé des enfants de plus de 10 ans.
5. À la fin du stage, Benjamin a été content de l’avoir réalisé.
Complète les phrases suivantes avec les informations du texte. Copie-les dans ton cahier.
1. Benjamin a déjà travaillé avant comme animateur, quand
2. Il a beaucoup aimé son stage théorique parce que…
a.
b. c.
3. La colonie de vacances à Saint-Raphaël a été une expérience difficile parce que… a.
4. À la fin du stage, Benjamin s’est rendu compte que l’animation
Lis le témoignage de Mathéo qui raconte son expérience professionnelle. Lis les phrases et ensuite remets-les dans l’ordre, d’après la chronologie de ses démarches.
1. J’ai fait un stage pratique d’un an.
2. Je donnais des cours de soutien et j’animais des activités culturelles.
3. J’ai intégré l’équipe d’animateurs d’une maison des jeunes et de la culture.
4. J’ai décroché le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

5. J’ai été engagé en tant qu’animateur socioculturel.
6. J’organisais aussi des sorties et des ateliers.
7. J’ai déposé mon CV dans les associations qui m’intéressaient.
7
Fais correspondre les éléments de gauche avec ceux de droite et reconstitue les phrases.
J’ai été engagé les membres du club au cinéma et au théâtre.
Je travaillais à créer plusieurs jeux de société.
J’ai aidé les personnes âgées comme animateur dans un club du troisième âge.
J’accompagnais de grandir personnellement et d’approfondir mes aptitudes professionnelles. Nous avons réussi dans le bénévolat.
Cette expérience professionnelle m’a permis à réaliser différents projets.
LA SYNTAXE DES VERBES
8
Écris dans ton cahier les phrases de l'exercice 4 qui expriment les événements dont la durée est délimitée dans le passé et les informations dont la durée n’a pas de limites.
La durée n’a pas de limites
La durée a ses limites
Accompagner quelqu’un
J’accompagnais les personnes âgées au cinéma.
Travailler comme/en tant que Je travaillais comme/en tant que serveur.
Aider quelqu’un à faire quelque chose
J’aidais les enfants à faire leurs devoirs.
Permettre à quelqu’un de faire quelque chose
Ce travail m’a permis de devenir plus responsable.
RACONTER AU PASSÉ
On perçoit les événements au passé composé comme accomplis dans les délais de temps précis. Par contre, les événements exprimés à l’imparfait n’ont pas de limites de temps et sont perçus comme inaccomplis.
Le passé composé L’imparfait
La durée est délimitée dans le passé Le début et la fin de l’action ne sont pas précisés dans le passé
Les évènements accomplis, terminés dans le passé par rapport au moment où l’on parle.
Les activités qui se succèdent dans le passé. Les évènements inaccomplis où le début et la fin ne sont pas précisés
L’an dernier, j’ai passé un stage théorique. On a fait pas mal d’activités sportives, on a réalisé des travaux manuels, on a joué, on a chanté, on a dansé.
Les enfants demandaient beaucoup de présence.
Les activités qui sont habituelles, régulières dans le passé.
Il fallait jouer le rôle d’un parent.
Certains enfants étaient durs à canaliser et se fâchaient dès qu’on leur disait quelque chose.
Le fond de l’évènement principal.
C’était génial.
Il y avait une super ambiance.
Lis la biographie de Coco Chanel et dis : 9
a. quelles phrases se réfèrent à l’action accomplie dans le passé,
b. quelles phrases correspondent à l’action qui dure dans le temps,
c. quelles phrases expriment le fond de l’action principale.

1. Quand Gabrielle « Coco » Chanel est née à Saumur en 1883, sa mère travaillait comme couturière.
2. Sa famille vivait dans une grande pauvreté et sa situation est devenue encore plus grave après la mort de sa mère.
3. Gabrielle avait 12 ans, quand son père a abandonné ses trois filles dans un orphelinat.
4. Gabrielle et ses deux sœurs vivaient une vie très stricte dans l’orphelinat où Coco a appris la couture dès l’âge de 18 ans.
5. Elle a débuté sa carrière comme couseuse* en 1903 dans un atelier de couture qui se trouvait à Moulins.
6. En même temps, elle chantait dans un bar pour gagner plus d’argent et c’est à ce moment-là qu’elle a obtenu son célèbre surnom de Coco après avoir chanté « Qui qu’a vu coco dans l’Trocadéro ? ».
7. Elle était passionnée de mode donc, en 1909, elle a commencé son apprentissage à Paris.

8. À Paris, elle a rencontré son grand amour, Arthur « Boy » Capel, qui l’a aidée à ouvrir sa première boutique parisienne, en 1910, au fameux 31, rue Cambon.
9. Coco Chanel a rapidement mis une touche masculine dans ses dessins car elle voulait libérer les mouvements de la femme et moderniser les tenues.
10. Ses créations exprimaient la simplicité et l’élégance à travers des robes droites et le pantalon qui était jusqu’alors réservé aux hommes.
11. Après la guerre, son entreprise est devenue prospère et employait déjà environ 300 ouvrières.
* Aujourd’hui, on utilise le mot « couturière »


PARTICIPE PASSÉ
Verbes conjugués avec l’auxiliaire AVOIR
Verbes conjugués avec l’auxiliaire ÊTRE j’ai tu as il/elle/on a nous avons vous avez ils/elles ont
aimer – aimé apprendre – appris attendre – attendu avoir – eu boire – bu comprendre – compris compromettre – compromis conduire – conduit connaître – connu construire – construit courir – couru couvrir – couvert croire – cru découvrir – découvert devoir – dû dire – dit écrire – écrit entendre – entendu être – été faire – fait falloir – (il a) fallu lire – lu mettre – mis offrir - offert ouvrir – ouvert peindre – peint pleuvoir – (il a) plu pouvoir – pu prendre – pris recevoir – reçu répondre – répondu savoir – su tenir – tenu traduire – traduit vendre – vendu vivre – vécu voir – vu vouloir – voulu
je suis tu es
il/elle/on est nous sommes vous êtes ils/elles sont
aller – allé(e)(s) arriver – arrivé(e)(s) descendre – descendu(e)(s) devenir – devenu(e)(s) entrer – entré(e)(s) monter – monté(e)(s) mourir – mort(e)(s) naître – né(e)(s) partir – parti(e)(s) passer – passé(e)(s) rentrer – rentré(e)(s) rester – resté(e)(s) retourner – retourné(e)(s) revenir – revenu(e)(s) sortir – sorti(e)(s) tomber – tombé(e)(s) venir – venu(e)(s)
FORMATION DE L’IMPARFAIT (RAPPEL)
Chercher Choisir
FORMATION DE L’IMPARFAIT (RAPPEL)
Être Avoir
j’étais tu étais
il/elle/on était nous étions vous étiez ils/elles étaient
FORMATION DE L’IMPARFAIT
j’avais tu avais
il/elle/on avait
nous avions vous aviez
ils/elles avaient
(VERBES DU 1ER GROUPE – CAS PARTICULIERS)
Commencer Manger
nous commençons nous mangeons
je commençais tu commençais
il/elle/on commençait on commençait nous commencions vous commenciez ils/elles commençaient
La place des adverbes au passé composé
J’ai déjà travaillé. Tu as rapidement trouvé un stage. Il s’est bien reposé.
je mangeais tu mangeais
il/elle/on mangeait on mangeait nous mangions vous mangiez ils/elles mangeaient
La phrase négative
Je n’ai pas encore travaillé. Tu n’as pas rapidement trouvé de stage.
Il ne s’est pas bien reposé.
FORMATION DU PASSÉ COMPOSÉ (RAPPEL)
Travailler Partir
j’ai travaillé tu as travaillé il/elle a travaillé on a travaillé nous avons travaillé vous avez travaillé ils/elles ont travaillé
je suis parti(e) tu es parti(e) il est parti/elle est partie on est parti(e)(s) nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)(s) ils sont partis/elles sont parties
S’engager
je me suis engagé(e) tu t’es engagé(e) il s’est engagé/elle s’est engagée on s’est engagé(e)(s) nous nous sommes engagé(e)s vous vous êtes engagé(e)(s) ils se sont engagés/elles se sont engagées
Apprendre Vouloir Faire
nous cherchons nous choisissons nous apprenons nous voulons nous faisons
je cherchais tu cherchais
il/elle/on cherchait
nous cherchions
vous cherchiez
ils/elles cherchaient
je choisissais tu choisissais
il/elle/on choisissait nous choisissions vous choisissiez
ils/elles choisissaient
j’apprenais tu apprenais
il/elle/on apprenait
nous apprenions
vous appreniez
ils/elles apprenaient
je voulais tu voulais
il/elle/on voulait
nous voulions vous vouliez
ils/elles voulaient je faisais tu faisais
il/elle/on faisait
nous faisions vous faisiez
ils/elles faisaient
12
Lis les phrases concernant les impacts positifs du numérique sur la vie quotidienne. Mets le verbe entre parenthèses à l’imparfait pour exprimer une habitude dans le passé. Copie-les dans ton cahier.
1. Il y a une vingtaine d’années, peu de personnes (être) connectées à Internet. De nos jours, tous les foyers y ont accès.
2. Il y a quelques années, les adolescents (ne pas avoir) de smartphones alors que maintenant, 65 % des jeunes de 12 ans en ont un.
3. Au cours du siècle précédent, pour communiquer avec ses amis, on (devoir) utiliser le téléphone ou on (écrire) une lettre ; actuellement, grâce aux réseaux sociaux, la communication peut se faire à l’écrit, à l’oral ou grâce à des vidéos et, tout cela, sans limite.
4. Avant, nous (acheter) tout dans les magasins ; de nos jours, grâce au numérique, les achats en ligne sont en constante progression.
5. Avant, toutes les réservations (se faire) par le biais d’un office de tourisme tandis que maintenant, on les fait soi-même à l’aide d’un smartphone.
6. Dans les années 90, les démarches administratives (prendre) beaucoup de temps tandis que maintenant, on peut les faire sans bouger de chez soi.
7. Avant, on (s’orienter) à l’aide d’une carte car la navigation GPS (ne pas exister) ; depuis son apparition, cet outil de navigation est devenu très populaire.
8. Avant, nous (payer) seulement avec du liquide ; maintenant, nous pouvons payer notre consommation à l’aide de notre smartphone.
Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé et recopie les phrases dans ton cahier.
1. Lucas était au chômage quand, d’un jour à l’autre, il (trouver) un job intéressant.
2. Il habitait à Quimper, mais il (s’installer) à Brest pour son travail.
3. Il voulait acheter un studio, mais, finalement, il (louer) une petite maison en banlieue.
4. À Quimper, il ne trouvait pas de travail et puis, sans s’y attendre, il (devenir) chef de cuisine dans un grand restaurant à Brest.
5. Quand il était à l’école, il apprenait l’art de son métier, mais à Brest, il (devoir) apprendre à prendre toutes les responsabilités en tant que chef de cuisine, chef d’équipe et gestionnaire.
6. Avant, il sortait souvent avec ses amis, et depuis, qu’il est chef de cuisine, il (ne pas encore sortir)
Lis l’interview de l’écrivaine française Marie NDiaye et mets les verbes entre parenthèses à la forme convenable du temps passé qui convient. Écris les réponses de l’écrivaine dans ton cahier. Fais l’élision, si nécessaire.
– Quand avez-vous commencé à écrire et pourquoi ?
– J’ai commencé à écrire tôt, à l’âge de 10 ans, parce qu'en fait je (être) une grande lectrice et je (adorer) lire. Je (vouloir) reproduire ce que je (aimer)
– Quel genre d'histoires c’était ?
– À chaque fois, je (s’intéresser) au genre d’histoire que je (être) en train de lire à ce moment-là. Par exemple, quand je (lire) toute la série des Fantômettes, je (écrire) des histoires comme ça.
– Qui vouliez-vous devenir quand vous étiez petite ?
– Quand je (être) petite, je (vouloir) devenir écrivaine.
– Quel est votre plus beau souvenir d’enfance ?
– Il y en a tellement ! Mon grand frère et moi, nous (passer) souvent les vacances en Beauce, chez notre grand-mère qui nous (faire) des crèmes au chocolat et des charlottes aux fraises. Ce (être) délicieux !
D’après : https: //www.mechant-loup.schule.de/ interviews/ecrivaine-marie-ndiaye.html

Marie NDiaye
Marie NDiaye écrit des romans, des pièces de théâtre, des pièces radiophoniques, des scénarios et des livres d'enfants. Elle a obtenu, entre autres, le Prix Femina en 2001 pour son roman Rosie Carpe, le Prix Goncourt en 2009 pour son roman Trois femmes puissantes et le Prix Ulysse en 2018 pour l’ensemble de l’œuvre.
Le proviseur du lycée présente les objectifs du projet
C’est un projet innovant que l’équipe de professeurs a décidé de monter auprès de deux classes BTS en première année. C’est leur première année d’autonomie et, en termes d’apprentissage de leur vie d’adulte, ils sont souvent confrontés à pas mal de problèmes liés à l’hygiène de vie et l’équilibre alimentaire. C’est à partir de ce constat qu’on a décidé de monter un projet dont le but était de rendre les élèves plus conscients du rôle que le bien-être peut jouer dans leur vie. C’était l’un des aspects les plus intéressants de ce projet. Il y avait donc les élèves qui ont tenu des stands ainsi que des professionnels du milieu médical et social qui ont animé des ateliers.
Alex, élève en BTS Fluide Énergie Domotique, l’un des étudiants organisateurs de la Journée de la Santé et du Bien-être présente les stands :

On a organisé cette journée avec le CoDES 04, c’est-à-dire le Comité départemental d’ é ducation pour la s anté. C’est une association dont le but principal est de promouvoir la santé. Elle porte surtout sur la prévention de tout ce qui est alcool, drogue, addiction, mauvaise alimentation, etc. Il y a de nombreux stands tenus par des élèves, mais aussi par des intervenants extérieurs. On a, par exemple, des stands où on trouve tout ce qui porte sur l’alimentation. Il y a des stands sur lesquels il y a des mini-jeux où il faut élaborer des menus équilibrés à partir d’un choix d’aliments ou encore deviner la quantité de sucre et de matière grasse présents dans certains aliments. Il y a aussi un stand où on apprend à créer des cocktails sans alcool. C’est un stand ludique car il faut pédaler pour mixer son cocktail. Dans une autre partie du lycée, il y a tout ce qui penche sur l’alcool, la drogue, l’addiction. Là aussi, il y a des stands tenus par les élèves et des stands tenus par les psychologues de la Maison des adolescents et du Centre médico-social qui sont aussi présents. Ce sont plutôt des lieux d’écoute où les élèves peuvent poser des questions aux intervenants qui sont spécialistes.
Sophie Noël, qui a animé un atelier sur la communication non violente, fait le point
J’ai animé un atelier « Les émotions au service de la communication ». J’ai voulu montrer aux élèves que grâce à l’attention que nous portons à nos émotions, à tout ce qu’elles suscitent en nous, nous pouvons retrouver le pouvoir d’agir qui est le besoin universel de tout être humain. Le pouvoir d’agir et le besoin d’écoute, ce sont des valeurs essentielles dont l’homme a besoin.
D’après : https://www.frequencemistral.com/Sante-et-bien-etre-les-lyceens-parlent-aux-lyceens_a7346.html
Vocabulaire difficile
soutenir – podporovat susciter – vyvolávat
Questions
1. Qui a monté le projet de la Journée de la Santé et du Bien-Être ?
2. Quel était le but de ce projet ?
3. À qui les organisateurs ont-ils adressé le projet ?
4. Quel est le but de l’association CoDES 04, qui a participé à l’organisation du projet ?
5. À quelles thématiques étaient consacrés différents stands ?
Observe
QUI
Dans le projet, il y avait des élèves. Ces élèves ont animé des ateliers.
Dans le projet, il y avait des élèves qui ont animé des ateliers.
QUE
C’est un projet innovant. L’équipe de professeurs a monté ce projet auprès de deux classes BTS.
C’est un projet que l’équipe de professeurs a monté auprès de deux classes BTS.
DONT
1. Le pouvoir d’agir et le besoin d’écoute, ce sont des valeurs essentielles. L’homme a besoin de ces valeurs.
Le pouvoir d’agir et le besoin d’écoute, ce sont des valeurs essentielles dont l’homme a besoin.
2. Le Comité départemental d’éducation pour la santé, c’est une association. Le but principal de cette association est de promouvoir la santé.
Le Comité départemental d’éducation pour la santé, c’est une association dont le but principal est de promouvoir la santé.
OÙ
1. Certains stands sont des lieux d’écoute. Dans ces endroits, les élèves peuvent poser des questions aux spécialistes de santé.
Certains stands sont des lieux d’écoute où les élèves peuvent poser des questions aux spécialistes de santé.
2. La semaine est devenue un moment fort. Au cours de la semaine, les participants ont rencontré des spécialistes de santé.
La semaine est devenue un moment fort où les participants ont rencontré des spécialistes de santé.
PRONOMS RELATIFS SIMPLES
Fonctions
QUI – sujet
QUE – complément d’objet direct
DONT –
1. préposition de + complément d’objet indirect
2. complément de nom
OÙ –
1. complément circonstanciel de lieu
2. complément circonstanciel de temps
Exemples
Les spécialistes de la santé animent les ateliers qui sont adressés aux élèves. Les spécialistes de la santé animent les ateliers. Ces ateliers sont adressés aux élèves.
La Journée de la santé est un grand évènement que les élèves ont préparé avec leurs professeurs.
La Journée de la santé est un grand évènement. Les élèves ont préparé cet événement avec leurs professeurs.
La Journée de la santé, c’est un événement dont on parle dans les médias. On parle de cet évènement.
C’est une longue journée dont le programme est bien rempli. Le programme de cette journée est bien rempli.
C’est un lycée professionnel où on a organisé la Journée de la santé. On a organisé la Journée de la santé dans un lycée professionnel.
C’est une journée où les élèves parlent du bien-être.
Les élèves parlent du bien-être pendant la journée.
Le bien-être et la santé physique, mentale et intellectuelle
Relie les phrases de l’affiche suivante à l’aide des pronoms relatifs qui ou que. Note les phrases dans ton cahier.


Prenons soin de notre corps, notre esprit nous en remerciera !
Faisons du sport. Le sport permet de libérer des endorphines dans le corps.
Produisons des endorphines. Elles augmentent notre capacité à réussir dans presque tous les aspects de notre vie.
Consommons des aliments sains. Ils sont disponibles dans certains magasins ou en ligne.
Privilégions de bons nutriments comme des vitamines et des minéraux. Ils sont meilleurs pour notre santé.
Évitons les sucreries. Nous pouvons les remplacer par des fruits.
Buvons du thé ou des infusions et non des sodas ! Nous pouvons nous-mêmes préparer les thés et infusions.
Réduisons le sel et utilisons plus d’herbes et d’épices. Nous pouvons acheter ces herbes et épices dans presque tous les magasins d’alimentation.
Ne négligeons pas notre sommeil. C'est indispensable pour se sentir bien le lendemain.

Complète les conseils du diététicien avec un pronom relatif convenable. Tu peux recopier les phrases dans ton cahier et/ou les dire à voix haute. 5
Que manger avant un effort intellectuel ?
Il faut manger des aliments l’index glycémique est bas, sont complets et nous trouvons une source de protéines permettent d’éviter la fatigue. Privilégions les aliments la richesse en vitamines et minéraux est indiscutable, comme fruits, légumes, fruits secs ou oléagineux. N’oublions pas l’eau nous avons besoin pour bien nous hydrater. Évitons de manger des repas trop gras peuvent ralentir la digestion et provoquer un coup de fatigue. N’oublions pas le sommeil dépend tout le métabolisme et est responsable du bon fonctionnement de notre organisme.
Réaliser ses objectifs : un psychologue donne ses conseils
Que faire pour améliorer sa qualité de vie ? Relie les phrases suivantes à l’aide d’un pronom relatif convenable. Copie-les dans ton cahier.
1. Appréciez les choses simples. Vous disposez de ces choses au quotidien : une famille aimante, un toit, des amis, de la nourriture, de l’eau propre.
2. Appréciez les choses précieuses qui vous entourent. Nous prenons souvent ces choses pour acquises. Beaucoup de gens n’ont pas ces choses.
3. Renforcez les relations avec les personnes importantes pour vous. Vous aimez ces personnes.
4. Prenez soin de vous-mêmes et organisez mieux votre emploi du temps. Vous allez prévoir dans cet emploi du temps des moments de détente.
5. Trouvez chaque semaine quelques heures pour vous-mêmes. Pendant ces heures-là, vous ne penserez ni au travail, ni aux tâches du quotidien.
6. Il ne faut pas ignorer les mauvaises expériences. Nous pouvons profiter de ces expériences pour apprendre et aller de l’avant.
7. Trouvez le côté positif de chaque mauvaise situation. La vie nous apporte inévitablement ces mauvaises situations.
8. Aidez les personnes vulnérables. Ces personnes attendent votre générosité.
9. Aider une personne âgée à porter ses sacs ou faire du bénévolat les fins de semaine, ce sont des actes de générosité. Ces actes permettent d'augmenter le bonheur personnel de chacun.
D’après : https://fr.wikihow.com/am%C3%A9liorer-sa-qualit%C3%A9-de-vie

Comment s’y prendre pour réaliser ses rêves ? Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif qui convient.
Les étapes à suivre
1. Faites une liste d’objectifs réalistes vous voulez réaliser.
2. Fixez les objectifs sont les plus importants.
3. Notez les étapes vous devrez franchir en vue de réaliser vos objectifs.
4. Faites la liste des choses vous avez besoin pour réaliser vos rêves.
5. Ne vous arrêtez jamais d’apprendre, c’est la seule façon vous allez progresser.
6. Si vous voulez, par exemple, devenir scénariste de séries télévisées, apprenez à écrire des scénarios vous soumettrez dans différentes compétitions.
7. Regardez les actualités tous les jours, lisez des livres, apprenez de nouveaux mots – tout ce qui vous rend plus intelligent que le jour précédent est quelque chose vous pouvez être fier.
8. Écoutez plus, parlez moins. Vous serez surpris de ce les gens ont à vous offrir.
9. Apprenez la patience vous devrez faire preuve. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.
10. Selon certains experts, il faut environ 10 000 heures de travail pour atteindre la maîtrise réelle d’un sujet. Travaillez donc pour atteindre le but vous souhaitez.

Le bien-être au travail…
Lis les phrases suivantes et dis à quel élément de la phrase correspond la forme soulignée.
Pour cultiver le bien-être au travail, il faut

1. - faire des choses que nous aimons,
2. - choisir un métier qui nous intéresse,
3. - faire le travail dont nous avons toujours rêvé,
4. - réaliser les objectifs qui permettent de s’épanouir,
5. - mener des projets dont tout le monde profite,
6. - soigner les relations interpersonnelles qui sont les fondamentaux d’une bonne qualité de vie au travail,
7. - créer un environnement de travail agréable où tout le monde se sent motivé,
8. - émettre une énergie positive que tout le monde autour de nous va voir.
Complète les phrases suivantes avec le pronom relatif convenable. Présente tes propositions à voix haute et/ou note-les dans ton cahier.
La personne qui se sent bien au travail, c’est quelqu’un… voit l’intérêt du travail, peut s’épanouir dans son métier, voit les perspectives d’évolution, a de bonnes relations avec ses collègues et avec sa hiérarchie, est bien rémunérée, la qualité de travail est reconnue, la vie privée est respectée.
Le chef d’entreprise idéal, c’est quelqu’un… est compétent, les employés respectent, la qualité de management est remarquable.
L’environnement idéal de travail, c’est l’endroit… on respecte la santé et la sécurité de l’emploi, les aménagements renforcent le bien-être au travail.
à tes réussites personnelles et réponds aux questions suivantes. Écris les réponses dans ton cahier.
1. Quels sont les rêves que tu as déjà réalisés ?
2. Quels sont les succès que tu as déjà connus ?
3. Quelle est l’expérience professionnelle que tu as déjà vécue ?
4. Quelles sont les bonnes surprises que tu as faites à ta famille ?
5. Quels sont les meilleurs livres que tu as lus et les films que tu as vus ?
6. Quels sont les cadeaux précieux que tu as reçus ?
7. Quel est le meilleur choix que tu as fait ?

L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ AVEC L’AUXILIAIRE AVOIR
Observe
J’ai déjà vécu une expérience professionnelle. L’expérience professionnelle que j’ai vécue, c’est deux mois en tant que serveur.
Accorde, si nécessaire, les participes passés dans les phrases du carnet de réussites personnelles de Julie. Écris les versions correctes dans ton cahier.
Le carnet de réussites de Julie - les personnes que j’ai aidé , - les valeurs que j’ai respecté , - les bonnes idées que j’ai eu , - les bonnes décisions que j’ai pris , - les bons choix que j’ai fait , - les projets que j’ai réalisé , - les tâches que j’ai accompli , - les leçons que j’ai appris , - le temps que j’ai consacré pour pratiquer le sport, - les bons livres que j’ai lu

Le bien-être et la vie étudiante
: les besoins à satisfaire…
Lis le texte suivant qui parle d’une fédération d’étudiants infirmiers de France. Ensuite, réponds aux questions ci-dessous. 12
La Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers (FNESI) est une association sur laquelle peuvent compter tous les étudiants en nécessité.
Les besoins des étudiants auxquels veut répondre la FNESI ne sont pas toujours satisfaits car ces jeunes adeptes dépensent souvent trop d’énergie pour s’occuper des autres.
Ainsi, après avoir constaté que la formation en soins infirmiers entraîne, pour beaucoup de jeunes, des problèmes psychologiques et physiques (stress, fatigue, mauvaise alimentation, etc.), la FNESI a pour objectif de leur fournir des outils nécessaires pour surmonter les problèmes auxquels les étudiants font face au quotidien.
La Semaine du Bien-Être est un des projets que les étudiants peuvent monter eux-mêmes pour promouvoir le bienêtre au sens large, physique, psychologique et social.
Fais correspondre les termes à leur définition.
1. un hebdomadaire
2. un magazine d’actualité
3. un jeu télévisé
4. un feuilleton
5. un quotidien
6. un forum
7. un mensuel
8. une brève
9. un débat télévisé
10. un flash
A. un roman télévisé divisé en chapitres et diffusé à la télé pendant plusieurs années
B. un programme télévisé qui réunit des personnalités intellectuelles ou politiques pour discuter sur un problème précis
C. une publication qui paraît chaque jour
D. un bref journal télévisé ou radiophonique composé de plusieurs brèves, où le présentateur présente plusieurs informations en quelques minutes
E. une publication qui paraît une fois par semaine
F. un concours qui passe à la télé l’après-midi ou le soir
G. un programme qui parle des problèmes actuels
H. un lieu d’échange entre des internautes sous la forme d'un groupe de discussion
I. une information lue à l’antenne par un présentateur ou une présentatrice
J. une publication qui paraît une fois par mois
Avec ton/ta collègue, regardez les titres de la presse française et faites des hypothèses sur la thématique des textes abordés dans ces journaux et magazines.






c d



4
Lis les extraits des articles de presse. Dans quel journal ou magazine pourraient-ils être publiés ? Fais correspondre les titres de l’exercice 3 au fragment qui peut leur correspondre.
L’Argentine s’est qualifiée pour le tournoi masculin (23 juillet – 8 août 2021) des Jeux Olympiques de Tokyo en battant la Colombie (2-1), lors de la deuxième journée du tournoi de qualification sud-américain, jeudi à Bucaramanga (Colombie). Urzi (49e) et Pérez (52e) ont inscrits les deux buts ; ils chercheront au Japon à renouer avec l’or, décroché par l’Albiceleste à Athènes en 2004 et Pékin en 2008.
Alors que les défilés Haute Couture se terminent ce jeudi 23 janvier, les maisons Valentino et Elie Saab présentaient hier leurs collections printemps/été 2020.
À l’hôtel Salomon de Rothschild, où Valentino a pour habitude de tenir ses défilés, le créateur de la maison, Pierpaolo Piccioli, avait convié de nombreuses personnalités du monde de la mode, de la chanson mais également du cinéma. Pour le défilé de la maison Elie Saab, qui se tenait au Grand Palais à 12 h 30 mercredi 22 janvier, l’actrice et top model Molly Sims était une des invités phares de l’événement.
Vos plantes d’intérieur font grise mine durant l’hiver ? Découvrez nos conseils pour les entretenir et en prendre soin. Durant l’hiver, les plantes d’inté- rieur peuvent être fragilisées à cause des courants d’air. De la même façon, leur terre peut s’assécher à cause des radiateurs. Ainsi, il est important de veiller sur elles et de redoubler d’at- tention, si on ne souhaite pas les voir mourir. Pour cela, certains gestes sont à adopter au quotidien.
Pain au chocolat ou croissant ? Muesli ou banane ? Autant de questions que l’on se pose parfois quand on veut manger léger le matin. Découvrez 10 petits déjeuners pauvres en calories.
On ne le répétera jamais assez : le petit-déjeuner est le premier repas de la journée, mais aussi et surtout le plus important ! Pourquoi ? Parce qu’il permet de faire le plein d’énergie pour commencer la journée du bon pied et ainsi éviter les fringales en milieu de matinée.
S’il est déconseillé de partir de chez soi le ventre vide, pas question pour autant de manger n’importe quoi ! Il est tout à fait possible de déguster un bon petit-déjeuner sans prendre de poids. Pour cela, on mise sur les protéines, les vitamines, les fibres ou encore le calcium !
Vous souhaitez découvrir les pays baltes ? Pourquoi ne pas vous laisser tenter par Riga, capitale de la Lettonie et véritable centre culturel.
Riga est connue comme étant l’une des capitales de l’art nouveau. Quoi de mieux, pour découvrir la beauté de cette ville au bord de la mer Baltique et du fleuve Daugava, que de se balader à pied et d’admirer l’architecture des lieux.
L’une des rues à emprunter absolument est la rue Albert (Alberta iela). On y trouve de magnifiques immeubles Art nouveau datant du début du XXe siècle.
Personne n’aime être malade. C’est pourquoi certains prennent des vita- mines l’hiver, et d’autres se font vacci- ner contre la grippe. Mais il arrive que, malgré ces précautions, le virus grippal arrive à nous atteindre. Quels sont les symptômes d’une grippe ? La grip- pe est une infection virale très con- tagieuse qui touche les voies respira- toires supérieures. Ses symptômes, du moins au tout début, peuvent être confondus avec ceux d’autres mala- dies virales. Mais leur intensité et leur durée permettent généralement de les distinguer d’un rhume par exemple. 6
Serrures connectées, caméras de surveillance, téléphones... La recon- naissance faciale déboule dans no- tre quotidien. Mais identifie-t-elle à coup sûr ceux qu’elle est program- mée pour reconnaître et, surtout, ne peut-elle pas se faire abuser par un inconnu ? À vrai dire, jusqu’à il y a peu, mieux valait faire confiance aux bons vieux mots de passe se- crets, voire aux empreintes digitales... Les systèmes d’authentification les plus courants, basés sur la recon- naissance d’un visage en deux dimen- sions, montrent leurs limites lors des variations d’éclairage, de posture ou d’expression des personnes.
Pourcette neuvième journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites, quelque 121 000 personnes ont manifesté jeudi en France, dont 15 000 à Paris, selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur. La CGT a de son côté comptabilisé 130 000 manifestants à Paris.
Selon les préfectures ou la police, les manifestants étaient 5 300 à Lyon, 4 500 à Marseille, 2 700 à Rennes, 3 500 à Toulouse ou Bordeaux, 1 700 à Lille, 1 600 à Clermont-Ferrand ou Nice, 1 300 à Dijon, 1 100 à Perpignan.
Lis les phrases et traduis-les en tchèque. Observe les modifications qui ont été faites. 5
1. Le magazine informe : « Les défilés Haute Couture se terminent ce jeudi 23 janvier ».
Le magazine informe que les défilés Haute Couture se terminent ce jeudi 23 janvier.
2. L’auteur de l’article demande aux lecteurs : « Savez-vous identifier les symptômes de la grippe ? »
L’auteur de l’article demande si les lecteurs savent identifier les symptômes de la grippe.
3. Les lecteurs demandent : « Qui a gagné le tournoi de qualification ? » Les lecteurs demandent qui a gagné le tournoi de qualification.
4. Le journaliste recommande aux lecteurs : « Partez en Lettonie ! » Le journaliste recommande aux lecteurs de partir en Lettonie.



LE DISCOURS RAPPORTÉ
Le style indirect sert à rapporter les paroles de quelqu’un. Pour transformer le discours direct en discours indirect, certaines modifications grammaticales sont indispensables, comme p. ex. modifications des pronoms personnels, des pronoms démonstratifs et possessifs, des marqueurs de temps, des temps verbaux.
DISCOURS DIRECT
1. Vous annoncez : « Nous nous présentons au concours demain ».
2. Il constate : « Ma sœur n’a plus vos livres ».
3. Il me demande : « Est-ce que tu vas régler ce problème ? »
4. Nous vous demandons : « Quittez cette salle ! »
5. Je lui demande : « Qui est-ce qui vient à ton anniversaire ? »
6. Elles nous demandent : « Qu’est-ce que vous envisagez de faire après le bac ? »
7. Mes parents me demandent : « Qu’est-ce qui te démotive à apprendre cette matière ? »
DISCOURS INDIRECT
Vous annoncez que vous vous présentez au concours demain.
Il constate que sa sœur n’a plus nos livres.
Il me demande si je vais régler ce problème.
Nous vous demandons de quitter cette salle.
Je lui demande qui vient à son anniversaire.
Elles nous demandent ce que nous envisageons de faire après le bac.
Mes parents me demandent ce qui me démotive à apprendre cette matière.
TRANSFORMATION DU DISCOURS DIRECT EN DISCOURS INDIRECT
affirmation, constatation
phrase 1 + que + phrase 2 question simple (est-ce que, inversion)
phrase 1 + si + phrase 2 question avec Qui est-ce qui…
phrase 1 + qui + phrase 2 question avec Qu’est-ce que…
phrase 1 + ce que + phrase 2 question avec Qu’est-ce qui…
phrase 1 + ce qui + phrase 2 question avec un mot interrogatif (pourquoi, où, comment, quand…)
phrase 1 + mot interrogatif + phrase 2 impératif
phrase 1 + de + infinitif
QUELQUES VERBES QUI INTRODUISENT LE DISCOURS INDIRECT
ajouter confirmer expliquer annoncer déclarer préciser assurer demander raconter avouer dire répondre
Transforme les phrases comme dans l’exercice 5. 6
1. Le journaliste constate : « Personne n’aime être malade ».
2. Les lecteurs demandent : « Pouvons-nous améliorer la vie des plantes en hiver ? ».
3. Les citoyens se demandent : « Où y a-t-il des manifestations contre la réforme des retraites ? »
4. Le scientifique prévient les lecteurs : « Méfiez-vous des systèmes de reconnaissance faciale ! »
5. Les lecteurs demandent : « Quels sont les symptômes de la grippe ? »
6. Les lectrices demandent : « Pourquoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ? »
C’est parti !
CVIČEBNICE FRANCOUZŠTINY
3
A2/B1
S’engager pour s’épanouir étape 1
Un groupe de lycéens s’est engagé dans le bénévolat. Parmi les phrases proposées, choisis celle qui décrit la situation présentée sur la photo et souligne-la.

a. Chloé a aidé une personne âgée à faire le ménage.
b. Chloé a fait les courses avec une personne âgée.

a. Bruno a travaillé comme animateur d’enfants.
b. Bruno a donné un cours de soutien aux adolescents.



a. Manon s’est occupée d’un enfant en nécessité.
b. Manon a accompagné une personne à mobilité réduite.

a. Joséphine est devenue animatrice dans une maison de retraite.
b. Elle s’est engagée, comme bénévole, dans un refuge pour animaux.
a. Kévin et Élodie ont distribué des repas pour les Restaurants du Cœur.
b. Kévin et Élodie ont collecté des produits alimentaires dans des supermarchés.
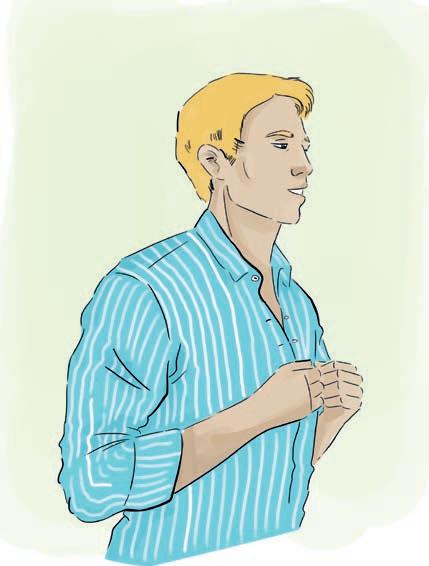



- Tu es prêt pour aller à l’école ?
- Non, je ne me suis pas encore habillé.
- Est-ce que tu t’es déjà lavé les dents ?




- Pourquoi est-ce que tu t’es levé si tard ? On va être en retard.
- Je me suis levé comme d’habitude.
- Non, pas encore. Je suis en train de le faire.
- Tu as déjà pris ton petit-déjeuner ?
- As-tu fini de manger ?
- Non, pas encore ; et puis je n’ai pas faim.
- Oui, j’ai pris un croissant, un jus d’orange et un café.
- Chéri, où sont les enfants ?
- Ils se sont couchés et je crois qu’ils se sont endormis.
- Quel dommage ! Je n’ai pas pu les voir.

- Est-ce que tu as préparé tes livres d’école pour demain ?
- Oui, je les ai préparés hier soir.
- Qu’est-ce que vous avez fait après l’école ?
- C’était la grande journée du nettoyage, on a ramassé les déchets dans le parc municipal.
- Vous avez déjà mangé ?
- Oui, on a mangé une pizza.
- Tu as déjà fait tes devoirs ?
- Non, à vrai dire, je ne les ai pas encore commencés.
3
Écris les participes passés à partir des infinitifs suivants.
1. aider
2. être
3. avoir
4. partir
5. choisir
6. finir
7. découvrir
8. devenir
9. acquérir
10. attendre
4
11. répondre
12. prendre
13. dire
14. vivre
15. atteindre
16. peindre
17. voir
18. savoir
19. vouloir
20. pouvoir
Complète les phrases suivantes (1-8) avec les éléments proposés.
1. Je/J’
2. Tu
3. Louise
4. Louis
5. Mon frère et moi, on
6. Nous
7. Vous
8. Manon et Nathalie
5
… a travaillé comme animatrice en colonie de vacances.
… a choisi le bénévolat dans un refuge animalier.
… a trouvé un job d’été à la campagne.
… n’ont pas travaillé pendant les vacances.
… avons découvert le métier d’animateur.
… ai aidé les personnes âgées.
… avez accompagné des personnes handicapées à des manifestations culturelles.
… as été volontaire dans une maison de retraite.
Léo est un garçon de 17 ans qui ne dit pas toujours la vérité. Il raconte comment il a passé sa journée mais ce n’est pas toujours vrai. Regarde les dessins et dis si les informations fournies se réfèrent à la réalité vécue. Rectifie les informations qui sont fausses.
EXEMPLE
Je me suis levé à sept heures du matin.

Non, il s’est levé à huit heures.
Je me suis rapidement douché et puis j’ai pris mon petit-déjeuner.
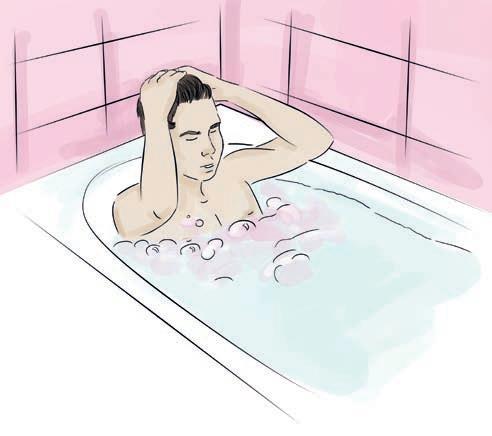

J’ai pris mon bus à neuf heures moins vingt.

Je n’ai eu aucun contrôle.

Je suis sorti de chez moi à huit heures et demie.

Je suis arrivé à l’école à temps et j’ai commencé les cours à neuf heures.

À midi, j’ai mangé à la cantine de l’école.

J’ai fini mes cours à trois heures et je suis resté à l’école pendant une heure pour préparer un projet de biologie.

Je suis rentré chez moi à six heures du soir.

J’ai écouté de la musique.

Plus tard, j’ai eu un cours d’anglais.

Je me suis occupé de mon petit frère Michel.

À onze heures, je me suis senti très fatigué et je suis allé me coucher.


koncipovaný tak, aby odpovídal potřebám českých studentů. Učebnice umožňuje všestranný rozvoj jazykových kompetencí.

