

Emmanuelle Ghislain & Nadine Khouzam





Investir dans des politiques DEI est devenu un choix stratégique - parfois de survie - pour de nombreuses entreprises. Encore faut-il savoir où concentrer ses efforts et être capable d’en mesurer les résultats.
Amélioration des performances économiques, meilleure attractivité et rétention des talents… Si le “pourquoi” d’une politique de Diversité, Équité et Inclusion (DEI) est de plus en plus évident, le “comment” reste une question à part entière pour de nombreuses organisations désireuses d’aller dans ce sens. En effet, les actions possibles sont nombreuses, mais les ingrédients du succès ne sont pas identiques pour toutes. Il est donc essentiel de pouvoir établir la réalité DEI d’une entreprise et de parvenir à mesurer quantitativement les retours d’investissements réalisés dans le cadre de stratégies DEI.
Et c’est justement là toute la difficulté. Car il est aujourd’hui extrêmement délicat (voire légalement impossible dans certains secteurs) pour l’employeur d’obtenir des données relatives à la diversité. En effet, celle-ci ne s’arrête pas au genre ou à l’âge, mais inclut des indicateurs bien plus larges tels que l’origine, l’orientation sexuelle, une situation de handicap visible, etc.
Le défi se corse encore quand on aborde les questions d’inclusion et d’équité. L’accès aux opportunités de carrière, la place
faite à la différence et aux opinions variées qu’elle génère, l’appartenance à une culture d’entreprise… voilà une liste non exhaustive de critères qui détermineront si une organisation peut se définir respectueuse de la différence ou non. Il est évident qu’un.e employé.e pourrait ressentir de l’appréhension à partager un tel niveau de vulnérabilité avec son employeur, que même un sentiment de sécurité psychologique forte ne pourrait transcender.
C’est exactement sur base de ce constat que repose la création de l’Index de Cohesion Belgium: un outil permettant de rassembler, de manière anonyme, sécurisée et factuelle, les informations nécessaires à l’évaluation de la diversité, l’équité et l’inclusion d’une entreprise. Cet index permettra aussi bien de photographier en un temps T la situation DEI que de mesurer son évolution, ainsi que la portée/l’efficacité des mesures et investissements déployés par l’organisation. Au niveau belge, la standardisation de l’Index permettra également aux entreprises de s’échelonner aux autres acteurs du monde économique et de communiquer plus largement sur leurs atouts respectifs d’employeurs inclusifs.
Enfin, Cohesion Belgium propose aux HR et DEI Managers une plateforme de rencontre et d’échange d’expériences et d’apprentissage, afin d’évoluer au plus vite vers ce qui nous rassemble : la vision d’une société qui nous offre à toutes et tous d’être la plus authentique et la meilleure version de nous-mêmes.

4 Forges de Clabecq, un exemple écologique

6 Les entreprises doivent montrer l’exemple


10 Le digital, ami et ennemi du développement durable
14 Interview • Emmanuel Mossay
18 Plus verte, mais pas plus rapide
22 Smartlist • Une petite histoire


24 Panel d’experts • Shifting economy
26 Chronique • Thomas De Groote


Country manager
Christian Nikuna Pemba
Creative director
Baïdy Ly
Content directors
Annick Joossen
Bryony Ulyett
Texte
Pierre Lagneaux
Thibaut Van Hoof
Photo en couverture
Tim Vannerom
Impression
Roularta
Smart Media Agency
Leysstraat 27
2000 Antwerpen
+32 (0)3 289 19 40 redactie@smartmediaagency.be Fokus-online.be
Il est aujourd’hui extrêmement délicat pour l’employeur d’obtenir des données relatives à la diversité.

Si le sujet du climat est sur toutes les lèvres, beaucoup ignorent la portée exacte des actions menées par l’Europe pour devenir plus verte. Car en 2050, l’objectif est clair : zéro émission ! Un objectif fou, mais qui pourrait se réaliser moyennant une grande mobilisation et de solides outils. Parmi eux : l’échelle de performance CO2 créée, testée et approuvée depuis 2009 par nos voisins hollandais.
Qu’est-ce que l’échelle de performances CO2 ?
L’échelle de performances CO2 est un système visant à inciter les entreprises à réduire leurs émissions de CO2, tant au niveau de leur fonctionnement que des matières premières qu’elles utilisent. Un système qui terminera sa phase de test chez nous en cette fin d’année 2023. Aurélien Bernard, auditeur chez COPRO, explique : « Le principe est simple : il s’agit d’examiner la consommation de CO2 actuelle d’une entreprise donnée pour ensuite mener celle-ci à se fixer des objectifs de réduction d’émissions ».
En pratique, l’échelle comporte quatre axes et cinq niveaux. Plus une entreprise fait d’efforts, plus elle peut monter l’échelle
jusqu’à atteindre le niveau 5. Les quatre axes, eux, visent à impliquer l’entreprise du point de vue de son empreinte carbone. Il s’agit avant tout de faire un audit de la situation (1) pour permettre à l’entreprise de se fixer des objectifs de réduction ambitieux mais réalisables (2). Il lui faudra ensuite communiquer en interne et en externe sur ses consommations et ses objectifs de réduction (3), puis participer à des initiatives du secteur concernant la réduction de CO2 (4).
L’importance de contrôler ses émissions de CO2 aujourd’hui
L’intérêt de s’impliquer dans le programme est multiple : tout d’abord, réduire sa consommation de CO2 est une nécessité environnementale. Ensuite, plus l’implication de l’entreprise est importante, plus elle sera avantagée dans le cadre des marchés publics et démontrera ses engagements écologiques auprès de ses clients et prospects.
Et demain ?
Si l’échelle de performances est encore en phase test chez nous, elle semble déjà faire ses preuves. Sa mise en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs a généré des
retours positifs, tant en Flandre qu’en Wallonie. « Ce constat permet aux Régions d’envisager une réflexion quant à une utilisation élargie du dispositif dans les marchés publics régionaux », précise Sylvie Loutz, gestionnaire de projets en développement durable au sein du SPW. Une échelle de performance qui a donc un bel avenir en Belgique et, pourquoi pas, dans les pays voisins.
Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction depuis plus de 40 ans, COPRO s’est récemment diversifié dans la certification d’échelle de performance en CO2 pour les entreprises liées au secteur routier. Grâce à son expertise, COPRO peut aujourd’hui délivrer des certificats spécifiques de sensibilisation au CO2 à toute entreprise ou projet répondant à une échelle de critères précis, évalués par des auditeurs.
La législation ne vous laissera bientôt plus le choix. L'Union Européenne, par exemple, vise à réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030 et à atteindre 45% d'énergies renouvelables, ou encore l’imposition à tous les bâtiments non résidentiels de bornes de recharge dès 2027.
Du côté des économies, l'adoption des énergies renouvelables mène à une diminution significative des coûts énergétiques. Certains de nos clients ont même réduit leur facture de 85% en une année seulement.
Quant à l'image de votre organisation, adopter une stratégie écoresponsable est une manière efficace de renforcer votre image de marque. En effet, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) influence environ la moitié de l'image d'une entreprise.
Comment votre organisation peutelle réduire ses émissions de CO2 ?
Le bilan carbone est la première étape pour obtenir une vue d'ensemble de votre empreinte carbone et de vos consommations énergétiques. Vous pourrez alors obtenir des gains faciles à mettre en place. Puis, l’audit énergétique (obligatoire ou volontaire) va plus loin en analysant en profondeur toutes vos performances énergétiques. Il identifie les technologies à implémenter et leurs investissements. Vous pouvez aussi optimiser en permanence vos consommations grâce au monitoring énergétique qui vous permet de les réduire d’environ 10%.
Mais ces étapes pourraient s’avérer insuffisantes face à la complexité de la neutralité carbone et encore plus si vous manquez de ressources humaines compétentes en la matière.
Vous pouvez alors recourir au consulting en énergie et notamment à des workshops qui permettent à votre équipe de se former et de définir des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme.
Toutes ces étapes aboutissent à l’élément indispensable pour une transition énergétique réussie : votre plan stratégique en énergie. Celui-ci vous garantira d’atteindre vos objectifs environnementaux et financiers, dans le respect des délais et du budget.
Il faut savoir qu’il est généralement recommandé d'installer des panneaux solaires pour produire une énergie verte et locale, tout en valorisant votre propriété.
Face à la difficulté de comparaison entre les fournisseurs, vous pouvez opter pour l’audit en énergie solaire Vous obtenez ainsi directement une étude complète de la centrale solaire, une estimation de la production solaire annuelle, des économies et ROI attendus.
Grâce à cet audit, vous avez ainsi une base solide pour lancer un appel d’offres efficace. Vous pouvez aussi vous en servir pour l'installation de carports solaires sur vos parkings en les couplant à des stations de recharge de voitures électriques
En quoi Helexia peut vous aider ? Helexia (Groupe Voltalia), est le partenaire idéal pour vous accompagner dans votre transition vers des solutions énergétiques durables. Nous vous aidons à réduire vos coûts énergétiques et votre empreinte carbone.

Nous prenons tout en charge : étude, installation, maintenance, et pouvons même réaliser des investissements pour vous.
Pour réussir votre transition énergétique, rendez-vous ici : helexia.be/fr/réussir-votre-transition ou via ce QR code :
En trois mots : législation, économies, image.
"La législation ne vous laissera bientôt plus le choix."
À propos de.
Actuellement, des discussions sont en cours concernant la mise en place d’un secrétariat belge dédié à la gestion de l’échelle de performance CO2.

Fermé en 1996, le site des Forges de Clabecq est longtemps resté un chancre économique, vestige d’un passé industriel et d’un drame social qui a coûté des milliers d’emplois. Mais aujourd’hui, l’ensemble du site est en pleine métamorphose, preuve qu’un site industriel et polluant peut connaître une nouvelle vie.
Durant plus de 20 ans, le nom des Forges de Clabecq a été synonyme de faillite d’une entreprise, de grèves parfois violentes et du licenciement de plusieurs milliers de travailleurs. À l’entrée de la ville de Tubize, le site de 87 hectares a longtemps été une cicatrice à ciel ouvert. Mais tout a changé en quelques années. Il y a d’abord eu la phase de démolition et de dépollution du site par Duferco, et puis la création des premiers lotissements. Car c’est une nouvelle petite ville qui va prendre place sur le site, avec des milliers de logements, des écoles, des services publics et des commerces.
en septembre 2024, soit 20 ans après la naissance des premiers projets sur le site, comme le raconte Pascal Seret, promoteur du projet. « La première prise de contact que j’ai pu avoir à Tubize remonte à 2004, mais le site venait de fermer et il était trop tôt pour lancer un projet », se rappellet-il. « Je suis revenu à la charge en 2013 après avoir croisé une échevine de l’époque. L’assainissement était déjà bien entamé et il manquait juste une idée phare pour enclencher les grands projets. »
Contact est alors pris avec Duferco, propriétaire du site, pour entamer une réflexion globale. « Ce projet d’outlet était ma première idée et nous avons obtenu en avril 2015 l’accord du Collège communal.. Le projet tel que nous l’avons porté dès le début reposait sur une mixité au niveau du bâti. Il n’était pas question de créer un ghetto de commerces ou de logements, mais d’offrir des endroits de partage. Nous avons rebâti une ville dans la ville. »
— MICHEL JANUTH BOURGMESTRE DE TUBIZEou encore agriculture urbaine, avec 9.500 mètres carrés d’espaces dédiés à l’agriculture sur les toits des bâtiments, soit la plus grande ferme urbaine d’Europe. Des coulées vertes existantes ont aussi été conservées au niveau des espaces extérieurs, et des bassins d’orages font évidemment partie du projet. »
On l’a compris, cet outlet doit être une belle porte d’entrée à l’ensemble d’un projet urbanistique qui court encore sur de longue année, pour donner un souffle nouveau à Tubize. « Cela réinvente Tubize, tout simplement », se réjouit Michel Januth, bourgmestre de la ville. « On offre une vision plus moderne de la ville que l’on fait passer d’une cité industrielle à une ville contemporaine. On ne tombe pas non plus dans la caricature de la cité-dortoir puisqu’à côté du logement, on crée une activité économique avec des commerces et du loisir. »

Certains sont déjà prêts, mais le plus attendu est sans aucun doute le Tubize Outlet Mall. Les murs du futur centre commercial sont déjà construits et cet ensemble de 17.000 mètres carrés de magasins prend forme de jour en jour, pour une ouverture prévue aux dernières nouvelles
Une ville qui doit en plus répondre aux défis actuels et faire de ce site anciennement pollué un exemple régional. « Je me suis toujours battu pour faire des promotions axées sur l’énergie verte, la passivité, les matériaux de qualité, tout en restant sur des prix attractifs. On a misé sur tout ce qui fait un bon projet moderne aujourd’hui : photovoltaïque, diminution de la place de la voiture dans l’espace public
Et si ce projet repose avant tout dans les mains d’investisseurs privés, les autorités locales ont aussi eu leur mot à dire. « Notre volonté était vraiment de mettre le focus sur le développement durable, la mobilité douce, etc.» poursuit le bourgmestre. « Dans les permis qui ont été accordés pour les différentes phases, nous sommes toujours restés attentifs à maintenir un concept où la voiture ne serait pas trop présente et où la nature serait respectée. »
Le projet tel que nous l’avons porté dès le début reposait sur une mixité au niveau du bâti.
Il n’était pas question de créer un ghetto de commerces ou de logements.
— PASCAL SERET PROMOTEUR DU PROJET
On offre une vision plus moderne de la ville que l’on fait passer d’une cité industrielle à une ville contemporaine.
Si apprendre à consommer moins, mieux, local et durable est une notion qui s’est largement développée aujourd’hui d’un point de vue alimentaire ou vestimentaire par exemple, le sujet reste encore assez flou quant à notre consommation énergétique au quotidien. Pourtant, qu’il s’agisse de consommation professionnelle ou privée, la question de savoir comment amorcer la transition énergétique est essentielle si l’on veut atteindre nos objectifs en 2030 et réduire drastiquement notre empreinte carbone. Mais comment faire ? L’une des solutions proposées en Belgique : les communautés d’énergies renouvelables. Explications, fonctionnement et avantages.
Une communauté d’énergies renouvelables : de quoi s’agitil exactement ?
L’idée d’une communauté d’énergies renouvelables est de produire une énergie verte et locale et de la mettre à disposition de différents consommateurs locaux, qu’ils soient simplement citoyens ou à la tête d’une entreprise de la région. Selon le nombre de participants au projet, chacun pourra bénéficier d’une quotité d’énergie renouvelable moins chère à déduire de sa facture émise par un fournisseur traditionnel. Un système aux multiples avantages puisqu’au-delà d’offrir une énergie plus verte et plus abordable financièrement, il permet à tout un chacun d’investir dans l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes et de pouvoir ainsi amorcer une transition énergétique durable.
Si le principe est assez simple, il demande néanmoins de la part des participants un certain investissement. Comme le précise Olivier Bontems, Directeur Energie
et de consommer.
et Solutions Durables chez IDETA, Agence de Développement Territorial en Wallonie picarde : « prendre part à une communauté d’énergies renouvelables c’est véritablement prendre conscience de l’intérêt d’amorcer sa transition énergétique et démontrer sa motivation à participer à un projet mutuel, collectif ». Car se lancer dans une communauté, c’est en réalité choisir de devenir membre d’une ASBL, et donc de participer un minimum à la vie de cette communauté, de travailler et de s’engager ensemble.
Changer ses habitudes pour changer le monde
Pour qu’une communauté d’énergies renouvelables puisse fonctionner correctement et surtout se consolider
avec le temps, chaque citoyen devra évidemment s’impliquer, croire au projet et se donner les moyens de le mener à bien. Pour cela, la flexibilité et l’ouverture aux changements seront les maîtres mots. Olivier Bontems précise : « Nous avons pris l’habitude de mettre en route nos appareils ménagers énergivores la nuit car les fournisseurs traditionnels proposent des tarifs plus avantageux après 22h. Avec les énergies renouvelables, le principe est différent, puisque l’énergie sera plus abondante et moins chère lorsque la source naturelle utilisée sera la plus puissante. Pour le photovoltaïque, qui fonctionne grâce au soleil, les meilleures heures de fonctionnement seront donc en pleine journée ! ». Un changement d’habitudes qui doit être collectif et qui passe par un changement de gestion de notre consommation énergétique.
Vers une transition énergétique durable…


Si le chemin vers la transition énergétique est bien amorcé depuis plusieurs années, il reste évidemment des actions à mener, des projets à développer et des mentalités à changer. Prendre conscience, c’est garder constamment à l’esprit les trois piliers d’une consommation plus responsable. Tout d’abord consommer moins, à tous niveaux. Ensuite, transformer notre consommation résiduelle, nécessaire à notre vie, en une consommation durable. Dans le cas des énergies, cela passe par de nouvelles installations permettant la production d’énergies renouvelables. Et enfin, consommer mieux. « Les opérations de partage d’énergie rejoignent clairement ce troisième pilier puisque les énergies proposées aux consommateurs sont intermittentes, c’est-à-dire qu’elles demandent de l’adaptation pour jouir pleinement de tous leurs avantages », rappelle Olivier Bontems.
À propos de.
Depuis 1991, l’Agence de Développement Territorial IDETA et ses 70 collaborateurs sont au service des communes, entreprises et citoyens de la Wallonie picarde. Une mission de développement territorial qui vise à booster l’essor de la région mais aussi à promouvoir son développement durable grâce à la production d’énergies renouvelables, à la création de communautés de partage d’énergie et à la sensibilisation à la transition énergétique. www.ideta.be
Cela peut paraître simpliste, mais pour s’investir pleinement en faveur de notre planète, il faut avant tout prendre conscience de nos modes de fonctionnement.
Participer à une communauté d’énergies renouvelables, c’est une véritable démarche sociologique qui demande quelques adaptations dans sa manière de vivre
Les communautés d’énergies renouvelables : œuvrer ensemble pour une consommation plus verte

Qui dit développement durable dit investissements. Mais au-delà de cela, les entreprises doivent aujourd’hui réfléchir à leur environnement direct pour continuer à se développer tout en relevant les défis énergétiques et écologiques qui feront leur développement de demain.

Pour se développer et répondre aux défis sociétaux et climatiques, toutes les entreprises doivent revoir leur manière de fonctionner. Cela pour échapper à de nouvelles taxes, mais aussi pour diminuer leurs dépenses énergétiques, notamment. Mais quand on parle d’environnement au sens large, cela inclut aussi l’environnement direct d’une entreprise, et la manière dont elle évolue et s’intègre dans son quartier.
Le site de Tour et Taxis, à Bruxelles, représente un bel exemple de projet urbanistique qui prend place dans un quartier tout en le redynamisant. Une histoire qui a commencé il y a 22 ans, sur un site dont on faisait déjà référence au 15e siècle. Tout un programme. « Depuis le milieu des années 2000, il a fallu s’adapter au marché et au monde actuel », confie Olivier Kempen, Sales&Hospitality Manager. « Je suis arrivé ici en 2006, au moment du lancement du projet de l’entrepôt royal. Déjà pour ce projet, la volonté était de protéger au maximum le patrimoine industriel de Bruxelles. »
Au fil des années, d’autres parties du site ont connu une nouvelle vie. Dernier projet en date : l’Hôtel des douanes. Et puisque les choses ont évolué depuis une vingtaine d’années, la réflexion globale s’est précisée. « On parlait très peu de durabilité au départ, c’est arrivé au fil des années. Mais avec la pandémie du Covid et la crise énergétique ensuite, ces questions ont pris une dimension plus importante. Le premier élément à prendre en compte est la circularité, avec un maximum de récupération de matériaux dans des bâtiments auxquels on donne une nouvelle vie. Tous les éléments nouveaux sont là pour amener de nouvelles technologies et améliorer la performance des bâtiments, avec une ambition de neutralité. Cela passe par des pompes à chaleur, des panneaux solaires ou encore la récupération des eaux de pluie. »

Et l’ouverture vers l’extérieur complète le tableau. « C’est un quartier entier qui s’ouvre sur Bruxelles avec des bureaux, des expos, des événements et toute une partie du site qui repose sur les loisirs. On a 600 ans d’histoire derrière nous, et on veut en construire encore 600 autres à venir. »
Au niveau public, des organes agissent aussi pour créer des pistes de réflexion et nourrir des projets communs entre des entreprises qui cohabitent dans un parc économique. Un exemple avec l’inBW,
l’intercommunale du Brabant wallon, qui possède plusieurs parcs d’activités.
« Pris un à un, ces bâtiments sont privés et nous ne pouvons pas demander à ces entreprises plus que ce qu’on leur demande déjà au niveau de la législation », explique Valérie Kessen, directrice du département économique de l’inBW. « Par contre, nous sommes actifs au niveau des aides qu’ils pourraient recevoir et surtout sur la gestion des parcs d’activités. Ensuite, il y a nos propres bâtiments. Nous sommes occupés à réaliser un audit de l’ensemble de nos parcs immobiliers. Le but étant de cibler tous les projets à mener pour répondre à des critères de durabilité et d’écologie. Cette réflexion vaut aussi pour les futurs parcs d’activités qui sortiront de terre dans les années à venir. À NivellesNord, nous avons par exemple protégé une partie du site, avec la collaboration du DNF et de Natagora. »
Environnement Écoutez maintenant le dernier épisode du Fokus Podcast.
Dans la gestion de ses parcs d’activités, l’inBW se présente comme un syndic responsable d’une copropriété. « Avec ce statut, nous travaillons au développement du caractère durable de nos parcs. On veut aller plus loin avec une charte urbanistique pour chaque parc», indique Valérie Kessen. « Il y a aussi un changement de mentalité à opérer pour les futurs projets. Pourquoi ne pas miser sur des bâtiments mitoyens, par exemple ? »
Le Parlement wallon a adopté un décret sur les communautés d’énergie. Cette législation introduit de nouveaux concepts, dont la possibilité de développer de nouvelles formes de partage d’énergie, que ce soit en participant à une communauté d’énergie citoyenne (CEC) ou renouvelable (CER), ou en partageant de l’énergie renouvelable produite collectivement au sein d’un même bâtiment.
On parlait très peu de durabilité au départ, c’est arrivé au fil des années.
— OLIVIER KEMPEN TOUR & TAXIS
Découvrez l’implantation unique et privilégiée du projet Paradis Express situé face à la gare des Guillemins.

> Appartements 1 à 4 chambres énergétiquement performants


> Premières livraisons fin avril 2023
> Prix fixe garanti
Rue Paradis 90, Liège
04 268 22 00
www.matexi.be
La marque espagnole de mobilité Silence, distribuée par Astara Western Europe, ouvre son premier Urban Store belge à Bruxelles. Vous pourrez y découvrir sa gamme complète de scooters électriques et bientôt la toute première Nanocar S04.


Silence est l’un des principaux fabricants de scooters électriques en Europe et a comme ambition de rendre nos villes surchargées plus accueillantes.
Depuis plus de dix ans, Silence conçoit, développe et fabrique des scooters électriques et des batteries rechargeables sur base de sa propre technologie.
Fondé à Barcelone, la société a rapidement connu le succès et représente aujourd’hui 30 % du marché
européen des scooters électriques. Les scooters S01, S01+ et S02 sont désormais visibles dans les rues et et la Nanocar S04 le sera bientôt.
Ce qui rend Silence unique, c’est son système de batterie, partagé par son scooter et la Nanocar. Cette batterie est amovible et interchangeable et peut être transportée facilement grâce à son système de trolley. Elle peut également être facilement rechargée sur une prise de courant classique et utilisée comme source d’énergie. À terme, Silence souhaite installer des stations de recharge dans chaque ville, de sorte que ses véhicules puissent également être achetés sans batterie, mais qu’ils puissent être loués, utilisés avec facilité et rechargés à différents endroits de la ville.
Les véhicules sont également connectés à internet et
à des outils en ligne très pratiques via l’application My Silence (utilisateurs privés) ou l’application Silence Connected (gestionnaires de flotte et utilisateurs professionnels, par exemple pour les livraisons).
A propos du choix du lieu bruxellois, Maaike, responsable de la marque, explique : « Nous avons commencé à chercher un lieu qui corresponde à notre vision et à notre ambition. Tour & Taxis est un site novateur et élégant qui accorde de l’importance au développement urbain et au recyclage. Nous voulons nous renforcer mutuellement, aujourd’hui et encore plus à l’avenir. »
Silence est constamment à la recherche de solutions de mobilité innovantes et durables qui rendent la vie plus agréable et plus efficace. L’Urban Store de Tour & Taxis est un premier pas dans la nouvelle histoire de la Belgique. THE
Le premier Urban Store belge de scooters électriques et de Nanocars
S’il est important pour nous, citoyens du monde, de s’engager activement pour la durabilité, il en va de même pour nos entreprises belges. Qu’elles œuvrent dans le secteur marchand ou non marchand, elles doivent donner l’exemple, mais aussi et surtout pouvoir répondre aux nouvelles exigences européennes pour rester pérennes. Focus sur l’importance de soutenir l’innovation pour une économie circulaire en Belgique.
Vers des entreprises plus durables
L’économie circulaire et la durabilité sont des concepts largement utilisés aujourd’hui. Mais, adaptés aux entreprises, que signifient-ils exactement ? Stefaan Sonck Thiebaut, Directeur Général d’Innoviris, explique: « L’économie circulaire, c’est en fait l’utilisation optimale des ressources tout au long du cycle de vie d’un produit. Et ça sous-entend plusieurs niveaux : il s’agit d’abord de penser les produits différemment, de travailler sur d’autres types de business plan pour optimiser la manière de confectionner le produit, avec moins de ressources et d’énergies. Ensuite, il faut étendre la durée de vie du produit de différentes façons et, finalement, en fin de cycle, il s’agit de savoir comment utiliser et recycler les déchets rejetés par le produit ». Un processus complexe qui demande évidemment des compétences et des savoir-faire spécifiques pour parvenir à trouver la solution la plus adaptée à son produit. Et à cet égard, aujourd’hui en Belgique, nous avons plus que jamais besoin d’innover. « L’innovation est primordiale ! C’est grâce à toutes les nouvelles idées qui vont germer dans les esprits créatifs que nous pourrons faire fonctionner de nouveaux modèles économiques », argumente Stefaan Sonck Thiebaut.
Soutenir l’innovation : un pilier essentiel pour amorcer le changement
Créer une économie plus juste et durable au sein de nos entreprises grâce à l’innovation va permettre de les rendre plus compétitives sur le marché. D’une part parce qu’elles vont cesser d’utiliser certains réseaux d’approvisionnement devenant petit à petit moins disponibles, mais aussi parce qu’elles vont apprendre à devenir résilientes face aux crises. Et, in fine, ces entreprises seront dans une position plus forte pour attirer des talents, des investisseurs et des consommateurs de leurs produits qui se tournent de plus en plus vers des entreprises vertes pour tous types de consommation. «C’est pourquoi il est fondamental d’apporter notre soutien aux projets d’innovation allant dans le sens de la circularité », précise Stefaan Sonck Thiebaut.
Soutenir l’innovation, oui, mais comment? En réalité, ce soutien passe par plusieurs axes. Comme l’explique Stefaan Sonck
Thiebaut, il s’agit d’abord d’apporter une aide financière aux projets les plus porteurs. « Chez Innoviris, nous analysons les différents projets qui émergent en Région Bruxelles-Capitale selon des critères alignés avec la stratégie de la Région, la ’’Shifting Economy’’. Et lorsque l’analyse montre que le projet est innovant, aura un impact positif pour l’entreprise et le potentiel d’un impact positif, social ou écologique pour la Région, nous le cofinançons ». Mais ce n’est pas tout. Sensibiliser les entrepreneurs en devenir à la durabilité et aux aides dont ils pourraient disposer est également un pan essentiel de la démarche. Si l’on constate aujourd’hui qu’à peu près 70% des entrepreneurs bruxellois souhaitent s’engager dans l’économie circulaire, seuls 30% sont réellement au courant des aides disponibles « C’est pourtant par une modification de fonctionnement de nos entreprises locales que nous pourrons atteindre nos objectifs de neutralité carbone », explique Stefaan Sonck Thiebaut. Si bon nombre de projets positifs voient le jour, il reste donc essentiel de parler davantage du sujet et d’aider les entrepreneurs à comprendre les aides que les régions ont à leur offrir, car elles sont nombreuses !
Aujourd’hui, demain, et après ?
Afin d’assurer un avenir serein pour nos entreprises, il faut continuer à encourager les démarches d’innovation durables et permettre aux entreprises de confronter leurs idées ingénieuses avec la réalité. La dynamique circulaire est très forte actuellement, mais cela ne suffit pas. « Il faut poursuivre notre soutien auprès de nos entreprises afin qu’elles passent du stade de l’idée à celui de la concrétisation. Ce qui est essentiel, c’est d’aider nos régions à mettre sur pied des entreprises durables. », conclut Stefaan Sonck Thiebaut.

Un constat tout de même très positif qui laisse entrevoir de belles avancées et des changements motivants pour l’avenir.
Innoviris est un organisme public dont le rôle est de soutenir la recherche et l’innovation à BruxellesCapitale en ciblant les PME, les centres de recherches, le secteur non marchand et le secteur public. Mais aussi en apportant de la sensibilisation et du soutien à travers les Circular Innovation Journey qui aident les entreprises à connaître et mieux comprendre les différentes aides proposées par la Région.
STEFAAN SONCK THIEBAUT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ce qui est essentiel, c’est d’aider nos régions à mettre sur pied des entreprises durables.
L’innovation est primordiale ! C’est grâce à toutes les nouvelles idées qui vont germer dans les esprits créatifs que nous pourrons faire fonctionner de nouveaux modèles économiques.
Presque toutes les entreprises dans le monde réfléchissent aux moyens de fonctionner de manière plus durable. Mais estce plus facile ou plus difficile quand elles ont une certaine taille ? Réponse de l’une des plus grandes entreprises au monde.
Avec quelque 127 000 collaborateurs, un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards d’euros et 400 marques en portefeuille, la société hollandaise Unilever est un géant à tous points de vue. En termes de durabilité, cela présente à la fois des avantages et des défis, explique Tom Smidts, CEO. « L’avantage, c’est qu’avec des changements parfois minimes, nous pouvons faire rapidement une différence considérable. Rien qu’en Belgique, nous vendons environ 300 millions de produits par an, via lesquels nous pouvons avoir un impact. Notamment en concevant de plus petits emballages, en utilisant de meilleurs matériaux ou en optimisant notre logistique et notre chaîne d’approvisionnement. Nous pouvons y travailler en tant que grande entreprise disposant des ressources et de l’attention nécessaires. L’inconvénient est que nous opérons dans de nombreux pays et que nous fonctionnons avec une chaîne d’approvisionnement mondiale. Il n’est donc pas évident de procéder à certains ajustements, en particulier pour la Belgique. »
Unilever souhaite devenir une entreprise ‘‘net zero’’ d’ici 2039, ce qui signifie que ses émissions nettes de CO2 seront nulles. « Au niveau des produits, nous avons déjà pris des mesures considérables », explique M. Smidts. « D’ici 2025, nous ne voulons utiliser que des emballages entièrement recyclables, recyclés ou compostables. En Belgique, nous en sommes déjà à 96 %. Nous réduisons massivement l’utilisation de ‘‘plastiques vierges’’ (plastique nouvellement produit, ndlr) et serons sous les 50 % d’ici 2025.

Nous évaluons également nos émissions et notre impact dans la chaîne logistique. Nous réduisons au maximum les distances parcourues par nos camions et aux PaysBas, entre autres, nous expérimentons des camions électriques afin de réduire les émissions de CO2 ».
Mais tout cela n’empêche pas M. Smidts d’affirmer qu’il faut maintenir un équilibre entre économie et écologie. Car si ces efforts ne sont pas rentables sur le plan économique, ils ne seront bien souvent pas viables à long terme. Les consommateurs ont également un rôle important à jouer en modifiant leur comportement d’achat et de consommation. « Nous avons par exemple créé des ‘‘éco-recharges’’ pour Cif: de petites recharges dans lesquelles il suffisait d’ajouter de l’eau et qui contenaient 75% d’emballages plastiques en moins. Le hic? Les consommateurs s’imaginaient qu’ils disposaient ainsi d’une moindre qualité de produit. Nous avons rencontré le même problème avec les déodorants concentrés ou les produits de lessive. En outre, la durabilité entraîne un coût supplémentaire qui peut se traduire par un surcoût en magasin, ce qui peut constituer un obstacle pour les consommateurs. Il est donc aussi de notre responsabilité de bien communiquer et de conclure de bons accords avec les retailers. Une dynamique positive s’est créée avec les principaux retailers et fournisseurs pour mettre en place des initiatives, au-delà des frontières de l’entreprise, visant à rendre notre secteur plus durable. »
Unilever a été fondée en 1930, à la suite de la fusion de l’entreprise productrice de margarine néerlandaise Margarine Union et du fabricant de savon britannique Lever Brothers. L’entreprise possède des centaines de marques domestiques telles que Dove, Knorr, Omo, Rexona et Lipton. Chaque jour, ces produits sont utilisés par 3,4 milliards de personnes. Le groupe emploie 127 000 personnes. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 60 milliards d’euros.
« Concernant l’approvisionnement de nos produits alimentaires, des programmes d’agriculture régénératrice sont en cours avec notre fournisseur Ardo pour récupérer, filtrer er réutiliser l’eau dans les cultures. Nous travaillons également avec Too Good To Go pour diminuer la quantité de déchets alimentaires et avons ainsi déjà pu éviter le gaspillage de plus de 15 000 portions depuis 2020. Chaque vendredi, nous organisons aussi notre FREE’day: nos collaborateurs se voient offrir un repas gratuit préparé avec les restes de la semaine. Ce qui nous évite de devoir les jeter juste avant le week-end. »
Selon M. Smidts, des incitants gouvernementaux peuvent également jouer un rôle bénéfique. « En Belgique, nous subissons une accumulation de taxes, de droits et de charges qui contribuent à ce prix élevé et affectent négativement notre compétitivité par rapport à d’autres pays. J’invite donc les gouvernements et les parties prenantes à ‘‘récompenser’’ davantage les entreprises et les consommateurs qui font des choix durables, par exemple en réduisant les impôts, la TVA ou les aides à l’investissement. Ce qui bénéficiera à l’équilibre entre économie et écologie et à la durabilité dans son ensemble.»
TOM SMIDTS CEO
Il est très difficile de faire payer un supplément pour des produits écologiques. C’est un obstacle de taille pour les consommateurs, surtout à l’heure actuelle.
L’avantage de notre taille est qu’avec des changements parfois minimes, nous pouvons créer rapidement un impact considérable.
L’intelligence artificielle et ses milliers d’applications ouvrent des portes vers des innovations qui permettront d’accompagner les citoyens et les entreprises vers le développement durable. Mais chaque donnée utilisée provoque aussi de la pollution.
Digital, numérique, intelligence artificielle, données mobiles ou encore Internet… Autant de mots qui sont entrés dans le langage commun et dans les programmes politiques ces dernières années. Il faut dire qu’on ne peut plus faire évoluer un pays ou une entreprise sans compter sur les nouvelles technologies. Mais où sont les limites de la digitalisation ? On évoque le plus souvent les problèmes liés à la sécurité ou à la protection des données, mais la pollution générée par tous les appareils digitaux (smartphone, ordinateurs, etc) et autres data centers est conséquente.
C’est sur ces questions que travaille au quotidien l’Institut Belge du Numérique Responsable. « La question n’est pas de savoir s’il faut continuer à digitaliser, mais surtout comment le faire », confie Jules Delcon, Business Developer pour l’Institut Belge du Numérique Responsable. « On parle aujourd’hui des enjeux environnementaux et des outils qu’on peut utiliser pour encourager le développement durable. Le digital est un
allié pour y arriver, mais seulement si on l’utilise bien. Le numérique apporte clairement des bénéfices à nos entreprises : l’accès à l’information, à la formation… c’est génial tout ce qu’on peut faire aujourd’hui à partir d’un smartphone. Le numérique peut aussi répondre à beaucoup de besoins en termes de développement durable et d’accompagnement des entreprises dans leur consommation d’énergie, par exemple. »
Mais les entreprises actives dans le numérique génèrent aussi leur propre empreinte carbone. « Le numérique repose sur des ressources qui ne sont pas illimitées. Je pense à tout ce qu’il faut pour construire un smartphone ou un ordinateur, notamment les métaux rares. Et en même temps, l’objectif aujourd’hui doit aussi être d’avoir un numérique inclusif et utile à tous. Personne ne doit être laissé de côté. Il faut donc mener un travail de sensibilisation à ce niveau. Faire comprendre qu’un smartphone pollue énormément quand on le construit, c’est assez facile. Mais faire comprendre qu’il pollue aussi
— MATHIEU MICHEL SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA DIGITALISATION, CHARGÉ DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA RÉGIE DES BÂTIMENTS
quand on l’utilise, c’est plus compliqué. Ce n’est pas comme laisser un robinet ouvert et laisser couler l’eau. La pollution se produit parfois à des milliers de kilomètres, via des data centers. Et puis, il y a aussi la question de la seconde vie de tous ces appareils. On est encore trop peu avancé au niveau du recyclage et de la seconde vie qu’on leur donne. »

Il est donc important d’encadrer le numérique et toutes ses ramifications au niveau législatif, comme l’explique Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation. « La digitalisation peut être un allié dans un tas de domaines, mais ne l’est pas par défaut. Comme pour toutes les innovations, il faut l’utiliser correctement si on veut qu’elle ait un impact positif durable. »
Mais comment agir concrètement ? « Pour certaines utilisations, la sobriété numérique est un concept davantage pris en considération. Cela passe par un meilleur rendement des data centers, par exemple en récupérant la chaleur qu’ils émettent pour produire de l’énergie. Mais dans l’application du digital, on peut agir sur beaucoup de choses. On peut agir sur la consommation d’énergie de tous les bâtiments publics, avec la possibilité de pouvoir chauffer pièce par pièce quand c’est nécessaire. Je pense aussi aux voitures partagées et aux applications qui permettent la gestion d’une flotte de véhicules. Dernier exemple avec le portefeuille digital que nous sommes occupés à mettre en place et qui permettra, à terme, d’économiser des tonnes de papiers. »

La digitalisation peut être un allié dans un tas de domaines, mais ne l’est pas par défaut.
Faire comprendre qu’un smartphone pollue énormément quand on le construit, c’est assez facile. Mais faire comprendre qu’il pollue aussi quand on l’utilise, c’est plus compliqué.
Nous sommes à la veille d’une très importante transition énergétique qui verra la production d’énergie d’origine renouvelable jouer un rôle crucial. Cette transition s’accompagnera également d’un changement radical des offres tarifaires. L’entreprise wallonne Haulogy développe des logiciels qui permettent à tous les acteurs du marché de l’énergie (consommateurs, fournisseurs, producteurs, entreprises et pouvoirs publics) d’effectuer cette transition rapidement, efficacement et à moindre coût.
La transition énergétique en Europe va entraîner d’énormes changements. Haulogy conçoit des logiciels qui permettent de gérer les défis et les risques liés à cette transition. « Nous sommes un éditeur de logiciels qui propose des solutions informatiques aux fournisseurs d’énergie, aux producteurs, aux opérateurs d’équilibrage et aux gestionnaires de réseau, ainsi qu’aux grands consommateurs d’énergie ou aux entreprises qui souhaitent réduire leur facture énergétique grâce à un monitoring intelligent », explique Bart Focquaert, directeur des ventes.
À cette fin, Haulogy dispose d’outils logiciels destinés à différents acteurs. « Les fournisseurs d’énergie utilisent AMEO Supply Hub, pour offrir à leurs clients une traçabilité complète de leur bouquet énergétique. Cela permet aux consommateurs de mieux connaître l’origine de leur énergie, mais aussi aux fournisseurs de facturer des prix différents pour l’énergie produite par leurs éoliennes, par exemple, par rapport à l’énergie qu’ils achètent sur les marchés de gros. Cela permet également de rendre leurs clients actifs. »
Pour les opérateurs de réseaux, Haulogy a également développé la plateforme SANO. « Elle permet une gestion active du réseau », explique Charles Delhaye. « Elle peut, par exemple, prédire où et quand des congestions sont attendues en chaque point du réseau. Notre algorithme d’IA prend en compte les données météorologiques pour une extrême précision des prévisions d’injection et de prélèvement. »


« Depuis notre création en 2005, nous avons constamment réagi aux nombreux changements du marché de l’énergie», explique Charles Delhaye, directeur général. « D’abord la grande vague de libéralisation de 2005 avec l’apparition de nombreux nouveaux acteurs sur le marché, puis la vague de numérisation. Et aujourd’hui, nous nous concentrons pleinement sur la transition énergétique en cours. »
Des faits nouveaux
« L’évolution vers les énergies renouvelables rend l’offre et les prix beaucoup plus difficiles à prévoir. En outre, nous restons encore très dépendants des combustibles fossiles et le rôle de l’énergie nucléaire est appelé à diminuer. Sans parler des événements géopolitiques qui impactent considérablement les prix de l’énergie. Cela rend le marché plus imprévisible mais crée aussi des opportunités. Ceux qui sauront en tirer parti paieront leur énergie moins cher. »
Autre outil : AMEO Optiflex, qui permet aux grands consommateurs de contrôler leur consommation d’énergie. « Ces entreprises ont généralement un contrat d’énergie incluant des prix dynamiques qui varient d’heure en heure en fonction de l’offre », explique Charles Delhaye. «Le logiciel leur permet de contrôler intelligemment leurs parcs de machines, leurs entrepôts frigorifiques, leurs batteries ou leurs stations de recharge. Lorsque les prix sont bas, le système veille à ce que les batteries soient complètement chargées, pour que, lors des pics de prix, le prélèvement sur le réseau soit le plus faible possible. Il en résulte une réduction des coûts et des émissions de CO2. Auparavant, cette approche n’était bénéfique que pour les très gros consommateurs ; aujourd’hui, en raison de la forte fluctuation des prix, davantage d’entreprises peuvent en bénéficier.


Pour tous les acteurs du marché de l’énergie, il existe également la solution AMEO Hedging, qui permet d’effectuer des analyses rétrospectives et futures de la demande et du prix de l’énergie. « Cela permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des objectifs d’efficacité énergétique et de réduction de l’empreinte carbone. »

« C’est notre vision holistique qui distingue Haulogy de ses concurrents », souligne Bart Focquaert. « Nous gérons l’ensemble des éléments pour nos clients : stockage des batteries, tarification dynamique, consommateurs d’énergie qui produisent, stations de recharge, panneaux solaires... De plus, nous sommes totalement indépendants de leur fournisseur d’énergie. »
« Depuis notre création en 2005, nous avons constamment réagi aux nombreux changements du marché de l’énergie »

Dans les années à venir, l’importance de ces calculs ira croissante, car les directives de l’UE orientent les citoyens et les entreprises vers les énergies renouvelables et la réduction des émissions de CO2. « Ce tournant est délicat pour les entreprises, car il ne fait pas partie de leur cœur de métier. Grâce à notre offre logicielle, nous pouvons donc les décharger entièrement de cette préoccupation. » haulogy.net
Charles Delhaye Directeur général Bart Focquaert Directeur des ventes Charles Delhaye, directeur général
Avec les différentes crises traversées ces dernières années, le modèle de l’économie sociale émerge. Au sein de celui-ci, le secteur de la seconde main a le vent en poupe. Les Petits Riens sont certainement l’acteur du secteur le plus connu des Belges, mais soupçonne-t-on l’impact social et environnemental qui se cache derrière cette organisation ?
Aujourd’hui, le secteur de la seconde main profite de l’engouement du public pour le vintage. Acteur incontournable, les Petits Riens récupèrent chaque année 8000 tonnes de dons et disposent d’un réseau de trente magasins de seconde main dans tout le pays. Actifs dans le secteur depuis des décennies sur base d’un modèle d’économie sociale et solidaire, ils voient arriver une concurrence d’acteurs privés de plus en plus forte. Face à cet afflux, les Petits Riens se différencient grâce à un impact social fort et à un impact environnemental évident.

Pour Emmanuel Bawin, directeur général des Petits Riens, trois enjeux clés sont à cibler par rapport à cette nouvelle réalité du secteur de la seconde main. Trois enjeux au cœur desquels se trouve l’engagement social et environnemental des Petits Riens : « D’un point de vue environnemental, il est impensable que des vêtements traversent toute l’Europe pour arriver chez nous. Au niveau social, il faut que les personnes qui travaillent sur cette chaîne puissent soit être en formation, soit avoir un job alors qu’elles sont éloignées de l’emploi. »
Au-delà de ces enjeux sociaux et environnementaux, le directeur général des Petits Riens souligne celui de la digitalisation qui doit devenir un levier pour accroître l’engagement citoyen. « Notre conviction première est qu’il faut garder du commerce physique en matière de seconde main. Ce qui permet de vivre une véritable expérience, tant pour les clients que pour nos travailleurs en insertion. Cependant, en parallèle, nous sommes conscients de l’importance du commerce en ligne. Nous développons actuellement notre propre plateforme avec pour objectif que chaque transaction effectuée ait un impact. Un impact environnemental, car nous restons dans le périmètre de la Belgique, mais aussi un impact social. En effet, il sera possible de reverser tout ou partie de la transaction effectuée pour financer une action sociale des Petits Riens. Grâce à la digitalisation, nous voulons prouver qu’il est possible d’avoir plus d’impact et d’augmenter l’engagement des citoyens. »
Les impacts sociaux et environnementaux sont donc au cœur même de l’économie sociale. Un choix qui n’est pas des plus évident pour les sociétés qui font le choix de ce modèle, comme le souligne Emmanuel Bawin : « Ce n’est pas un petit enjeu. Nous sommes une entreprise d’économie sociale et, dans ce contexte, nous sommes soumis à une double contrainte. Il y a celle de nos ambitions sociales : nous faisons tout pour atteindre nos objectifs sociaux. Nous pilotons notre organisation avec un tableau d’impacts social et environnemental. Mais nous sommes aussi sur un marché où il y a une réalité économique. Notre activité économique doit répondre à une exigence de rentabilité: 80% de nos recettes proviennent de nos ventes, et 20% seulement proviennent de subsides. » Une réalité impactée par les crises successives : « Nous sommes dans une logique d’entreprise, nous l’avons toujours été, même avant les crises successives. Celles-ci ont accentué un rapport difficile. Il y a un véritable challenge pour faire face à des besoins au niveau social de plus en plus fort avec l’augmentation de la précarité et de nos publics bénéficiaires alors que nos moyens pour y faire face s’amenuisent. Cette capacité de traverser les crises avec un tel niveau d’ambitions sociales et environnementales tout en étant exposé au marché comme n’importe quel autre acteur est un challenge au quotidien. »
Un challenge qui anime particulièrement Les Petits Riens, comme conclut Emmanuel Bawin : « Ce modèle est un modèle d’avenir. A l’heure où les citoyens sont à la recherche de réponses à des crises environnementales et sociales successives, des organisations comme la nôtre prouvent qu’il est possible d’allier activité économique tout en créant un impact environnemental et social fort. Ce modèle est rendu possible par la solidarité et le collectif. Si je prends l’exemple des Petits Riens, chaque matin, ce sont mille personnes qui sont sur le pont. J’ai tendance à dire que l’équipe est plus grande que ça, car il y a aussi toutes les personnes qui nous font confiance et qui s’engagent à nos côtés. Cette notion de communauté engagée, c’est le cœur de l’économie sociale. »
Les Petits Riens occupent une place de premier rang dans le secteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 85 ans. Notre activité de collecte, tri et vente de biens de seconde main, en plus de son impact environnemental positif, constitue une plateforme d’insertion socioprofessionnelle pour près de 500 personnes chaque année. En parallèle, nous développons également des actions actives dans l’accès au logement, l’emploi et l’accompagnement au quotidien des plus vulnérables.




Professeur-invité dans plusieurs universités et directeur Recherche & Innovation chez EcoRes, centre d’expertise qui accompagne les entreprises vers plus de durabilité et développe des projets sociétaux innovants, Emmanuel Mossay estime que l’économie circulaire est l’une des clés de la transition écologique.
Selon vous, quelle est la place de l’écologie dans le système économique actuel ?
« Plus de 50 % du PIB mondial dépend de la nature alors que nous restons dans une logique d’extraction et de non-préservation des ressources naturelles, pourtant essentielles à la vie et aux échanges économiques. Nous devons réencastrer l’économie dans les limites biocapacitaires pour permettre le renouvellement des ressources naturelles, en respectant les limites planétaires ainsi que le plancher social décrit par le modèle du donut. »
C’est un grand défi ?
« La population se divise en trois groupes : deux de 15 % et un de 70 %. D’un côté, nous avons les 15 % les plus militants voulant imposer la transition écologique. Aux antipodes, les autres 15 % voient un océan d’opportunités pour créer un capitalisme vert. Ces deux blocs occupent la scène médiatique avec deux récits diamétralement opposés. Le défi est de créer un récit enthousiasmant fédérant la majorité silencieuse des 70 %. »
Et au niveau mondial ?
« Tout est interrelié dans notre écosystème. Plus la population va croître, plus le commerce et les relations vont se développer à l’international et plus ces interrelations vont se complexifier. Et là, il y a un souci. Le Nord consomme la majorité des ressources et impacte le Sud par la surexploitation des ressources, des emplois indécents et l’exportation de nos déchets. Aujourd’hui, nous ne subissons pas encore les conséquences complètes de nos dérives de surconsommation, car l’écoconception de produits plus respectueux des humains et de la nature est loin d’être la norme. »
C’est ici que peut intervenir l’économie circulaire. Quelle en est votre définition ?
« Parmi les 114 définitions, j’utilise celle de l’ADEME. L’économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des biens, vise à rationaliser l’utilisation des ressources et à réduire son impact sur l’environnement, tout en augmentant le bien-être des individus. J’ajoute qu’il doit viser la robustesse de l’économie et être structuré suivant les trois étapes de l’échelle de Lansink : repenser le modèle économique, réutiliser et enfin recycler. »
L’économie circulaire est donc devenue un enjeu indispensable ?


de sa transformation en transition. Intervient aussi la double matérialité avec les normes européennes ESG qui obligent les entreprises à considérer leur robustesse face aux évolutions et changements climatiques, mais aussi à envisager les conséquences de leurs choix sur l’environnement. Enfin, la réussite de la “transition matérielle’’ repose sur des leviers immatériels. Change management, sensibilisation, formation ou mise en place de projetstests induisent une spirale positive qui entraîne la majorité des acteurs. »
Que manque-t-il pour que l’économie circulaire devienne la norme ?
De véritables mines urbaines
« Avec leurs intrants quotidiens de déchets-ressources, les ressourceries et recycleries ont une forte résilience. À Bruxelles, plus de 5 tonnes de petits déchets électriques et électroniques sont générées par jour. Or, plus de 25 % de ces équipements fonctionnent encore ou sont facilement réparables. Imaginez l’impact si nous pouvions nous approvisionner avec cette mine urbaine. Il faut aussi anticiper et écoconcevoir les produits pour augmenter leur durabilité, leur réparabilité et leur partage. »
Cette situation est-elle présente à tous les niveaux ?
« Localement, des expérimentations systémiques positives émergent comme le système de mesure par les citoyens des émissions de CO2 en situation de mobilité développé à Lathi ou à Lyon. L’expérience des habitants est géniale : la différence entre le quota mensuel et leur consommation est convertie en monnaie locale. À Bruxelles, la stratégie régionale de transition économique, la Shifting Economy, permet de transformer le cadre institutionnel soutenant la transition grâce à une coordination transversale unique des acteurs. »
« Moins de 8 % de l’économie mondiale est circulaire. L’économie mainstream n’est pas efficace pour gérer les ressources. Par exemple, 20 % de l’alimentation produite n’est jamais consommée ! Nous sommes aussi ultra-dépendants des matières premières. Pourtant, avec les déchets-ressources, nous disposons de mines urbaines pouvant recréer des chaînes de valeur partielles. Dans les années 80, tout n’a pas été délocalisé au même endroit en Asie. Les chaînes de valeur ont été fragmentées pour plus de rentabilité. Aujourd’hui, avec la relocalisation et l’économie circulaire, nous pouvons rapatrier les maillons riches en valeur ajoutée et plus proches des consommateurs. Notre lien à la consommation doit s’inverser pour prioriser l’accès à des équipements mutualisés, partagés en fabriquant des produits plus robustes afin d’augmenter le niveau de services offerts, en ajoutant le modèle de l’économie de la fonctionnalité : on ne vend pas un produit, mais une fonction et une performance. Les opportunités sont donc énormes. »
Que doit faire une entreprise pour y parvenir ?
« C’est le cœur de notre travail chez EcoRes. Nous fédérons les parties prenantes internes avec un travail collectif d’identification des opportunités et des risques d’absence de transition. Nous faisons une cartographie complète des flux de ressources et de matières, tant dans une dynamique d’économie circulaire que d’impact et d’adaptation aux changements climatiques. Nous proposons aussi de visiter des solutions existantes, l’inspiration montre où l’entreprise se situerait au terme
« La situation est encore très confortable avec une économie boostée par le pétrole. Il faut sortir de cette illusion où nous ne payons pas le vrai prix social et environnemental des objets, des ressources naturelles et encore moins de l’énergie. Les décideurs doivent devenir courageux. Des chocs, comme ceux de ces dernières années, seront nécessaires pour comprendre nos ultra-dépendances, alors que nous sommes assis sur l’or des mines urbaines. Avec des ressources moins accessibles, les prix augmentent, ce qui engendrera de plus en plus d’obligations et de contraintes, à l’image du Green Deal européen, qui doivent s’appliquer à tous les acteurs d’un secteur. Dès lors, des accompagnements seront indispensables pour innover autrement, de façon plus durable et résiliente. Grâce aux économies circulaires et de la fonctionnalité et au biomimétisme (visant à imiter les solutions développées par la nature depuis des millénaires), nous pouvons y arriver. »

L’économie circulaire, aussi pour les services
« Gesnord gère appels et rendez-vous pour des médecins. L’entreprise a constaté qu’un business model basé sur un volume d’appels n’était pas compatible avec une pénurie de sa ressource principale : les médecins. Elle a alors revu sa proposition de valeur, en développant une approche qualitative en fixant des limites de disponibilité des médecins. Ce qui a augmenté la fidélisation des clients et pérennisé l’activité. Bref, un bel exemple du principe d’économie circulaire et de la définition stricte de la préservation de la ressource. »
Quelles sont les personnalités qui vous inspirent ?
« J’ai envie de citer deux personnes : Bruno Colmant, économiste qui a notamment dirigé la Bourse de Bruxelles, et Jacques Crahay, dirigeant de l’entreprise Cosucra et ancien président de l’Union wallonne des entreprises. S’ils ont deux profils différents, ils sont tous les deux en transition et en recherche pour repenser l’équation économique face aux enjeux du changement climatique. »
Aujourd’hui, nous ne subissons pas encore les conséquences complètes de nos dérives de surconsommation.
Il faut repenser l’équation économique, la réencastrer dans les limites planétaires et sociales.
Le règne des véhicules thermiques touche progressivement à sa fin.
Le régime de déduction fiscale les concernant aussi. Mais vous pouvez encore en bénéficier jusqu’au 30 juin 2023.
À partir du 1er juillet 2023, un nouveau régime fiscal entrera en vigueur pour les voitures à moteur à combustion (y compris les hybrides). Mais comme tout le monde le sait, la fiscalité en Belgique est une matière complexe. C’est pour cette raison qu’un petit récapitulatif de la marche à suivre s’impose. Voici comment profiter du financement à temps.
Une date doit devenir votre date de référence : le 1er juillet 2023. C’est à partir de ce jour que les voitures à moteur à combustion (diesel, essence, LPG, CNG et hybrides rechargeables) ne seront plus fiscalement déductibles à vie. « Quel que soit votre concessionnaire de référence, veillez donc bien à lui rendre visite avant cette date butoir », explique Peter Van Hoylandt, Sales & Marketing director BMW Group Financial Services. En effet, votre contrat de leasing doit impérativement être conclu avant cette deadline.
Quant à la stratégie “wait and see”, elle n’est pas vraiment conseillée. « Si vous attendez encore et ne signez un contrat de leasing qu’après le 30 Juin 2023, une période de transition sera instaurée jusqu’e fin 2025 ». Dans ce cas, la déductibilité fiscale diminuera progressivement jusqu’à 0 % selon la gradation suivante : 75 % en 2025, 50% en 2026, 25 % en 2027 et 0 % à partir de 2028.
Électrique ou énergie fossile : faites votre choix !
L’avantage du marché automobile actuel est qu’il offre un large choix de véhicules, en termes de marques, de modèles ou de modes de combustion. L’inconvénient est qu’il faut vous résoudre à faire un choix clair entre toutes ces options. Comme le dit le dicton : choisir, c’est renoncer. Malheureusement, la déductibilité fiscale selon le mode de combustion fera bientôt partie de ce critère de choix qu’il faudra prendre en compte. « En tenant compte de ce critère, vous pourrez soit prendre votre temps pour faire votre achat, soit agir plus
rapidement », explique Peter Van Hoylandt. Si votre choix se porte sur une voiture électrique, il ne sert à rien de vous affoler. L’achat d’un véhicule de ce type vous permettra de profiter d’une déductibilité fiscale avantageuse jusqu’en 2027. Mais comme dit précédemment, ce ne sera pas le cas pour une voiture à moteur à combustion (y compris hybride). Cela étant dit, un véhicule à énergie fossile reste toujours une option si vous voulez opter pour une plus grande autonomie sans le temps de recharge et/ou un coût initial moindre. Dans ce cas, prenez connaissance de la troisième étape.
Un véhicule à moteur thermique et un mode de financement adéquat Il est temps d’acheter votre nouvelle voiture ! Mais il se peut que des questions vous taraudent toujours. En effet, que se passe-t-il si vous possédez actuellement un financement ? Et si le véhicule que vous convoitez n’est pas encore disponible à la vente, pouvez-vous tout de même bénéficier d’un régime fiscal avantageux ? « Il n’y a pas de crainte à avoir. Nous avons tout prévu!», explique Peter Van Hoylandt. « Même si vous n’utilisez votre voiture que plus tard, de nombreux concessionnaires vous offrent la possibilité de souscrire un contrat de leasing/renting* avant le 1er juillet 2023.»
Profitez à 100 % du 100 %
Vous voilà désormais propriétaire d’un somptueux nouveau véhicule. Il ne vous reste plus qu’à en profiter. Mais sachez que vous gardez la déductibilité totale de 100% sur votre véhicule tant que sa propriété ne change pas (vous ne devez donc ni le vendre ni le ré-immatriculer).
Particulier(s) ou professionnel(s), BMW Group Financial Services a pour vous la formule qui convient parfaitement à votre BMW. Via différents produits financiers, d’entretiens & assurances, nous disposons pour chaque profil de la solution financière adéquate. BMW/MINI Switch* est la solution pour les clients professionnels qui veulent conserver un maximum de flexibilité. BMW/MINI Switch* est le nom commercial du produit Renting Financier qui vous permet de remettre votre BMW/MINI anticipativement sans frais supplémentaires.

* Sous les conditions suivantes : RENTING FINANCIER BMW/MINI s’adresse exclusivement aux clients professionnels qui utilisent le véhicule dans le cadre de l’exercice de leurs activités commerciales, professionnelles ou artisanales.
 PETER VAN HOYLANDT SALES & MARKETING DIRECTOR
PETER VAN HOYLANDT SALES & MARKETING DIRECTOR

En tenant compte de ce critère, vous pourrez soit prendre votre temps pour faire votre achat, soit agir plus rapidement.
Si vous attendez encore et ne signez un contrat de leasing qu’après le 1er juillet 2023, une période de transition sera instaurée jusque fin 2025.
Recyclage, réemploi, économie circulaire… autant de termes souvent utilisés aujourd’hui mais que nous avons encore un peu de mal à appliquer à certains secteurs. Le monde automobile en premier. Si bon nombre d’entre nous jugent la démarche tout à fait louable et absolument nécessaire, nous sommes encore frileux à l’idée, par exemple, d’installer sur nos véhicules des pneus d’occasion, encore trop souvent synonymes de moindre qualité dans l’imaginaire collectif. Et pourtant, le recyclage du caoutchouc en général a bel et bien un avenir radieux devant lui. Explications.
Le recyclage des déchets caoutchouc, un domaine très spécifique

Cela fait maintenant longtemps que le recyclage de nos déchets domestiques est bien intégré dans nos routines quotidiennes. Mais qu’en est-il des autres déchets ? Ceux dont on n’imagine pas les implications si on les abandonnait trop longtemps dans la nature ? À cet égard, le cas du caoutchouc est emblématique. Ce matériau est utilisé pour bon nombre de produits courant, à commencer par les pneus de nos voitures, mais on sait mal ce qu’il devient lorsqu’il est usé et inutilisable. Chris Lorquet, CEO de l’ASBL Recytyre, précise : « Aujourd’hui, ce sont pas moins de 6 millions de pneus usés par an que la Belgique doit collecter et traiter. Alors pour éviter les dépôts clandestins très fréquents avant les années 2000, ou l’incinération de la totalité de ces pneus, il faut recycler et réutiliser le caoutchouc comme matière première secondaire dans les applications ferroviaires, l’isolation ou des matériaux antivibratoires ». Mais si la mission semble évidente, le recyclage des pneus de véhicule n’est pas si simple pour autant.
Lorsqu’un pneu est usé, sa vie n’est pas pour autant terminée. Il existe plusieurs types de revalorisation du produit. Le réemploi d’abord. En effet, s’il n’est pas trop abîmé, le remettre en circuit de vente via des marchands spécialisés dans l’occasion.
différemment. Car si le recyclage et le réemploi sont des techniques approuvées et largement utilisées pour réduire nos empreintes carbones, la base de l’écodesign est bel et bien d’allonger la durée de vie du produit avant de réfléchir aux solutions pour le réutiliser une fois qu’il est usé.

Dans le domaine du poids-lourd, on parle plutôt de rechapage : l’idée est d’ôter la bande de roulement usagée du pneu pour en mettre une nouvelle si la carcasse est toujours saine. Le recylage notamment par granulation ensuite axé sur le matériau lui-même. Et, si toutes ces options ne sont plus possibles, opter pour l’incinération pour utiliser son pouvoir calorifique et économiser ainsi de l’énergie.
Un constat qui pousse à s’interroger sur le mode de conception des pneus et sur les solutions envisageables pour améliorer la circularité de la matière.
Aujourd’hui, les préoccupations climatiques poussent de plus en plus les concepteurs à imaginer leur produit
Heureusement, des solutions intéressantes se mettent doucement en place pour imaginer les pneus de demain, qui seront peut-être inusables, peut-être rechapables, ou peut-être encore mis en location selon notre nombre de kilomètre à l’année. Bref, un bel avenir pour la réutilisation d’un caoutchouc usagé, mais aussi de nombreux défis en perspective. Car comme l’explique Chris Lorquet, « mettre sur pied de nouvelles solutions écoconçues est un premier pas de géant. Il faudra ensuite s’inquiéter de la réutilisation de nos matériaux de réemploi ainsi que de la capture des microplastiques laissés par les pneus usés sur la route ou ses abords. Deux gros défis majeurs qui, j’en suis sûr, motivent déjà bon nombre de concepteurs aujourd’hui ! »
Recytyre est une ASBL fondée en 1998 dont le rôle est d’organiser et de coordonner en Belgique la collecte et le recyclage de pneus usagés. Grâce à son travail, en collaboration avec les autorités régionales, Recytyre peut aujourd’hui recycler 100% du volume collecté. Créé voici 5 ans au sein de la Fondation Roi Baudouin, le Fonds GREEN.er soutient les diverses initiatives et innovations en matière de recyclage de déchets en caoutchouc.
 CHRIS LORQUET CEO
CHRIS LORQUET CEO
Intégrer le recyclage jusque dans nos pneus de voiture ? C’est possible !
Grâce au recyclage, nous nous assurons que les déchets ne finiront pas dans la nature. Mais les producteurs doivent aussi se réinventer pour un avenir plus durable.
Selon le SPW Mobilité et Infrastructures, en 2019, 84 % des marchandises étaient acheminées par camion, ce qui représente 99 % des émissions de CO2 du transport terrestre. Pourtant, des solutions existent pour réduire cette empreinte carbone et remplacer les camions.

Une des solutions, c’est l’intermodalité. Pascal Moens, Directeur au SPW Mobilité et Infrastructures, Direction du Transport et de l’Intermodalité des Marchandises, explique :
« L’intermodalité est l’utilisation de plusieurs modes de transport dans une même chaîne logistique. Souvent, on pense au conteneur, l’unité de transport intermodal par excellence pour les transports massifiés. Mais l’intermodalité est un secteur bien plus complexe et varié. »
Malgré son réseau ferroviaire et ses voies navigables, la Wallonie a longtemps été à la traîne dans ce domaine. « Nous n’avions pas de terminaux », confie Pascal Moens. « Pourtant, il y a quelques années, des services et des terminaux se sont développés grâce à divers opérateurs. En dix ans, le transport de conteneurs s’est développé avec une croissance à deux chiffres. Nous partions de quasiment rien et aujourd’hui, nous ne sommes pas loin des 200000 TEU. »

Cette croissance est liée aux infrastructures qui ont vu le jour et qui ne cessent de se développer. « Sur le territoire wallon, nous sommes arrivés à une assez grande maturité en matière d’infrastructures », se félicite Pascal Moens. « Nous avons suffisamment d’infrastructures de transbordement et celles-ci vont continuer à se développer. »
C’est d’ailleurs ce qui se passe dans le Port Autonome du Centre et de l’Ouest avec le terminal de Garocentre, géré depuis 2012 par Duferco Logistique « Notre première grande mission était de desservir l’usine voisine de production d’acier, aujourd’hui NLMK », se souvient Luk Denkens, General Manager chez Duferco Logistique. «Dans notre contrat de concession, nous devions aussi développer le transport de conteneurs. Une activité que nous avons commencée en 2015. L’an passé, nous avons transporté 18456 TEU, ce qui n’est pas mal pour un petit terminal comme celui de La Louvière. »
Avec 6 ha, trois voies ferrées, un quai de 300m, un portique de manutention et différents équipements, le terminal de Garocentre ne cesse d’évoluer. « Nous avons récemment redéveloppé le transport ferroviaire avec, une fois par semaine pour commencer, un train qui relie le port d’Anvers à notre terminal. Nous travaillons donc sur un système trimodal qui nous permet de passer d’un mode à l’autre en cas de problème technique ou autre. »
Une souplesse que n’offre pas forcément le transport routier. Mais ce n’est pas le seul atout selon Luk Denkens : « C’est plus vert, plus durable, mais pas plus rapide. Si un camion part d’Anvers, la livraison se fera le jour même, mais il y a le problème de la congestion au niveau du ring d’Anvers et du ring de Bruxelles. Par barge, il faut compter deux jours de livraison et un jour et demi par le train. L’intermodalité est un changement qui doit entrer dans la philosophie de chaque client et nous constatons que les mentalités changent. En plus, grâce aux subsides pour le transport fluvial, nous sommes plus ou moins au même tarif que le transport routier. » Par ailleurs, un terminal comme celui de Garocentre offre de nombreux services à ses clients.
Malgré cela, Pascal Moens est obligé de constater : « C’est paradoxal, malgré la progression constante de l’intermodalité, le transport routier continue d’évoluer. Aujourd’hui, nous possédons ces outils de l’intermodalité, mais ils ne parviennent pas à prendre significativement des parts de marché aux transports routiers. Mais restons positifs, si les acteurs de l’intermodalité n’étaient pas là, cette situation serait pire encore. En effet, l’intermodalité est l’un des outils majeurs identifiés pour modifier la mobilité sur notre territoire et diminuer ses nombreux impacts négatifs. »
L’intermodalité est un changement qui doit entrer dans la philosophie de chaque client et nous constatons que les mentalités changent.
— LUK DENKENS DUFERCO LOGISTIQUE
Valipac fête son vingt-cinquième anniversaire. Comment l’organisation a-t-elle contribué à faire de nos entreprises de véritables championnes du recyclage ? Et quels sont ses projets et ses objectifs pour les années à venir ? Nous avons posé la question à son directeur général, Francis Huysman. « La Belgique est aujourd’hui prête à relever les défis de demain. »


Valipac a été fondé en 1997 pour apporter une réponse collective à la “responsabilité élargie du producteur” pour les emballages industriels. Cette notion signifie que les entreprises restent responsables de l’emballage de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, qu’il s’agisse de carton, de plastique, de bois ou de métal.

« L’Union européenne a décidé à l’époque que les entreprises européennes devaient atteindre un certain taux de recyclage pour les emballages qu’elles utilisent pour commercialiser leurs marchandises », explique Francis Huysman. « Nous coordonnons toutes les informations nécessaires à ce processus et sommes l’interface entre entreprises, producteurs d’emballages, collecteurs, recycleurs, traders, etc. Ainsi, les entreprises savent combien de tonnes elles ont déjà recyclées et leur pourcentage par rapport au total. Nous ne collectons, ni ne trions, ni ne recyclons les déchets. Pour cela, les entreprises travaillent avec un collecteur de déchets de leur choix ».

Du linéaire au circulaire
Avant la création de Valipac, l’industrie suivait un modèle “linéaire” : les déchets étaient mis en balles, chargés sur un bateau et expédiés vers l’Asie. Beaucoup de choses






ont changé depuis. « Aujourd’hui, sur les 780 000 tonnes d’emballages industriels mis sur le marché dans notre pays, plus de 91 % sont recyclés », explique Francis Huysman. « Environ 15 % de plus qu’il y a 20 ans, lorsque le taux était inférieur à 80 %. Les objectifs sont différents pour chaque type de matériau. Pour le carton, par exemple, l’objectif est de 90 %, mais nous avons déjà atteint 100 %. Pour le bois, l’objectif est de 80% et nous sommes à 90 %, ce qui est déjà très appréciable. »

Seul le plastique fait encore exception, puisque son taux de recyclage stagne à un peu plus de 60 %. « Sur les 100 000 tonnes de d’emballages industriels en plastique utilisées chaque année en Belgique, environ 80 % sont des films d’emballage ou des housses de palettes », explique Francis Huysman. « La grande distribution en utilise de très grandes quantités. Cependant, la plupart des PME produisent moins de déchets et ne prennent donc pas la peine de trier le plastique. Il finit donc dans les déchets résiduels. Chaque année, nous menons des campagnes ciblées à l’intention des entreprises qui ne trient pas suffisamment le plastique. Par exemple, en distribuant des sacs de collecte gratuits ».


Pour renforcer la durabilité de l’emballage, Valipac a défini des points d’attention. « Nous allons davantage sensibiliser à l’éco-design», explique Ingrid Bouchez, responsable de la communication. « Il s’agit d’emballages conçus pour être recyclés. La Valipac Academy a élaboré des lignes directrices ainsi qu’un outil permettant aux entreprises de vérifier dans quelle mesure leurs emballages sont recyclables. »



Valipac souhaite aussi que les emballages en plastique contiennent davantage de matières recyclées. « Pour cela, nous avons introduit une prime de 50 euros par tonne d’emballage en plastique contenant au moins 30 % de matière recyclée », explique Francis Huysman. « Aujourd’hui, ce taux est de 2 % maximum, il reste donc fort à faire pour atteindre l’objectif européen de 35 % d’ici 2030. »
Enfin, Valipac propose également 4 primes pour les entreprises qui recyclent leurs emballages. Francis : « La première est une prime unique de démarrage pour les entreprises qui se lancent dans la collecte sélective. La deuxième, une prime conteneur couvrant la location de conteneurs sélectifs. La troisième, une prime pour le recyclage des emballages en bois, en métal et en plastique. Enfin, une “prime sac” pour la collecte sélective des films en plastique.»
Championne du recyclage
« La Belgique est prête à relever les défis de demain », affirme fièrement Francis Huysman. « Nous sommes loin devant la plupart des autres pays européens. Ceux-ci ne disposent pas encore de système pour les emballages industriels, mais doivent en mettre un en place d’ici 2024. Récemment, Valipac a multiplié les contacts avec des organisations d’autres pays afin de partager son savoir-faire. Dans l’intérêt de l’industrie, nous devrions nous efforcer de parvenir à une harmonisation et à une coopération au niveau européen. »
Valipac aide les entreprises à remplir leurs obligations en matière de recyclage depuis un quart de siècle
Les objectifs énergétiques du pacte vert européen ne sont plus un secret pour personne : d’ici l’année 2050, l’Europe souhaite être le premier continent à atteindre une parfaite neutralité carbone. Si bon nombre de mesures sont déjà très efficaces, le problème des énergies au sein des bâtiments reste important car elles représentent 28% des émissions totales de CO2 à l’heure actuelle. Mais comment amorcer la transition au sein des entreprises et des ménages pour parvenir à nos objectifs climatiques en 2050 ? Focus sur la pompe à chaleur hybride, une solution durable qui a de belles années devant elle !
Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur hybride ?
La pompe à chaleur hybride est un système de chauffage qui combine les technologies d’une pompe à chaleur classique et celles d’une chaudière au gaz. Didier Hendrickx, Head of Gas Markets Development chez Gas.be, explique : « L’avantage d’un tel système réside dans le fait qu’il utilise plusieurs techniques et qu’il switche de l’une à l’autre. Ainsi, en fonction de la température extérieure, de la chaleur souhaitée à l’intérieur, des prix de l’énergie et du CO2 rejeté, la pompe à chaleur hybride et son système intelligent vont choisir de faire fonctionner soit la pompe, soit la chaudière ».

Une solution intéressante qui offre aussi l’avantage de pouvoir s’installer facilement, rapidement et dans une grande partie des logements existants. Soit en ajoutant une pompe à chaleur à une chaudière existante, soit en installant les deux systèmes directement ensemble. Car si décarboniser les bâtiments est nécessaire, il est évidemment impossible d’envisager des solutions qui seraient trop complexes ou trop coûteuses pour les consommateurs.
Une solution win-win pour tout le monde !
En réalité, malgré la motivation des consommateurs privés ou professionnels à fournir des efforts d’un point de vue énergétique, les finances restent le frein
majeur à une transformation complète de nos bâtiments pour les rendre neutres en carbone. Grâce à la pompe à chaleur hybride, chaque consommateur peut non seulement entamer la décarbonisation de son habitation ou de son entreprise sans se ruiner et sans devoir entreprendre de travaux lourds, mais aussi se laisser la possibilité d’y ajouter d’autres éléments lui permettant de réduire davantage ses consommations, comme des panneaux isolants, des panneaux photovoltaïques, etc. Didier Hendrickx précise : « Une étude menée dans plus de 450 ménages aux PaysBas démontre tout le bénéfice des pompes à chaleur hybride : elles fournissent près de 70% des besoins énergétiques des ménages, diminuent de 35% les émissions de CO2 et permettent une économie de plus de 300 euros par an ! ». De quoi laisser du budget aux consommateurs pour le réinvestir s’ils le souhaitent.
La pompe à chaleur hybride permet également de régler, pour l’instant, le problème d’une surcharge éventuelle sur le réseau électrique car, on le sait, effectuer une transition à 360° vers le full-électrique reste compliqué à envisager actuellement. « Lors des pics de consommations sur le réseau électrique, la pompe à chaleur hybride peut, si nécessaire, automatiquement s’enclencher du côté chaudière », explique Didier Hendrickx.
Un objectif réalisable d’ici 2050 ?
Équiper 1 million d’habitations de 10 à 40 ans d’ancienneté et de classe énergétique C et D d’une pompe à chaleur hybride permettrait d’économiser 1.4 million de tonnes de CO2 par an, ce qui est loin d’être négligeable. En revanche, pour atteindre cet objectif, il s’agit de mettre en place un cadre clair et de promouvoir plus largement cette technologie qui pourrait, à terme, nous mener pas à pas vers la décarbonisation de nos habitations.
Gas.be réunit les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz actifs en Belgique. Si sa mission de base est d’assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de gaz, naturel et renouvelable, de notre pays, l’entreprise vise de plus en plus à sensibiliser consommateurs et décideurs à l’apport des gaz renouvelables pour la résolution des problèmes climatiques. En tant qu’expert dans son domaine, Gas.be propose aujourd’hui des solutions énergétiques durables et efficaces, tant pour les entreprises que pour les ménages.
www.hybridheatpumpplatform.be
 DIDIER HENDRICKX HEAD OF GAS MARKETS DEVELOPMENT
DIDIER HENDRICKX HEAD OF GAS MARKETS DEVELOPMENT

Aujourd’hui, notre société doit répondre à un triple défi au niveau de ses énergies. Elles doivent être plus vertes, performantes et peu coûteuses.
Avec ce système qui s’adapte au rythme financier de chacun, l’idée est d’atteindre in fine, mais petit à petit, ce fameux objectif d’habitations totalement neutres.
Vous n’avez pas la possibilité de faire installer une pompe à chaleur dans votre habitation ? Buderus vous présente une alternative à l’efficacité redoutable : la pompe à chaleur hybride.


Le réchauffement climatique est à nos portes. Nous en sentons déjà les effets dévastateurs dans certaines parties du globe. Mais saviez-vous que le parc immobilier en Belgique s’inscrit comme l’un des grands pollueurs ? Et pour cause, plus de 75% des bâtiments ont été construits avant 1971. Ce qui signifie que la majorité des Belges ne disposent pas d’une isolation thermique suffisante. Et comme tout le monde le sait, sans cette isolation thermique, c’est la planète qui trinque en subissant l’augmentation des gaz à effet de serre.
Les gouvernements belges ont bien compris que la transition énergétique ne pouvait plus attendre et les échéances ont été fixées. Dès 2025 à Bruxelles (et 2030 en Wallonie), vous ne pourrez plus construire une nouvelle habitation sans que celle-ci ne respecte la norme Q-ZEN. Dès 2026, la Flandre obligera toutes les nouvelles constructions à se doter d’une pompe à chaleur. Tandis qu’à partir de 2030, la Wallonie interdira l’achat de chaudières au mazout. Pour les citoyens, il est donc également temps de prendre le taureau par les cornes. Mais comment s’y prendre ?
Pendant longtemps, la rénovation du bâti et l’installation d’une pompe à chaleur dans chaque habitation étaient les solutions les plus adéquates. La pompe à chaleur offre en effet une alternative écologiquement viable aux combustibles fossiles. Mais quel propriétaire aurait aujourd’hui les épaules assez solides et le portefeuille assez rempli pour effectuer de telles transformations ?
Passer d’un système de chauffage traditionnel à une pompe à chaleur peut sembler complexe, voire impossible. Heureusement, il existe aujourd’hui un système intermédiaire qui combine à la fois pompe à chaleur et chaudière traditionnelle : la pompe à chaleur hybride.
La pompe à chaleur hybride a ceci d’intéressant qu’elle peut être installée sans que l’habitation ne réponde aux normes d’isolation les plus élevées. Dans le cas de l’installation d’un système “Add-on”, la chaudière existante n’aura même pas à être remplacée. Mais ce n’est pas tout! Un système hybride peut également fonctionner avec des radiateurs et choisira automatiquement le type de chauffage le plus efficace (chaudière gaz ou mazout) afin d’offrir la consommation la plus basse. Il permettra de réduire jusqu’à 60% sa consommation de chauffage par rapport à un système de chauffage conventionnel. Le système hybride est également le système privilégié pour les rénovations des maisons qui ne sont pas connectées au réseau de gaz de ville. Il est effectivement possible d’opter pour ce système en combinaison d’une chaudière au gaz propane ou au mazout. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, des incitations financières s’élevant à plusieurs milliers d’euros ont été mises en place, afin d’encourager les propriétaires de bâtiments existants à adopter ce type de système.
80 % de vos besoins ! C’est ce que votre pompe à chaleur assure en termes de chauffage et de production d’eau chaude chaque année. Votre chaudière, quant à elle, n’intervient que dans certaines conditions : lorsque la température extérieure descend en dessous de 2 °C ou lorsque la demande en eau chaude sanitaire est élevée. Mais pas de panique! Tout est automatisé. Le système choisit en toute intelligence la source d’énergie la plus avantageuse pour assurer un confort optimal. Adaptative suivant la réalisation des travaux d’isolation, la pompe à chaleur pourrait, à termes, prendre en main l’intégralité du chauffage nécessaire.
Si la pompe à chaleur originale et l’hybride fonctionnent différemment, elles ont pourtant des points communs particulièrement intéressants. Elles réutilisent en effet toutes les deux l’énergie du sol et de l’air extérieur qu’elles amplifient grâce à un compresseur. Le système de chauffage fait ensuite le reste. La quantité d’énergie dégagée est significative, atteignant jusqu’à 4kW sans pour autant que la consommation ne crève les plafonds (1kW). Le rendement des pompes à chaleur avoisine ainsi les 400% alors qu’une chaudière traditionnelle atteindra au mieux 95%. À noter également qu’aucune réaction de combustion ne sera à l’œuvre dans ce système de chauffage.
LA PETITE COUSINE DE LA POMPE À CHALEURDe tout temps, l’homme a eu besoin d’énergie pour ses diverses activités. De l’énergie éolienne au nucléaire, en passant par l’eau, le charbon, l’électricité et le gaz naturel, la Belgique n’a pas à rougir en matière d’innovation. Notre pays a souvent été à la pointe dans les différents secteurs.
Par Pierre LagneauxLa plus ancienne source d’énergie
Le vent est très certainement l’une des plus anciennes sources d’énergie. Des premiers voiliers de l’Antiquité aux moulins à vent du Moyen-Âge, l’homme a depuis toujours essayé de dompter l’énergie éolienne. Mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que l’ingénieur américain Charles F. Brush construit à Cleveland la première éolienne automatique destinée à la production d’électricité.

Depuis cette première éolienne à ossature bois et d’une puissance de 12 kW, l’énergie éolienne a bien évolué. Et la Belgique n’a pas à rougir dans le domaine. En effet, en 2022, il y avait 1741 éoliennes opérationnelles sur notre territoire. Grâce à elles, notre pays est le dixième producteur d’électricité éolienne de l’Union européenne. Mieux encore, la Belgique est le cinquième plus gros producteur d’énergie éolienne en mer au monde.


Zénobe Gramme dompte le courant
Et si c’était en Belgique que se trouve le berceau de l’électricité ? En tout cas, c’est grâce à un inventeur belge que cette source d’énergie a véritablement pris son essor. En effet, en 1869, Zénobe Gramme invente la machine de Gramme, mieux connue sous le nom de dynamo. Cette géniale invention transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Il s’agit, ni plus ni moins, de la première génératrice moderne de courant continu.
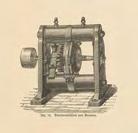
Par après, la première centrale électrique de Belgique est construite à Bruxelles en 1885, soit seulement trois ans après celle érigée par Thomas Edison à New York ! La première centrale régionale sera construite en 1898 le long du Canal Bruxelles-Charleroi, à Oisquercq. La Belgique est donc un des berceaux de la fée électricité en Europe.
Le haut potentiel hydraulique de la Wallonie

L’eau, c’est la vie. Il est donc tout naturel que l’homme s’en soit servi comme source d’énergie. Les premières traces d’exploitation de l’énergie hydraulique remontent à l’Antiquité. Mais c’est surtout au Moyen-Âge qu’elle va se développer dans nos régions avec les moulins à eau que nous pouvons encore admirer dans certaines villes et certains villages.
Il y a cent ans, trois mille moulins hydrauliques transformaient la force de l’eau en énergie en Belgique. Une énergie qui ne se limitait plus uniquement à la meunerie, mais permettait aussi de produire de l’électricité.
Aujourd’hui, le potentiel hydraulique de la Belgique se trouve majoritairement en Wallonie où près de cent cinquante centrales hydroélectriques produisent de l’électricité grâce à la force de ses cours d’eau.
Zeebruges plaque tournante du gaz naturel
La Belgique est une grande consommatrice de gaz naturel. Par ailleurs, grâce au port méthanier de Zeebruges, elle est une véritable plaque tournante entre les pays producteurs (Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège) et les pays consommateurs situés au sud et à l’est.

Les origines de l’industrie gazière en Belgique remontent à 1905 avec le début des opérations de la société Gazelec. En 1929, la société Distrigaz est créée suite à une convention entre la Société Générale, l’ICGA et Gazelec. Le but de cette triple entente est de construire et gérer une canalisation traversant le pays du Nord au Sud, entre Anvers et le Borinage.
Comment
Le charbon, mine d’or de la jeune Belgique
Le charbon a fait la richesse de la Belgique pendant plus d’un siècle. Au lendemain de la Révolution de 1830, la Belgique devenue indépendante est le deuxième producteur de charbon au monde. Une richesse qui fait de la jeune nation la deuxième puissance économique mondiale derrière le Royaume-Uni et son empire colonial.
En 1840, plusieurs mines belges font leur entrée sur la place boursière de Paris. Ce seront les premières entreprises industrielles à bénéficier d’une cotation officielle à la Bourse de Paris.
La Belgique compte alors plus de trois cents mines principalement situées dans les régions de Liège, Charleroi, La Louvière et du Borinage, mais les charbonnages étaient déjà en activité bien avant l’indépendance du pays.
Pionnier, de la naissance au démantèlement
L’histoire du nucléaire en Belgique est relativement jeune. En 1956, le Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire de Mol réalise la première réaction en chaîne contrôlée dans son réacteur de recherche. Ici aussi notre pays fait partie des pionniers. En effet, la première production expérimentale d’électricité à partir d’un réacteur nucléaire date du 20 décembre 1951.
En 1957, des ingénieurs belges participent au démarrage du premier réacteur nucléaire à eau pressurisée aux États-Unis. Une expérience qui aboutira en 1962 au démarrage en Belgique du premier réacteur de ce type en dehors des États-Unis. Dès 1970, la Belgique démarre son programme nucléaire avec la construction des centrales de Doel et de Tihange.

L’Europe s’est engagée à atteindre la neutralité carbone au niveau de ses habitations d’ici 2050. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, le secteur de l’énergie se mobilise. Pour le fournisseur de gaz Antargaz, expert en matière de gaz propane en citernes, le biopropane fait partie des solutions. Explications avec Hugues Ninane, responsable commercial au sein de l’entreprise.
Le biopropane, l’alternative renouvelable au propane
« Trois atomes de carbone et huit atomes d’hydrogène : la composition d’une molécule organique de propane ou de biopropane est exactement la même. La seule différence réside dans leur provenance », explique Hugues Ninane, « Le gaz propane classique est une énergie d’origine fossile tandis que le biopropane est produit via le raffinage d’huiles végétales durables ou de déchets de l’industrie alimentaire ». Ce processus permet d’obtenir du gaz liquide d’une source parfaitement renouvelable et de réduire

jusqu’à 80 % des émissions de CO2 ! « En Belgique, pays de la frite, cela voudrait dire que nous pourrions récolter toutes les huiles de fritures usagées pour leur redonner une seconde vie ! » s’enthousiasme le représentant d’Antargaz. Conditionné en bouteilles ou en citernes, tout comme le propane, le biopropane se stocke et se transporte facilement. Il alimente un logement en énergie et peut être utilisé pour les tâches domestiques telles que se chauffer, se laver ou encore cuisiner, même sans raccordement au réseau de gaz naturel.
L’objectif 2050 : décarboner le propane
« Le biopropane est déjà disponible en Europe, mais dans des quantités minimes. La distillation est un principe simple et connu depuis très longtemps mais la mise en place des usines et leur approvisionnement prend du temps. La production va augmenter au fur et à mesure » rapporte Hugues Ninane. Le but : mélanger progressivement ce gaz vert au propane jusqu’à le remplacer complètement. Antargaz ambitionne de
distribuer 25% de biopropane d’ici 2030, et exclusivement du biopropane en 2050. Pour les consommateurs, ça ne changera strictement rien, les installations restent les mêmes : «Ceux qui décident d’opter pour un chauffage au propane aujourd’hui sont déjà prêts pour le biopropane de demain. Aucune adaptation ni investissement supplémentaire ne sera nécessaire puisqu’il s’agit d’exactement la même molécule ! » assure Hugues Ninane.
Une transition plutôt qu’une révolution
« À terme, notre société fonctionnera uniquement à base d’énergies 100% renouvelables, mais cette transition ne se fera pas du jour au lendemain », pointe le responsable commercial d’Antargaz, « Dans des délais aussi courts que 2030 (année pour laquelle le Green Deal européen prévoit déjà une réduction drastique des émissions des CO2), il est illusoire de penser qu’il sera techniquement possible d’alimenter tout le monde en électricité ». La solution intermédiaire, selon l’expert ? Opter pour un mix énergétique, via une pompe à chaleur hybride, par exemple. « Ce système, qui associe gaz et électricité, permet de réduire sa facture d’énergie et son impact sur l’environnement tout en gardant un certain confort », détaille-t-il, « Antargaz garantit l’énergie pour tous et partout. Nous avons un rôle à jouer dans la transition écologique, là où la densité de population est plus faible, où le réseau de gaz de ville et d’électricité sont moins disponibles », précise le responsable commercial, « Finalement, nos comportements doivent également changer si l’on veut assurer l’avenir des générations futures : le kilowattheure le moins cher et le plus écologique, ce sera toujours celui qu’on ne consomme pas ! » .
Antargaz est un fournisseur de gaz en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. L’entreprise est le leader du marché belge de la distribution de propane et de butane en citernes et en bouteilles de gaz, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Elle fournit également du GPL carburant aux stations-services. Depuis 2011, Antargaz est une filiale d’UGI, un acteur international dans la distribution et les services énergétiques. www.antargaz.be
Antargaz ambitionne de distribuer 25% de biopropane d’ici 2030, et exclusivement du biopropane en 2050.
Trois atomes de carbone et huit atomes d’hydrogène : la composition d’une molécule organique de propane ou de biopropane est exactement la même. La seule différence réside dans leur provenance.HUGUES NINANE COMMERICAL ACCOUNT MANAGER
Ces dernières années, on parle beaucoup de la shifting economy dans les programmes politiques de certains partis. Mais en quoi cela consiste-il concrètement ? Pour en savoir plus, nous avons posé la question à trois élus qui travaillent chaque jour sur cette question : Alain Maron, Barbara Trachte et Philippe Henry.
Par Thibaut Van HoofPhilippe Henry
Ministre wallon du Climat, des Infrastructures, de l’Énergie et de la Mobilité.
Sur quels axes de la Shifting Economy travaillez-vous ?

« Je travaille au renouveau de l’économie wallonne, afin d’aboutir à un juste équilibre entre développement social, économique et durabilité environnementale. Je me concentre en particulier, dans le respect de mes compétences, sur les quatre dimensions suivantes : la définition d’un cap en matière climatique ; le renforcement des accords volontaires et des modes de collaboration participatifs ; le financement de la transition, indispensable pour stimuler certains investissements et créer de nouvelles opportunités, et le développement de nouvelles solutions énergétiques afin de donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions. »


Alain Maron
Ministre bruxellois de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie participative.
Barbara TrachteSecrétaire d’État bruxellois de la Transition économique et de la Recherche scientifique.
« D’abord, Bruxelles-Environnement a une légitimité certaine sur la transition économique. Par exemple, après avoir mis en place l’Alliance Emploi-Environnement dès 2010. Celle-ci impliquait notamment l’obligation du passif pour toute nouvelle construction. Ensuite, il y a une production de déchets énorme à Bruxelles : 2 millions de tonnes ! Ces déchets sont une mine d’or à valoriser. Réduire l’impact environnemental des entreprises passe par la réduction et la bonne gestion de leurs déchets. Enfin, troisième axe, nous stimulons des filières “Good Food” pour une alimentation saine pour les Bruxellois et les Bruxelloises, et bonne pour la planète. »
« Je travaille plus globalement sur le développement de l’activité économique autour de ces projets sociaux et environnementaux, qui doivent aller de pair. Tout est fait pour réorienter notre action, et cela passe par exemple par une réforme des marchés publics. Cette transition vise toute l’économie bruxelloise, et nous voulons attirer en masse les entreprises vers ces projets. Il y a des opportunités à saisir et les deux crises que nous venons de vivre (Covid et guerre en Ukraine) ont montré que les entreprises qui avaient déjà entamé leur mue avaient mieux résisté que celles qui étaient encore très dépendantes de la Chine ou d’autres pays lointains. »
Concrètement, pouvez-vous nous parler de quelques grandes réalisations de ces dernières années ?
« Le Gouvernement a récemment adopté son nouveau Plan Air Climat Énergie (PACE) de la Wallonie qui confirme l’objectif de réduction de 55 % de ses émissions de gaz à effet de serre wallonnes à l’horizon 2030. Le secteur de la construction est essentiel pour nous permettre d’atteindre nos objectifs climatiques. Dans ce contexte, une stratégie d’orientation et de formation à la rénovation énergétique durable est en cours de préparation. Au niveau énergétique, j’ai renforcé le soutien au secteur des énergies renouvelables. Hautement stratégique et indispensable pour la transition, ce secteur a injecté près d’un demi-milliard d’euros dans l’économie wallonne en 2022. »
« Un des soutiens les plus importants est “BeCircular”, qui a permis de financer ces dernières années plus de 230 projets d’économie circulaire sur le territoire Bruxellois. Cela représente plus de 850 emplois créés et un effet de levier de 1 pour 8, c’est-à-dire que pour 1€ d’argent public, 8€ sont investis par le secteur privé. Nous voulons que l’économie circulaire devienne la norme. Vu les tonnes de déchets produits chaque année, nous avons de la ressource à capter et à valoriser pour créer de la valeur sur le territoire régional. C’est bon pour l’économie, pour l’environnement, mais aussi pour l’emploi de toutes et tous. »
Enfin, quels sont les grands défis d’ici la fin de la législature ?
« Le premier concerne la finalisation des accords de branche de troisième génération, toujours en cours de discussion au sein du Gouvernement. Ces accords volontaires permettent aux entreprises de recevoir des aides publiques si elles s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à améliorer leur efficacité énergétique. Le deuxième concerne la réforme des aides à l’investissement initiée par mon collègue Willy Borsus. Enfin, je terminerai par l’élaboration d’un plan stratégique wallon pour l’hydrogène. Basé sur une dynamique participative avec l’ensemble des parties prenantes de la société, ce plan aura une portée holistique qui englobera toutes les dimensions de la société. »
« Avec Barbara Trachte, nous avons mis sur les rails le train de la transition économique avec Shifting Economy, Renolution, Good Food, le Plan Air Climat Énergie… L’enjeu est que personne ne reste à quai, que cette transition soit inclusive et concerne tout un chacun. Les indépendant·es et les très petites entreprises doivent aussi bénéficier de la transition. C’est aussi faire en sorte que les locataires et les petits propriétaires puissent vivre dans des logements rénovés et performants énergétiquement. C’est faire en sorte que la Good Food soit accessible au plus grand nombre et que l’offre de Good Food soit présente dans tous les quartiers de Bruxelles. »
« Nous avons pour projet de créer chaque année un nouveau parc de PME. La demande est très grande, et chaque projet se remplit immédiatement. Quand on parle d’économie, on parle aussi d’argent, et nous avons mis au point des outils pour faciliter l’accès aux financements. Nous avons créé un cadre qui permet aux citoyens d’investir dans des projets ambitieux tout en protégeant leur argent. Il y a aussi tout un volet sur l’accompagnement des entreprises, avec une place importante donnée aux femmes qui veulent entreprendre. Nous avons assoupli les règles d’accès à la profession, ou encore lancé des primes pour encourager la rénovation énergétique. »
« Au niveau administratif, je pense à l’adoption d’une ordonnance sur l’innovation et les aides aux entreprises. Sur le terrain, nous visons une massification de la shifting economy. Le défi sera de toucher plus que ceux qui sont déjà convaincus par ces questions. On a déjà la chance à Bruxelles d’avoir de nombreuses personnes qui sont intéressées et convaincues par ces thématiques, mais il faut aussi aller toucher ceux qui en sont plus éloignés. Enfin, Bruxelles seule n’a pas tout le levier pour tout faire avancer. Il faudra compter sur le soutien d’autres niveaux de pouvoir en Belgique et même en Europe pour renforcer notre action et apporter plus de justice au niveau économique. »


Depuis quelques années, les inquiétudes environnementales et les crises successives ont considérablement modifié notre vision du monde professionnel. Aujourd’hui, avant de s’engager, la génération Z tient à s’assurer que la durabilité est au cœur des préoccupations de l’entreprise et que le bien-être au travail est un sujet central. Avec, pour effet, une modification radicale du rôle des team leaders, des professionnels des ressources humaines et des grands patrons. Alors, comment aborder ces changements de manière sereine et leur trouver des solutions efficaces sur le long terme ?
Focus sur les ODD, un précieux outil de développement durable.
Le bien-être et la durabilité, deux concepts indissociables
Le bien-être au travail englobe quatre dimensions spécifiques qui doivent chacune être respectée pour qu’un collaborateur se sente bien sur son lieu de travail. Siviglia
Berto, CEO de B-Tonic, explique : « Il y a d’abord le bien-être mental et émotionnel, qui sous-entend une certaine sérénité face au stress et une adaptabilité aux changements. Ensuite, on retrouve le bien-être physique, qui signifie que la santé du collaborateur n’est pas affectée par son lieu de travail.
Puis le bien-être social, qui englobe les relations entre collaborateurs, avec la famille ou les amis. Et enfin, le bien-être financier : le collaborateur est-il apte, grâce à son salaire, à faire face à ses obligations matérielles ». Si cette notion est largement discutée en entreprise aujourd’hui, elle reste malheureusement trop peu approfondie.
Avec, pour résultat, des solutions qui se développent pour un, voire deux axes, mais rarement plus.
La clé pour mener à bien ces analyses, ce sont les Objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations-
Unies et que chaque entreprise devrait utiliser à la manière d’une boussole. Selon leur ADN et leurs valeurs, chaque entreprise peut établir une liste de quelques ODD qu’elle souhaite respecter. Et ensuite mettre en place des actions concrètes qu’elle peut facilement relier à ces ODD. « Les ODD sont la porte d’entrée et la clé pour comprendre et avancer vers la voie de l’entreprenariat et du bien-être durables », précise Siviglia Berto.
nécessaire, donc être hyper flexible. Et bien sûr, générer un impact positif pour la société de manière générale. « En fait, pour être durable, une entreprise doit voir loin et avoir les épaules assez fortes pour tenir sur le long terme, malgré les crises et les modifications dans notre manière de travailler. Le tout en répondant positivement aux questionnements de l’ensemble de ses collaborateurs afin de limiter au maximum l’absentéisme », précise Siviglia Berto.
Des enjeux majeurs pour notre société actuelle et celle de demain S’engager dans l’entreprenariat durable est, certes, un vrai défi, mais aussi et surtout une nécessité. Depuis quelques années, les collaborateurs en entreprise osent enfin aborder les sujets qui fâchaient auparavant : « Ça ne va pas », « Je ne m’en sors plus », « Je suis stressé ». Une liberté de parole qui devrait encore être encouragée davantage afin d’enlever un maximum de pression pesant aujourd’hui sur bon nombre de travailleurs. Et ainsi trouver enfin une solution aux postes vacants de plus en plus nombreux et au manque cruel de collaborateurs efficaces que l’on constate actuellement.
B-Tonic est une filiale de Baloise destinée aux entrepreneurs, professionnels RH et conseillers en prévention. Son objectif : aider les entreprises à développer et entretenir des actions visant à plus de bien-être à long terme. Grâce à des outils de scanning et de mapping, reliés aux dix-sept ODD européens, B-Tonic épaule les petites et grosses entreprises qui souhaitent développer leur politique de durabilité.
Qu’est-ce que l’entreprenariat durable pour vos collaborateurs ?
Si les ODD sont la meilleure voie d’accès vers l’entreprenariat durable, la notion va bien au-delà. Tendre à la durabilité en entreprise, c’est avoir une réelle vue sur le futur, c’est savoir se projeter à long terme, pouvoir gérer les crises, se repositionner et s’adapter quand c’est
Pour envisager sereinement l’avenir en entreprise, il semble que la clé soit une vision à long terme : s’intéresser à ses collaborateurs, ouvrir le débat, mettre en place des actions qui répondent aux différents ODD et faire l’état des lieux réguliers de sa propre situation. « Le terme ‘‘durabilité’’ exige de considérer le bien-être dans son sens le plus large possible. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous contenter d’organiser quelques conférences ou activités par an. Un processus de changement est nécessaire, dans le cadre duquel l’entrepreneur ose sortir de ses habitudes, avec une vision long terme. », conclut Siviglia Berto.
SIVIGLIA BERTO CEOIl faut prendre en compte les quatre dimensions, y travailler régulièrement et avancer petit à petit, en analysant les effets des actions menées pour le bien-être.
La durabilité ne se résume pas à l’écologie pour les entreprises. Le bien-être des collaborateurs est tout aussi essentiel pour un avenir et un lieu de travail véritablement durables.


Tout d’abord, il faut comprendre que toutes les entreprises, peu importe leur taille, ont un impact sur l’environnement. Elles utilisent des ressources naturelles pour produire des biens et des services, et ces activités peuvent avoir des effets négatifs. Les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l’air et de l’eau, les microplastiques, la dégradation des sols et la destruction de la biodiversité ont des conséquences directes sur la santé humaine en termes de maladies respiratoires, d’allergies, de maladies cardiovasculaires, ou encore de cancers.
Les consommateurs optent de plus en plus pour des produits durables. Bientôt, il sera donc économiquement irresponsable de ne pas entreprendre durablement. Mais il n’y a pas que les consommateurs qui changent. Les entreprises qui mesurent leur impact écologique et adoptent des pratiques durables sont souvent perçues comme des employeurs plus attractifs et engagés. Les jeunes talents sont de plus en plus préoccupés par l’environnement et la durabilité et ils recherchent des entreprises qui partagent leurs valeurs. Cela peut améliorer leur réputation et leur image de marque, et ainsi attirer plus de candidats qualifiés et motivés. Selon des enquêtes menées par Deloitte, près de 75 % des millennials (nés entre 1981 et 1996) estiment que les entreprises doivent avoir un objectif social ou environnemental. Et près de 40% d’entre eux ont déjà refusé des offres d’entreprises qui ne partageaient pas leurs valeurs.
Commencez doucement, mais commencez maintenant. En utilisant, par exemple, des outils de mesure de l’analyse du cycle de vie, qui permettent d’évaluer l’impact environnemental d’un produit ou d’un service de la production à l’élimination. Réfléchissez aussi à la nécessité réelle d’un emballage/produit/service
avant de le rendre plus durable. Osez être critique. Impliquez vos collaborateurs (fournisseurs et clients) dans le processus et identifiez ensemble les actions à mener à court et à long terme. Les SDG (Sustainable Development Goals) des Nations Unies forment une bonne base pour cet exercice.
Aujourd’hui, mesurer et communiquer son impact est un avantage concurrentiel. Demain, ce sera une obligation légale. Il vaut donc mieux faire le choix de l’entrepreneuriat durable dès maintenant afin d’être bien préparé. En évaluant l’empreinte écologique d’une entreprise, on peut comprendre l’ampleur de son impact et identifier les améliorations possibles. Outre les motivations économiques, les entreprises peuvent être des moteurs de changement positif pour l’environnement et la société, ce qui est une raison largement suffisante pour se lancer.
Et puis il y a aussi cette incroyable satisfaction personnelle que l’on ressent quand on se remémore sa journée de travail en tant qu’entrepreneur durable. Cette fierté n’a pas de prix. La question devrait donc être prise à l’envers : pourquoi votre entreprise ne s’engagerait-elle pas dans cette voie ?
Et puis il y a cette incroyable satisfaction personnelle que l’on ressent quand on se remémore sa journée de travail en tant qu’entrepreneur durable.
— THOMAS DE GROOTE FONDATEUR DE RIVER CLEANUP

Pour les entreprises, l’ESG et le développement durable et responsable sont devenus des priorités. Il en va de même pour une entreprise productrice de tabac comme Philip Morris International (PMI). Mais dans son secteur d’activité si spécifique, comment relève-t-elle ces défis ? En se réinventant complètement.
Pour les entreprises, la durabilité n’est plus seulement une obligation morale, c’est un impératif stratégique permettant d’allier réussite économique et responsabilités sociales et environnementales. Adopter des pratiques durables leur permet de créer de la valeur, réduire les risques et contribuer à un avenir durable.
« Le développement durable englobe de nombreux domaines », indique Aurora Marin, Sustainability Manager chez PMI. «PMI est actif dans plusieurs d’entre eux. Par exemple, via des programmes pour réduire la consommation d’énergie dans les usines, passer à l’électricité verte et rendre la flotte de véhicules plus écologique. Mais nous ne pouvons pas tout faire seuls. C’est pourquoi nous suivons le parcours d’entreprise durable du VOKA, afin de renforcer notre stratégie interne en tenant compte des attentes externes et locales. »
« Chez nous, la durabilité passe également par le respect de la diversité », poursuit Aurora. « Chacun, indépendamment de son âge, de son sexe, de son appartenance ethnique et de ses orientations religieuses ou sexuelles, jouit des mêmes opportunités. La diversité, l’inclusion et la durabilité sont des principes de base. Nous les faisons même évaluer par des organismes spécialisés. Ce n’est donc pas un hasard si nous avons reçu le titre de «Top Employer» à plusieurs reprises. PMI a également été l’une des premières multinationales à obtenir le certificat Equal Salary, attestant de la parité salariale entre hommes et femmes. »
L’impact sociétal potentiellement le plus important pour PMI réside peut-être dans sa recherche de meilleures alternatives pour
près d’un milliard de fumeurs dans le monde. « Beaucoup l’ignorent, mais nous opérons actuellement une gigantesque transformation visant à arrêter la commercialisation des cigarettes dans de nombreux endroits d’ici 10 à 15 ans», déclare Elfriede Berger, Scientific Engagement Manager chez PMI.
L’un des fers de lance de cette transformation est la recherche et le développement. À Neuchâtel, en Suisse, un millier de scientifiques et d’ingénieurs travaillent au nouvel avenir de PMI, explique Elfriede. « Nous avons déjà investi plus de 10 milliards de dollars en R&D depuis 2008, générant quelque 1 700 nouveaux brevets. Nous sommes donc fiers de figurer dans le top 50 des entreprises ayant déposé le plus de brevets en Europe. 99 % de notre budget de R&D est consacré à l’abandon progressif de la cigarette et au développement d’alternatives moins risquées pour les fumeurs. »
PMI s’est également engagé dans la voie du développement de produits ne contenant plus de nicotine. « En février 2021, PMI a annoncé son ambition de se développer vers le bienêtre et les soins de santé. Combinées à notre expertise en sciences de la vie, les acquisitions de Fertin, Vectura et OtiTopic en 2021 constituent une base pour le développement de produits respiratoires et oraux. Cela offre des possibilités d’administrer rapidement et efficacement des produits de bien-être et de santé existante. Par exemple, des traitements pour certaines affections cardiovasculaires ou des problèmes neurologiques tels que les migraines. Nous prévoyons aussi des opportunités dans le domaine de la gestion de la douleur. D’ici à 2025, ce secteur d’activité devrait représenter un milliard de dollars. »
Erreur sur la personne
Elfriede est familière du secteur pharmaceutique, ayant précédemment travaillé pour Novartis, AbbVie et Johnson & Johnson. N’est-il pas étrange de passer de ce secteur à une entreprise principalement connue pour ses produits liés au tabac ? « Je vais être honnête : la première fois que PMI m’a appelée, j’ai cru qu’il
y avait erreur sur la personne. Comme la plupart des gens, je ne savais pas que cette entreprise s’engageait dans une mutation gigantesque. Mais lorsque j’ai commencé à me renseigner, j’ai décidé de sauter le pas ».
Auparavant, Elfriede s’occupait principalement des dossiers de remboursement de médicaments. Ce qui impliquait de nombreux contacts avec les médecins et une lecture assidue d’études médicales et d’essais cliniques. « De ce point de vue, peu de choses ont changé. Mon travail dans l’industrie pharmaceutique visait avant tout à rapprocher la médecine des patients et à accroître l’accessibilité de la médecine. Chez PMI, grâce à l’avenir sans tabac que nous préparons, je peux également avoir un impact sur la santé publique. Et ce, à très grande échelle, ce qui me procure une intense motivation ».
Actif depuis 1847, PMI employant aujourd’hui quelque 71 000 personnes, est active dans 180 pays et réalisant un chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars. PMI a annoncé qu’avec ses alternatives sans fumée, elle visait à remplacer les cigarettes le plus rapidement possible et de devenir complètement sans fumée.
Elfriede Berger Scientific Engagement Manager
Regardez autour de vous. Vous voyez Bruxelles changer ? Oui, la capitale met le cap vers une économie plus durable et circulaire. Avec son habitat moins énergivore, une mobilité plus douce et de l’emploi pour tous. Au cœur de ce projet, il y a le port de Bruxelles, ses entreprises de construction, son terminal à conteneurs et ses bateaux. Le transport le moins polluant. Oui, c’est ici que cette nouvelle économie prend sa source. Cela fait partie de notre masterplan. Alors startups, créateurs, visionnaires… soyez les bienvenus au cœur de la transformation bruxelloise.
