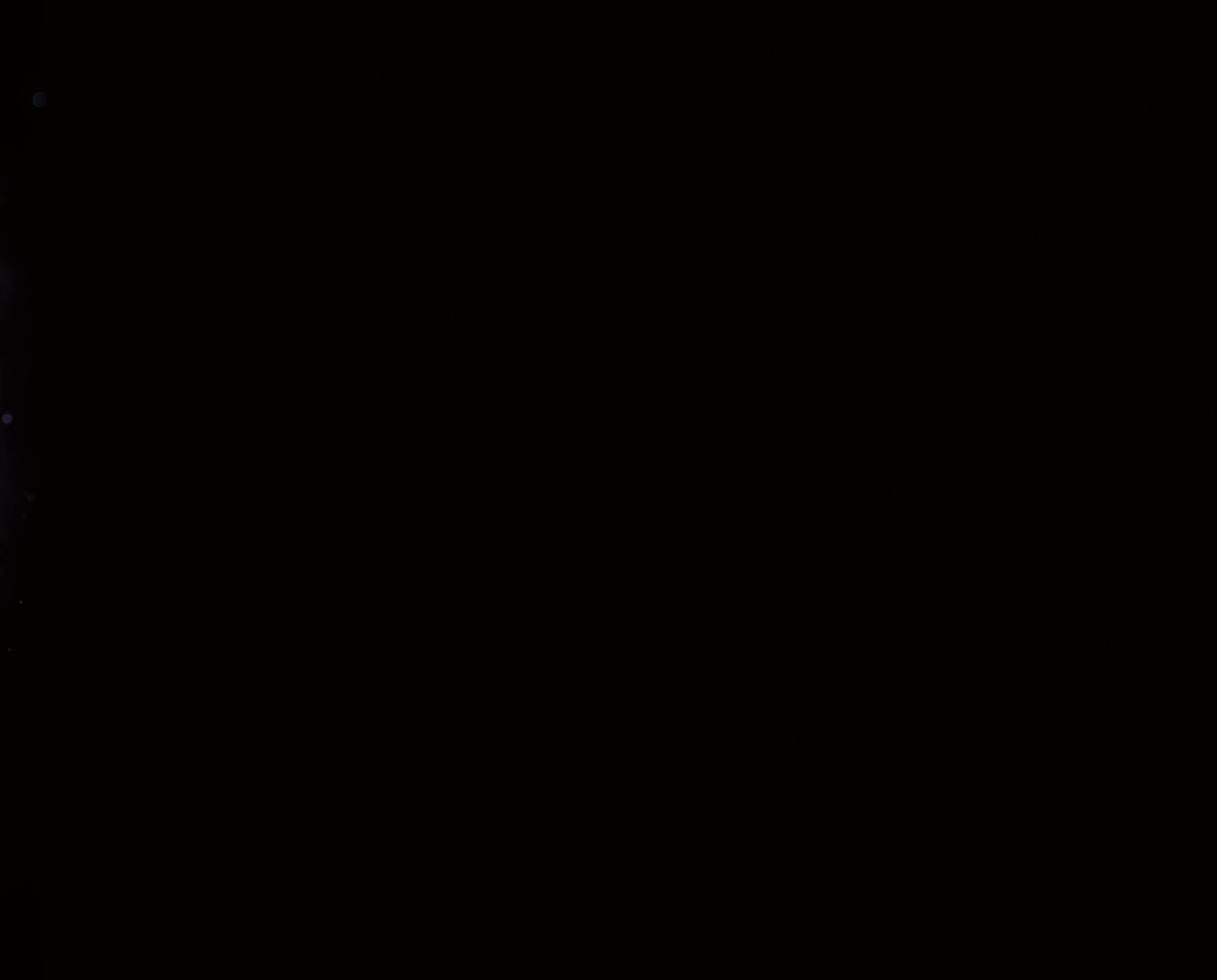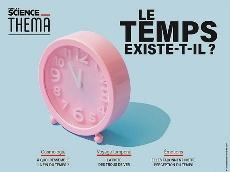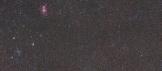L 13256 - 549 H - F: 7,00 € - RD POUR LA SCIENCE 07/23 NUCLÉAIRE La question cruciale du cycle du combustible L’analyse de Sylvain David physicien DANS LE SECRET DES BALEINES Comment ces géantes traquent le krill Planétologie CAP SUR LES LUNES GLACÉES DE JUPITER Chimie QUAND LES LIQUIDES ONT DES TROUS ChatGPT D’OÙ VIENNENT DE GÉNIE DES IA ? DOM 8,50 € –BEL./LUX. 8,50 € –CH : 12,70 FS –CAN. 12,99 $CA –PORT. CONT. 8,50 € – MAR. : 78 DH –TOM 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Juillet 2023n° 549

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne
MENSUEL POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef : François Lassagne
Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier
Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly
HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin
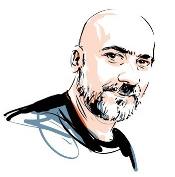
Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe
Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr
Directrice artistique : Céline Lapert
Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande
Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery
Assistant administratif : Bilal El Bohtori
Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec
Direction du personnel : Olivia Le Prévost
Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho
Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon
Ont également participé à ce numéro : Julien Bobroff, Roman Ikonicoff, Clément Romac
PUBLICITÉ France
stephanie.jullien@pourlascience.fr
ABONNEMENTS
www.boutique.groupepourlascience.fr
Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr
Tél. : 01 86 70 01 76
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Adresse postale :
Service abonnement groupe Pour la Science
20 rue Rouget-de-Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux.
Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)
France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros
Reste du monde : 85,25 euros
DIFFUSION
Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie
Tél. 04 88 15 12 47
Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr
DISTRIBUTION
MLP
ISSN 0 153-4092
Commission paritaire n° 0927K82079
Dépôt légal : 5636 – Juillet 2023
N° d’édition : M0770549-01
www.pourlascience.fr
170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris
Tél. 01 55 42 84 00
SCIENTIFIC AMERICAN
Editor in chief : Laura Helmut
President : Kimberly Lau 2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc.
Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial «Scientific American» sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL».
© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).
Origine du papier : Autriche
Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne
DITO É
Imprimé en France
Maury Imprimeur SA Malesherbes
N° d’imprimeur : 271 093
IMMENSE IGNORANCE
Il est aujourd’hui établi que les papillons de jour sont apparus il y a 100 millions d’années environ, sur le continent américain. Qu’on songe aux trésors de patience et d’ingéniosité qui furent nécessaires à l’équipe à l’origine de ce résultat, comparant des centaines de gènes, appartenant à des milliers d’espèces. Et convenons de l’exploit : franchir les millions d’années, à travers le globe, pour retrouver la piste des représentants ancestraux d’aussi fragiles êtres que ces lépidoptères ? La science d’aujourd’hui en est capable.
Comment ne pas s’étonner, dès lors, que les scientifiques n’aient pas encore percé le secret de la manière dont s’alimentent les plus grands êtres que porte notre planète ? Si l’on sait où vivent et se reproduisent les baleines à fanons, on ignore en effet encore comment elles parviennent à localiser le krill dont elles se nourrissent. Par quel moyen repèrent-elles ces minuscules crevettes dans l’étendue sans limite des océans ? Plusieurs équipes s’emploient à résoudre ce mystère. Il faut à la fois suivre au plus près les cétacés, prélever minutieusement des échantillons de l’eau où ils évoluent pour y rechercher tout indice physicochimique qui leur servirait éventuellement de piste vers leurs proies, tout en perturbant le moins possible ces espèces menacées.
Si les connaissances issues du travail des scientifiques poursuivent indéniablement leur expansion, l’immensité de notre ignorance progresse elle aussi, à mesure que nous posons de nouvelles questions à la nature… mais aussi à chaque fois que nos propres créations nous plongent dans la perplexité. C’est le cas des modèles massifs de langage, dont le fameux ChatGPT. Il leur arrive d’accomplir des tâches pour lesquelles ils n’ont pas été destinés. Et leurs concepteurs sont incapables d’expliquer les ressorts de ces performances inattendues. Nous avons encore, à l’évidence, des choses à apprendre des machines qui apprennent (l’apprentissage étant la caractéristique déterminante des modèles massifs de langage). Et, qui sait, ce faisant, parce que ces machines sont susceptibles d’être le siège de processus proches de ceux qu’identifient les neuroscientifiques dans notre cerveau, nous deviendrons moins ignorants… de notre nature humaine, sujet s’il en est de questionnements inépuisables. n
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 3
François Lassagne Rédacteur en chef
s
OMMAIRE
ACTUALITÉS GRANDS FORMATS
P. 6
ÉCHOS DES LABOS
• Quand le cerveau contrôle un implant pour remarcher
• Les chasseurs-cueilleurs néolithiques faisaient des plans
• Un blanc impossible
• Des lignes de bulles
• Les mirusvirus, de nouveaux virus marins
• Les garde-fous du Système solaire
P. 18
LES LIVRES DE L’ÉTÉ
P. 20
DISPUTES
ENVIRONNEMENTALES
Le carbone dans tous ses états
Catherine Aubertin
P. 22
LES SCIENCES À LA LOUPE Peut-on accroître la productivité de la recherche ?
Yves Gingras
P. 38
PHYSIQUE NUCLÉAIRE
FUTUR DU NUCLÉAIRE : LA QUESTION
CRUCIALE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
Sylvain David, Sandra Bouneau et Adrien Bidaud
La part du nucléaire dans le mix énergétique mondial reste débattue Dans l’hypothèse d’une augmentation significative, s’en tenir à la seule fission de l’uranium réduirait l’échelle de son développement.

P. 52
PLANÉTOLOGIE EN ROUTE VERS LES MONDES GLACÉS DE JUPITER

Jonathan O’Callaghan
La mission Juice a décollé le 14 avril dernier en direction des lunes glacées de Jupiter. Avec la sonde Europa Clipper, elle explorera ces mondes qui hébergent des océans d’eau liquide sous leur surface. Ces conditions sont-elles propices à la vie ?
P. 57
PORTFOLIO DES OCÉANS EXTRATERRESTRES
Rebecca Boyle et Juan Velasco
P. 46
INFORMATIQUE
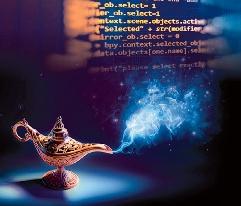
Six lunes du Système solaire contiendraient de vastes quantités d’eau liquide
LETTRE D’INFORMATION
NE MANQUEZ PAS
LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE
GRÂCE À LA NEWSLETTER
• Notre sélection d’articles
• Des offres préférentielles
• Nos autres magazines en kiosque
Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

En couverture :
© Gaby Barathieu
Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot
Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.
MODÈLES MASSIFS DE LANGAGE : D’OÙ VIENNENT LES COUPS DE GÉNIE DE L’IA ?
Stephen Ornes
Les modèles massifs de langage comme ChatGPT sont désormais suffisamment grands pour commencer à exhiber des comportements surprenants et imprévisibles. Reste à comprendre pourquoi.
P. 62
PLANÉTOLOGIE
« DE L’EAU LIQUIDE, IL Y EN A PARTOUT DANS L’UNIVERS »
Entretien avec Gabriel Tobie
Les mondes glacés et leurs probables océans d’eau liquide en profondeur restent encore globalement inconnus.
4 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023
fr
N° 549 / Juillet 2023
P. 66
CHIMIE
QUAND LES LIQUIDES ONT DES TROUS !
Martin Tiano et Margarida Costa Gomes
Stocker du gaz, dépolluer, séparer des fluides…
C’est possible grâce aux liquides poreux. En une dizaine d’années, ces matériaux ont connu des progrès fulgurants
P. 72
HISTOIRE DES SCIENCES
L’HÉRITAGE DE JEAN-HENRI FABRE À L’HEURE DU DÉCLIN DES INSECTES
Romain Garrouste
Fin observateur, ce savant hors normes, dont on s’apprête à fêter le bicentenaire, a remarquablement documenté une faune aujourd’hui menacée : les insectes du bassin méditerranéen.

P. 24
BIOLOGIE ANIMALE
DANS LE SECRET DES BALEINES
Kate Wong
Comment les baleines à bosse, ces colossales créatures qui se nourrissent par filtration, trouvent-elles leurs proies minuscules dans l’immensité océanique ? La réponse à cette question pourrait être la clé de la sauvegarde de ces espèces menacées.

P. 34
ÉCOLOGIE COMPORTEMENTALE
EST MULTISENSORIELLE »
Entretien avec Aurélie Célérier et Bertrand Bouchard
Signaux chimiques, échos acoustiques, orientation magnétique ? Comment les cétacés parviennent-ils à repérer des proies minuscules dans l’immensité de l’océan ? Éclairages d’Aurélie Célérier et de Bertrand Bouchard, biologistes, qui observent le comportement des baleines et des dauphins pour percer le secret de leurs sens.

RENDEZ-VOUS
P. 80
LOGIQUE & CALCUL DES SUITES
À LA DYNAMIQUE INSAISISSABLE
Jean-Paul Delahaye

Certaines règles simples engendrent des situations mathématiques étranges qu’il est difficile de comprendre totalement.
P. 86
ART & SCIENCE
On a marché sur la Lune, sous terre
Loïc Mangin
P. 88
IDÉES DE PHYSIQUE
Des aimants trop canons
Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik
P. 92
CHRONIQUES
DE L’ÉVOLUTION
Comment les papillons ont conquis le monde

Hervé Le Guyader
P. 96
SCIENCE & GASTRONOMIE
La fin des cristaux dans les vins blancs ?
Hervé This
P. 98
À PICORER
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 5
« CHEZ LES CÉTACÉS, LA QUÊTE DE NOURRITURE
QUAND LE CERVEAU CONTRÔLE UN IMPLANT POUR REMARCHER
La connexion directe des signaux cérébraux à un dispositif de stimulation électrique situé sur la moelle épinière a rendu l’usage de ses jambes à un patient paraplégique.
En 2011, à la suite d’un accident de vélo, Gert-Jan Oskam s’est retrouvé paralysé des jambes. Sa moelle épinière avait été partiellement endommagée, empêchant les commandes motrices en provenance du cerveau d’être relayées jusqu’à ses muscles. Mais aujourd’hui, cet homme de 40 ans commence à récupérer l’usage de ses jambes : il marche, monte des escaliers, etc. Et cela, grâce à une interface « cerveau-moelle épinière » conçue par l’équipe de Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Avec ce « pont numérique », GertJan Oskam pense à l’action de marcher et le signal est transmis jusque dans les muscles de ses jambes.

D’après l’Organisation mondiale de la santé , chaque année , entre 250 000 et
500 000 personnes sont victimes d’un accident conduisant à une section complète ou partielle de la moelle épinière. La plupart de ces accidents n’endommagent pas directement les nerfs moteurs, mais la perturbation des signaux
pour rétablir efficacement une mobilité des membres
Cependant , dès 2018, l’équipe de Grégoire Courtine a obtenu des résultats encourageants avec une approche inédite, l’électrostimulation. La stratégie a consisté à placer, en dessous de la lésion, un ensemble d’électrodes sur la dure-mère, la membrane entourant et protégeant la moelle épinière. Ces électrodes, pilotées par un ordinateur, envoyaient des impulsions électriques pour amplifier les signaux reçus des connexions encore fonctionnelles, de sorte à activer indirectement les neurones moteurs qui contrôlent les muscles des jambes.
émis par le cerveau vers les membres inférieurs suffit à bloquer le contrôle des muscles et à provoquer la paralysie
Si la prise en charge de ces patients s’est améliorée ces dernières années, il n’existe pas d’approche thérapeutique
Initialement, six patients ont bénéficié de cette approche. Ils ont réussi à se tenir debout et à marcher dans le laboratoire avec une aide externe. Et après plusieurs mois de rééducation intensive, la mobilité avait progressé chez les six patients… même en l’absence de stimuli À la suite de l’accident, en l’absence de signal provenant du cerveau, il est probable que les fibres nerveuses intactes se
6 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 ÉCHOS DES LABOS
P. 6 Échos des labos
P. 18 Les livres de l’été
P. 20 Disputes environnementales P. 22 Les sciences à la loupe
Patient paraplégique marchant grâce à l’interface cerveau-colonne vertébrale.
NEUROSCIENCES
© CHUV /
Gilles Weber
Un algorithme décode les intentions motrices du patient et les convertit en impulsions électriques
mettent en dormance Leur stimulation par les électrodes et le travail de rééducation ont favorisé leur réveil et le renforcement de leur activité au point de rétablir une certaine mobilité
En 2022, des améliorations du système ont permis à trois nouveaux patients ayant une lésion complète de marcher ou de faire du canoë après seulement un à trois jours de calibration. Cependant, un inconvénient subsistait Les séquences de stimulation sont préprogrammées et le patient ne peut pas les ajuster selon la situation dans laquelle il évolue Ce dernier avait donc une perception peu naturelle de la marche et il avait l’impression d’être plus contrôlé par la machine que d’être, lui, aux commandes
Dans leur toute dernière avancée , l’équipe de Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine continue d’utiliser la matrice d’électrodes installée sur la moelle épinière, mais elle est maintenant reliée au cerveau par un nouveau système sans fils . Les chercheurs ont ainsi installé 64 électrodes au niveau de la région du cerveau qui contrôle le mouvement des jambes Ces capteurs enregistrent avec une grande fidélité l’activité neuronale.
Un algorithme décode les intentions motrices du patient à partir des signaux neuronaux et les convertit en impulsions électriques à destination des muscles.
La connexion n’a pris que quelques minutes pour s’établir. Le patient a retrouvé un contrôle beaucoup plus naturel de ses mouvements, ce qui lui permet de marcher, de monter des escaliers ou de se déplacer sur un terrain complexe Et, encore une fois, les chercheurs ont constaté que la combinaison du système de stimulation et de l’entraînement intensif a rétabli partiellement la fonction motrice. Gert-Jan Oskam est capable de marcher sur de courtes distances sans l’aide du système et seulement en s’appuyant sur des béquilles
Il reste à étendre l’expérience à d’autres personnes, dont certaines avec une lésion totale. Par ailleurs, les chercheurs envisagent d’adapter leur système pour des individus qui ont perdu l’usage de leurs bras n
Sean Bailly
Ligo et Virgo : une nouvelle campagne d’écoute du cosmos
Après une longue pause pour améliorer leurs instruments, les interféromètres laser géants repartent en chasse d’ondes gravitationnelles. De nouveaux types de sources sont au programme. Marie-Anne Bizouard fait le point sur cette campagne.

accompagné de plusieurs problèmes. Par exemple, Ligo a dû changer des miroirs dont le revêtement chau ait de façon non uniforme.
Qu’est-ce qu’un interféromètre laser géant ?
Ce type de détecteurs est conçu pour traquer les ondes gravitationnelles, ces vibrations du tissu de l’espace-temps émises par des sources très particulières comme des systèmes binaires d’objets compacts (trous noirs ou étoiles à neutrons). Dans ce détecteur, un laser est divisé en deux faisceaux qui se propagent perpendiculairement dans deux bras de plusieurs kilomètres. Ils se réfléchissent sur des miroirs aux extrémités des bras et reviennent au point de départ, où ils interfèrent. Une onde gravitationnelle trahit son passage dans le détecteur en altérant la figure d’interférence.
Le 24 mai dernier, les équipes des interféromètres Ligo (aux États-Unis), Virgo (en Italie) et Kagra (au Japon) ont commencé une nouvelle campagne de prise de données dite « O4 », après trois ans de mise à jour pour augmenter leur sensibilité.
En quoi ont consisté ces améliorations ?
Pour réduire le bruit quantique qui domine à haute fréquence et qui est lié aux fluctuations de l’état fondamental de la lumière (vide quantique), nous utilisons une technique de « compression » de la lumière. Mais cette technique a un inconvénient. À cause du principe d’incertitude d’Heisenberg, le gain sur le « bruit de grenaille » à haute fréquence se traduit par une augmentation du bruit de pression de radiation : les fluctuations quantiques de la force avec laquelle les photons frappent les miroirs sont plus grandes, ce qui dégrade la sensibilité à basse fréquence. Pour O4, nous avons amélioré le système de compression de la lumière avec une cavité de filtrage qui fait tourner phase et amplitude de la lumière selon la fréquence.
Pour Ligo et Virgo, un des autres objectifs était d’augmenter la puissance du laser pour gagner en sensibilité. Cependant, ce changement s’est
La campagne de prise de données a commencé. Mais certains détecteurs rencontrent des contretemps. De quelle nature ?
Ligo a bien commencé la phase O4 le 24 mai dernier. Mais Virgo a eu des problèmes avec deux miroirs. L’un est déjà réparé, mais l’autre doit être changé, ce qui prend du temps. L’objectif est de rejoindre O4 en septembre. Virgo aura été absent les premiers mois, mais la phase O4 est prévue sur dix-huit mois, donc il y aura une grande période où Ligo et Virgo opéreront de concert. Quant à Kagra, l’interféromètre mis en route le plus récemment, il va prendre un mois de données puis les travaux d’amélioration vont reprendre pour rejoindre plus tard Ligo et Virgo avec une meilleure sensibilité.
Quels sont les objectifs astrophysiques de O4 ?
Pour O4, nous devrions détecter plusieurs fusions de systèmes binaires par semaine. Nous espérons, par exemple, a ner la mesure de la distribution de masse des paires de trous noirs, car celle-ci nous renseigne sur la formation de ces objets et l’histoire des galaxies. Nous espérons aussi voir de nouvelles choses. Si nous avons de la chance, nous détecterons peut-être les ondes gravitationnelles émises par une étoile massive qui s’e ondre sur elle-même avant d’exploser en supernova. Mais pour cela il faudrait que l’explosion se déroule dans la Voie lactée, car ces signaux sont très faibles.
Autre sujet intéressant, l’émission des pulsars (des étoiles à neutrons en rotation). Il ne s’agit pas d’un événement transitoire comme la fusion d’objets compacts ou l’e ondrement d’une étoile massive. C’est une émission continue. Et on ne pourra la mettre en évidence qu’à la fin de la phase O4 en intégrant l’ensemble des données collectées. n
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 7 H. Lorach et al., Nature, 2023.
MARIE-ANNE BIZOUARD directrice de recherche à l’observatoire de la Côte d’Azur
Propos recueillis par Sean Bailly
ASTROPHYSIQUE
L’ESSENTIEL
> Avec seulement 70 femelles en âge de se reproduire, les baleines franches de l’Atlantique nord sont en danger grave d’extinction.
> En étudiant la manière dont d’autres baleines à fanons parviennent à trouver leurs proies minuscules, le krill, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point un outil
prédictif permettant de mieux protéger ces animaux.
> Le sulfure de diméthyle (DMS), un composé chimique libéré par le phytoplancton lorsqu’il est mangé par le krill, pourrait être un indicateur permettant aux baleines de trouver leurs proies.
L’AUTRICE
Dans le secret des baleines
Comment les baleines à bosse, ces colossales créatures qui se nourrissent par filtration, trouvent-elles leurs proies minuscules dans l’immensité océanique ? La réponse à cette question pourrait être la clé de la sauvegarde de ces espèces menacées.

Lorsqu’il est temps de passer à table , les baleines à bosse se mettent en route vers les confins du monde Leur mission : s’en mettre plein la panse jusqu’à être bien en chair et comblées Elles doivent accumuler des réserves d’énergie, prenant près d’une tonne de graisse par semaine, pour assurer leur subsistance pendant le voyage qu’elles e ff ectuent entre leurs aires d’alimentation polaires et subpolaires et les eaux chaudes où elles se reproduisent Ce voyage nécessite de parcourir des milliers de kilomètres sur plusieurs mois, et les baleines doivent être prêtes à se reproduire à leur arrivée Or, il semble que la nature aime les paradoxes , car ces prédateurs colossaux , qui mesure jusqu’à 18 mètres de long et peser 40 tonnes, constituent leurs réserves de graisse en se nourrissant des proies parmi les plus minuscules du monde marin – dont le krill, un crustacé à l’allure de crevette présent dans tous les océans du monde , mais qui se concentre en particulier dans les eaux froides des hautes latitudes
Nous savons déjà bien comment les baleines à bosse se nourrissent. Elles filtrent l’eau de mer à travers des plaques de kératine, appelées fanons, qui tapissent leur mâchoire supérieure et ressemblent aux poils effilés d’une brosse à dents usée Chaque jour, elles dévorent plusieurs milliers de kilogrammes de proies minuscules Or, pour obtenir une telle quantité de nourriture, elles doivent repérer des groupes denses de crustacés Une fois qu’un essaim est localisé, elles recourent à une astucieuse tactique de chasse coopérative ; elles nagent en cercles tout en soufflant des colonnes de bulles pour créer une sorte de filet afin d’encercler le krill . Puis , elles passent à table , s’élançant sur leurs proies densément rassemblées, mâchoires ouvertes et engloutissant des milliers de litres d’eau remplie de krill dans leurs poches gutturales plissées, avant de filtrer leur prise à travers leurs fanons Malgré tout ce que les scientifiques ont appris à propos de ces léviathans majestueux, personne ne sait comment les baleines à fanons (ou mysticètes, un groupe qui comprend les baleines à bosse , les baleines bleues , les
 © Scott Wilson
© Scott Wilson
BIOLOGIE ANIMALE
24 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023
KATE WONG journaliste à Scientific American
Les baleines à bosse et autres baleines à fanons sont les plus grands animaux de la planète, mais elles se nourrissent de certaines des plus petites proies des océans.

POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 25
rorquals communs et boréals, entre autres) trouvent leur nourriture en premier lieu. Leurs cousines, les baleines à dents – cachalots, bélugas , dauphins , etc . –, utilisent des signaux sonar ultrasoniques pour détecter leurs proies, mais les baleines à fanons n’ont pas cette capacité Pourtant, elles parviennent à trouver leurs minuscules cibles dans l’uniformité infinie de la mer Ce mystère, les chercheurs brûlent de le résoudre, ne serait-ce que parce qu’il représente une lacune énorme dans nos connaissances fondamentales sur des espèces très connues De manière plus urgente, savoir comment les baleines à fanons cherchent leur nourriture a d’importantes implications en matière de conservation, en particulier pour une espèce à fanons appelée « baleine franche de l’Atlantique nord »
Celle-ci, un cétacé trapu et aux couleurs sombres qui se nourrit de copépodes – des zooplanctons de la taille d’un grain de riz –, a la triste particularité d’être l’un des mammifères les plus menacés de la planète. En effet, la chasse commerciale à la baleine a failli faire disparaître cette espèce au début du XXe siècle. En 1935, la Société des Nations avait interdit la chasse à toutes les baleines franches, mais contrairement à d’autres espèces dont le nombre avait aussi chuté à cause de cette pratique, les populations de baleine franche de l’Atlantique nord n’ont pas réussi à rebondir à la suite de cette mesure Les zones d’alimentation de l’animal au large de la NouvelleAngleterre et des provinces maritimes canadiennes chevauchent des zones d’activité humaine intense Par conséquent, les collisions avec les navires et l’enchevêtrement dans les engins de pêche, ainsi que les perturbations de leur habitat et de leurs proies induites par le changement climatique, ont fait des ravages
Les estimations les plus récentes indiquent qu’il reste moins de 350 baleines franches de l’Atlantique nord, dont seulement 70 femelles en âge de se reproduire. Selon certaines projections, l’espèce pourrait s’éteindre dans les deux prochaines décennies. Or, comprendre comment les baleines à fanons traquent leurs proies pourrait aider les scientifiques à prévoir où elles iront se nourrir et à mieux gérer les activités humaines qui nuisent aux cétacés dans ces zones
DES ESPÈCES ESSENTIELLES
Mais cette espèce de baleine n’est pas la seule concernée Toutes les baleines à fanons sont de véritables ingénieures des écosystèmes : elles se nourrissent en eaux profondes et libèrent ensuite des nutriments près de la surface par le biais de leurs excréments, qui favorisent la croissance d’organismes végétaux microscopiques, les phytoplanctons Ceux-ci nourrissent à leur tour le krill et d’autres
Ce texte est une adaptation de l’article Big little mystery, publié par Scientific American en avril 2023.
créatures à la dérive formant le zooplancton, qui sont mangés par des animaux plus grands. Les tissus des baleines retiennent également d’énormes quantités de dioxyde de carbone qui contribueraient autrement au réchauffement de la planète – environ 33 tonnes pour une baleine moyenne de grande taille Lorsque les baleines meurent, leurs carcasses coulent au fond de la mer, où elles nourrissent des communautés entières d’organismes des profondeurs – des requins dormeurs aux bactéries aimant le soufre – qui sont spécialement adaptés à l’exploitation de ces « chutes de baleines » pour se nourrir et s’abriter. La santé des populations de ces cétacés contribue donc à la santé d’un grand nombre d’autres espèces
Le moyen le plus direct pour apprendre comment une baleine à fanons trouve sa nourriture consiste à l’équiper d’un dispositif qui enregistre son comportement sous l’eau et à observer l’animal en train de chercher son repas Hélas, cela n’est pas possible avec les baleines franches de l’Atlantique nord, car elles
sont tellement stressées par l’activité humaine que tout contact direct avec l’homme ne ferait qu’aggraver la situation Heureusement , la baleine franche a des cousines , comme la baleine à bosse, qui sont beaucoup moins en danger. Et l’un des meilleurs endroits pour les observer se nourrir est leur aire d’alimentation, aux confins du monde.
En 2020, deux semaines avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare l’état pandémique du Covid-19, j’ai embarqué à bord d’un navire pour l’Antarctique afin de suivre un groupe de recherche s’attelant à comprendre comment les baleines à fanons trouvent leur nourriture J’y suis allé en tant qu’invitée du croisiériste Polar Latitudes, pour observer une étude menée par les sept scientifiques accueillis sur son bateau de tourisme et pour donner une conférence sur l’évolution des baleines. En se joignant à une telle expédition touristique, l’équipe internationale de chercheurs venus des États-Unis, de Suède et
26 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 BIOLOGIE ANIMALE DANS LE SECRET DES BALEINES
Certaines espèces sont confrontées à des menaces existentielles £
du Japon a économisé les coûts exorbitants habituels d’un voyage vers le continent glacé. En échange de trois cabines communes, de repas et de l’utilisation de deux bateaux pneumatiques robustes , les scientifiques informaient régulièrement les autres passagers de leurs recherches, présentées comme une expédition axée sur les baleines dans le cadre d’un programme de science citoyenne
L’équipe testait une hypothèse sur l’alimentation des baleines à fanons , issue de recherches sur les oiseaux de mer. Au milieu des années 1990, Gabrielle Nevitt, de l’université de Californie , à Davis , a montré que le sulfure de diméthyle (DMS), une substance chimique libérée lorsque le phytoplancton est mangé par le zooplancton, attire les procellariidés, ou oiseaux de mer à narines tubulaires, un groupe d’oiseaux carnivores comprenant les albatros , les pétrels et les puffins , qui mangent ensuite le zooplancton. Il s’agit d’un arrangement mutualiste : en attirant les oiseaux de mer par l’odeur du DMS, le phytoplancton se protège du zooplancton Même tout en bas de la chaîne alimentaire, l’ennemi de votre ennemi est votre ami
SUR LA PISTE DU SULFURE DE DIMÉTHYLE
Les chefs d’équipe de l’expédition, Daniel Zitterbart de l’institut d’océanographie Woods Hole, un physicien qui utilise des méthodes de télédétection pour étudier le comportement et l’écologie des baleines et des pingouins, et Kylie Owen, spécialiste du comportement des baleines au Musée suédois d’histoire naturelle, se sont demandé si les mysticètes pouvaient
être attirées de la même manière par le DMS Le cas échéant, suivre le produit chimique vers des zones où il se trouve en concentrations plus élevées devrait, en théorie, conduire les baleines vers des groupes plus denses de krill et d’autres mangeurs de phytoplancton que si elles cherchaient au hasard Pour en avoir le cœur net, les deux chercheurs se sont associés à Annette Bombosch, biologiste spécialiste des baleines à l’institut Woods Hole ; à Joseph Warren, chercheur spécialiste des zooplanctons à l’université de Stony Brook ; à Kei Toda, de l’université de Kumamoto, au Japon, qui a mis au point la technologie de mesure du DMS, et à Kentaro Saeki, son étudiant alors diplômé ; ainsi qu’à l’océanographe Alessandro Bocconcelli, lui aussi de l’institut Woods Hole, pionnier dans l’utilisation de balises numériques sophistiquées pour l’étude des cétacés.
L’équipe avait prévu de marquer les baleines à bosse à l’aide d’instruments personnalisés contenant des capteurs de pression, des accéléromètres, des compas magnétiques et des hydrophones qui enregistrent leur comportement sous l’eau, ainsi qu’un émetteur radio permettant de les suivre Leurs permis ne les autorisaient à marquer que cinq individus au plus, et ce sur cinq jours seulement, le reste de la croisière de douze jours étant consacré au transit Ils n’avaient donc pas droit à l’erreur Nous avons quitté le port argentin d’Ushuaia, la ville la plus méridionale d’Amérique du Sud, le 28 février et avons passé les deux jours suivants de cette année bissextile à traverser le passage de Drake, la célèbre voie navigable houleuse de 1 000 kilomètres de large entre l’Amérique du Sud et l’Antarctique, escortés par des
Pour étudier comment les baleines à bosse en Antarctique trouvent le krill, les chercheurs fixent des balises sur leur peau et analysent des échantillons d’eau là où elles évoluent.

POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 27 ©
Kate Wong ; Activités réalisées/image prise en vertu du permis ACA2019-018 de la loi sur la conservation de l’Antarctique, et du permis 2018-0020 de protection de l’environnement et de la biodiversité pour les cétacés.
albatros et des pétrels Le 1er mars, nous avons franchi une zone frontière connue sous le nom de « convergence antarctique » et avons pénétré dans les eaux calmes et froides de l’océan Austral Pour la première fois depuis notre entrée dans le passage de Drake, nous apercevions la côte à tribord : l’île Smith, qui fait partie des îles Shetlands du Territoire britannique de l’Antarctique Une fois la houle passée, j’ai pu prendre conscience de l’extraordinaire environnement qui s’offrait à nous Les fragments de glace et les bourguignons – quelques-unes des nombreuses formes que prennent les icebergs – se joignent à la mer et au ciel pour produire un spectacle mêlant toutes les nuances de bleu Des poussins de manchots papous duveteux courent après leurs parents épuisés pour réclamer de la nourriture ; des phoques crabiers d’un blond platine se prélassent au soleil sur des divans de glace à la dérive…

Le matin du 4 mars, je me suis réveillée au lever du jour à Paradise Bay, un port pittoresque où les baleiniers jetaient autrefois l’ancre Depuis mon siège sur le ponton d’un bateau pneumatique , j’ai observé le soleil levant percer une ouverture dans la couverture nuageuse et baigner un glacier lointain d’une lumière dorée Nous étions désormais sur le territoire des baleines, où nous rencontrions des groupes de mammifères qui flottaient à la surface comme d’immenses souches, exhalant de grands panaches d’air humide , dont le souffle s’ajoutait aux craquements des glaciers en plein vêlage et aux grondements des avalanches. La veille , les scientifiques avaient marqué leur première baleine à bosse avec succès Les passagers ont applaudi lorsque la nouvelle a été annoncée au petit- déjeuner Malheureusement , l’animal en question a dormi pendant toute la durée de l’observation Mais plus tard dans la journée, ils ont marqué un deuxième spécimen, qui s’est révélé être un sujet modèle, effectuant plusieurs plongées jusqu’à 260 mètres. Les données fournies par les capteurs indiquent que la baleine se nourrissait par filtration – exactement ce que les chercheurs voulaient voir
Ce 4 mars au matin, l’équipe tentait donc de marquer un troisième individu, en espérant qu’il se comporterait comme le précédent. Daniel Zitterbart, un homme grand et vivace qui pense et parle avec une rapidité formidable, s’est levé à 5 h 30 et s’est rendu sur la passerelle du navire pour déterminer si des baleines se trouvaient dans les parages ainsi que le temps qu’il faisait Or, la journée s’annonçait prometteuse. En effet, plusieurs cétacés avaient été repérés à proximité et l’eau était calme, des conditions idéales pour récupérer les balises, qui sont programmées pour rester sur une baleine pendant quelques heures seulement avant de se détacher et de flotter vers la surface À 6 h 45, les bateaux
de recherche ont été mis à l’eau et les scientifiques se sont préparés à marquer un individu aperçu non loin Pour ce faire, ils utilisent une perche en fibre de carbone longue de six mètres. Une fois qu’ils se sont approchés à moins de trois mètres du cétacé, grâce à cette perche, ils peuvent coller la balise, qui comporte quatre ventouses sur sa face inférieure, sur l’animal qui ne se doute de rien Ainsi, Annette Bombosch et Alessandro Bocconcelli ont navigué sur une étendue d’eau placide en direction d’un groupe de baleines ( à bosse ), ralentissant à leur approche Mais ses membres avaient l’air paresseux Kylie Owen et Annette Bombosch ont donc décidé de cibler un autre groupe qui semblait plus actif

ENREGISTRER LE COMPORTEMENT
Depuis mon point d’observation, situé sur un autre bateau pneumatique, deux baleines à bosse sont alors entrées dans notre champ de vision. Seules leurs petites nageoires dorsales et la partie supérieure de leur dos noir et lisse étaient visibles. Elles n’avaient pas l’air très grandes, mais comme les icebergs, la majeure partie de leur masse se trouve sous la ligne de flottaison À distance, on ne peut donc se faire une idée de leur énormité que lorsqu’elles agitent leurs grandes nageoires au-dessus de l’eau, qu’elles soulèvent leur queue avant de plonger ou qu’elles propulsent leur corps entier hors de l’eau lors d’un de leur saut spectaculaire Alors, Daniel Zitterbart a saisi la lourde perche de marquage et s’est tenu prêt, sur le qui-vive, un pied sur l’étrave et l’autre dans le bateau. La pose de la balise est une opération délicate ; pour que l’émetteur transmette un signal puissant, il doit être placé aussi haut que possible sur le dos de l’animal, tout en évitant la zone de peau sensible qui entoure son évent Lorsque le bateau s’est approché des baleines, Daniel Zitterbart a levé la perche et, au moment opportun, l’a abaissée avec juste assez de force pour que la balise s’accroche solidement à l’une d’elles. L’animal a sursauté , puis a disparu – une réaction typique – et les chercheurs se sont empressés de ranger la perche, de marquer sa position GPS et de se préparer à le surveiller. Leurs trois poses de balise étaient alors couronnées de succès
Une fois que la baleine marquée a refait surface, ils ont passé les heures suivantes à la suivre des yeux et à l’aide d’un récepteur VHF [très haute fréquence] connecté à l’émetteur de la balise, en restant à une distance de plus de 90 mètres du cétacé afin de ne pas interférer avec sa routine. Il faut ensuite récupérer les balises – qui stockent les données comportementales et coûtent 10 000 dollars chacune
lorsqu’elles se détachent automatiquement des baleines à l’heure préprogrammée, après leur
28 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 BIOLOGIE ANIMALE DANS LE SECRET DES BALEINES
–
Les baleines à fanons engloutissent d’énormes quantités d’eau remplie de proies minuscules, qu’elles filtrent ensuite à travers des plaques de kératine appelées « fanons » (en haut). Le krill antarctique (en bas) est l’un des aliments préférés des baleines à bosse.
déploiement. L’équipe n’a alors plus qu’à espérer que le sujet choisi a été coopératif « Idéalement, nous cherchons à marquer une baleine active qui ne se nourrit pas encore, et qui s’éloigne pour se nourrir », explique Kylie Owen. Après cela, les chercheurs à bord du bateau principal doivent prélever des échantillons d’eau pour voir si les concentrations de krill et de DMS augmentent le long du trajet de la baleine S’ils marquent un individu alors qu’il est déjà en train de se nourrir, ils n’ont cependant aucune piste à suivre. Il faut cependant tenir compte du fait que les baleines à bosse sont des animaux sauvages qui ont leur propre programme. « Les étoiles doivent vraiment s’aligner pour que les choses se passent comme nous le souhaitons », reconnaît Kylie Owen
Visiter l’Antarctique, c’est rencontrer les forces qui ont façonné le destin des mysticètes au fil des siècles. Descendantes d’animaux terrestres à quatre pattes, les baleines ont subi l’une des transformations les plus spectaculaires de tous les groupes de vertébrés lorsqu’elles sont passées à la vie aquatique. Comme tous les organismes, elles ont évolué sous l’influence des changements environnementaux, et leur voyage évolutif a commencé il y a environ 50 millions d’années, durant l’Éocène, une ère marquée par un effet de serre prononcé À l’époque , le supercontinent
austral du Gondwana était en train de se fracturer et l’ancien océan nommé Téthys s’étendait de l’océan Pacifique à la Méditerranée. Dans ses eaux chaudes et peu profondes, les ancêtres des baleines ont subi la première phase de leur transformation : elles sont devenues aptes à prendre la mer Leurs membres antérieurs se sont transformés en nageoires, leurs nez sont devenus des évents et leurs oreilles ont été remodelées afin de pouvoir entendre sous l’eau Alors que leurs ancêtres tétrapodes et à fourrure erraient sur les rivages, quelque dix millions d’années d’adaptation à la vie aquatique ont rendu les baleines inaptes à s’aventurer sur la terre ferme

La deuxième phase de leur évolution s’est déroulée alors que la planète se changeait en un monde dit « de glace ». Tandis que l’Éocène laissait sa place à l’Oligocène, les forces tectoniques portaient le coup de grâce au Gondwana, découpant l’Australie, l’Amérique du Sud et l’Antarctique. Une fois la séparation de ces masses continentales achevée, le courant circumpolaire antarctique s’est formé tout autour du continent du même nom, l’isolant des eaux plus chaudes et faisant remonter des profondeurs les nutriments nécessaires à une abondance de phytoplancton et de zooplancton Ce nouveau courant était si vaste et si puissant qu’il a modifié la circulation, la température et

POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 29
© Michael S. Nolan/Alamy Stock Photo (en haut) ; Justin Hofman/Alamy Stock Photo (en bas)
Les rorquals bleus et les autres baleines à fanons sont des ingénieurs de l’écosystème. Leur santé contribue à celle de nombreuses autres espèces.

la productivité des océans dans le monde entier C’est dans ce creuset de changements tectoniques, climatiques et océaniques que sont apparus les précurseurs des baleines à fanons modernes : il y a 35 millions d’années, les premiers représentants de cette lignée patrouillaient dans les mers Au fil des millions d’années suivantes, leurs descendants ont fini par acquérir des fanons et la taille gigantesque qui ont fait la réputation de cette branche de la famille des baleines
Bien que ces animaux aient été façonnés par des changements environnementaux et écologiques spectaculaires à l’échelle de l’évolution, cette longue histoire n’a pas immunisé leurs descendants modernes contre les dangers provoqués par des changements profonds à des échelles de temps plus courtes. Au cours du seul XXe siècle , les baleiniers industriels , armés de harpons explosifs et de navires usines capables de traiter les carcasses en mer, ont massacré plus de deux millions de mysticètes, poussant de nombreuses populations au bord de l’extinction et dégradant leurs écosystèmes Certaines espèces se sont rétablies depuis la disparition de cette industrie, mais elles sont aujourd’hui confrontées à une nouvelle série de menaces existentielles . Le
réchauffement des mers et la pêche commerciale altèrent notamment la disponibilité du zooplancton dont les baleines dépendent pour se nourrir
Quatre jours après avoir observé l’opération de marquage, j’ai rejoint Joseph Warren, Daniel Zitterbart , Kentaro Saeki ainsi que Julien Bonnel de l’institut Woods Hole sur le bateau de croisière Celui-ci a dû faire un détour par la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, une base chilienne dotée d’une piste d’atterrissage sur l’île du Roi-George, dans l’archipel des Shetlands du Sud, pour évacuer un passager blessé vers l’hôpital le plus proche, au Chili. Les chercheurs ont décidé de profiter de cette escale inattendue pour cartographier les concentrations de krill et de DMS dans une baie peu profonde du côté nord de l’île. Nous portions des vestes, des bonnets et des gants pour nous protéger des morsures du froid matinal, mais quelques semaines auparavant, l’Antarctique avait enregistré une température record de 18,3 degrés Celsius La péninsule antarctique, que nous avons explorée, est l’une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement . Elle perd par conséquent de grandes quantités de glace, ce qui est nocif pour le krill En effet, le krill juvénile dépend
30 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 BIOLOGIE ANIMALE DANS LE SECRET DES BALEINES © Franco Banfi/Minden Pictures
de la glace de mer hivernale pour s’abriter et on pense qu’il se nourrit d’algues qui poussent sur la face inférieure de la glace
La hausse des températures n’est pas la seule pression exercée sur ces animaux La demande pour ces petits crustacés a augmenté au cours des deux dernières décennies En cause : l’industrie des compléments alimentaires, qui présente l’huile de krill comme une source riche d’acides gras oméga -3 pour l’homme, et l’industrie de l’aquaculture, qui utilise ces crustacés pour alimenter les poissons d’élevage La pêche au krill est-elle gérée de manière durable ? La question est controversée Mais une étude réalisée en 2020 sur les prédateurs du krill, parmi lesquels figurent aussi les manchots, a révélé que même avec
Personne ne sait comment les baleines à fanons trouvent leur nourriture £
des limites de pêche prudentes dans les eaux de la péninsule antarctique – moins de 1 % du stock dans le secteur Atlantique du sud-ouest de l’océan Austral – ces derniers, dans cette région , sont tout de même en déclin Cela peut être imputable au fait que les navires de pêche concentrent leurs efforts dans des zones que les manchots privilégient également La distribution et la biomasse du krill et d’autres espèces de proies changeant, les prédateurs , y compris les baleines , doivent adapter leurs routines de recherche de nourriture en conséquence
DES ROUTINES FRAGILISÉES
Tandis que le bateau pneumatique s’éloignait du bateau de croisière, les chercheurs installaient leur équipement. Ils utilisent un échosondeur pour envoyer des ondes sonores dans l’eau, où elles rebondissent sur le krill et les autres animaux qu’elles rencontrent, créant sur l’ordinateur portable de Joseph Warren une image des créatures dérivant dans la colonne d’eau. Plus la fréquence du « ping » est basse, plus le transducteur « voit » en profondeur Les pings à haute fréquence , en revanche , permettent de voir des cibles plus petites Ainsi, l’équipe utilise deux fréquences, l’une basse et
l’autre haute, pour rechercher les agrégations de krill, qui se trouvent généralement dans les 200 mètres supérieurs de la colonne d’eau La mascotte du laboratoire de Joseph Warren, un jouet à l’effigie d’un petit cochon couinant, nommé Sir Pings-a-Lot II, surveillait les travaux « On ne fera pas plus excitant que ça », plaisante le chercheur en laissant tomber l’échosondeur à la mer
Le krill n’est pas aussi passionnant à suivre que ses prédateurs, mais ces dernières années, c’est la science qui s’est développée à son propos qui a produit les meilleurs résultats
Pendant que le bateau principal se déplaçait le long de « lignes de transect », dessinant un quadrillage de la zone à explorer, Kentaro Saeki se penchait toutes les deux minutes par-dessus bord afin de prélever de l’eau à la surface de la mer en vue de l’analyser. Deux mallettes en plastique de la taille d’un sac et d’une valise à main contenaient l’équipement nécessaire pour mesurer la présence de DMS dans les échantillons d’eau . D’abord , le barboteur y insuffle de l’air pour faire passer le DMS en phase gazeuse, puis le séchoir élimine toute humidité persistante Après cela, l’ozonateur forme du soufre élémentaire à partir du DMS gazeux, et un photomultiplicateur mesure la lumière émise par le soufre – la quantité de lumière est proportionnelle à la quantité de DMS présente. Auparavant, ce type d’analyse était effectué en laboratoire ; mais les chercheurs de l’institut Woods Hole ont pu miniaturiser le dispositif de mesure du DMS mis au point par Kei Toda pour le faire tenir dans un petit bateau « Avoir réussi à faire fonctionner le détecteur de DMS dans un bateau aussi petit, c’est notre exploit de la saison, se réjouit Daniel Zitterbart Nous ne savons pas combien de temps le signal du DMS issus de l’échantillon d’eau demeure viable Par prudence, nous le traitons en moins de deux minutes. »
Contrôler les données de l’échosondeur, prélever l’eau, traiter l’échantillon. Répétez l’opération Il n’y avait aucune baleine ici pour distraire les chercheurs de la monotonie de ce travail ; rien d’autre qu’un ciel d’un bleu intense, un vent brutal et le bourdonnement du moteur hors-bord Nous avions effectué plus de la moitié du relevé lorsque l’échosondeur a enfin détecté du krill – un groupe de crustacés suspendus au-dessus du fond marin dans les eaux peu profondes de la baie Le manque d’adrénaline de ce travail a été compensé par son impact scientifique potentiel « Une grande partie de ces baies n’a pas encore été étudiée par qui que ce soit, donc toutes les données que nous pouvons obtenir sont précieuses », remarque Joseph Warren Les scientifiques sont retournés sur le navire avec deux agrégations de crustacés détectées et des dizaines d’échantillons d’eau analysés
des
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 31
–
données qui les aideront à comprendre comment le krill et le DMS sont répartis dans l’océan Austral et à établir une base de référence pour mesurer les changements futurs. En mars, le bref été austral touchait déjà à sa fin. La lumière du jour cédait du terrain à l’obscurité et la glace de mer commençait à s’étendre. Bientôt, les baleines à bosse se dirigeraient vers le nord pour se reproduire dans les eaux chaudes au large des côtes occidentales de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. Peut-être était-ce pour cette raison qu’elles ne coopéraient pas Bien que les chercheurs aient réussi à marquer les cinq individus pour lesquelles ils avaient obtenu un permis, seules deux d’entre eux se sont nourris pendant qu’ils étaient surveillés Les trois autres somnolaient ou erraient en toute détente dans les baies. Pour Daniel Zitterbart, le manque d’intérêt des cétacés pour la recherche de nourriture signifie que, la prochaine fois, l’équipe devra modifier le calendrier de ses recherches . « En mars , [ les baleines à bosse] sont déjà si grosses qu’elles dorment trop , constate - t - il . Nous ferons mieux de nous y prendre plus tôt dans la saison, car les baleines seront encore en train de constituer leurs réserves corporelles et seront plus actives. »
Leur stratégie relative à la chimie de l’eau de mer pourrait aussi nécessiter des ajustements L’analyse préliminaire des échantillons obtenus par les chercheurs ainsi que des échantillons supplémentaires recueillis par les passagers, dans le cadre du programme de science citoyenne du navire , a révélé des signaux plus faibles que prévu de DMS Il est possible qu’il n’y ait tout simplement pas eu beaucoup de DMS dans l’eau Toutefois, une autre possibilité , selon Joseph Warren , est qu’une couche d’eau douce fondue au-dessus de l’eau de mer ait dilué le signal. « La physique de l’eau complique les choses », préciset-il. Pour obtenir une image plus claire de la composition chimique , les chercheurs devront peut- être prélever des échantillons d’eau plus profonde
VERS UNE SURVEILLANCE DEPUIS L’ESPACE
À l’avenir, Daniel Zitterbart souhaite s’éloigner des programmes de visites touristiques en bateau de croisière et se concentrer sur la mise au point d’une image détaillée de l’activité dans une seule et unique baie L’idée est d’embarquer sur une croisière à destination de l’une des bases de recherche de l’Antarctique et d’y rester, seulement avec les bateaux pneumatiques. Ils étudieraient alors les baleines, le krill et la chimie de l’eau au même endroit, plusieurs jours d’affilée, et verraient comment ils évoluent, puis ils rattraperaient le navire principal sur le chemin
Les baleines franches de l’Atlantique nord sont en danger critique d’extinction. Les chercheurs espèrent utiliser le sulfure de diméthyle pour prédire où ces baleines vont se nourrir – une information qui pourrait guider la gestion de la conservation de ces animaux.

du retour Cependant, il leur faudra d’abord trouver un bateau capable de les emmener au bout du monde Ces dernières années, l’industrie des croisières a accumulé une liste d’attente de clients ayant payé leur voyage sans pouvoir l’effectuer à cause de la pandémie. Ainsi, hélas, les voyages auxquels l’équipe pourrait normalement se greffer sont complets. « D’après nos plans, nous avons besoin de cinq ans de données, mais trois années sont déjà passées à la trappe », déplore Daniel Zitterbart à propos de l’impact de la pandémie sur le projet. Il espère qu’il sera possible d’obtenir un passage en 2024. En attendant, il s’intéresse à d’autres approches possibles qui, à l’autre bout de la planète, pourraient accélérer l’aide apportée aux baleines qui en ont le plus besoin
Au cours des trois dernières années, en attendant la prochaine occasion en Antarctique, Daniel Zitterbart, Kylie Owen et leurs collègues ont étudié la relation entre le DMS, le zooplancton et les mysticètes dans les eaux au large du Massachusetts, aux États-Unis. Comme ils ne peuvent pas marquer les baleines franches de l’Atlantique nord, ils recherchent des corrélations entre les points chauds du DMS et les agrégations de baleines franches dans la baie de Cape Cod L’idée est de voir si ce composé chimique peut servir d’indicateur pour prédire où les baleines vont faire leur apparition Pour cela, l’équipe étudie les cétacés par bateau et par avion, mais sans utiliser de balises Alors que les recherches menées en Antarctique visent à identifier le mécanisme précis par lequel les baleines à fanons trouvent leurs proies – que ce soit en suivant les gradients de DMS jusqu’aux essaims de krill ou par un autre moyen –, les travaux de Cape Cod visent uniquement à établir si ces baleines ont tendance
32 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 BIOLOGIE ANIMALE DANS LE SECRET DES BALEINES
© Foto4440/Getty Images
David Wiley
à se montrer dans les parties de l’océan où les concentrations de DMS sont plus élevées. Si c’est le cas, les scientifiques peuvent théoriquement utiliser les valeurs de DMS pour prédire où et quand les baleines apparaîtront, que ces mammifères détectent réellement le DMS ou qu’ils suivent un autre indice qui y est lié
Les efforts actuels pour protéger les baleines franches de l’Atlantique nord impliquent des restrictions saisonnières de vitesse pour les navires et des systèmes de surveillance visuelle et acoustique. Par exemple, du 1er janvier au 15 mai, dans la baie de Cape Cod, qui est une importante aire d’alimentation pour les baleines franches, tous les navires de 19 mètres de long ou plus sont soumis à une limite de vitesse de 10 nœuds afin de réduire le risque de blessures graves causées par des collisions avec les cétacés Si des baleines sont vues ou entendues dans la région à n’importe quel moment de l’année, les bateaux de toutes tailles sont priés de ralentir et de faire attention à ces créatures. Une application gratuite, appelée Whale Alert, affiche les zones de gestion saisonnière et les données de détection des baleines sur une carte en temps quasi réel Ces approches de gestion manquent cependant de puissance prédictive, d’après l’écologiste
David Wiley, du Stellwagen Bank National
Marine Sanctuary de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique , qui travaille avec Daniel Zitterbart sur la recherche sur le DMS. Par ailleurs, les gros bateaux qui empruntent des voies de navigation encombrées sont souvent incapables de changer de cap assez rapidement pour éviter les collisions avec ces gros animaux, qui se déplacent lentement « Avec un outil prédictif comme le DMS, nous pourrions planifier au lieu de réagir »
En 2021, Kylie Owen, Daniel Zitterbart, David Wiley et leurs collaborateurs ont publié un article fondé sur les recherches menées à Cape Cod, montrant que des niveaux plus élevés de DMS correspondent à des concentrations plus élevées de zooplancton, de sorte que si les baleines à fanons suivent en effet le DMS, celui-ci les conduira bien vers leurs proies. Les chercheurs tentent à présent de déterminer si les baleines à fanons se regroupent effectivement dans ces points chauds de DMS Les résultats préliminaires indiquent que c’est bel et bien le cas pour les baleines franches de l’Atlantique nord et les rorquals boréals (une autre espèce à fanons qui se nourrit de copépodes). Pour étayer leur argument, les chercheurs mesureront à partir de cette année les concentrations de DMS dans la baie de Cape Cod et la baie du Massachusetts toutes les deux semaines le long de lignes de cheminement normalisées, avant l’arrivée des baleines franches, mais aussi lorsqu’elles arrivent et lorsqu’elles repartent Leur objectif est de déterminer à partir de quelle quantité de DMS dans l’eau elles font leur apparition. « Nous devons déterminer les seuils, c’està-dire ce qui est biologiquement pertinent pour les baleines », explique David Wiley à propos de l’étude, qui devrait durer environ deux ans L’objectif serait de pouvoir surveiller depuis l’espace , grâce à l’imagerie satellite , les endroits où les niveaux de DMS augmentent et qui sont donc susceptibles d’être des lieux de rassemblement pour les baleines franches de l’Atlantique nord Les responsables de la gestion de la faune pourraient détourner les navires de ces zones ou fermer temporairement les pêcheries ou les sites d’énergie éolienne qui dérangent les baleines, jusqu’à ce que les niveaux de DMS diminuent et que les cétacés s’en aillent. Par ailleurs, les climatologues s’intéressent depuis longtemps au DMS, parce qu’il favorise la formation des nuages Ils ont déjà découvert que cette substance chimique pouvait être détectée depuis l’espace Mais il faudra des données satellitaires à plus haute résolution que celles dont on dispose actuellement pour prédire les mouvements des baleines. Pour les baleines franches de l’Atlantique nord et tous les organismes dont le destin est lié au leur, le corpus de connaissance ne s’étoffe pas assez rapidement… « Si les choses ne changent pas , ces baleines franches disparaîtront de notre vivant », s’alarme David Wiley. Il estime que le sort de cette espèce clé est le problème de conservation de notre époque . Peut - être qu’avec l’aide des baleines à bosse affamées de l’Antarctique et de quelques scientifiques curieux, les baleines franches de l’Atlantique Nord et d’autres mysticètes en péril reprendront un jour leur place de souveraines du royaume océanique n
BIBLIOGRAPHIE
M. S. Savoca et al., Baleen whale prey consumption based on high-resolution foraging measurements, Nature, 2021.
J. H. Geisler et al., The origin of filter feeding in whales, Current Biology, 2017.
C. T. S. Little, Life at the bottom : The prolific afterlife of whales, Scientific American, 2010.
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 33
Si rien ne change, les baleines franches de l’Atlantique disparaîtront de notre vivant £


46 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 INFORMATIQUE
L’ESSENTIEL L’AUTEUR
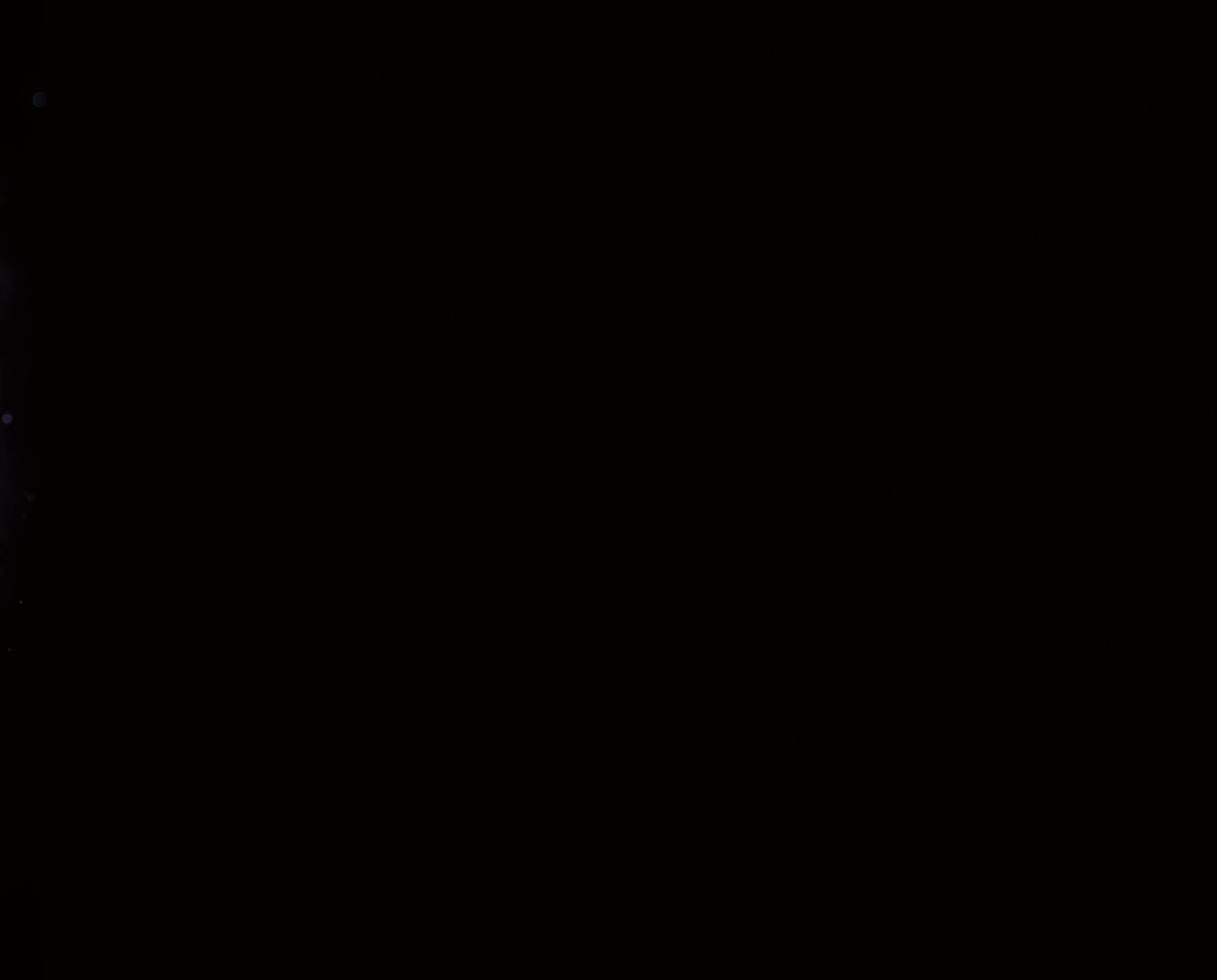
> Depuis l’irruption dans la sphère publique de ChatGPT, dont la 4e version vient d’être implémentée, les « modèles massifs de langage » impressionnent par leurs capacités.
> Constituées de réseaux de neurones artificiels à plusieurs centaines de milliards de paramètres, ces IA semblent développer des compétences émergentes, telles des capacités

de calcul ou de déduction, dépassant le simple traitement du langage pour lequel elles ont été conçues et entraînées.
> Les chercheurs tentent de comprendre les mécanismes de cette apparente émergence, qui souvent se manifeste brutalement à partir d’un seuil de taille du réseau, afin de la rendre prévisible et de contrôler des e ets qui pourraient se révéler néfastes.
Modèles massifs de langage
D’où viennent les coups de génie de l’IA ?
Les modèles massifs de langage comme ChatGPT sont désormais suffisamment grands pour commencer à exhiber des comportements surprenants et imprévisibles. Reste à comprendre pourquoi.
Quel film ces émojis décriventils ? Cette question était l’une des 204 tâches choisies l’année dernière pour tester la capacité de divers modèles massifs de langage (large language models, ou LLM, pour leur acronyme anglais), les moteurs de calcul derrière les chatbots d’intelligence artificielle (IA) tels que ChatGPT Les LLM les plus simples ont fourni des réponses surréalistes. « Le film est un film sur un homme qui est un homme qui est un homme », a commencé l’un d’eux. Les modèles de complexité moyenne se sont approchés de la bonne réponse, suggérant Le Monde secret des émojis Mais le modèle le plus complexe l’a emporté en une seule réponse : Le Monde de Némo

« Je m’attendais à être surpris. Mais ce que ces modèles accomplissent est vraiment étonnant », commente Ethan Dyer, chercheur en informatique chez Google Research, qui a participé à l’organisation du test. La surprise tient au fait que ces modèles sont supposés n’appliquer qu’une seule directive : accepter une
chaîne de texte en entrée et prédire ce qui va suivre, encore et encore, en se basant uniquement sur des statistiques Certes, les informaticiens s’attendaient à ce que le passage à grande échelle améliore les performances pour des tâches connues , mais ils n’avaient pas prévu que les modèles se montrent soudainement capables de gérer autant de tâches nouvelles et imprévisibles. Des études récentes, comme celle à laquelle a participé Ethan Dyer, ont en effet révélé que les LLM peuvent développer des centaines d’aptitudes « émergentes » – des tâches que peuvent accomplir les grands modèles, contrairement aux plus petits, et dont beaucoup ne semblent pas avoir grand-chose à faire avec l’analyse d’un texte. Ces dernières vont de la multiplication à la génération d’un code informatique exécutable et, manifestement, à l’identification d’un film sur la base d’émojis Plus surprenant encore : de nouvelles analyses suggèrent que pour certaines tâches et certains modèles, il existe un seuil de complexité audelà duquel la compétence du modèle monte en flèche Un comportement dont les mêmes

POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 47
© Romolo Tavani/shutterstock (lampe) ; © whiteMocca/shutterstock (fond)
STEPHEN ORNES journaliste scientifique, auteur de Math Art : Truth, Beauty, and Equations (Union Square & Co., 2019)
analyses montrent, aussi, le revers : à mesure qu’ils gagnent en complexité, certains modèles affichent de nouveaux biais et inexactitudes dans leurs réponses « Ce type d’aptitudes, dont font preuve les grands modèles de langage, n’était jusqu’ici, à ma connaissance, pas traité dans les publications scientifiques », s’étonne Rishi Bommasani, informaticien à l’université Stanford L’année dernière , il a aidé à compiler une liste de dizaines de comportements émergents, parmi lesquels figurent plusieurs de ceux identifiés dans le projet d’Ethan Dyer Cette liste ne cesse de s’allonger. Aujourd’hui, les chercheurs s’efforcent non seulement d’identifier d’autres capacités émergentes , mais aussi de comprendre pourquoi et comment elles adviennent
en substance , ils essaient de prédire l’imprévisible
Comprendre l’émergence des aptitudes des modèles pourrait apporter des réponses à des questions profondes entourant l’IA et l’apprentissage automatique en général, comme le fait de savoir si les modèles complexes font vraiment quelque chose de nouveau ou s’ils deviennent simplement très bons en analyses statistiques. Cela aiderait également les chercheurs à exploiter les avantages potentiels de ces capacités émergentes et à en limiter les risques « Actuellement, nous ne savons pas comment prédire dans quel type d’application est susceptible d’apparaître une aptitude néfaste, que ce
DU LANGAGE AU CODE
« Je veux que tu te comportes comme un terminal Linux. J’écrirai des commandes et tu répondras avec les réponses que devrait afficher un terminal ». Après ces premières instructions, un ingénieur de l’entreprise DeepMind a demandé à ChatGPT d’exécuter des commandes diverses, allant de la création d’un fichier affichant une liste de blagues à l’écriture d’un code, dans le langage Python, calculant les dix premiers nombres premiers (ci-dessus).
soit de manière progressive ou imprévisible », observe Deep Ganguli, informaticien membre de l’équipe de la start-up Anthropic
L’ÉMERGENCE DE L’ÉMERGENCE
Biologistes, physiciens, ou encore écologistes, utilisent le terme « émergents » pour décrire les comportements collectifs autoorganisés qui apparaissent lorsqu’une large collection d’éléments se comporte comme une seule entité Les combinaisons d’atomes sans vie donnent naissance à des cellules vivantes ; les molécules d’eau créent des vagues ; lors de leurs « murmurations », les étourneaux tracent dans le ciel des motifs changeants, mais identifiables ; les cellules font bouger les muscles et battre les cœurs… Les capacités émergentes se manifestent essentiellement dans des systèmes comportant un grand nombre de parties individuelles Mais ce n’est que récemment que les chercheurs ont pu documenter ces capacités dans les LLM, du fait que ces modèles ont atteint des tailles considérables.
Les modèles de langage existent depuis des décennies. Jusqu’à il y a environ cinq ans, les plus puissants étaient basés sur ce que l’on appelle un « réseau neuronal récurrent ». Ceux-ci, pour l’essentiel, considèrent une chaîne de texte donnée et prédisent quel sera le mot suivant. Ce qui rend un modèle « récurrent », c’est qu’il apprend à partir de ses propres résultats : ses prédictions sont réinjectées dans le réseau afin d’améliorer les performances futures.
En 2017, des chercheurs de Google Brain ont introduit un nouveau type d’architecture appelé transformer Alors qu’un réseau récurrent analyse une phrase mot par mot, le transformer traite tous les mots en même temps Par conséquent, les transformers sont capables de traiter de volumineux corpus de texte en parallèle Cette architecture, notamment en augmentant le nombre de paramètres des modèles de langage, est à l’origine de l’accroissement rapide de leur complexité. Les paramètres s’apparentent à des connexions entre les mots, et les modèles s’améliorent en ajustant ces connexions au fur et à mesure qu’ils parcourent les textes qui leur sont fournis pour les entraîner Plus il y a de paramètres dans un modèle, plus celui-ci peut affiner ses connexions, et plus il se rapproche d’une imitation satisfaisante du langage humain. Comme on s’y attendait, une analyse réalisée en 2020 par les chercheurs d’OpenAI a montré que les modèles gagnent en précision et en capacité avec la taille
Ce texte est une adaptation de The unpredictable abilities emerging from large AI models, publié par Quanta Magazine en mars 2023.
Mais l’entrée en scène des LLM a également fait apparaître de nombreux phénomènes véritablement inattendus. Avec l’avènement de modèles comparables à GPT-3, qui compte 175 milliards de paramètres – ou le modèle PaLM de Google, qui peut être étendu jusqu’à 540 milliards de paramètres –, les utilisateurs
48 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 INFORMATIQUE MODÈLES MASSIFS DE LANGAGE : D’OÙ VIENNENT LES COUPS DE GÉNIE DE L’IA ? © Pour la Science ; © Sira Anamwong/Shutterstock, d’après engraved.blog
–
ont commencé à décrire de plus en plus de comportements émergents. Un ingénieur de DeepMind a rapporté avoir même réussi à convaincre ChatGPT qu’il était un terminal Linux et l’avoir amené à exécuter un code mathématique simple pour calculer les 10 premiers nombres premiers (voir page 48) Fait remarquable, il est parvenu à finir la tâche plus rapidement que le même code s’exécutant sur une vraie machine Linux.
Comme dans le cas du film « Émoji », les chercheurs n’avaient aucune raison de penser qu’un modèle de langage conçu pour prédire du texte imiterait de manière convaincante un terminal informatique Nombre de ces comportements émergents illustrent l’apprentissage « à zéro coup » ou « à peu de coups », qui décrit la capacité d’un LLM à résoudre des problèmes qu’il n’a jamais – ou rarement – rencontrés auparavant, durant la phase d’entraînement Selon Deep Ganguli , il s’agit justement là d’un objectif à long terme de la recherche en IA . Le fait de montrer que GPT-3 peut résoudre des problèmes sans aucune donnée d’entraînement explicite, sur un mode à zéro coup, « m’a amené à arrêter ce que j’étais en train de faire et à m’impliquer davantage dans cette voie de recherche », dit le chercheur Il n’a pas été le seul. Une flopée de scientifiques, ayant repéré les premiers signes que les LLM peuvent aller au-delà des contraintes de leurs données d’entraînement, s’efforcent de mieux comprendre à quoi ressemble l’émergence et comment elle se produit La première étape a consisté à la documenter minutieusement.
AU-DELÀ DE L’IMITATION
En 2020, Ethan Dyer et d’autres à Google Research ont prédit que les LLM allaient induire d’importantes transformations – quant à la nature de ces transformations, la question restait ouverte Ils ont donc demandé à la communauté des chercheurs de fournir des exemples de tâches difficiles et variées afin de tracer les contours de ce qu’un LLM pourrait accomplir Ce travail a été baptisé la « Référence au-delà du jeu de l’imitation » (Beyond the Imitation Game Benchmark ou BIG-bench), par allusion au « jeu de l’imitation » d’Alan Turing, un test visant à déterminer jusqu’à quel point un ordinateur est en mesure de répondre à des questions d’une manière humaine convaincante – ce qui, plus tard, sera connu comme le test de Turing Le groupe s’est particulièrement intéressé aux exemples où les LLM acquièrent soudainement de nouvelles capacités totalement absentes auparavant « Comprendre ces transitions brutales est une grande question pour la recherche », assure Ethan Dyer
Comme on pouvait s’y attendre, pour certaines tâches, les performances d’un modèle donné se sont améliorées de manière régulière
et prévisible au fur et à mesure que sa taille (et donc sa complexité) augmentait. Pour d’autres tâches, l’accroissement du nombre de paramètres n’a apporté aucune amélioration. Mais pour environ 5 % des tâches, les chercheurs ont constaté ce qu’ils ont appelé des « percées » – des sauts rapides et spectaculaires de performance à partir d’un certain seuil d’échelle, ce seuil variant en fonction de la tâche et du modèle. Par exemple, les modèles avec relativement peu de paramètres – quelques millions seulement – ne pouvaient répondre de manière satisfaisante à des tâches d’addition à trois chiffres ou de multiplication à deux chiffres, mais, avec des dizaines de milliards de paramètres , la précision a bondi dans certains modèles Des sauts similaires se sont produits
DES PERFORMANCES QUI ÉMERGENT SUBITEMENT
Une équipe de recherche de Google a récemment conduit de nombreux tests visant à évaluer la dépendance des performances des modèles de langage massif au nombre de paramètres qui les constitue (ainsi qu’à la puissance de calcul qu’ils requièrent). Lorsqu’ils doivent effectuer des additions, soustractions et multiplications, les modèles GPT-3 et LaMDA ont une performance quasi nulle pour plusieurs ordres de grandeur, puis deviennent nettement performants à partir de 13 milliards de paramètres (GPT-3) et 68 milliards de paramètres pour LaMDA (en haut, à gauche). On observe un comportement similaire pour la translittération de l’alphabet phonétique international (en haut, à droite), ou la recomposition d’un mot à partir du mélange de ses lettres (en bas, à gauche). Le phénomène s’observe aussi pour les tests de restitution de connaissance. Le test « MMLU » (en bas, à droite) agrège 57 tests couvrant des questions de mathématique, d’histoire, de droit ; les trois modèles testés présentent des performances faibles jusqu’à 10 milliards de paramètres environ, puis affichent des performances croissant rapidement à partir de 70 à 280 milliards de paramètres (selon le modèle).
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 49 © Pour la Science, d’après J. Wei et al., Emergent abilities of large language models, Transactions on Machine Learning Review, 2022.
109 109 109 1011 1011 108 1010 1012 1011 106 106 106 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 10 10 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50 Taux de réussite ( %) Taux de réussite ( %) Taux de réussite ( %) Taux de réussite ( %) ARITHMÉTIQUE RECOMPOSITION CONNAISSANCES TRANSLITTÉRATION LaMDA GPT-3 Chinchilla Gopher
pour d’autres tâches, notamment le décodage de l’alphabet phonétique international , le déchiffrage des lettres d’un mot, l’identification de contenu offensant dans des paragraphes en hinglish (une combinaison d’hindi et d’anglais) ou encore la production d’équivalent anglais de proverbes kiswahili
Mais les chercheurs ont vite compris que la complexité d’un modèle n’était pas le seul facteur déterminant. Certaines capacités inattendues étaient, aussi, issues de modèles plus petits, avec moins de paramètres, ou entraînés sur des ensembles de données de moindre taille – dès lors que les données étaient d’une qualité suffisamment élevée De plus, ils ont montré que la façon dont une requête est formulée a une influence sur la précision de la réponse du modèle Quand Ethan Dyer et ses collègues ont posé la question du titre du film à émojis en utilisant, par exemple, un format à choix multiples, l’amélioration de la précision du modèle a été moins un saut soudain qu’une augmentation graduelle , proportionnelle à l’augmentation de la complexité du modèle
Et l’année dernière, dans un article présenté à la conférence NeurIPS, le rendez-vous phare du domaine, des chercheurs de Google Brain ont montré comment un modèle invité à expliquer son propre raisonnement (une capacité
LE CHEMIN DU RAISONNEMENT
Il est possible, pour leur faire réaliser certaines tâches, d’inviter les modèles massifs de langage à rendre explicites leurs étapes de raisonnement. Dans certains cas, cette manière de procéder provoque une amélioration significative des performances des modèles. Ici, la résolution d’un problème simple par ChatGPT, sans (à gauche) et avec (à droite) raisonnement explicite.
appelée « raisonnement en fil de pensée ») pouvait résoudre correctement un problème dit « du mot » [type de problème mathématique consistant à déterminer si deux expressions données renvoient au même problème mathématique, ndlr], alors que le même modèle sans cette « invite » [prompt, en anglais – les mots ou phrases données en entrée au modèle pour susciter sa réponse, ndlr] n’y parvenait pas Yi Tay, un scientifique de Google Brain qui a mené une étude systématique des percées, signale des travaux récents suggérant que les invites du type « fil de pensée » modifient la dynamique de changement d’échelle des modèles et, par conséquent, le point où l’émergence se produit Dans leur article pour NeurIPS, les chercheurs de Google ont montré que l’utilisation d’invites « fil de pensée » pouvait susciter des comportements émergents qui n’avaient pas été identifiés dans l’étude BIGbench. De telles invites, qui demandent au modèle d’expliquer son raisonnement , devraient aider les chercheurs à étudier pourquoi l’émergence se produit Des découvertes récentes analogues à celles-ci suggèrent au moins deux possibilités pour expliquer l’émergence, estime Ellie Pavlick, informaticienne à l’université Brown, qui étudie les modèles computationnels du langage. La première est que,


50 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 INFORMATIQUE MODÈLES MASSIFS DE LANGAGE : D’OÙ VIENNENT LES COUPS DE GÉNIE DE L’IA ?
© Pour la Science ; © Sira Anamwong/Shutterstock,, d’après J. Wei et al., Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models, NeurIPS, 2022.
de pensée de pensée
comme le suggèrent les comparaisons avec les systèmes biologiques , les grands modèles acquièrent vraiment de nouvelles capacités de manière spontanée. « Il se pourrait très bien que le modèle ait appris quelque chose de fondamentalement nouveau et différent, qu’il n’avait pas à plus petite taille, dit-elle C’est ce que nous espérons tous : qu’il y ait un changement fondamental se produisant lorsque les modèles passent à des échelles supérieures. » L’autre possibilité, moins sensationnelle, modère-telle, est que ce qui semble être émergent pourrait plutôt être l’aboutissement d’un processus interne et statistique se produisant avec des raisonnements de type fil de pensée Les grands LLM pourraient simplement mettre en évidence des heuristiques [ou procédures ad hoc, ndlr] qui restent hors de portée des modèles à moins de paramètres, ou ayant eu accès à des données de moindre qualité Mais, précise-telle, pour découvrir laquelle de ces explications est la plus vraisemblable, il faut mieux comprendre le fonctionnement des LLM. « Puisque nous ne savons pas ce qui se passe sous le capot, nous ne pouvons pas dire laquelle de ces hypothèses est la bonne »
POUVOIRS ET PIÈGES IMPRÉVISIBLES
Il y a un problème évident à demander à ces modèles d’expliquer leur propre raisonnement : ce sont des menteurs notoires « Nous nous appuyons de plus en plus sur ces modèles pour e ff ectuer des tâches de base , observe Deep Ganguli, mais je ne me contente pas de les croire Je vérifie leur travail » Parmi de nombreux exemples amusants, Google a présenté en février son chatbot basé sur un LLM, Bard Le post de blog annonçant ce nouvel outil a malencontreusement rendu manifeste le fait que Bard était susceptible d’erreurs factuelles [il a attribué au télescope spatial JWST la première photo d’une planète extrasolaire, alors que celle-ci date de 2004, ndlr].
L’émergence conduit à l’imprévisibilité, et l’imprévisibilité – qui semble augmenter avec l’échelle – rend difficile pour les chercheurs d’anticiper les conséquences d’une utilisation généralisée « Il est difficile de savoir à l’avance comment ces modèles seront utilisés ou déployés, prévient Deep Ganguli Or pour étudier les phénomènes émergents, il faut avoir un cas en tête, et on ne peut savoir quelles capacités ou limitations pourraient survenir avant d’avoir étudié l’influence de l’échelle » Dans une analyse des LLM publiée en juin 2022, les chercheurs d’Anthropic ont examiné si les modèles manifestaient certains types de préjugés raciaux ou sociaux, à l’instar de ceux précédemment signalés dans des algorithmes non basés sur les LLM et utilisés pour prédire quels anciens criminels sont susceptibles de
commettre un nouveau crime Cette étude a été inspirée par un paradoxe apparent directement lié à l’émergence : à mesure que les modèles améliorent leurs performances en passant à l’échelle, ils peuvent également augmenter la probabilité de phénomènes imprévisibles, y compris ceux qui pourraient potentiellement provoquer des biais ou des dommages.
« Des comportements nuisibles apparaissent brusquement dans certains modèles », relève Deep Ganguli Il cite une analyse récente des LLM, connue sous le nom de BBQ benchmark, qui a mis en évidence que les préjugés sociaux émergent lorsque le nombre de paramètres est énorme « Les grands modèles deviennent brusquement plus biaisés. » Ne pas tenir compte de ce risque, assure-t-il, pourrait être délétère pour des catégories de personnes éventuellement concernées par ces modèles Mais il propose un contrepoint : lorsque les chercheurs ont simplement indiqué au modèle de ne pas se fier aux stéréotypes ou aux préjugés sociaux – littéralement en tapant ces instructions –, le modèle a été moins biaisé dans ses prédictions et ses réponses Cela suggère que certaines propriétés émergentes pourraient également être utilisées pour réduire les biais. Dans un article publié en février 2022, l’équipe d’Anthropic a fait état d’un nouveau mode d’« autocorrection morale » dans lequel l’utilisateur invite le programme à être utile, honnête et inoffensif.
Selon Deep Ganguli, l’émergence véhicule à la fois un potentiel surprenant et un risque imprévisible Les applications de ces grands LLM prolifèrent déjà , donc une meilleure compréhension de cette combinaison aidera à exploiter la diversité des capacités des modèles de langage « Nous étudions comment les gens utilisent réellement ces systèmes », rappelle, pour l’heure, Deep Ganguli Et il est clair que ces utilisateurs passent leur temps à bricoler avec les modèles « Nous passons beaucoup de temps avec les interfaces de chat, poursuit-il, et c’est en fait là, dans ces conversations, que l’on commence à pouvoir se faire une idée de la confiance à accorder
ou pas
aux modèles » n
LES MODÈLES PLUS GRANDS APPRENNENT PLUS VITE
Les performances des modèles s’appuyant sur la technique des transformers, à l’origine notamment des capacités de ChatGPT, dépendent étroitement du nombre de paramètres manipulés. Il a été récemment établi que les modèles deviennent performants au bout d’un nombre d’exemples fournis en entraînement d’autant plus faible que le nombre de paramètres (ci-dessus, croissant du jaune au violet) est important.
J. D. Ganguli et al., The capacity for moral self-correction in large language models, arXiv (preprint), 2023.
J. Wei et al., Emergent abilities of large language models, Transactions on Machine Learning Review, 2022.
J. Wei et al., Chain-ofthought prompting elicits reasoning in large language models, NeurIPS, 2022.
D. Ganguli et al., Predictability and surprise in large generative models, FAccT’22 : 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2022.
J. Kaplan et al., Scaling laws for neural language models, arXiv (preprint), 2020.
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 51 ©
J. Kaplan, d’après J. Kaplan et al., Scaling laws for neural language models, arXiv, 2020.
–
–
BIBLIOGRAPHIE 10 8 6 4 0 107 109 1011 Nombre d’exemples Probabilité d’erreur (%°) 1 milliard de paramètres 1 000 paramètres

72 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 HISTOIRE DES SCIENCES
L’ESSENTIEL
> Savant en partie autodidacte, Jean-Henri Fabre a consacré une grande partie de sa vie à l’étude des insectes.
> En 1879, en s’installant dans un mas provençal, il a choisi de les étudier en un lieu considéré aujourd’hui comme une zone critique pour la biodiversité : le pourtour méditerranéen.
> Ses observations a ûtées imprègnent toujours les études actuelles sur les insectes et autres arthropodes.

> Les récits précis et pleins de vie qu’il en a faits ont suscité nombre de vocations d’entomologistes.
L’AUTEUR
ROMAIN GARROUSTE entomologiste et paléoentomologiste à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB) au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris
L’héritage de Jean-Henri Fabre à l’heure du déclin des insectes
Fin observateur, ce savant hors normes, dont on s’apprête à fêter le bicentenaire, a remarquablement documenté une faune aujourd’hui menacée : les insectes du bassin méditerranéen.
Harmas En provençal , ce terme désigne une terre caillouteuse, inculte, abandonnée à la végétation Pourtant, quand en mars 1879, à 56 ans , Jean - Henri Fabre acquiert un tel domaine à Sérignan-du-Comtat, à trente kilomètres d’Avignon, il exauce son vœu le plus cher depuis une quarantaine d’années Le jour même de la signature, avec sa famille, il s’installe dans la belle maison au cœur de cette friche d’un hectare, paradis des chardons et des hyménoptères, où il pourra à loisir observer ses sujets de prédilection, les insectes, dans leur environnement naturel. Son projet : transformer ce lieu en « un laboratoire d’entomologie vivante », comme il l’écrira trois ans plus tard dans ses Nouveaux Souvenirs entomologiques.
Quelques années plus tôt, Fabre a démissionné de l’enseignement public et quitté son poste de conservateur du musée Requien, le muséum d’histoire naturelle d’Avignon Il
souhaite désormais se consacrer à l’entomologie de terrain, à l’opposé de la taxonomie classique où l’on se contente de fixer l’insecte dans une boîte et de lui coller une étiquette : « Je ne connaîtrai réellement la bête que lorsque je saurai sa manière de vivre, ses instincts, ses mœurs », écrit-il dans ses Souvenirs entomologiques
De fait, il n’est pas un fin taxonomiste : il est tellement attiré par l’étude des comportements qu’il en oublie parfois de bien identifier l’animal étudié Il sera ainsi coupable de menues méprises dans ce domaine , par exemple sur la punaise grisâtre Elasmucha grisea ( voir la figure page 78). Mais celles - ci paraissent insignifiantes à côté de la somme des observations menées et des premières scientifiques accomplies dans des domaines allant de la chimie des substances naturelles ( notamment pour améliorer le procédé de fabrication de teinture rouge à partir du rhizome de la garance) à l’écoéthologie et à l’agroécologie appliquée
Rapidement perçu comme un savant hors norme, Jean-Henri Fabre (1823-1915), ici âgé de 87 ans, refusa plusieurs postes académiques, car ils l’auraient éloigné de son Harmas, en Provence, si propice à l’étude des insectes et des choses de la nature en général. Il quitta le domaine le moins possible après son installation, en 1879.
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 73 J.-H. Fabre, Souvenirs entomologiques, édition définitive, 1925 © Domaine public
C’est d’ailleurs dans ce domaine qu’il s’illustrera dès 1880, lorsque l’Académie des sciences le mandatera pour étudier le phylloxéra de la vigne. Ce minuscule hémiptère cousin des pucerons venu d’Amérique – plus exactement du Mississippi, comme l’a retracé récemment son étude génomique, coordonnée par François Delmotte et Denis Tagu, de l’Inrae – décime alors le vignoble français La compréhension que Fabre aura de cet insecte ravageur, et notamment de ses migrations entre la surface du sol et la pleine terre à la recherche de racines fraîches, contribuera à sauver la France viticole dans ces années. Sa notoriété deviendra alors une légende qui n’aura d’égal que son mauvais caractère et une possible misanthropie
Mais, pour l’heure, une seule chose compte, son Harmas et les merveilles qu’il recèle : « Mes chères bêtes d’autrefois , mes vieux amis , d’autres de connaissance plus récente, tous sont là, chassant, butinant, construisant dans une étroite proximité. » Il y vivra trente-six ans, entouré des siens et sculptant patiemment le jardin de plantations adaptées pour attirer les insectes de tous les milieux , des sous - bois ombrés aux claires garrigues en passant par le jardin agricole
Modeste et érudit, en partie autodidacte, déçu de ses contemporains y compris certains savants académiques, Fabre n’avait de considération que pour le travail sans relâche et le cumul d’informations sur la nature qui l’entourait, ainsi que pour la transmission au plus grand nombre dans des ouvrages scolaires, sans la moindre volonté d’enrichissement personnel ou de gloire quelconque Quel est son héritage aujourd’hui, alors que l’on célèbre le bicentenaire de sa naissance et que l’Harmas, acquis en 1922 par le Muséum national d’histoire naturelle, vient de rouvrir ses portes au public après plusieurs mois de travaux de réaménagement ? La question est d’autant plus vive que le déclin des insectes ne fait plus aucun doute et que l’on annonce leur place future dans l’alimentation humaine, entre solution miracle et soleil vert vertueux, voire ressource protéique pour la conquête de l’espace.
TÉMOIN DE LA BIODIVERSITÉ
Fabre est mort en 1915. La déprise agricole qui a suivi la Première Guerre mondiale n’avait pas encore eu lieu Elle changera ensuite les écosystèmes, d’une part en laissant de côté des espaces agricoles traditionnels, d’autre part en commençant une mécanisation sans précédent de l’agriculture , qui entraînera l’utilisation massive de pesticides de synthèse dès la Seconde Guerre mondiale Il n’a connu ni l’une ni l’autre, et sa Provence (mais aussi la Corse et l’Aveyron où il a vécu) était alors le cadre idéal pour observer une nature préservée dans
JEAN-HENRI FABRE EN QUELQUES DATES
1823
Il naît le 21 décembre à Saint-Léons, dans l’Aveyron.
1841
À 19 ans, il devient instituteur à Carpentras.
1849
Il est nommé professeur de physique à Ajaccio, puis à Avignon.
1855
Il soutient deux thèses, l’une de zoologie sur les organes reproducteurs des myriapodes, l’autre de botanique sur les tubercules de l’orchis bouc.
1860
Il dépose un brevet sur une amélioration de la fabrication de la garancine, un colorant végétal.
1862
Il publie son premier ouvrage scolaire, Leçons élémentaires de chimie agricole
un cadre rural et naturel , non impacté par l’agriculture industrielle et l’urbanisation.
Le déclin des insectes n’avait alors probablement pas commencé, mais une guerre sans merci se préparait contre cette multitude mal comprise, malgré plusieurs ouvertures littéraires et avant tout scientifiques de savants comme Fabre . Quelques années plus tard , l’agronome Georges Kuhnholtz-Lordat, auteur en 1938 d’un essai intitulé La Terre incendiée, décrivant les rapports entre la forêt, le champ et la prairie au fil de l’histoire, et le botaniste Roger Heim , un des fondateurs de l’Union internationale pour la conservation de la nature en 1948, tous deux parmi les premiers écologues, n’ont pas reçu beaucoup plus d’écho Et au début du xixe siècle, les avertissements du naturaliste allemand Alexander von Humboldt, précurseur de l’écologie scientifique , et du naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck n’avaient pas davantage suscité l’émoi. En fait, sans le savoir vraiment, Fabre explorait ce qui deviendrait le deuxième « point chaud de biodiversité » le plus étendu à l’échelle mondiale : le pourtour méditerranéen.
Cette dénomination désigne des zones considérées comme critiques pour la biodiversité d’après deux critères : la présence d’au

L’HARMAS AUJOURD’HUI
Sous la responsabilité du Muséum national d’histoire naturelle depuis 1922, l’Harmas de Jean-Henri Fabre, à Sérignan-du-Comtat, en Provence – le « laboratoire d’entomologie vivante » où il a passé tant d’heures à étudier la faune et la flore –, est devenu le gardien de ses œuvres, mais aussi de l’esprit de cet érudit de la fin du XIXe siècle. Fermé depuis plusieurs mois pour réaménagement, ce site unique vient de rouvrir ses portes au public. Dispositifs inédits d’études, aquarelles délicates et précises, photographies originales, films pédagogiques, Fabre savait tout faire et a tout essayé en précurseur curieux et infatigable. Mêlant entomologie, histoire des sciences et histoire de France, un parcours à travers la demeure familiale et le cabinet de travail qu’il avait fait construire à côté invite le visiteur à une immersion dans sa vie et son œuvre. Le cabinet abrite quelque 1 300 objets et spécimens qu’il a récoltés au fil de ses recherches – des insectes, mais aussi des fossiles, des coquillages, des nids d’oiseaux et même des ossements humains et autres vestiges archéologiques. Le jardin, aménagé en une friche savante et paisible, héberge de nombreuses espèces végétales
sélectionnées par Fabre lui-même ou d’après ses écrits, dont des plantes de garrigue très appréciées des insectes, comme le thym, la lavande et le romarin, ainsi que quatre systèmes d’observation imaginés par le savant. Prêts pour la chasse au sphex, le pistage des chalicodomes ou la recherche de l’antre du cerceris ?
Informations pratiques : www.harmasjeanhenrifabre.fr
74 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 HISTOIRE DES SCIENCES L’HÉRITAGE DE JEAN-HENRI FABRE À L’HEURE DU DÉCLIN DES INSECTES
moins 1 500 espèces endémiques de plantes vasculaires (0,5 % des 300 000 espèces actuelles connues) et la disparition d’au moins 70 % de leur végétation primaire. Depuis la définition de ces zones, en 2000, par l’écologue britannique Norman Myers, trente-six régions du monde entrent dans cette catégorie Avec ses 12 500 espèces endémiques de plantes vasculaires, le bassin méditerranéen est parmi les plus riches et les insectes, par leur diversité – quelque 150 000 espèces – et leur taux élevé d’endémisme, lié à celui des plantes, y sont bien représentés
Et pour cause. Dans les régions méditerranéennes de la France, comme dans celles des autres pays du pourtour de cette mer unique, fermée, mais ouverte sur le monde, une vaste diversité végétale et animale s’est développée au rythme du recul des glaciations vers le nord et de l’aridification dans le Sud Associés à l’impact des premières civilisations humaines, qui ont ouvert le milieu en permanence et sont ainsi devenues, d’une certaine façon, des artisans de biodiversité locale, et à des facteurs favorisant l’endémisme , comme la mise en place de chaînes de montagnes, ces changements climatiques aussi profonds que récents ont permis à une très grande diversité
1879
Il publie les premiers Souvenirs entomologiques, dont les dix séries paraîtront jusqu’en 1907. La même année, il acquiert l’Harmas, à Sérignan-duComtat, dans le Vaucluse.

1880
L’Académie des sciences lui commande une étude sur le phylloxéra de la vigne, un insecte qui décime le vignoble français.
1887
Il devient correspondant de l’Académie des sciences.
1910-1915
Il reçoit plusieurs honneurs internationaux et son nom est proposé pour le prix Nobel de littérature.
1913
Raymond Poincaré, président de la IIIe République, lui rend visite à Sérignan.
1915
Il meurt le 11 octobre à Sérignan, après la victoire de la Marne, où combattait l’un de ses fils.
La première biographie de Jean-Henri Fabre parut en 1913, du vivant de l’entomologiste, qui en écrivit la préface (ici une réédition publiée en 1924). Son auteur, Georges-Victor Legros, était un disciple et ami qui s’était donné pour mission de le faire connaître au monde entier.

Un aperçu des jardins de l’Harmas, ici photographiés à la fin avril (à gauche), de la maison familiale avec au fond la petite serre froide que Jean-Henri Fabre fit construire en 1880 pour abriter les plantes sensibles au gel (ci-dessus) et du cabinet de travail de l’entomologiste (à droite)


POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 75
©
Domaine public (en haut) ; © MNHNAgnès Iatzoura (jardin et maison) ; © Romain Garrouste (cabinet)
entomologique de se maintenir, avec des influences africaines et asiatiques.
En Provence, Fabre ne pouvait donc pas être mieux placé pour s’émerveiller et comprendre le monde foisonnant des insectes Certes , l’aperçu aurait été encore plus complet sous les tropiques, mais les paysages méditerranéens, qu’il explora jusqu’en Corse, étaient déjà assez riches Et les pentes du mont Ventoux, haut sommet de Provence où s’étale l’étagement des écosystèmes, lui ont permis de comprendre les peuplements d’insectes sur ses flancs, associés aux plantes et aux champignons, comme avant lui Alexander von Humboldt et son acolyte le botaniste français Aimé Bonpland, qui, à l’aube du xixe siècle, lors de leur ascension du volcan Chimborazo, en Équateur, avaient méticuleusement analysé la flore et la faune en fonction du sol et de l’altitude

UN « OBSERVATEUR INIMITABLE »
Dans L’Origine des espèces, paru en 1859, Charles Darwin décrit Fabre comme un « observateur inimitable » Le naturaliste britannique avait remarqué ses travaux , et ils avaient correspondu et échangé quelques idées expérimentales , par exemple sur l’orientation des animaux et , notamment , l’influence des champs magnétiques sur celleci Fabre n’était pas un fervent partisan de la théorie de l’évolution , trop transformiste à ses yeux Il défendait plutôt un certain fixisme. La variation entre individus au sein des populations ne l’avait pas intrigué ni convaincu comme moteur de l’évolution, lui pourtant si observateur Il ne cherchait pas, semble - t- il , d’explication , ni à élucider les mécanismes profonds, mais voulait décrire et comprendre ce qu’il observait Il avait aussi une grande défiance pour les théories, préférant mener sa propre enquête : « Je me suis imposé, comme je l’ai toujours fait dans mes diverses recherches entomologiques , la loi formelle d’agir comme si j’ignorais tout. On a ainsi, à mon humble avis, la liberté d’esprit et la franchise d’allures que réclament les minutieux problèmes des mœurs d’un insecte », disait-il le 15 novembre 1880 devant l’Académie des sciences, lors de la présentation de ses résultats sur le phylloxéra de la vigne Y avait- il une pointe d’ironie dans l’adjectif « inimitable » utilisé par Darwin ?
Peut-être aussi une réelle admiration
Toujours est-il que l’estime était réciproque entre les deux hommes, comme en témoignent leur correspondance et leurs écrits , et que Darwin a loué à plusieurs reprises les descriptions précises et vivantes de l’entomologiste, au point de suggérer de les utiliser si jamais il devait écrire sur l’évolution des instincts. Fabre avait en effet une façon bien personnelle de raconter ses observations, qui a marqué ses
contemporains En 1912, son premier biographe, Georges-Victor Legros, le présentait comme quelqu’un qui n’aimait pas écrire et écrivait donc peu. Mais son héritage littéraire – en particulier ses dix séries de Souvenirs entomologiques, chroniques naturalistes sans équivalent, et ses nombreux ouvrages scolaires – est unique et foisonnant, car tout le petit monde arthropodien est passé devant lui et a fait l’objet d’observations, de chroniques et de comparaisons littéraires Doté d’une grande culture dans nombre de domaines , y compris des sciences comme la physique et la chimie, utilisant la première personne et un style à première vue détaché, mais précis, l’entomologiste français fait mouche dans beaucoup de ses textes en faisant apprécier la complexité et la beauté cachée des comportements de ces petites bêtes bien plus intelligentes qu’on ne le croyait alors
Avant lui, des auteurs prolifiques avaient déjà ouvert une fenêtre sur leur monde , comme le physicien et entomologiste RenéAntoine Ferchault de Réaumur au xviiie siècle, auteur entre autres de Mémoires pour servir à l’histoire des insectes en six volumes, et le médecin et naturaliste landais Léon Dufour, qui écrivit plus de deux cents articles sur les insectes dans la première moitié du xixe siècle. Mais ces dignes prédécesseurs n’avaient pas la plume alerte et imagée pour mettre à la portée de tous, de l’entomologiste le plus savant au simple curieux de nature, le peuple fascinant à nos pieds, dans nos jardins Plusieurs contemporains ne s’y sont pas trompés et ont proposé son nom à diverses reprises, dans les années 1910, pour le prix Nobel de littérature. Mais c’est finalement le Belge Maurice Maeterlinck qui a reçu cette récompense
76 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 HISTOIRE DES SCIENCES L’HÉRITAGE DE JEAN-HENRI FABRE À L’HEURE DU DÉCLIN DES INSECTES © Romain Garrouste
LA CIGALO E LA FOURNIGO
[…]
Il m’indigne, le fabuliste, quand il dit que l’hiver tu vas en quête de mouches, vermisseaux, grains, toi qui ne manges jamais. Du blé ! Qu’en ferais-tu, ma foi ! Tu as ta fontaine mielleuse, et tu ne demandes rien de plus. Que t’importe l’hiver ! Ta famille à l’abri sous terre sommeille, et tu dors le somme qui n’a pas de réveil. Ton cadavre tombe en loques. Un jour, en furetant, la fourmi le voit. De ta maigre peau desséchée la méchante fait curée ; elle te vide la poitrine, elle te découpe en morceaux, elle t’emmagasine pour salaison, provision de choix, l’hiver, en temps de neige. […]
en 1911. Son essai La Vie des abeilles , paru en 1901, a montré la voie d’une littérature axée sur l’observation de la vie des insectes (ici sociaux), suivi des récits de l’écrivain allemand Ernst Jünger relatant en 1967 ses Chasses subtiles désabusées de coléoptères dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ou dans les expéditions africaines de la légion étrangère

UNE SCIENCE IMPRÉGNÉE
Coléoptères (scarabées, charançons, coccinelles…), hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis… ), hémiptères ( cigales , pucerons , punaises… ), tous les ordres d’insectes ou presque sont passés sous la loupe de l’entomologiste, mais aussi les myriapodes, leurs cousins communément appelés « mille-pattes », qui l’intriguaient et qu’il avait eu l’occasion d’observer dès sa thèse de doctorat, soutenue en 1855 à la Sorbonne , à Paris. Quand on connaît le monde des insectes méditerranéens et quand on a soi-même observé les insectes dans des jardins du Midi, on comprend le choix des sujets d’étude, on les connaît pour les avoir observés et… pour avoir lu les Souvenirs entomologiques. Culture et sciences s’associent et pour peu que l’on soit observateur, on rencontre un jour ou l’autre tous les acteurs de la grande pièce de théâtre ordonnancée dans ces chroniques. Premières journées de printemps, soirées d’été, début des fraîcheurs automnales, toutes ces périodes portent leurs cohortes d’insectes selon les milieux, des garrigues rencontrées sur les adrets, les versants les plus ensoleillés des vallées, aux sous-bois frais des ubacs, les versants opposés.
Aujourd’hui, les sciences du comportement se sont informatisées et quantifiées avec l’usage
LE VRAI VISAGE DE LA CIGALE ET DE LA FOURMI
En réalisant un inventaire dans le dédale de l’Harmas en juin 2022, je suis tombé sur une scène qui aurait ravi Jean-Henri Fabre : une fourmi du genre Crematogaster et une grande cigale (Lyristes plebejus) face à face sur un grand arbre, semblant converser. L’entomologiste s’était penché sur la fable de La Fontaine et ses observations lui avaient permis de critiquer son interprétation et sa teneur même, sans fondements naturalistes si ce n’est le caractère sexuel du chant de la cigale et d’autres traits de vie. Fabre, qui était aussi poète, proposa même sa propre version de la célèbre fable corrigée de ses défauts scientifiques, en provençal avec traduction en français. La fourmi n’y a pas davantage le beau rôle, mais pour une autre raison (voir l’extrait
ci-contre). Car sur notre image, il s’agit bien de la rencontre entre une fourmi qui protège le végétal qu’elle exploite, par exemple en y recherchant des proies ou des pucerons à élever, et un grand insecte susceptible de lui servir de nourriture… La prédatrice n’est pas celle que l’on croit. L’art et les techniques de photographie animalière, et en particulier de la macrophotographie, ont beaucoup évolué depuis l’époque de Fabre. Néanmoins, l’entomologiste a été pionnier dans ces approches, comme le montrent les photos de l’édition définitive des Souvenirs entomologiques, telle celle du balanin. Il avait compris l’intérêt pédagogique de la photographie et du cinéma. On imagine ce que Fabre aurait pu faire avec ces outils modernes !
LE BALANIN EMPALÉ
Les balanins sont des coléoptères de la famille des Curculionidae, des charançons spécialisés dans plusieurs fruits à coques (châtaignes, noisettes, chênes), que leur impressionnant rostre permet de forer. Celui-ci, démesuré, permet à la femelle d’y insérer un œuf. Jean-Henri Fabre a passé beaucoup de temps pour comprendre ce mécanisme. Il a même photographié un échec qui a conduit à la mort de l’insecte, resté planté dans le gland d’un chêne et ne pouvant s’en dégager (ci-dessus). La description du rostre conduit le chercheur à une réflexion très éclairante sur sa démarche : « Que fait-il de ce pal démesuré, de ce nez ridicule ? Ici, j’en vois qui haussent les épaules. Si l’unique but de la vie est, en effet, de gagner de l’argent par des moyens quelconques, avouables ou non, de pareilles questions sont insensées. Heureusement d’autres se trouvent aux yeux de qui rien n’est petit dans le majestueux problème des choses. Ils savent de quelle humble pâte se pétrit le pain de l’idée, non moins nécessaire que celui de la moisson ; ils savent que laboureurs et questionneurs nourrissent le monde avec des miettes accumulées. »
POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 / 77 J.-H. Fabre, Souvenirs entomologiques, édition définitive, 1925 © archives.org/Smithsonian Libraries (Domaine public)
J.-H. Fabre
LA PUNAISE MATERNELLE
Les punaises de la famille des Pentatomidae, comme la punaise verte (ci-contre photographiée dans le jardin de l’Harmas au printemps 2022), pondent des œufs très caractéristiques qu’elles laissent à leur sort et qui sont souvent la proie de parasites et de prédateurs. Seule une espèce en France adopte un comportement maternel, la punaise grisâtre, Elasmucha grisea : la femelle garde sa ponte jusqu’à l’éclosion des jeunes punaises et la protège activement des prédateurs. Jean-Henri Fabre a étudié cette espèce, mais n’a jamais observé ce comportement, se moquant des observateurs précédents qui avaient décrit ce phénomène. En fait, une erreur de détermination ne lui avait pas permis d’observer la bonne espèce et de voir ce comportement assez peu répandu chez les hémiptères.

des méthodes d’imagerie automatique, qui permettent d’analyser les trajectoires des insectes, et l’étude fine de l’écophysiologie des organes des sens Dans ce domaine en effet, l’électrophysiologie – l’enregistrement de l’activité électrique du système nerveux des insectes – a révélé le fonctionnement précis de ces organes, et l’étude de l’activité des gènes offre une étonnante compréhension physiologique et évolutive de leurs fonctions, à la protéine exprimée près. L’éthologie, quant à elle, est devenue l’écoéthologie en prenant en compte beaucoup mieux les variables environnementales par un suivi précis, mais aussi par le renouvellement des questions scientifiques : l’étude des modèles classiques (drosophile, ravageurs des cultures devenues industrielles) s’est développée, mais les modèles se sont aussi diversifiés avec des questions liées aux perturbations anthropiques et à la conservation des peuplements et des espèces Pour autant, les questions fondamentales n’ont pas été oubliées et la démarche comparée , digne héritière des observations de Fabre, s’est aussi déployée.
Ces dernières années , on est même allé encore plus loin en attribuant, y compris au sein de colonies d’insectes sociaux, des comportements individuels . Certains grillons champêtres , par exemple , se sont révélés moins explorateurs que d’autres ou avaient une tendance plus faible à quitter leur refuge Plus généralement, en explorant les sens des insectes, on commence à mieux comprendre leur propre Umwelt – leur univers sensoriel, qui inclut éventuellement la perception de leur propre existence –, ou encore leur phénotype étendu , c’est- à - dire l’ensemble de leurs caractères observables, qu’ils dépendent de leur patrimoine génétique ou de leur environnement, et on se rapproche petit à petit d’une réalité qui nous avait échappé par excès d’anthropocentrisme. Et si les insectes et tous les petits organismes qui nous entourent avaient stricto sensu une conscience ? Avec ses
observations a ff ûtées et sa poésie littéraire pour les décrire, Fabre n’était pas loin de nous y conduire, voire de le déceler Pour l’historienne des sciences Valérie Chansigaud, qui dans son ouvrage Les Français et la nature , pourquoi si peu d’amour ? , paru en 2017 constate que « les Français s’intéressent moins à la nature que leurs voisins germanophones ou anglophones », Fabre est l’exception. Il peut même « être légitimement considéré comme le plus brillant biographe de la nature qu’a compté la France depuis l’époque des Lumières » Il fait aimer la nature pour plusieurs raisons, la qualité et la minutie de ses observations, qu’il saisit quand l’occasion se présente , « esclave de la saison , du jour et de l’heure, de l’instant même », et le bonheur quand celles-ci se produisent, qu’il fait partager de manière communicative Encore aujourd’hui , nombre d’entomologistes ou d’arachnologues doivent leur vocation à cet enthousiasme et ont encore plaisir à parcourir les lignes des Souvenirs entomologiques J’en fais partie n
BIBLIOGRAPHIE
H. Gourdin, Jean-Henri Fabre, l’inimitable observateur, Le Pommier, 2023.
A.-M. Slézec, Jean-Henri Fabre en son harmas de 1879 à 1915, Édisud, 2011.
P. Tort, Fabre, le miroir aux insectes, Vuibert/Adapt, 2002.
P.-P. Grassé, L’œuvre de J.-H. Fabre et l’éthologie contemporaine, La Gazette apicole, novembre 1973.
J. Rostand, Cet homme fut mon idole !, La Gazette apicole, novembre 1973.
G.-V. Legros, La Vie de Jean-Henri Fabre, naturaliste, Delagrave, 1912.
78 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 HISTOIRE DES SCIENCES L’HÉRITAGE DE JEAN-HENRI FABRE À L’HEURE DU DÉCLIN DES INSECTES © Romain Garrouste
Une sélection d’articles rédigés par des chercheurs et des experts
























Une lecture adaptée aux écrans
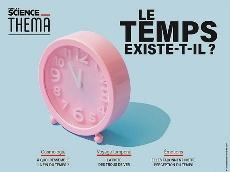

3€ 99

À découvrir dans la collection
Scanner ce QR Code avec votre téléphone pour commander votre numéro, ou rendez-vous sur boutique.groupepourlascience.fr



3 Thema Dans le des abeilles SOMMAIRE P/4/L’INTELLIGENCE DES ABEILLES AURORE AVARGUÈS-WEBER P/18/LES ABEILLES ONT LA NOTION DU ZÉRO SÉBASTIEN BOHLER P/30/L’ÂME DE GÉOMÈTRE DES ABEILLES ALAIN SATABIN P/45/UN DESTIN DE REINE GRÂCE À LA ROYALACTINE LOÏC MANGIN P/22/LA RECONNAISSANCE VISUELLE DES INSECTES ELIZABETH TIBBETTS ET DYER P/41/LES ABEILLES ONT-ELLES UNE PERSONNALITÉ ? DALILA BOVET P/48/L’EFFET DES PESTICIDES MESURÉ GRANDEUR NATURE MARIE-NEIGE CORDONNIER P/53/LA POLLUTION AU PLOMB AFFECTE AUSSI LES ABEILLES ISABELLE BELLIN P/58/LES INSECTES SONT EN CHUTE LIBRE JOSEF SETTELE P/69/MENACES SUR LA POLLINISATION JEAN-FRANÇOIS SILVAIN P/76/LA CIRE D’ABEILLE EST UTILISÉE DEPUIS 10 000 ANS FRANÇOIS SAVATIER P/81/L’ABEILLE, MIROIR DE NOS ANGOISSES CHRISTOPHE ANDRÉ P/41 P/76 P/58 P/22 P/14/L’ABEILLE SAIT FAIRE DES ADDITIONS ET DES SOUSTRACTIONS SEAN BAILLY
HERVÉ THIS
physicochimiste, directeur du Centre international de gastronomie moléculaire AgroParisTech-Inrae, à Palaiseau

LA FIN DES CRISTAUX DANS LES VINS BLANCS ?
Souvent pris pour des « impuretés », les cristaux de tartrate qui précipitent dans les vins blancs ne sont pas une fatalité.

Alors que s’achèvent les célébrations du bicentenaire de Louis Pasteur, dont un premier travail fut l’étude du « tartre du vin », des chimistes australiens et polonais publient une nouvelle méthode pour éviter la précipitation des cristaux de bitartrate de potassium dans les bouteilles de vin
Les raisins contiennent du potassium et de l’acide tartrique en abondance, mais ces ions ne précipitent pas dans la solution aqueuse qu’est le jus de raisin. En revanche, la fermentation, qui engendre de l’éthanol, réduit la limite de solubilité du tartrate de potassium : ce dernier peut rester en sursaturation dans les vins, mais il précipite quand le vin est refroidi et que la sursaturation augmente excessivement.
Les précipités – nommés « diamants du vin » au Canada – sont peu appréciés des gourmets. Ils sont plus souvent présents dans les blancs (où ils sont visibles) que dans les vins rouges, d’une part parce que les vins blancs sont rapidement embouteillés, avant leur précipitation, et d’autre part parce que les vins blancs sont souvent bus plus frais que les rouges. Comment faire précipiter le tartre avant l’embouteillage ?
Certains vignerons recourent à des précipitations par refroidissement, mais la technique est lente, et coûteuse. Aussi les chimistes ont-ils exploré des techniques telles que l’échange d’ions, l’électrodialyse, des ajouts d’additifs (par exemple, la carboxyméthylcellulose). Tout récemment, une nouvelle méthode a été testée : faire précipiter le tartre en plongeant dans le vin des plaques ou des grilles dont la surface a été « fonctionnalisée » à l’aide d’un plasma.
Le traitement par plasma est rapide (quelques minutes), se fait sur des surfaces
C’est la fermentation qui, en engendrant de l’éthanol, réduit la solubilité du tartrate de potassium issu de l’acide tartrique et du potassium présents dans le raisin.
de forme quelconque, qu’il n’est pas nécessaire de préparer, et aucun solvant n’est nécessaire : il s’agit seulement de créer un plasma, par exemple à l’aide d’une différence de potentiel électrique, dans une chambre où l’on a fait le vide, puis introduit un composé que l’on veut déposer.
Dès 2017, Panthihage Ruvini Dabare et ses collègues des universités de Bedford Park (Australie) et de Łódź (Pologne) avaient fonctionnalisé des nanoparticules magnétiques pour clarifier des vins (on les récupérait à l’aide d’aimants). Tout récemment, la même équipe a testé l’intérêt des surfaces traitées par plasma avec des vins de plusieurs cépages (muscat, sauvignon blanc, chardonnay, pinot). Les substrats étaient des galettes de silicium ou des grilles d’acier inoxydable (3 par 7 centimètres), qu’il suffit de retirer du vin après précipitation.
Lors des tests, des vins en présence de surfaces fonctionnalisées et les mêmes vins sans ces surfaces ont été stockés pendant des périodes comprises entre une et quatre semaines, à différentes températures. Après une semaine de stockage, des précipités apparaissaient dans les vins sans surfaces traitées, réduisant la concentration en tartrate à 24 et 98,5 milligrammes par litre respectivement à 0 °C et à 4 °C, alors qu’il restait 382 milligrammes de bitartrate de potassium en chai (15 °C). Avec les vins
en présence de surfaces traitées, la concentration tombait à 15 milligrammes par litre, après seulement une semaine, pour des vins pourtant stockés à 15 °C !
Les cristaux formés dépendent des fonctionnalisations : quand elles portaient des groupes amines, par exemple, les surfaces engendraient plus de cristaux de tartre ; les cristaux étaient moins nombreux mais plus gros sur les surfaces fonctionnalisées à l’oxazoline.
L’utilisation de grilles d’acier inoxydable augmente la surface de contact, et, donc, l’efficacité du traitement. Mais ce dernier agirait-il négativement sur d’autres composés ? Pas sur les composés phénoliques, en tout cas, mais les tests sensoriels restent à faire. n
INFLUENCE TARTRIQUE
➊ Dans une casserole, réduire 50 centilitres de vin rouge jusqu’à consistance sirupeuse.
➋ Ajouter deux feuilles de gélatine, du sel, du poivre moulu finement, et une cuillerée d’acide tartrique.
➌ Émulsionner 100 grammes de beurre.
➍ Se procurer des pectines (poudre pour faire prendre les confitures) et les ajouter au vin.
➎ Servir cette sauce à la saveur élégamment relevée par l’acide tartrique avec une entrecôte grillée.
96 / POUR LA SCIENCE N° 549 / JUILLET 2023 SCIENCE & GASTRONOMIE
L’AUTEUR
© Mariyana M/Shutterstock
ABONNEZ-VOUS À
Le magazine papier 12 numéros par an
Le magazine en version numérique 12 numéros par an
Le hors-série papier 4 numéros par an
Le hors-série en version numérique 4 numéros par an
Accès à pourlascience.fr actus, dossiers, archives depuis 1996
VOTRE
TARIF D’ABONNEMENT
Commandez plus simplement ! Pour découvrir toutes nos o res d’abonnement et e ectuer un paiement en ligne, scannez le QR code ci-contre
3 FORMULES AU CHOIX
4,90 € PAR MOIS
6,50 € PAR MOIS
30 % de réduction * 36 % de réduction *
BULLETIN D’ABONNEMENT
OUI,
8,20 € PAR MOIS
46 % de réduction *
À renvoyer accompagné de votre règlement à : Abonn’escient – TBS Group – Service abonnement Groupe Pour la Science 20 rue Rouget de Lisle - 92130 Issy les Moulineaux Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr


je m’abonne à Pour la Science en prélèvement
automatique
Je choisis ma formule (merci de cocher)
FORMULE
PAPIER
• 12 n° du magazine papier
FORMULE
PAPIER + HORS SÉRIE
• 12 n° du magazine papier
• 4 n° des hors-séries papier
1 2 3
Nom :
FORMULE
INTÉGRALE
• 12 n° du magazine (papier et numérique)
• 4 n° des hors-séries (papier et numérique)
• Accès illimité aux contenus en ligne
Mes coordonnées Mandat de prélèvement SEPA
Prénom :
Adresse :
Code postal Ville :
Tél. :
Courriel : (indispensable pour la formule intégrale)
J'accepte de recevoir les o res de Pour la Science ☐ OUI ☐ NON
* Réduction par rapport au prix de vente en kiosque et l’accès aux archives numériques. Délai de livraison : dans le mois suivant l’enregistrement de votre règlement. O re valable jusqu’au 31/03/2024 en France métropolitaine uniquement. Pour un abonnement à l’étranger, merci de consulter notre site boutique.groupepourlascience.fr. Photos non contractuelles. Vous pouvez acheter séparément les numéros de Pour la Science pour 7 € et les hors-séries pour 9,90 €. En souscrivant à cette o re, vous acceptez nos conditions générales de vente disponibles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/CGV-PLS.
Les informations que nous collectons dans ce bulletin d’abonnement nous aident à personnaliser et à améliorer les services que nous vous proposons. Nous les utiliserons pour gérer votre accès à l’intégralité de nos services, traiter vos commandes et paiements, et vous faire part notamment par newsletters de nos o res commerciales moyennant le respect de vos choix en la matière. Le responsable du traitement est la société Pour la Science. Vos données personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Pour la Science ne commercialise ni ne loue vos données à caractère personnel à des tiers. Les données collectées sont exclusivement destinées à Pour la Science Nous vous invitons à prendre connaissance de notre charte de protection des données personnelles à l’adresse suivante : https://rebrand.ly/charte-donnees-pls. Conformément à la réglementation applicable (et notamment au Règlement 2016/679/UE dit « RGPD ») vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’e acement, à la portabilité et à la limitation de vos données personnelles. Pour exercer ces droits (ou nous poser toute question concernant le traitement de vos données personnelles), vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse protection-donnees@pourlascience.fr.
En signant ce mandat SEPA, j’autorise Pour la Science à transmettre des instructions à ma banque pour le prélèvement de mon abonnement dès réception de mon bulletin. Je bénéficie d’un droit de rétractation dans la limite de 8 semaines suivant le premier prélèvement. Plus d’informations auprès de mon établissement bancaire.
TYPE DE PAIEMENT : RÉCURRENT



Titulaire du compte
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Désignation du compte à débiter
BIC (Identification internationale de la banque) :
IBAN : (Numéro d’identification international du compte bancaire)

Établissement teneur du compte
Nom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Date
PAPIER FORMULE
SÉRIE
OFFRE D’ABONNEMENT FORMULE
PAPIER + HORS -
FORMULE INTÉGRALE
DURÉE LIBRE Groupe Pour la Science - Siège social : 170 bis, boulevard du Montparnasse, CS20012, 75680 Paris Cedex 14 – Sarl au capital de 32 000 € – RCS Paris B 311 797 393 – Siret : 311 797 393 000 23 – APE 58.14 Z
et
Organisme Créancier : Pour la Science 170 bis, bd. du Montparnasse – 75014 Paris N° ICS FR92ZZZ426900 N° de référence unique de mandat (RUM)
signature
4 MERCI DE JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN RIB
PAR MOIS – 46
6,50 € PAR MOIS – 36 % 4,90 € PAR MOIS – 30 % 1-F-INT-N-3PVT-8,2
1-F-HSPAP-N-3PVT-6,5
1-F-PAP-N-PVT-4,9
8,20 €
%
€
€
€
PAG23STD
PICORER À
p.
p.
p.52
JUICE
La mission Juice a décollé le 14 avril 2023 à destination de Jupiter. Elle mettra huit ans à atteindre sa cible en suivant une trajectoire complexe pour profiter de l’assistance gravitationnelle de la Terre, de Vénus et de Mars et ainsi économiser du carburant. À son arrivée en juillet 2031, la sonde concentrera ses dix instruments scientifiques sur trois lunes joviennes, en particulier Ganymède, le plus gros satellite naturel du Système solaire.
FIL DE PENSÉE PENDULE DE NEWTON
3,2 × 10–11
C’est l’énergie (en joules) que libère la fission d’un atome d’uranium, soit dix millions de fois plus que celle issue de la combustion d’une molécule de méthane. Typiquement, un réacteur fissionne de l’ordre de 1 tonne de combustible par an… soit 200 tonnes de minerai extrait.
Cet objet est constitué de billes côte à côte suspendues par des fils. On écarte la première de la file des autres billes puis on la lâche. Sous l’effet de la gravité, la bille accélère et percute la deuxième bille. Sans dissipation d’énergie, seule la dernière bille repart, à la vitesse d’arrivée de la première. En pratique, il y a toujours un peu de perte d’énergie, mais un pendule de bonne qualité fonctionne près d’une minute.
ZÉOLITHES
Ces « pierres qui bouillent » décrites en 1756 par le chimiste suédois Axel Fredrik Cronstedt sont capables d’absorber et de stocker de grandes quantités d’eau grâce à leurs pores de quelques angströms. On les utilise aussi bien pour piéger des polluants, stocker et stabiliser des gaz que pour purifier des mélanges ou catalyser des réactions.
LÉPIDOPTÈRES
Avec ses 160 000 espèces, ce groupe qui rassemble papillons de jour et de nuit est le deuxième plus diversifié des 30 ordres d’insectes, après celui des coléoptères. Ces deux ordres et les hyménoptères (abeilles, frelons, fourmis…), diptères (mouches, taons, moustiques…) et hémiptères (punaises, pucerons, cigales…) contiennent 80 % des espèces d’insectes.
£
£ Exiger des chercheurs davantage d’efficience n’aurait pour effet que de détruire un système d’évaluation qui s’est lentement mis en place au cours des trois derniers siècles
YVES GINGRAS professeur d’histoire et de sociologie des sciences
46
38
66
92
88
En 2022, des chercheurs ont montré qu’un système de conversation type ChatGPT invité à expliquer son raisonnement – une capacité appelée « raisonnement en fil de pensée » –devenait capable de résoudre un problème qui lui résistait. 22
p.
p.
p.
p.
Retrouvez tous nos articles sur www.pourlascience.fr
Diplômes d’Université de l’Observatoire de Paris
EXPLORER ET COMPRENDRE L’UNIVERS
Licence 1
LUMIERES SUR L’UNIVERS
Niveau Suivi
Licence 1 à Master 1


Formation en présentiel ou à distance Cours magistraux filmés et retransmis en direct ou en différé
Objectifs
Formation en ligne
Tutorat personnel et individualisé Cours thématiques avec de nombreux exercices
Acquérir un panorama des connaissances actuelles en astronomie et astrophysique auprès d’astronomes professionnel·le·s



Acquérir des bases solides en astrophysique à travers les parcours thématiques proposés

Se spécialiser grâce aux exercices suivis et corrigés à distance par un·e astronome professionnel·le
Contenu




Cours et TD (Mécanique Céleste, Ondes et Instruments, Soleil, Cosmologie, Galaxies etc.)










Stage pratique d’une semaine à l’Observatoire de Meudon (optionnel et sous conditions)
Stage d’observation à l’Observatoire de Haute Provence (optionnel et sous conditions)
Des parcours thématiques adaptés à tous :

• Des étoiles aux planètes (L1-L2)

• Cosmologie et Galaxies (L2)









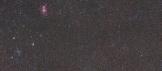

• Mécanique céleste (L3)
• Sciences planétaires (L3)

• Fondamentaux pour l’astrophysique (L3)

• Fenêtres sur L’Univers (M1)
• Instrumentation (M1)
Plusieurs centaines d’exercices corrigés individuellement
Pages Web
http://ufe.obspm.fr/DU/DU-en-presentiel/ DU-Explorer-et-Comprendre-l-Univers/ contact.duecu@obspm.fr




Contact
http://ufe.obspm.fr/Formations-en-ligne/ LUMIERES-SUR-L-UNIVERS/ contact.dulu@obspm.fr
Date limite d’inscription 3 septembre 2023
https://espacecandidature.psl.eu
La simulation multiphysique favorise l’innovation

Pour innover, les ingénieurs ont besoin de prédire avec précision le comportement réel de leurs designs, dispositifs et procédés. Comment ? En prenant en compte simultanément les multiples phénomènes physiques en jeu.
» comsol.fr/feature/multiphysics-innovation





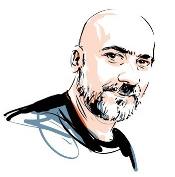




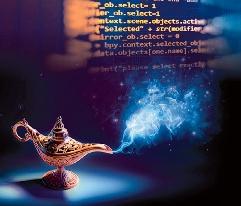









 © Scott Wilson
© Scott Wilson