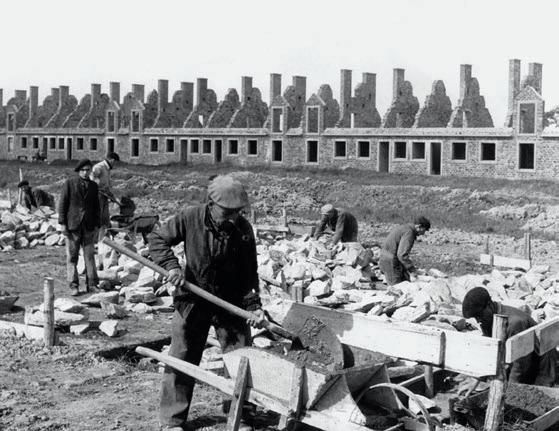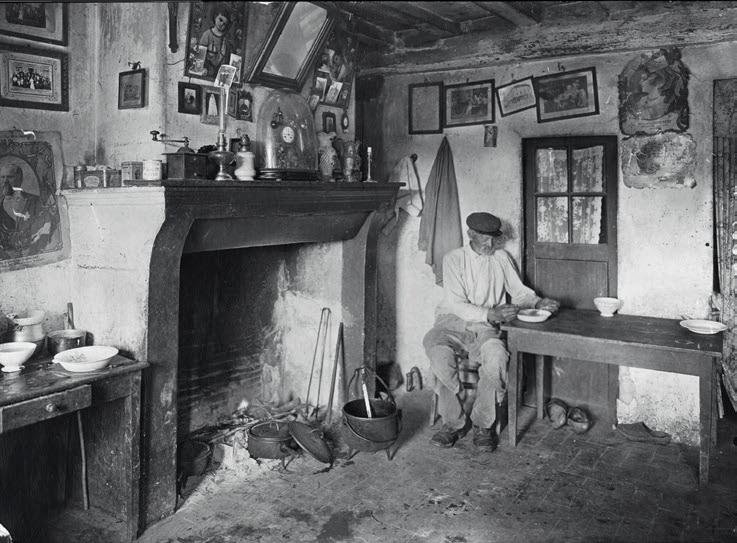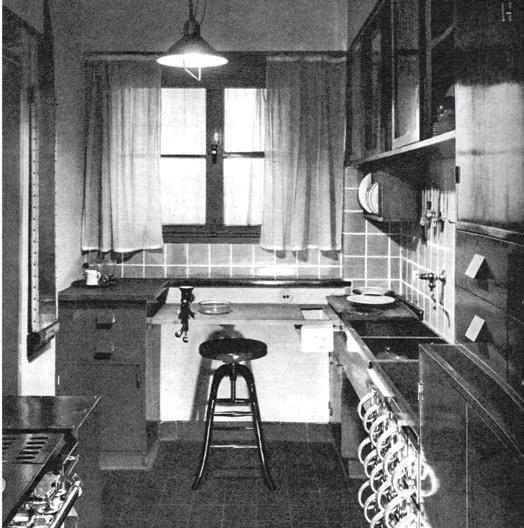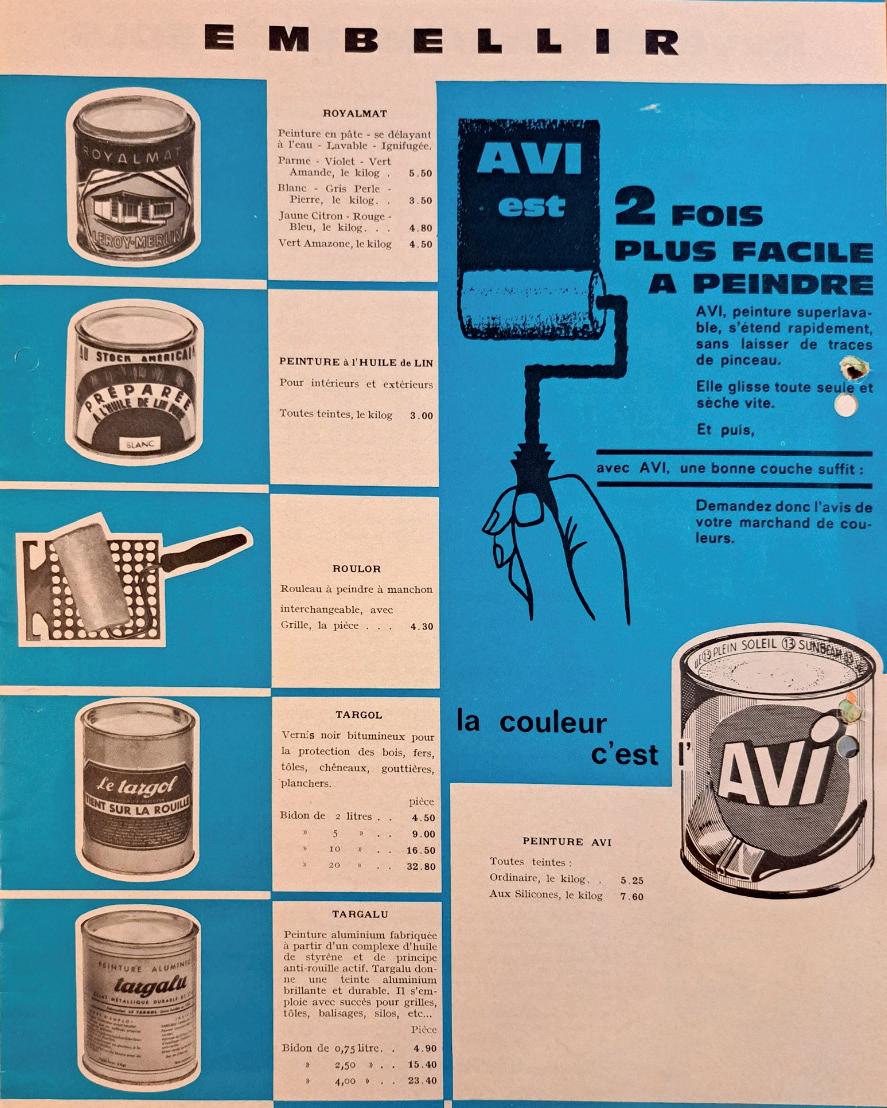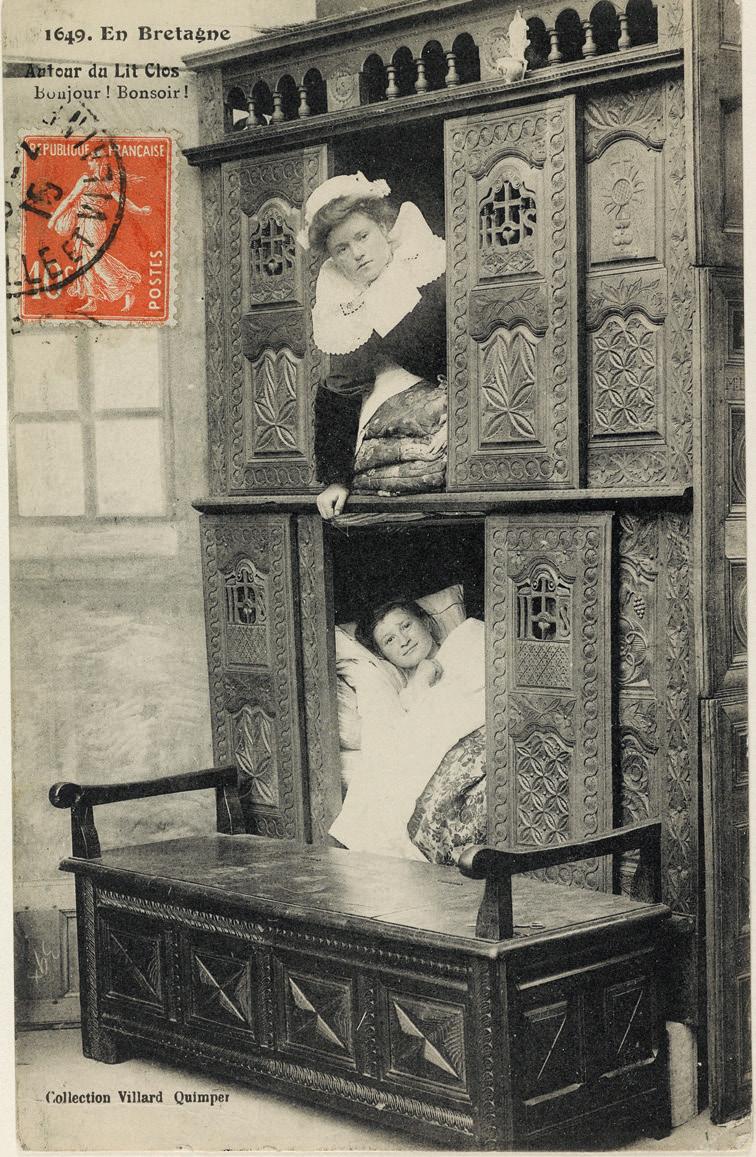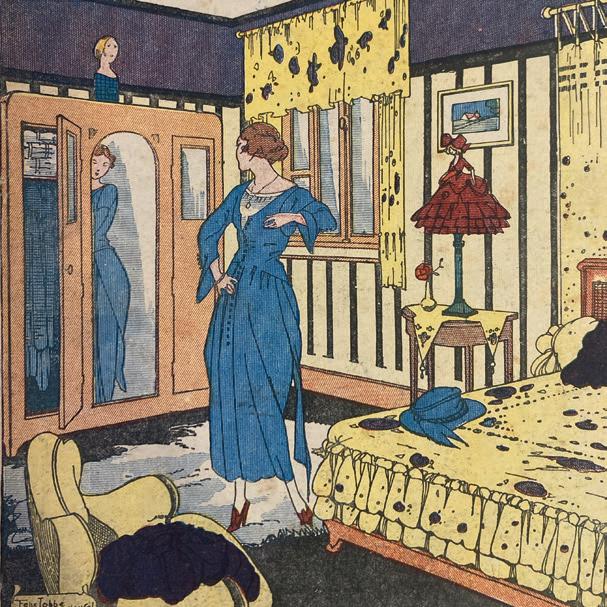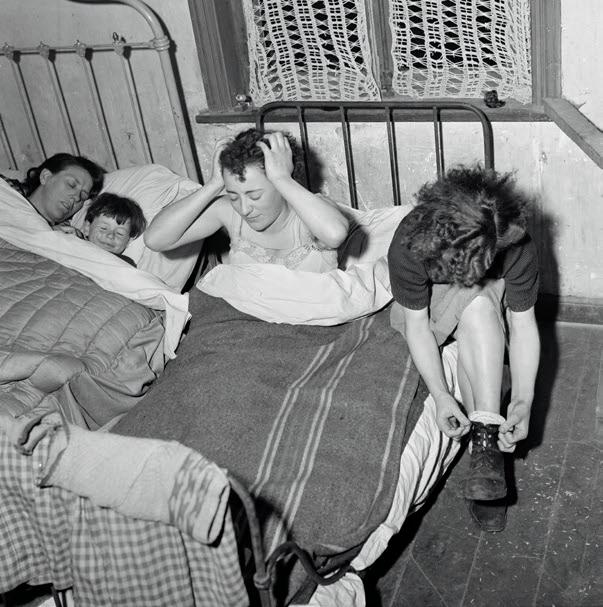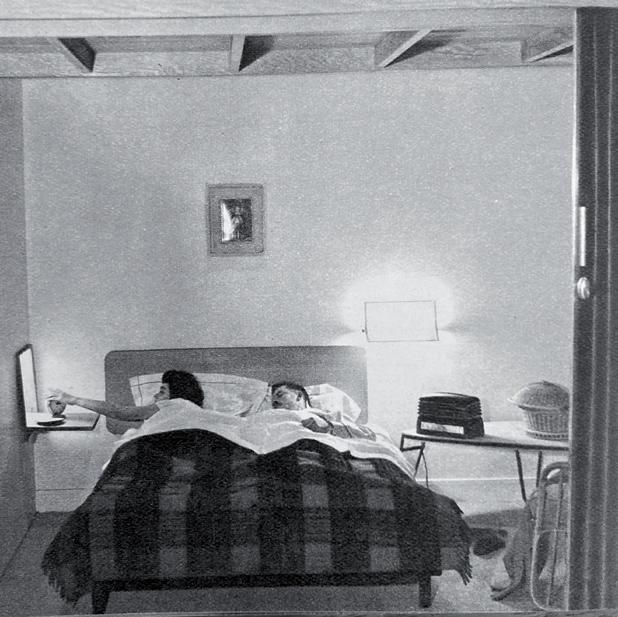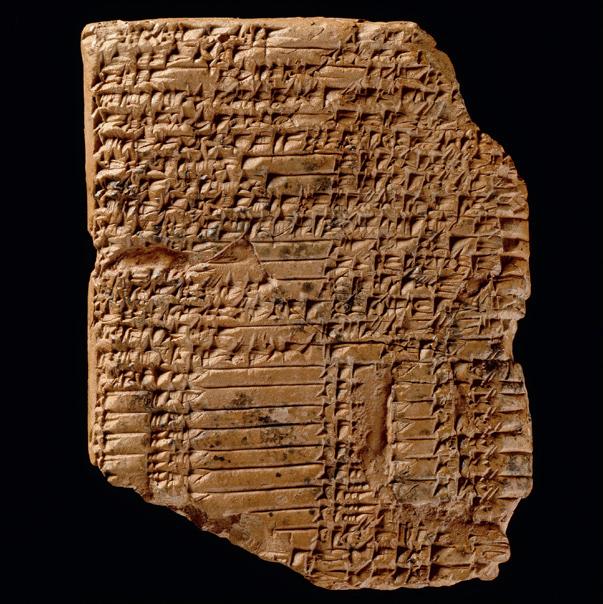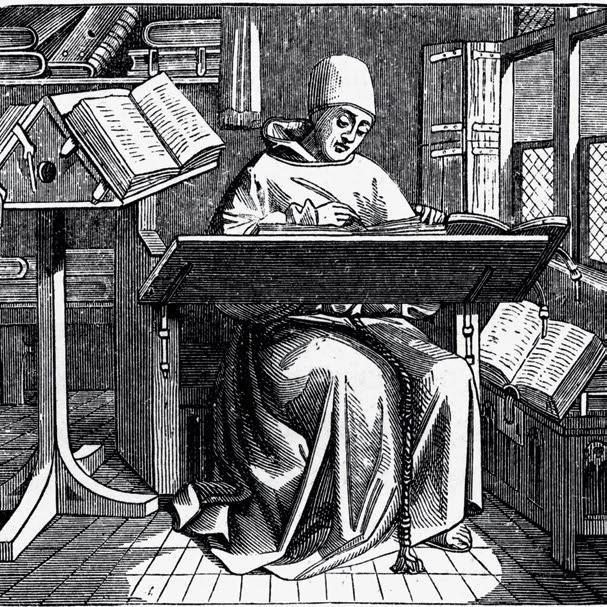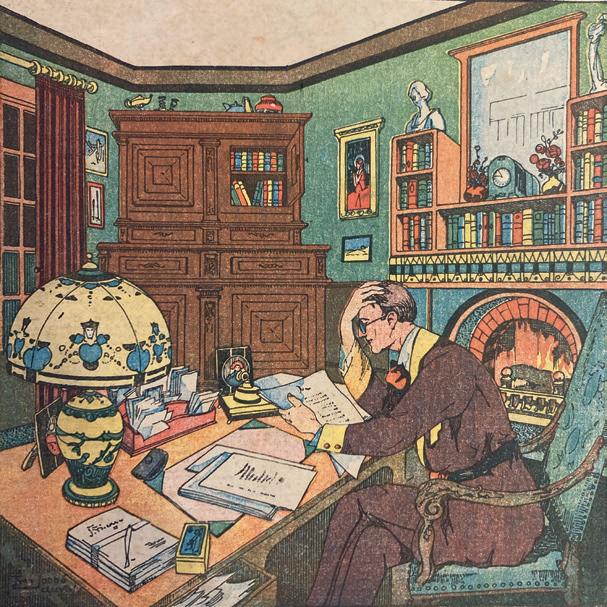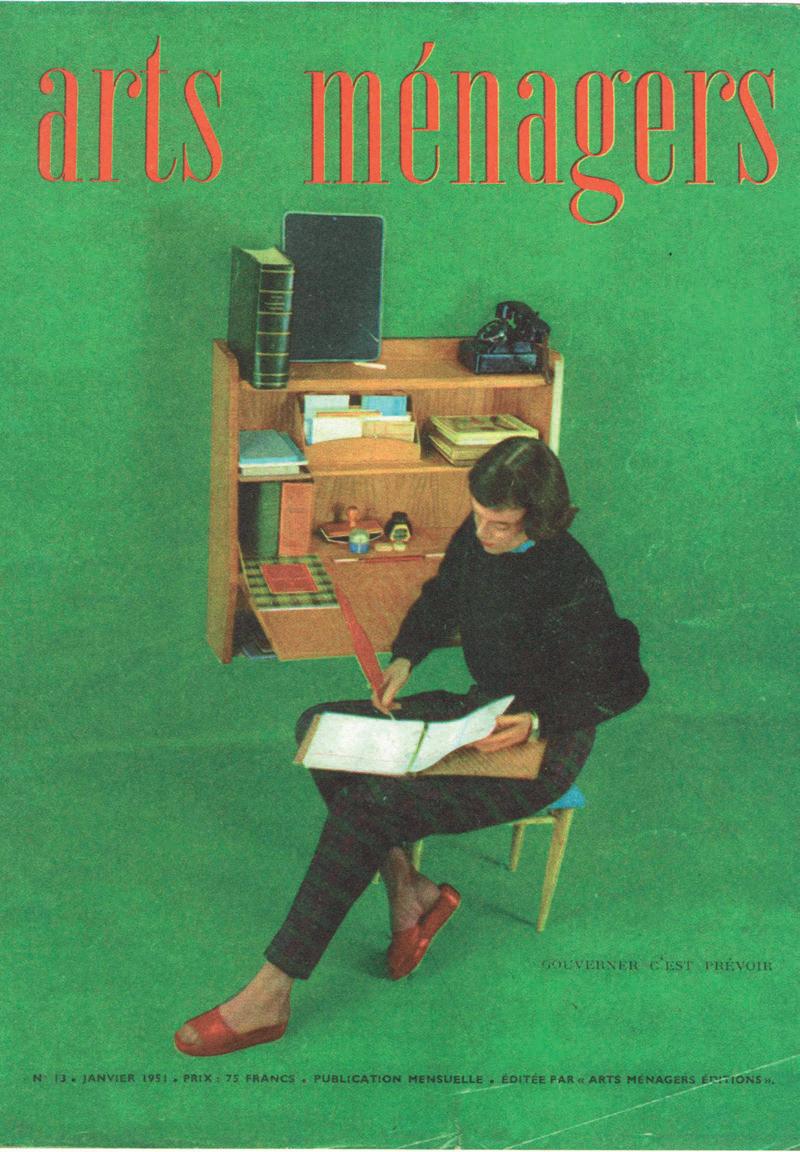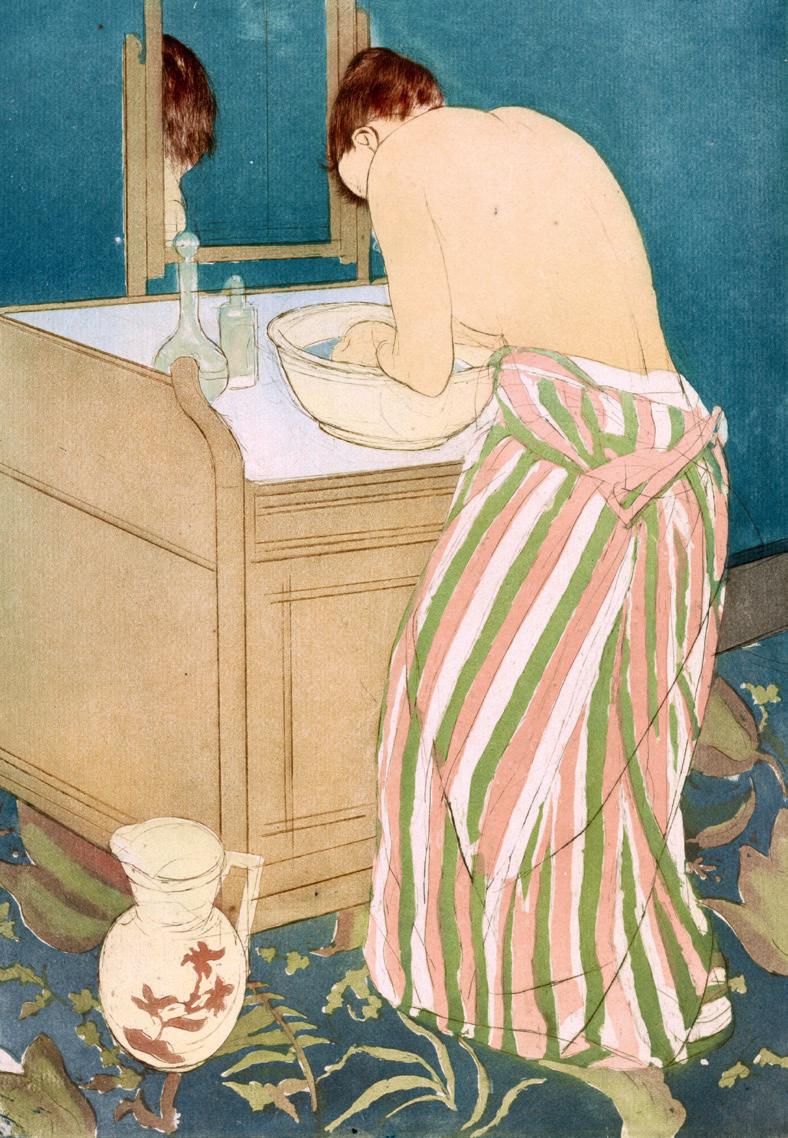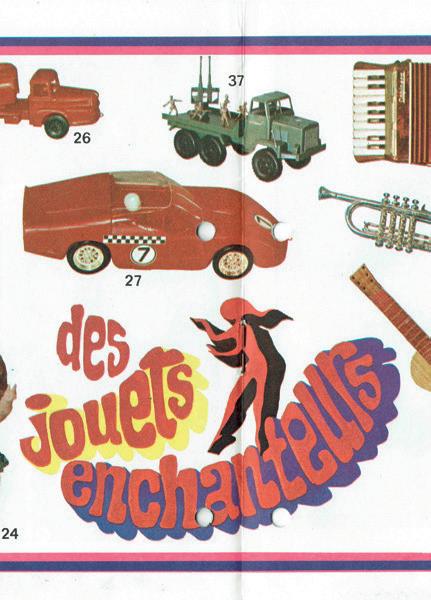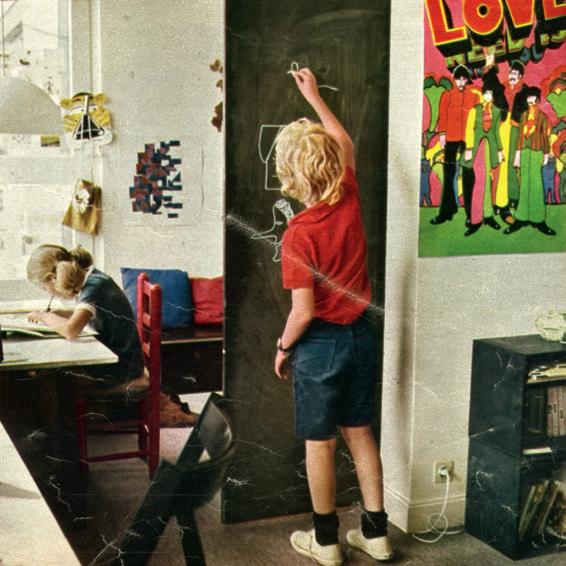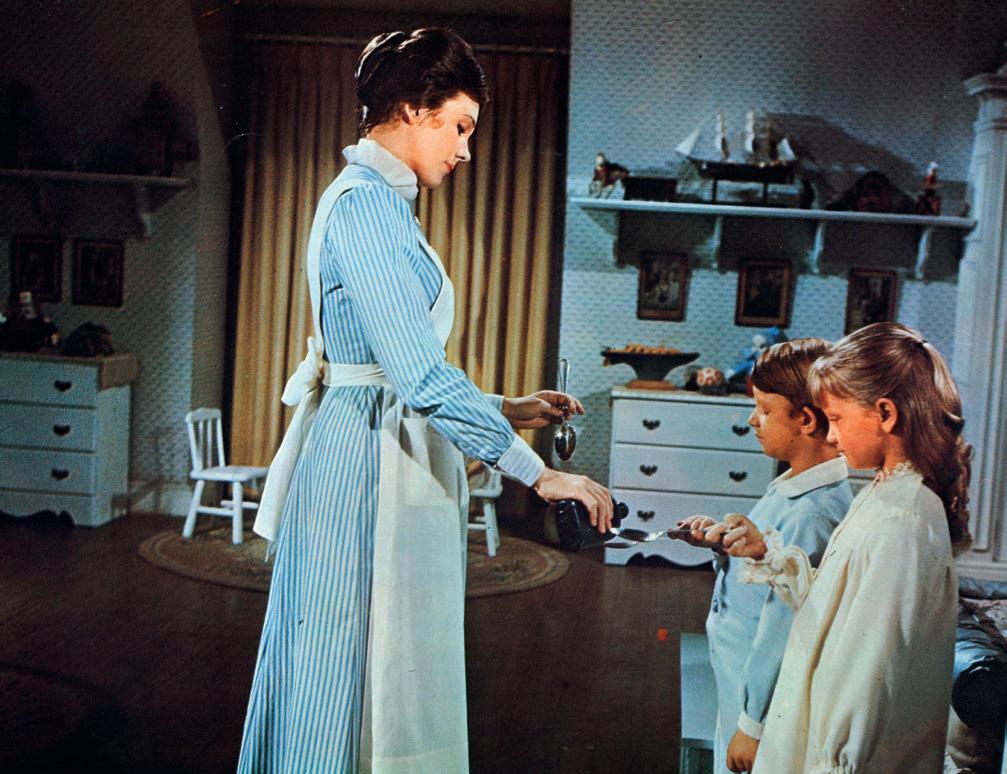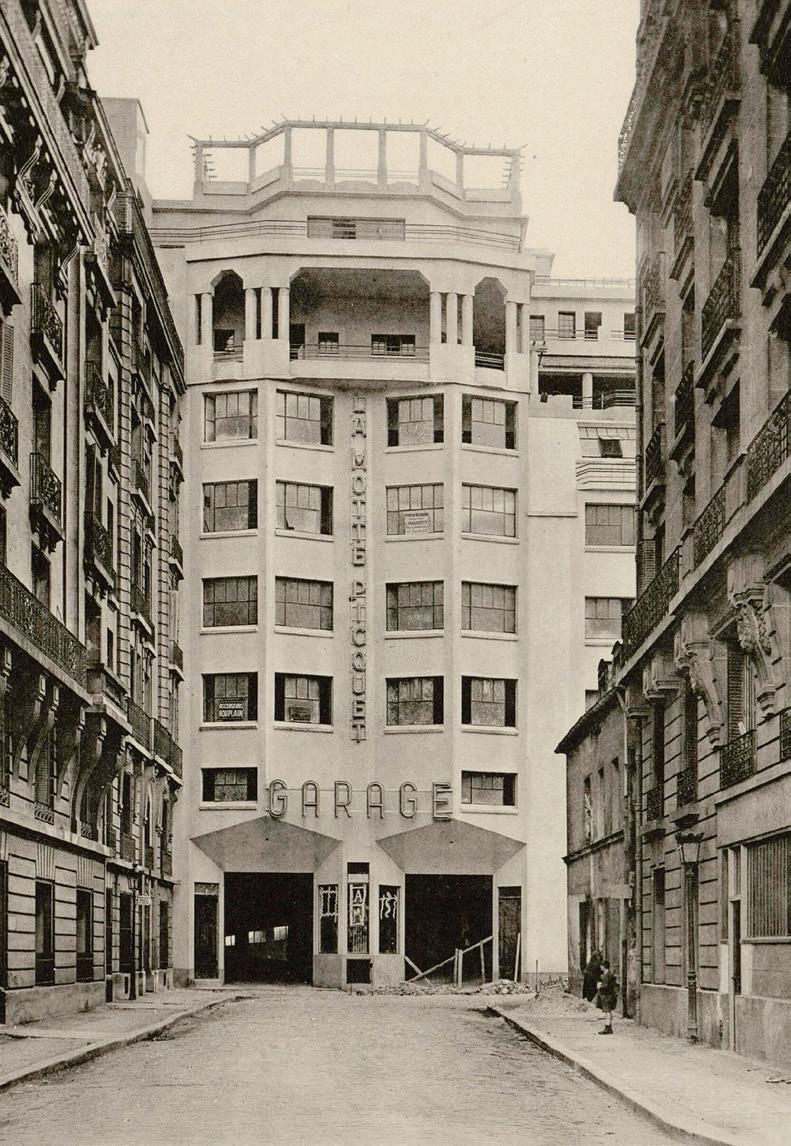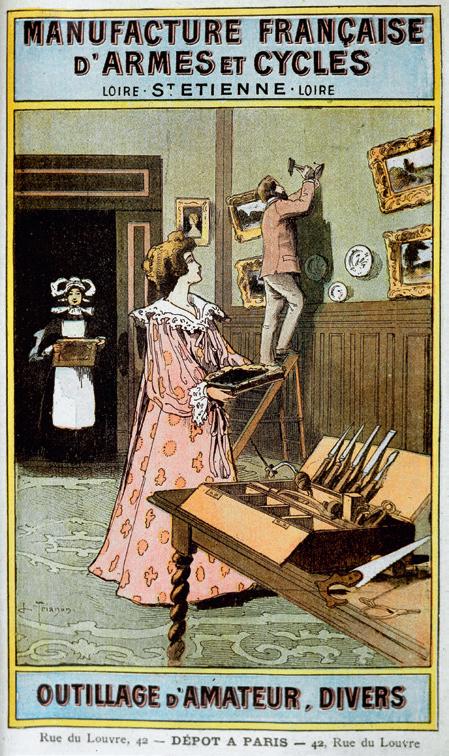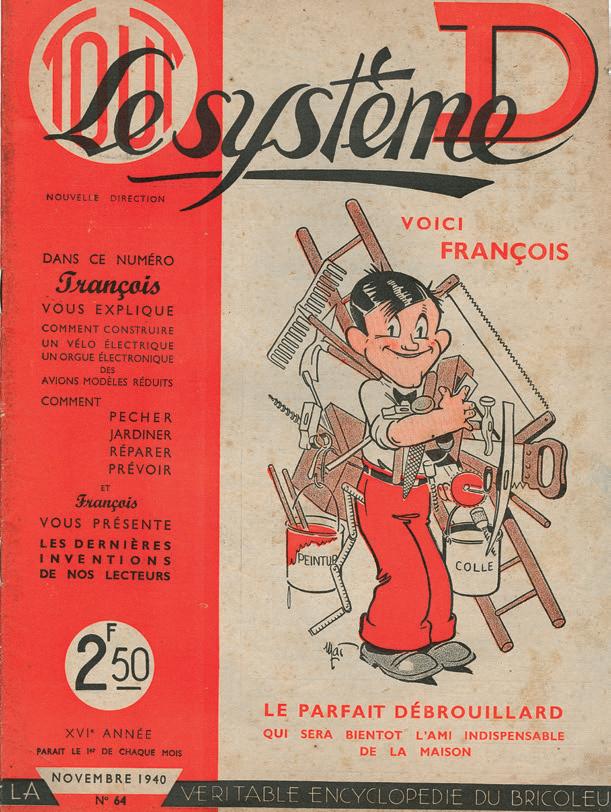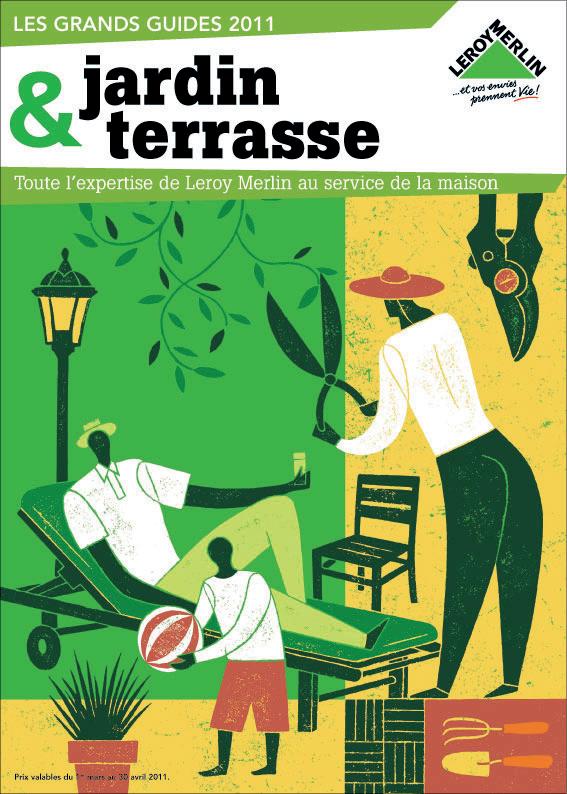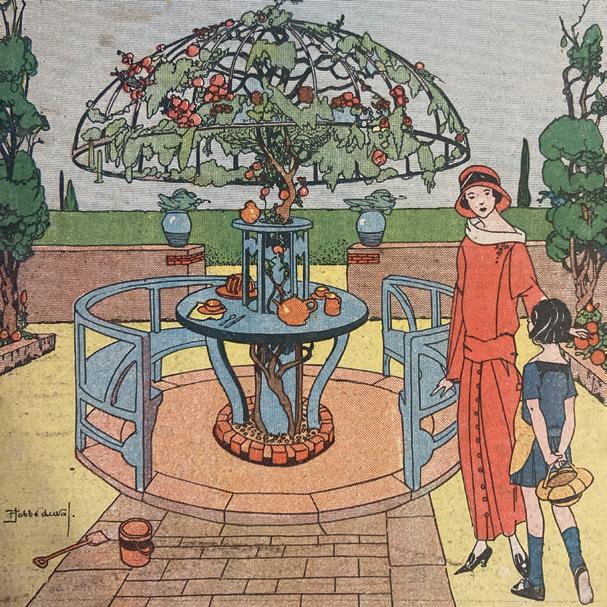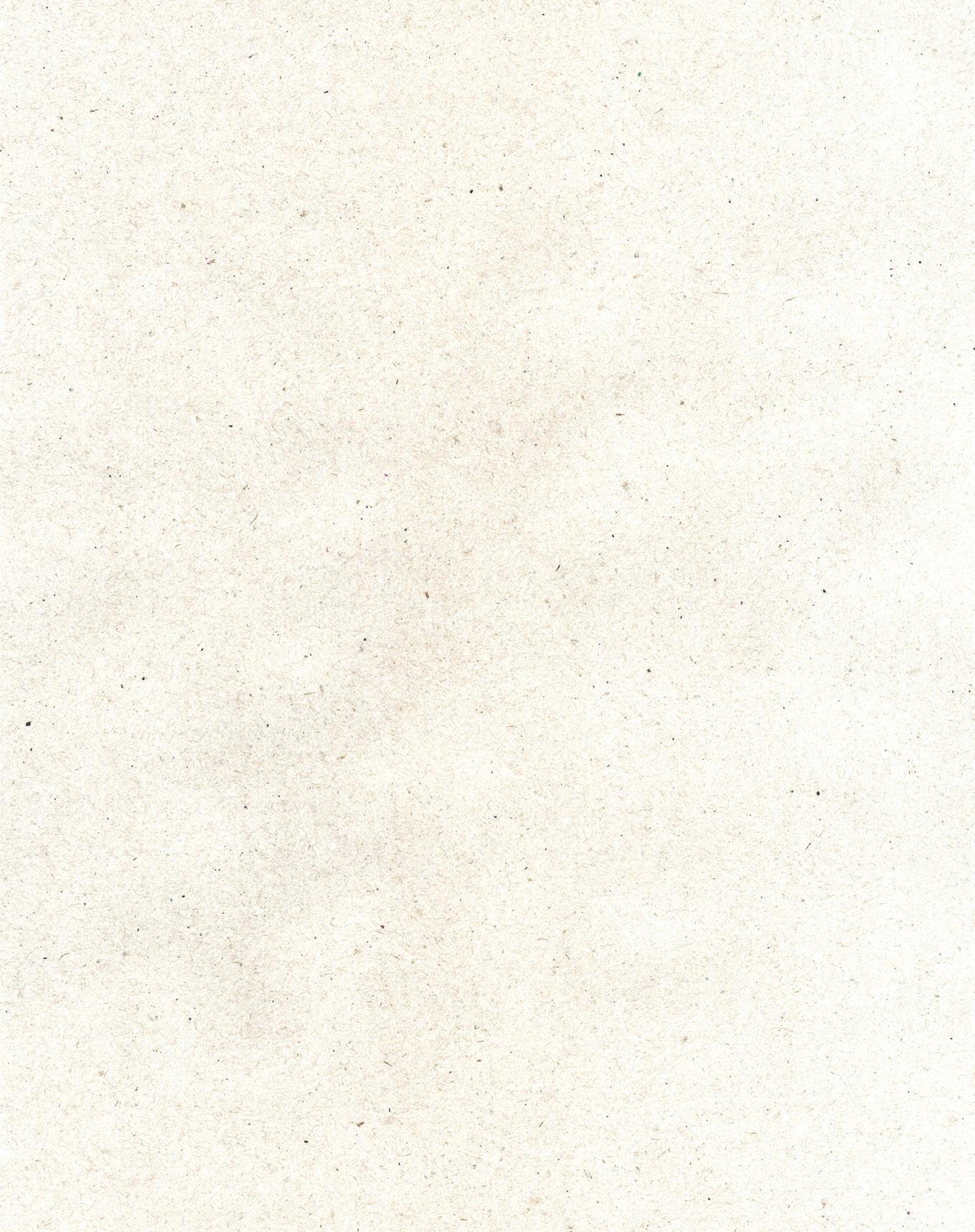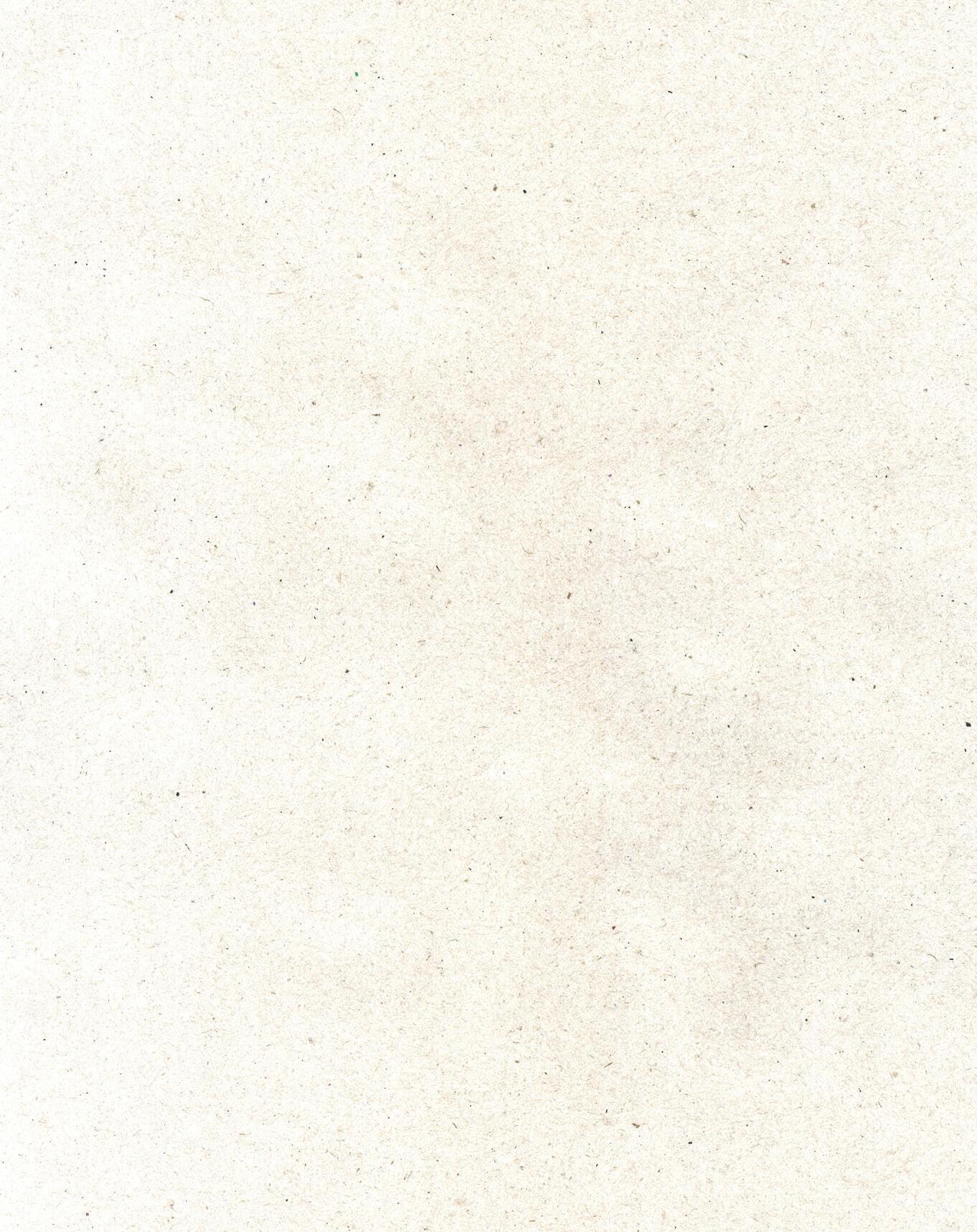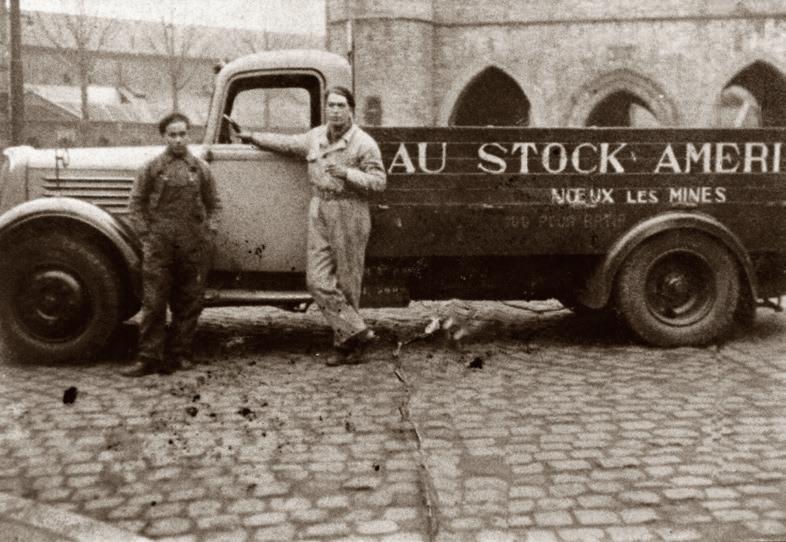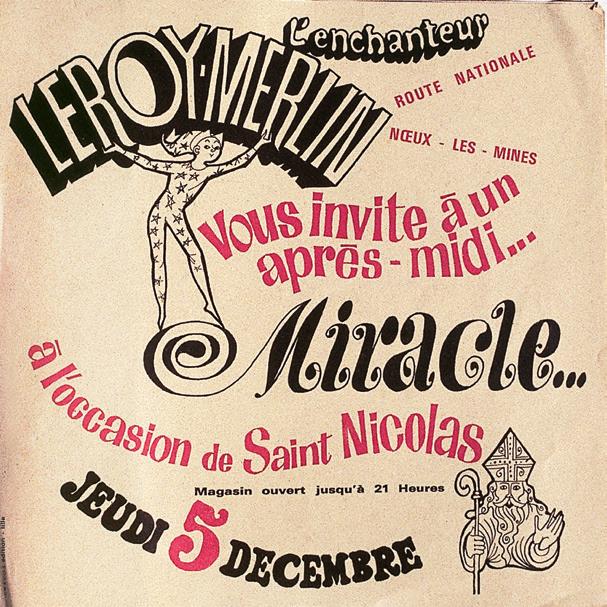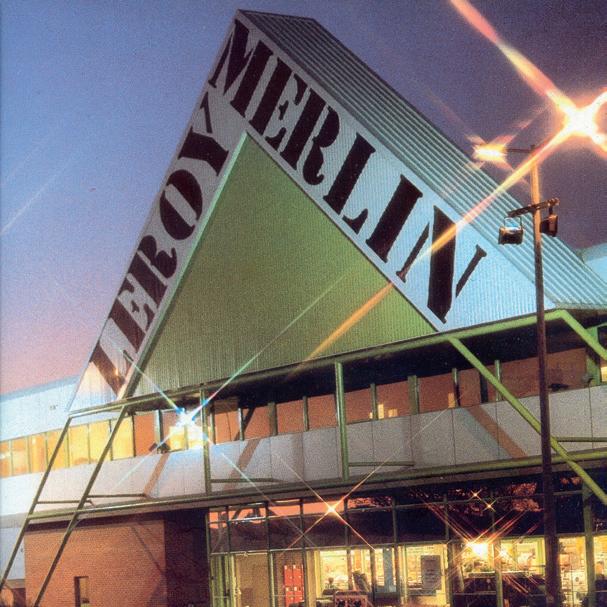« L’être humain est le seul animal à être un artiste, et l’art d’habiter fait partie de l’art de vivre. Une demeure n’est ni un terrier ni un garage. »
Ivan Illitch (1926-2002), philosophe, penseur de l’écologisme et critique de la société industrielle.
N° / 5 000 exemplaires
FAÇON s
D ’ HABITER
CON s TRUIRE L ’ AVENIR çA FAIT 100 AN s
QUE ÇA NOUs RA ss EMBLE ET ÇA
n ’ est PA s
PRÈs DE s ’ ARRÊTER !
ous fêtons cette année les 100 ans de Leroy Merlin. L’occasion pour nous, à travers le livre Façons d’habiter, de prendre de la hauteur pour raconter l’habitat d’hier et penser celui de demain.
N
28 janvier 1924 : Adolphe Leroy et Rose Leroy se disent oui. De l’union de ces deux noms, naît l’entreprise Leroy Merlin avec, pour tout premier magasin, celui de Nœux-les-Mines qui propose la revente de surplus militaires à des prix très accessibles. Au fil de ces 100 années, de grandes mutations ont traversé la société française : la reconstruction dans les années 1950, l’essor de la maison individuelle, les changements du modèle familial… Leroy Merlin a accompagné ces mutations en donnant accès à un logement abordable, en garantissant un habitat sain, en permettant aux Français de faire des économies d’énergie. Jusqu’à aujourd’hui, 2024, et notre engagement pour un habitat positif.
Face au mouvement perpétuel du monde, la clé de notre longévité et de notre leadership a été, et restera, notre soif de savoir et sa mise en pratique à toutes les échelles de notre activité. Cela concerne d’abord nos métiers. La formation sur les produits, les services et les savoir-faire reste une priorité, que ce soit parmi les collaborateurs ou auprès des artisans partenaires.
Nous devons apprendre, toujours et encore. Apprendre des autres, en allant sur le terrain, en rencontrant nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs. Nous devons aussi continuer à apprendre de nous-mêmes comme nous le faisons lors de nos rendez-vous « Vision » tous les dix ans pour imaginer tous ensemble l’avenir de notre entreprise.
Rares sont ceux qui savent que Leroy Merlin abrite un centre de recherche. Notre « faculté de l’habitat » unique en son genre, Leroy Merlin Source, réunit en effet une cinquantaine de chercheurs et de professionnels pour enquêter sur la manière d’habiter des Français. Ce pôle de recherche analyse les façons de vivre chez soi, de se chauffer, de cuisiner, de travailler, de jouer, de bricoler, de vieillir… Il explore l’évolution de nos mœurs, de nos inquiétudes et de nos souhaits. Grâce à ces recherches et ces savoirs collectés, nous pouvons imaginer des produits et services pour améliorer le quotidien des habitants et le futur de l’habitat.
Le progrès permanent et la connaissance sont également, en miroir, au cœur de la relation avec nos clients. Notre rôle est de transmettre des savoirs et des savoir-faire aux Français pour les rendre maîtres chez eux. Cela passe concrètement par de l’accompagnement via des
contenus pédagogiques, des cours de bricolage, des tutoriels, qui aident les habitants à réaliser leurs projets d’aménagement, d’embellissement et de rénovation.
À l’orée de ce nouveau siècle d’existence, nous vivons une petite révolution de l’habitat. Les Français doivent repenser leur « chez-eux » avec souplesse. Intégrer les réseaux numériques, désormais bien installés dans nos foyers, et les nouveaux modes de consommation, élargir l’horizon domestique qui a bougé depuis la crise du Covid et les confinements, composer avec les tensions sur les circuits logistiques, la baisse du pouvoir d’achat ou les répercussions de la géopolitique, aborder bien sûr les grandes transitions énergétique et écologique.
Habiter devient plus que jamais une aventure, un défi pour lequel il faut être solide comme le chêne et souple comme le roseau. Il faut s’adapter et créer, apprendre pour progresser. Devant nos fidèles témoins, les habitants, nous sommes fiers d’écrire l’histoire de l’habitat depuis maintenant un siècle. Fiers de continuer à apprendre et à nous mobiliser, comme en témoigne ce livre. On peut tout construire ensemble, même l’avenir.
Agathe Monpays, directrice générale de Leroy Merlin France
L ’ HABITAT
L’habitat d'hier et de demain
LA CUI s INE
De l’ombre à la lumière
LE sALON
De la mondanité à l’intimité
LA CHAMBRE PARENTALE
Du nid à l’île
p. 8
p. 48
p. 70
p. 90
LE BUREAU
Du mobilier au télétravail
LA sALLE DE BAIN
Le corps architecte
p. 108
p. 124
LA CHAMBRE D ’ ENFANT
D’une chambre inexistante à un univers stratégique
LE GARAGE
p. 150
p. 168
L ’ ATELIER
Bricoler pour durer
LE JARDIN
Paradis retrouvé
Des voitures au « big bazar» LEROY
p. 184
p. 204
100 ans d’histoire p. 220
s OMMAIRE
MERLIN
L ’ HABITAT D ’ HIER ET DE DEMAIN
Rétrospective
De l’idéal du pavillon individuel à l’habitat régénératif
Savez-vous pourquoi les êtres humains ont construit les premières huttes ? Pour se défendre des agressions extérieures et des prédateurs, car, en évoluant, ils étaient devenus plus vulnérables : moins d’odorat pour flairer le danger, moins de crocs pour mordre, moins de pattes pour être véloces… L’habitat a, lui aussi, évolué avec l’homme. Il est la photographie de la société, le reflet des mœurs de son temps, l’expression des liens tissés avec son environnement, avec les autres et avec soi. Êtes-vous prêts à traverser l’épopée de l’habitat en France au xxe siècle ? Chaque pièce mérite une visite guidée, parfois quelques flashbacks pour bien comprendre son évolution. Mais attardons-nous tout d’abord sur la naissance et l’essor du pavillon individuel, puis son « réenchantement » au xxie siècle, en compagnie de l’ethnologue Viviane Hamon¹.
Avant l’essor des maisons Phénix et consorts, avant la réglementation thermique de 1975, la France construit des maisons. Beaucoup de maisons.
sous la ville, la campagne
Pendant la période 1949-1974, on compte près de 3,5 millions de maisons individuelles édifiées, soit un peu plus de 20 % de l’ensemble du parc individuel français actuel. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est meurtrie. La pénurie de logements décents
s’éternise, puisque c’est seulement en hiver 1954 que l’abbé Pierre lance son fameux appel pour venir en aide aux Français les plus démunis. La reconstruction du pays se fait en parallèle d’un énorme exode rural, tandis que l’agriculture s’industrialise. Partout en France, des jeunes rejoignent massivement la ville parce que la ferme n’offre plus de travail aux familles trop nombreuses. En parallèle, les mutations agricoles privent des propriétaires en bordure de ville de succession : leurs enfants, pour certains partis étudier, ne souhaitent pas reprendre la ferme. Dépourvus d’assurance vieillesse, ces agriculteurs vendent leurs terres et obtiennent ainsi une retraite.
l ’ HABITAT 10

Chantier de construction de maisons individuelles d’État à Nantes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Photographie médiathèque Terra.
L’abbé Pierre sortant du palais de l’Élysée après avoir été reçu par le président de la République René Coty, suite à son appel d’aide aux sans-abris le 1er février 1954. Photographie KeystoneFrance / Gamma Rapho, 13 mars 1954.

11
Des parts de terre réglementées
Des géomètres découpent alors ces terres vendues. Les parcelles deviennent des terrains constructibles, où l’on érige des maisons individuelles. Il faut rappeler qu’à cette époque d’expansion urbaine, avant et après la guerre, des débats idéologiques animent l’architecture française. D’un côté, les héritiers de Le Corbusier et du Ciam (Congrès international d’architecture moderne, 1928-1959), apôtres du logement collectif, visent à y réunir la classe ouvrière. À l’opposé de cette vision sous influence marxiste, on trouve les tenants de la maison individuelle. Car, quand on pense à la reconstruction, on pense souvent aux grands ensembles, mais on oublie la construction de ce parc immobilier individuel. Des primes de l’État encouragent cette croissance urbaine pavillonnaire, aides que l’on obtient sous certaines conditions.
Des maisons toutes identiques ?
Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) encadre la qualité des constructions. Concrètement, des plans types définissent des obligations minimales : surface des pièces, hauteur sous plafond, prescriptions d’hygiène, d’assainissement et de ventilation, etc. C’est ce qu’on appelle la politique des logécos (logements économiques et familiaux), qui comprend aussi un encadrement des prix et des conditions avantageuses de prêts bancaires. Résultat, à plein d’égards, ces projets
attirent de nombreux Français. Les directions régionales de l’équipement adaptent ces normes en ajoutant des touches régionalistes. Cela se traduit, en Bretagne par exemple, par des encadrements de portes et fenêtres et des soubassements en granit. Voilà des maisons ultra normées qui auraient pu apparaître dans un catalogue agréé par l’État ! Le même principe de construction s’applique dans toutes les maisons : du parpaing, une lame d’air, de la brique et du plâtre. On peut citer aussi les matériaux des planchers, plus ou moins nobles selon les pièces : du chêne et du châtaigner dans le séjour, du pin dans les chambres ; et de véritables charpentes traditionnelles réalisées par des charpentiers. Sans oublier un signe de progrès pour l’époque : la présence de WC.
Deux pans de l’histoire de la construction
À partir des plans types, deux manières différentes de construire ces pavillons coïncident. D’abord, une forme d’auto-construction hybride.
Rappelons la naissance dans les années 1920 du premier mouvement organisé d’autoconstruction, sous l’impulsion de l’ingénieur Gëorgia Knap. Jusqu’en 1940, plus de 1 000 maisons sont construites par vingt-deux groupes d’habitants implantés principalement dans des communes industrielles. À la fin de la guerre, ce mouvement d’auto-construction coopératif prend le nom de « Castors ». À la manière des Castors, dans le quartier de Hellio-Bily (Saint-Brieuc) étudié par l’ethnologue Viviane Hamon, certains pavillons individuels sont partiellement auto-construits à partir des années 1950.
l ’ HABITAT 12

Catalogue Leroy Merlin pour la vente de baraquements/cabines type Clairmarais, 1928. Archives Leroy Merlin.
LA DÉMOCRATISATION DE L’HABITAT INDIVIDUEL
À la fin des années 1920, des familles françaises vivent encore dans des baraquements de fortune issus de la Première Guerre mondiale. Des laissés-pour-compte de la reconstruction. Lors d’un voyage à Paris, Adolphe Leroy passe par hasard devant « La Gauloise », une entreprise de construction de petites maisons préfabriquées en bois-fibrociment. C’est une révélation. Il décide de reproduire l’idée chez lui dans la foulée. Sans aucune notion de construction, il crée un atelier de menuiserie et acquiert un matériau récemment arrivé sur le marché, l’Éternit.
C’est ainsi que l’enseigne Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) propose, dès 1929, différents modèles de chalets, garages, abris de jardin, poulaillers, clapiers, salles de fêtes et écoles provisoires, à des prix jamais vus. Un service montage prend en charge la construction des bâtiments à l’endroit choisi par le client. Les commandes affluent et ces chalets à bas coût permettent de démocratiser l’habitat individuel. Le Stock devient le spécialiste de la construction préfabriquée, démontable et économique, qui sera très appréciée aussi après la Seconde Guerre mondiale.
13

Fête de l’Union Commerciale, Nœux-les-Mines, années 1950.
Archives Leroy Merlin.

Adolphe Leroy lors d’une cérémonie de remise de médailles sportives, 1950.
Archives Leroy Merlin.
l ’ HABITAT 14
D’UN ENGAGEMENT LOCAL ET ASSOCIATIF À UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE ET UNE ENTREPRISE CITOYENNE
Dans les années 1920, pour faire face aux conséquences de la grande crise, une partie des commerçants, parmi lesquels Adolphe Leroy installé à Nœux-les-Mines dans le Nord, fonde « l’Union Commerciale » dont l’objet est de promouvoir le commerce local au travers de manifestations sportives et festives. Le fondateur du Stock Américain, qui a le goût du contact humain et l’amour de Nœux-les-Mines, investit son entreprise et son temps dans l’animation de la ville. Il met sur pied des matchs de football au profit des personnes sans emploi, des ducasses (terme ch’ti désignant les fêtes foraines) et des carnavals. Le Nord étant la patrie des géants, lors de défilés carnavalesques, un mineur de cinq mètres est créé aux couleurs du Stock Américain. Lorsqu’une loterie a lieu, les lots proviennent souvent de la société. Adolphe fonde ou préside de nombreuses associations, comme le Central nœuxois, club de boxe d’envergure nationale, le Vélo Club nœuxois ou le club colombophile. Chaque manifestation confère à la ville un air de fête et renforce la popularité d’Adolphe Leroy dont beaucoup disent qu’il est « le roi de Nœux-les-Mines ». La plupart des associations sollicitent des subventions qu’il honore. Cette attitude solidaire lui vaut le respect de tous en dépit d’un caractère hérissé.
Dans les années 1930, Adolphe Leroy met sur pied une ducasse le jour de la fête nationale. Un défilé déambule dans les rues de la ville et chante en patois un air célébrant le Stock Américain. Ce sont des manifestations qui fédèrent et font rêver un large public : le 4 juillet 1932 a ainsi lieu un lâcher de montgolfière. La course des Broutteux est un autre exemple de rendez-vous festif, une course de brouettes au départ des ateliers du Stock Américain, qui remporte un franc succès. Adolphe Leroy œuvre ainsi pendant cinquante ans pour la population nœuxoise et sa vie associative.
Cette culture se poursuit aujourd’hui à travers des magasins ancrés et engagés dans leur territoire pour rendre accessible à tous le « mieux-habiter ». Cela se traduit par des partenariats de long terme avec des associations de terrain – plus de 230 sont actifs aujourd’hui. Le dernier en date étant le partenariat avec Stop à l’exclusion énergétique, démontrant l’engagement de l’entreprise dans la lutte contre la précarité énergétique. Ce qui fait la particularité de cet engagement de terrain, c’est la participation des collaborateurs : depuis novembre 2020, chaque salarié peut sur son temps de travail consacrer une journée à une association de son choix. Beaucoup font le choix de participer, en équipe, à des chantiers solidaires comme ceux de l’association Bricos du cœur. L’engagement des collaborateurs est aussi essentiel à l’activité de la Fondation Leroy Merlin : ils rencontrent les personnes âgées ou en situation de handicap chez elles, montent leur dossier et les accompagnent dans leur projet d’adaptation de leur logement. L’œuvre marchande et l’œuvre sociale sont intrinsèquement liées depuis les débuts.
15
Les bâtisseurs sont des jeunes issus de familles agricoles reconvertis en policiers, car une caserne de CRS est présente sur le territoire depuis 1924. Comme ils connaissent le métier d’agriculteur par leurs parents, ils viennent aider leurs aînés aux champs, le soir après le travail. En contrepartie, les agriculteurs leur prêtent leurs chevaux et tombereaux pour transporter des matériaux. Et le week-end, ils construisent leur maison. Il ne s’agit pas de maisons en totale auto-construction, mais les futurs occupants réalisent une grande partie de la tâche eux-mêmes.
À côté de l’auto-construction, se développe une autre méthode plus cosmopolite. Des entrepreneurs espagnols, italiens et portugais construisent pour les ménages français. Les années 1920 à 1940 sont une période de grande émigration italienne en France en raison du fascisme. Des dynasties s’installent, dont des artisans très inventifs puisqu’ils créent par exemple l’ancêtre de la maison Phénix, un bâti à partir de plaques de béton fabriquées en usine. La maison dite Novello (1924), à Rennes, sera d’ailleurs classée monument historique. De vrais métiers œuvrent donc, des maçons, des menuisiers, des serruriers ferronniers, des charpentiers, des couvreurs… Les maisons ne sont peut-être pas toujours du goût de tout le monde, mais elles sont extrêmement bien construites. Ces entrepreneurs étrangers, eux qui ont reconstruit la France, mériteraient une vraie reconnaissance !
Des maisons « dans leur jus »
Regardons de plus près l’intérieur des pavillons créés à Saint-Brieuc. La surface habitée dans les années 1950 est beaucoup plus réduite qu’aujourd’hui dans les mêmes pavillons désormais réhabilités. On utilise encore pleinement les pièces de service : la buanderie et son lavoir en béton, le garage et sa fosse à vidange, le grenier qui sert de vrai débarras. La chercheuse Viviane Hamon, ayant elle-même grandi dans un pavillon urbain en Bretagne, raconte : « C’étaient les sous-sols du sale. Quand on mangeait des galettes, comme ça sentait mauvais, on les préparait et on les mangeait au sous-sol et non dans la salle à manger de réception. C’est là aussi que l’on gardait les conserves et que l’on faisait bouillir la lessive. »
Le décor finit par geler. Le temps fige les cuisines rustiques, les lustres, les papiers peints désuets. Les premiers occupants, ayant connu la stabilité de l’emploi et la retraite à soixante ans, habitent leur pavillon jusqu’à leur décès, tandis que leurs enfants font pour la plupart leur vie ailleurs. C’est ainsi que des quartiers entiers ont subi un gel générationnel. Comme des vaisseaux qui auraient voyagé dans le temps, les maisons revisitées dans les années 2010 témoignent encore de la mode des années 1960.
l ’ HABITAT 16


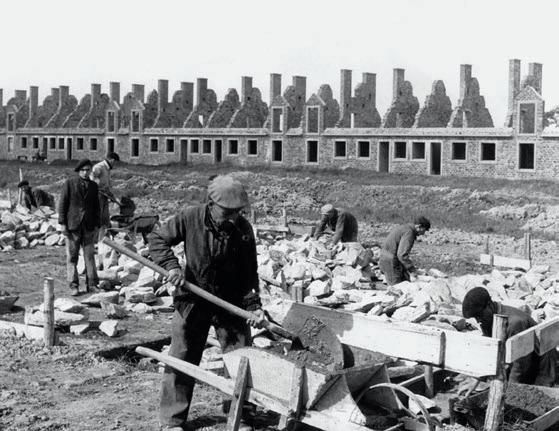
17
Construction d’une maison par « Les Castors » près de Bordeaux en 1951. Photo AGIP / Bridgeman Images.
Reconstruction, Nantes, 1947.
Photo Tallandier / Bridgeman Images.
Maisons Novello, Rennes, 1952. Photographie Archives départementales des Côtes-d’Armor, fonds Novello.
Témoignages d’un autre temps
Comme les papiers peints se démodent, les conditions dans lesquelles ce modèle du pavillon individuel a prospéré sont aujourd’hui dépassées. L’époque semble en effet bien lointaine… À ce moment-là, la conscience des enjeux écologiques liés à l’activité humaine était peu répandue et l’énergie semblait abondante. Ainsi, ce modèle du pavillon individuel, mal isolé et peu connecté aux transports en commun, a contribué à l’artificialisation des sols, à l’étalement urbain et au règne de la voiture : des dommages collatéraux, qui n’étaient pas alors perçus comme tels, sont aujourd’hui des aberrations.
Cette époque où l’énergie était abondante et peu coûteuse nous laisse des millions de passoires énergétiques qu’il faut rénover. Dans ce parc, on compte de nombreux pavillons individuels dont la réhabilitation récente n’est pas toujours un succès du point de vue de la performance énergétique, selon Viviane Hamon, spécialiste du sujet. Elle explique ces « rendez-vous ratés » par une méconnaissance technique, de mauvais arbitrages budgétaires, le triplement de la surface habitée et la « loftisation » rendant désirables des grands espaces de vie très ouverts.
L’art d’habiter pour tous
« La société industrielle est la seule qui s’efforce de faire de chaque citoyen un élément qu’il faut abriter et qui est donc dispensé du devoir de cette activité communautaire et sociale que j’appelle l’art d’habiter », nous dit Ivan Illich² sur l’habitat au xxe siècle. Le penseur distingue en effet le fait d’être logé et le fait
d’habiter. Alors, où et comment habiter (et pas seulement se loger) au xxie siècle, à l’heure de l’urgence écologique ?
Dans notre société où le progrès change de nature, une société post-industrielle qui revalorise le vivre-ensemble et l’environnement, il apparaît nécessaire de s’emparer de l’habitat pour le rendre durable et heureux. Les initiatives individuelles innovantes seraient-elles l’avenir de l’habitat ? L’auto-construction revient en force avec comme préoccupations récurrentes l’emploi de matériaux naturels ou biosourcés, l’autosuffisance énergétique (a minima les maisons auto-construites sont passives), la réutilisation des eaux grises, la récupération des eaux de pluie et la ventilation. Quiconque souhaite conjuguer économie et écologie s’intéresse au papier, au carton, à la paille, à la boue, à la terre cuite, au bois et à toutes les techniques ancestrales. L’habitat partagé fait aussi son grand retour mais cette fois, il est choisi et non subi : que ce soit par conviction écologique ou pour rompre avec la solitude, des habitants montent des projets de rénovation ou de construction communs et choisissent de vivre ensemble et séparément à la fois. Chacun chez soi mais avec des pièces partagées comme la buanderie, l’atelier, la salle de jeux pour les enfants et la chambre pour les amis de passage.
1 Viviane Hamon, Lionel Rougé, Hortense Soichet, Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-1970, Les chantiers Leroy Merlin Source, n°50, 2022.
2 Cité par Mona Chollet, Chez soi. Une odysée de l’espace domestique, Zones, 2015.
l ’ HABITAT 18

Une rue pavillonnaire de Saint-Brieuc.
Intérieur d’un pavillon de Saint-Brieuc. Photographies réalisées par Hortense Soichet dans le cadre de la recherche Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-1970, Leroy Merlin Source, 2022, en partenariat avec l’ADEME.

19
LEROY MERLIN SOURCE, LA RECHERCHE À L'ÉCOUTE DES HABITANTS
Créé par Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin Source est le réseau de recherche de l’entreprise sur l’habitat, dont le fil rouge est aujourd’hui l’habitat durable. Il réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels du champ de l’habitat (appelés correspondants Leroy Merlin Source) qui partagent leurs savoirs et leurs connaissances avec le plus grand nombre et, en particulier, avec les collaborateurs de l’entreprise.
Au sein de trois pôles, « Habitat et autonomie », « Habitat, environnement et santé », « Usages et façons d’habiter », ils créent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques, réflexions et échanges, sur les évolutions de l’habitat et les modes de vie, principalement par le recours à la recherche en sciences humaines et sociales.
Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers de recherche dont les thèmes sont définis annuellement par les membres des groupes de travail, en dialogue avec les axes stratégiques de l’entreprise. Ces travaux sont construits avec des collaborateurs de Leroy Merlin et sont ouverts à des partenariats avec des acteurs de l’habitat et des institutions publiques et privées. Les résultats de ces chantiers sont communiqués d’une part aux collaborateurs de l’entreprise, sous des formes adaptées à leurs préoccupations, et d’autre part à tous les acteurs de la chaîne de l’habitat intéressés, dans une diversité de supports : rapports de recherche et synthèses, films, expositions, événements publics… Ils sont également disponibles en open source sur le site www.leroymerlinsource.fr.
En 2019, Leroy Merlin a souhaité ouvrir un nouveau champ de recherche, axé sur l’évolution des métiers du retail et de la consommation. L’entreprise a donc signé un partenariat avec l’université de Lille pour la création d’une chaire industrielle : la chaire TRENDS (Transformation of Retailing Ecosystems and New Market Dynamic(s)). Cette chaire est un lieu de rencontres, de réflexion, d’échanges entre différents acteurs qui souhaitent imaginer le commerce de demain. Elle vise à co-créer et diffuser de la connaissance auprès de l’ensemble des parties prenantes de la société sur la place et le rôle que devra prendre le commerce dans la société de demain.
En 2021, le partenariat signé par le magasin Leroy Merlin de Nice avec l’université Côte d’Azur et plus particulièrement avec l’Imredd (Institut méditerranéen du risque de l’environnement et du développement durable) pour le développement de la chaire « UX for Smart Life Home and Mobility » donne à l’entreprise l’opportunité de travailler sur le sujet de la vie intelligente et de lever les verrous scientifiques qui peuvent freiner le développement technologique de nos environnements intelligents. La chaire a pour vocation de tester et d’étudier l’acceptabilité et l’impact sur les usagers des nouveaux systèmes connectés et des services numériques associés imaginés par les entreprises partenaires.
« La détection des signaux faibles que permet la recherche à travers ses méthodologies scientifiques et pluridisciplinaires est une façon pour l’entreprise d’anticiper les besoins et les attentes des habitants, consommateurs et clients. Et donc, d’être une entreprise innovante », conclut Claire Letertre, responsable de la recherche chez Leroy Merlin France.
l ’ HABITAT 20

21
Apprendre à habiter publié par Leroy Merlin Source en 2023.
L ’ HABITAT DE DEMAIN
Où va l’habitat ? Au bout du chemin, l’habitat sera non seulement durable mais aussi régénératif : dans sa construction et sa rénovation, en utilisant des matériaux durables et de récupération, et aussi dans son usage quotidien. Les habitants ne feront pas seulement des économies d’eau, ils utiliseront l’eau de pluie pour les sanitaires et leurs eaux usées seront revalorisées, pour l’agriculture notamment. Ils ne se contenteront pas de trier leurs déchets, ils les réduiront à la source et leur donneront une seconde vie. Et en cultivant leur potager, ils ne feront pas que nourrir leur famille, ils régénéreront le sol et créeront des îlots de biodiversité. Un tel défi ne peut être relevé sans l’engagement de grands acteurs comme Leroy Merlin pour rendre accessibles les solutions.
l ’ HABITAT 22
Clara Lorinquer, qui dirige le département Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, explique sa vision : « La maison idéale vit en autonomie. Déconnectée des réseaux d’électricité et d’eau.
Je dirais même qu’on n’a presque pas besoin d’aller faire les courses grâce à son potager. C’est une maison passive, qui n’a pas besoin d’énergie pour être chauffée ni pour être climatisée. L’énergie dont elle a besoin sert à un éclairage réduit au minimum et à faire fonctionner quelques appareils comme un lave-linge. Le troc et les échanges entre voisins y sont monnaie courante. Sa surface réduite réserve une place pour ranger des vélos et autres mobilités douces. Cet habitat de demain part d’un constat : nous avons des moyens et des ressources limités. Il nous faut donc les optimiser, notre rôle étant d’identifier les sujets qui auront un réel impact. Car la raison d’être originelle de Leroy Merlin, intrinsèque, restera toujours la même quelles que soient nos évolutions : améliorer l’habitat du plus grand nombre.
Le premier sujet auquel je pense à propos de l’habitat de demain, c’est la réduction des consommations d’énergie. C’est celui que nous avons choisi d’affronter en priorité, autrement dit la décarbonation. Car on sait maintenant compter le carbone et cette méthode fait scientifiquement consensus. Avant tout, nous avons une vraie carte à jouer sur l’empreinte carbone des matériaux. Demain, il faudra par exemple arrêter de construire des maisons en béton, donc avec du ciment (NDLR : la fabrication du clinker, composant principal du ciment, génère énormément de CO₂), et passer à des constructions en bois. Cela dit, ce ne sera pas
23
« la maison idéale vit en autonomie. »
Chapitre 24
possible tant que nous ne proposerons pas de solution alternative accessible au plus grand nombre. Je ne crois à la radicalité que si l’on sait apporter la solution.
À l’échelle du logement, pour réduire sa consommation d’énergie, il faut aussi engager une rénovation énergétique. Or nous savons qu’il y a des freins pour se lancer dans un tel projet. Imaginez que votre diagnostic DPE est mauvais. Vous savez que votre maison consomme de façon excessive, par exemple 400 kWh par an, vous sentez bien un inconfort chez vous, mais vous avez une multitude d’interrogations : que faire ? par où commencer ? Les travaux de rénovation énergétique font peur, car ils sont très chers et complexes. Deuxième difficulté, les aides. Il y a MaPrimeRénov’, telle aide locale et encore telle autre… Tout cela est compliqué, et en plus, il faut avancer les frais ! Troisièmement, qui faire intervenir en premier ? Comment coordonner tous ces corps de métier ? Le chauffagiste, le plombier, le menuisier en charge des fenêtres… Le sujet de la rénovation énergétique, qui a un impact environnemental et sociétal très fort, est aussi le parcours le plus complexe pour un habitant. À nous, Leroy Merlin, de le rendre accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi nous avons créé un nouveau métier en magasin, le responsable rénovation énergétique, qui vient absorber la complexité à la place du client, en accompagnant son projet.
Autre sujet majeur pour l’avenir : l’eau. Nous savons mesurer la quantité d’eau que nous consommons mais nous ne savons pas encore analyser la qualité de l’eau que nous rejetons.
Or c’est important, parce que moins on pollue l’eau par nos usages dans la maison, plus cette eau-là peut être réutilisée à d’autres fins. Pour ce sujet des eaux grises, nous travaillons sur des systèmes de réseaux d’eau différents pour permettre la réutilisation de l’eau dans les WC. Le but étant de proposer une offre simple et accessible dès que possible.
Notre rôle, vendre des solutions répondant aux attentes des clients, ne reposera plus demain sur la vente de produits neufs. Mon étoile polaire, pour un habitat durable, c’est que Leroy Merlin ne dépende plus de l’industrie extractive non renouvelable. Cela peut sonner un peu technique, mais c’est très concret. D’abord, il s’agit de réparer au maximum nos produits. Ensuite, il s’agit de proposer de la location plutôt que de vendre un produit neuf qui s’avère inutile en cas d’usage ponctuel. Une troisième voie consiste à vendre de la seconde vie. C’est du bon sens !
Je pense que par nos modes d’habiter, nous pouvons être régénératifs, avoir des impacts positifs et non détruire. Leroy Merlin devra rendre cet habitat accessible par une politique de prix, des solutions de financement, une pédagogie essentielle et un programme de fidélité. Nous veillerons toujours à fluidifier le parcours du client, pour que les nouvelles solutions proposées et les nouvelles façons de consommer soient aussi simples que les anciennes. Claires comme de l’eau de roche. »
25
la lutte contre la précarité énergétique
Témoignage de
Franck Billeau, fondateur de Réseau
Éco Habitat :
« J’ai fondé Réseau Éco Habitat en 2014 à Compiègne, dans la région Hauts-de-France.
L’association Stop à l’exclusion énergétique a repris le même principe, mais à l’échelle nationale.
Avant de créer l’association, alors que je travaillais au Secours catholique, j’ai fait construire ma maison en ossature bois. C’est une maison normale, carrée, bien orientée, située dans un lotissement en périurbain, composée uniquement de matériaux respirants qui régulent l’humidité, stockent la chaleur et offrent une parfaite isolation thermique. C’est une maison quasiment passive ou bioclimatique qui ne
consomme que cent euros de chauffage à l’année, c’est-à-dire deux stères de bois par an. J’ai alors pris conscience qu’un quart des dons du Secours catholique servait à payer des factures d’énergie très élevées, pour des personnes dont on ne réglait pas les problèmes de surconsommation d’énergie, de santé, de budget… sans mentionner l’empreinte carbone de leurs habitations, des passoires énergétiques. J’ai donc voulu m’attaquer à cette précarité énergétique. Comme je l’ai fait dans ma propre maison, l’idée est d’utiliser ce qu’il y a de mieux – des matériaux biosourcés – pour ceux qui n’en ont pas les moyens.
Leroy Merlin s’est tout de suite intéressé à mon projet et une équipe de chez eux a même visité ma maison. Après cela, l’offre de matériaux biosourcés du magasin de Compiègne s’est étoffée !
l ’ HABITAT 26
Ouate de cellulose, fibre de bois, Fermacell (c’est-à-dire une plaque de plâtre à base de gypse)… Selon moi, l’action de Leroy Merlin est une vraie innovation sociale. Car à travers le sujet de la précarité énergétique, ils ont été parmi les premiers à proposer des solutions d’avenir à un public très précaire, invisible, qui ne fréquente même pas leurs magasins. Notre partenariat avec Leroy Merlin s’inscrit sur le long terme, non seulement pour apporter des solutions de financement via leur fondation, pour soutenir l’association ou régler le reste à charge des familles, mais aussi pour proposer des matériaux afin de répondre massivement aux chantiers de rénovation énergétique. Réussir ce type de travaux chez des personnes en grande précarité, dans des logements très dégradés, cela peut encourager un public beaucoup plus large. La rénovation énergétique est un enjeu majeur, que ce soit pour les périodes de grand froid ou de canicule ; au vu du coût de l’énergie et du dérèglement climatique, on risque de mourir chez soi si l’on ne fait rien, autant de chaud que de froid parce qu’on ne peut plus chauffer.
Il y a en France un peu plus de propriétaires que de locataires, parmi lesquels des propriétaires pauvres vivant dans un logement dégradé mais qui croient n’avoir droit à rien, du fait d’être propriétaires. Ils ont honte et peur, peur qu’on leur retire leurs enfants ou de se retrouver de force dans un Ehpad si l’on découvre leur logement… Nos bénévoles accompagnant les ménages tissent des liens de fraternité qui durent bien au-delà du temps du chantier ; par exemple Pierre, qui est chasseur, continue d’apporter de temps en temps un petit cuissot de chevreuil aux personnes qu’il a aidées. Ce
qui est formidable, c’est de voir combien sortir de la précarité énergétique enclenche un cercle vertueux vers l’emploi, l’intégration sociale et la santé. Je pense à une dame devenue maire adjointe aux affaires sociales de sa commune, à un bachelier qui a vécu son année de terminale dans de meilleures conditions et rendu fier son père, à ceux qui n’ont plus besoin d’assistance respiratoire à domicile parce qu’ils n’ont plus d’asthme, à une mère heureuse de voir sa grande revenir régulièrement à la maison pour prendre une douche chaude… Tous ces récits de vie rapportés par les bénévoles nous donnent confiance et espoir en l’avenir. »
Témoignage de Bernard saincy, président de stop à l’exclusion énergétique :
« Stop à l’exclusion énergétique est une association créée en 2020 qui fédère soixante organisations, des associations caritatives jusqu’à de grandes entreprises, pour accompagner et mettre en œuvre la rénovation de l’habitat de familles en grande précarité énergétique, une situation qui touche douze millions de personnes en France. Quelques définitions s’imposent :
La grande précarité désigne les ménages ayant des revenus inférieurs au plafond des ressources très modestes défini par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Parmi ces très modestes, 50 % sont de grands précaires, pour beaucoup propriétaires occupants, habitant une passoire thermique.
Une passoire thermique est un logement qui consomme plus de 350 kWh au mètre carré, donc très énergivore, ce qui se caractérise par de nombreuses fuites au niveau de la toiture et des menuiseries. Il en résulte une mauvaise atmosphère intérieure en termes de froid, d’humidité et de moisissure. Un tel habitat peut basculer en situation d’insalubrité.
Pour sortir de l’insalubrité et/ou rendre le logement plus performant, il faut faire le plus souvent une rénovation globale : toiture, isolation des murs, changement de système de chauffage, mise en place d’une ventilation, etc. Il faut savoir que l’essentiel de la déperdition énergétique se concentre au niveau de
la toiture (40 %) ; viennent ensuite les murs (30 %), les menuiseries (15 %) et pour le reste, le plancher bas.
Nous agissons en suivant un parcours de rénovation en cinq étapes :
L’identification des familles
Soit les services sociaux repèrent des familles en grande difficulté et nous les signalent ; soit ce sont les bénévoles d’associations qui les détectent, telles qu’ATD Quart monde, le Secours catholique, la fondation Abbé-Pierre.
La construction du projet
Il est indispensable que la famille participe à la définition du projet. Repenser les pièces de la maison par exemple, parce que des cloisons ont été abîmées par les moisissures et doivent être abattues, ne peut se faire sans recueillir les souhaits de la famille.
Pendant cette phase, nous demandons aussi des devis à des artisans afin de prévoir l’enveloppe à financer.
La recherche de financement
Nous cherchons toutes les aides dont pourrait bénéficier le ménage en fonction de ses revenus. La plupart du temps, les personnes ignorent leurs droits. Il s’agit de monter avec elles un dossier de demande d’aide à l’Anah, de solliciter le Département, la Région, la collectivité territoriale, des groupes de protection sociale, des fondations… En moyenne, une rénovation globale coûte un peu plus de 70 000 euros au total. En mobilisant toutes les aides disponibles, on arrive généralement à financer 90 % des travaux. Il reste 10 % à charge,
l ’ HABITAT 28
et pour une famille dont le revenu ne dépasse pas 16 000 euros par an, trouver 7 000 euros est mission impossible. Nous cherchons donc des financements complémentaires auprès de groupes comme Leroy Merlin, AG2R La Mondiale, Schneider Electric, GRDF, Enedis, Saint-Gobain… Il est important de préserver un reste à charge pour la dignité des familles, même symbolique, pour qu’elles contribuent à la rénovation de leur maison et puissent s’en féliciter.
Le suivi des travaux et la vérification de la qualité
Des opérateurs de chantier assurent le suivi des travaux et la coordination des artisans ; par exemple les associations Dorémi, les Compagnons bâtisseurs, Soliha, Réseau Éco
Habitat… La plupart du temps, le chantier dure environ deux mois et les familles sont relogées.
L’accompagnement de la famille après le chantier
Après la livraison du chantier, une formation est nécessaire pour sensibiliser les habitants aux éco-gestes et optimiser l’efficacité énergétique. Il faut apprendre à utiliser les radiateurs, les thermostats, la pompe à chaleur… Il faut aussi désapprendre ! Les études prouvent qu’au début les familles continuent à ouvrir les fenêtres en cas de chaleur, à faire des trous aux murs pour accrocher des tableaux, ce qui crée des ponts thermiques.
L’accompagnement de la famille n’est pas seulement technique, il est aussi social et financier. Car le problème de l’habitat ne constitue en général qu’une facette d’un ensemble de problèmes. Ces personnes en grande pauvreté
se caractérisent notamment par le non-recours aux aides sociales, des liens sociaux très faibles… La rénovation de l’habitat entraîne des conséquences heureuses que l’on appelle les “externalités positives”. En effet, on observe souvent un retour à l’emploi des personnes en âge d’être actives, de meilleurs résultats scolaires des enfants, un retour de la famille au sein du voisinage, une amélioration de l’état de santé car souvent, l’humidité et le froid des passoires énergétiques induisent des maladies respiratoires. La famille autrefois repliée sur elle-même recrée du lien social et reprend vie.
Leroy Merlin intervient dans ce parcours de plusieurs façons :
- le financement du reste à charge des familles en grande difficulté ;
- l’établissement de conventions avec les opérateurs pour fournir des matériaux à prix coûtant, ce qui permet de réduire le coût de ces très gros chantiers ;
- la prise en charge des finitions (peinture, rideaux, etc.), qui comptent beaucoup pour les familles ;
- la co-création de la “fresque de la précarité énergétique”, un outil de sensibilisation destiné aux collectivités territoriales, associations et entreprises ;
- l’accompagnement des territoires “Zéro exclusion énergétique” comme zones d’accélération de chantiers d’ampleur pour les ménages les plus modestes. »
29
tiny house, la chaumière de demain
« Nous avons chacun nos heures de chaumières et nos heures de palais. » La poésie de Gaston Bachelard saisit ainsi, en une phrase, la large palette de nos instincts en matière d’habitat. Des envies aujourd’hui paradoxales : nous avons pris l’habitude d’être gourmands en espace et pourtant nous mesurons plus que jamais à quel point, demain, la sobriété sera aussi spatiale. Comme l’écrit l’essayiste Mona Chollet, “la tiny house est un rêve de chaumière”, un petit espace avec un plus faible impact carbone, où l’on vit bien, sur un terrain agréable. Réduire l’espace, c’est aussi densifier l’habitat ; serait-ce la solution de demain ? Yannick Perrin-Terrin, responsable des relations clients au magasin Leroy Merlin de Pleurtuit-Dinard, nous parle de ce phénomène né aux États-Unis
et de son expérimentation : « La tiny house est un habitat éco-responsable de format réduit. À l’origine en auto-construction, c’est une maison sur remorque, que l’on peut enlever en principe, donc à la fois nomade et sédentaire, ce qui diffère d’un mobil-home. Aussi, contrairement à la caravane, on utilise pour la construire et l’isoler des matériaux les plus écologiques possibles. C’est un mode de vie simple, vraiment réduit à l’essentiel, en général pour des personnes très attachées à l’écologie, avec par exemple des toilettes sèches.
Vue de l’extérieur, la maison peut paraître très petite, mais tout est optimisé pour qu’à l’intérieur, ce soit quand même un espace de vie très confortable.
l ’ HABITAT 30
En 2017, nous avons réalisé un projet de tiny house de A à Z dans le magasin de Dinard. Nous nous sommes formés chez Baluchon, une petite société du côté de Nantes, qui nous a fourni les plans. Puis pendant neuf mois, tous les mardis et les jeudis, nous avons fabriqué la maison en faisant intervenir nos formateurs de cours de bricolage et tous ceux qui étaient intéressés. Nous proposions ainsi de l’apprentissage, dans une démarche pédagogique, car chacun pouvait participer à une ou plusieurs étapes, y passer le temps souhaité et peut-être ensuite se lancer dans de l’auto-construction. Le fait que la maison repose sur une remorque limite le poids, donc nous avons pesé tous les matériaux et opté principalement pour du bois afin d’alléger au maximum.
Certains clients venaient de très loin juste pour voir une étape, par exemple l’isolation à la fibre de bois, ou tout simplement pour voir l’agencement et apprendre la menuiserie. Au-delà de l’attrait économique de ce type de construction, ce qui faisait rêver, c’était l’idée d’habiter en pleine nature. La tiny house nous rappelle la cabane de l’enfance. Cela a été l’occasion de rencontres, d’échanges enrichissants entre les participants. Je me souviens de Pierre, charpentier naval à la retraite, qui a participé quasiment du début à la fin. Il a partagé son savoir-faire avec nos formateurs et d’autres personnes, dont des clients devenus des copains. Laurent, pilote d’avion, a par exemple permis à Pierre de faire un baptême de l’air. »
31
« nous avons chacun nos heures de chaumières et nos heures de palais. »
l ’ HABITAT 32

33
Illustration Andréa Mongia.
L ’ habitat de demain ou l ’ enjeu de la solidarité
l ’ HABITAT 34
Démocratiser un habitat digne, en particulier rendre la rénovation énergétique accessible aux plus démunis, tel est le pari solidaire de Leroy Merlin, dont Nicolas Cordier se fait le porte-parole depuis plus de dix ans. Explications.
« Qu’est-ce qui fait que Leroy Merlin existera encore dans vingt ans ? Je pense que la réponse est liée à notre utilité : construire un habitat digne pour tous, y compris pour ceux qui ne sont pas clients de nos magasins, lutter contre l’exclusion énergétique dont nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne. Cela dit, il ne s’agit pas d’une activité philanthropique en marge du business, mais bien d’une manière d’exercer notre métier différemment, en apportant des solutions aux personnes en grande précarité. Si la finalité n’est pas d’abord l’argent, cela repose cependant sur un modèle économique équilibré.
35
« trois millions d’euros financés par leroy merlin, c’est permettre de boucler
600 travaux de rénovation énergétique de familles très modestes. »
Depuis 2016, nous avons mis en place un dispositif que l’on appelle “achats solidaires”. Il permet à des associations qui luttent pour améliorer les conditions de logement de personnes en précarité de réaliser leurs achats chez nous, dans un magasin avec lequel elles signent un partenariat, et de récupérer chaque trimestre 100 % de la marge générée. Historiquement, ces associations avaient leurs habitudes d’achat dans des réseaux professionnels.
Or c’est un moyen très concret d’obtenir un levier de financement supplémentaire pour financer leurs frais de structure. Aujourd’hui, nous comptons 230 partenariats de ce type. Nous incluons aussi nos clients, de plus en plus des citoyens engagés, dans la solidarité. À travers l’arrondi en caisse, ils peuvent soutenir nos associations partenaires et dégager un financement supplémentaire significatif. Au cœur de nos opérations de chauffage, nous leur disons notre mobilisation contre la précarité énergétique en abondant le fonds de Stop à l’exclusion énergétique pour financer le reste à charge de familles en précarité. Nous avons ainsi versé un million d’euros en 2022 et en 2023, un budget reconduit en 2024. Trois millions d’euros, c’est permettre de boucler le budget de 600 travaux de rénovation énergétique de familles très modestes.
Aller jusqu’au bout des travaux est également l’une de nos missions. Car les finitions ne sont jamais prises en compte par les financements publics et privés de la rénovation énergétique. Ils financent globalement l’isolation, la ventilation et le chauffage, et après, vous avez des plaques de placo sans enduit, les saignées visibles d’une électricité refaite. Là aussi, nous
avons un rôle à jouer : certains collaborateurs font le choix, une journée par an, de participer à ces chantiers de finition. Cette journée payée par l’entreprise au service du monde associatif s’appelle Positive Impact Day.
Enfin, pour sensibiliser l’ensemble des parties prenantes – habitants, collaborateurs Leroy Merlin, bénévoles d’associations caritatives, opérateurs – nous développons la “fresque de la précarité énergétique”. Cet outil permet d’initier un vrai changement de mentalité. Je suis persuadé que d’ici vingt à trente ans, les entreprises qui garderont la préférence des clients seront celles qui auront apporté la preuve de leur utilité, dans une perspective de progrès social et écologique. »
37
La légèreté durable de l’habitat
Un habitat capable non seulement de neutraliser son empreinte carbone, mais aussi de l’améliorer et de produire sa propre énergie ?
Ce n’est pas un vœu pieux, c’est l’avenir. Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif chez Leroy Merlin, nous explique :
« Demain, l’habitat sera durable pour l’environnement, meilleur pour la santé des Français, mais aussi confortable, décoré à notre image.
Ce chez-soi où l’on aime recevoir va bien au-delà du durable. Ses bénéfices réparent à la fois ses habitants, la planète et la société.
l ’ HABITAT 38
La maison est un lieu très important dans la vie de chacun, essentiel pour bien vivre, fabuleux à plein d’égards et chargé d’émotion. Cela dit, elle est aussi une source de nuisance sur de nombreux sujets. L’usage des bâtiments représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre ; si l’on ajoute la construction, cela représente 40 %. Il y a aussi la pollution des sols, les impacts sur la santé, la production de déchets, la consommation d’eau… La première étape d’un habitat durable consiste donc à réduire ces impacts négatifs – réduire les consommations d’énergie et d’eau. Deuxième étape, il faut réussir à être neutre, ce qui signifie zéro impact, ni positif ni négatif. Il s’agit donc de produire l’énergie que l’on consomme, de ne plus avoir de déchets, etc. En construction neuve, ces bâtiments passifs existent déjà, dans plusieurs pays d’ailleurs. Troisième étape, le graal qui paraît fou aujourd’hui mais qui résoudra nos problèmes : nous devons aller vers un habitat régénératif. Que chacun régénère le vivant, partout. Une entreprise par exemple peut utiliser ses propres terrains pour recréer de la biodiversité ou générer une électricité qu’elle reverse à la collectivité… Dans une maison, il est aussi possible de générer plus d’électricité que l’on n’en consomme, de collecter plus d’eau que celle utilisée, de remettre du vivant dans les jardins. Pour l’instant, ce type d’habitat est assez méconnu, mais nous devons dès aujourd’hui décrypter et préparer cet avenir. En tant que leader, c’est la responsabilité de Leroy Merlin. »
39
« ce chez-soi où l’on aime recevoir va bien au-delà du durable.
ses bénéfices réparent à la fois ses habitants, la planète et la société. »
l ’ HABITAT 40

41
Illustration Andréa Mongia.
La décarbonation, tête de proue de l’habitat de demain
Réduire les émissions de carbone, vaste projet. C’est l’un des défis à relever dès aujourd’hui pour pouvoir habiter demain, parmi d’autres enjeux liés aux limites planétaires. Leroy Merlin le place en tête de ses priorités, comme l’explique Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif : « L’urgence absolue, au niveau collectif et mondial, est le carbone. Leroy Merlin a pris l’engagement de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, pour respecter les accords de Paris vers un monde à + 1,5 °C. Notre empreinte
carbone est liée à 90 % à nos produits, sur l’ensemble de leur cycle de vie, de l’extraction de matière à la fin de vie, en passant par la fabrication et l’usage. Nous travaillons très fortement là-dessus, même si sur ce sujet de la décarbonation, nous sommes entièrement dépendants de nos fournisseurs, dont la plupart sont des PME ou des TPE n’ayant pas les moyens de devenir des experts en carbone. Notre responsabilité est de les accompagner. »
En charge du commerce responsable chez Leroy Merlin, Claire Beauvais précise :
l ’ HABITAT 42
« Être le plus économe possible en ressources à chaque étape de vie d’un produit, c’est ainsi que l’Ademe définit l’économie circulaire. Nos produits sont fabriqués pour une majeure partie à partir de matériaux non renouvelables. D’où l’importance de ce que nous appelons “l’éco-conception”. Nous explorons déjà des pistes toutes simples pour économiser la matière, par exemple réduire l’épaisseur des carrelages ou des parois de douche. Cela ne les rend pas moins solides, la qualité est identique et c’est un gain de matière qui réduit l’empreinte carbone du produit. De très nombreux produits sont concernés. Une autre manière de décarboner le commerce consiste à prolonger au maximum la durée de vie des produits. Si l’on observe par exemple le marché de la seconde main dans l’habillement, on constate qu’il a énormément changé en l’espace de cinq ans seulement. J’ai l’intuition que le marché de l’habitat peut vivre une évolution similaire, à condition que l’on fasse de la pédagogie, en mettant en avant l’impact environnemental de telle ou telle solution, de même que son impact économique. Car la raréfaction de la matière va créer de l’inflation sur les prix d’achat, donc l’usage deviendra vraiment une alternative économique intéressante. Sur certaines familles de produits, je pense que la location peut facilement entrer dans les mœurs, parce que les utilisations sont ponctuelles. On utilise une perceuse dix minutes en moyenne au cours de toute une vie, pourquoi alors la posséder ? »
43
« on utilise une perceuse dix minutes en moyenne au cours de toute une vie, pourquoi alors la posséder ? »
Chapitre 44
À la préservation des ressources s’ajoute la préservation de l’eau, dans une perspective d’habitat durable voire régénératif. Les problèmes d’eau sont la traduction du dérèglement climatique dans le quotidien de chacun. Marie Simunic, directrice générale déléguée en charge des marchés et de l’offre, nous explique en quoi consiste le défi de l’eau : « Nous avons sollicité l’hydrologue Emma Haziza qui nous renseigne sur notre rôle autour de l’eau. D’abord, il faut éviter au maximum de consommer l’eau des nappes phréatiques. Cela se traduit chez Leroy Merlin par de l’innovation, notamment pour perfectionner la récupération de l’eau de pluie afin de la filtrer et de l’utiliser, ou encore pour produire de l’eau à partir de l’air ambiant, grâce à une machine que nous testons actuellement dans nos bureaux. Le deuxième enjeu concerne les eaux grises. Partout dans la maison où l’on n’a pas besoin d’eau potable, il s’agit de récupérer les eaux grises et de les utiliser, par exemple dans les toilettes ou pour arroser le jardin. Troisième sujet : l’économie d’eau à travers diverses technologies, par exemple dans la robinetterie. Quatrièmement, il faut se prémunir contre le risque d’inondation. Il existe par exemple des “batardeaux”, des plaques isolantes qui empêchent l’eau d’entrer dans la maison et que l’on installe contre les portes et parois quand on sait que le risque d’inondation arrive pour bloquer l’eau. Il s’agit aussi de développer des solutions pour hydrater quand même le sol par microgouttelettes, pour diminuer le risque d’inondation. Car un sol trop sec ne peut absorber la pluie. »
En effet, un sol qui ne respire pas ne permet pas à l’eau de s’évacuer et lorsque cet empê-
chement est provoqué par le béton, le risque climatique se double d’une menace pour la biodiversité. L’intégrité de la biosphère est une limite planétaire atteinte puisque la sixième extinction de masse a déjà commencé. Agathe Ruckebusch partage sa vision de la biodiversité : « Le vivant se meurt. On dérègle tellement la planète que les espèces végétales et animales n’ont le temps ni de se renouveler ni de s’adapter aux nouvelles conditions, et donc disparaissent. On entend souvent qu’il y a eu plusieurs précédents dans l’histoire de la planète : oui, mais jamais aussi rapidement, sur moins de cent ans. La chaîne de vie étant déréglée pour tous, cela crée des problèmes de ressources et d’alimentation très graves y compris pour l’espèce humaine. Parmi les neuf limites planétaires, bien sûr le climat joue sur la biodiversité, mais aussi l’eau et la déforestation. Il est donc primordial que Leroy Merlin contribue à préserver l’eau et les forêts. La biodiversité souffre aussi de l’artificialisation des sols : la nature a de moins en moins de place, du fait des villes, mais aussi des magasins et des parkings qui nous concernent directement. Avec la loi ZAN (zéro artificialisation nette), pour construire, il faudra déconstruire. Je pense que cette révolution de l’immobilier va sonner le glas de la propriété individuelle. C’est le sens de l’histoire de densifier les villes, vivre localement, avoir des espaces partagés entre habitants, moins utiliser l’automobile, préserver nos campagnes et nos forêts. Arrêter de goudronner les allées est un bon exemple de changement à opérer pour laisser passer l’eau. Dans tous les cas, il faut de la pédagogie car la biodiversité est un sujet diffus, indirect, donc complexe. »
45
Qu’est-ce que le commerce durable dans l’habitat ?
Le métier de commerçant et de grand distributeur dans le secteur de l’habitat n’est plus soutenable en raison de la fabrication de produits neufs. Comment la transformation s’opère-telle ? Comment Leroy Merlin peut-il réduire l’empreinte de son métier historique ? Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif, explique sa vision : « Nous amorçons dès aujourd’hui la réduction de notre impact sur l’environnement, mais ce n’est pas suffisant. Demain, Leroy Merlin basculera vers des modèles économiques rentables et soutenables. Il faudra sans doute des années avant de trouver le bon équilibre, même s’il existe déjà des pistes vraiment prometteuses.
l ’ HABITAT 46
Il s’agit de réconcilier les besoins de nos clients et une empreinte environnementale nettement moindre que celle des produits neufs vendus de façon volumique. Car aujourd’hui nous réalisons qu’il est inutile de posséder individuellement tout ce que nous utilisons. D’où l’idée de proposer des alternatives au besoin de neuf. Du point de vue de l’entreprise, cela signifie que nous devons accepter la rentabilité à long terme : au lieu de vendre le produit, nous vendons son bénéfice à un client qui, lui, accepte de ne pas le posséder. Une économie verte repose donc sur la fonctionnalité et l’usage. Nous vendrons – et cela se fait déjà pour certaines catégories – l’utilisation d’une tondeuse, d’une perceuse, d’une alarme, plutôt que le produit lui-même, via la location ou l’abonnement, à l’année, au mois ou à la semaine. Cela peut aussi consister à fournir par exemple une machine à laver, de la lessive, tant de kilos de linge lavé, et à prendre en charge l’entretien de la machine. Et si l’on poursuit ce but, on peut réduire très fortement les impacts négatifs, voire aller vers une économie régénérative en développant également des impacts positifs pour le vivant : notre activité aura alors un impact positif plus important que son impact négatif. »
47
LA CUI s INE, DE L ’ OMBRE À LA LUMIÈRE
Histoire
Une pièce
« rétrofuturiste »
De la cheminée de la salle commune du monde paysan aux cuisines des châteaux et monastères, de la cuisine bourgeoise fief des domestiques à la cuisine fonctionnelle des logements pour ouvriers, la cuisine se transforme. C’est la pièce qui cerne le mieux la société française à travers les âges, entre tradition et modernité, entre ouverture et fermeture, entre ordre et désordre, entre famille et individu¹.

la cuisine 50
« La cuisine claire et gaie », Maggy Monier, illustratrice, Les Dimanches de la femme, 26 novembre 1922. CCO.
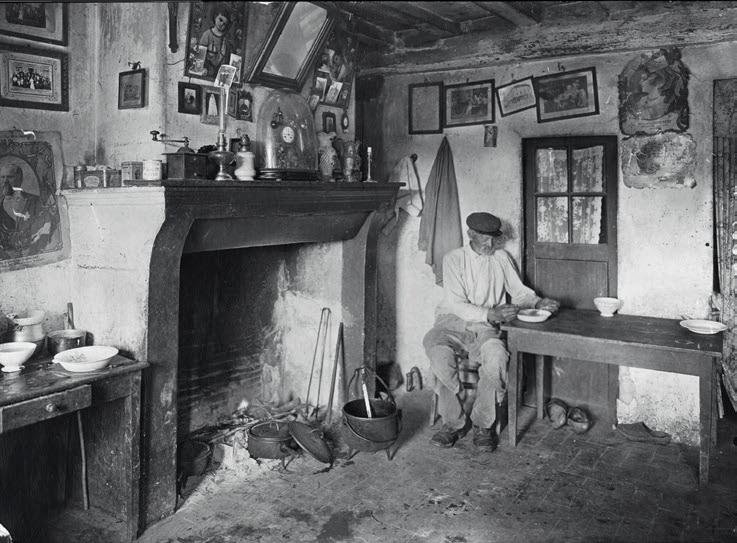
Paysan à table dans son intérieur, Épieds, Aisne, vers 1914. Photographie ministère de la Culture, médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. GrandPalaisRmn / Opérateur Z.
Moyen Âge rime avec stockage. En raison des famines, l’espace consacré au stockage des denrées alimentaires et à la cuisine dépasse parfois largement celui réservé au logement.
Des cuisines frontières entre ville et campagne
Dans une maison paysanne de deux pièces, l’une abrite un coin cuisine, l’autre sert de cellier où l’on stocke des tonneaux, des sacs de céréales, des huiles, des vins, des fruits. L’apparition de la notion d’intimité au xviiie siècle fait évoluer l’habitat français et la cuisine. Avec le déclin de la vie de cour, les nobles découvrent le plaisir de vivre chez eux, en famille. Avoir plusieurs espaces dédiés à la cuisine
devient signe de luxe, d’où l’emploi du pluriel –on parle « des cuisines » des châteaux. Dans les classes populaires, en revanche, on improvise la cuisine dans n’importe quelle pièce qui comporte une cheminée. Chez les bourgeois, la cuisine est reléguée au fond des appartements ou des maisons où s’affaire la domesticité. C’est là que s’élabore la traditionnelle cuisine française. À l’ère industrielle, les cuisines se démocratisent. Au xixe siècle, en ville, c’est souvent une petite pièce donnant sur cour, comprenant un fourneau et un sol spécifique. Les mêmes principes guident la conception des cuisines dans les appartements bourgeois, notamment à Paris. Une nette partition des espaces sépare les maîtres et les domestiques : la cuisine est reliée d’un côté par un long couloir de service à la salle à manger, de l’autre à un escalier de service qui dessert la cave, la cour de service et les chambres de bonne. Un office attenant réunit une table à découper, une fontaine ou un évier (avec l’apparition de l’eau courante) et un vaisselier.
51
C’est dans cette annexe que les enfants en bas âge et les domestiques prennent leurs repas. La cuisine blanche étincelante naît au début du xxe siècle. Trois évolutions modernisent la pièce. Premièrement, les nouveaux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité (il faut attendre les années 1950 pour que les campagnes soient également raccordées). Ensuite, l’hygiénisme transforme les habitudes en termes de matériaux – carrelage émaillé et peinture brillante – et de nettoyage. On passe de l’époussetage qui soulève la poussière au lavage à l’eau et à l’éponge. Enfin, le taylorisme issu de l’industrie américaine s’introduit dans l’espace domestique. Dès le milieu du xixe siècle, Catherine Beecher étudie la rationalisation du travail de la ménagère avec le souci d’optimiser ses efforts, ce qui se traduira par exemple par l’apparition de l’îlot central dans les cuisines américaines.
En France, le logement social serait-il précurseur de l’innovation dans la pièce ? C’est en effet dans les ancêtres des HLM, les habitations bon marché (HBM) destinées aux ouvriers et aux petits employés, qu’apparaissent les premières cuisines ouvertes et la cuisine équipée que nous connaissons aujourd’hui. L’architecte Auguste Labussière conçoit vers 1905 trois types de pièces selon le public visé : une vaste cuisine-salle à manger pour ceux fraîchement arrivés de la campagne, habitués à la salle
commune ; une cuisine en alcôve parfois derrière des portes ou un rideau pour ceux acclimatés à la vie urbaine ; une petite cuisine séparée sur le modèle bourgeois pour les employés. La sociologue spécialiste de l’habitat Monique Eleb résumait ainsi ces transformations décisives de la pièce : « Dans la cuisine cachée au fond de l’appartement, les objets étaient mobiles, ustensiles posés n’importe où et meubles placés au hasard. Au début du xxe siècle, ils se fixent et, raccordés aux réseaux, deviennent des “équipements”. Ce qui n’est pas une mince révolution puisque la fixité des canalisations commande désormais toute l’organisation de l’habitation². ».
La promotion de la technique dans l’entre-deux-guerres
C’est dans les ancêtres des HLM qu’apparaissent les premières cuisines ouvertes et la cuisine équipée.
Préparer, cuisiner, laver-ranger. La cuisine se conçoit désormais autour de ce « triangle d’activités », trois fonctions encore en vigueur aujourd’hui dans la conception de la pièce. Il faut alors rationaliser l’espace, soulager la ménagère en diminuant le nombre de ses pas. Car, avec la disparition progressive des domestiques à demeure, le rôle de la femme évolue. La maîtresse de maison prend la responsabilité de la cuisine et le ménage devient une science, théorisée en France par Paulette Bernège qui importe les idées américaines d’organisation du travail et analyse la gestuelle. La ménagère intéresse donc les architectes, comme le montrent ces trois innovations devenues des cas d’école : 1. La cuisine du Bauhaus marque les esprits en 1923. La fameuse école d’arts appliqués de Weimar, en Allemagne, présente alors une maison prototype – la Haus am Horn – entièrement aménagée pour les classes populaires. Confort
la cuisine 52

Intérieur de cuisine d’une concierge à Paris, 1936. Photographie Willem van de Poll. Nationaal Archief, CCO.
Cuisine entièrement électrifiée, vers 1930, appartement Auguste Perret. Photographie André Kertész.

53
et économie sont les maîtres-mots d’une cuisine moderne, d’une grande simplicité, comparée par ses détracteurs à une salle d’opération. C’est en fait le début des normes fonctionnelles et ergonomiques : une surface continue devant la fenêtre (plan de travail), des surfaces lisses et faciles à entretenir, des placards aux portes coulissantes.
2. La cuisine de Francfort pourrait être l’idéal des célibataires. Elle est créée par Margarete Schütte-Lihotzky en 1926 dans la ville nouvelle allemande de Römerstadt, pour le logement social ouvrier. Ce modèle de cuisine-laboratoire connaîtra un succès mondial. On y travaille debout, dans une pièce de 6,27 m2 où la concentration spatiale des tâches doit permettre de gagner du temps, en partant du principe qu’elles sont accomplies par une seule personne. On y trouve un radiateur, une cuisinière avec hotte, une porte coulissante donnant sur la pièce repas, une planche à repasser rabattable, un garde-manger, un plan de travail en bois dans lequel s’encastre un tiroir pour récupérer des épluchures et sous lequel se range un tabouret peu confortable à trois pieds et à roulettes, un évier à double bac en béton préfabriqué, un égouttoir, de nombreux rangements en hauteur, des tiroirs en métal pour le vrac (farine, riz, etc.), un placard pour la poubelle, un placard à balais.
3. La cuisine intégrée de Louis-Herman De Koninck est, quant à elle, l’ancêtre de nos cuisines standardisées. L’architecte belge présente au Congrès international de l’architecture moderne (Ciam) de Bruxelles en 1931 une cuisine rationnelle, inspirée de travaux sur la pénibilité domestique, avec les premiers éléments standardisés de 60 × 60 cm. Jusque-là, il n’existait
pas de normes pour dimensionner l’équipement électroménager. L’architecte s’associe donc à plusieurs fabricants pour instaurer cette norme de 60 cm qui va bientôt s’imposer à toute l’industrie. À partir de 1932 et pendant plusieurs décennies, cette cuisine sera commercialisée sous le nom de Cubex.
Ces innovations sont encore loin de gagner la France entière. Dans les années 1930, la notion de confort est balbutiante et l’eau courante reste une exception. L’enseigne Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) poursuit cependant son entreprise de démocratisation de l’habitat. Adolphe Leroy, en plus des surplus américains, se porte acquéreur de produits de faillites d’usines, de fins de séries, d’invendus et d’articles déclassés. Il parvient par exemple à obtenir des lots d’éviers, « céramiques d’Aire-surla-Lys », qu’il revend à prix cassés. Le succès est retentissant parmi les ouvriers et les mineurs qui accèdent ainsi à cet objet symbole de confort et de luxe, jusque-là réservé aux classes aisées.
Les Trente
Glorieuses, la cuisine fonctionnelle et rationnelle
Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des foyers utilisent encore un placard aéré sous la fenêtre en guise de garde-manger. Le réfrigérateur domestique se diffuse lentement ; l’électroménager en général devient désirable, à mesure que grandit le culte du confort, et symbolise les espoirs de libération de la femme. Pourtant, dans les années 1950, le pourcentage de femmes au foyer atteint un record historique. Dans ce contexte de reconstruction, l’habitat des classes aisées se rapproche de celui des classes moyennes et populaires.
la cuisine 54


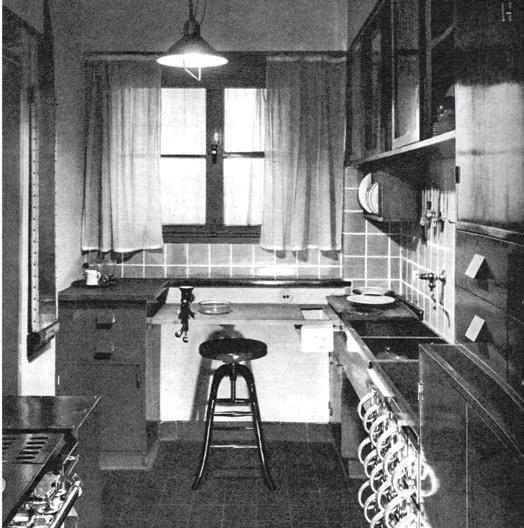
55
1. La cuisine du Bauhaus de la Haus am Horn à Weimar, Allemagne. Photographie de Martin Schutt / dpa / Alamy Live News.
2. La cuisine de Francfort, 1926. CCO.
3. La cuisine intégrée (Cubex) en situation, 1932. Photographie Alamy.
Autrement dit, on assiste à une unification de la cuisine en termes de forme et de surface : elle est bien souvent conçue pour une seule personne, des célibataires parfois, le plus souvent des ménagères.
La pièce se rapproche du séjour, près de l’entrée, et sa surface est diminuée. Alors que la cuisine paysanne continue de s’organiser autour d’une table, en ville la table est supprimée pour fluidifier la circulation. La salle à manger disparaît peu à peu au profit d’un coin repas dans le séjour. Une nouvelle tendance dans les logements neufs consiste à ouvrir la cuisine sur le séjour via un passe-plat ou un bar, même si les Français préfèrent, à cette époque et même encore aujourd’hui³, une cuisine fermée⁴ où l’on peut prendre ses repas.
Et si la ménagère, grâce à un agencement bien pensé, cessait de faire les cent pas dans sa cuisine ? C’est en partant de l’idée que le rangement est prioritaire, qu’il fait gagner de la place mais aussi du temps à la ménagère, que Charlotte Perriand imagine, en 1950, la cuisine pour les habitations de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. Dans cette cuisine de poche de 4,8 m2, tout est à portée de main : il suffit à la ménagère de pivoter sur elle-même pour accéder à tous les équipements. Recouverte de linoléum au sol et dotée d’un plan de travail en U en aluminium, elle est très facile à entretenir. Ouverte sur le séjour grâce à un meuble bar, cette cuisine permet à la ménagère de rester en contact avec ses amis et sa famille. Et elle a pour particularité, très rare à l’époque, de ne pas avoir de fenêtre : en étant ouverte sur le séjour, elle bénéficie d’une lumière « en second jour ». Cette cuisine, très fonctionnelle et ouverte, inspirera la cuisine des temps modernes.
À partir des années 1970, on peut noter quelques évolutions, principalement d’ordre esthétique : l’encastrement des équipements, la popularité du Formica, puis l’utilisation de bois massif dans les années 1980 ou encore d’acier inoxydable (inox). C’est de plus en plus une « pièce tendance » où les Français se distinguent par le soin qu’ils portent au décor. Cependant, même s’il évolue, l’espace change peu ; tous les ferments de la cuisine contemporaine existent déjà au cours des Trente Glorieuses et ce sont plutôt les pratiques qui évoluent. Comme d’autres boucles de l’histoire de l’habitat, au début du xxie siècle, un modèle ancien refait surface. Les Français plébiscitent la grande salle commune issue du monde rural, tout en y ajoutant le confort et la fonctionnalité de la cuisine laboratoire des années 1920. Cette salle commune rebaptisée « cuisine américaine » est une cuisine-pièce à vivre qui a du caractère, héritière des avancées technologiques, sociales et culinaires, et d’une conscience écoresponsable. Une cuisine rétrofuturiste en somme.
1 Source principale pour la rédaction de ce chapitre : Laetitia Vidal, En cuisine, État de l’art Leroy Merlin Source, 2021.
2 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
3 Monique Eleb et Philippe Simon, Le Logement contemporain – Entre confort, désir et normes, 1995-2012, Mardaga, 2013.
4 « Comment le Français veut-il être logé ? », Sciences et vie, hors-série « L’habitation », mars 1951.
la cuisine 56


57
Marcel Roux, cuisine polychrome, in Arts ménagers, octobre 1954. D.R.
La cuisine conçue par Charlotte Perriand pour la Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille 1950. ©Adagp, Paris 2024.

Feugerolles, 1953. Photographies Henri Salesse, médiathèque Terra.
Alors que la cuisine paysanne continue de s’organiser autour d’une table, en ville la table est supprimée pour fluidifier la circulation.

la cuisine 58
Chambon

59
Chambon Feugerolles, 1953. Photographies Henri Salesse, médiathèque Terra.
Usages d’aujourd’hui
Un monde miniature
retour de la table dans la cuisine pour prendre ses repas.
« En cent ans, la cuisine est passée de la pièce à cacher à la pièce à montrer et a remplacé, quand sa surface le permet, la salle à manger dans son rôle de rivale du séjour⁵. » D’une pièce fermée au regard extérieur, voire aux habitants euxmêmes si les domestiques l’occupaient, à un espace de réception et de représentation où l’on accueille les visiteurs, le statut de la cuisine a bien changé. Réflexions sur les usages en cuisine au xxie siècle.

la cuisine 60
Le
Photographie Leroy Merlin.

Cuisine semi-fermée par de simples étagères. Photographie Leroy Merlin.
ouverte ou fermée ? Aujourd’hui, le débat sur la délimitation de la pièce perdure et détermine sa place au sein du foyer.
L’âme du chez-soi
Lorsqu’il s’agit d’une cuisine fermée, c’est un lieu de vie plutôt centré sur la famille et la sphère privée, moins ouvert sur l’extérieur. Dans tous les cas, elle accueille des moments privilégiés : repas entre intimes – famille ou amis proches –, bureau de fortune pour les devoirs des enfants, réunion d’adolescents autour du réfrigérateur… La cuisine est décrite par ceux qui l’habitent comme l’une des pièces les plus chaleureuses, le pivot du chez-soi, le lieu de conversations intimes⁶.
Passage de relais
C’est aussi un fort lieu de transmission, parfois inconsciemment. Les valeurs d’une maisonnée se concentrent dans la cuisine et s’expriment
avant, pendant, après les repas. Le rapport à la nourriture, la nature des échanges à table, les savoir-faire culinaires, les éventuels rituels, la mémoire familiale et une infinité d’autres nuances propres à chacun se transmettent ici, des uns aux autres, en particulier des parents aux enfants.
La plaque tournante des repas
Chacun son rythme et son menu. La cuisine fédère des repas pris séparés et/ou ensemble. La sociologue Monique Eleb décrivait avec finesse l’évolution contemporaine du repas de famille : « La désynchronisation des activités de chacun, les pratiques culinaires et les façons de prendre les repas se multiplient : plateau-télé dans le salon voire dans la chambre, plats préparés réchauffés au micro-ondes et mangés sur un coin de table seul ou à plusieurs, repas de famille dans la cuisine – si sa surface le permet – ou dans un coin du séjour, et repas festifs du
61
week-end. Ainsi, les pratiques ne s’excluent pas mais au contraire s’additionnent. La cuisine et ses équipements, ainsi que le séjour sont structurés par ces pratiques. »
Le repas de famille est ainsi à la fois désacralisé, et sacralisé quand il advient, d’après le sociologue Jean-Claude Kaufmann : « Les repas pris encore en commun se chargent alors d’un rôle symbolique fédérateur de l’entité familiale qui s’est paradoxalement accru à mesure que se développait l’individualisation⁷. »
Tailler pour libérer l’espace
Quelle que soit la place accordée à la table, le défi actuel est le gain de place. Comme l’explique Christophe Sapena, designer chez Leroy Merlin, l’éco-conception des meubles ou la nécessaire réduction de leur empreinte carbone impose d’optimiser l’espace, tout en diminuant les dimensions. Le designer explique par exemple comment, pour la ligne de meubles Delinia, il a diminué la profondeur d’un caisson de 35 à 28 cm, ce qui est suffisant pour des assiettes de 24 à 26 cm de diamètre en moyenne. La hauteur en revanche est augmentée avec des meubles sur toute la hauteur, pour s’adapter à notre évolution morphologique. Cela répond aussi à une tendance « géométrique », car l’étalon en matière de design est aujourd’hui le rectangle vertical du smartphone, qui a remplacé le rectangle horizontal du 16/9e des années 1990. La cuisine s’aère autant que possible. Avec la fusion des deux pièces, les promoteurs et architectes tendent à réduire les espaces dédiés à la cuisine et au séjour. Une autre raison d’optimiser les dimensions des meubles, mais aussi de soigner ce que l’on choisit de montrer, aux
intimes comme aux visiteurs. D’où l’intégration d’étagères d’exposition qui sculptent l’ancien bloc fermé par une porte opaque. Les pratiques éco-responsables comme le vrac alimentaire transforment ainsi la cuisine en une épicerie fine, où l’on « expose » ses mets favoris. Cette tendance révèle une évolution esthétique de la pièce. L’importance qu’on accordait aux éléments eux-mêmes, c’est-à-dire le meuble, les finitions, les détails, l’électroménager dernier cri, se déplace vers l’essence de la cuisine : les aliments. Des pâtes achetées en vrac, une bouteille d’huile d’olive, une boîte de conserve d’exception… On est fier de montrer ce que l’on aime, ce qui est bon et beau.
La cuisine vit en fait une évolution anthropologique majeure. La satisfaction d’un besoin primaire – se nourrir – devient un accomplissement, une activité manuelle valorisée et valorisante. On cuisine certes par nécessité (tant mieux si c’est bon), mais aussi parce que c’est un moment convivial, un plaisir pour soi, en plus du partage avec les autres. Mieux manger, la cohérence entre le contenu de l’assiette et la préservation de l’environnement, renforce cette attention portée à la cuisine.
Ces quelques facettes disent combien la pièce est devenue centrale. Dépendante, aussi, des conditions matérielles et des valeurs de chacun. C’est un petit monde en soi, capable de ressourcer ceux qui y habitent, une bulle intime qui est en même temps perméable aux problématiques environnementales et sociales. Si la cuisine était un document, ce serait une sorte de passeport augmenté : on y lirait à la fois l’identité de ses habitants et la photographie de notre société.
5 Ibid 6 Ibid
7 Extrait de Laetitia Vidal, En cuisine, État de l’art Leroy Merlin Source, 2021, consultable sur leroymerlinsource.fr
la cuisine 62

63
Illustration Andréa Mongia.
zéro déchet ou comment fabriquer des produits à partir de déchets
Si le tri sélectif est entré dans les mœurs des Français pour le plastique, le papier et le verre, l’apprentissage est encore en cours concernant les déchets alimentaires, autrement dit le compost. Même si la pratique semble plus aisée en zone rurale, elle gagne les villes ; d’autant que le tri des déchets biodégradables est devenu partout obligatoire en janvier 2024. D’une manière générale, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Voilà la politique de l’habitat régénératif, zéro déchet, et l’ambition de demain pour les acteurs du secteur comme Leroy Merlin. Claire Beauvais, en charge du commerce responsable et de l’économie circulaire, évoque la gestion des déchets par l’entreprise : « Peut-être, comme moi, stockezvous plein de fonds de pots de peinture chez vous, dans votre garage ou à la cave.
la cuisine 64
Vous les gardez “au cas où”, si jamais vous deviez faire une petite retouche… Les années passent et vous ne le faites pas. Et tous ces pots entamés représentent une manne de matière à recycler, à condition que les industriels aient la capacité de refabriquer de la peinture nouvelle à partir de matière existante, ce qui n’est pas le cas pour tous aujourd’hui. L’enjeu pour nous consiste à capter chez les particuliers et les artisans ce gisement qui, autrement, finirait incinéré, et à le réinjecter auprès des acteurs pertinents. D’ailleurs nous possédons nous-mêmes un gisement de peinture dans nos magasins, avec nos machines à teinter qui font de la peinture sur mesure pour les clients, disponible pour le recyclage. Parmi nos produits les plus émissifs en carbone figure le carrelage. Comme la peinture, la capacité industrielle à fabriquer du carrelage recyclé existe. Or c’est un produit très lourd, donc il ne circule pas facilement. Nous réfléchissons à organiser soit de la collecte, soit de la récupération de chutes, donc quelques tonnages de carrelage à aller chercher !
Cela fait quinze ans que nous collectons dans des espaces de tri en magasin les piles, les lampes, les produits électriques et électroniques, par souci du tri. Entretemps, la loi Agec adoptée en 2020 a imposé d’aller beaucoup plus loin : nous devons désormais récupérer tous les produits que nous commercialisons. Si un client a une cloison à abattre, il peut nous rapporter les gravats, de même que des meubles de cuisine, de salle de bain, etc. Nous avons l’obligation de tout prendre et de mettre les déchets dans la bonne benne. Mieux, nous devons recycler au maximum. C’est un immense défi logistique pour nous, notamment la collecte de matériaux de chantier, mais que nous allons faire avec plaisir. Car cela arrive au moment où l’on a bien pris conscience de nos impacts environnementaux : nous savons que la matière recyclée est essentielle pour décarboner notre offre. »
65
Réutiliser les Eaux grises dans le logement, pour ou contre ?
Parmi les neuf limites planétaires, il y a l’utilisation d’eau douce. On distingue l’« eau bleue » (les lacs, les rivières et les nappes souterraines), dont le seuil est critique, et l’« eau verte » (le changement du niveau d’humidité des sols) dont la limite est atteinte. Alors, forcément, le sujet des eaux grises est d’actualité. D’autant plus que l’État français autorise, seulement depuis le 11 mars 2022 dans le cadre de la loi Agec, la réutilisation des eaux usées traitées. De quoi s’agit-il ? Les eaux grises, qui proviennent des douches, baignoires, lavabos, lave-linge, éviers de cuisine et lave-vaisselle, peuvent être une ressource alternative à l’eau potable pour certains usages domestiques, après leur traitement. C’est un défi logistique à organiser pour l’habitat, mais aussi un changement de mentalité à opérer pour les Français.
la cuisine 66
En 2015, le pôle de recherche Leroy Merlin Source a réalisé une étude psychosociale sur le sujet⁸ dans la région de Nantes, à l’initiative du docteur Fabien Squinazi, expert auprès de l’Anses⁹. Les principaux résultats de la recherche ont révélé d’abord des niveaux de connaissance du circuit de l’eau différents selon le lieu de résidence, plus élevés parmi les habitants ruraux que chez les urbains. L’acceptabilité des eaux usées traitées varie selon les différents usages proposés : les usages extérieurs sont plus acceptés que les usages intérieurs, à l’exception de l’alimentation de la chasse d’eau qui est l’usage le plus accepté de tous. L’enquête a également révélé une moindre acceptation des usages lorsqu’ils impliquent un contact proche du corps, comme le lavage du linge et l’hygiène corporelle. Les eaux provenant du lave-linge s’avèrent mieux acceptées que celles provenant de la salle de bain et surtout de la cuisine, perçues comme les plus sales et les moins propices à une réutilisation. L’étude montre une peur des maladies de peau et des maladies digestives qui résulteraient du contact ou de l’ingestion d’eaux grises traitées. Enfin, les participants perçoivent d’abord un avantage économique, puis écologique à ce réemploi de l’eau domestique. En conclusion, si les mentalités ont sans doute changé depuis 2015, un travail de pédagogie s’impose pour dépasser les réticences. Pour préserver l’eau.
8 Colin Lemée, Gaëlle Bulteau, Ghozlane Fleury-Bahi, Oscar Navarro, Fabien Squinazi, Les Eaux grises dans le logement. Quels potentiels de réutilisation au regard des représentations des Français ?, étude pilote dans la région nantaise, Les chantiers Leroy Merlin Source, no 13, 2015. En partenariat avec le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et le LPPL (Laboratoire de psychologie des Pays de la Loire).
9 Agence nationale de sécurité sanitaire.
67
Le rapport aux appareils domestiques et le retour à l’état sauvage
Jean possède un petit moulin à épices électrique et un hachoir demi-lune en marbre de Carrare. Savez-vous quel outil cet habitant préfère utiliser le plus souvent ? Sans hésiter, il choisit son hachoir et explique : « Un, parce que c’est esthétique ; deux, parce que c’est sensuel ; et trois, ça me permet de faire aussi vite que le moulin électrique qu’il faut sortir, brancher, nettoyer… » Son voisin Ali, bricoleur confirmé, affirme quant à lui utiliser de préférence sa scie à main, plutôt que sa scie sauteuse dernier cri, parce que celle-ci fait du bruit, de la poussière et réveille ses enfants de leur sieste.
la cuisine 68
Que nous disent ces deux observations faites chez l’habitant ? Réponse d’une designeuse, Julie Gayral, d’un prospectiviste, Émile Hooge, et d’un sociologue¹⁰, Benjamin Pradel, qui s’intéressent ensemble à l’évolution de notre rapport aux appareils domestiques¹¹ et à notre future manière d’habiter.
Dans les années 1970, la tendance est de déléguer un peu aveuglément la tâche à l’appareil, qui libère (surtout les femmes à l’époque) de la charge ménagère et domestique. Cette logique évolue ensuite vers plus de domestication, c’est-à-dire une volonté de comprendre comment l’appareil fonctionne et de le maîtriser, de le réparer potentiellement. Le but est alors de s’approprier les objets et de les faire durer, sans en dépendre.
Aujourd’hui, les chercheurs pressentent un glissement et ils projettent dans l’habitat de demain une mise à distance des objets domestiques. Les habitants reprennent en effet la main, pour certaines activités socialement valorisantes. Après des décennies de valorisation de l’intellectuel, le manuel redore son blason. Ce retour correspond à un rapport plus sensible voire sensuel à l’habitat et à l’environnement. Il n’y a pas d’écologie possible sans faire soi-même : voilà une explication cachée à la valeur de plus en plus accordée à l’artisanat. Cela dit, il faut en avoir les moyens, autrement dit, le temps. Avoir le temps de préparer une tarte aux pommes maison, prendre le temps de bricoler une lampe. La main nous fait donc revenir au temps long. Demain, ferons-nous tous l’éloge de la lenteur ? Un luxe pour ceux qui manquent de temps.
Les enquêteurs observent en tout cas la chose suivante : plus l’on ajoute d’options, moins les habitants les utilisent. Si l’on pousse le raisonnement, le besoin des consommateurs apparaît très souvent en dessous des capacités disponibles et pourtant, l’étendue des options continue à être un argument commercial.
Aujourd’hui, 80 % des détenteurs d’un smartphone n’utilisent que 15 % de ses capacités, ce qui peut étonner, comme le souligne Benjamin Pradel : « Nous avons des ordinateurs entre les mains, qui pourraient détecter les étoiles perdues dans l’univers, et nous nous en servons pour regarder des films ! C’est un peu de la surconsommation, de la suroption ou de la surpotentialité ! »
La société de demain reviendra peut-être à des appareils plus basiques, plus maîtrisables par l’utilisateur. Pour cela, le sociologue pose une condition : « Il faut que ce soit accompagné d’un démarketing, d’une forme de décroissance de la publicité dans ce qu’on fait miroiter à l’acheteur comme norme de consommation. »
10 Julie Gayral, Émile Hooge et Benjamin Pradel, Domestiquer ses appareils domestiques, reprendre la main sur la technique pour rester maître chez soi ?, étude Leroy Merlin Source, 2023, consultable sur leroymerlinsource.fr
11 Par « appareils domestiques », il faut entendre tous les robots et autres outils fonctionnant à l’électricité, qui nous aident au quotidien dans les tâches domestiques.
LE sALON, DE LA MONDANITÉ À L ’ INTIMITÉ
Histoire
« Objets
voulant
nous identifier »
Bienvenue dans la pièce publique de la maison. Lieu de la sociabilité au cœur de l’habitat, le salon est aussi la galerie de souvenirs de chacun : des objets exposés ici, parce que l’on a envie de les partager ou simplement de les contempler. Le sociologue et coordinateur scientifique de Leroy Merlin Source, Pascal Dreyer, nous propose un aperçu historique et quelques réflexions sur les objets de décoration, des ovnis précieux.

le sALON 72
« Coin de studio moderne », Raymond Cazanave, illustrateur, in Les Dimanches de la femme, 6 août 1922, CCO.

« Le coin du radiateur », Félix Jobbé Duval, illustrateur, in Les Dimanches de la femme, 15 octobre 1922, CCO.
Une histoire de mots
« Le terme “salon” ? C’est la salle de séjour qui a perdu un L. Des dénominations diverses l’ont précédé et remplacé selon les classes sociales, jusqu’à aujourd’hui où tout s’appelle séjour. Mais c’est toujours une pièce de réception, qu’elle soit salle, salon (aristocratique et bourgeois), salle commune (pour les classes populaires). Proust et ses contemporains l’appelaient aussi “hall” ou “atelier” (à double hauteur), ou encore “studio”. Puis, le terme anglais living room ayant fait son apparition dans les années 1930, on le traduit par “salle de séjour”, l’idéal des jeunes ménages des années 1950, puis simplement par “séjour¹”. »
Autant de mots répertoriés par la sociologue Monique Eleb pour désigner différentes manières de se réunir. Aujourd’hui, l’architecture ayant fait disparaître les pièces de l’appartement bourgeois haussmannien, notamment la salle à manger, la plupart des Français ont un séjour et non plus un salon (qui impliquait une séparation des espaces).
Une fois encore, l’habitat français puise dans ses racines. Les multifonctions du séjour tel que nous le connaissons, à la fois « cuisine américaine », salle à manger, home cinema, bureau et chambre parfois, rappellent la « salle » du Moyen-Âge, où toutes les activités de la maisonnée étaient réunies – le travail, la cuisine dans la cheminée, la veillée.
Vous prendrez bien une tasse de thé ?
Revenons à notre salon, au début du xxe siècle. S’il existe, il délimite une pièce de réception, réservée aux invités et parfois considérée comme une pièce de prestige, peu utilisée au quotidien. Hérité de l’habitat aristocratique et bourgeois, descendant des « salons littéraires », il met en scène l’art de la conversation autour d’un canapé, de fauteuils et de guéridons.
73
Il devient aussi un lieu central pour la famille. On s’agglomère autour d’objets techniques qui peuplent durablement les foyers français. Dans les années 1920 et 1930, le salon ouvre une fenêtre sur le monde grâce à la radio. Les nouvelles et la musique habitent l’espace, tissant des liens invisibles entre les membres du foyer, fédérés par une seule et même irruption du monde extérieur à l’intérieur. Dans les années 1950 et 1960, la télévision prend le relais ; la vie dans le salon est désormais rythmée par la communion autour du poste. Regarder la télévision religieusement inaugure une nouvelle manière d’être ensemble, jusqu’à l’avènement d’Internet.
Avec la démocratisation des téléviseurs dans les années 1980 et 1990, le salon se décentralise : les Français peuvent s’offrir plusieurs postes. « La télé » pénètre les chambres, les cuisines, et les spectateurs se séparent en regardant des programmes différents dans une même maison. Chacun son écran. Cette évolution culmine à mesure que les ordinateurs et téléphones portables se multiplient. Chacun sa bulle. Autant de bulles que d’habitants cohabitent désormais dans le séjour. Vivre ensemble et séparément est la nouvelle manière de faire salon !
La société de la décoration
Dans cet espace commun, où l’on reçoit, où l’on montre qui l’on veut être, les objets tiennent une place importante. L’évolution notoire au xxe siècle se situe après la Seconde Guerre mondiale. À partir de la reconstruction, les objets entrent massivement dans l’intérieur des
Français, à la fois techniques, facilitant la vie domestique, et de décoration. Comme le décrit le roman de Georges Perec Les Choses (1965), avec les Trente Glorieuses, la quête du bonheur passe par la possession matérielle pour de nombreux Français. La société de consommation introduit en effet les objets que l’on achète et dont la fonction première est d’ornementer, contrairement aux objets d’affection transmis au sein d’une famille ou venant d’ailleurs.
Décorer son intérieur se traduit soudain, par exemple, par l’apparition de bouddhas dans les maisons françaises. Cette tendance est le fruit d’une longue évolution du goût occidental pour l’Extrême-Orient ; elle reflète également un intérêt pour le bouddhisme précédant l’essor du « développement personnel ».
L’histoire de la colonisation peut d’ailleurs se refléter dans le rapport aux objets. Longtemps, les arts africains ont été représentés dans l’habitat français et il existe encore une production, sur le même mode que par le passé colonial, d’objets artisanaux destinés aux touristes. Mais cette décoration-là est remise en cause par les mouvements décoloniaux actuels, étant perçue comme une « appropriation culturelle ». La décroissance de la décoration est-elle donc en cours ? Les sociologues observent que les Français tendent à faire des achats raisonnés. Soucieux de ne pas surconsommer et de canaliser l’encombrement de leur intérieur, certains n’achètent plus que des objets utilitaires.
le sALON 74

famille écoutant la radio dans son salon dans les années 1930.

75
Une
Photographie Alamy.
Couple de personnes âgées dans leur salon, vers 1970.
Photographie René Maltête, Gamma Rapho.
Ce sont donc des pratiques culinaires ou des usages quotidiens qui justifient tel ou tel achat, par exemple des tasses, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine. Ces objets ont à la fois une utilité et du sens, aux antipodes du gadget jetable, que l’on ne garde pas longtemps.
Histoire(s) de vie(s)
Donner du sens à son environnement, c’est la fonction première des objets observés par les sociologues Pascal Dreyer et Elsa Ramos². Ceux que l’on tient à garder près de soi, chez soi, ont une triple signification : géographique, temporelle et relationnelle. Les plus précieux combinent ces trois éléments, d’où leur forte valeur sentimentale.
Un miroir de l’intimité, voilà ce qu’ont en commun tous ces objets venus d’ailleurs. Prenez par exemple telle personne qui a voyagé au Sénégal et possède plein de souvenirs de ses voyages. Comme symbole d’un objet d’ailleurs, auquel elle tient par-dessus tout, elle montre un vase originaire de Malicorne-sur-Sarthe. Pourquoi ? Parce que c’est là qu’elle a passé son enfance, chez ses grands-parents, où elle a vécu des expériences extraordinaires et fondatrices. C’est ce vase venu du fin fond de la France qui tient une place très particulière dans son chez-soi, au point qu’elle déclare : « J'espère que cet objet si précieux, mon fils ou ma fille va le récupérer. »
Voyage intérieur et interpersonnel
Les objets voyagent à travers soi. On en hérite ou on les élit, on leur donne un sens, et ils occupent une fonction particulière dans le décor : permettre de se définir, de se remémorer qui l’on est. Au retour d’une expatriation, ils suscitent la curiosité d’amis, tels des véhicules de
conversation. Raconter l’histoire de cet objet, c’est se raconter, à la fois à l’autre et à soi-même, en actualisant à chaque récit qui l’on est devenu par rapport à l’objet.
Et à la fin ? On peut continuer à habiter, malgré l’absence. L’essayiste Mona Chollet saisit ainsi une présence-absence à travers les objets : « Il faut la mort, parfois, pour que l’on mesure à quel point les personnes débordent sur les choses, et réciproquement. Il paraît presque impossible de se persuader que le disparu ne va pas entrer et tirer un livre de sa bibliothèque, s’asseoir dans son fauteuil ou revenir occuper sa place à la table du déjeuner, alors qu’un décor demeuré intact parle encore de lui, de ses goûts, de ses habitudes, de sa personnalité ; alors que tout porte la marque familière de son corps et la patine des années qu’il a vécues ici : ses vêtements imprégnés de son odeur dans le placard, sa montre sur le rebord du lavabo³… »
Les personnes très âgées éprouvent parfois une détresse à l’idée qu’elles ne transmettront pas tous leurs objets fétiches. Les objets atterrissant au marché aux puces, dans une recyclerie ou un bric-à-brac retournent à la case départ. Leur charge affective s’efface et ils démarrent une nouvelle vie avec de nouveaux propriétaires. Garder toutes les facettes de soi près de soi, c’est un peu trop, non ? La difficulté à se détacher de soi-même, voilà peut-être pourquoi nous, Occidentaux, sommes des habitants-accumulateurs compulsifs. Pour habiter léger ou quitter son habitat en paix, une mise à jour régulière s’impose. À vos marques, prêts, triez !
1 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
2 Elsa Ramos et Pascal Dreyer, Les Objets d'ailleurs dans le logement : les présents de l'habiter, chantier 56 de Leroy Merlin Source, 2024.
3 Mona Chollet, Chez soi, Éditions Zones, 2015.
le sALON 76

77
Salon de Bernard et Annabel Buffet, Tourtour, Var, 1961.
Photographie Maurice Zalewski, adoc-photos.

Un père et ses deux enfants regardant la télévision, 1969. Photographie H. Armstrong Roberts, Alamy.
d’un

le sALON 78
Intérieur
logement, La Grosse Borne, Villiers-le-Bel, 1965. Photographie F. Galby, archives CDC.
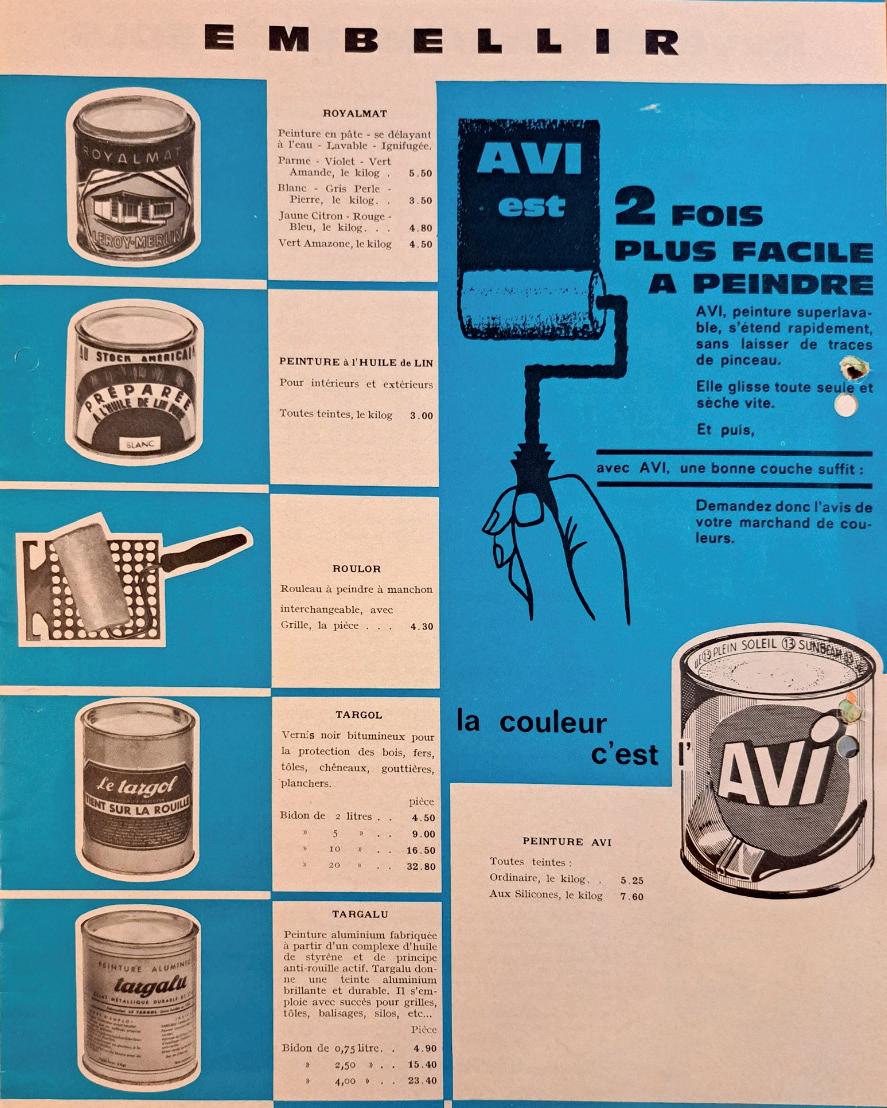

C’est dans les années 1950 que les premiers produits de décoration font leur apparition dans les catalogues Leroy Merlin. Par exemple, le Balatum se popularise, un nouveau revêtement de sol très apprécié après la Seconde Guerre mondiale, constitué de carton enduit d’asphalte, ainsi que le Placoplatre. Des produits plus classiques sont aussi commercialisés sous la marque « Stock Américain », comme le montre le catalogue de 1967 avec cette page titrée « Embellir ». Signe que le goût du beau s’installe dans l’habitat français !
79
Perios dolorio nsedis pligendipit, cone del magni dolorehenis alique
L’ARRIVÉE DE LA DÉCORATION CHEZ LEROY MERLIN
Extrait du catalogue Embellir de 1967. Archive Leroy Merlin.
Design
Le salon au xxie siècle, entre influence et émancipation
Derrière chaque objet, il y a un designer. Dans chaque salon, des tendances. Le rôle du designer est de les anticiper, de mettre en forme les désirs de confort de chacun, sans jamais oublier l’esthétique, ni désormais l’écoresponsabilité. Visite guidée dans le salon des Français en compagnie de Christophe Sapena, designer chez Leroy Merlin.
Lhabitat reflète globalement la personnalité de celui qui habite et le salon en particulier, la personnalité rêvée ; on y montre ce que l’on a envie de montrer. C’est aussi une photographie de la société à l’instant T.
Des idées, des décos
En matière de décoration, les Français sont inventifs. Rendre beau le laid est l’une des manières d’exprimer cette créativité. Tel habitant, gêné par son compteur électrique au beau milieu du salon, l’embellit en fixant un cadre doré autour. Comment transformer une
protubérance technique et fonctionnelle en œuvre d’art !
L’inventivité, c’est aussi le fait de détourner l’usage premier d’un produit, comme la palette en bois utilisée en table basse ou en étagère murale. Ce détournement peut parfois déboucher sur une innovation pour le designer. Par exemple, on observe qu’un bricoleur qui n’a pas de marteau sous la main utilise souvent, à la place, le manche d’un tournevis. D’où la création d’une gamme de tournevis avec poignée renforcée pour pouvoir enfoncer des clous.
le sALON 80
'

81
Illustration Andréa Mongia.
Un salon nu
Dans le salon du xxie siècle, on observe une tendance nette au dépouillement. D’abord, la culture déménage, ou plutôt le divertissement se dématérialise. Les supports tels que VHS, DVD, vinyles, CD, disparaissent de notre champ de vision, hormis chez des collectionneurs. Car le visionnage de films ou l’écoute de musique se font désormais en streaming, voire la lecture de livres sur liseuse. Les étagères se vident et se raréfient.
Aussi, la télévision représente de moins en moins la pièce focale du salon. D’une part, les fabricants font un effort de design pour que les postes s’intègrent le mieux possible dans leur environnement, au point qu’on ne les remarque plus. D’autre part, certains salons n’incluent même plus de téléviseur, détrôné par les écrans d’ordinateur et les tablettes. Un peu comme la chambre à coucher qui s’aère, dépoussiérée et désencombrée, le salon se minimalise. On remarque par exemple des évolutions liées à la hauteur sous plafond : les plafonds étant plus bas, la tradition d’orner la pièce d’un beau lustre ou plafonnier s'est estompée au profit des spots intégrés dans les faux plafonds.
Que reste-t-il du salon ainsi minimalisé ? Principalement les murs, et le canapé, qui devient l’élément central. Même minimaliste, le salon reste une pièce publique, où l’on reçoit, que l’on a tendance à soigner, parfois plus que les pièces privées. Le salon est au goût du jour,
c’est une démonstration de savoir-vivre. Et avec les émissions de décoration des années 2000 à la télévision puis l’avènement des réseaux sociaux, la décoration d’intérieur s’est véritablement démocratisée. Instagram et Pinterest propulsent la moindre tendance de niche dans n’importe quel intérieur : un mobilier des années 1950 restauré, du béton ciré au sol, un mur fresque, un canapé d’inspiration Togo, une méridienne intégrée à des canapés modulables… Cette démocratisation d’un certain goût – érigé en modèle par les intérieurs Airbnb – aboutit à la norme du dépouillement et efface des vestiges de décoration rustique tel que l’élément d’ébénisterie dit du « chapeau de gendarme ».
La pénétration dans l’habitat français de références en rafale, qui auparavant n’atteignaient pas le foyer lambda, peut être déroutante. Il n’est pas évident de trier ce bombardement de modèles. D’après Christophe Sapena, les Français finissent toujours par n’en faire qu’à leur tête, en s’émancipant des diktats de la mode. Conclusion : la responsabilité des acteurs de l’habitat n’est pas d’imposer systématiquement un point de vue, mais d’offrir la possibilité d’adapter telle ou telle proposition à l’envie de chacun. Autrement dit, on tend vers plus de modularité, plus de produits à finir soi-même plutôt que des produits finis : par exemple, une planche de bois et deux équerres en guise de meuble de salon. Par l’acte de bricolage, on s’approprie cette planche, on s’approprie son propre intérieur. Et le salon se crée, à portée de main.
le sALON 82

Décoration épurée faisant la part belle aux tons naturels. Photographie Leroy Merlin.
Personnalisation de la décoration illustrée par le détournement de simples étagères en éléments décoratifs. Photographie Leroy Merlin.

83
mieux connaître les habitants et leurs modes de vie
Les équipes Leroy Merlin partagent une conviction forte : c’est en accompagnant les habitants dans leurs nouvelles façons d’habiter et en anticipant leurs besoins qu’elles pourront imaginer et fournir les solutions les plus pertinentes.
Ainsi, pour mieux comprendre les habitants et leurs besoins, quelques magasins ont eu l’idée de faire des visites chez leurs clients. Baptisées « visites habitants », elles se sont généralisées dans tous les magasins en 2005 et ont même essaimé chez Auchan et chez des concurrents ! Ces rendez-vous, pris chez des clients volontaires, permettent aux équipes de plonger en immersion dans le vécu des habitants : pour les magasins, cela leur permet de mieux connaître les habitats et les contraintes des habitants
Chaque visite s'avère être une surprise, un enseignement intime et précieux sur les usages dans l'habitat français.
le sALON 84
de leur quartier et, pour les responsables de l’offre produits, de recueillir des données sur les problématiques rencontrées et les besoins en matière de rangement, de décoration ou de confort. Un exemple : lors des visites, revenait de manière récurrente le besoin d’une porte moins encombrante à son ouverture. Ainsi est né le bloc porte coulissante, répondant à un réel besoin de gain de place. En pratique, chaque visite s’avère être une surprise, un enseignement intime et précieux sur les usages dans l’habitat français. C’est comme un laboratoire des produits existants qui permet aux designers notamment d’observer concrètement comment ils sont utilisés, de concevoir d’éventuelles améliorations et d’imaginer les innovations de demain.
Pour aller plus loin et sonder les modes d’habiter des Français, Leroy Merlin a créé en 2005 un pôle de recherche sur l’habitat : Leroy Merlin Source. Ce réseau réunit des professionnels, des acteurs de l’habitat et des chercheurs autour de problématiques telles que vieillir chez soi, le télétravail, la place de l’enfant dans le logement, l’évolution des fonctions du garage, etc. L’originalité de ce pôle de recherche, par rapport à d’autres réseaux privés ou centres académiques, est son approche sensible et le fait que la clé d’entrée reste toujours l’habitant.
85
L’évolution des produits vers un meilleur impact environnemental
le sALON 86
Nous l’avons vu, le salon accueille une foule d’objets, parfois venus d’ailleurs et qui ne sont pas forcément éco-responsables – notre prise de conscience de la surconsommation n’est-elle pas encore balbutiante ? L’indice bien connu Nutri-score, qui guide les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des produits alimentaires, a été créé par un consortium d’industriels. Ce type d’indicateur de référence pourrait bien être, dans le secteur de l’habitat, Home Index. Une initiative de Leroy Merlin, expliquée par Claire Beauvais, en charge du commerce responsable et de l’économie circulaire au sein de l’entreprise :
« Home Index est un indicateur qui évalue l’impact environnemental et social d’un produit tout au long de son cycle de vie. Grâce à cette notation de A à E, nous donnons aux clients les moyens de choisir les produits en un coup d'œil. Lancé fin 2022, Home Index prend en compte jusqu’à trente critères qui évaluent et synthétisent tout le cycle de vie du produit, de sa fabrication à sa fin de vie en passant par son utilisation. Par exemple l’éco-conception et la part de matériaux recyclés ou biosourcés, l’impact sur la santé avec le niveau d’émission de COV dans l’habitat, le niveau de consommation d’énergie… L’idée est de proposer un indice universel et simple d’utilisation pour le client en magasin ou en ligne.
87
« l’analyse de l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie du produit est une vraie science. »
le sALON 88
C’est aussi un vecteur d’amélioration de notre offre, qui renforce les partenariats avec nos fournisseurs embarqués dans un cercle vertueux, puisque l’indice est visible par tous. Nous ambitionnons de mettre Home Index en open source et de le présenter à nos concurrents pour qu’il devienne un outil commun, ce qui aurait du sens pour tous, y compris nos clients. En tant qu’acteurs de l’habitat, nous devons simplifier des données complexes, offrir une pédagogie qui permette à chacun de s’y retrouver, en cohérence avec ses priorités. »
Home Index est donc à la fois un moyen pour les habitants de connaître l’impact des produits et d’en faire un critère de choix et un moyen pour l’entreprise d’améliorer son offre. Car l’un des enjeux de demain est de faire évoluer les produits de consommation pour diminuer leur impact, et notamment leur empreinte carbone. Marie Simunic, qui dirige l’offre chez Leroy Merlin, partage cette vision :
« L’étude carbone de l’entreprise révèle que 90 % du carbone vient du produit. Notre défi est de bien comprendre, catégorie de produits par catégorie de produits, ce qui pèse dans l’empreinte carbone. Et les natures d’action sont très différentes selon les typologies d’offre. Dans le cas de la peinture par exemple, cela passe par une recherche de formules biosourcées, c'est-à-dire basées sur des produits d’origine naturelle, pour éliminer au maximum les COV (composés organiques volatils) tels que le formaldéhyde. Bien sûr, la nature des actions diffère selon la nature des produits. L’analyse du carrelage montre par exemple que le transport pèse beaucoup moins que la fabrication dans son empreinte carbone, en raison de la cuisson du sable très consommatrice d’énergie.
Alors que dans le cas de l’ampoule, c’est la consommation chez l’utilisateur qui compte le plus en termes d’émission de carbone. L’enjeu sur le carrelage est de fabriquer des produits plus fins pour consommer moins de matière, et de pouvoir sourcer ou développer des usines qui évitent les énergies fossiles. À résistance équivalente, nous savons réduire l’épaisseur d’une dizaine de millimètres à 7 ou 8 mm : 40 % de réduction, c’est autant de matière première en moins, donc une empreinte plus faible à qualité identique ! L’épaisseur du carrelage est faussement perçue comme un gage de qualité, d’où notre rôle pédagogique auprès des habitants. En tout cas, en amont, c’est important de bien comprendre ces processus. L’analyse de l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie du produit est une vraie science. C’est un travail de fond que nous menons avec nos fournisseurs partenaires, que nous accompagnons, au besoin, dans la transition écologique de leur outil de production. Parfois l’offre n’existe pas au bon prix et nous jouons notre rôle de leader pour accompagner la transition du marché : par exemple, nous avons décidé d’arrêter les climatiseurs qui ne sont pas à double flux, alors que les climatisations froides représentaient jusque-là 70 % du marché. Notre but est de pouvoir proposer rapidement des produits réversibles au même niveau de prix, alors qu'ils coûtent plus cher. »
89
LA CHAMBRE PARENTALE, DU NID À L ’ ÎLE
Rétrospective
Histoire
d’une pièce intime
sDe la naissance à la mort, tous les chemins mènent à la chambre. Abri du sommeil et des rêves, de l’amour et de la sexualité, de la prière et de la paresse, la chambre parentale découle d’une longue histoire, celle d’une pièce plus ou moins privée, unique ou double, selon les époques, les milieux sociaux et les mœurs des Français. D’un lit faisant partie de la pièce à vivre à la « suite parentale », visitons ce nid de la vie, en compagnie de l’ethnologue Pascal Dibie¹.
aviez-vous que l’homme de Cro-Magnon dormait sur des peaux de rhinocéros laineux à la fourrure épaisse et douillette ? Que son cousin habitant le littoral couchait sur des algues à bulles ? Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes organisent leur sommeil. C’est une nécessité absolue pour les mammifères bipèdes de soulager leur colonne vertébrale, qui porte un septième du poids de leur corps. Le sens premier de la chambre est donc un lieu aménagé pour le repos.
À ce besoin fondamental, d’abord strictement physiologique, se greffent au fil du temps des stratégies et des besoins nouveaux. Ce n’est par exemple qu’à partir du développement
économique de l’Occident et de l’arrivée de nouveaux objets, à la fin du xive siècle, que l’armoire apparaît, car le coffre dans lequel on rangeait les vêtements ne suffit plus. On gardait aussi beaucoup de choses sous les lits, façon de mieux surveiller pendant la nuit ce qui était considéré comme rare et précieux. Dans le Morvan, la richesse du paysan se mesurait à la hauteur de son lit. À l’époque, la grande majorité de la population est rurale ; à la campagne, on dort dans des longères, avec les bêtes dans le foin, ou dans des alcôves, en particulier des armoires à étages dont on ferme les rideaux le jour. Car il n’y a pas de chambre, mais une salle commune, intergénérationnelle et multifonctionnelle, où l’on s’entasse pour se tenir chaud.
la CHAMBRE 92
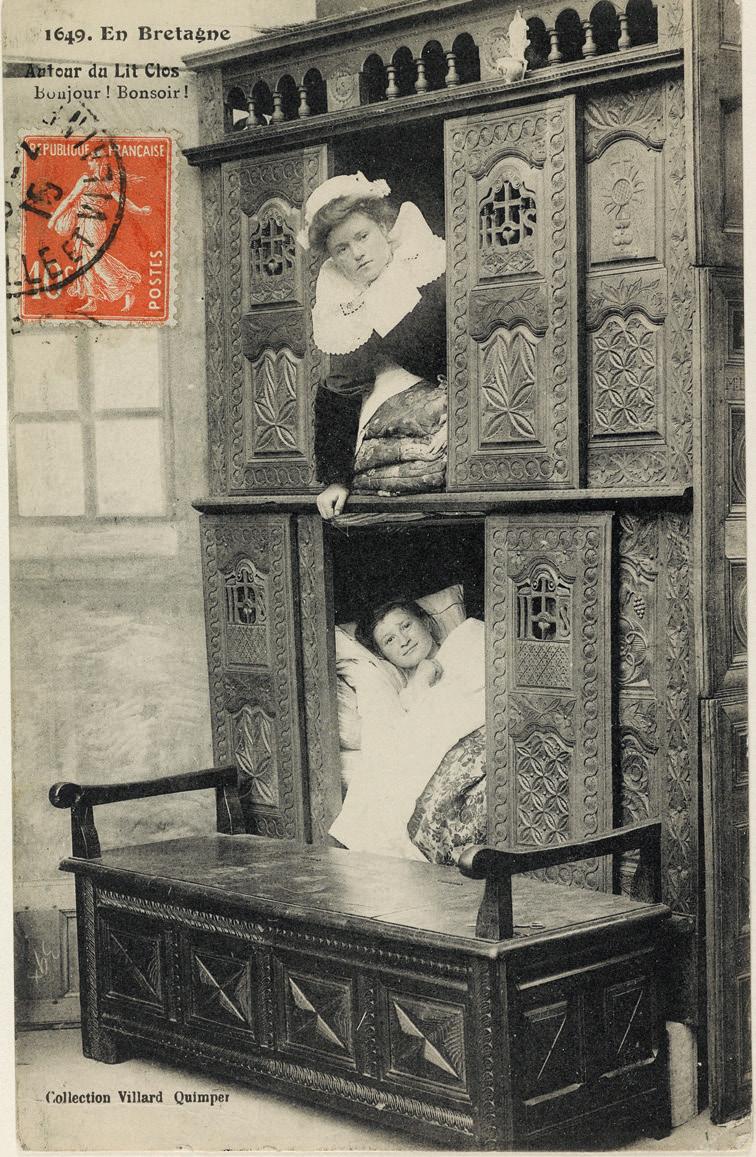
93
Le lit-clos, meuble traditionnel de Bretagne. CCO.
Cette « chambre principale », d’une trentaine de mètres carrés en moyenne, perdure jusqu’à la fin du xixe dans de nombreuses régions françaises. Jules Renard décrit alors en Bourgogne les « draps de lit froids, humides. On se couche avec son tricot, son caleçon, ses chaussons, sa robe de chambre et on grelotte toute la nuit²».
En fait, la chambre devient un lieu dédié au sommeil au fur et à mesure qu’apparaît la notion (et le mot) d’intimité, à la fin du xviie siècle. D’abord parmi les classes privilégiées, on commence à éprouver le désir d’être seul et d’avoir des espaces qui le permettent. Ce sentiment nouveau du « moi » paraît alors incompatible avec l’organisation de l’espace : des escaliers mènent directement aux différentes pièces qui s’ouvrent les unes sur les autres. Difficile à imaginer aujourd’hui, voici une scène tout à fait ordinaire à l’époque : pour aller jusqu’à sa chambre, un locataire traverse la chambre de la jeune fille de la maison ! On vit à l’intérieur comme à l’extérieur, la communauté prime sur l’individu et il est parfaitement normal de vivre dans la promiscuité, sous le regard des autres³.
La chambre devient un lieu dédié au sommeil au fur et à mesure qu’apparaît la notion (et le mot) d’intimité.
En plus de l’émergence du « moi », la présence de moins en moins tolérée des domestiques conduit à repenser l’habitat et sacraliser la chambre. Vous souvenez-vous du personnage de Toinette dans la pièce de Molière Le Malade imaginaire ? Son maître Argan est excédé de la surprendre en train de comploter dans la chambre de sa fille Angélique… Or l’intrusion de la servante dans la vie de son maître est étroitement liée à la division de l’espace, les domestiques passant alors par les pièces principales pour faire le service.
Au xviiie siècle, les demeures des classes aisées comptent deux chambres parentales, l’une pour l’homme et l’autre pour la femme. On peut d’ailleurs deviner le statut de la femme en observant la répartition des espaces. Si les appartements de Madame sont privés et occupent un périmètre équivalent à ceux de Monsieur, alors la femme est reconnue comme une personne à part entière, d’un rang égal⁴.
La chambre reste un luxe ; il faut être suffisamment nanti pour en avoir une. Dans l’habitat des classes populaires, la chambre « escamotable » laisse place au salon le jour, le lit servant de canapé. C’est dans le monde rural qu’apparaît le mariage d’amour à la fin du xviiie siècle, d’où, quelque temps plus tard, l’apparition de la « chambre conjugale ». N’en avoir qu’une reste longtemps un signe de pauvreté : ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les milieux plus aisés l’adopteront.
la CHAMBRE 94

Un accouchement dans la cuisine, qui était aussi la chambre dans les campagnes après la Seconde Guerre mondiale. Photographie de Jean-Philippe Charbonnier réalisée dans une ferme de la Creuse en 1950, Gamma Rapho.
95
Au xixe, siècle, la chambre inspire les écrivains et leurs personnages. Une caisse de résonance de mille émotions, idées et goûts. Elle devient sanctuaire, s’y abandonner est un sacerdoce pour les rêveurs solitaires, friands d’évasion casanière. La chambre est aussi le théâtre des ébats amoureux.
On peut citer la stratégie d’entrée décrite par Alexandre Dumas dans La Dame aux camélias Grâce au positionnement du lit près de la fenêtre, la dame peut se poster à contre-jour et regarder entrer le visiteur, pleinement éclairé par la lumière.
Savez-vous pourquoi le xixe transforme la société et la chambre en particulier ? La révolution du siphon permet de relocaliser les toilettes à l’intérieur de l’appartement, généralement attenantes à une chambre ou deux, dans les appartements bourgeois. Résultat, la « domesticité organique » disparaît : jusque-là, les domestiques dormaient devant les portes des chambres de leurs maîtres et étaient chargés de jeter les seaux de la nuit par la fenêtre ou les descendre au pied de l’habitation. Ceux qui étaient témoins des vies et des corps vont désormais passer les nuits dans des chambres de bonne. Peu à peu, on s’enferme à l’intérieur de sa propre maison, on met des verrous et des clés aux portes.
Au début du xxe siècle, même si la notion de privé et de public a beaucoup évolué, il est encore compliqué de délimiter une chambre parentale française en dehors de l’appartement bourgeois. Ailleurs, c’est une pièce plurielle, soit occupée par une fratrie dont les parents dorment dans le salon, soit par la famille entière.
1 Pascal Dibie, Ethnologie de la chambre à coucher, Grasset & Fasquelle, 1987.
2 Jules Renard, Journal, année 1905, cité par Michelle Perrot, op. cit.
3 Cf. « Intimité », in Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
4 Ibid., cf. « Chambre ».
la CHAMBRE 96
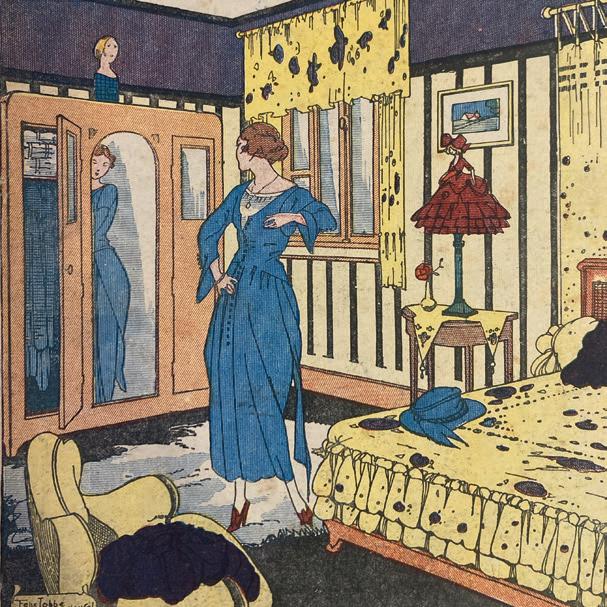
« La chambre de la parisienne », Félix
Jobbé Duval illustrateur, Les Dimanches de la femme, 19 mars 1922. CCO.
« La chambre bleue et rose », Maggy Monier illustratrice, Les Dimanches de la femme, 27 août 1922. CCO.

97
Ethnologie
Plus de fonctions, moins de symboles
Notre visite se poursuit au xxe siècle. Dire « chambre », c’est impliquer tout un système de culture. La culture voyage, les influences se mêlent et la chambre à coucher française s’affirme comme européenne.
La chambre, Bruay-en-Artois, vers 1950. Photographie ministère de la Culture, médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. GrandPalaisRmn / Émile Muller
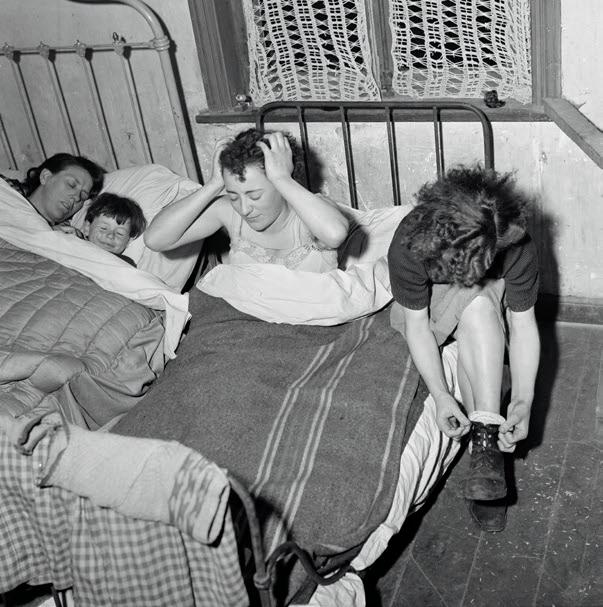
la CHAMBRE 98
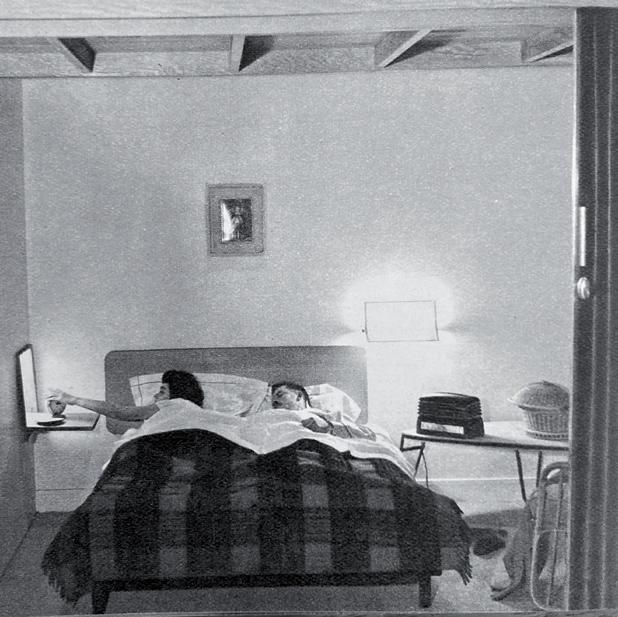
L’appartement idéal présenté au salon des Arts ménagers, 1952. Photographie Arts ménagers.
Depuis l’enfance, on nous inculque un système d’habitudes, une « culture endormie » française. Par exemple, le temps de sommeil : les jeunes filles élevées dans le jansénisme à l’abbaye de PortRoyal imitaient les moines en dormant sept heures par nuit, allongées sur le dos, les mains à l’extérieur, pour ne pas risquer de toucher leur corps.
L’espace du sommeil, cette « petite mort », est peuplé de signes et d’esprits. La magie y est très présente jusque tard au xxe siècle. Les portes des chambres contiennent de la ferraille pour chasser les mauvais génies et les démons, car l’odeur du fer qui est créée à partir du feu les repousse.
Lors d’un accouchement, on place de l’ail, des oignons et un couteau dans la chambre, on ajoute même du fer autour de la serrure, pour protéger le nouveau-né du génie qui a horreur de ces odeurs. Selon l’ethnologue Pascal Dibie, la disparition progressive de la magie correspond à l’avènement d’un monde plus rationnel, d’une vie plus ordinaire – comme pour la chambre ?
Les pratiques des dormeurs nous renseignent sur une foule de nuances culturelles, parfois cocasses si l’on pense aux scènes de vie conjugale autour du partage du lit ! Du fond de la Scandinavie jusqu’à Metz, il y a les sociétés à couette et, de Metz jusqu’à l’Égypte, les sociétés à draps, autrement dit la culture du lin. Au nord, grâce à la domestication des eiders auxquels on vole des plumes, le dormeur se love nu sous une couette, en chien de fusil. Plutôt deux couettes qu’une s’imposent dans le lit conjugal pour ne pas avoir trop chaud et pouvoir s’aérer.
99
Plus au sud, les couples dorment sous un système d’oignon, avec des couches superposées de couvertures sur un drap, et le plus frileux a besoin d’une couche en plus… L’ethnologue Pascal Dibie observe dans ces usages différentes personnalités : d’un côté, en Europe du Sud, une société bordée, de l’autre, en Europe du Nord, une société ouverte. En imposant la couette dans l’Europe des draps, le suédois Ikea aurait-il ouvert les mentalités ?
En tout cas, la « suédisation » du monde permet de transformer la pièce à l’espace contraint qu’est la chambre en un lieu plus ouvert et fonctionnel. Il faut savoir que le lit a longtemps représenté en France le seul bien que l’on possède et qui permet de se marier. En disant « j’apporte le lit », un prétendant prouve qu’il a assez de moyens. On retrouve le lit dans les actes notariés, on le transmet de génération en génération. Il est tout à fait courant qu’en emménageant, un jeune couple reprenne un lit ayant appartenu à des grands-parents. Au-delà de l’aspect matériel, c’est un objet sacré, le lieu où l’on engendre, le berceau de la descendance. Pour ceux qui ne possèdent pas de lit de famille, pendant la première moitié du xxe siècle, la chambre à coucher est un cadeau de mariage
très apprécié. Un lit, une armoire et des tables de chevet assorties. Dès son origine, Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) en propose puis, au début des années 1950, les chambres et autres meubles connaissent un essor considérable (au point qu’un magasin exclusif d’ameublement ouvre en 1951 pour les cinquante ans d’Adolphe Leroy fils).
Le patrimoine familial que représente le lit est remis en cause par l’arrivée en France des couettes et de la literie d’Ikea, et nos habitudes s’en trouvent bousculées. Car au lieu d’un matelas fait main, onéreux, et d’un lit ancien à forte valeur sentimentale, on se met à traiter ce meuble de la nuit comme une commode quelconque. Il devient interchangeable, à durée de vie réduite. Exit les tentures sombres et bourrées de poussière. Ouvrez les volets ! Bienvenue dans la chambre suédoise, dégagée, absolument ouverte, fonctionnelle (non plus symbolique) et hygiénique.
La « suédisation » du monde permet de transformer la pièce à l’espace contraint qu’est la chambre en un lieu plus ouvert et fonctionnel.
Hygiénique ? La pasteurisation bouleverse tout l’habitat, la chambre et le couchage. Jusque-là, on n’est pas seul dans le lit, même si l’on dort seul… Sont aussi présents des compagnons de nuit envahissants, les acariens, les punaises et les puces. Les lits en bois constituent des labyrinthes où les punaises se cachent. Pour se protéger des petits vampires à six pattes, les hôpitaux adoptent les lits en fer, démontables et nettoyables au feu avec un bec Bunsen. Quant aux matelas, c’est la colonisation qui les fait évoluer : l’arrivée des fibres de coco en provenance d’Algérie permet de fabriquer des matelas en palme, où aucun acarien ne peut loger. Le mot matelas est d’ailleurs d’origine arabe, matrah signifiant « le tapis sur lequel on se couche ».
la CHAMBRE 100


101
Chambre à coucher des années 1950. Photographie médiathèque Terra.
Chambre extraite du catalogue Ikea de 1984. D. R.
Il y a un tel désir d’hygiène qu’on oblige à laver les draps et le linge de nuit plus souvent qu’une fois par saison… Les draps sentaient mauvais ! Et comme on pensait qu’on ne vivait pas vraiment pendant le sommeil, une chemise de nuit pouvait être portée 107 ans ! L’apparition de la machine à laver transforme complètement le rapport au linge. Une nouvelle accoutumance à la propreté se met en place et la chambre continue à être respectée, tout en étant moins sacralisée.
Il faut mentionner une autre évolution importante, celle de la micronisation des systèmes techniques, influence directe des États-Unis. Cette micronisation transforme certaines pièces de l’habitat, notamment la cuisine dont la superficie peut se réduire grâce à l’arrivée de nouvelles technologies comme la gazinière. Cet espace libéré peut l’être au profit de la chambre, qui, elle, a besoin de plus de surface : avec l’évolution morphologique, les gabarits changent, et la taille des lits passe de 140 centimètres de largeur à 160 voire 180. De telles dimensions ne passant que par les fenêtres, les « standards » des chambres de neuf mètres carrés avec un petit mètre d’ouverture sont revus, on abat des cloisons et on repense les espaces.
À partir des années 1980 et 1990, la chambre n’est plus un espace fonctionnel réservé au sommeil, mais polyfonctionnel. On y accole la salle de bain. Le dressing prend de l’importance et de l’espace. La suite parentale se répand,
pour ceux qui peuvent se l’offrir, d’autant que l’on se met même à travailler dans la chambre. Il y a comme un retour de la Rome antique, la posture allongée n’est pas une provocation malséante, c’est une nouvelle manière d’être.
Espace de sommeil, espace d’éveil intérieur, la chambre, point névralgique du chez-soi, est l’île où l’on se régénère. Citons l’essayiste et romancière Chantal Thomas, qui écrit à propos de sa chambre de bonne ou plutôt d’étudiante, habitée dans les années 1960 : « Dans ce Paris étranger, dont j’ignorais encore tout, ma première chambre, tel le rectangle de douceur d’une serviette étendue sur la plage, m’offrait les contours sûrs d’un abri⁵. »
5 Chantal Thomas, Comment supporter sa liberté, Payot, 1998.
la CHAMBRE 102

La chambre parentale, en intégrant la salle de bain et le dressing, est devenue un idéal pour les Français. Photographie Leroy Merlin.
Pour intégrer la chambre au rez-de-chaussée, les garages sont transformés en suites parentales. Photographie Leroy Merlin.

103
Bien isoler, bien chauffer, bien ventiler
la CHAMBRE 104
Traditionnellement, la chambre n’est pas chauffée, à moins d’être un recoin dans la pièce commune, non loin du foyer. Les dormeurs français portent donc des bonnets de nuit – c’est d’ailleurs à Troyes qu’ils sont confectionnés en laine, dès le xvie siècle. Une autre parade pour ne pas grelotter la nuit consiste à utiliser des briques chauffe-lit en terre cuite. Et pour se protéger des intempéries et de la lumière, on a recours à des volets intérieurs qui restent cependant inefficaces contre les courants d’air.
Cette longue histoire aboutit au xxie siècle à une science nouvelle, la performance énergétique, qui s’impose à tous désormais. Car la meilleure écologie, c’est l’économie. La rénovation énergétique illustre bien cette maxime : un habitat rendu performant fait chuter drastiquement ses dépenses en chauffage, autant qu’il réduit son empreinte carbone.
Le responsable de la rénovation énergétique chez Leroy Merlin, Olivier Corbin, nous éclaire sur cet enjeu de société majeur : « La rénovation énergétique pour notre enseigne repose sur trois piliers d’utilité et de sens. Le premier concerne l’environnement : nous nous inscrivons dans les objectifs de réduction de l’impact carbone de la France. Deuxièmement, il s’agit d’un enjeu de croissance. Il nous faut dès maintenant nous orienter vers un business plus sain, plus congruent, plus durable, dans lequel les équipes se sentent utiles et trouvent du sens à leur travail. Le troisième pilier est l’enjeu sociétal : permettre à chaque Français, y compris ceux qui manquent de moyens pour réaliser de gros travaux, de vivre dans un logement digne.
Concrètement, la rénovation énergétique concerne quatorze corps de métiers que l’on peut répartir en trois objectifs principaux : bien isoler sa maison, bien la ventiler, bien la chauffer.
105
« les classes énergétiques a et b ne réprésentent que 4% de l’habitat actuel en france. »
L’isolation précède tout le reste : si votre maison n’est pas bien isolée, même les meilleurs systèmes de chauffage et de ventilation ne permettront pas d’atteindre une bonne performance énergétique. Non seulement le nombre de métiers concernés est important mais il s’agit aussi d’un parcours complexe, régi par des aides d’État, dont les démarches administratives s’avèrent parfois longues – le temps de monter un dossier et d’obtenir les validations nationales, régionales et locales. Sans oublier le défi de trouver les bons artisans et de coordonner la pose. Pour aider les clients face à cette complexité, nous avons créé une mission appelée “responsable de rénovation énergétique” (REE), qui les accompagne de A à Z dans leur parcours et coordonne diagnostics, conception du projet global, suivi des travaux réalisés par nos artisans partenaires, financement et obtention des aides. Un client qui serait intéressé par une rénovation énergétique est mis en relation avec un REE en magasin. Celui-ci établit d’abord le diagnostic de la maison et, en fonction de l’éligibilité du client, de son système de revenu, des différents scénarios envisagés, il identifie les points de travaux nécessaires, il monte le dossier administratif et les demandes d’aides, il met en relation le client et les artisans, puis il coordonne les travaux jusqu’à la fin du chantier pour s’assurer de son bon déroulement.
C’est un métier tout nouveau, que l’on peut exercer après une formation diplômante encadrée par la Solive. Aujourd’hui, nous en comptons une quarantaine dans nos magasins, l’objectif étant d’avoir un responsable minimum par grand bassin de magasins, voire par magasin.
Cette évolution s’inscrit dans une transformation plus large pour Leroy Merlin : proposer des produits les moins énergivores et les moins
carbonés possibles. Par exemple, l’isolation en biosourcé représente aujourd’hui à peine 5 % des produits de cette catégorie ; d’ici 2025, elle représentera 40 % de notre offre.
L’enjeu plus global, aussi, consiste à faire évoluer les modes de consommation, par exemple remplacer les ballons d’eau chaude de 300 litres, qui consomment beaucoup d’eau, beaucoup d’électricité, par de plus petits, d’une centaine de litres, et prendre des douches plus courtes ; l’hiver, chauffer la maison à 19 degrés plutôt que 21, etc. Ces changements comportementaux ont un impact à titre individuel sur la facture d’électricité et la consommation d’eau, mais aussi, collectivement, sur la planète et l’économie des ressources.
Le sujet de la rénovation énergétique est vraiment devenu une bataille chez Leroy Merlin, qui nous mobilise tous et toutes. Aujourd’hui, même l’habitat neuf n’est pas aux normes visées par l’État pour 2050. Les classes énergétiques
A et B ne représentant que 4 % de l’habitat actuel en France, je vous laisse imaginer le champ des travaux qui se profile devant nous. C’est quasiment une mission d’intérêt public… Voilà pourquoi tous les acteurs sont les bienvenus. »
Le sujet de la rénovation énergétique est vraiment devenu une bataille chez Leroy Merlin, qui nous mobilise tous et toutes.
107
LE BUREAU, DU MOBILIER
AU TÉLÉTRAVAIL
Histoire
Il était une fois le bureau...
Tablette portant le texte d’un mythe de création sumérien, période néo-sumérienne, 3e millénaire av. J.-C., Irak, Paris, musée du Louvre. Photographie GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Franck Raux.
C’est peut-être le mot le plus riche de toute la maison. Le bureau. Est-ce un meuble ou une pièce ? Un ensemble de collègues ou l’adresse où l’on travaille ? Pour raconter l’histoire de cette pièce au sein de l’habitat, en France aux xxe et xxie siècles, voyageons dans le temps et dans l’espace. Des scribes à la Silicon Valley…
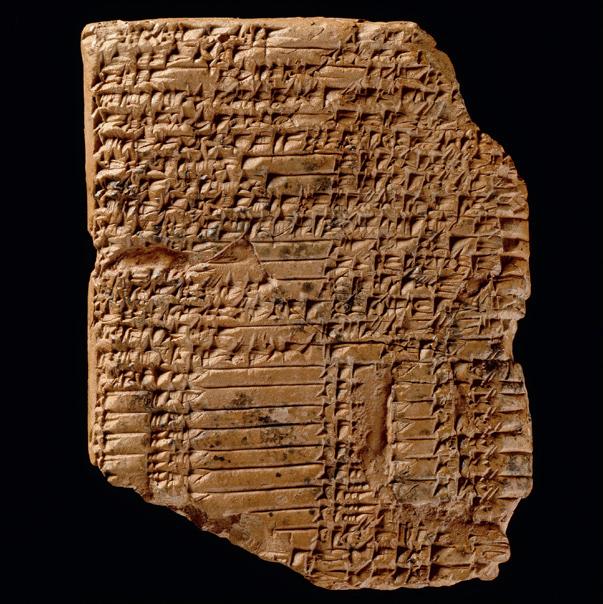
le BUREAU 110
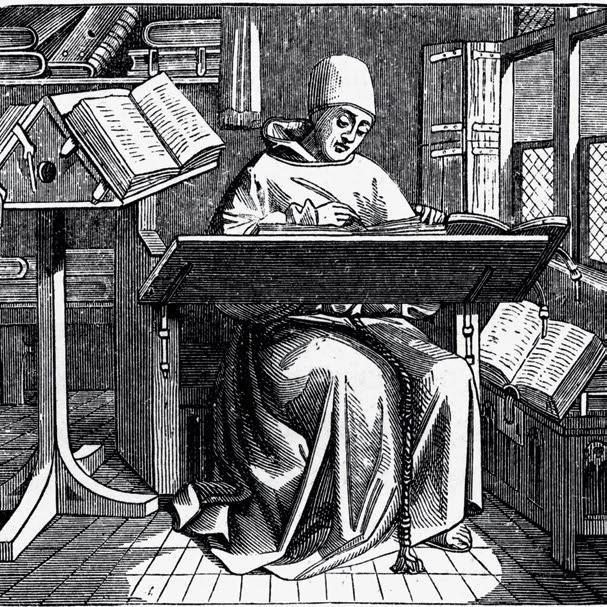
Scribe ou moine copiste, gravure Paul Lacroix, 1870. Photographie The Print Collector, Heritage Images, Alamy.
Notre promenade de pièce en pièce s’arrête sur un lieu insaisissable. Il est difficile de dater son apparition. Tout dépend de ce qu’on entend par bureau et jusqu’où s’étend l’habitat. Partons du principe qu’il désigne un espace dédié au travail. Dans ce cas, le premier bureau pourrait bien être l’ancêtre du smartphone, nomade, qui tient dans la paume de la main : la tablette de cire. Cette petite planche de bois recouverte de cire permet d’écrire et de réécrire à l’infini à l’aide d’un stylet. La plus ancienne connue
nous emmène loin, en Mésopotamie, au xive siècle avant Jésus-Christ !
Traversons les siècles jusqu’à ce que l’écriture sur parchemin fixe un lieu. Nous voilà au Moyen Âge, non pas dans une demeure, mais dans l’atelier d’une abbaye où un moine copiste confectionne un manuscrit. La souplesse du parchemin nécessite un support solide et confortable, un pupitre, recouvert d’une bure qui absorbe les surplus d’encre. Une bure ? Ce mot vient de burel, ou « étoffe grossière » de couleur rouge-brun, ou de buriaus qui prend le sens de « table où l’on fait les comptes ». Arrêtons-nous là et observons l’habitat au xive siècle. Les premiers bureaux apparaissent alors dans les châteaux et les demeures de nobles français, aménagés dans des tours ou des recoins. C’est là que les seigneurs et administrateurs tiennent leurs comptes.
111
Le bureau, à la fois le meuble et la pièce, emprunte divers noms au fil du temps. Citons le secrétaire à abattant, qui conserve secrets des documents, billets galants ou argent, dans des compartiments dissimulés. Citons aussi le cabinet, qui est le nom courant de la pièce jusqu’au xxe siècle. Comme l’écrit la spécialiste de l’habitat Monique Eleb, le cabinet « forme avec la chambre et la garde-robe le dispositif du petit appartement. Ce bureau est alors l’une des pièces les plus représentatives du statut de l’habitant. Orné de tableaux, de tapis précieux et souvent meublé d’un lit de repos, il est plutôt masculin, mais, jusqu’à la fin du xviiie siècle, des femmes aristocrates s’y retirent pour faire leur courrier voire écrire des livres¹ ».
Au détour du passé lointain, le bureau se révèle donc être un privilège, réservé à une élite sociale. Il faut attendre l’essor du commerce et de l’industrie pour qu’il atteigne les classes moyennes. Dans les années 1900, une maison bourgeoise inclut souvent cette pièce où l’on peut gérer ses affaires personnelles, à l’abri des regards. C’est aussi un lieu de réflexion et d’évasion qui se confond parfois avec la bibliothèque. Imaginez des murs tapissés de chêne, un air imprégné de l’odeur de livres anciens, un bureau en acajou massif : symbole de réussite pour les uns, sanctuaire de savoir pour les autres, et pour les artistes et les savants, le berceau du génie.
Les avancées technologiques contribuent à développer l’adoption du bureau, et de nouveaux objets trônent sur le meuble : la machine à écrire, le téléphone et plus tard l’ordinateur.
Dans les années 1920 et 1930, le meuble évolue sous l’influence du style Art déco, plus généralement de l’architecture moderne, vers davantage de simplicité. On peut citer le bureau MT876 de Pierre Chareau, en bois et métal, que l’artiste décorateur conçoit pour la Maison de verre à Paris. Ses lignes extrêmement épurées contrastent tant avec les secrétaires « à l’ancienne » !
La démocratisation du bureau fait face à une contradiction : d’un côté, le meuble, produit en masse avec l’explosion du secteur tertiaire, se popularise largement ; de l’autre, les habitats, en particulier citadins, manquent de place pour lui consacrer une pièce entière. Avoir un bureau dans un coin du salon entre cependant dans les mœurs, en particulier à partir des Trente Glorieuses. Les avancées technologiques contribuent aussi à développer l’adoption du bureau, et de nouveaux objets trônent sur le meuble : la machine à écrire, le téléphone et plus tard l’ordinateur.
La révolution numérique
L’introduction de l’informatique chez les habitants dans les années 1990, surtout l’Internet, est la première étape de la petite révolution de l’habitat que nous connaissons tous. Un détail annonce déjà les changements majeurs de notre rapport au travail et au bureau. Dès les premiers systèmes d’exploitation graphiques, notamment Windows de Microsoft, l’interface de l’utilisateur s’appelle « bureau » (office en anglais). Une fois n’est pas coutume, le bureau prend un sens nouveau. C’est une métaphore visuelle représentant un espace de travail, des dossiers et des fichiers sous forme d’icônes. L’idée est de rendre
le BUREAU 112

« Paul Bourget », in Nos contemporains chez eux. Photographie Paul Marsan dit « Dornac », xixe siècle, Paris, ENSBA. Photographie Beaux-Arts de Paris, Dist. GrandPalaisRmn / image Beaux-arts de Paris.
l’ordinateur convivial et intuitif en l’associant à des objets et des concepts de la vie quotidienne. Des étagères visibles et des tiroirs fermés. Savons-nous à l’époque combien cette nouvelle « étymologie » anticipe la dématérialisation et le nomadisme à venir ?
Paradoxalement, au début du xxie siècle, alors que les frontières physiques et matérielles se brouillent, le bureau devient une question centrale dans les projets immobiliers. Les bailleurs prévoient soit un espace de coworking au pied des logements sociaux, soit des coins bureaux dans les appartements plus haut de gamme. La transformation du monde du travail est profonde et multiple : l’essor de l’entreprenariat, le cumul des métiers par les slashers ou encore le télétravail confirment la nécessaire présence d’un espace de travail à domicile.
1 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
113
Cabinet de travail de la reine Marie-Amélie aux Tuileries, peinture sur porcelaine, JeanCharles Develly, 1841, Paris, musée du Louvre. Photographie GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi.

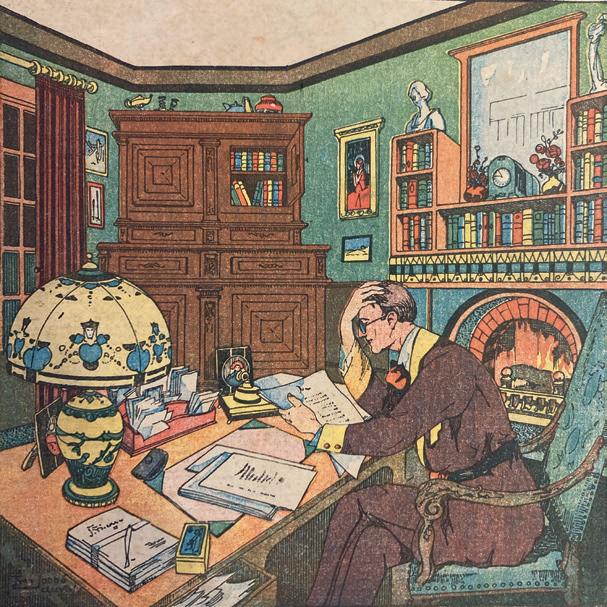
« Le cabinet de travail de Monsieur », Félix Jobbé Duval illustrateur, Les Dimanches de la femme, 24 septembre 1922. CCO.
le BUREAU 114

LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 1930-1982
Du papier à lettres et une plume, une machine à écrire, un Minitel, un ordinateur… À toutes les époques, des objets de correspondance trônent dans le bureau et lient les habitants au monde extérieur.
La place de l’ordinateur dans l’habitat bouleverse toutes les habitudes. Y compris les modes de consommation de l’habitant : autrefois, son « shopping maison » se faisait dans un catalogue en papier, puis il a adopté le téléphone pour passer commande, et aujourd’hui il surfe sur la boutique en ligne.
Dès le début des années 1930, Au Stock Américain (l’ancêtre de Leroy Merlin) lance les premiers catalogues produits, organisant ainsi la vente par correspondance qui existe déjà de manière informelle.
Les consommateurs avaient coutume de commander les produits qu’ils connaissaient par cœur, par lettre, sans bon de commande. Ils versaient un acompte à la commande et réglaient le solde au chauffeur à la livraison, autrement la marchandise repartait.
Ce service de livraison gratuite a été mis en place dès les débuts du Stock dans un rayon de cent kilomètres grâce à trois camions Renault. Par la suite, chaque magasin a possédé sa propre flotte de livraison et ses chauffeurs. Certains y voient
l’une des raisons du succès de l’entreprise. La livraison reste gratuite jusqu’à ce que la crise pétrolière de 1973 inaugure le « prix emporté – prix livré ». En 1977, sur l’exemple de Conforama, la société instaure le prêt de camionnettes permettant au client de rapporter chez lui ses marchandises en bénéficiant du prix emporté.
115
Extrait du catalogue Au Stock Américain, début des années 1930. Archive Leroy Merlin.
Sociologie
Le télétravail ou la maîtrise du temps et de l’espace
En 2020, un invité surprise arrive chez les habitants et décide d’y rester : le travail. Une installation précipitée, mais préparée depuis le début du xxie siècle. Le bureau se métamorphose et se greffe sur toutes les pièces de l’habitat. Réflexions en compagnie de la sociologue Djaouidah Séhili et de la designer-illustratrice Sandra Villet².
Depuis vingt-cinq ans, j’ai régulièrement pris en photo mes bureaux successifs et tout ce qui s’y trouvait : livres, lampes, cahiers, images, cartes, petits mots, bougeoirs et boîtes d’encens, bols et théières, confiseries, bijoux, stylos, tubes de colle ou de crème. Quand je les regarde, ces natures mortes me replongent aussitôt, comme si je respirais un parfum, dans l’atmosphère d’une période de ma vie³. »
Ces lignes de Mona Chollet résonnent chez toutes celles et ceux qui investissent leur espace de travail. On se dit qu’un bureau, c’est vrai, ça ne
se partage pas. C’est intime. Pourtant, on dirait que ce rapport très sensible vient d’une autre époque, d’un espace disparu. Tous les repères du bureau, tel qu’on l’a connu pendant les Trente Glorieuses, volent aujourd’hui en éclats. On le dit désormais « flexible », non seulement dans le monde de l’entreprise, mais aussi à la maison. Dans un même foyer, chacun peut suivre sa « visio » à tour de rôle, depuis un même bureau, du cours de soutien scolaire avec un professeur à la réunion virtuelle avec des collègues. Et encore, même cette configuration paraît désuète car le travail de bureau ne nécessite plus de rester vissé à un poste fixe. Un écran, d’ordinateur portable ou de smartphone, suffit pour travailler, n’importe où dans la maison. Le travail et l’habitat se percutent pour former un espace-temps hybride que les sociologues Djaouidah Séhili, Tanguy Dufournet et Patrick Rozenblatt appellent le « trabitat » et le « travail multi-situé chez soi ».
le BUREAU 116
«
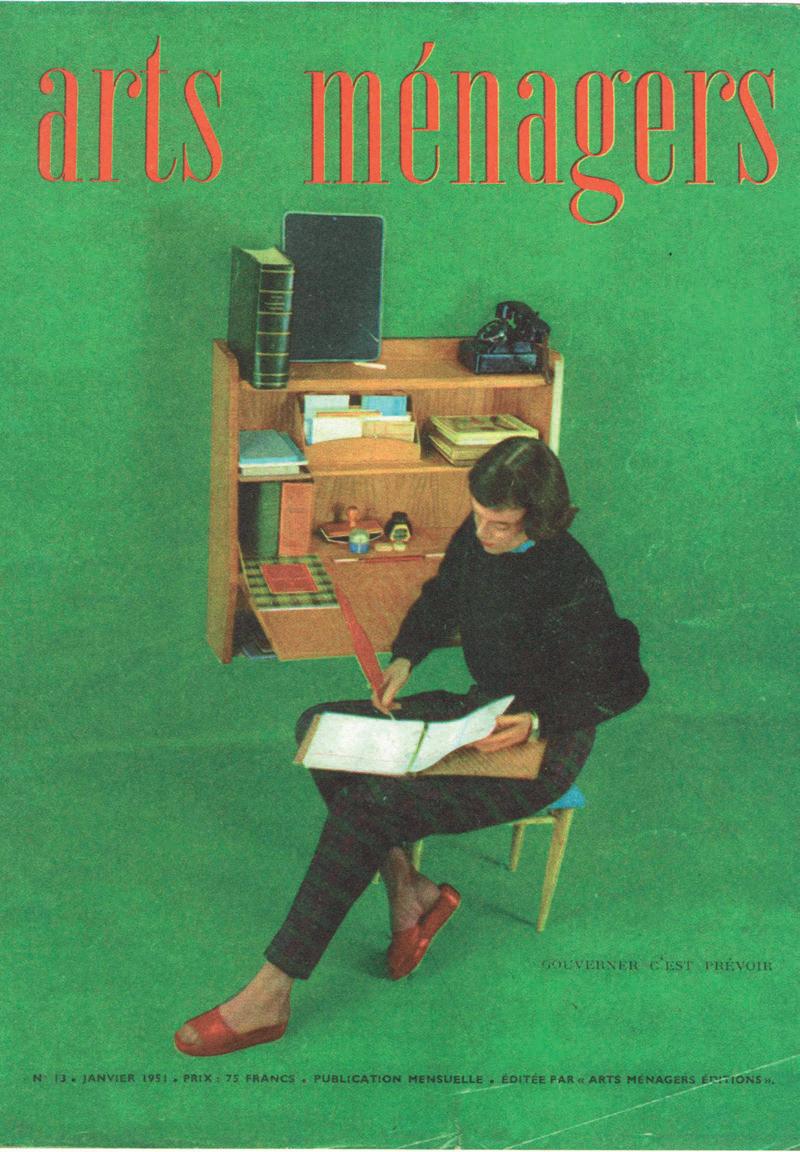
117
Couverture de la revue Arts ménagers, janvier 1951. Photographie Arts ménagers.
Le bureau se dématérialise donc, ou plutôt le travail se matérialise autrement. C’est d’abord une intrusion spatiale. Des objets visibles, parfois oubliés, occupent l’horizon domestique : un dossier qui traîne, un ordinateur qui vous suit partout, du matériel parsemé çà et là. Aucune pièce n’y échappe, ni même les WC où certains avouent démarrer leur journée en lisant leurs e-mails sur leur téléphone. L’intrusion est aussi temporelle, du fait de décalages horaires au sein d’une équipe, ou des multiples moments consacrés aux messages professionnels en dehors du temps de travail. Même l’artisan qui travaille en dehors du domicile ou dans un atelier bien séparé de la maisonnée est amené à gérer ses commandes ou répondre à des messages une fois rentré chez lui. Chassez-le par la porte, le travail revient par la fenêtre. Partout. Tout le temps.
Décodons les différents profils du travail à domicile
Lors de leur enquête sur l’essor du travail chez soi avant et pendant la pandémie de la Covid-19, les sociologues Djaouidah Séhili, Tangy Dufournet et Patrick Rozenblatt, ainsi que la designer-illustratrice Sandra Villet, ont observé les pratiques d’un échantillon d’habitants et défini six « profils » de travail à domicile. Lequel s’invite chez vous ?
Les portraits-robots nous donnent des pistes pour canaliser cet invité qui peut s’avérer envahissant :
• Le « travail chez soi encadré » : dans cette maison, le travail qu’on appelle donc « l’invité » dispose de sa chambre d’ami et n’en sort pas. Les temps et les espaces sont bien délimités, par exemple il n’est pas autorisé à pénétrer dans la chambre.
• Le « travail chez soi non encadré » : ici, c’est l’inverse : l’invité se comporte en roi. Tous les temps et les espaces lui sont consacrés : « le logement tout entier est un open space », pourrait-on dire.
• Le « travail chez soi domestiqué » : c’est une cohabitation harmonieuse où habiter prime sur le travail. L’invité trouve sa place sans l’occuper exclusivement, par exemple grâce à des cloisons amovibles qui délimitent les espaces de chacun.
• Le « travail chez soi non domestiqué » : l’invité virevolte dans tous les sens, mais la cohabitation se met en place peu à peu, l’expérience offrant des leçons à l’habitant. Par exemple, les enfants ou le conjoint viennent limiter l’empiètement du travail.
• Le « travail chez soi ritualisé » : l’emprise de l’invité est limitée, grâce à des rituels mis en place et respectés au quotidien. Des moments et des lieux excluent le travail, par exemple promener le chien pour terminer la journée.
• Le « travail chez soi non ritualisé » : l’habitant n’arrive pas à maîtriser le temps pour l’invité. Le travail est partout et omniprésent.
le BUREAU 118

119
Illustration Andréa Mongia.
Que nous disent ces profils ?
Qu’il est impossible de dissocier le temps et l’espace : le défi pour l’habitant consiste à concilier les deux. Une pièce dédiée au travail permet à priori de mieux l’encadrer, surtout si elle est nécessaire à l’exercice de l’activité (poterie, consultation médicale…). Autrement, il s’avère plus compliqué de restreindre le travail à la pièce et au temps qu’on y passe : les « télétravailleurs » passent de la cuisine au canapé, du canapé à leur bureau. Le travail est non seulement multi-situé entre entreprise et habitat mais aussi multi-situé au sein même de la maison !
Ainsi, les chercheurs observent de nombreux espaces-bureaux non occupés par des habitants qui préfèrent travailler ailleurs dans la maison. En plus de la nature de l’activité, un autre facteur semble jouer : l’âge. Plus l’habitant-travailleur est jeune, plus la tendance à l’éparpillement dans l’habitat et à l’emprise du travail est forte. Il faut mentionner aussi la question du genre.
L’enquête, pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, révèle la tendance des hommes à se réapproprier l’espace de travail préexistant, jusqu’alors plutôt investi par leurs femmes qui jonglaient déjà entre vie professionnelle et vie privée.
Une révolution à apprivoiser
Les sociologues alertent sur l’extrême rapidité des changements en cours, expliquant que l’adoption du travail chez soi est un processus long, qui nécessite d’expérimenter des aménagements pour arriver à une situation vivable, confortable et idéale. Des solutions intéressantes permettent d’organiser l’espace de façon harmonieuse et souple, sans le fermer
complètement, en laissant passer la lumière ou le végétal ; par exemple des persiennes ou du mobilier modulaire. Pour le corps statique et assis dont l’exercice est sous-sollicité, des solutions ergonomiques restent à inventer. Il faut mettre en place des transitions, y compris de silence, pour mettre l’esprit et le corps au repos. D’autant que, pour beaucoup, le mobilier personnel est utilisé pour le travail même s’il n’est pas adapté, parce que l’on n’avait pas prévu de travailler chez soi et parce que l’équipement de l’espace de travail chez soi n’a pas forcément été organisé avec l’employeur.
Qu’en est-il de la joie d’être chez soi ?
Nombreux sont les habitants qui en témoignent. Ils aiment le contact sensoriel avec l’atmosphère de leur logement. Telle habitante travaille chez elle comme psychologue, dans une pièce dédiée, porte fermée, mais elle tient à rester connectée à son chez-elle grâce à des fleurs cueillies dans son jardin et posées dans son bureau. Telle autre se retrouve positionnée devant ses vélos lors de visioconférences. Il s’agit ainsi de nouvelles manières de tisser du lien, en donnant à voir une part qui pourrait/devrait être cachée selon les anciens codes, ceux du monde d’avant… L’intrusion du travail force à se réapproprier l’habitat, à le réinventer, pour ne pas subir une organisation temporaire mais embrasser pleinement de nouveaux modes de vie consentis. Dessiner des frontières, découper le temps, pour que le travail ne soit pas le seul habitant.
2 Djaouidah Séhili, Patrick Rozenblatt, Tanguy Dufournet et Sandra Villet, L’Essor du « travail multi-situé chez soi » et les modalités spécifiques d’organisation du travail, Les chantiers Leroy Merlin Source no 46, 2021.
3 Mona Chollet, Chez soi, Éditions Zones, 2015.
le BUREAU 120

Le mobilier personnel, parfois improbable, est utilisé pour le travail même s’il n’est pas adapté... Photographie Valentin Belleville / Hans Lucas.
121
LA s OBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Nous l’avons vu, le bureau se propage dans tous les recoins de la maison. Dans son Odyssée de l’espace domestique, Mona Chollet décrit avec justesse comment l’habitat à l’ère d’Internet combine deux mouvements opposés. Un premier mouvement de l’extérieur vers l’intérieur fait surgir une « foule de parfaits inconnus » en permanence chez soi. Et, de l’intérieur vers l’extérieur, une multitude d’activités nous contraint désormais à un tête-à-tête avec l’écran, en ligne.
« À partir de quelle heure on ne regarde plus son smartphone ? Faut-il l’utiliser en vacances ?
Dans quelle pièce faut-il l’interdire ou désactiver les notifications ? » Ces interrogations d’Alexis Masset, responsable digital chez Leroy Merlin, posent la question de la sobriété numérique. Un
sujet très vaste, car il s’agit non seulement de réduire son empreinte carbone, mais aussi de préserver la quiétude chez soi – quiétude menacée par ces incessants va-et-vient numériques.
Le fait que les activités digitales génèrent une pollution de l’environnement commence tout juste à être connu du grand public. L’empreinte du numérique sur terre représente en effet 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre en France⁴, et la croissance de cette part est exponentielle. De la fabrication des équipements à leur recyclage, toute la chaîne produit un impact, y compris sur la biodiversité, sur l’eau, sur l’air. Or c’est une réalité, l’habitat est de plus en plus connecté, des smartphones et autres IoT (« Internet des objets ») à la domotique ou l’automatisation de
le BUREAU 122
la maison. Cela peut heureusement avoir des effets positifs sur l’environnement, comme la gestion des bâtiments en autonomie, mais aussi négatifs. Comment trouver le bon équilibre ?
C’est le cœur du sujet, selon l’expert en digital : « En tant que leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat, notre mission est de montrer la voie, d’exprimer des partis pris, pour aider les habitants à prendre de bonnes habitudes de sobriété. Vivre dans un habitat à la fois numérique, responsable et positif s’apprend : c’est à nous de transmettre cette pédagogie pour que chacun puisse faire ses choix en conscience. Ensuite, chaque foyer vit bien sûr selon son propre mode de vie. »
Un habitat positif, pour être cohérent, ne doit pas générer une pollution numérique qui annulerait ses gains en énergie. Une frugalité s’impose et oblige parfois à revenir à des solutions non digitales. Il y a, au cœur de cette frugalité, la relation humaine, comme l’explique l’expert : « La relation humaine est dans l’ADN de Leroy Merlin, notamment dans notre rapport au numérique. C’est un peu le même type de rapport qu’il faut instaurer dans l’habitat de demain : toujours mettre la relation humaine avant les processus digitaux. Il faut distinguer le numérique qui a une interface avec l’humain et celui qui n’en a presque pas. Un volet qui se ferme et s’ouvre en automatique, quand la nuit tombe et que le jour se lève, fait économiser de la ressource en chauffage sans interaction avec l’habitant. Dans un espace-chambre, ce type de numérique ne pose pas problème parce qu’il n’entame pas cet espace réservé, soit à la relation, soit au calme. En revanche, un écran dans la chambre qui bipe, affiche les news, vient popper des notifications, provoque des perturbations. »
La frugalité digitale, c’est donc une digital detox, autrement dit, le tri des interactions et perturbations entre le digital et l’humain à l’intérieur d’un cocon protégé. Nous vivons dans un monde où l’information afflue constamment : l’habitat ne doit pas alourdir la charge mentale mais plutôt décharger mentalement. Il doit rester un « espace-ressource » pour ceux qui y habitent. Certaines pièces sont plus ressources que d’autres : la chambre, espace à soi, régénère par le sommeil ; la cuisine, espace social, régénère par la nourriture et la convivialité. La frugalité numérique permet de préserver ces pièces ressources. Elle facilite le fait d’habiter grâce à des outils digitaux, tout en limitant les intrusions. Cela dit, les limites sont difficiles à mettre en place. Alexis Masset nous invite à les définir en conscience :
« L’habitat de demain doit tirer profit d’une domotique facilitante et la moins intrusive possible. Un habitat connecté-déconnecté. »
Déconnecté d’une forme d’extérieur pour que l’habitat reste un environnement ressource. Connecté à l’intérieur pour la même raison et pour réduire son impact environnemental.
LA sALLE DE BAIN, LE CORPs ARCHITECTE
Histoire
Se baigner ou non, telle est la question
Il était une fois la salle de bain. Des thermes antiques à la salle de bain connectée, plus de deux millénaires d’histoire, miroir de l’évolution de la société, du rapport au corps et à l’hygiène. Le sociologue Benjamin Pradel¹ nous guide au pays du bain, de collectif à individuel, de public à privé, de bassine ambulante à pièce intime.
Une salle de bain XXL et publique. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier les thermes à la romaine, ancêtres méconnus des clubs de sport huppés, en version gratuite : lavage, massage, repos, bavardage, sport, restauration, affaires… Des lieux où l’on socialise et où la pudeur n’existe pas encore. Un bond dans le temps, nous voilà chez les moines cisterciens au xiie siècle. Eux aménagent une pièce avec une fontaine nommée lavabo, pour se laver les mains avant d’entrer à l’église ou au réfectoire. À cette époque, les
plus aisés possèdent une cuve d’eau froide, tandis que les habitants des villes fréquentent les étuves ou les bains publics, qui sont mixtes. Cachez ce corps que je ne saurais voir ! L’Église condamne la promiscuité des corps après le concile de Trente (1545-1563) : le corps devient source de péché et doit être caché, des autres et de soi-même. Aussi, l’eau est accusée de causer les épidémies de peste et de syphilis. Et c’est ainsi que, peu à peu, la pratique des bains publics s’arrête.
Cette méfiance envers l’eau donne naissance à la toilette sèche, à la Renaissance. La propreté n’est alors qu’une façade. On camoufle la saleté en changeant de vêtements, surtout si l’on est riche, et les odeurs avec des parfums, poudres et pommades. Les eaux sales sont vidées dans les rues… L’hygiène telle que nous la connaissons est encore loin !
la sALLE DE BAIN 126
Peinture représentant des thermes sous la

127
Rome antique, The Baths of Caracalla, Alma-Tadema Lawrence, 1899. Bridgeman Images.
L’expression « salle de bain » apparaît dès 1691, mais ce n’est qu’en 1765 que son sens moderne se répand : une pièce aménagée pour prendre un bain. À ce besoin nommé de privatiser le bain, correspondent les notions d’individu et d’intimité qui apparaissent et marquent un tournant dans le rapport au corps à la fin du xviie siècle. Dans les classes aisées, les femmes bénéficient d’un cabinet de toilette attenant à la chambre. L’eau est apportée par des domestiques et vidée dans les meubles lavabo. Y a-t-il quelqu’un pour porter l’eau ? Au xviiie siècle, seuls les aristocrates et les grands bourgeois urbains peuvent s’offrir la main-d’œuvre nécessaire pour amener et chauffer l’eau dans les salles de bain. Les bains et l'hygiène font alors leur réapparition dans les palais. Puis les bains publics reviennent à Paris (piscines, cabinets de bain), ainsi que les premières latrines collectives dans les maisons.
Un bain tous les deux ans. Voilà en moyenne la fréquence des bains d’un Français en 1850 ! La découverte du microbe par Pasteur inaugure cependant l’ère de l’hygiène au xixe siècle. Pour mieux se défendre, il faut se laver !
Dans les campagnes, on continue de se laver dans les ruisseaux, mais les progrès de la fontainerie accélèrent la distribution de l’eau.
À Paris, Haussmann réalise un réseau de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux usées pour les quartiers privilégiés. Dans les hôtels particuliers, on pratique le lavage à l’éponge dans un tub que l’on remplit à l’aide d’un broc. Quant aux plus modestes, ils « tubent » dans la cuisine, où l’évier est le seul point d’eau de la maison, ou bien dans la chambre, parfois derrière un rideau.
Au début du xxe siècle, il y a deux France. Une minorité de citadins est sensibilisée à la notion d’hygiène, grâce à la médecine et à l’école ; c’est le corps qui se lave régulièrement. Et, parmi la grande majorité de la population rurale, les habitudes peu hygiéniques, parfois liées à des croyances, persistent. C’est le corps perçu comme puissant parce qu’il sent fort, protégé contre les maladies par la saleté. Baignoires en fonte émaillée, granit-porcelaine, acier émaillé, acrylique, douches latérales encastrées : les équipements se diversifient, mais restent chers et la grande majorité des maisons n’est pas dotée de pièce spécifique. Le grand public utilise toujours le tub avec son broc de service.
Dans les habitations du début du xxe siècle financées par des industriels philanthropes sont expérimentées des salles de bain collectives puis privatives. Les habitations bon marché (HBM), qui verront le jour peu après, reprendront ce principe. L’hygiène et ses nouveaux usages représentent alors un progrès. À l’avantgarde, on trouve aussi des projets d’architectes qui conçoivent pour des clients fortunés de magnifiques salles de bain.
Un bain tous les deux ans. Voilà en moyenne la fréquence des bains d’un Français en 1850 !
la sALLE DE BAIN 128
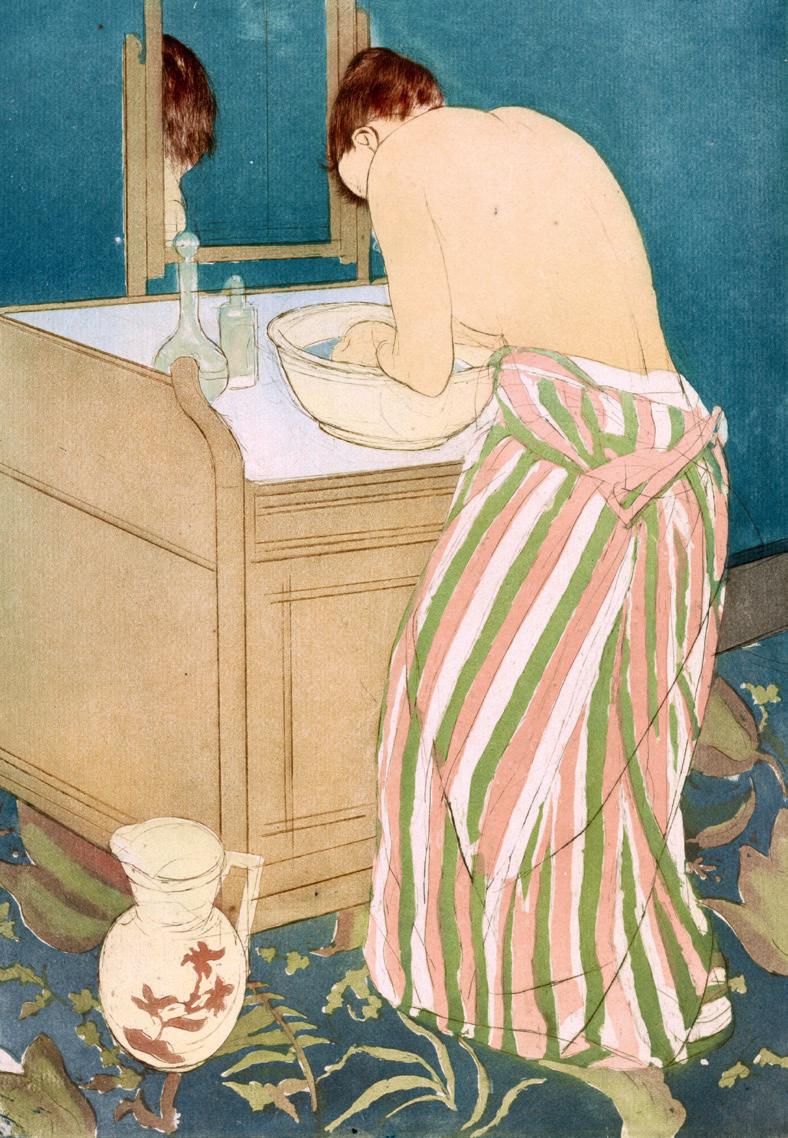
129
La Toilette, aquatinte, Mary Cassatt, 1890-1891, Paris. Photographie Granger, Alamy.
Celle de la villa Savoye témoigne, dès 1931, de la volonté de Le Corbusier d’en faire une pièce saine, aérée, lumineuse et pratique du fait de son emplacement attenant à la chambre. Et la démocratisation s’opère grâce à l’enseigne Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) : certains produits réservés aux classes aisées et symboles de confort sont démocratisés dès les années 1930, par exemple les appareils sanitaires en céramique et grès émaillés vendus à moindre coût.
Après la Seconde Guerre mondiale, seuls 10 % des logements disposent d’une baignoire ou d’une douche. La proportion atteint la barre des 50 % en 1970. Dès 1968, Leroy Merlin poursuit la démocratisation de la salle de bain en présentant des produits sanitaires dans ses catalogues. Dans les magasins, des pièces entières sont mises en situation dans des box, avec le souci du détail – savons, serviettes, gants de toilette, carrelages et autres accessoires. Une première en France, si bien que des clients demandent alors d’emporter le tout chez eux à l’identique, savon compris ! Au fil des décennies, le corps propre, le besoin d’intimité aussi, redessinent l’habitat français.
Après la Seconde Guerre mondiale, seuls 10 % des logements disposent d’une baignoire ou d’une douche. La proportion atteint la barre des 50 % en 1970.
Les constructions de grands ensembles intègrent des salles de bain et les pavillons prévoient des chambres plus petites pour pouvoir en accueillir².
En 2000, on compte presque 100 % de salles de bain dans les logements en France. On projette de plus en plus de désirs pour cette pièce. En plus de la toilette basique, on soigne autant que possible le confort (double vasque, douche à l’italienne), l’esthétique (matériaux nobles) et la consommation d’énergie (économie d’eau, ventilation). Les vœux ne sont pas toujours exaucés, car la salle de bain reste onéreuse et difficilement idéale : c’est une « pièce totale » où toutes les problématiques techniques de l’habitat s’entrechoquent.
1 Benjamin Pradel, La Salle de bains, entre désirs et contrariétés, état de l’art n°3, Leroy Merlin Source, 2022.
la sALLE DE BAIN 130

131
Salle de bain de la villa Savoye, Poissy, Le Corbusier architecte, 1928-1931. Photographie Alamy. ©F.L.C. / Adagp, Paris, 2024.

Salle de bain. Photographie album Maciet, bibliothèque des Arts décoratifs, Paris.
Jeune femme dans sa salle de bain, 1974. Photographie Bridgeman Images.
Les constructions de grands ensembles intègrent des salles de bain et les pavillons prévoient des chambres plus petites pour pouvoir en accueillir.

la sALLE DE BAIN 132

133
Couple dans une salle de bain, années 1960. Photographie Bridgeman Images.

la sALLE DE BAIN 134
Illustration Andréa Mongia.
LA FONDATION LEROY MERLIN, LES FONDATIONS D’UN HABITAT INCLUSIF
Le chemin d’acceptation du handicap ou de la perte de mobilité est long. Longtemps, on s’adapte à la pièce plutôt qu’on ne l’adapte : enjamber la baignoire, se contorsionner pour que l’aidant et l’aidé ne se gênent pas dans des espaces réduits, porter un enfant handicapé dans l’escalier pour le mener à sa chambre ou à la salle de bain… Jusqu’à ce qu’un jour, en raison d’une chute ou juste d’un enfant devenu trop lourd pour que l’on puisse le porter, ce ne soit plus possible. On décide enfin de se faire aider. Quand le dossier arrive à la fondation, il y a souvent une notion d’urgence.
La fondation Leroy Merlin accompagne et finance des travaux d’aménagement du logement pour des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui en font la demande en magasin. Des équipes du magasin Leroy Merlin concerné instruisent le dossier, le font remonter jusqu’à un comité d’évaluation des projets, qui émet ensuite un avis. Si celui-ci est positif, un accompagnement de la famille demandeuse se met en place avec comme cap non pas la réponse à un besoin immédiat, mais une projection dans dix ans. Le parti pris est de penser tout de suite le projet à l’échelle d’une maisonnée qui évolue, au-delà du seul handicap.
Cette démarche d’accompagnement correspond à l’ambition des débuts. Lors de sa création en 2006, la fondation souhaitait mobiliser les collaborateurs de l’entreprise, leur appartenir à eux, et non à un conseil d’administration. Cette intention de fédérer se retrouve dans chacun des plus de 1 000 projets accompagnés jusqu’à présent. Des projets d’adaptation de salle de bain et de toilettes, mais aussi des aménagements de garage ou d’extension pour créer une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée, ou encore des accès facilités à l’extérieur et à l’intérieur… Si à chaque fois l’autonomie reste le but premier, on observe aussi combien la circulation entre les pièces est importante. Les projets de la fondation permettent de « désenclaver » les pièces de l’habitation. Alors, la personne en situation de handicap et ses accompagnants peuvent assumer leur interdépendance et leur autonomie, grâce à une dignité restaurée.
135

la sALLE DE BAIN 136
Jeune fille atteinte du syndrome de Down en plein atelier de bricolage. Photographie Anna Stills, Alamy.
FABLIFE OU LE GOÛT DE LA VIE
En France, l’approche la plus répandue vis-à-vis du corps handicapé ou âgé est très médicalisée : un corps différent ne pourrait exister autrement qu’en institution. Le concours Fablife a le mérite de redonner de la vie en encourageant le maintien à domicile. Pascal Dreyer, coordinateur scientifique et chercheur associé de Leroy Merlin Source, nous en raconte la genèse : « En 1991, en tant que responsable des actions françaises de Handicap International, je crée Déclic, un magazine dédié à la famille et au handicap. Nous partons alors d’un constat : les familles d’enfants en situation de handicap rencontrent des difficultés dans l’accompagnement au quotidien. Nous savons que les mères ont la charge de la santé et de l’éducation de ces enfants. Mais quel rôle jouent les pères, les oncles, les cousins ? C’est après avoir rencontré M. Facon, le père d’une petite fille en situation de handicap habitant à Lille, que nous avons l’idée de créer avec lui le Concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses, rebaptisé quelques années plus tard Fablife. Ce concours a pour objectif de récompenser l’inventivité des parents, et plus particulièrement des pères, qui créent des solutions dans le logement pour que l’enfant vive le plus normalement possible avec sa famille. À la recherche d’un sponsor, je rencontre Leroy Merlin qui s’enthousiasme pour le projet et apporte son soutien. Le Concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses est né ainsi, parrainé par Jérôme Bonaldi, une star des années 1990. Chaque année, depuis 1997, le concours récompense les meilleures innovations et astuces créées par des parents, hors aide technique médicale. Les prix décernés couronnent à la fois des aides techniques, comme par exemple la construction d’une rampe spécifique, et des aides au jeu, comme le fait de pouvoir jouer au Scrabble grâce à de petits supports (pour avoir les lettres devant soi et pouvoir les manipuler). De nombreuses inventions visent ainsi l’autonomie de l’enfant, par exemple un système pour boire tout seul ou encore un parc estrade pour un grand enfant, où il peut bouger en toute sécurité sans que l’on voie que c’est un parc… Dans les premières années, une maman avait été récompensée pour avoir réorganisé tout son appartement selon un code fait de couleurs et de signes, facilitant le déplacement de son enfant autiste dans le logement. L’intention des parents, hier comme aujourd’hui, reste la même : banaliser l’aide technique et faire en sorte que la maison ne soit pas trop stigmatisée. Rien de pire pour une famille que d’accueillir des visiteurs dans une maison leur donnant ce sentiment : « Attention, vous entrez dans la maison d’une personne en situation de handicap. » Légitimer l’action des parents et des proches. Permettre à des enfants très atteints physiquement de vivre dans leur chambre aménagée et banalisée. Répondre au besoin d’humanisation de ces personnes. Ce qui est beau, finalement, c’est de restaurer la dignité au cœur de ce que l’on a de plus intime : le chez-soi. »
137
Décryptage
La pièce 3 en 1 : complexité technique, refuge intime et sas social
Êtes-vous plutôt baignoire à l’ancienne ou douche à l’italienne ? En cinq minutes top chrono ou adepte d’une évasion d’une heure ? Décryptons, dans cette pièce devenue incontournable, les tendances d’équipement actuelles. Quant à nos usages au xxie siècle, c’est le sociologue Benjamin Pradel qui les analyse avec finesse. Montrez-nous votre salle de bain et nous vous dirons qui vous êtes !

la sALLE DE BAIN 138
Photographie Leroy Merlin.

Imaginez que vous avez un projet de rénovation chez vous et que le budget ne vous permet pas de refaire toutes les pièces. Laquelle sacrifiez-vous ? La plupart des Français décideront de reporter les travaux de la salle de bain, en moyenne, rénovée tous les dix-sept ans ! De plus, cette pièce de moins de six mètres carrés a perdu la moitié de sa surface en un siècle – même si depuis les réglementations PMR (personnes à mobilité réduite), sa capacité doit au minimum accueillir la rotation d’une chaise roulante. Pourquoi, alors, négliger la salle de bain ? Parce qu’elle est
la pièce la plus complexe et la plus onéreuse de la maison.
Comme toutes les autres, voire plus encore, la salle de bain reflète les inégalités sociales : pour avoir une belle et grande salle de bain, il faut avoir de l’argent. Souvent elle est trop petite, ou l’on voudrait en avoir deux. Dans les logements collectifs, il manque en général une ouverture extérieure. On déplore d’ailleurs des problèmes de ventilation et d’humidité, ou d’électricité qui n’est pas tout à fait aux normes. Cette pièce rassemble des problématiques de plomberie, d’électricité, de carrelage mural et au sol, ainsi qu’un vrai enjeu d’étanchéité. Le défi, surtout, consiste à trouver un consensus entre la circulation et le niveau de confort des équipements souvent encombrants que sont la douche, la vasque et le meuble. Parfois s’ajoutent un espace WC et une zone buanderie, ce qui peut encombrer la pièce et la rendre peu pratique.
139
Illustration Andréa Mongia.
La séparation WC – salle de bain est d’ailleurs une tradition très française. De la même façon que les anciens cabinets de toilette visaient à séparer beauté et coquetterie d’une part, propreté et hygiène de l’autre, la salle de bain française abrite le « propre », tandis que les WC évoquent le « sale ». En sortant les WC de la salle de bain, le bidet, associé à la toilette intime, lui, disparaît ; en cause aussi, la réduction de la taille des pièces. Notons que le bidet s’utilise encore beaucoup en Italie, en Espagne et dans les pays arabes. Et au Japon, on utilise une sorte de deux-en-un, fusion entre toilettes et bidet, les washlets qui tentent de pénétrer le marché français.
Revenons à la salle de bain. Du fait de sa complexité et de son coût, elle est donc un marqueur social. Et pour le sociologue Benjamin Pradel, ce marqueur social – une salle de bain difficile d’usage, mal équipée, débordante ou trop partagée – peut contrarier une autre facette sociologique de la pièce : le processus d’individuation. Autrement dit, le désir de devenir soi-même en se différenciant des autres. De l’enfance à l’âge adulte, la salle de bain est un lieu de construction de l’identité : le rapport à son propre corps en tant qu’enveloppe charnelle, le rapport à la beauté et à l’apparence, le rapport au monde extérieur. Plus on grandit,
plus on met l’autre à distance et plus l’on veut s’enfermer dans la salle de bain – une pièce cruciale à l’adolescence, quand l’estime de soi et la préparation pour sortir se confondent. C’est un sas social, où l’on retire ses habits intimes, où l’on se prépare pour sortir, où l’on repasse en rentrant chez soi – le lieu où l’on redevient soi.
L’indétrônable baignoire où le temps s’arrête
Pourquoi la baignoire est-elle encore si répandue dans l’habitat français, à l’heure des prises de conscience écologiques ? D’abord, elle reste une nécessité pour couvrir tous les besoins, en particulier ceux des parents d’enfants en bas âge. Donner le bain en même temps à la fratrie, offrir à tous les enfants le plaisir du jeu d’eau et la découverte du corps, c’est plus compliqué dans une douche. Ensuite, la salle de bain est devenue plus qu’un espace d’hygiène : c’est un lieu de bien-être et de relaxation, dans lequel la baignoire joue un rôle important, symbole d’un temps que l’on s’accorde pour soi. La tendance de notre siècle est en effet d’y trouver refuge. Certains en font un spa à domicile, un cocon doux comme le coton, parfumé à l’encens, éclairé à la bougie.
Cela se reflète dans les choix de rénovation et de décoration, qui expriment un besoin de décompresser. Des végétaux, des matières chaleureuses comme le bois ou le bambou, des faïences et des zelliges, la pierre qui revient en force… Autant d’éléments naturels pour rompre avec la rudesse de la ville ou de la modernité. Sans oublier la chaleur indispensable du chauffe-serviettes. De l’enfance à l’âge adulte, la salle de bain est un lieu de construction de l’identité – le lieu où l’on redevient soi.
la sALLE DE BAIN 140

L’indétrônable baignoire. Photographie Leroy Merlin.

141
La salle de bain imaginée comme un spa à domicile. Photographie Leroy Merlin.
Le rêve de salle de bain des Français, la douche à l’italienne
On observe cependant une tendance nette : celle consistant à remplacer la baignoire par la douche. Plusieurs raisons l’expliquent : la hausse des prix de l’énergie, la recherche de gain de place par les promoteurs immobiliers, l’éveil de la conscience écologique, et surtout la perte de mobilité ou le vieillissement. Une douche à l’italienne, donc de plain-pied ou presque grâce aux receveurs extra-plats, a l’avantage de concilier bien-être et sécurité. Voilà encore une facette propre à la salle de bain, qui évolue en fonction des évolutions du corps. L’enfant en bas âge n’a pas les mêmes besoins que la personne qui vieillit… Chaque corps habite la pièce différemment. Il faut donc laisser le corps dicter l’habitat, en orienter les évolutions, pour que corps et habitat évoluent ensemble.
L’émergence d’une conscience écologique et des défis liés à l’économie d’
eau
Le remplacement de la baignoire par la douche illustre une nouvelle manière de se laver et de prendre soin de soi d’une part, et de nouvelles pratiques et équipements pour économiser l’eau d’autre part. La sobriété et le souci d’économie de cette ressource succède à des décennies d’illusion d’abondance. La responsable d’offre salle de bain de Leroy Merlin, Barbara
Furry, remarque que cette vigilance se retrouve aussi dans la nouvelle robinetterie, désormais systématiquement conçue pour l’économie d’eau. Chaque composant clé est optimisé : la cartouche qui régule le débit et maintient une température de l’eau constante ; l’aérateur, appelé aussi mousseur, qui réduit le débit d’eau par ajout d’air sans perte de confort ; le flexible d’alimentation qui adapte le robinet à toutes les configurations. Résultat, une belle amplitude d’eau et au moins 40 % d’eau économisée par rapport à un robinet à l’ancienne. Qu’en est-il de la réutilisation des eaux grises ? Des recherches prometteuses sont en cours sur les circuits d’eau, notamment le travail de deux ingénieurs inventeurs d’une douche à circuit fermé. L’eau y est filtrée, traversée par des ultraviolets, nettoyée et ensuite réutilisée dans le cadre d’une seconde, troisième, quatrième douche… Au total, six ou sept cycles sont possibles, ce qui implique un changement de posture de la part de l’usager. La capacité d’eau étant très limitée, il s’agit de se discipliner pour prendre des douches de trois minutes seulement. D’autres solutions visent à réduire à la source la quantité d’eau utilisée, comme les pommeaux de douche brumisateurs.
Le remplacement de la baignoire par la douche illustre de nouvelles pratiques et équipements pour économiser l’eau.
la sALLE DE BAIN 142

143
Le rêve de la douche à l’italienne. Photographie Leroy Merlin.
Une autre préoccupation écologique dans la salle de bain est l’empreinte carbone. Les marques innovent sur la légèreté du receveur, facilitant ainsi son transport et sa mise en œuvre. Il s’agit par exemple d’utiliser du PET recyclé plutôt que de la résine, ce qui équivaut à un poids de 16 kg pour un receveur de 120 cm par 90 cm, contre 50 kg traditionnellement ! Un tel poids est aussi une catastrophe en termes de troubles musculo-squelettiques, pour l’artisan ou le bricoleur qui le pose, comme pour les travailleurs chargés de la manutention.
Big Doctor is watching you
L’histoire de l’habitat est ainsi faite de boucles. L’enjeu hygiéniste du début du xxe siècle fait écho à l’épidémie de Covid-19 du début du xxie. La question de la santé revient en force dans la salle de bain. C’est souvent là que l’on trouve l’armoire à pharmacie ; là aussi que, demain, nous pourrons faire un check-up santé : Google a en effet déjà déposé des brevets sur des capteurs capables de détecter d’éventuelles pathologies. Par exemple, un tapis de douche qui permet de se peser, un miroir analysant la carnation, le tout connecté à une application communiquant les informations à votre médecin.
Miroir, mon beau miroir
Internet pénètre la salle de bain et la porte ne ferme plus. Avant, on y était tout seul. Désormais, c’est un lieu de mise en scène de soi. Combien de selfies de personnes dans leur salle de bain circulent sur les réseaux ? Partager son intimité avec le plus grand nombre via un smartphone : aujourd’hui, la manière dont on se construit en tant qu’individu au milieu des autres passe beaucoup par les écrans et les réseaux sociaux. Une redéfinition de l’intimité, du rapport au corps et finalement du bain, qui redevient… public.
2 C.Bonvalet, Les Aspirations des Français en matière de logement en 1945 : un regard sur l’histoire du modèle pavillonnaire, Politique du logement, 2020.
la sALLE DE BAIN 144

Avant, on y était tout seul. Désormais, c’est un lieu de mise en scène de soi. Photographie
145
Ekaterina Demidova, Alamy.
ADAPTER LA sALLE DE BAIN AU
VIEILLI ss EMENT ET AU handicap
la sALLE DE BAIN 146
Voici l’histoire de Gérard et Charles, père et fils habitant le Vaucluse, confrontés soudainement au problème du vieillissement à domicile. Gérard, qui est veuf et âgé de quatre-vingts ans, vit seul à une dizaine de kilomètres de son fils. Ce que Charles redoutait arrive malheureusement : le père fait une chute grave (100 % des séniors qui tombent à domicile font une chute grave nécessitant une hospitalisation), dans sa salle de bain (comme pour 42 % des chutes). La rénovation de sa salle de bain date d’il y a vingt ans, quand Gérard avait soixante ans et qu’il se sentait en pleine forme. Sa retraite démarrait, il fourmillait de projets et avait envie de croquer la vie, de la réinventer même : il ne voulait certainement pas entendre parler de vieillissement ! La raison de sa chute ? La baignoire. Dur en effet d’enjamber les 60 cm pour entrer dans le bain. Le père regagnera bientôt son domicile, tandis que le fils prend conscience de l’inadaptation du logement. Vite, il faut agir !
En réponse à ce cas concret, Barbara Furry, responsable d’offre douches et receveurs chez Leroy Merlin, évoque une solution immédiate : « Refaire une salle de bain complète ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut compter entre quatre et six mois de délai pour commander les matériaux et faire intervenir l’artisan. Ensuite, le chantier immobilise la pièce pendant une dizaine de jours. Je me bats pour réduire le plus possible le nombre de chutes ; environ 2 000 chutes par an pourraient être évitées grâce à une salle de bain adaptée.
147
« seuls 6% des logements sont adaptés au vieillissement. »
C’est pourquoi nous proposons des solutions immédiates en pareil cas, du plug and play : une cabine de douche que l’on positionne à la place de la baignoire, entre deux ou trois murs, et qui cache la partie du mur non carrelée. La cabine contient des barres d’appui et un siège intégrés ; son seuil, tout petit, est facile à passer. »
Dans l’urgence, ce type de produit peut résoudre des situations comme celle de Gérard. À plus long terme, on lit entre les lignes un enjeu d’avenir, à la fois technique et sociologique : mieux anticiper le vieillissement de la population française. La salle de bain est une « pièce totale », où se réunissent toutes les problématiques liées au vieillissement, mais aussi aux situations de handicap. Comment se relever ? Comment se maintenir debout ? Comment ne pas glisser ? Comment se regarder dans le miroir sans se tordre, ou en étant en position assise ? Les besoins des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées ont des points communs en termes d’accessibilité et de sécurité dans les salles de bain. Le plus souvent, la salle de bain est pensée sur le mode hôtelier, c’est-à-dire que l’on propose du bien-être et du décor au détriment des aspects pratiques de la mobilité réduite. Comme le souligne Pascal Dreyer, coordinateur scientifique et chercheur associé de Leroy Merlin Source : « C’est la pièce qui demande le plus de plasticité en termes d’équipement, or c’est celle où l’on en met le moins. » Concrètement, elle est rarement prévue pour importer une aide technique – une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant manuel –, ou pour qu’une deuxième personne intervienne auprès de l’habitant. Comme l’explique le chercheur : « Il manque souvent de l’espace pour
l’articulation de deux corps, la chorégraphie de l’accompagnement de la personne. Le drame, dans les travaux d’adaptation de la salle de bain entre quatre-vingts et quatre-vingt-cinq ans, que l’on fait en urgence, c’est que les personnes n’ont plus le temps de l’appropriation. Elles sont tout de suite projetées dans la situation de difficulté. Nous devons intégrer le fait que ça ne va pas porter malchance d’incorporer des éléments de confort bien avant qu’ils ne deviennent une aide nécessaire ! »
Si Gérard et Charles avaient anticipé l’inéluctable, ils auraient pu installer une douche à l’italienne avec une colonne hydraulique qui fait discrètement office de barre d’appui ; ou un receveur antidérapant, en pierre par exemple, qui aurait été à la fois esthétique et aux normes PMR ; ou une barre au design hybride, qui permet à la fois de se relever et de poser un smartphone.
D’ici trente ans, plus d’un Français sur trois aura plus de soixante ans ; or seuls 6 % des logements sont adaptés au vieillissement. Dans une société de la longévité, où l’on sait que l’on va vieillir plus que nos grands-parents, il faut sortir du déni par rapport au vieillissement. Or, comme l’analyse Pascal Dreyer : « Avec l’accélération de nos modes de vie, les personnes âgées ont disparu de notre quotidien, elles ont été invisibilisées. Dans nos représentations, les personnes très âgées sont déjà mortes, or c’est tout le contraire ! Là est le tabou. »
La transformation de ce lieu de grande intimité ne peut se faire de manière brutale, si elle ne veut pas déboussoler ses usagers. Il faut l’anticiper. Et pour cela, il faut accepter de regarder en face le vieillissement.
149
LA CHAMBRE
’ ENFANT,
L ’
D ’ UN UNIVER s
D
AFFIRMATION
Histoire
D’une chambre inexistante à un univers stratégique
« Les bonnes actions ont leur récompense », Sophie de Renneville, Éducation de la poupée, Paris Eymery, 1823. Collection particulière, Open édition.
Plus encore que la chambre parentale, la chambre des enfants émerge tardivement et de façon variable selon les milieux sociaux. De l’absence de l’enfant dans l’habitat à une présence savamment orchestrée, petite histoire de cette pièce, miroir du statut de l’enfant dans la société française.

la chambre d ’ enfant 152

Chambre d’enfant, appartement de M. R. M. à Paris, 1925. Photographie album Maciet, bibliothèque des Arts décoratifs, Paris.
jusqu’à la fin du xviiie siècle, l’enfant est absent de l’habitat, comme il est absent de la société. Les enfants sont des mini adultes sans caractéristiques propres. Il y a ceux qui travaillent très tôt, ceux qui sont élevés ailleurs et ceux qui partagent la vie des domestiques.
Pionnier inattendu de la considération de l’enfant : le Roi Soleil. L’historienne Michelle Perrot raconte : « L’esquisse d’une chambre d’enfant, on la trouve à Versailles. Louis XIV, homme de famille, voulait les Enfants de France dans ses parages, légitimes et bâtards
réunis par son sang. Ils logent d’abord dans la vieille aile [de Versailles]. »
La rudesse caractérise alors le traitement des enfants, qui ont plus de devoirs que de droits.
Cela dit, on prend peu à peu conscience de leurs particularités, on les distingue des adultes. Cette évolution culturelle se fait sous l’influence de médecins et de philosophes, par exemple Jean-Jacques Rousseau¹. Il se penche sur leur développement dans son œuvre Émile ou De l’éducation, mais plutôt hors de l’habitat : « Peut-on concevoir une méthode plus insensée que d’élever un enfant comme n’ayant jamais à sortir de sa chambre ? (…) Au lieu de le laisser croupir dans l’air usé d’une chambre, qu’on le mène journellement au milieu d’un pré². »
C’est à la fin du xviiie siècle que la pièce de l’enfant apparaît enfin, en tant qu’espace propre, séparé et principalement dédié au repos, dans les maisons des aristocrates et des grands bourgeois.
153
Il y a à l’époque moins de séjours en nourrice, moins de pensionnats pour les garçons, même si les valeurs morales qui organisent l’espace dédié à l’enfant restent l’ordre et la bienséance. Dans les plans d’architecte du xixe, on trouve une chambre assignée et une division par sexe. L’habitat se transforme, comme l’expliquait Monique Eleb, psychologue, sociologue et historienne des façons d’habiter contemporaines :
« Les chambres d’enfants, les salles à manger et salles de jeux qui leur sont destinées, ainsi que le “salon de famille”, vont matérialiser ce changement d’idéologie concernant l’importance des années de formation et l’émergence de la tendresse au sein de la famille³. »
Chacun sa chambre
C’est le but ultime que les parents poursuivront, au fur et à mesure du xxe siècle, jusqu’au sacrifice courant de nos jours de laisser la chambre, s’il n’y en a qu’une, à l’enfant. La conquête de l’habitat pour l’enfant conjugue les progrès parallèles de l’économie, de l’autonomie et de l’individuation⁴.
En 1912, les grands magasins innovent. Le Printemps consacre désormais une page de son catalogue au mobilier pour enfants. La clientèle visée est bourgeoise et plutôt parisienne et le mobilier ne se différencie pas encore de celui des adultes⁵. Puis l’on voit apparaître des dimensions adaptées à la taille des enfants, des coins arrondis, des bois résistants et des décors enfantins ; des meubles spécifiques, d’abord accessibles aux classes les plus aisées.
Dans les classes modestes, l’habitation à bon marché (HBM) conçue pour les ouvriers prévoit des chambres d’enfants, mais trop petites pour leur permettre de jouer⁶. C’est en cela que se distingue la bourgeoisie à la même époque : offrir aux enfants, quand les moyens le permettent, un espace suffisamment grand pour des activités d’éveil, de jeu et d’étude. Dans les traités de savoir-vivre, les bourgeoises qualifient les enfants de « ce qu’on a de plus précieux au monde » et préconisent d’installer leurs chambres à proximité de celles des parents⁷. Après la Seconde Guerre mondiale, la pièce se généralise avec la construction des grands ensembles⁸. Puis la société de consommation sort la chambre d’enfant de son seul rôle de dortoir. Vêtements, jouets, livres : un univers joyeux à l’esthétique de plus en plus marquée se met en place dans le chez-soi des petits. Une rupture majeure a lieu : l’article 351 du Code civil détricote la hiérarchie des relations familiales en passant de la puissance paternelle à l’autorité parentale. En 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant poursuivra cette reconnaissance officielle de l’enfant, qui légitime son espace propre dans l’habitat. À la même époque, les designers rendent réel le rêve de chambre cabane et contournent la contrainte de surfaces limitées : quand il n’est pas possible de lui consacrer plus d’espace, il faut de l’ingéniosité ! Des solutions multifonctionnelles, de la modularité et l’investissement de la surface en hauteur se traduisent en lits superposés, « lits-bureaux-armoires-étagères » et autres mezzanines, qui rencontrent un grand succès auprès des enfants et des adolescents. On peut citer comme exemple phare l’Abitacolo, imaginé par le designer Bruno Munari en 1971.
la chambre d ’ enfant 154

155
Chambre d’enfants, 1951, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Photographie médiathèque Terra.
Dans les années 1980, grâce à la généralisation des échographies, il devient possible de connaître à l’avance le sexe du bébé. Les futurs parents (plutôt les mères à l’époque) s’engagent alors dans une consommation et une préparation matérielle très genrées, contrairement aux parents des années 1970 qui préparaient plutôt un environnement neutre. La spécialiste de l’habitat Monique Eleb analysait finement cette tendance : « Style marin, sportif, guerrier pour les garçons, couleur rose ou pastel pour les filles, autant de traditions issues de la culture bourgeoise du xixe siècle qui perdurent encore. Faut-il le regretter ? Le décor éduque et contribue directement à la construction de la personnalité de l’enfant. Heureusement, si les parents fixent un décor initial, les enfants se l’approprient très vite et le font évoluer selon leurs goûts, passions et héros du moment, notamment à l’adolescence, le plus souvent sans avoir à le négocier⁹. » Avec le xxie siècle arrive un profond changement des mœurs et une remise en question de cette éducation genrée, à la fois dans le choix des jouets et la décoration des chambres d’enfant.
Un théâtre pour enfants ou une cage dorée ?
À la fin du xxe siècle, les crises entraînent un repli sur la sphère privée. Les parents, de plus en plus protecteurs vis-à-vis de leurs enfants, restreignent leur accès à ce lieu d’autonomisation qu’est l’espace public. Les enfants et
adolescents passent de plus en plus de temps dans leur chambre, phénomène encore renforcé par les nouveaux usages numériques. Espace de jeu, de bricolage et d’étude, salle de lecture et salon de sociabilité, refuge, la chambre est une pièce multifonctionnelle indispensable en temps de crise, sanitaire ou économique. La chambre des enfants a conquis sa légitimité pendant sa courte histoire. Périmètre de protection des dangers de la maison et de la rue. Lieu des activités de l’enfant pour ne pas les éparpiller au sein de la maison. Espace de construction de l’identité, mais aussi ouvert sur le monde et traversé par les courants qui animent la société. Entre autonomie et contrôle parental, la chambre est ce territoire où l’enfant devient grand.
1 Perla Serfaty-Garzon, « Les territoires de l’enfance dans l’espace familial. De l’enfant récepteur à l’enfant prescripteur », Enfance et Psy, no 72, dossier « Maison d’enfance : habitants et invités », p.29-42, septembre 2016.
2 Michelle Perrot, Histoire de chambres, Seuil, 2009.
3 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
4 Ibid.
5 Annie Renonciat, « Quand la chambre fait école. Images et usages pédagogiques de la chambre d’enfant », Actes du colloque international sur La chambre d’enfant, un microcosme culturel : espace, consommation, pédagogie, Musée national de l’Éducation – CNDP/CANOPÉ, Rouen, 7-10 avril 2013, Strenæ, juillet 2014.
6 Monique Eleb avec Anne Debarre, L’Invention de l’habitation moderne – Paris 1880-1914, « Architecture de la vie privée, suite », éd. AAM/Hazan, Paris, 1995.
7 Ibid.
8 Logements collectifs construits dans les banlieues des grandes villes dans les années 1960 dans le cadre de la politique de planification urbaine.
9 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
la chambre d ’ enfant 156


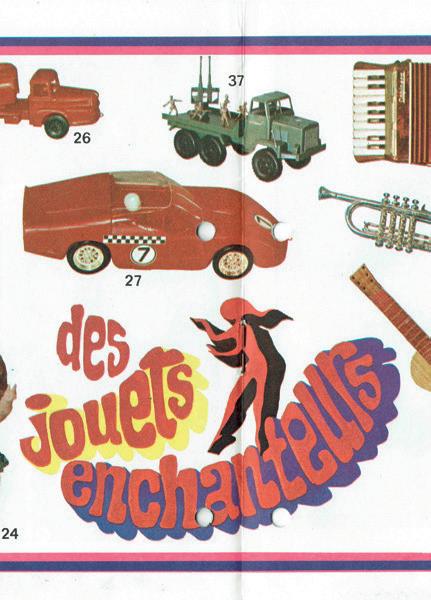

L’ENCHANTEUR
En 1960, Leroy Merlin adopte l’image de « l’Enchanteur » avec son logo représentant un petit lutin joyeux. Sa politique commerciale est alors résolument tournée vers la famille. De multiples animations et promotions font la joie des enfants et les catalogues font la part belle aux jouets.
157
Extrait du catalogue Leroy Merlin de 1968. Archives Leroy Merlin.

la chambre d ’ enfant 158
Chambre d’enfants en 1952. Photographie Arts ménagers.

Chambre des enfants, 1970, Bagnolet. Photographies Marie-Claire n°45, novembre 1970, Denis Reichle.
Entre autonomie et contrôle
parental, la chambre est ce territoire où l’enfant devient grand.
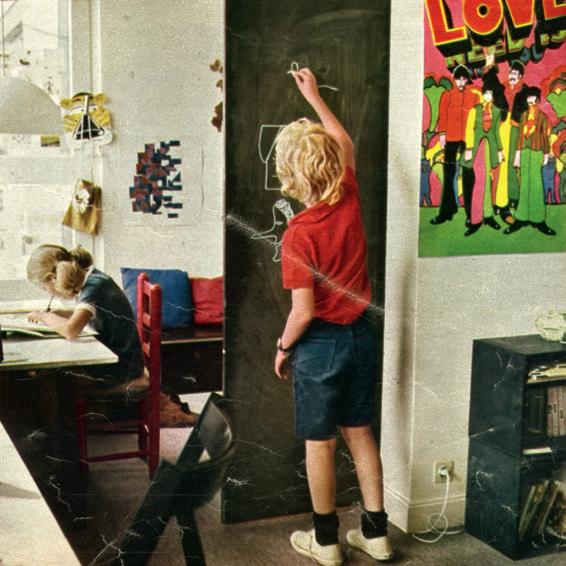
159
Sociologie
Le chez-soi des enfants et adolescents
Une chambre à soi ? Quand on en a une, rien de plus normal, et quand on n’en a pas, on s’organise des coins à soi. Avoir un territoire personnel est fondamental, d’après la sociologue Elsa Ramos, dont les enquêtes de terrain donnent la parole aux enfants¹⁰. À partir de leurs points de vue, elle livre quelques clés d’analyse pour comprendre le chez-soi des enfants en perpétuel mouvement et interdépendant des parents.
a société française, surtout parmi les catégories supérieures, encourage l’autonomie dès le plus jeune âge. « Sois autonome ! », répète-t-on à l’enfant qui doit apprendre à faire seul, d’après les pédagogies en vogue à l’école comme à la maison. Par une série de décisions, les parents dessinent ainsi un territoire personnel pour l’enfant : le choix crucial de l’école, le choix des activités, l’organisation et la décoration de la chambre à hauteur d’enfant ou de parent, le partage de la pièce avec une fratrie ou non, la culture de la porte fermée ou ouverte, etc.
LOn le voit bien, ce cadre posé par les parents met l’enfant face à un paradoxe que l’on pourrait appeler « l’autonomie sous contrôle parental ». C’est là toute l’ambiguïté de la chambre dite d’enfant. Il faut être chez soi, devenir soi, tout en étant chez ses parents. La chambre manifeste l’ambition des parents, faire de leurs enfants des êtres autonomes et semer en eux les graines de la réussite. C’est une pièce où l’enfant se construit, de même que le « bon parent », qui recherche finalement un peu de tranquillité grâce à la chambre d’enfant… Une soupape !
Comme dans Tanguy, la comédie réalisée par Étienne Chatiliez en 2001, le paradoxe se poursuit bien au-delà de l’âge adulte. En France, on cohabite relativement tard avec ses parents, jusque 24-25 ans, tout en valorisant l’autonomie. Car la société française distingue, plus qu’ailleurs, autonomie et indépendance.
la chambre d ’ enfant 160
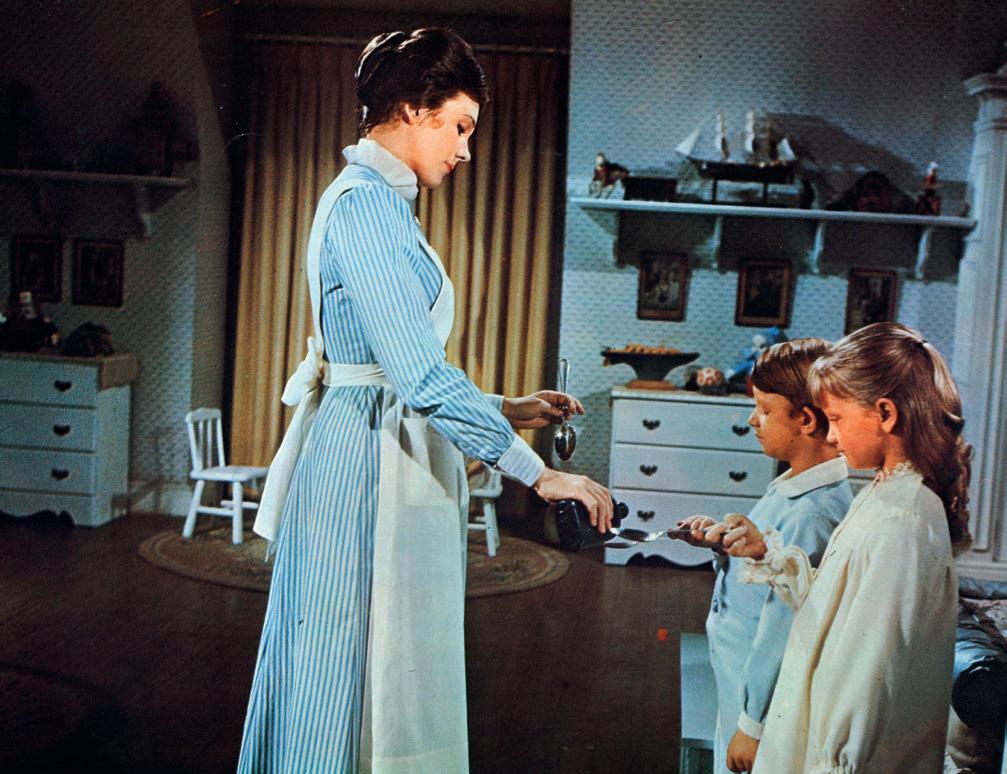
C’est là toute l’ambiguïté de la chambre dite d’enfant. Il faut être chez soi, devenir soi, tout en étant chez ses parents.
161
Photo du film Mary Poppins avec Julie Andrews, Walt Disney Productions, 1964. Photographie Pictoral Press, Alamy.
L’indépendance, c’est objectif et quantifiable : gagner de l’argent et vivre dans son propre logement. L’autonomie désigne quelque chose de plus diffus : être un individu et peut-être avoir un fonctionnement différent de celui de ses parents. D’où le bazar dans la chambre qui devient, à l’adolescence, une revendication !
Les critères de rangement ne sont plus les mêmes en cette période particulière où l’enfant devient adulte.
secrets du « cohabitat »
Trois chez-soi cohabitent finalement du point de vue de l’enfant : chez moi, chez mes parents et chez nous. C’est-à-dire le territoire personnel de l’enfant, les règles parentales et la convivialité familiale.
Que se passe-t-il chez mes parents ? La relation parent-enfant se tisse sur le mode hiérarchique. Le parent est chez lui, c’est lui qui décide, par exemple, de l’horaire des repas et du menu. Chacun est à sa place et les places ne se confondent pas. La reconnaissance de l’enfant repose sur la filiation : il est d’abord l’enfant du parent.
De quoi est composé alors le chez-nous ?
La relation parent-enfant se tisse sur le mode égalitaire. Si l’on reprend l’exemple du repas, c’est le moment convivial, plutôt le week-end, où l’on se retrouve avec plaisir et l’on discute. L’enfant dans ces moments-là est reconnu comme un individu à part entière et la parole est au centre. En revanche, un deuxième type de repas, celui de la règle parentale, rythme la vie domestique au quotidien les jours de semaine.
Et le chez-moi, alors ? Il se construit au fur et à mesure que l’enfant grandit, jusqu’à devenir un antre interdit aux parents au moment de l’adolescence.
Les enfants et leur chez-soi
Les enfants investissent donc leur chambre comme un véritable chez-soi mais de quoi décident-ils exactement ? Le plus souvent, les parents décident de la décoration de la chambre pour les éléments fixes (les murs, les sols, etc.), et les enfants choisissent les éléments mobiles (les jeux et activités), ce qui tombe bien. Car la chambre est un récit de soi fluctuant très vite, au rythme auquel l’enfant évolue. Telle affiche, tel jeu, telle activité soudain ne sont plus d’actualité et disparaissent de la vue. Quand la chambre est partagée, plusieurs territoires cohabitent ; un frère peut par exemple occuper le sol, tandis que sa sœur investit l’espace en hauteur. Deux univers très différents sont alors délimités dans une même chambre par des dessins, des objets, des couleurs. Une piste pour mieux vivre en chambre partagée : tenir compte de la hauteur selon l’âge de l’enfant ! La chambre d’enfant, ce sont des « poupées russes d’intimité ». Ce que l’enfant donne à voir est accroché au mur et accessible à tous, tandis que ses secrets sont cachés dans des tiroirs et des recoins. Les collections permanentes, régulièrement triées, ne conservent que les objets à grande valeur sentimentale, et côtoient les expositions temporaires. Ce musée plein de vie rassemble tous les enfants habitant la chambre : l’enfant du passé avec quelques livres et peluches gardés de la petite enfance, l’enfant qui habite la chambre aujourd’hui, et l’enfant en devenir.
10 Elsa Ramos et Juliette Bertrand, Le Chez-soi des 6-13 ans, trouver sa place au prisme de l’ambiance sonore domestique, Les chantiers Leroy Merlin Source, 2021.
la chambre d ’ enfant 162

Le lit cabane, une illustration du chez-soi des enfants.

163
Photographie Leroy Merlin.
Photographie Leroy Merlin.
RENDRE LA MAI s ON PLUs sAINE
S’il y a bien une pièce de la maison que l’on voudrait 100 % saine, sans polluants toxiques ni perturbateurs endocriniens, c’est sans aucun doute la chambre d’enfant. Informés plus que jamais, nous savons aujourd’hui le risque qu’a représenté par exemple l’utilisation du bisphénol A pendant des décennies, dans de nombreux plastiques et résines. La connaissance du risque sanitaire est la première étape vers une maison plus saine. Sandrine Le Deit, responsable de la stratégie d’offre chez Leroy Merlin, explique : « Rendre la maison plus saine, c’est prendre en compte à la fois la santé de ceux qui l’habitent et la santé de la planète. Et c’est ce qui m’anime au quotidien. Utiliser des produits à durée de vie longue, réparables, qui impactent le moins possible en termes de carbone et de ressources naturelles. Émettre
la chambre d ’ enfant 164
le moins possible de composés organiques volatils (COV), à la fois au moment de la pose d’un produit et tout au long de son utilisation. Une maison plus saine, c’est donc une maison moins polluée par les produits et les pratiques, mais aussi bien isolée et bien ventilée.
Ces questions ne se posaient pas il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui, nos connaissances et nos compétences se sont améliorées sur ces sujets : forcément, l’offre évolue en conséquence. Que ce soient les caissons et étagères qui servent à aménager une pièce, ou les sols et stratifiés, nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils émettent le moins possible de particules. On dit souvent que la pollution dans l’habitat est plus grande que la pollution à l’extérieur, d’où l’importance d’aérer sa maison et ce, en raison des COV. C’est surtout le cas après la pose de peintures. Aujourd’hui, nous développons des peintures qui contiennent de la résine biosourcée à base d’ingrédients d’origine naturelle, qui sont particulièrement adaptées aux chambres d’enfant car, à l’application et pendant le séchage, elles émettent très peu de particules.
165
« je suis convaincue qu’à travers ces partis pris, peu à peu, nous faisons
basculer le marché. »
Des engagements forts
Je suis fière que Leroy Merlin assume sa position de leader de l’habitat à impact positif, que l’entreprise, en responsabilité, assume des partis pris qui seront de plus en plus forts. Cela peut impliquer que nous renoncions à des produits ou à des catégories de produits qui ne sont plus vertueux ni pour l’habitant, ni pour la planète, même si cela doit représenter un manque à gagner.
Le premier renoncement fort dans notre histoire a été celui du glyphosate, dès 2009. Nous n’avons pas communiqué à l’époque, mais nous avons mis en pratique nos convictions. Prôner le jardin naturel et vendre du glyphosate, cela n’avait pas de sens ! Un ou deux magasins avaient quand même continué à en vendre pour répondre à la demande de certains clients, d’où notre discrétion à l’époque. Aujourd’hui, je crois que cela se passerait différemment : l’arrêt de ce produit serait imposé à tous les magasins sans exception. Aujourd’hui, j’observe que la radicalité est très attendue des collaborateurs mais aussi, de plus en plus, de la part de nos clients qui nous demandent de pousser plus loin nos engagements.
Autre exemple plus récent : nous avons supprimé les convecteurs électriques d’entrée de gamme, les fameux “grille-pain”, parce qu’ils sont très énergivores. Leur bénéfice de chauffe n’était pas très intéressant pour l’habitant, mais ils répondaient à un vrai besoin, leur prix étant très abordable. Dans ce cas précis, nous avons expliqué notre décision. En parallèle, nous travaillons à la mise au point de systèmes de chauffage plus performants et moins polluants pour proposer une alternative. Nous avons également offert des bons d’achat à ceux qui ramenaient
leur ancien convecteur pour acquérir des produits plus efficients à tous points de vue.
Je suis convaincue qu’à travers ces partis pris, peu à peu, nous faisons basculer le marché ; en instaurant une nouvelle norme, nous sommes dans notre rôle. Les fournisseurs challengés doivent s’adapter en développant de nouveaux produits éco-conçus.
Au sein de l’entreprise, nous sommes face à un défi immense : concilier la création de valeur pour assurer la subsistance de nos 30 000 collaborateurs et de notre écosystème tout en assurant notre mission au service des habitants et la préservation de la planète. Et nous devons, toujours, relever le défi de la démocratisation en rendant accessibles les produits les plus vertueux. C’est une équation extrêmement complexe mais ô combien passionnante, qui nous oblige à repenser notre modèle.
Nos enfants, les premiers concernés
Dans le cas particulier de la chambre d’enfant, demain, je suis convaincue qu’il faudra aller vers des matières et matériaux les plus bruts possibles et peut-être les moins transformés. D’un côté, il y aura des produits de haute technologie, comme les systèmes de chauffage, permettant de consommer moins d’énergie et de polluer moins. De l’autre, il y aura un retour à la naturalité. Par exemple, des rideaux en lin, utilisant des teintures à base de pigments naturels et recourant à des procédés de fabrication simples et peu énergivores. Nous allons redécouvrir des matériaux plus naturels, moins transformés, qui conviendront aux envies des habitants de mieux vivre en prenant soin d’eux et de la planète. Nous sommes très conscients de notre grande responsabilité. »
167
LE GARAGE, DEs VOITUREs
AU « BIG BAZAR »
Le boom des garages
Faites-vous partie du tiers des Français qui utilisent un garage sans pourtant y garer une voiture ? Aujourd’hui miroir de nouvelles pratiques des Français, le garage assiste aux transformations du xxe siècle en étant aux premières loges. De la révolution automobile à l’urbanisation, de l’avènement de la tech au business en ligne de la seconde main, en route vers l’histoire de cette pièce !
Paris, 1929. L’heureux propriétaire d’une Panhard huit cylindres a fière allure. Coiffé d’un haut-deforme, sourire aux lèvres, il va chercher sa voiture à l’« hôtel pour automobiles » où son bijou a dormi, bien à l’abri. Il n’est pas question pour ce Parisien de déléguer le plaisir et le savoir-faire de la conduite à un chauffeur !
C’est à quelques rues de son appartement que se situe le La Motte-Picquet¹, garage collectif de huit étages. Cet édifice flambant neuf, prouesse architecturale d’un genre nouveau, offre aux véhicules une circulation à sens unique. En plus d’assurer le logement et
l’entretien des automobiles, ce garage est un lieu de sociabilité : les trois derniers étages sont réservés aux loisirs des propriétaires fortunés (un salon de thé, un restaurant et même un court de tennis). Au début du xxe siècle, les garages en ville sont donc collectifs et, à la campagne, les hippomobiles (voitures tirées par des chevaux) logent dans des écuries, des remises à fourrages ou des marchés couverts.
Quand, alors, la voiture se rapproche-t-elle du logement ? À partir de l’entre-deux-guerres, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à mesure qu’elle devient plus accessible. Cette démocratisation est une conséquence du fordisme et de l’explosion industrielle. Imaginez les bêtes de mécanique que sont alors les automobiles, objets techniques encore chers et fragiles… Il est nécessaire de les protéger des vols et des intempéries.
le GARAGE 170
Histoire
Garage, 6-10 rue de la Cavalerie, Paris, Robert Farradèche, architecte, 1929 in Encyclopédie de l’architecture, t. IV , bibliothèque de l’INHA, Paris. CCO
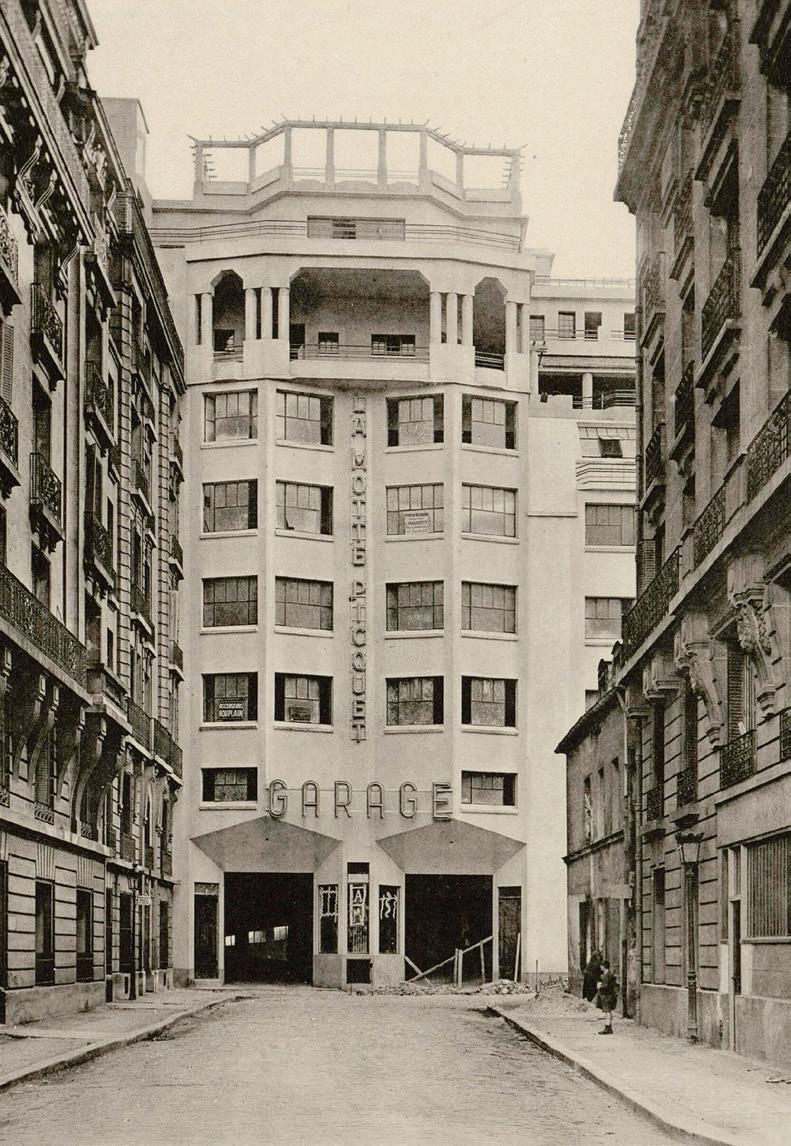
171
Les garages domestiques apparaissent dans les nouveaux lotissements suburbains, généralement détachés de la maison principale et conçus pour abriter une seule voiture. Ce sont souvent de simples structures en bois ou en métal. Il faut attendre les années 1960 pour voir en France des garages attachés aux maisons, alors que l’American way of life pénètre le pays en profondeur. Un propriétaire habitant une maison individuelle peut enfin accéder à son véhicule sans avoir à sortir de chez lui. Cette tendance se propage dans les années 1970 et 1980. On assiste alors à une explosion du nombre de garages, liée au succès inédit du modèle de la maison individuelle : l’accès facilité à la propriété et la démocratisation des voitures conduisent à l’essor de l’habitat pavillonnaire qui lui-même engendre un phénomène d’étalement urbain et une dépendance à la voiture. Le nombre de véhicules par ménage augmente, d’où un agrandissement des surfaces dédiées. Du côté de l’habitat collectif, dès 1957, les architectes ont l’obligation de concevoir des aires de stationnement privé correspondant aux besoins des immeubles, zones qu’ils commencent à intégrer aux sous-sols. Ces parkings souterrains
permettent d’ailleurs de limiter l’occupation extérieure des espaces verts et collectifs. La voiture « s’expose », c’est un signe de réussite qu’on place devant le garage, dans la cour, ou même dans la rue, à une époque où le stationnement ne pose pas de problème. C’est plutôt la place à l’intérieur de l’habitat qui peut manquer… si bien que les familles apprécient l’espace dégagé par la sortie du véhicule. Une fois vidé de son encombrant locataire, le garage se métamorphose en un endroit où l’on peut faire autre chose.
Place aux artistes et entrepreneurs !
Aux États-Unis, il est depuis toujours un repaire d’artistes et d’inventeurs. Le mythe d’une Silicon Valley développée à partir des garages naît dès 1939, quand les ingénieurs Bill Hewlett et David Packard créent le futur géant de l’informatique HP. Citons la fameuse légende d’Apple, née en 1976 dans le garage de Steve Jobs. Il y a aussi de nombreux garage bands, par exemple le groupe de pop-rock The Beach Boys formé en 1961 au domicile des frères musiciens, ou plus tard, en 1987, le groupe de grunge culte Nirvana, créé dans le garage de Kurt Cobain.
Il faut attendre les années 1960 pour voir en France des garages attachés aux maisons.
La France suit la même tendance, dès les années 1950 avec Pablo Picasso qui utilise un garage comme atelier dans la villa La Galloise à Vallauris. Un lieu idéal pour travailler notamment des sculptures en métal. Idem pour Jean Dubuffet à Vence, où l’artiste crée certaines œuvres d’art brut emblématiques : le Personnage aux yeux de strass utilise par exemple les débris d’une automobile incendiée qu’il trouve dans un garage.
le GARAGE 172
Répétition d'un groupe de rock dans le garage. Photographie Rob Watkins, Alamy.

Une matinée bricolage entre amis d’enfance dans le garage, années 1990. Photographie Trinity Mirror, Mirrorpix, Alamy.

173
En fait, les exemples de créativité dans les garages français se multiplient au fil des décennies, de la musique à l’artisanat en passant par la danse et les clubs underground. Même la tech française s’inspire de l’exemple américain. Le site Meetic par exemple, l’un des leaders mondiaux des rencontres en ligne au début des années 2000, est fondé en 2001 par Marc Simoncini depuis son garage à Boulogne-Billancourt.
Au début du xxie siècle, les garages deviennent de plus en plus sophistiqués et intégrés dans la conception globale de la maison. Certains sont dotés d’une isolation améliorée, de systèmes de chauffage et de refroidissement, ainsi que d’éclairage et de prises électriques supplémentaires.
D’autres s’équipent de technologies modernes comme des bornes de recharge pour véhicules électriques et aménagent l’accueil de diverses mobilités douces. Initialement construit autour de l’automobile, le garage se réinvente désormais, avec et sans elle.

le GARAGE 174
Image extraite du film Jobs de Joshua Michael Stern, représentant Steve Jobs (joué par Ashton Kutcher) et ses associés dans leur garage. D.R.
1 Architecte Robert Farradèche, 6-10, rue de la Cavalerie, 75015 Paris, classé monument historique.
L’American way of life, avec le double garage attenant à la maison et accueillant tous les objets de loisir, a fortement influencé les modes de vie français. Photographie H. Armstrong Roberts, Alamy.

175
Sociologie
1001 visages du garage
Home studio du musicien en herbe, studio tout court pour recevoir des visiteurs ou loger un adolescent, arrière-cuisine ou local d’activité, atelier de bricolage ou buanderie… Les Français occupent ou partagent la place autrefois réservée à l’automobile avec de multiples usages. En compagnie du sociologue Benjamin Pradel², visite et récits de ce lieu hybride, le garage au xxie siècle.
L’
histoire du garage, longue d’à peine un siècle, nous montre combien la richesse et la diversité de la culture populaire s’y sont déployées, outreAtlantique et en France. En témoignent les nombreux garages entrés dans la postérité !
La situation de ce refuge à l’abri des regards explique son succès. Ni tout à fait au-dedans de l’habitat principal, ni tout à fait en dehors. C’est un espace indépendant et « plastique », autrement dit, qui peut s’adapter aux besoins évolutifs des habitants. Rappelons d’abord la
variabilité de ses structures aujourd’hui : 37 % sont attenants au logement, 21 % en sont détachés, 16 % sont inclus dans un espace technique plus vaste, et le reste se partage entre box, souterrains, de surface, etc. Le stationnement de la voiture concerne encore 65 % des Français qui en sont détenteurs. L’observation des usages des habitants en plus du seul stationnement automobile révèle 1 001 visages du garage, que nous pouvons résumer en trois grandes tendances.
Les coulisses du chez-soi
Le plus souvent, une impression de désordre règne dans les garages, mais en réalité, l’espace est organisé selon des logiques, de rangement, d’utilisation et esthétiques, très différentes de celles des pièces à vivre et à recevoir. Le garage est la face B de la maison.
le GARAGE 176

Photographie réalisée par Hortense Soichet dans le cadre de la recherche Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-1970, Leroy Merlin Source, 2022, en partenariat avec l’ADEME.
Photographie réalisée par Hortense Soichet dans le cadre de la recherche Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 19501970, Leroy Merlin Source, 2022, en partenariat avec l’ADEME.

177
L’empilement et l’accumulation caractérisent cet envers du décor. Il peut être un lieu de stockage des aliments (conserves, vin et congélateur), des vêtements (d’hiver, d’été ou à donner), du matériel d’activité (jardinage, sport et camping)… Ces fonctions de cellier et de dépôt en font un sas technique et logistique, trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, et un sas sanitaire où se gèrent, sur une même zone, la saleté, avec le stockage des poubelles, la litière du chat ou les encombrants, et la propreté, avec la zone buanderie ou les produits d’entretien.
Ces différentes zones dans les garages multifonctionnels s’expliquent, selon notre guide sociologue : « Le garage permet la reconstitution de pièces disparues (buanderie, cellier, atelier, vestibule) ou le doublement de pièces existantes occupées (cave, grenier), pour libérer de la place dans des logements qui rétrécissent ou qui sont conçus pour maximiser la surface des pièces à vivre. »
Si le garage ressemble alors parfois à un bazar, c’est qu’une logique autant esthétique que fonctionnelle domine, celle de l’imperfection assumée. On intègre pleinement la matière brute : souvent les murs en parpaing ne sont pas peints, les câbles électriques sont apparents et peuvent être alors « shuntés », les trous ne
Si le garage ressemble parfois à un bazar, c’est qu’une logique autant esthétique que fonctionnelle domine, celle de l’imperfection assumée.
sont pas rebouchés et accueillent un clou pour pendre une vieille veste. Cette imperfection peut cacher une intention de « faire joli » dans une esthétique patchwork. Par exemple, tel habitant expose une collection impressionnante de bénitiers sur un mur de garage, à côté d’un bouquet de fleurs en plastique, d’une vieille balance et d’une photo de couple vintage. Cette ambiance bariolée s’explique aussi par le réemploi. Un tas de meubles ou d’objets atterrissent ici pour vivre leur seconde vie ; par exemple, un rangement aménagé au fond d’un box à partir d’anciens éléments d’une cuisine rénovée, un ancien bureau transformé en établi, une armoire penderie pour les tenues de bricolage.
Un espace plastique
Élire domicile dans le garage pour créer un atelier de bricolage, voilà un usage très fréquent et même originel, si l’on pense à l’atelier de mécanique qui jouxtait l’automobile. Cela nous amène à évoquer une deuxième dimension du lieu : un espace adaptable, capable de répondre au besoin d’un espace personnel à organiser ou utiliser selon des logiques propres, à distance maîtrisée de la famille ou du groupe avec lequel on cohabite.
Le garage pour l’homme, la cuisine pour la femme. Ces attributions traditionnelles des pièces par genre existent encore en France. La revendication masculine du lieu perdure pour des activités spécifiques comme le bricolage ou le jardinage et pour y déployer une organisation et un rangement différents du reste des pièces à vivre.
le GARAGE 178


179
L’usage du garage est multiple : espace de stockage, buanderie, cellier ou encore atelier de bricolage. Photographies Leroy Merlin.
C’est aussi une échappatoire selon les âges de la vie, à bonne distance de la maisonnée. Le garage est un espace d’aventure pour l’enfance, un refuge à l’adolescence où l’on peut faire du bruit sans déranger, de la musique, la fête, recevoir ou juste s’exiler – d’où l’importance d’une porte de séparation. L’enfant qui a grandi bénéficie plus tard de la transformation de l’espace – en partie ou en totalité – en chambre mais aussi en studio, salle de jeux, salle de sport plus ou moins partagée selon les besoins de chacun… Plusieurs configurations existent pour servir de soupape. La possibilité d’habiter cette surface légalement non habitable soulage de nombreux ménages français qui vont jusqu’à sa transformation en nouvelle pièce de vie : par exemple en suite parentale, en cuisine ou en studio pour un aïeul dépendant. De plus en plus aussi, le garage se transforme en un espace professionnel pour certains habitants-entrepreneurs qui l’aménagent en un atelier de création artisanale, en plateforme d’achat et/ou de revente d’objets en ligne, en bureau pour le télétravail, voire en studio à louer entre particuliers.
Un centre de tri !
Si les rythmes de l’habitat pouvaient être capturés, il faudrait sans doute les chercher dans le garage. C’est la pièce la plus traversée par le mouvement, la plus chargée des différentes temporalités de la maison. Il y a les flux quotidiens ou hebdomadaires, liés à l’intendance de la maison et aux dépla-
cements des habitants : par exemple l’accès aux réserves alimentaires, l’entrée et la sortie du linge, le stationnement de la voiture, des vélos et trottinettes. Il y a aussi les flux saisonniers qui rythment l’année. Les fêtes réorganisent le lieu pour faire de la place et les départs en vacances occasionnent des déplacements de vêtements, valises, matériel de camping ou de ski. L’hiver, on y rentre le bois de chauffage, on en sort les cartons de décorations de Noël, on y stocke les plantes en pot fragiles. Aux beaux jours, on y prépare les travaux de jardinage, on y déballe le mobilier d’extérieur, on y trie des affaires avant une brocante. Et il y a les flux à plus long terme, ceux de la conservation, des photos jaunies par le temps et des jouets des enfants, ceux de la dévalorisation d’objets et de vêtements qui ont séjourné ici juste le temps que l’habitant s’en détache émotionnellement (ce qui peut être long !), avant leur revalorisation ou leur évacuation. Le garage devient alors le centre de tri des souvenirs, la cité de transit des trésors domestiques. Plateforme de la logistique domestique quotidienne, temple du do-it-yourself (DIY), entrepôt de la récup’ et du réemploi, surface utile requalifiable à l’infini, le garage contient finalement l’esprit de l’habitat du xxie siècle : durable et circulaire.
2 Benjamin Pradel, Les Usages du garage ou la domestication du mouvement dans l’habitat, recherche Leroy Merlin Source, 2018.
le GARAGE 180


181
Traditionnelle vente de garage. Photographie Paul McKinnon, Alamy.
Traditionnelle vente de garage. Photographie Mick Flynn, Alamy.
LEs MOBILITÉs DOUCEs ET LA MULTIMODALITÉ
La sortie de la voiture du garage pose la question de la place accordée aux différents moyens de transport dans l’habitat. Plus généralement, cette pièce devenue un bazar habité, plus qu’un box automobile, ouvre des perspectives d’avenir et nous interroge sur nos changements à opérer, comme l’explique Agathe Ruckebusch, de l’équipe Enjeu impact positif de Leroy Merlin : « Le transport représente l’une des quatre principales sources d’émissions de gaz à effet de serre du citoyen. Entre les déplacements, l’habitat et l’alimentation – qui représentent à eux trois les trois quarts de l’empreinte carbone –, chaque citoyen peut trouver sa voie pour vivre à bas carbone : se demander ce qui est le plus important pour lui et adapter son mode de vie pour réduire ses émissions globales tout en conservant du confort et ce qui compte le plus à ses yeux. Des logiques de budget vont
le GARAGE 182
sans doute se mettre en place : on peut imaginer que l’on aura le droit demain à un “budget carbone”, par entreprise, par ville, par citoyen. Les carnivores le “dépenseront” dans la viande, les voyageurs dans l’avion ou la voiture, et ainsi de suite. Cette approche permet de déculpabiliser en restant réaliste : nous devons tous faire des efforts, mais les efforts de l’un ne seront pas ceux de l’autre. Nous sommes inégaux face au transport, car bien sûr la ville et la campagne n’offrent pas les mêmes possibilités. Ce n’est pas pareil d’avoir une station de tramway au coin de la rue et d’habiter en pleine campagne. Certains n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur voiture tous les jours pour aller travailler ou pour acheter à manger : il faut se méfier du dogmatisme à propos de la voiture… Autant que possible, la multimodalité doit être encouragée, autrement dit alterner entre plusieurs moyens pour se déplacer, parfois le vélo, parfois la marche, parfois les transports publics, parfois la voiture. La multimodalité a bien sûr un impact sur l’habitat, en particulier l’organisation du garage. Il faudra prévoir l’espace pour garer et l’électricité pour recharger les équipements. L’habitant aura plus d’équipements, mais ils pourront être partagés avec des voisins ou dans des communautés. Ces questions ont aussi un fort impact social. En France, les 10 % les plus aisés émettent cinq fois plus de carbone que les 50 % les plus pauvres. Lutte contre le réchauffement et lutte contre les inégalités sociales doivent aller de pair : les plus aisés, parce qu’ils ont de grandes maisons à chauffer, possèdent de nombreux équipements et voyagent plus facilement, auront plus d’efforts à faire, mais aussi plus de moyens pour investir dans des équipements vertueux. »
183
L
’ ATELIER, BRICOLER POUR DURER
Histoire
La démocratisation du bricolage
Et si l’atelier était la pièce de la maison où nous nous sentons exister ?
Comme la cuisine, la couture et le jardinage, l’habitant pratique le bricolage, mais a-t-il jamais pensé aux vertus de cette activité ? Hier dénigré, aujourd’hui célébré, le bricoleur pourrait être l’homme de demain. Petite histoire d’une revalorisation.


Couverture du Petit inventeur, Albin Michel, 1925. Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-71783. Système D, « journal hebdomadaire illustré du débrouillard », 1er janvier 1924. Photographie Wikicommons.
l ’ ATELIER 186
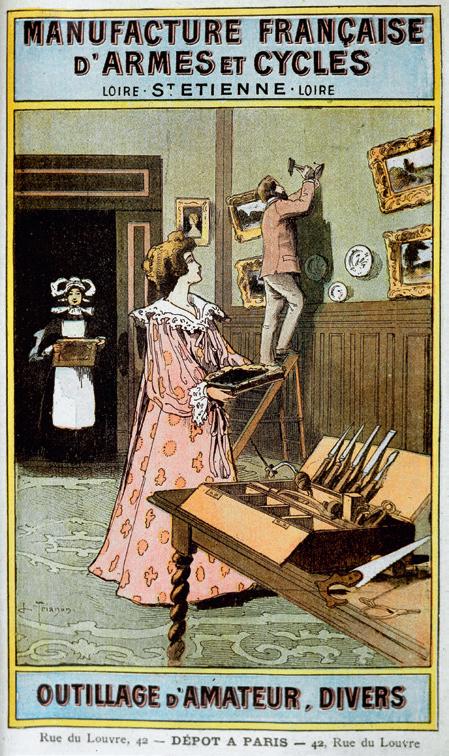
au début du xxe siècle, bricoler, autrement dit réaliser soi-même de petits travaux de construction, de réparation ou d’amélioration chez soi, ne va pas de soi.
L’avènement de la société industrielle a infériorisé l’intelligence de la main : la division du travail et la spécialisation ont contribué à dévaloriser les métiers manuels au profit des emplois de bureau et des professions intellectuelles. Le « bricolage » est alors perçu comme une tâche manuelle ingrate pour qui ne peut s’offrir les services d’un artisan. Le terme bricolage ne se répandra que vers 1940, mais la pratique existe déjà, évolue au fil des ans et connaîtra au début
« Outillage d’amateur, divers », catalogue publicitaire Manufrance, vers 1905. Photographie collection F. Grob / Kharbine-Tapabor.
du xxie siècle une revalorisation comparable à celle de la cuisine : de nécessité, il sera élevé au rang de hobby. Dès les années 1920, la popularité du Arts and Crafts Movement, mouvement anglais né à la fin du xixe siècle pour résister au tout industriel, contribue à encourager la création artisanale et le travail manuel. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Au Stock Américain, premier nom de l’entreprise française nouvellement créée par Adolphe Leroy, transgresse même les coutumes commerciales en devenant le premier négociant en matériaux tourné vers le particulier (les circuits traditionnels passaient en effet de l’usine au grossiste, puis du grossiste à l’artisan). Les particuliers accèdent ainsi pour leur propre habitat à des tuiles, du carton bitumé, des fenêtres, des escaliers, des portes, du carrelage, du bois et des panneaux, le tout provenant de baraquements américains désassemblés. Le marché du « bricolage » est né.
187
Après la Seconde Guerre mondiale, la pratique continue à se démocratiser, grâce à la disponibilité accrue des matériaux et à un intérêt croissant pour l’amélioration de l’habitat, dont témoigne la multiplication des manuels de bricolage¹. De nombreux ouvrages offrent des conseils pratiques aux amateurs : simples et ludiques comme la réalisation de jouets ou d’objets de décoration, plus techniques avec le b.a.-ba de la plomberie, l’électricité, la maçonnerie et la menuiserie.
Au besoin de réconfort lié à la reconstruction du pays succède le culte du confort. Comme l’explique l’anthropologue Abdu Gnaba, au cours des Trente Glorieuses, « le confort devient le mythe fondateur de notre société, le symbole ultime du bonheur ». La forte croissance économique permet en effet d’améliorer les conditions de vie des Français, de façon variable bien sûr selon les milieux sociaux et les zones rurales ou urbaines. Du simple accès aux équipements ménagers modernes, qui facilitent la vie domestique, au luxe superflu et burlesque dépeint par Jacques Tati dans Mon oncle (1958), on valorise de plus en plus son intérieur. En toute logique, le maintien du bon fonctionnement de ce chezsoi, autrement dit le bricolage, gagne du terrain.
Le confort, oui, mais sans effort : c’est aussi grâce au progrès technique que la pratique du bricolage est facilitée avec, par exemple, l’apparition d’outils portatifs dès les années 1960 : perceuses sans fil, meuleuses d’angle, scies sauteuses… Au fil des décennies, ces outils deviennent plus puissants,
plus autonomes, plus légers, plus ergonomiques. En parallèle, le bricolage se met au service du « style ». Abdu Gnaba remarque l’identification croissante des individus avec leur intérieur : « On passe de l’uniquement utilitaire, comme la grande armoire de grand-mère, à des choses capables de représenter la personnalité de chacun, au même titre que les vêtements. » C’est dans ce contexte qu’apparaît en France le do-it-yourself (DIY), la société évoluant vers plus d’expression individuelle, plus d’autonomie personnelle. En 1981, à l’arrivée en France du Suédois Ikea, le DIY se propage. Plutôt que d’acheter un meuble tout fait, le monter soi-même suscite le plaisir de l’avoir fait, en plus de l’attractivité du prix bas. Le fait de réunir permet à chacun de mettre sa patte, une dimension essentielle du bricolage aux yeux de l’anthropologue : « Au lieu d’avoir un produit inerte que j’achète, j’ai un objet vivant parce que je le touche : en l’assemblant moi-même, je l’anime. »
Je m’anime, pourrions-nous ajouter. Abdu Gnaba nous invite à saisir l’étymologie poétique : « Dans bricoler, il y a bris et coller, l’acte symbolique de rassembler des choses éparses. Le bricolage est fondamentalement humaniste : en construisant le monde, je me construis moi-même. On ne naît pas humain, on le devient. Le bricoleur est l’être qui prend sa vie en main, le penseur manuel. » En un mot, bricoler, c’est exister !
1 Cf. Roger Carpentier, Le Petit Bricoleur ; Pierre Moreau, Le Bricolage pour tous ; Robert Longechal, Le Manuel du bricolage ; René Bühler, Bricolage et réparations à la maison ; etc.
l ’ ATELIER 188

Père construisant un modèle réduit d’avion avec son fils, couverture de Science et Vie, 1953. Photographie Kharbine-Tapabor.
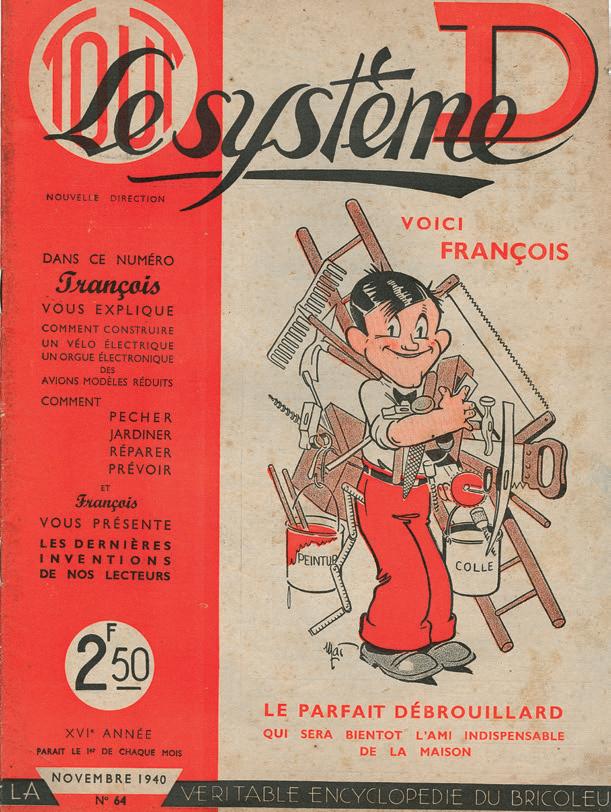
Couverture du magazine
Tout le système D, années 1940. Photographie Wikicommons.
189
Toute l’expertise de Leroy Merlin au service de la maison

des Grands guides
l ’ ATELIER 190
2011 Prix valables du 1er septembre au 31 octobre 2011.
2011
chauffage, confort & économies d'énergie chauffage, confort & économies d'énergie LES GRANDS GUIDES 2011 10LM1401_Couv_Guide_2011_Chauffage_V3.indd 1 07/07/11 15:22
LES GRANDS GUIDES
LES GRANDS GUIDES
Couvertures
Leroy Merlin 2011, diffusés dans les magasins à partir de 2009.
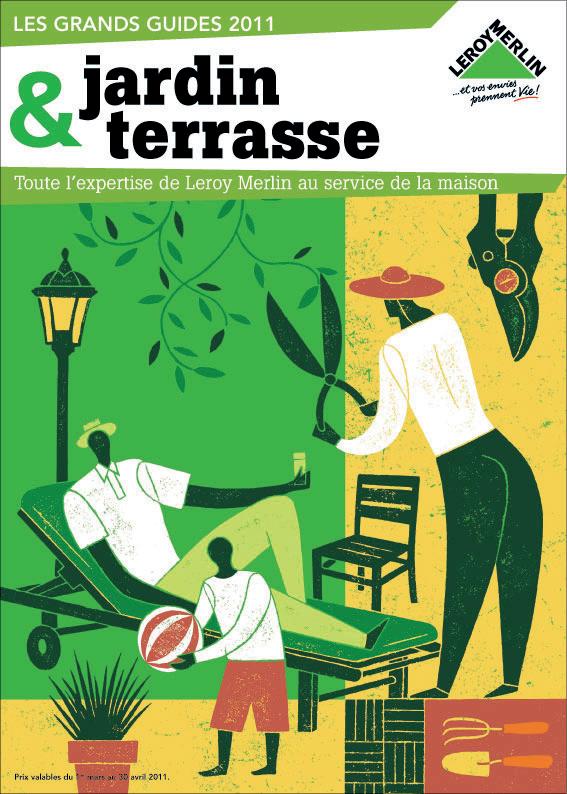
L’ASSISTANCE
TECHNIQUE LEROY MERLIN
Si l’industrie pense l’objet, le bricoleur en expérimente l’usage et d’abord l’installation. Entre les deux, Leroy Merlin construit un pont, en particulier depuis 1993, date de la création de l’« assistance technique ». La plateforme téléphonique guide les clients avant ou après un achat. Elle s’apparente à un laboratoire, identifiant les éventuelles lacunes pour les remonter du terrain jusqu’au fournisseur. Par exemple, la notice de montage d’un store extérieur est réécrite par les techniciens de Leroy Merlin, passant d’une page recto verso à quinze pages ; les appels sur ce produit chutent alors de 7 000 à 600 par an, soit autant de bricoleurs mieux accompagnés. Au fil des décennies, l’assistance technique observe la culture du bricolage et son évolution, notamment la hausse du niveau moyen de connaissance, donc d’exigence. Avec l’accès illimité à l’information, les habitants cherchent des spécialistes lors d’appels plus longs et plus complexes. On ne demande plus comment diluer une peinture glycéro-acrylique, mais comment monter un panneau photovoltaïque !
191
Anthropologie
C’est en forgeant que l’on devient forgeron
Dans Bricole-moi un mouton², l’anthropologue Abdu Gnaba brosse le portrait-robot de six bricoleurs, portraits qui semblent intemporels si l’on considère le travail manuel. Différentes personnalités ou types de bricoleurs existent, à des degrés divers selon l’évolution de la pratique du bricolage, jusqu’au début du xxie siècle où prédominent le « méditatif » et « l’artiste ». Tour d’horizon.
« Le secouriste : je panse donc je suis. » Spécialiste des urgences, le secouriste ne bricole qu’en cas de nécessité. Il répare une fuite d’eau chez lui ou chez ses proches. Terre à terre dans sa pratique élémentaire, céleste dans le soin qui fait sens.
« L’horloger : si je fais, je fais bien. »
Ultra méticuleux, l’horloger organise et anticipe autant que possible son bricolage. Son approche est méthodique, sa pratique minutieuse ; il bricole pour remettre en ordre le monde.
« L’artiste : le bricolage, c’est moi. »
L’artiste bricole pour embellir le monde et y imprimer sa patte. L’esthétique prévaut sur la commodité : il signe des réalisations avant tout originales.
« Le militant : faire mieux avec moins. »
Glaneur d’objets, anticonformiste et toucheà-tout, le militant pratique un bricolage quasi politique, une forme de résistance aux injonctions de la société.
« Le méditatif : la bricoolitude. »
Le méditatif bricole en pleine conscience. Sa pratique lui offre un moment et un temps à lui, une évasion qui le régénère.
l ’ ATELIER 192

193
Un bricoleur et sa femme, janvier 1959, Photographie Mirrorpix, Bridgeman Images.
« Le 3 0 : j’ai ramené ça de demain. » Ingénieux, méthodique, le 3.0 est un inventeur permanent, un casanier solitaire capable de fabriquer un objet complexe et futuriste en puisant dans des savoir-faire ancestraux.
Cette galerie de portraits révèle un trait commun, l’ingéniosité. Le bricoleur brille par son intelligence pratique, il s’adapte aux situations et tire profit des circonstances. Il fait donc avec les moyens du bord, comme nous le rappelle l’étymologie : de l’italien bricola, « catapulte », le mot « bricoler » prend le sens de « manœuvrer par des moyens détournés ». Le bricoleur use de la ruse en ne cherchant pas à gagner mais à avancer. Qu’il soit méticuleux ou désorganisé, artiste ou pompier, il agit à la croisée des chemins, entre travail et plaisir, entre réparation et création. Cette œuvre d’humilité par excellence s’oppose à l’injonction contemporaine à la perfection et à la réussite. Le bricolage répond à un autre enjeu de notre civilisation. Les individus de plus en plus fonctionnalisés, tels les maillons d’une chaîne de production, perdent parfois le sens de leur existence. Et comme l’explique le mécanicien et philosophe Matthew Crawford, le bricolage apporte un véritable apaisement à celui qui le pratique : « La satisfaction qu’un individu éprouve à manifester concrètement sa propre réalité dans le monde par le biais du travail manuel tend à produire chez cet individu une certaine tranquillité et une sérénité. (…) Il lui
suffit en effet de montrer la réalité du doigt : le bâtiment tient debout, le moteur fonctionne, l’ampoule illumine la pièce³. » À partir des années 2010, avec l’effet amplificateur des réseaux sociaux, le bricolage devient une tendance culturelle majeure. Il met en valeur des youtubeurs comme Barnabé qui partage ses convictions sur la culture de la récupération. Ainsi popularisée, la récup’ s’impose au gré des crises économique et écologique. La prise de conscience de la surconsommation transforme le bricolage en une activité militante : il s’agit d’apprendre à réparer plutôt que de jeter et acheter neuf. Remettre à l’honneur l’intelligence de la main, comme dans les sociétés traditionnelles, pour la survie et le progrès de l’humanité.
2 Abdu Gnaba, Bricole-moi un mouton, Le voyage d’un anthropologue au pays des bricoleurs, L’Harmattan, 2016.
3 Matthew B. Crawford, Éloge du carburant : essai sur le sens et la valeur du travail, La Découverte, 2010.
l ’ ATELIER 194

195
Père et fils repeignant le mur de leur maison. Photographie Bridgeman Images.
L ’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE : RÉPARATION ET RÉUTILI sATION
Les grandes entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la préservation des ressources et les enjeux climatiques. Le modèle économique linéaire fondé sur l’extraction de matière, la transformation, la vente, l’utilisation et la destruction, doit assurément se réinventer. C’est aussi cela, la transition écologique : passer de ce modèle linéaire à une économie circulaire, seul cadre viable pour le commerce de demain. Dans le secteur de l’habitat, l’économie circulaire pousse à réinventer les modes de consommation à travers la réparation, la seconde vie, la location et la revalorisation des déchets. Ceuxci doivent d’abord être minimisés pour éviter le gaspillage. Matthieu Degeorges, responsable de la seconde vie chez Leroy Merlin, évoque un projet qui va dans ce sens : « Tous les produits abîmés en magasin sont désormais pro-
posés à la vente à des prix très réduits, sous la bannière Presque-parfaits. Grâce à cette seconde chance commerciale, nous pouvons enfin sortir ces produits de la benne. »
Des alternatives au neuf
Demain, il sera tout à fait ordinaire pour un habitant de revendre ce qu’il n’utilise plus. C’est déjà le cas pour certains objets, mais de façon informelle et sans garantie. Si les secteurs de l’automobile et de la téléphonie ont développé depuis longtemps le reconditionnement, il est encore à mettre en place dans le secteur de l’habitat. Les qualifications concernées par le reconditionnement devront rester locales, pour éviter une empreinte carbone liée au transport. Matthieu Degeorges explique l’étendue de cet
l ’ ATELIER 196
enjeu d’avenir : « Concrètement, nous organisons dès aujourd’hui le diagnostic, le contrôle, la remise en état, puis la regarantie et la revente en seconde main au nom de Leroy Merlin. Nous travaillons aussi sur l’achat de tels produits par les habitants, plus complexe à mettre en place, car il faudra les certifier et les tracer. Apporter la preuve que le reconditionnement a été fait dans les règles de l’art. »
Ce commerce circulaire reposera aussi, surtout, sur la multiplicité des choix proposés à l’habitant. Pour des besoins temporaires, la location peut se justifier comme une réponse ponctuelle à un besoin ponctuel. L’expert en seconde vie illustre la vision de Leroy Merlin à ce propos : « Par exemple, un coupe-carreau est typiquement un produit qui peut s’utiliser 100 % en seconde main, nécessaire lors de la pose d’un carrelage, mais à l’usage très limité dans le temps. Nous proposerons à l’habitant son rachat garanti, ce qui permettra aux clients qui souhaitent tout de même acquérir ce produit de pouvoir avoir une valeur de rachat garantie par Leroy Merlin. » Pour des produits qui s’utilisent plus régulièrement, mais qui sont chers à l’achat, l’habitant de demain aura spontanément recours aux diverses offres de location. Des tests de location de robots-tondeuses et de kits d’outillage ont d’ores et déjà été très concluants ! D’où une réflexion plus large sur des offres au long cours : « Nous travaillons à la mise en place d’abonnements, c’est-à-dire l’accès à une certaine valeur de produits pour une somme mensuelle. La seconde vie comme la location répondent à deux besoins : d’abord, le prix car ils permettent d’accéder à des produits de qualité à prix bas et, ensuite, l’envie de consommer mieux, en évitant d’acheter systématiquement des produits neufs. »
La durabilité, l’enjeu majeur pour les produits neufs
Cette réorganisation du marché sur le mode circulaire aura pour effet bénéfique de redonner de la valeur, de proposer des produits de plus haute qualité. Un plus grand nombre d’habitants pourra ainsi sortir du premier prix. Car il s’avère impossible, économiquement et souvent techniquement, de concevoir un produit low-cost durable. Bastien Hild, responsable de la réparation chez Leroy Merlin, explique : « Une perceuse à 15 € est conçue pour un usage très ponctuel, ce qui en fait quasiment un produit “jetable”. L’enjeu est donc de remplacer les premiers prix par des solutions d’usage, autrement dit une économie de la fonctionnalité, à faible coût, mais avec des produits qui durent. Nous nous assurerons que telle perceuse à louer sera fiable, durable, performante, réparable. Les produits à louer auront un cycle de vie le plus long possible. »
La clé du marché de demain est donc la durabilité. Pour être durable, un produit doit d’abord être fiable, ne pas tomber en panne, du moins le plus tard possible. Ensuite, il doit être réparable. Pour cela, il doit être démontable et remontable et, bien entendu, disposer de pièces détachées à des prix abordables. Cela peut sembler évident, mais aujourd’hui nombreux sont les fabricants qui induisent une obsolescence involontaire en ne prévoyant pas, dès l’usinage, que le produit soit démontable. Quant aux pièces détachées, si elles sont aujourd’hui rendues disponibles par les grandes marques, elles ne sont pas encore un réflexe pour les petites entreprises.
Tous ces sujets semblent interdépendants et convergent autour de la circularité, comme le souligne l’expert en réparation : « Au bout d’un nombre défini d’utilisations, entrecoupées de révisions pour prolonger la durée de vie du produit, celui-ci pourra être reconditionné, puis vendu. Le matériel usé sortira ainsi du circuit de la location pour rejoindre celui de la vente en reconditionné. »
Dans le cadre de la loi Agec, Leroy Merlin travaille sur l’« indice de durabilité », prévu pour 2024, qui intégrera à la fois la fiabilité, la réparabilité et la robustesse. Mais une des variables importantes de la durabilité du produit est l’utilisation et l’entretien : de nombreux produits ne tomberaient pas en panne s’ils étaient mieux entretenus. Depuis plusieurs décennies, avec la baisse globale du niveau de prix des équipements, on constate que les Français sont moins attentifs à l’entretien. D’où l’importance d’organiser le soin porté aux objets. Bastien Hild détaille une vision de la réparation qui prend en compte le budget et les aptitudes de bricolage de chaque habitant : « Notre but est de proposer au client soit un service complet de réparation professionnelle, soit des solutions à moindre coût pour accompagner sa réparation maison, y compris pour des produits qui n’auraient pas été achetés chez nous. Un dispositif d’autodiagnostic est déjà proposé à nos clients pour identifier la pièce détachée nécessaire, ce qui facilite beaucoup la prise en charge par l’habitant ensuite (notamment grâce à des tutoriels). Nous construisons la plateforme de réparation de demain avec des ancrages locaux, car il s’agit aussi de créer de l’emploi. En optant pour un tel service, l’habitant fait travailler son voisin. Par exemple, dans un atelier créé dans
le Nord avec une entreprise d’économie sociale et solidaire, trois personnes en insertion travaillent sur la réparation, l’entretien et le reconditionnement de nos produits. »
Enfin, pour réussir la transition vers l’économie circulaire de l’habitat, il faudra aussi avancer sur le front de la pédagogie, car la grande majorité des habitants préfère encore remplacer un produit en panne par du neuf plutôt que de le faire réparer. Notre interlocuteur réfléchit à cette problématique de façon positive : « Il faudra informer, démontrer les bénéfices, rendre visibles des indicateurs comme les tonnes d’émissions de CO₂ ou de déchets évités grâce à la réparation. »
Informer pour influencer, c’est nous encourager les uns les autres dans notre propre intérêt !
l ’ ATELIER 198
« on parle d’un bricoleur de génie parce qu’il trouve des solutions là où il n’y a pas de plans déterminés. »
199
ABDU GNABA
LE RÉEMPLOI DU POINT DE VUE
DEs
HABITANTs
l ’ ATELIER 200
Le réemploi a toujours existé et continuera d’exister au sein de l’habitat, comme nous l’explique avec conviction le sociologue Benjamin Pradel, qui mène des recherches pour Leroy Merlin Source :
« Le réemploi est une pratique circulaire : faire circuler les objets dans la maison d’une pièce à l’autre pour différents besoins, ou les faire arriver de dehors pour les revaloriser dans la maison pour un nouvel usage, ou les faire sortir car considérés comme inutiles pour soimême et les revaloriser dehors auprès d’autres habitants. Ces pratiques domestiques, qui font partie de la boîte noire de l’espace privé, sont aujourd’hui davantage considérées. Elles sont au cœur de la question d’une économie circulaire qui, jusqu’ici fortement abordée en termes de filières économiques (recyclage, réparation, revente, etc.), se penche sur les pratiques habitantes. Mises bout à bout, ces pratiques intimes peuvent orienter de manière vertueuse les modes de consommation et de production de demain. Je suis persuadé que les pratiques de
201
« la maison devient une matrice où les choses changent de statut. »
réemploi sont déjà très ancrées et de multiples manières chez les habitants : d’une part, l’achat ou la vente de biens d’occasion avec les sites de vente en ligne et surtout les traditionnelles brocantes, marchés aux puces et vide-greniers ; et d’autre part les pratiques qui font circuler les choses dans la maison plutôt que de les jeter, en y décelant un nouveau potentiel d’usage.
On trie et on conserve les habits du grand pour le petit. On anticipe le départ de l’aîné en gardant un aspirateur pour le lui donner le jour venu. On répare de plus en plus grâce à des tutoriels en ligne, un repair café ou son voisin. On se sert dans les encombrants. On donne au voisin. On réutilise d’anciens meubles pour organiser son garage. On transforme une chaise un peu usée, dont l’esthétique détonne, en chaise de jardin. On réutilise les sacs en plastique et emballages en carton… À ce titre, les espaces qui permettent le stockage, le rangement, le bricolage prennent d’autant plus de valeur aux yeux des habitants. La maison devient une matrice où les choses changent de statut suivant que l’habitant les considère comme une ressource active ou potentielle, ou comme un déchet. Je pense d’ailleurs que les déchets que l’on voit à la sortie des logements ont déjà été en partie réutilisés à l’intérieur.
La participation de l’habitant au cycle de l’économie circulaire est encore trop souvent sous-considérée. Il y est majoritairement réduit à son rôle de consommateur qui va acheter de manière responsable ou de trieur qui va déposer dans la bonne filière ses déchets… Or toutes ces pratiques de réutilisation, hétérogènes et intimes, qui font circuler les choses entre les pièces, les générations, les voisins, les
époques, les fonctions, ne sont pas encore bien cernées. Mais les recherches qui s’intéressent aux valeurs, représentations, imaginaires, motivations de ces pratiques se multiplient.
Dans notre société où les transitions sont nécessaires, comprendre le déploiement de ces pratiques est important pour en faire le socle d’une évolution réaliste des pratiques de consommation vers plus de sobriété. Mais il faut les replacer dans la réalité des modes de vie et notamment des conditions d’habitat qui les rendent plus ou moins possibles et désirables. D’une part, certaines pratiques usuelles et populaires deviennent des leviers de différenciation sociale par le haut car elles ne sont plus atteignables par toutes et tous suivant leurs conditions d’habitat et, d’autre part, il faut faire attention au discours selon lequel ces pratiques peuvent émaner des populations les plus modestes qui vivraient une sobriété heureuse. Le réemploi est plus facile et mieux vécu quand on en a les moyens, parce que c’est une sobriété choisie et non contrainte. »
203
LE JARDIN, PARADI s RETROUVÉ
Histoire
D’agrément ou de subsistance, le jardin fédérateur
Comment contenir la « pièce jardin » dans un périmètre bien défini ? Le jardin se raconte forcément au pluriel. Les Français habitent des jardins de façon très variable selon les périodes, les zones géographiques et les types de logement. Promenade champêtre et impressionniste pour dépeindre, par petites touches, des coins de paradis.
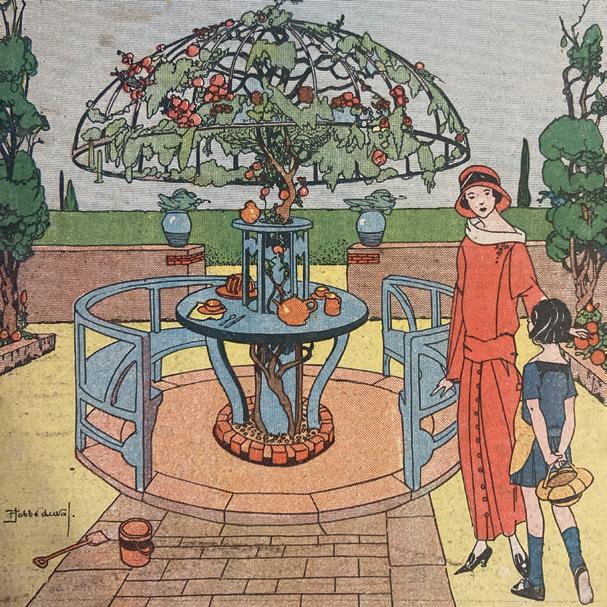
le JARDIN 206
« Pour prendre le thé », Félix Jobbé Duval illustrateur, Les Dimanches de la femme, 1922. CCO.

Jardins ouvriers du fort d’Ivry. Photographie Robert Doisneau, 1945, Gamma Rapho.
notre promenade commence en 1920, à ChâtenayMalabry. Derrière ses rues animées, dans le jardin ouvrier de la Butte-Rouge créé une quinzaine d’années plus tôt par la Ligue française du coin de terre et du foyer¹, règne un drôle de tableau sonore, des rires, les notes d’un accordéon, quelques éclats de voix et le chant des oiseaux. Des légumes productifs poussent en intercalés pour gagner de la place : pommes de terre, carottes, salades, haricots et radis. Les ouvriers, principalement des cheminots de la gare de Sceaux, créent ici leur oasis de verdure.
Tous les soirs et surtout le dimanche, le même rituel se déroule dans le jardin divisé en parcelles individuelles : cultiver la terre, récolter les fruits de son labeur, pour nourrir les siens. On se retrouve dans de petits espaces de détente autour d'un pique-nique partagé, sur des bancs en bois. Au jardin, on partage bien plus que le labeur pour subsister, on s’évade, on discute, on bricole des cabanes en rivalisant de créativité. Un jardinier a disposé par exemple des croisillons blancs autour de sa parcelle pour réfléchir la lumière du soleil, qu’il a même décorés avec une tête de pharaon trouvée en brocante, ou comment joindre l’utile à l’agréable !
Le même été, voici une autre ambiance, à Collonges-au-Mont-d’Or. Nichée au sommet d’une colline, offrant une vue imprenable sur la vallée de la Saône et les montagnes environnantes, se cache une maison des champs datant du xviie siècle.
207
C’est là qu’une riche famille lyonnaise prend ses quartiers d’été depuis des générations. La propriété s'étend sur plusieurs hectares de parc arboré, des chênes séculaires, des tilleuls odorants et des marronniers à l’ombrage généreux. Les « influenceurs du passé » y ont laissé leur empreinte, celle d’un jardin à la française, ordonné depuis un centre, selon des principes mathématiques. Les allées pavées traversent des massifs de roses au parfum envoûtant, d’iris et de pivoines éclatantes. Des sentiers mènent à des recoins enchanteurs. La propriété hérite du savoir-faire des aïeux, l’horticulture lyonnaise, que le potager perpétue. Les enfants s’amusent à ramasser des fraises mûres à point et à cueillir des mirabelles gorgées de soleil. C’est dans ce cadre idyllique que la famille savoure la douceur de l’été et se détend, loin du tumulte de la ville, au-dessus des nuages industriels.
Seul le passage des saisons fera évoluer ce paysage à Collonges-au-Mont-d’Or, un jardin d’ornement, très travaillé mais dans lequel on vit, héritier d’un jardin de représentation, qui n’existait que pour les yeux. Celui de la Butte-Rouge nous montre quant à lui, en miroir, une facette de la grande histoire, celle du monde ouvrier. Il faut imaginer ce qu’étaient les villes françaises au milieu du xixe siècle. Au fur et à mesure de
L'évolution des jardins est souvent liée à des moments particuliers, de crise ou d’expansion.
l’essor industriel, les populations s’entassent et les conditions d’hygiène se détériorent. Par peur des épidémies et des révoltes que pourrait générer la misère, mais aussi pour stabiliser une main-d’œuvre très demandée à l’époque, le patronat met à disposition des ouvriers des jardins attenants aux logements. Le discours moralisateur visant à « détourner les ouvriers du bistrot » est vite évacué. C’est une forme de bien-être que les jardiniers y trouvent, malgré le labeur – cultiver ses légumes, respirer le bon air, passer le dimanche en famille. Le christianisme libéral reprend l’idée au tournant du siècle et les jardins ouvriers se multiplient, jusqu’à l’âge d’or entre les deux guerres.
Cet exemple nous montre que l'évolution des jardins est souvent liée à des moments particuliers, de crise ou d’expansion. Dans l’entredeux-guerres, c’est en pleine crise économique et du logement, alors que le chômage est au plus haut, que les parcelles d’ouvriers prospèrent. L’entreprise d’Adolphe Leroy, Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin), identifie alors une réelle demande de la population qui doit faire son jardin pour subsister, et propose dès 1929 des abris, des poulaillers et des clapiers. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le retour de la prospérité économique entraîne le déclin de ces jardins ouvriers. L’urbanisation galope et les municipalités reprennent les terrains concédés à titre temporaire selon les besoins de la construction.
le JARDIN 208
Habitants dans leur jardin, Montreuil-sous-Bois, 1953.

209
Photographie Henri Salesse, médiathèque Terra.
Les années 1960 et 1970 marquent le développement en zone périurbaine de la maison individuelle, et du jardin de banlieue. Cette fois, ce n’est plus l’esprit guinguette qui prévaut mais plutôt l’inverse : un jardin à la pelouse rase que l’on voit depuis la rue, un jardin d’agrément où l’on construit son image publique. Le jardin de derrière, quand il existe, peut être plus désordonné. Finalement, la même logique qu’à l'intérieur de la maison se met en place à l’extérieur : d’un côté l’espace public, mis en scène, de l’autre la partie privée avec les services, réservée au cercle des intimes². Tout un art du lotissement se met en place car il amène, par les jardins, du lien social. Il suffit d’interroger des personnes qui ont grandi en lotissement pour mesurer leur nostalgie de l’errance, en grappes de copains, de maison en maison, de jardin en jardin, à taper le ballon.
En ville, la végétalisation des îlots de copropriété, où logeaient les chevaux puis les automobiles, se fait tardivement, sauf dans les quartiers cossus. À partir des années 1970, de plus en plus de copropriétés comptent des jardins, mais le plus souvent ce sont des pelouses interdites, des jardins pour les yeux, où le bruit est banni. Dans les années 1980 et 1990, les jardins ouvriers, familiaux et partagés (gérés collectivement en dehors d’une famille) retrouvent de l’intérêt aux yeux des Français. Le désir de bénéficier d’une alimentation simple et écologique gagne la ville. La préoccupation environnementale grandit aussi, bien après les « guérillas vertes » de Liz Christy, cette Américaine qui
a réveillé les terres en friche de Manhattan en lançant ses fameuses « bombes de graines ».
Le besoin de végétal se propage partout en France jusqu’à devenir une évidence au début du xxie siècle. Le jardin justifie à lui seul de quitter la ville ou de la repenser radicalement, ou plutôt « végétalement ». Peu importe sa taille, le jardin procure le plaisir de participer au cycle de la vie et de goûter aux saisons. Il apporte « apaisement thermique » et paix sociale. Plus qu’une évidence, il devient une nécessité.
Tout un art du lotissement se met en place car il amène, par les jardins, du lien social.
1 Société coopérative créée en 1896 par l’abbé Jules Lemire, actuelle Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs.
le JARDIN 210

LE BOIS OU LA PRISE DE CONSCIENCE D’UNE MATIÈRE PRÉCIEUSE
En 1963, les enjeux de la déforestation et l’impact carbone lié à l’importation du bois ne sont pas encore connus. À l’époque, la Société des Menuiseries Leroy Frères est l’atelier qui fabrique en série des produits en bois d’un très bon rapport qualité-prix (des escaliers, des châssis, des poutres, des chevrons, etc.). Alors que la coutume est d’utiliser du sapin nordique, Leroy Merlin innove en lançant la mode du bois exotique, venu de Malaisie ou d’Afrique, notamment pour aménager des terrasses. Le public est séduit et les commandes s’envolent. Aujourd'hui, l’entreprise ne travaille qu’avec du bois FSC (ONG promotrice d’une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts) et PEFC (« programme de reconnaissance des certifications forestières », label reconnaissant la gestion durable des forêts). Depuis 2003, Leroy Merlin s’engage auprès des ONG en faveur de la labellisation des produits utilisant les bois de forêts correctement gérées.
211
Photographie Leroy Merlin.
Usages d’aujourd'hui
Vivre ensemble dans un jardin positif
Les confinements démontrent avec fracas à quel point le jardin, ou même un extérieur végétalisé en ville, peut améliorer la qualité de vie. Non seulement la qualité de vie individuelle et sociale, mais aussi environnementale : une qualité de vie durable. Tour d’horizon des effets positifs du jardin au xxie siècle, en compagnie de Thierry Roche, architecte, urbaniste et chercheur pour Leroy Merlin Source.
maginez que votre journée démarre à vélo au quarantième étage. Au lieu de descendre de chez vous pour aller au travail, vous montez tout en haut, jusqu’au ciel. Vous parcourez les toits de votre immeuble et des immeubles alentour reliés par des passerelles. Vous souriez aux quelques voisins que vous croisez de bon matin. Vous passez d’un jardin zen à un jardin d’enfants, d’un potager à une terrasse aménagée en salle des fêtes, puis vous longez une mare où s’épanouit une faune sauvage. Vous respirez. Votre journée peut se dérouler sereinement.
ISi ce type d’aménagements existe déjà à Montréal, la tendance à habiter les toits est plutôt encore en éclosion en France. Pourquoi créer des jardins sur les toits ? La première raison est écologique. Pensez à la sensation de fraîcheur que l’on ressent en forêt, comme une climatisation naturelle grâce à l'évapotranspiration des arbres, ce processus par lequel l’eau s'évapore des plantes et du sol, formant une sorte de « respiration » végétale, essentielle à la régulation du cycle de l’eau dans notre environnement. Au contraire des sols végétalisés, les sols artificiels, rendus imperméables, perturbent le cycle de l’eau et aggravent les effets des inondations. Végétaliser les toits en ville et créer des îlots de verdure au sol sont donc des moyens pour limiter la hausse des températures en ville. De quoi se préparer à des étés à 50° comme ce sera sans doute le cas à Paris en 2030.
le JARDIN 212

213
Une respiration végétale en ville. Photographie Leroy Merlin.
Le deuxième argument qui plaide en faveur des jardins sur les toits est social. Quand on habite un tout petit logement en ville, où peut-on organiser l’anniversaire de son enfant, à part au fast-food du coin ou au square ? Un jardin sur le toit est une alternative extraordinaire, où l’on ressent moins le bruit (car il n’y a pas la résonance de la chaussée), où l’on jouit d’une énorme surface mutualisée, bien plus qu’une pièce supplémentaire. Le F2 s’ouvre alors sur l’horizon.
Un toit végétalisé est aussi ce que l’architecte
Thierry Roche appelle un « sociotope » : un espace favorable à la paix sociale. Concrètement, cela signifie que les parties communes ont un gros potentiel pour créer du lien entre voisins et qu’il faut en profiter. Créer un salon-bibliothèque dans un hall d’entrée, investir un local à vélos comme une place de village… Idem pour le toit, propice aux rencontres et à la bonne entente, surtout si les habitants de l’immeuble participent à la conception de l’espace. C’est la seule manière selon les professionnels de s’en emparer et de le faire durer. Autrement dit, en co-gérant le budget, en décidant eux-mêmes des univers qu’ils souhaitent, en exprimant leur créativité, les habitants s’attachent au projet de jardin sur leur toit. Et écrivent leur propre histoire.
Le nouveau visage du jardin, c’est aussi le soutien qu’il apporte aux logements dits passifs, qui ne nécessitent presque pas de chauffage. Le
projet d’habitat passif est global, rien n’est laissé au hasard : le jardin sert de réserve naturelle où l’on puise des ressources renouvelables ; la végétalisation de la partie ouest, en utilisant une pergola et des treilles, permet d’abaisser la température d’au moins deux ou trois degrés ; une fontaine à bras permet de récupérer les eaux de pluie ; et plutôt qu’une piscine, ce type de jardin peut être doté d’une nage naturelle, avec un bassin de décantation et une pompe solaire. Chaque élément est pensé dans un sens écologique, autonome, y compris le potager enrichi par du compost.
Le jardin contribue à réduire l’impact environnemental de l’habitat, en accueillant la biodiversité, en nourrissant ses habitants locavores et en créant une climatisation naturelle. Il contribue aussi au vivre-ensemble : on revient aux jardins vivriers du début du xxe siècle, dans un esprit guinguette et de partage. C’est le lieu du possible et de la rencontre, l’expression de la vie dans toute sa simplicité.
2 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.
le JARDIN 214

La végétalisation : un moyen de rafraîchir la maison. Photographie Leroy Merlin.
La végétalisation des toits permet de limiter la hausse des températures en ville, Danemark, 2017. Photographie Alex MacLean.

215
LE JARDIN AU SERVICE DE L’HABITAT
RÉGÉNÉRATIF
le JARDIN 216
Le jardin sous toutes ses formes reconquiert donc nos villes. C’est un poumon, dont on ne pourra plus se passer à l’avenir, comme le dit Florent Quelquejay, responsable du vivre-dehors chez Leroy Merlin : « Sans en avoir conscience, à travers des cycles de surconsommation, nous avons dégradé et distancié le vivant. Nous devons reconnecter les habitants à la nature, proposer des solutions pour jardiner, cultiver ou simplement vivre dehors et observer : c’est sûr, cela aura un impact sur le regard des habitants, leur manière de vivre et leur empathie envers la biodiversité.
La pandémie de Covid-19 a accéléré et révélé un mouvement latent : le besoin d’ouvrir l’habitat sur l’extérieur, de faire entrer le végétal chez soi et de pouvoir faire du dehors un espace de vie. Le jardin devient la cinquième pièce de la maison où l’on cuisine, on se détend et on reçoit. Cet oxygène bénéficie à la santé mentale des habitants. Dans la perspective d’un habitat
217
« reconnecter les habitants à la nature, c’est remettre les mains dans la terre. »
le JARDIN 218
régénératif, nous priorisons trois sujets à propos du jardin de demain : l’économie d’eau, le jardin nourricier et l’enjeu de la végétalisation.
D’abord, concernant l’eau, nous cherchons à permettre aux habitants d’arroser moins et mieux. Le but est d’arroser juste ce qu’il faut, pour préserver la biodiversité du jardin. Historiquement, il existe des récupérateurs d’eau de pluie raccordés aux gouttières, mais nous devons innover encore, récupérer un maximum d’eau de pluie et nous préparer aux épisodes de stress hydrique à venir. Nous adressons les enjeux puis co-concevons les solutions avec nos partenaires. Il s’agit aussi de développer la préservation de cette eau. L’utilisation de paillage, comme des copeaux de bois au pied des plantes, permet par exemple de garder l’humidité. Enfin, nous devons inventer des circuits dans la maison autour des eaux grises et de l’eau de pluie pour réutiliser un maximum l’eau et pas seulement au jardin.
Par ailleurs, reconnecter les habitants à la nature, c’est remettre les mains dans la terre. Il n’y a rien de tel que cultiver son jardin pour prendre conscience des enjeux et refuser les aliments venus de l’autre bout du monde. Nos convictions rencontrent les envies des habitants qui d’ailleurs utilisent de plus en plus le compostage. C’est extraordinaire de voir un enfant utiliser ce terreau maison, planter sa graine, l’arroser et la faire grandir. Nous souhaitons accompagner les habitants grâce à des solutions complètes et de la pédagogie, afin qu’ils puissent concevoir et cultiver leur potager au rythme des saisons.
Je pense que la permaculture est une solution d’avenir. Ce n’est pas le métier historique de Leroy Merlin, mais nous travaillons au développement d’une offre permettant à tous de bénéficier d’un jardin nourricier. Dans le jardin de demain, nous savons qu’il faudra faire le deuil du parfait gazon vert et lui préférer une pelouse parsemée de pissenlits.
À une échelle plus large, il nous faut aussi contribuer à végétaliser les villes : au lieu de tout ce béton, cette chaleur emmagasinée, que pouvons-nous faire pour capter le CO₂ et rafraîchir les espaces urbains ? Il faut des subventions si l’on veut massivement végétaliser. Les municipalités soutiennent l’achat de vélos, pourquoi pas la végétalisation des villes ? Tous ensemble, industriels, institutions et distributeurs, nous devons nous attaquer à ces nobles causes.
Créer des mini-forêts en ville, développer les jardins et potagers, économiser l’eau : nos objectifs du vivre-dehors constituent finalement des rééquilibrages nécessaires pour changer de paradigme. »
219
LEROY MERLIN,
100 AN s D ’ HI s TOIRE
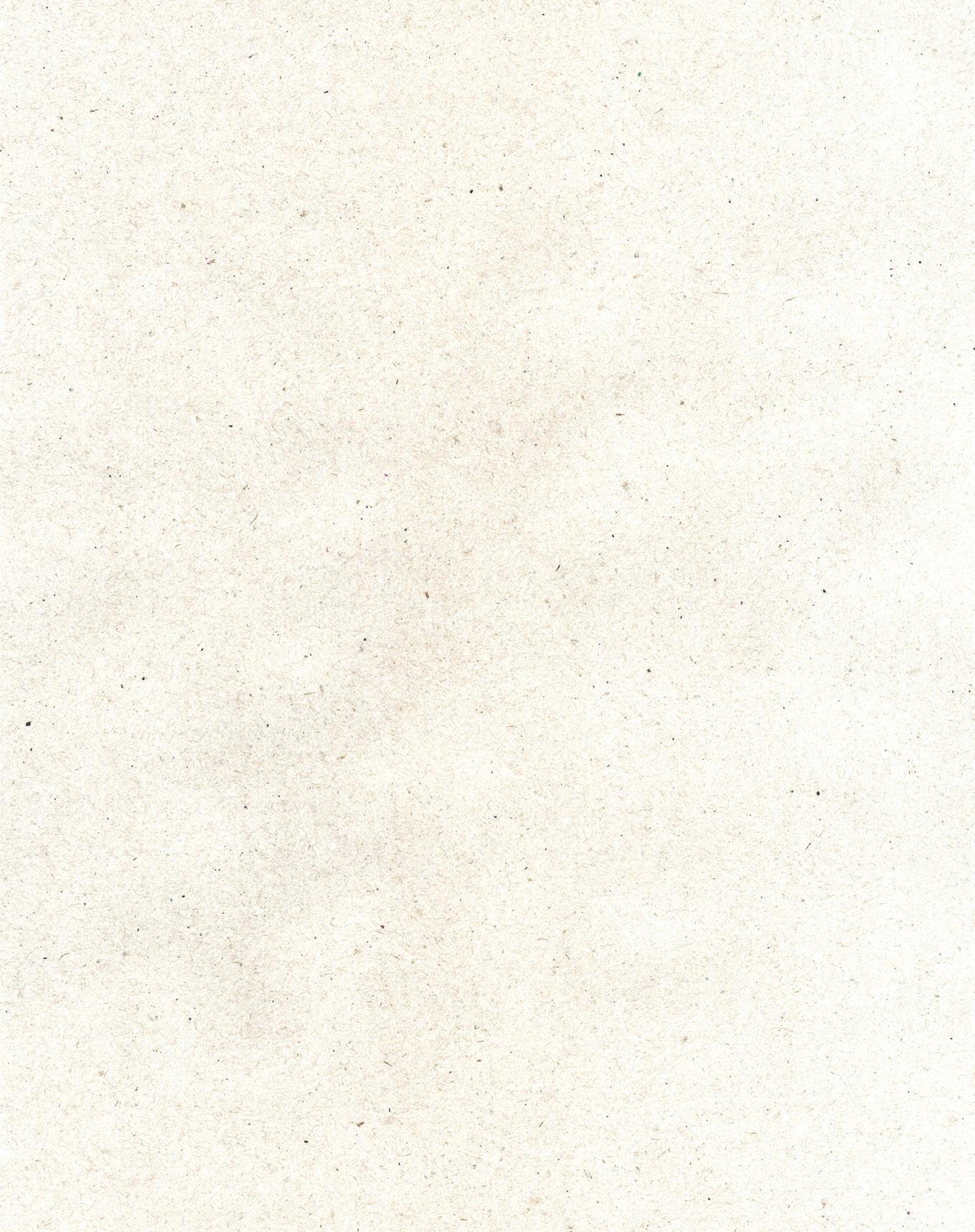
Rétrospective
Leroy et Merlin :
100 ans d’histoire


LEROY MERLIN 222
Carte postale de l’enseigne Au Stock Américain, 79 rue de la Gare, Nœux-les-Mines.


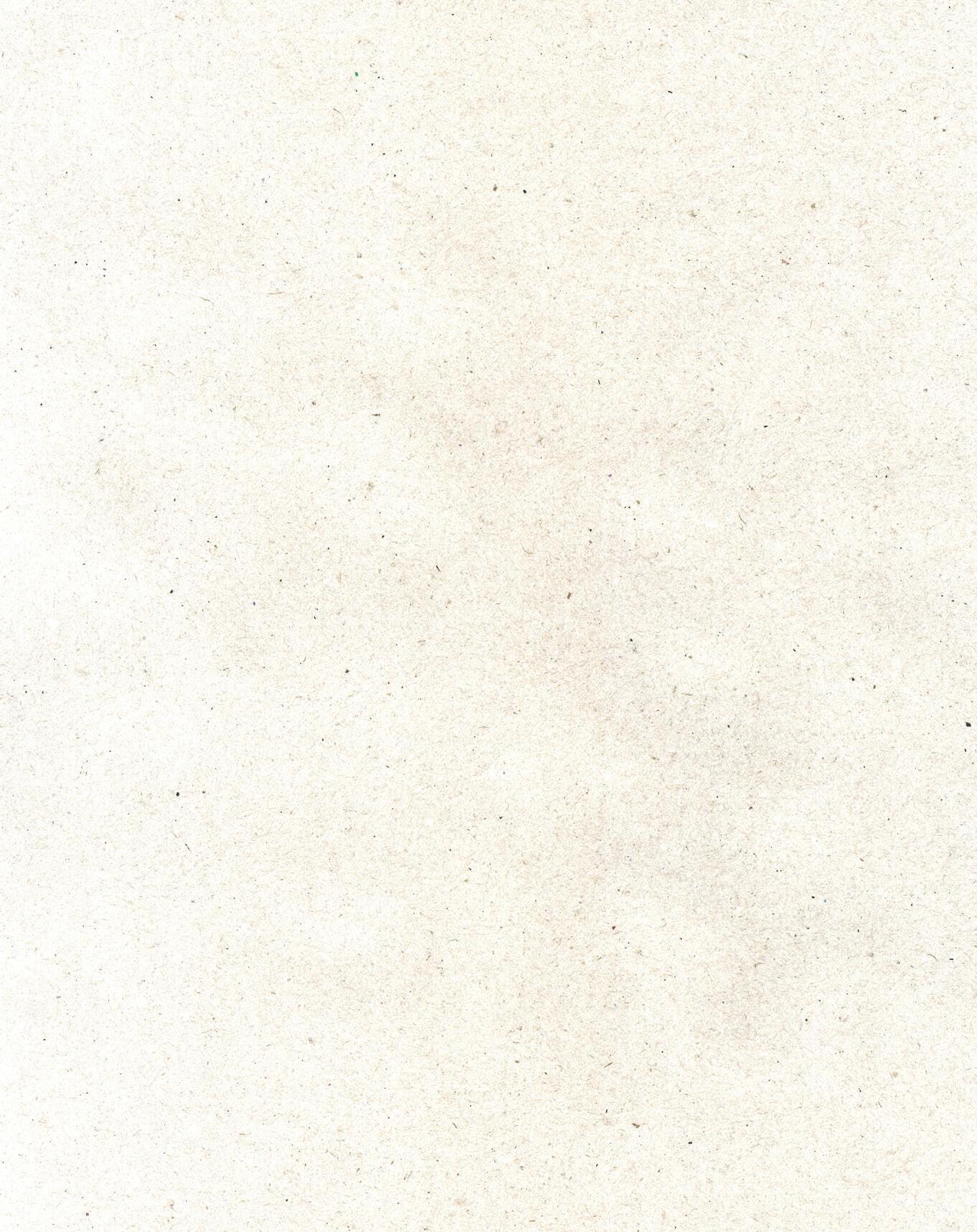
Les origines à la fin du xixe siècle
Leroy et Merlin : une histoire de familles
Il était une fois, dans le Nord, une hotte semblable à celle du Père Noël et beaucoup de volonté. Dans la famille Leroy, voici la grandmère. Sans elle, l’enseigne Leroy Merlin n’existerait peut-être pas. Lors du décès de son mari en 1879, Félicité Drelon, alors âgée de trente ans, se lance dans la vente d’épicerie en porte à porte, à pied et chargée d’une hotte. Une dizaine d’années plus tard, le succès étant au rendez-vous, Félicité demande de l’aide à son fils, Adolphe Leroy. Celui-ci, qui avait renoncé au métier traditionnel d’une lignée d’agriculteurs,
quitte donc la mine où il travaille et apprend volontiers le commerce auprès de sa mère. Doué, Adolphe développe l’activité grâce à la revente de marchandises provenant de ventes aux enchères. La famille acquiert une renommée certaine de commerçants. Idem chez les Merlin, déjà reconnus de père en fils pour le commerce de vaisselle.
Puis la Première Guerre mondiale rebat les cartes. Il faut se réinventer. À la fin du conflit, Adolphe Leroy père, âgé de quarante-six ans, a presque tout perdu si ce n’est sa fibre commerciale. Il relance une épicerie en gros qu’il abandonne progressivement au début des années 1920, au profit d’une activité nouvelle, dictée par les circonstances et qui fait sens. Sans le savoir, il préfigure déjà les enjeux du commerce du xxie siècle en créant ce que l’on appelle aujourd’hui une ressourcerie
La première photo de l’enseign Au Stock Américain, Adolphe Leroy fils à l’extrême gauche de l’image.
En effet, Adolphe Leroy se consacre désormais à la revente de surplus de l’armée américaine restés sur le territoire français après la fin du conflit et achetés aux enchères (brouettes, pelles, pioches, tôles, vêtements, couvertures, lits de camp, savons, etc.), pour une population d’après-guerre extrêmement démunie. Pari gagné : les marchandises s’écoulent rapidement. Le succès de l’enseigne Au Stock Américain est tel qu’Adolphe Leroy fils vient en renfort. Le père passe la main en 1923 en offrant à son fils la reprise du commerce au 79, rue de la Gare à Nœux-les-Mines. Qu’importe le cadre, la demande existe bel et bien et le succès se confirme.
La période paternaliste de 1924 à 1944
S’adresser au plus grand nombre, un savoir-faire
Un mariage officialise le début de cette grande aventure : le 28 janvier 1924, Adolphe Leroy fils épouse Rose Merlin. L’alliance des deux familles scelle le destin de l’entreprise, car le rapprochement des deux patronymes rebaptise bientôt l’enseigne. À partir de la fin des années 1920 (et jusqu’à sa disparition en 1960), le nom « Au Stock Américain » coexiste avec la « Maison » ou les « Établissements » Leroy-Merlin. Ce sens aiguisé du commerce hérité de son père, Adolphe Leroy fils le transforme en vision. Pionnier ? Sans doute, parce qu’il pressent les besoins des Français et sait leurs difficultés matérielles. L’entrepreneur inaugure alors un marché encore inédit, la vente directe aux particuliers de matériaux de construction et
d’aménagement de la maison. Surtout, il met en place une politique de prix accessibles qui va démocratiser certains objets symboles de confort, par exemple les éviers en céramique d’Aire-sur-la-Lys. La vente au plus grand nombre, dans une France meurtrie, devient son cheval de bataille. Des innovations commerciales soutiennent le projet et enracinent une culture du service : livraison gratuite, catalogues de produits avec vente à distance, matériel d’occasion. Le tout accompagné d’un sens de la réclame remarquable. L’enseigne va de succès en succès, notamment grâce à une nouvelle offre de « constructions démontables préfabriquées et économiques », adaptée aux besoins de reconstruction et de logement de la population du Nord de la France.
Adolphe Leroy fils incarne alors la figure du patron humaniste, au caractère bien trempé, pleinement engagé dans sa communauté de Nœux-les-Mines. Le 4 juillet 1932, il organise un lâcher de montgolfière qui émerveille les habitants ; cet événement illustre bien la personnalité de l’enseigne dès les débuts, calquée sur celle d’Adolphe, un esprit festif et fédérateur. Ducasses, fêtes de Noël et d’anniversaire, associations sportives, œuvres de charité… Ces événements ponctuent une activité qui résiste aux différentes crises grâce au génie commercial et au sens de l’adaptation du fondateur. De nombreuses entreprises françaises doivent alors fermer leurs portes tandis que l’enseigne Au Stock Américain embauche et inspire. Jusqu’à ce que, de nouveau, le galop ralentisse en raison du second conflit mondial. À la Libération en septembre 1944, comme en 1919 pour son père, tout est à refaire.


LEROY MERLIN 224



225
Photo prise vers 1930 : Adolphe Leroy fils se trouve en troisième position en partant de la gauche, Rose Merlin se tient à ses côtés, en robe noire, au milieu.
La reconstruction de 1945 à 1959
Le Stock Américain de père en fils
Dès le retour de la paix, il faut remettre Au Stock Américain sur les rails. Cette nouvelle ère correspond à une nouvelle génération qui entre en scène en 1946. Les fils d’Adolphe, Lionel et Bernard Leroy, rejoignent en effet leur père à la tête de l’entreprise qui comptait cinquante employés en 1940 et redémarre sur des bases identiques. La mission reste d’offrir à sa clientèle un vaste choix de produits, à des prix défiant toute concurrence, grâce à la vente à prix coûtant. L’offre se diversifie en relevant le défi de la reconstruction. D’abord, le service construction propose des habitations plus qualitatives. Ensuite, la mise en place d’une société de menuiserie répond au désir grandissant des Français d’aménager leur intérieur. Si le secteur matériaux représente toujours le fer de lance de l’entreprise, l’ameublement et les produits sanitaires, déjà bien présents dans les années 1930, s’affirment.
En 1952, le Stock ne désemplit pas. Adolphe ouvre donc d’autres dépôts, en commençant par le choix du cœur : Merlimont, une petite station balnéaire chère à la famille. En 1958, l’ascension franchit les frontières régionales.
Pour toute une frange de la population, Au Stock Américain représente une possibilité réelle d’améliorer son confort intérieur à des prix abordables.
C’est un tournant dans l’histoire de la société, le troisième dépôt ne s’ouvre pas dans le NordPas-de-Calais, mais à Longueau, en Picardie. Inclassable, l’entreprise paraît réellement atypique au regard du commerce traditionnel. Une « maison unique en son genre », comme elle se définit elle-même. Prix, choix, service : ces trois traits fondateurs perdurent et dessinent son visage. Pour toute une frange de la population, Au Stock Américain représente une possibilité réelle d’améliorer son confort intérieur à des prix abordables. L’un des slogans de l’époque résume d’ailleurs bien les choses : « Plus heureux qu’un roi dans un chalet Leroy » !
La conquête nationale de 1960 à 1978
Leroy-Merlin SA, entre tradition et modernité
Les Trente Glorieuses sont-elles donc des années glorieuses pour Leroy Merlin ? Sans nul doute. Entre 1947 et 1965, l’effectif des Houillères du Nord-Pas-de-Calais est divisé par deux, mais cette crise charbonnière n’affecte en rien l’enseigne. Sa puissance commerciale impressionne, voire dérange. Les grossistes et les négociants en matériaux apprécient peu la progression des succursales, tandis que l’entreprise s’avère très populaire dans les milieux ouvriers. La courbe des effectifs grimpe, passant de 250 salariés en 1965 à 1 500 en 1978. Le nombre de points de vente croît aussi, passant de cinq magasins en 1971 (alors appelés « dépôts »), à trente-quatre à la fin des années 1970. L'ouverture en 1974 d'un premier magasin en région parisienne, à Montsoult,


LEROY MERLIN 226



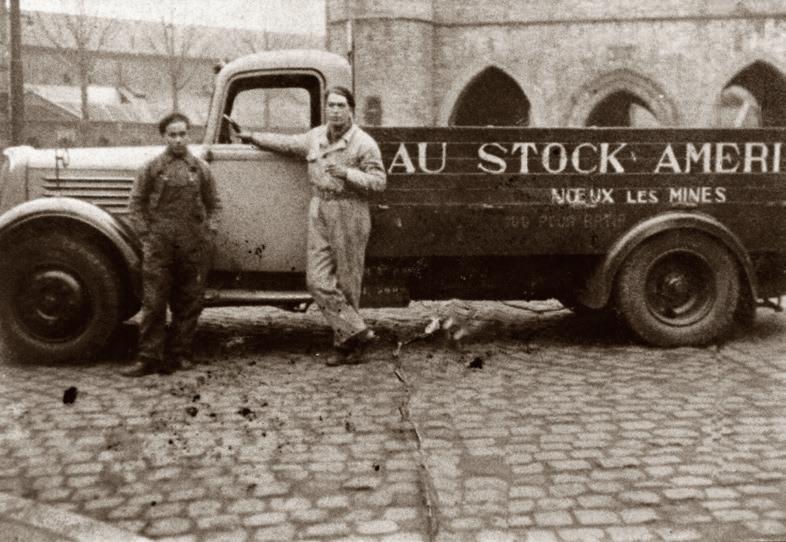
227
La famille Leroy Merlin.
Chauffeurs devant leur camion de livraison de l’enseigne Au Stock Américain, 1950.
marque un cap dans l’expansion nationale, même si l’enseigne reste présente surtout dans la moitié nord de la France. S’il continuera à suivre les affaires et à prendre part à certaines décisions jusqu’à son décès en 1978, Adolphe Leroy se met peu à peu en retrait au profit de ses deux fils. De grands changements s’opèrent alors à la direction. En 1960, on abandonne l’appellation d’origine « Au Stock Américain », après presque quarante ans d’existence, pour lui préférer « Leroy-Merlin », désormais société anonyme (SA). L’enseigne fait peau neuve. Un nouveau nom, un nouveau siège social et des idées audacieuses comme celle de Lionel Leroy qui lance le libre-service en 1966. C’est une petite révolution dans le milieu : pour la première fois, les clients peuvent toucher un marteau avant de l’acheter ! Cela implique une réorganisation complète de l’aménagement des magasins. Cette innovation réenchante l’expérience commerciale. La clientèle s’élargit, à mesure que « l’enchanteur » Leroy-Merlin se « multi-spécialise » avec des gammes de produits extrêmement larges : à l'époque, LeroyMerlin vend des meubles, de la vaisselle et même des jouets pour enfants ! La clientèle s’élargit, aussi, grâce à une stratégie de vente basée sur les promotions et les animations commerciales.
L’innovation est également organisationnelle. Les frères Leroy, fins négociateurs capables de dénicher le bon produit au bon moment, se rendent à l’évidence : leur mode de gestion
En avance sur leur temps, les frères Leroy informatisent dès 1971 la gestion des produits et le réapprovisionnement des magasins.
des produits est sous-dimensionné, devenu obsolète par rapport à la taille de l’entreprise. En avance sur leur temps, ils informatisent donc dès 1971 la gestion des produits et le réapprovisionnement des magasins. Le module créé, adaptable à chaque magasin, inaugure une gestion à l’article – ce qui est révolutionnaire pour l’époque –, une centrale d’achat et une automatisation de l’entrepôt et du réapprovisionnement.
Les débuts de l’ère Auchan, de 1979 à 1989
Savoir, pouvoir, avoir
L’organisation familiale, jusque-là une force, devient néanmoins un handicap. À l’heure où les concurrents s’associent avec de grands distributeurs pour accélérer leur développement, Leroy-Merlin poursuit le sien avec des moyens insuffisants, peinant à suivre la rapide montée en puissance des années 1977-1979.
À la toute fin des années 1970, la robustesse de l’entreprise est mise à mal. Poursuivre l’aventure sans soutien extérieur devient délicat. Fin 1978, peu après le décès d’Adolphe Leroy, Gérard Mulliez et Lionel Leroy se rencontrent et ratifient un accord de participation. Le contenu de cet accord est précis : Auchan entre dans le capital de Leroy-Merlin à hauteur de 50 % par apport de fonds. Les frères Leroy restent aux commandes sous certaines conditions, notamment concernant les résultats économiques : s’ils se révèlent inférieurs à un niveau préalablement défini, un changement de management sera alors envisagé.


LEROY MERLIN 228


Adolphe et ses deux fils, Bernard au milieu et Lionel à droite, 1965-1970.

Plaquette promotionnelle pour la Saint-Nicolas avec la signalétique « L’enchanteur », magasin de Nœux-les-Mines, 1966.
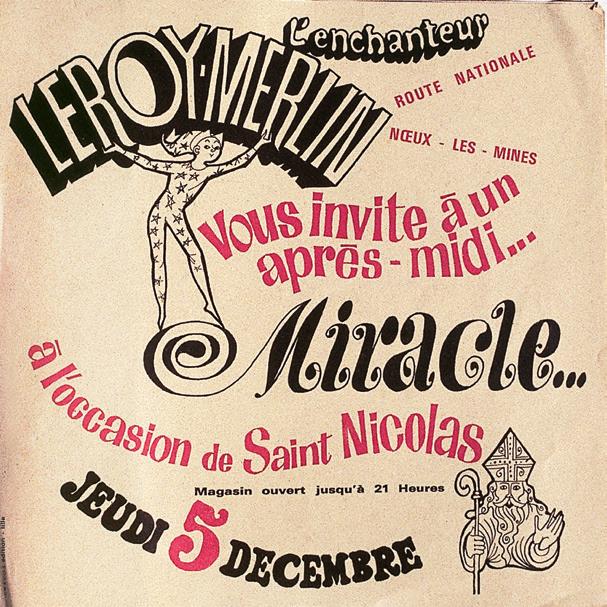
229
« Le client est le roi ; l’administratif, on verra » : en une boutade, la direction de Leroy-Merlin (toujours avec trait d’union à l’époque) résume sa vision traditionaliste du métier. En contraste, l’approche moderne des propriétaires d’Auchan vise l’expansion et la pérennisation de l’entreprise. Après une période de transition de deux ans, Auchan rachète la totalité des parts encore détenues par la famille Leroy en 1981, soulevant bien des doutes parmi le personnel, et la restructuration se met en place. Celle-ci donne lieu à un repositionnement total de l’enseigne, à un renouvellement de la gamme en profondeur et à un grand nombre de fermetures de magasins.
Comment dès lors restaurer la confiance de collaborateurs inquiets ? Par une nouvelle impulsion dans la gestion des affaires sociales.
À partir de 1982, une « politique de partage » se met en place : partage du savoir, partage du pouvoir et partage de l’avoir. D’où la création de l’intéressement (prime de progrès) puis de la participation aux bénéfices, ainsi que le développement de la représentation du personnel, de la formation, de la communication interne et d’un projet d’entreprise sur le thème de la réussite. D’un point de vue commercial, une page se tourne ; la publication du catalogue général cesse, de même que la vente par correspondance. L’image de la marque se modernise, notamment à travers sa nouvelle identité visuelle qui rend célèbre le triangle vert. Quel est le bilan de cette métamorphose ?
À partir de 1982, une « politique de partage » se met en place : partage du savoir, partage du pouvoir et partage de l’avoir.
Très positif. Dès 1985, le redressement s’achève et, en 1989, un premier magasin s’ouvre hors de France, à Leganés en Espagne, dans la communauté madrilène.
L’ouverture à l’international de 1990 à 1999
Vers une entreprise participative
Les engagements des années 1980 portent leurs fruits dans les années 1990. En dix ans, le groupe passe de 6 000 à 12 000 collaborateurs. Si la politique de partage est directement héritée du patrimoine d’Auchan, Leroy Merlin (le trait d’union a désormais disparu) apporte cependant sa pierre à l’édifice et pousse la démarche encore plus loin. La notion de « vouloir » s’ajoute aux trois autres et symbolise la transition vers une entreprise participative.
Rien de tel qu’un voyage pour renaître. C’est en 1991, à la suite d’un séjour du comité de direction français à San Francisco et sous l’impulsion de Christophe Dubrulle, alors directeur général, que l’entreprise prend la décision de faire évoluer son modèle. Les travaux du chercheur en relations internationales Michael Doyle, et ceux de Meryem Le Saget en vision partagée, conduite du changement et dynamiques collaboratives, sont les sources d’inspiration de ce nouveau paradigme. Ce changement s’incarne par le lancement de la démarche Vision. Ce vaste mouvement d’échange d’idées et d’innovations au sein de l’entreprise est déployé à partir de 1995 sous l’égide du directeur général Damien Deleplanque. Elle embarque l’ensemble des collaborateurs dans des moments participatifs inédits, par leur ampleur et leur échelle.


LEROY MERLIN 230


La fête de la réussite dans les années 1990.

Couverture d’une plaquette de présentation trilingue français, anglais et espagnol, mettant en avant le logo au triangle vert, 1989.
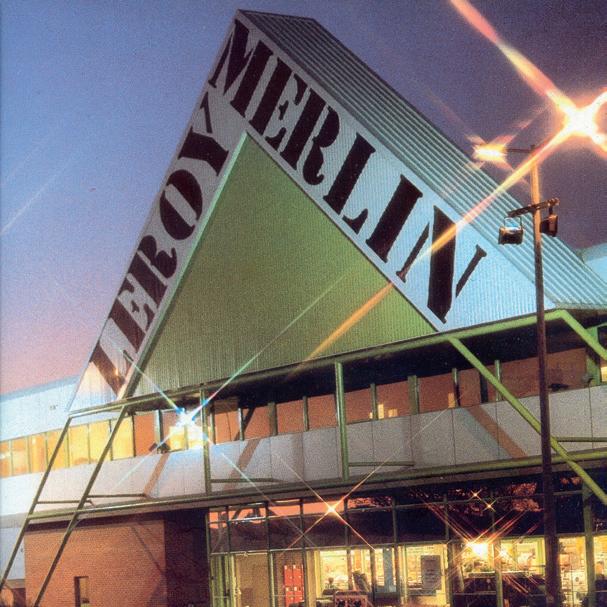
231
Chacun des 12 000 collaborateurs contribue, et toutes ces idées se trouvent synthétisées pour inspirer les choix stratégiques du comité de direction.
D’autres innovations ponctuent cette décennie, notamment les prémices du commerce électronique avec la naissance du premier site internet de vente en 1997. De plus en plus de supports véhiculent alors l’image de l’entreprise ; fidèle à son histoire, l’enseigne perpétue des engagements associatifs et actions solidaires. Et, dans le contexte international de ratification du protocole de Kyoto (COP3), on commence en interne à prendre la mesure de l’enjeu environnemental. Sur le volet ressources humaines, l’innovation n’est pas non plus en reste. Le passage effectif aux trentecinq heures s’organise en 1999, tandis que des demandes de formation et de mixité émergent parmi le personnel. La vie au sein de l’entreprise se révèle ainsi plus horizontale et moins hiérarchique. On est loin du temps des Leroy !

Le « faire soi-même » devient incontournable et les services, comme l’assistance technique et les cours de bricolage, viennent compenser, chez les nouvelles générations, un certain manque de savoir-faire manuel.
L’accélération de la vision, de 2000 à 2007
Vers une entreprise collaborative et engagée : « Accompagnons le rêve des habitants du monde »
Le rêve devient réalité. À partir de 1999-2000, l’ensemble des idées et innovations révélées durant la première phase de la démarche Vision se concrétise. C’est une satisfaction pour des milliers de collaborateurs. Trois ambitions sont nées de ce processus de réflexion collective : mettre l’homme au cœur de l’entreprise, devenir la référence mondiale de la satisfaction client et se développer comme une entreprise mondiale et prospère. Découlant de cette concertation, de nombreux services sont mis sur pied ou relancés dans le cadre d’une démarche pédagogique autour des projets de rénovation et d’aménagement de la maison permettant à Leroy Merlin de se différencier des autres enseignes. Avec l’augmentation des prix de l’immobilier, le « faire soimême » devient incontournable et les services, comme l’assistance technique et les cours de bricolage, viennent compenser, chez les nouvelles générations, un certain manque de savoir-faire manuel. L’objectif de ces services est également de développer la connaissance et la compréhension des clients afin de construire une relation client orientée vers la fidélisation. Au gré de ces améliorations qui émanent des collaborateurs eux-mêmes, Leroy Merlin acquiert un statut de référent dans le domaine de l’habitat. En 2003, l’enseigne se positionne comme leader du marché français des magasins de bricolage et détrône Castorama. Cette réussite s’accompagne d’une augmentation du nombre de collaborateurs (16 000 en 2007).

LEROY MERLIN 232


Équipes de magasins Leroy Merlin, début des années 2000.


233
La poursuite de la démarche Vision avec le lancement de Vision Accélération va pousser à la structuration d’une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE), d’abord en créant en 2006 la fondation Leroy Merlin en faveur des personnes handicapées et âgées, et ensuite en lançant en 2005 le premier réseau de recherche sur l’habitat, Leroy Merlin Source.
La transformation digitale de 2008 à 2017
Vers l’innovation collaborative : « Innover pour inventer demain »
Dans un monde en plein bouleversement économique, technologique, social et culturel, Leroy Merlin prend conscience de la nécessité de se réinventer.
À la suite de Vision Accélération, l’entreprise passe d’une culture produit, centrée sur le lieu de vente physique, à une culture de la relation client – les clients sont dorénavant appelés « habitants » –, qui se déploie sur une multitude de canaux (téléphone, smartphone, web, tracts, magazine, courrier papier, e-mail, réseaux sociaux, etc.).
Face à la montée en puissance de la vente en ligne, il apparaît de plus en plus évident que la relation à distance est tout aussi importante que celle en magasin. L’objectif est de faire cohabiter le digital avec le développement des magasins en impliquant les collaborateurs, notamment les vendeurs dont le métier est grandement impacté.
L’innovation est relancée dès 2010 car une transformation s’impose pour ancrer la croissance future de l’enseigne. La tendance prioritaire est la réorganisation de Leroy Merlin sous un mode collaboratif. Le but est de proposer des outils en cohérence avec l’évolution de l’entreprise qui favorisent un fonctionnement plus transversal pour travailler mieux et plus vite. L’engagement majeur sur cette période est d’orienter l’entreprise vers la notion d’habitat durable, en accord avec la stratégie « Inventer la maison de demain » qui se décline sur quatre thématiques : la santé, les économies d’énergie, le respect de l’environnement et la facilité de vie. D’un point de vue institutionnel, Leroy Merlin approfondit ses réflexions en organisant par le biais de Leroy Merlin Source les premières Assises de l’habitat en mars 2011.
De 2018 à 2023, devenir l’évidence habitat
Vers l’entreprise plateforme, leader de l’habitat positif
Suite à la révélation de la Vision 2015-2025 et se sachant talonnée par ses concurrents historiques, au premier rang desquels figure Castorama, mais aussi par les nouveaux rivaux digitaux, Leroy Merlin France décide de transformer son modèle traditionnel. Son offre, accessible par tous les canaux possibles, ne doit plus être celle d’un simple distributeur de produits mais celle d’un vendeur de solutions pour l’habitat. Mettant à profit son savoir-faire et son expertise métier sur l’organisation de la relation, elle fédère sous un mode plateforme un réseau d’entreprises partenaires


LEROY MERLIN 234


235
Illustration de Bénédicte Muller, extraite de la contribution Habitat durable, des savoirs pour penser et agir, Damien Rondepierre, Leroy Merlin Source, 2022.
(telles que Weldom, Kbane, et Quotatis) capables de proposer aux habitants un large panel de services et déploie une place de marché digitale (la marketplace) qui trouvera son plein essor pendant la crise sanitaire.
Leroy Merlin bénéficie d’un réseau de magasins solidement ancrés dans les territoires et, malgré l’essor de l’e-commerce, les clients restent attachés à un passage en magasin ; c’est là que la différence de l’enseigne doit être consolidée. En proposant un parcours d’achat et d’information aussi fluide sur le web qu’en magasin, l’objectif est d’atteindre une véritable fusion des deux modes de vente.
En mars 2020, lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’habitat devient une valeur refuge pour les Françaises et les Français. Cet événement bouscule la prise de conscience chez les collaborateurs Leroy Merlin de leur rôle essentiel dans le quotidien de leurs concitoyens. Déjà présent, leur sentiment d’appartenance se renforce, d’autant que l’entreprise semble plus que jamais essentielle. L’habitat devient une évidence. Être élue « enseigne préférée des Français », c’est un honneur, mais aussi une responsabilité pour Leroy Merlin qui s’est donné comme mission d’accompagner les habitants dans l’amélioration de leur logement tout en veillant à l’impact social et environnemental de ses activités au sein d’un monde aux ressources
Soucieuse de son impact positif, l’entreprise promeut désormais des modèles économiques circulaires qui rappellent les tout débuts du Stock Américain.
limitées. Soucieuse de son impact positif, l’entreprise promeut désormais des modèles économiques circulaires (réemploi, seconde vie des produits, location) qui rappellent les tout débuts du Stock Américain. Elle aspire à embarquer ses partenaires dans cette dynamique, pour créer un véritable écosystème utile à tous, notamment aux plus vulnérables – la lutte contre la précarité énergétique et le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées étant les deux enjeux majeurs aujourd’hui. Cet objectif s’inscrit dans une démarche RSE ambitieuse portée par l’ensemble du groupe Adeo sous le slogan : « We make it positive. » En soufflant ses cent bougies, l’entreprise, à la jeunesse et la vivacité sans cesse renouvelées, formule ses vœux avec foi en l’avenir. Le prochain cycle de Vision peut se mettre en place, embarquant les 30 000 collaborateurs de l’enseigne au sein des 144 magasins.


LEROY MERLIN 236



Depuis 2019, Leroy Merlin France est partenaire du collectif « Stop à l’exclusion énergétique » qui travaille à des solutions pour transformer la vie des plus précaires sur le plan de l’habitat et de l’énergie.
237
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs recherches ou leur témoignage, ont contribué à retracer l’histoire de l’habitat en France : Claire Beauvais, Denis Bernadet, Franck Billeau, Yves Bogaert, Mona Chollet, Olivier Corbin, Nicolas Cordier, Matthew Crawford, Matthieu Degeorges, Pascal Dibie, Pascal Dreyer, Tanguy Dufournet, Élise Dujardin, Monique Eleb†, Alice Fruchart, Barbara Furry, Julie Gayral, Laurent Glaser, Abdu Gnaba, Pierre-Yves Hadengue, Viviane Hamon, Nathalie Hervé, Bastien Hild, Émile Hooge, Jean-Philippe Hurtemel, Jean-Claude Kaufmann, Sandrine Le Deit, Dimitri Lecocq, Claire Letertre, Clara Lorinquer, Alexis Masset, Patrice Pageaud, Tristan de Paris, Jérôme Paternote, Yannick Perrin-Terrin, Michelle Perrot, Benjamin Pradel, Florent Quelquejay, Elsa Ramos, Thierry Roche, Lionel Rouge, Patrick Rozenblatt, Agathe Ruckebusch, Sylvie Sagne, Bernard Saincy, Christophe Sapena, Marie Simunic, Djaouidah Séhili, Hortense Soichet, Fabien Squinazi, Laetitia Vidal, Sandra Villet.
Ainsi que l’équipe Leroy Merlin France en charge du projet : son pilote, Florence Rousseau, et Marianne Barthelemy, Charline Delfosse, Marine Denekre, Matthieu Deroy, Marc Renaud et Carine Negroni.
Un merci tout particulier à celles et ceux qui ont contribué un peu, beaucoup, passionnément... : Emmanuelle Broutin, Laurence Callant, Claire Letertre, Christian Mairesse et Fabrice Matzke.
Pour restituer les 100 ans de l’histoire de Leroy Merlin, Christine Carbonnel Saillard et Clarisse Robert (Folioscope) se sont appuyées sur la documentation interne de Leroy Merlin France (journaux internes, rapports annuels, archives photos et vidéos, etc.) et notamment sur le livre historique paru en 1996 rédigé par Loïc Dupont, ainsi que sur des sources externes (archives familiales, presse ancienne, entretiens).
239
Édition
Caroline Albou Levinger et Céline Bouteiller
Rédaction
Nada Rihani Teissier du Cros
Direction artistique
Judith Meyerson
iconographie
Cécile Niesseron
Chapitre 11 : Archives Leroy Merlin
Relecture
Thomas Chaumont
Photogravure
Christophe Pete (Janvier)
Achevé d’imprimer à 5 000 exemplaires sur papier Amber Graphic par Snel, imprimerie labellisée Imprim’Vert et certifiée PEFC™ et FSC®.
Dépôt légal : avril 2024
Porte-plume Éditions

Conception et réalisation de livres sur mesure porteplume.fr