MéMoire
ENSA Clermont-Ferrand
janvier 2023
Paul Blotin
MéMoire
ENSA Clermont-Ferrand
janvier 2023
Paul BlotinSous la direction de Jean-Baptiste Marie et Victoria Mure-Ravaud

Avant toute chose, je tiens à remercier mes différents directeurs d’étude, qui ont su m’accompagner et m’orienter durant l’année qui s’est écoulée : Géraldine Texier-Rideau, Jean-Baptiste Marie et Victoria Mure-Ravaud. Leurs précieux conseils m’ont permis d’éviter les écueils et de trouver la bonne direction à suivre. Leur optimisme constant a été une source de motivation et de remobilisation dans mes recherches comme pendant la rédaction.
Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Juliac Cadic, Monique Le Clézio, Jean-Robert Lao, Gilles Du Pontavice, Michel Robert, Marjorie Hellard, René Guillaume, Loic Le Callonec, Gael Calvar, Jacques Lefebvre, Hèlène Martinez, Jennifer Parageaud et Claire Boyer. Ils et elles sont pour la plupart maires, adjoints municipaux et employés de mairie des communes traversées par le canal de Nantes à Brest. Les autres sont impliqués dans différentes associations locales historiques et patrimoniales. Sans leur collaboration, ce mémoire n’aurait pas pu se faire.
Je remercie aussi mes camarades et amis de l’ENSACF dont les remarques toujours honnêtes me permettent d’avancer semaine après semaine dans ce travail comme dans d’autres.
Enfin, merci à mes proches pour leur correction minutieuse et leur soutien durant les cinq années passées et surement les suivantes.
C’est à l’été 2016 que je découvre le canal de Nantes à Brest à l’occasion de vacances en famille. J’y découvre une nouvelle forme de tourisme qui, en liant voyage et sport, plait à l’adolescent que j’étais. Au fil des coups de pédale, je découvre progressivement les maisons éclusières, les moulins et minoteries abandonnées, les châteaux de Bretagne mais aussi les villes de Blain, Josselin, Pontivy ou encore Châteaulin. Tout le paysage de la Bretagne intérieure m’apparait comme un long plan séquence kilomètres après kilomètres. Ce premier voyage est aussi riche d’apprentissage sur l’itinérance en tant que telle : je dois emporter sur mon vélo tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, et donc en limiter le volume et le poids.
Je redécouvre le canal quatre ans plus tard avec pour nouvel objectif de rallier la ville de Saumur au cap le plus à l'ouest du Finistère. Le canal de Nantes à Brest, qui s’arrête à 50 kilomètres de cette dernière ville, est alors la principale portion d’un itinéraire agrandi. Je suis cette fois un étudiant en école d’architecture de deuxième année, et mon regard sur le monde a évolué suite aux enseignements que j’ai pu suivre à l'école. Plus sensible, je perçois d’une nouvelle manière l’architecture qui m’entoure mais surtout la figure paysagère que j’arpente et sa géographie. Voyager à vélo laisse beaucoup de temps à l’esprit pour vagabonder, et se perdre, mais je retiens de ce second voyage des premiers questionnements qui ont d’une certaine façon perdurée jusqu’à transparaitre dans ce travail de mémoire. Comment habite-t-on dans un objet mouvant comme une péniche ? Pourquoi un canal et comment a-t-il pu être construit ? Comment, en tant qu’architecte ou architecte en devenir, peut-on se saisir de cet ouvrage en tant que ressource de travail. J’imaginais naïvement un nouveau projet à édifier à chaque coude que pouvait prendre la rivière.
Plus tard, certaines lectures théoriques et artistiques ont résonné avec certaines caractéristiques de l’objet du canal de Nantes à Brest et ont fortifié mon désir de travailler sur ce sujet, à un moment ou un autre. Ainsi le document de Yves Cochet, Agnès Sinaï et Benoît Thévard, « Bioregion 2050, l’Ile
de France après l’effondrement »1 , ont été pour moi une première approche du biorégionalisme. Leur définition d’une unité biorégionale par ses limites géographiques, culturelles, historiques et non administratives m’a semblé intéressante dans un contexte de crises successives que nous traversons. Quel peut être le rôle du canal de Nantes à Brest dans cette matérialisation de limites physiques de futurs bio-régions ? Mais aussi, comment pourrait-il être utilisé comme outil de relation et de connections entre les différentes bio-régions bretonnes, hypothétiquement le Poher, Porhoët et la Cornouailles ?
La découverte du projet culturel du GR 132 en Provence a été l’occasion de repenser à ce sujet, mais au travers du prisme culturel et artistique, cette fois. Le projet se consacre à la création d’un long itinéraire de randonnée traversant villes et campagnes, en s’attardant sur les marges, les délaissés et les zones ordinaires. Dans un second temps le projet fait appel à des artistes qui produisent des œuvres de tout genre, de la petite structure au spectacle vivant. Le parallèle avec le canal de Nantes à Brest passe par la définition d’un itinéraire au long cours de taille similaire3 et qui traduit quelque chose du paysage et du grand territoire.
Le travail de mémoire qui suit s’inscrit donc dans la filiation de ces questionnements anciens, d’une expérience personnelle du site et de lectures importantes.
1 COCHET Yves, SINAÏ Agnès, THEVARD Benoit, « Bioregion 2050, l’ile de France après l’effondrement », Institut Momentum, octobre 2019
2 MARSEILLE PROVENCE 2013, « GR 2013, un sentier métropolitain de randonnée pédestre », WildProject, 2013
3 365 km pour le GR 13 et 364km pour le canal de Nantes à Brest
Remerciements
Avant-Propos
Sommaire
Introduction
p. 6 p. 4
p. 8
p. 10
Chapitre 1. 1793-1842: Un projet régional d’envergure nationale
A Le tracé face aux enjeux militaires, commerciaux et politiques
A.1. Le projet des états particuliers de Bretagne
A.2. Contexte militaire belliqueux des débuts de l’empire
A.3. La situation de la Bretagne intérieure
A.4. Conception et adaptation du tracé
A.5. Le projet impérial, de Pontivy à Napoléonville
B Travaux et travailleurs
B.1. Profil de la main d’oeuvre
B.2. Vie commune des forcats
C Infrastructure hydraulique d’exception
C.1. Fonctionnement des écluses et déversoirs
C.2. Échelles d’écluses et biefs de partage des eaux
C.3. Travaux annexes d’approvisionnement en eau des biefs
Chapitre 2. 1842-1930: Une exploitation limitée
A La nouvelle batellerie bretonne
A.1. Femmes et hommes du canal
A.2. La navigation et ses outils
B Interfaces ferroviaires et maritimes
B.1. Connexion maritime
B.2. Connexion ferroviaire
B.3. Ouvrages d’exception
C Excroissances bâties et évolutivité
C.1. Évolution du type et variations
p. 23
p. 53
p. 65
p. 85
p. 99
p. 115
C.2. Altérations de l’ouvrage
C.3. Usines hydroélectriques novatrices
D Déclin et abandon
D.1. Projet d’électrification de la Bretagne
D.2. Rupture du continuum
D.3. Gel, inondations et chômage
p. 137
Chapitre 3. 1930-2022: Un renouveau esthétique et touristique
A Du romantisme au pittoresque
A.1. Des précurseurs modernes influents
A.2. Art commun local
A.3. Les excès du pittoresque
B Du loisir au tourisme
B.1. Loisirs et canal aux XIXè et XXè siècles
B.2. Événements épisodiques: les fêtes du canal
B.3. Labellisation et mise à profit du patrimoine
B.4. Nouveaux récits nomades du territoire
B.5. Recyclage des artefacts de la machine hydraulique
Conclusion Bibliographie
Sitographie
Iconographie
Annexe 1 : Reconduction photographique, Port-Launay le 28.10.2022
Annexe 2 : Carte de localisation des maisons éclusières entre Chateaulin et Pontivy
p. 157
p. 181
p. 206
p. 219 p. 215 p. 212
p. 248
p. 256
Annexe 3 : Description des sources, ouvrages de références et sites utiles p. 258
Le canal de Nantes à Brest est une machine hydraulique d’exception. Elle s’implante dans un territoire spécifique : la Bretagne intérieure, qui n’est pas ou peu connectée à la mer et à son commerce. Le canal est une figure fluviale tendue entre deux métropoles françaises importantes : Nantes (303 382 habitants4 ) et Brest (139 163 habitants5 ) ce qui le caractérise spatialement et économiquement. En effet, l’essence même du canal est l’état d’infrastructure de réseau tels une route ou un chemin de fer, qui permet alors de desservir une destination et de transporter biens et marchandises d’un pôle à l’autre. Cependant, le canal de Nantes à Brest n’est pas uniquement un trait d’union tendu entre ces deux villes : c’est aussi une voie de passage résolument connectée à son territoire, et notamment aux petites et moyennes villes qu’elle traverse. Ces bourgs et bourgades vivent des situations de crises contemporaines complexes liées à l’exode rural, ils sont ainsi confrontés à une baisse d’activité des centres-villes, ainsi qu’une démographie et une attractivité en déclin. Mais plus que les petites et moyennes villes, le canal traverse surtout la campagne bretonne, ses forêts et ses vallons. Des territoires agricoles où l’élevage garde une place importante. Afin d’abreuver les troupeaux et d’irriguer les champs, l’Homme a établi tout un réseau de petits canaux, de talus et de fossés, qui, une fois associé aux rivières et ruisseaux, permet d’acheminer l’eau et de la partager dans le territoire et entre les différents peuplements humains.
La thématique de l’eau est un enjeu crucial du XXIe siècle, à l’heure où les rapports du GIEC6 se font de plus en plus alarmants et où l’actualité regorge d’exemples de crises et conflits issus de sa gestion7 . Ces crises
4 Données INSEE, 2015
5 Idem
6 SHUKLA P.R, SKEA J., SLADE R., AL KHOURDAJIE A., VAN DIEMEN R., MCCOLLUM D., PATHAK M., SOME S., VYAS P., FRADERA R., BELKACEMI M., HASIJA A., LISBOA G., LUZ S., MALLEY J., « Climate Change 2022 : Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change », Cambridge University Press, 2022
7 « Les méga-bassines, vraie parade aux sécheresses ou aberration environnementale ? », La Montagne, novembre 2022
soulèvent alors la question de la gestion de l’eau de par son statut de bien commun. Dans ce contexte, s’intéresser à un ouvrage tel que le canal de Nantes à Brest semble pertinent, en effet cette infrastructure oubliée, abandonnée, puis redynamisée par le tourisme est avant tout un projet territorial de gestion de l’eau. De 1783 à 1826, les ingénieurs des ponts et chaussées tels que Rapatel, Lecor, Lenglier, sous la supervision de Jean-Marie de Silguy8 , vont tenter de répondre à la question simple de comment adapter le cheminement de l’eau. Leur réponse passe par l’infrastructure et donc l’anthropisation d’un territoire au travers de canaux, rivières canalisées, biefs de partages9 et autres divers équipements de dérivation. Cet écosystème infrastructurel pourrait être classé en 3 grandes catégories : l’espace de circulation, les excroissances bâties et les espaces indéfinis10 .
L’espace de circulation à proprement parler est le canal ou la rivière canalisée. Son appréhension étendue comprend le chemin de halage, qui permit aux chevaux de trait de tracter les chalands11 tout au long de l’itinéraire. Depuis la fin de l’exploitation commerciale du canal, ce chemin est principalement utilisé par les touristes, nomades temporaires cheminant le long de l’itinéraire. Dans les bourgs traversés, le chemin de halage est souvent devenu une rue, un quai ou un parking qui, une fois recouvert d’asphalte, est intégré au réseau routier local et accueille des usages conséquents12.
Les excroissances bâties nécessaires au fonctionnement du réseau sont les écluses et maisons éclusières, récurrentes sur le parcours. Les écluses permettent de niveler et contrôler le niveau d’eau du canal. Leur manipulation et leur entretien nécessitent de la main-d’œuvre humaine présente en permanence sur le site. C’est pourquoi une maison éclusière est construite au droit de chaque écluse et loge l’éclusier et sa famille à proximité immédiate de leur lieu de travail. D’autres excroissances bâties liées à l’exploitation du canal, mais surtout à sa relation aux autres réseaux, sont les ponts. Ils peuvent être routiers ou ferroviaires,
8 « Présentation du canal de Nantes à Brest » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022
9 Un Bief de partage peut faire référence à deux concepts distincts : tout d’abord le Bief de partage des eaux. C’est une ligne de crête qui sépare deux bassins versants. La deuxième définition est l’infrastructure canal creusée au niveau de cette ligne de partage des eaux.
10 DERAMOND Sophie, DURAND Marc-Antoine, « Les infrastructures dans la littérature française contemporaine. Vers une poétique/ critique des marges. », Dans LAMBERT-BRESSON Michèle, TERADE Annie, « Paysages du mouvement. Architecture des villes et des territoires XVIIIe – XXIe siècles. », Éditions recherche / Ipraus, 2016
11 Embarcation a fond plat utilisé pour le transport de cargaisons sur le canal
12 La reconduction photographique ( présentée en annexe 1 p. 248 ) menée à Port-Launay documente cette évolution des rives du canal sur un territoire urbain en mettant en correspondance des cartes postales anciennes et des photographies actuelles sur le même cadrage..
plus rarement passerelles piétonnes. La hauteur de l’ouvrage définit toujours sa connexion ou non-connexion avec le chemin de halage du canal : ce dernier va soit passer dessous, si l’ouvrage est assez haut, soit s’y relier, si l’ouvrage est de taille modeste. Enfin, tous les bâtiments et équipements contemporains liés à l’activité touristique pourraient être classés dans cette catégorie des excroissances bâties, on y retrouve les lieux d’accueils comme les campings, hôtels, gites ruraux et chambres d’hôtes, lieux de restaurations au bord de l’eau ou à proximité, mais aussi les plus petits équipements, le mobilier public installé le long de l’itinéraire (table, banc), les embarcadères, les passerelles d’observation ou de pêche …
Les espaces indéfinis sont tous les espaces résiduels liés au canal de Nantes à Brest. Ils peuvent être liés au nivellement du terrain, ou bien au bon fonctionnement de la machine hydraulique. Dans le premier cas, ces espaces indéfinis sont tous les talus, remblais et autres levées qui permettent d’aplanir et de normaliser le chemin de halage. Ces équipements sont au service d’une homogénéisation du nivellement du parcours, nécessaire pour le halage des chalands. Dans le second cas, les espaces résiduels constituent une ramification du système hydraulique du canal de Nantes à Brest. En effet, pour assurer un niveau d’eau constant dans les écluses, il est nécessaire d’approvisionner certaines sections en eau et de prévoir le désengorgement d’autres.
L’eau est la ressource au cœur du canal de Nantes à Brest. Elle a d’abord permis le développement d’un paysage hydraulique, puis d’un paysage logistique et enfin d’un paysage touristique. Cette notion de l’eau et de son cheminement dans le territoire est l’une des clés cruciales de compréhension de ce site. Cependant, malgré sa canalisation certaine, la présence de l’eau est bien évidemment antérieure à l’occupation humaine. Alors, l’Homme a posé son regard sur ce territoire et a été amené à le représenter afin de concevoir les modifications et aménagements nécessaires. Plus tard, d’autres représentations sont ébauchées, mais à des fins diverses : artistiques, documentaires, géographiques, techniques, journalistiques, archivistiques, mémorielles ou encore militaires. Ces représentations d’une étendue naturelle font évoluer son statut et son appréhension. L’étendue naturelle devient tour à tour une installation, un site défensif, une ressource énergétique, un théâtre social de la batellerie bretonne et enfin, un paysage. Alain Roger théorise dans son ouvrage «
Court traité du paysage »13 ce processus anthropologique de transformation d’une étendue appelé pays en paysage. Il le nomme l’artialisation:
« À l’instar de la nudité féminine, qui n’est jugée belle qu’à travers un Nu, variable selon les cultures, un lieu naturel n’est esthétiquement perçu qu’à travers un paysage, qui exerce donc, en ce domaine, la fonction d’artialisation. À la dualité Nudité Nu je propose d’associer son homologue Pays Paysage, que j’emprunte, entre autres, à l’un des grands jardiniers paysagistes de l’histoire, René-Louis de Girardin, le créateur d’Ermenonville : « Le long des grands chemins, et même dans les tableaux des artistes médiocres, on ne voit que du pays ; mais un paysage, une scène poétique, est une situation choisie ou créée par le gout et le sentiment. » Il y a « du pays », mais des paysages, comme il y a de la nudité et des nus. La nature est indéterminée et ne reçoit ses déterminations que de l’art : du pays ne devient un paysage que sous la condition de ce qu’on pourrait nommer un paysart, et cela, selon les deux modalités, mobile (in visu) et adhérente (in situ), de l’artialisation . »14
La comparaison est très surement discutable, néanmoins l’auteur met en lumière toute l’importance du processus de représentation dans notre perception du monde et dans la construction mentale de paysages esthétiques. La dernière partie de la citation insiste sur deux modalités de l’artialisation : in visu et in situ. In visu induit une modification de la matérialité même du site. Alain Roger s’intéresse là à la discipline qu’est le paysagisme, ou comment la main de l’homme en vient à altérer un écosystème afin de le faire correspondre à des critères esthétiques anthropocentrés. Dans le cas du canal, l’action humaine a profondément modifié l’environnement, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons techniques. In Situ induit la capacité d’une œuvre d’art, ou de quelconque représentation, à être communicante, c’est-à-dire à être diffusée dans les différentes régions. La vision, la perception de l’auteur du document est partagée au plus grand nombre, et le processus de construction culturel d’un paysage se poursuit en dehors des territoires liés à l’objet de la représentation, ici la Bretagne intérieure.
Dans ce cas du canal de Nantes à Brest, le processus d’artialisation In Situ décrit dans la thèse d’Alain Roger s’applique bien à postériori d’une transformation In Visu. En effet, le site d’étude n’est pas une étendue naturelle et sauvage devenant paysage, mais une figure technique, hydraulique et logistique, profondément anthropisée.
13 ROGER Alain, « Court traité du paysage », Gallimard, 1997 14 Idem
Dans son article, Sophie Bonin15 oppose cette théorie de l’artialisation à une autre branche de la théorie du paysage : la géographie des représentations. S’appuyant sur les méthodes et outils du sociologue, ce courant de pensée s’intéresse à l’usager, au riverain, dans son rapport quotidien au paysage banal qui l’entoure. L’auteure commence par s’attarder sur la signification du terme paysage. Le mot est un néologisme, ce qu’elle relève comme un inconvénient. De plus, le mot paysage est absent de cette expression alors que c’est fondamentalement de ça qu’il s’agit ici. La géographie des représentations cherche à replacer l’humain dans un paysage, défini comme un espace vécu. Partir de l’humain implique une analyse non plus d’un paysage, mais plutôt de la perception que l’humain en a. C’est donc une analyse d’un phénomène subjectif qui ne recherche pas la vérité absolue, mais plutôt sa représentation.
L’eau et ses enjeux politiques, géographiques et écologiques demeurent aujourd’hui un sujet dont s’emparent artistes, auteurs et photographes. Leurs travaux portent ainsi sur l’espace matériel du fleuve ou de la rivière, pour ses qualités physiques de lumière, de motif et de couleur, mais aussi de l’espace immatériel de sa gouvernance et de sa mémoire. Quelles questions peuvent se poser nos contemporains dans leur production artistique actuelle ? Quelques exemples :
Sublime, les tremblements du monde
Le Centre Pompidou-Metz organise en 2016 cette exposition composée d’un corpus d’œuvres de périodes variées. L’exposition se fonde sur la définition historique du sublime dans l’histoire de l’art, un prolongement magistral du romantisme face à des phénomènes naturels dont le peintre est spectateur. Cependant, l’exposition dépasse cette conception du sublime afin de raconter les bouleversements actuels, conséquences de l’anthropocène et du capitalisme technologique. Il faut dès lors rompre avec ces modèles et en inventer de nouveaux. C’est là que l’exposition convoque des œuvres Land Art tout en mesurant leur posture écologique primaire, en effet « la naissance de ce mouvement fut liée à un renouvellement de la pratique artistique et non à une conviction écologique »16.
15 BONIN Sophie, « Au-delà de la représentation, le paysage », Strates, janvier 2004
16 ASTIER Claire, « Sublime : les tremblements du monde », Critique d’art, 2016
Ce livre écrit par Sacha Bourgeois-Gironde raconte l’histoire, un peu merveilleuse, du fleuve néozélandais Whanganui. L’importance de ce cours d’eau dans la culture ancestrale maorie a mené le gouvernement à lui donner le statut « d’entité vivante et indivisible »17 , la dotant alors de droits fondamentaux. Cette humanisation de la rivière évite toute logique de patrimonialisation qui la figerait dans le temps et dans un certain état. Au contraire, les évolutions de la rivière sont prises en compte dans ce pacte entre l’homme et la nature qui questionne les notions même de « bien » commun18 , de ressources et de protection. Comment, en donnant une voie à la rivière, lui donne-t-on la possibilité de défendre ses intérêts face aux instances humaines ? Et si la mise en récit du territoire ouvrait la possibilité d’un dialogue équitable entre humains et non-humains ?
Itinéraire Paris – Moisson Exposé à la galerie du CAUE 92, cet ensemble de 111 photographies de Jérémie Léon et Ambroise Tézenas est une véritable découverte du territoire de la Seine francilienne. L’arpentage et l’exploration du site sont à la base du travail des deux photographes. La Seine de leurs photographies n’est pas celle du centre de Paris, mais une Seine des marges post-industrielles19. L’exposition documente les traces de l’anthropocène dans des images mélancoliques vides de toute figure humaine. Par leur travail, les photographes représentent l’écoulement du temps autant que celui de la rivière20
Rhodanie, Paysage déclassé Le protocole du photographe Bertrand Stofleth dans sa série sur les territoires du Rhône est extrêmement précis : il suit le fleuve, de sa source alpine à la Camargue avec une voiture équipée d’une nacelle élévatrice. Chaque cliché se fait alors à la même hauteur du sol et surplombe de quelques mètres le point de vue humain. La nature est mise en scène au cœur des images. Ce sont surtout les espaces des berges, de la rive dans tous ses états qui intéressent le photographe. Il se distingue de l’œuvre de Jérémie Léon et Ambroise Tézenas dans la représentation qu’il fait de l’humain. En effet, si les figures de la ville moderne et industrielle sont présentes dans ses images, en tant que décor, c’est la scène de l’activité de l’homme échappant à cette modernité qui occupe toujours le premier plan. Le photographe fait ouvertement référence à l’Arcadie,
17 BOURGEOIS-GIRONDE Sacha, « Être la rivière », Presses universitaires de France, 2020
18 Idem
19
« -Suivant le fleuve- : trois expositions et un parcours immersif à découvrir » [en ligne], muuuz.com, mis en ligne en avril 2022, consulté le 08.12.2022
20
« Le Temps Fleuve » [en ligne], jeremieleon.com, mis en ligne en 2012, consulté le 08.12.2022
un lieu mythologique des jours heureux : « Rhodanie est une Arcadie de fortune certes, mais il faut y entendre néanmoins ce pouvoir des hommes à fabriquer un lieu de plaisir, concevoir une forme de résistance à l’oppression de la vie moderne, employer donc une ruse avec la société pour s’en écarter un peu avant de s’y fondre à nouveau : un art de l’échappée belle. » 21. La mystification d’un territoire anthropisé, la représentation d’activités humaines qui se fondent dans une sorte de torpeur intemporelle cohabitent picturalement avec le fleuve, sa présence forte et son éternité22.
Au travers de la constitution d’un vaste corpus iconographique, ce mémoire s’intéresse à l’histoire infrastructurelle du canal de Nantes à Brest. Présenté ci-après sous la forme d’une monographie chronothématique, le travail identifie les grandes périodes et les tournants majeurs de l’histoire du canal. Raconter l’histoire de cette infrastructure au travers de ses représentations interroge la démarche et la vision des auteurs de ces représentations, qu’ils soient artistes, ingénieurs ou usagers. Quel rapport de l’Homme au territoire par l’infrastructure estil montré par ces représentations et que nous apprennent-elles de son appropriation et utilisation au fil de ces trois grandes périodes ?
Plus qu’une grande figure paysagère, ce sont les représentations qui en sont faites que nous allons ici être amenés à analyser. Crées afin de satisfaire des besoins variés et évolutifs dans le temps, elles nous permettent finalement de comprendre le rapport que l’Homme entretient avec un paysage fluvial, et ce, au travers de ses yeux. Ce mémoire présente tout d’abord un vaste corpus iconographique comportant de nombreuses huiles sur toiles, aquarelles, cartographies, cartes postales, documents d’ingénieries, mais aussi gravures et illustrations de revues. La compilation de ses documents et leur mise en relation ont pour but de communiquer un vaste panorama des paysages hydrauliques, logistiques et touristiques du canal de Nantes à Brest.
Ce corpus de documents iconographiques provient de sources variées que l’on pourrait classer dans 2 grandes catégories : le fruit de recherches d’archives et les résultats d’un démarchage par email auprès des mairies, offices de tourismes, abbaye et couvents ainsi que de particuliers, dans les communes traversées par le canal23.
Il est à noter que les documents personnels que j’ai pu créer, que ce soit des photographies, des cartographies ou des collages sont exclus du corpus, mais retrouvables en annexe. En effet, le cœur du travail de ce mémoire se concentre sur les productions faites par d’autres et leur analyse.
Ce vaste corpus iconographique est la ressource première de ce travail de mémoire. Une méthodologie précise est adoptée afin d’organiser cette ressource hétérogène. Tout d’abord, l’ensemble des références est dénombré dans un tableau (voir iconographie p. 219). Ce tableau classe le corpus selon le type de médium (cartographie, peinture, carte postale, photographie ancienne, documents d’ingénieries) et s’attache à renseigner les caractéristiques de chaque document (particularités, auteur, date de production connue ou estimée, lieu représenté, source). Ce travail de compilation et de classement permet alors de recontextualiser le corpus à la fois spatialement, mais aussi historiquement. Le Pli de Situation repositionne alors les documents sur une carte globale ainsi que sur une frise chronologique. Cet exercice montre les zones surreprésentées spatialement et les périodes majeures de l’histoire de la représentation du canal. Il met aussi en lumière les zones d’ombres, lieux ou temporalités moins représentés. Ces zones d’ombres sont un véritable enjeu de l’appréhension globale du canal.
Une fois composé, ce corpus hétéroclite fait l’objet d’un processus de sélection. Il existe dès lors, deux corpus : le corpus étendu, qui comprend tous les documents en ma possession traitant du canal de Nantes à Brest et de son histoire, et un corpus réduit. Ce dernier est plus restreint en quantité, et se limite à 150 unités. Enfin, ce corpus restreint est organisé selon un plan chronothématique qui divise le développement de ce mémoire en trois chapitres. Le premier chapitre, 1793-1842 : Un projet régional d’envergure nationale comprend des documents ayant un lien avec le contexte historique qui débouche sur la construction du canal de Nantes à Brest, mais aussi des documents de conception, de fonctionnement ou liés à la phase de chantier. Le deuxième chapitre, 1842-1930 : Une exploitation limitée expose des scènes de la période batelière, de son essor à son déclin, ainsi que des documents de l’interrelation à d’autres modes de transports. La question de l’altération de l’ouvrage y est aussi abordée. Pour finir, 1930-2022 : Un renouveau esthétique et touristique détaille dans un dernier chapitre les causes et effets du développement du tourisme actuel, de l’influence des grands maitres à l’implication des habitants et des touristes dans la fabrication d’imaginaires communs.
Il faut préciser que les documents exposés dans chaque chapitre n’ont pas forcément été produits dans l’intervalle chronologique en question. En effet, c’est le thème du chapitre qui prévaut et nécessite parfois de convoquer des ressources iconographiques antérieures ou postérieures. De plus l’utilisation ou non de médiums différents est fortement corrélée à certaines périodes historiques d’apparition et de disparition de ces modes de représentation. L’organisation suivante du mémoire tente donc de croiser ces différents médiums et de ne pas les limiter à la temporalité de leur année de production.
Malgré sa dénomination, le canal de Nantes à Brest est un ensemble technique plus complexe qu’il n’y parait. Loin d’être une ligne droite tracée entre Nantes et Brest, il n’emprunte en réalité pas moins de sept vallées fluviales : celles de l’Erdre, de l’Isac, de l’Oust, du Blavet, du Doré, de la Kergoat, de l’Hyères et de l’Aulne. Ainsi, le canal de Nantes à Brest serpente en suivant la dénivellation et les reliefs naturels de la Bretagne intérieure. Ces différentes rivières sont connectées naturellement par des points de confluences, ou bien raccordées artificiellement par des échelles d’écluses. Cet écosystème infrastructurel, véritable machine hydraulique, s’inscrit dans un contexte géopolitique et historique bien précis. Les documents présentés ci-après nous en apprennent un peu plus sur l’état des lieux de la province de Bretagne, mais aussi sur le processus de développement du projet de canal et sur ceux qui l’ont réalisé. Après avoir identifié les enjeux militaires, commerciaux et politiques nous allons nous intéresser à la question des travaux et travailleurs avant d’analyser les différentes parties de cette machine hydraulique d’exception et leur fonctionnement.

L’ingénieur Picart de Norey trace en 1784 la Carte générale des fleuves, des rivières et des ruisseaux de Bretagne pour servir à la navigation intérieure de cette province (fig. 1). Y est représentée dans le cadre du dessin l’entièreté de la Bretagne, une partie de la Normandie, de l’Anjou et du Poitou. Le sud de l’Angleterre ainsi que les iles Anglo-normandes sont aussi présents. La menace militaire anglaise est illustrée par un combat naval dans la Manche, deux navires au pavillon britannique faisant feu sur un bâtiment français.
Le titre de la carte est inscrit dans un cartouche circulaire richement ornementé. Sur la partie supérieure est représenté un blason comprenant les armoiries du royaume de France, des fleurs de lys, ainsi que celles de la province de Bretagne. Le blason est encadré par une hermine avec l’inscription « à ma vie » sur le collier, ainsi qu’une paysanne à la gerbe de blé. Ce sont les symboles
ALe tracé face aux enjeux militaires, commerciaux et politiques
Le projet des États particuliers de Bretagne
de l’ordre de l’hermine et de l’épi, un vieil ordre de chevalerie médiéval repris ici pour représenter la province de Bretagne. La carte de Picart de Norey est en fait profondément politique. Elle nous montre le partage de la gouvernance de la Bretagne entre les États particuliers de Bretagne et le royaume de France. Les États particuliers de Bretagne sont une assemblée réunissant le clergé, la noblesse en grand nombre et des députés du tiers état24. Réunis tous les deux ans dans une ville de la province sous ordre du Roi, ils s’occupent principalement des questions financières et donc de l’impôt. Selon l’article écrit par Olivier Chaline, c’est en 1784, lors de la tenue de la séance à Rennes que les États particuliers de Bretagne obtiennent de nouvelles compétences : celles de l’octroi des villes, et donc une imposition menée par la noblesse plutôt que par l’état, la libre désignation des députés à la cour, mais surtout la gestion et l’administration des réseaux viaires et fluviaux de la province.
Les États généraux de Bretagne sont dès lors en charge de la navigabilité du réseau fluvial. Ils lancent une commission de navigation intérieure menée par le comte François-Joseph De Kersauzon la même année avant de présenter le projet au roi en 1784. Ce projet se fonde sur le travail de Joseph Abeille25 en 1730 qui
24 CHALINE Olivier, « Les États de Bretagne : Une diète à l’ouest de la France ? » Dans FIGEAC Michel, « noblesse française et noblesse polonaise, Mémoire, identité culture XVIè-XXè siècles », Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2006
25 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des
profite intelligemment de l’aménagement progressif de certaines rivières bretonnes, dont la Vilaine, depuis le XVIe siècle. Les États généraux sont dissous lors de la Révolution française, avortant par la même occasion le projet de canal, qui peinait à démarrer faute de moyens. La Révolution française ne sera cependant qu’un épisode passager de l’histoire de la conception du canal. De nouveaux enjeux vont émerger, réactivant le projet du comte François-Joseph De Kersauzon.
La figure 2 est un plan de la Bretagne datant de 1856 et qui fait un état des lieux stratégique du département du Finistère. Les routes, villes majeures et ports sont indiqués. Sur les cotés du dessin, l’auteur Victor Levasseur indique les figures principales natives du département et les lieux exceptionnels. Il dresse aussi un bilan de la production agricole et du commerce. Dans le coin inférieur gauche on retrouve des statistiques liées à la démographie et aux divisions administratives. Le canal est repéré sur la carte, sans être totalement mis en valeur.


Vue de l’intérieur du port de Brest prise de l’ancienne cale de l’indépendance, Huile sur toile, Jean-François Hue, 1795 (fig. 3). On y voit la rivière Penfeld, ainsi que de nombreux édifices militaires qui constituent le fameux Arsenal de Brest. On ne peut observer cette toile sans remarquer le grand nombre de frégates militaires et autres galions, à flots, à quais ou en cale sèche. Ce que nous montre cette peinture de Jean-François Hue, c’est le contexte militaire extrêmement tendu de l’époque. Ces bâtiments de la marine française ne peuvent prendre la mer, car la rade de Brest est sous le coup d’un blocus maritime mis en place par la Navy britannique. Tout navire qui oserait passer le goulet de Brest se retrouverait alors immédiatement pris en chasse par les escadres légères et les escadres côtières, positionnées respectivement dans le canal de l’Iroise et au Raz de Sein26. Le port de Brest accueille au tournant du siècle le principal des forces maritimes françaises, mais le soutien de la nation tantôt aux indépendantistes américains27, tantôt aux patriotes irlan-
26 MONAQUE Rémi, « Le blocus de Brest par les Anglais au début du consulat : Latouche-Tréville anime la défense » p. 83-93 Dans BOIS Jean-Pierre, « Défense des côtes et cartographie historique. Actes du 124e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques », Milieu littoral et estuaires, 1999
27 Guerre d’Indépendance des États-Unis, 19 Avril 1775 - 3
Septembre 1783
Contexte militaire belliqueux des débuts de l’empire
dais28, débouche sur cette situation de verrouillage du littoral français, de la Manche au golfe de Gascogne.
Il devient urgent de trouver une solution afin de relier de nouveau les arsenaux de Brest et de Nantes. Pour sortir de cette situation, Napoléon Bonaparte, désormais empereur, va s’intéresser au vieux projet du comte De Kersauzon. Un pareil ouvrage deviendrait une véritable alternative à l’itinéraire côtier emprunté traditionnellement. Le port de Brest, approvisionné de nouveau, retrouverait la possibilité de sortir ses frégates du goulet et de mener des attaques sur les ports anglais et les iles Franco-britanniques, tout en aidant les alliés espagnols dans le golfe de Gascogne. L’empereur décrète finalement le début des travaux en 1811, même si certains ont déjà commencé depuis trois années29. Le projet est dans un premier temps confié au commandant de la marine de Brest, le général Bruix, en 179930, mais c’est l’ingénieur Guy Bouessel qui hérite de sa gestion dans un second temps, en 180331. C’est lui qui tracera l’itinéraire final, mais son mérite doit être nuancé, son travail se résumant essentiellement à la compilation de travaux précédents.
L’itinéraire Nantes à Brest
28 Première Rébellion Irlandaise, 23 Mai 1798 – 23 Septembre 1798
29 « 7 septembre 1811 : Pose de la première pierre du canal de Nantes à Brest » [en ligne], bcd.bzh, mis en ligne en novembre 2016, consulté le 16.11.2022
30 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
31 « De Nantes à Brest : l’histoire d’un canal de 364 km de long », Ouest-France, octobre 2014
sera construit dans une deuxième phase de chantier, l’itinéraire Nantes à Saint-Malo étant tout d’abord privilégié, via le canal d’Ile et Rance au départ de Pontivy.
Le chantier n’avance pas franchement dans un premier temps, la gestion financière d’un projet de cette envergure posant problème. Il a donc fallu créer une instance spécialisée dans l’administration du chantier, la « Compagnie des canaux de Bretagne »32, qui emprunte alors 36 millions de francs en 1822.
La situation de blocus de la côte Atlantique ne se résoudra finalement pas par l’avantage stratégique donné par le canal de Nantes à Brest, mais par la capitulation de Napoléon le 22 juin 1815. La France entre dans la période de la Restauration et les relations entre le royaume de France et l’Angleterre sont pacifiées. Le tableau d’Ambroise-Louis Garneray, « Vue du port de Brest prise du parc aux vivres » (fig. 4), est peint en 1821, soit six ans après la chute de l’empire. Cette image montre un arsenal désengorgé de navires de guerre, contrastant avec la toile de Jean-François Hue. Quelques bateaux de pêches ou navires marchands rentrent au port dans une fin d’après-midi. Le château arbore un drapeau blanc, symbole de paix retrouvée. Les travaux du canal de Nantes à Brest sont cependant poursuivis, mais pour des raisons autres que militaires.
32 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986


Si le projet de construction d’un nouvel itinéraire au cœur de la Bretagne devient nécessaire, c’est avant tout parce que la situation du réseau de transport ne permet pas d’acheminer correctement les armements et marchandises par voie terrestre. Les routes sont en très mauvais état et peu carrossables. Rapidement, le projet militaire de construction du canal s’est vu augmenté d’un projet de désenclavement de la Bretagne intérieure, un territoire jusque-là en marge des autres régions de France. Le manque d’infrastructures, notamment de transports ainsi que le tissu économique faible hérité du moyen-âge est décrit par l’ingénieur Le Corre dans son rapport de 1822 : « Ce lieu est la Sibérie de la Bretagne, les habitants possèdent des mœurs sauvages comme le pays, des chemins impraticables, les maisons du bourg sont obstrués par des fumiers infects […] l’agriculture pauvre, l’industrie nulle, la misère plus que générale. »33 Ainsi le projet du canal revêt un nouvel enjeu stratégique : celui de développer massivement le transport intérieur des marchandises. C’est finalement la sécurité de cet itinéraire qui évite raiders Anglais, tempêtes et récifs, qui sera l’un de ses atouts premiers.
33 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
L’exploitation de gisements naturels et le développement de l’industrie vont dans un premier temps profiter au canal. Les ardoises bretonnes sont exportées dans toute la France au XIXe, ainsi que le bois et le charbon. Au XXe siècle, on y transporte des matières premières pour la sidérurgie, mais surtout du sable en provenance des bancs de sable marin du Finistère en grande quantité. Ils servent alors à la reconstruction de la France d’après-guerre.
Dans son ouvrage « Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle »34, Guy Haudebourg analyse les différents recensements de la population et les retranscrit en cartes (fig. 6). On observe ainsi sur la carte dédiée à la rubrique mendiants, vagabonds, bohémiens une disparité sur le territoire Breton. Les zones de Carhaix-Plouguer, Pontivy ainsi que Josselin observent des taux particulièrement hauts pouvant aller jusqu’à 20%, ainsi que tout le centre-Bretagne d’une manière plus générale avec une moyenne de 5 à 7%35. L’auteur justifie les taux plus faibles aux extrémités du canal par l’entame des travaux : « On peut quand même relever des progrès en Basse-Bretagne grâce au canal de Nantes à Brest achevé dans les années 1830. » 36
34 HAUDEBOURG Guy, « Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle », Presses universitaires de Rennes, Chapitre 2 p. 61102, 1998 35
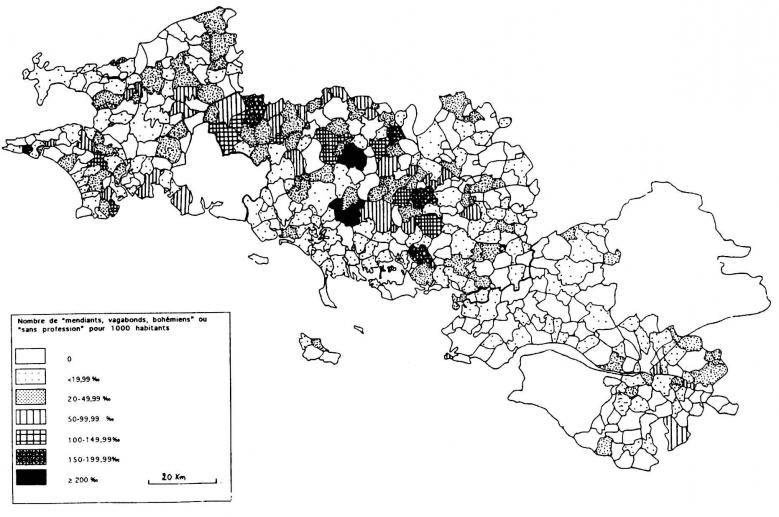




C’est en 1829 que l’ingénieur Jean-Marie De Silguy dessine la Carte Générale du Canal de Nantes à Brest (fig. 7). Elle représente le relief de la Bretagne, ses grand-routes et communes principales, mais surtout le réseau hydrographique empruntable au travers de rivières canalisées, tranchées et échelles d’écluses. On remarque tout d’abord une orientation particulière : le nord pointe l’angle supérieur gauche du dessin. L’itinéraire est ainsi reporté à l’horizontale, du bord droit de la carte au bord gauche. Ce non-respect des conventions de représentations n’est pas ici une franche révolution, mais s’inscrit plutôt dans la grande tradition de la carte-bande, utilisée dès le XVIIe siècle par les militaires37. Ils représentaient ainsi le chemin à parcourir et les obstacles à traverser avant d’atteindre l’objectif final, toujours en haut du dessin. La carte bande est donc une représentation très subjective et orientée du territoire, et dans le cas de la Carte Générale du Canal de Nantes à Brest, une représentation faite pour le pouvoir. C’est un effet la commande par le roi d’un document de synthèse, communicatif des grands travaux de canalisation et de désenclavement de la Bretagne, à 3 ans de la livraison du chantier. Les principales sections sont alors déjà ouvertes à la navigation, principalement aux deux extrémités de l’ouvrage.
37 VERDIER Nicolas, « Les formes du voyage : cartes et espaces des guides de voyage », In Situ, juin 2011
Comparer la carte de Jean-Marie De Silguy et celle de Picart de Norey, distante de 45 ans, permet de comprendre les évolutions qu’a subi le projet du canal, et donc les tracés envisagés tout d’abord et finalement rejetés. Une rigole d’approvisionnement en eau est un moment envisagée depuis les marais de Montoire 38jusqu’à l’Isac. Une seconde modification concerne le franchissement du bief de partage d’Hilvern, prévu tout d’abord bien plus au sud, entre Pleugriffet et St-Thuriau. Le tracé actuel est finalement choisi, au nord de Rohan et Pontivy. Dans son guide, Jacques Clouteau critique cette décision, le choix initial du bief plus au sud aurait permis d’éviter de longs et difficiles travaux39. On remarque aussi une approximation de Jean-Marie de Silguy, qui a été mal gommée. Il semblerait que le tracé de la tranchée de Glomel ait elle aussi évoluée : le projet original comprend une tranchée bien plus au Nord, reliant le Doré à l’Hyères en amont de Carhaix-Plouguer. La tranchée finalement réalisée est beaucoup plus longue, mais l’itinéraire réalisé est raccourci. Sur les deux cartes de De Silguy et de De Norey la connexion entre Oust et Vilaine au niveau de Redon est fausse. Une section canalisée finalement réalisée (comprenant notamment la 18bis, unique numéro bis de l’ouvrage) traverse le centre-ville même de Redon. 38 Marais
39 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
Il n’y en fait pas un seul mais des dizaines de projets de canaux reliant Brest et Nantes. Ces différentes versions s’alimentent mutuellement, chaque auteur s’inspirant des bons tracés trouvés par ses ascendants. La confrontation au site, enfin, est la dernière source de modification. Les cartographies du XVIIIe et XIXe siècle n’ont pas la précision actuelle, et les erreurs graphiques se traduisent parfois par des écarts de plusieurs dizaines de kilomètres dans la réalité : « Toutes les cartes géographiques et même topographiques de Bretagne, ou de quelque partie de cette province que ce soit, qui ont paru jusqu’à présent, placent très mal les situations et les distances respectives de quelques bourgs, châteaux, montagnes, passages et autres lieux remarquables, et même des sources et autres rivières et ruisseaux que doivent traverser les trois canaux projetés »40.
40 F.J DE KERSAUZON, op.cit. p21 In : BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986


Le plan tracé par M. Marsille (fig. 8) est un plan général de la ville de Pontivy sur relevé effectué en 1853. Le projet ne s’intéresse pas au centre ancien et se développe en périphérie, doublant ainsi la superficie du centre-ville et le dotant de nouveaux monuments. La légende nous indique, par l’usage de la couleur, une distinction entre l’état de la ville en 1760 et le projet d’aménagement impérial : « La teinte et le tracé noir indiquent l’état des lieux en 1760, la teinte et le tracé rose indiquent les monuments et le tracé de la nouvelle ville appelée du nom de son fondateur, Napoléonville. Levé adressé par Mr Marsille architecte de la ville et de l’arrondissement, le 6 février 1853 ».
En effet, le consul Bonaparte prend la décision en 1801 de développer massivement la ville de Pontivy, renommée Napoléonville, en la prolongeant par une ville neuve41. Pontivy n’est alors encore qu’un petit bourg, mais sa situation géographique est avantageuse. Elle est située au cœur de la Bretagne, sur un carrefour routier et fluvial important. Bonaparte la destine à devenir la nouvelle capitale, à la fois économique, mais aussi militaire, de la Bretagne. Ce que démontre ce document, c’est que les travaux de creusement du canal de Nantes à Brest, par la canalisation du Blavet, font partie intégrante des
41 HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011
Le projet impérial, de Pontivy à Napoléonville
travaux impériaux d’aménagement et de modernisation de la ville. A Pontivy le canal est un monument42.
En inspectant le plan, on peut remarquer une décomposition du projet en trois entités majeures qui étendent la ville dans trois directions. Au sud43 se trouve le principal aménagement, le viaire et le parcellaire agricole anciens sont effacés pour laisser place à un réseau de rues hippodamien44. Elles portent les noms des grandes victoires de l’empereur : Iéna, Ulm, Austerlitz… Le cœur de ce quartier nouveau est composé de la place d’armes Napoléon le Grand, entouré par l’Hôtel de Ville, le tribunal et la prison. Cette partie du projet comprend un très large boulevard périphérique, le boulevard du Blavet. Ce quartier se termine par un vaste parc rationalisé ouvert sur la rivière. À l’ouest se trouve le quartier Clisson, un ensemble de bâtiments militaires où furent cantonnés le 7e régiment de hussards puis le 2e de chasseurs à cheval45. Construit dans l’alignement de la place royale, il est relié à cette dernière par un pont neuf (fig. 9) qui traverse le Blavet. Au nord le projet urbain se concentre sur la définition d’un champ de foire et de deux routes impériales, mais surtout sur le creusement d’un ca-
42 Terme emprunté à Pierre Pinon dans son article : PINON Pierre, « Des monuments du paysage », p. 241
43 Remarquons que la carte ne respecte pas la norme cartographie d’orientation au Nord.
44 Un plan hippodamien est une forme d’urbanisme basé sur la figure de l’ilot et des rues à angles droits.
45 HUET Yann-Armel, « A Pontivy, ils ont été les derniers soldats à cheval », Ouest-France, septembre 2014
nal permettant de connecter le Blavet à l’Oust en franchissant le bief de partage d’Hilvern.
Le plan de Marsille traduit une certaine culture urbaine46 de l’empire. L’urbanisme est réduit à la mise en valeur du monument, par la création de vastes places et de grandes allées tracées selon des normes de symétries et de proportions. Dans son article, Dominique Hervier expose l’opposition entre les visions universelles des ingénieurs civils et celles plus localistes des architectes : « Ce sont deux forces contraires qui s’exercent alors sur le devenir de Pontivy : d’une part, la prise en compte plus réaliste de la topographie du site, en bord de rivière, d’autre part la composition académique, monumentale et régulière, qui soumet la forme urbaine à l’ordonnance du monument public »47. Mais la maitrise des tracés et la rationalisation du territoire s’appliquent aussi aux infrastructures. C’est dans ce contexte que s’inscrit la canalisation du Blavet, en amont jusqu’à Gouarec et en aval jusqu’à Hennebont. Ces deux ouvrages permettent respectivement de construire la section centrale du canal de Nantes à Brest et de créer un itinéraire fluvial jusqu’à Lorient et l’Océan.
46 Terme emprunté à Dominique Hervier dans son article : HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011
47 HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011
Le projet d’aménagement de Pontivy est avant tout le témoin de la volonté des habitants de la ville de faire allégeance à l’Empereur dans une Bretagne hostile, car tenue par les insurgés républicains. Ainsi, le projet et les travaux de construction du canal de Nantes à Brest relèvent parfois d’une volonté politique locale, notamment à Pontivy, qui supplée l’ambition des administrateurs nationaux.


Les travaux de création du canal de Nantes à Brest ne sont pas égaux et homogènes. Certaines sections sont plus faciles à creuser et canaliser que d’autres, les causes étant diverses, mais souvent liées à la géologie du sol ainsi que son humidité et sa dénivellation. Trois points particuliers sont à évoquer : les biefs de partages de Bout-de-bois, Hilvern et Glomel. Ce sont de grandes tranchées longues de plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres, qui viennent creuser le granit et araser des collines. L’usage d’explosif a massivement été utilisé lors des travaux de ces tranchées. Ce sont les points culminants du canal puisqu’ils relient entre elles les différentes sections, plus basses en altitudes. Ces travaux prendront jusqu’à 28 ans à réaliser48, ils constituent le cœur du chantier du canal de Nantes à Brest.
La première étape des travaux de canaux de jonction est l’acquisition des parcellaires concernés.
48 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, p. 143, 2006
Ils appartiennent originellement à des paysans et à des meuniers, qui ne sont pas toujours enclins à s’en séparer. Cette question est alors un premier point de blocage. La figure 10 est un plan cadastral des travaux du bief de partage d’Hilvern. Plus de 70 parcelles diverses doivent être rachetées sur ce site d’Hilvern, qui n’est que le second plus grand du canal.
Pour construire ces sections de canal plus complexes, il faudra une main d’œuvre humaine en nombre. La gestion de ces travailleurs est plus ardue qu’il n’y parait, notamment à cause de la géographie et de la démographie du site. Nous avons ainsi pu voir précédemment que la Bretagne intérieure était un territoire marginalisé avec des habitants plus pauvres qu’ailleurs en France, et une agriculture compliquée. Malgré la fragilité de cette population, elle est tout de même mise à contribution49. Les paysans passent ainsi la belle saison dans les champs, et le reste de l’année à réaliser des travaux de terrassement et creusement pour gagner une rente qui reste très modeste50. Mais ces travailleurs viennent à manquer dans les départements plus reculés du Morbihan et des Côtes du Nord, la ou les travaux sont plus laborieux avec le creusement de tranchées d’envergure. Les administrateurs doivent alors importer une main d’œuvre d’autres territoires français. Ainsi, il est un temps envisagé de faire venir des travailleurs d’Auvergne et de Bourgogne comme ça a été le cas ail-
49 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
50 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, 2006
leurs et notamment sur le chantier du canal du Charolais ou ils seront 450 en provenance du Velay51. Le bilan sera mitigé, en effet les travailleurs ainsi importés seront pris dans des rixes avec les habitants. Pour ces raisons, cette solution ne sera finalement pas employée sur le canal de Nantes à Brest. En revanche, de nombreux forçats vont être utilisés. Leur provenance est multiple, tantôt insoumis et déserteurs de l’armée impériale, tantôt prisonniers de la guerre d’Espagne, tantôt bonapartiste, tantôt condamnés au boulet à la peine commuée par le Roi52. L’illustration produite par Rouger, « La sortie du bagne le matin » (fig. 11) illustre les bagnards enfermés en grand nombre à Brest. Ils seront déplacés par convois entiers pour contribuer à tous les chantiers de la Bretagne. La seconde illustration réalisée cette fois par Françoise Le Fur (fig. 12) représente l’un de ces convois, à destination de la section du canal de Nantes à Brest de Glomel53. Cette illustration est tirée de l’ouvrage de Jean Kergrist, « Les bagnards de Glomel »54, un roman revenant sur cet épisode du chantier du canal. Par la narration, cet ouvrage forge un imaginaire collectif sur le labeur des forçats. Il par-
51 LEMOINE Bertrand, « L’évolution de la technique de construction des canaux », p. 176 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
52 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre 2006
53 Une tranchée de 3km de long qui prendra près de 9 ans à construire, principalement par des bagnards
54 KERGRIST Jean, « La vie au camp de Glomel », Éditions des Montagnes-Noires, 2011
ticipe ainsi à la mise en récit du territoire du canal.
Ce même dessin de Françoise Le Fur nous montre les tenues des bagnards, de simples guenilles, mais aussi trois officiers de l’armée royale chargés de leur surveillance. L’article de Pierre Pinon55 sur les chantiers des canaux nous en apprend un peu plus sur la structuration de ces convois. Les prisonniers sont répartis en bataillons de 400 hommes sous la surveillance de 2 officiers et 12 sous-officiers ainsi que d’un bataillon de gendarmerie56. Il cite l’ingénieur Ch. Forey qui décrit les conditions de vie des bagnards : « Les prisonniers commenceront leur journée au soleil levant après avoir pris leur repas », « tout prisonnier qui volera le pain ou autre vivre à un de ses camarades, le remboursera et recevra par un caporal espagnol57 vingt-cinq coups de bâton sur les fesses »58.
À la suite de l’envoi des nombreux convois de bagnards, la ville de Brest va perdre une main d’œuvre facile puis s’enfoncer dans un marasme économique qui aura débuté par le blocus britannique de la ville et les difficultés d’approvisionnements.
55 PINON Pierre, « Notes sur quelques ouvrages et chantiers
», p. 186 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
56 Idem
57 Fait référence ici à une sorte de police militaire
58 PINON Pierre, « Notes sur quelques ouvrages et chantiers
», p. 186 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986



En dehors des heures de travail, les forçats sont gardés dans un camp sécurisé dont l’implantation fait débat. En effet, les différentes communes refusent d’accueillir ces condamnés près de leur bourg, rejetant alors le camp dans les landes alentour. La figure 13 est un plan général et élévations du camp de Glomel, associé à une section des baraquements ainsi qu’un détail constructif d’assemblage de pièces de bois. Le camp de forme rectangulaire est organisé autour d’une vaste cour centrale. Les gendarmes et les prisonniers sont hébergés dans des ailes différenciées au confort variable. Ainsi, on observe un dortoir dans l’aile est aménagé par de nombreux lits, là où les ailes nord et sud sont dédiées aux prisonniers et disposent donc d’un confort amoindri. Les espaces sont remplis de poteaux qui, outre de porter le toit, permettent de suspendre des hamacs en bon nombre. Jusqu’à 150 détenus59 sont abrités dans chacun de ces dortoirs. La cuisine est disposée au milieu de la cour, évitant ainsi la diffusion des odeurs dans les différents dortoirs. Cette implantation limite aussi le risque d’incendie. Elle se compose de deux fourneaux principaux. L’aile ouest, ainsi que les angles du camp sont occupées par des bureaux, des 59 « Bief de partage, dit -la Grand Tranchée- ou – Tranchée de Glomel - » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022
magasins, une infirmerie, une pharmacie et un cachot.
L’analyse de la coupe révèle une structure légère de bois, facile à monter par des condamnés qui ne sont pas toujours formés à la construction. Cette facilité de montage passe notamment par des assemblages simplifiés. La charpente est surmontée de chevrons soutenant un lattage et un toit de matière végétale, probablement de chaume. Les murs sont épais et les ouvertures extrêmement réduites afin de prévenir les tentatives courantes d’évasion. Cette restriction de la place de la fenêtre est visible sur l’élévation de Le Corre. On observe enfin des rigoles creusées de part et d’autre des baraquements afin d’évacuer les eaux usées et d’améliorer un tant soit peu l’hygiène du camp, mais les conditions sanitaires demeurent sommaires.
Entre 40060 et 70061 hommes seront employés en permanence à Glomel, pour un total de 400062 forçats différents. Beaucoup y laisseront la vie. En effet, les conditions difficiles de travail, la fatigue extrême et la maigre alimentation s’ajoutent aux épidémies de typhus et de choléra, et font des ravages chez les prisonniers comme les gendarmes63. Le nombre exact
60 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre 2006
61 « Grande tranchée des bagnards », [en ligne], cirkwi.com, mise en ligne 2020, consulté le 24.11.2022
62 « La tranchée des bagnards – Canal de Nantes à Brest », [en ligne], cotesdarmor.com, mise en ligne inconnue, consultée le 24.11.2022
63 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre
de victimes est inconnu, car ces statistiques ont été recensées et conservées par l’armée, qui n’est pas l’organisation la plus transparente sur ses données.
Les bagnards vont déclencher plusieurs incendies lors des 9 années d’exploitation du camp et tenter de s’échapper à de nombreuses reprises. La chute de la monarchie advient en juillet 1830 et les troupes républicaines se répandent dans toute la France. Leur arrivée à Glomel sonne la fin de l’exploitation du camp, ce dernier est démantelé et les bagnards se dispersent dans la région. Le 16 juin 183464 le recourt au bagne est abolit en France, parachevant ainsi la chute du camp de forçats de Glomel. Le reste des travaux sera dès lors réalisés par des entreprises locales, choisies sur appels d’offres. 2006 64
« 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre


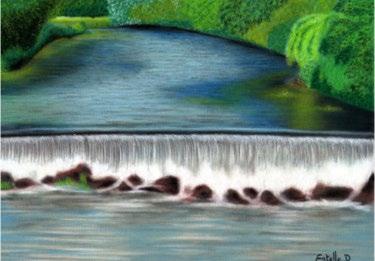
L’écluse et le déversoir sont les unités de base qui fondent le canal de Nantes à Brest. Pour assurer une navigation optimale, il faut limiter les effets de courants et de remous, donc de déplacement de la masse d’eau, afin de créer un plan d’eau le plus horizontal et calme possible. Pour ce faire, les ingénieurs mettent en œuvre des déversoirs de manière régulière afin de diviser les 364 kilomètres de canal en 239 tronçons au niveau d’eau pilotable. Dans son tableau « Écluse sur le canal de Nantes à Brest » (fig. 15), le peintre Ivonick représente l’un de ces déversoirs, la localisation précise est inconnue. Plusieurs éléments de cet équipement hydraulique sont représentés : au premier plan se trouve le mur déversoir, qui retient l’eau jusqu’à un certain niveau, puis l’évacue vers le tronçon inférieur du canal. Il assure aussi un rôle de défense en cas de crues en permettant d’évacuer rapidement le trop-plein d’eau65. Un
65
« Canal du Blavet, les déversoirs », [en ligne], patrimoine. bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022
enrochement est souvent présent au pied du mur déversoir, renforçant la solidité de l’ouvrage et atténuant la force cinétique de l’eau. Ces murs peuvent être fondés sur radiers ou sur semelle, mais ces fondations sont surdimensionnées afin de résister à la force de l’eau. À l’extrémité du déversoir se trouve une vantelle, c’est une ouverture dans l’ouvrage. Un système de vannerie permet alors de laisser plus ou moins passer d’eau. Ce système est manipulable au moyen d’une manivelle.
La figure 16 est dessinée au pastel en 2013 et représente le déversoir de bon repos. On retrouve ici le mur déversoir et les enrochements, ainsi que les tronçons amont et aval du canal. L’artiste s’attarde dans cette peinture de paysage sur les effets de l’eau : la végétation dense se reflète dans l’eau calme en amont alors qu’en aval l’eau déversante crée remous et écume.
Lorsque l’ouverture permet le franchissement d’une embarcation, on ne parle plus de vantelle, mais de pertuis. En dotant le pertuis d’une seconde porte, on crée un sas d’écluse. Cette invention majeure apparait au XVIIe siècle66 et révolutionne le transport fluvial en permettant de connecter les différentes vallées fluviales entre elles.
La manœuvre de transfert d’un bateau de l’amont vers l’aval du canal est simple, mais nécessite
66 PICON Antoine, « Les canaux et le travail de l’ingénieur à l’âge classique », p. 272 Dans Caisse Nationale des Monuments
Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
du temps. Tout d’abord l’éclusier doit fermer la porte inférieure et ouvrir la trappe de la porte en amont. L’eau va progressivement remplir le sas d’écluse. Une fois le niveau d’eau du sas ramené au niveau du bief supérieur, l’éclusier peut fermer les trappes et ouvrir les portes (appelées vantaux). Le bateau peut pénétrer dans l’écluse. Une fois les portes supérieures refermées l’éclusier peut entamer le vidage de l’écluse en ouvrant les trappes des vantaux inférieurs, cette fois. Cette opération ne se fait pas sans remous, le batelier doit donc s’assurer que son bateau est bien amarré aux bittes d’amarrage. Enfin, l’éclusier peut ouvrir les vantaux inférieurs et laisser le batelier avancer dans le tronçon suivant, jusqu’au prochain site d’écluse67. Lors de cette opération, près de 300m3 d’eau seront descendus dans le bief68. Toute l’intelligence du système réside dans la manipulation par gravité de l’eau, évitant ainsi tout système de pompage ou nécessitant un moteur et une énergie quelconque. Bernard Forest de Bélidor est un ingénieur français du XVIIIe siècle spécialisé dans les systèmes de canaux. Son ouvrage, « Architecture hydraulique » revient sur l’histoire de l’ingénierie de l’eau, de l’aménagement le plus primitif à la machinerie à vapeur. Il décrit l’art de concevoir des écluses comme « la plus essentielle partie de l’architecture hydraulique »69. Il rejette la définition de l’ingénierie hydrau-
67 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, p. 49, 2015
68 Idem p.50
69 BÉLIDOR, « Architecture hydraulique », t.1, In : PICON Antoine, « Les canaux et le travail de l’ingénieur à l’âge classique », p.
272 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites
lique comme une simple technique et préconise l’emploi de concepts architecturaux contemporains, tels que l’usage de modules et de proportions élégantes.
La figure 17 est la page 2 du « Cours de la Vilaine de Redon à Rennes en vue cavalière ». C’est un document ancien, datant de 1543, et qui témoigne de l’utilisation du fleuve comme voie de transport et de communication depuis le moyen-âge. L’écluse représentée est rudimentaire, mais avant-gardiste pour le XVIe siècle, il s’agit en effet d’une des premières écluses à sas. Si l’on compare cet ascendant de l’écluse moderne à celles présentes sur le canal de Nantes à Brest, on distingue une différence majeure au niveau des portes. Elles ne s’ouvrent pas en opposition au sens de l’eau, mais se soulèvent verticalement. Cette technique ne permet pas à des bateaux de taille conséquente de passer les portes, elle est donc plutôt utilisée par des barques fluviales à fond plat, de taille réduite. Trois de ces embarcations sont représentées dans le dessin, chargées de tonneaux et de marchandises diverses. La légende du dessin est inscrite sur un manuscrit dans le bord inférieur droit de l’illustration : « Le portrait démontre en perspective la manière des écluses doubles. » Il est donc ici question d’exposer un progrès technique important pour la province de Bretagne.
/ Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986



Pour passer d’une vallée fluviale à une autre, les relier, l’itinéraire doit traverser des reliefs parfois importants. Un système de tunnel aurait été trop couteux alors les ingénieurs ont décidé de faire passer les embarcations au-dessus des collines. Si l’on compare le canal à une rivière, ce qui est une de ses perceptions les plus courantes, cela revient à dire que le flux d’eau monte soudainement vers le sommet d’une colline, avant de redescendre de l’autre côté. L’effet est donc assez spectaculaire. Pour ce faire, les ingénieurs ont utilisé un système appelé échelle d’écluses, visible sur le plan d’État-major de 1866 (fig. 18). L’échelle d’écluse consiste en une succession d’écluses sur une très petite section, permettant ainsi au canal de s’élever très rapidement de plusieurs dizaines de mètres. Cependant, la manœuvre est extrêmement longue pour les péniches et leurs bateliers qui nécessitent de longues heures voire une journée pour franchir chaque échelle d’écluse. Au sommet, le bateau emprunte une tranchée positionnée sur le bief de partage des eaux, d’un versant à un autre, avant d’emprunter une nouvelle échelle d’écluse, mais dans le sens descendant cette fois, jusqu’à arriver à la vallée fluviale suivante. On dénombre trois biefs de partages, mais seulement quatre échelles d’écluses sur le canal.
Échelles d’écluses et bief de partage des eaux
La figure 20 est une coupe assez remarquable du canal de Nantes à Brest, car elle en représente l’intégralité. L’usage de deux échelles de représentations différentes dans la verticalité et l’horizontalité permet d’exagérer le relief. Cette coupe se lit de Brest vers Nantes, cette première étant placée à gauche du dessin. Suivant ce sens de lecture, on rencontre successivement les biefs de Glomel et Hilvern, assez visible, puis le bief de Bout-de-bois, qui est un relief bien plus modéré. Ce document est plutôt complet, car outre la dénivellation du canal, il représente aussi le positionnement des différentes écluses, et distingue les cours d’eau empruntés par le canal. Enfin, il divise l’itinéraire en 5 parties correspondants aux départements traversés. Ce document est produit par la DDE70 du Morbihan qui ne le conserve pas précieusement dans ses archives, mais l’a placardé simplement au mur et semble donc l’utiliser couramment. La nécessité de diviser l’itinéraire en sections se référents aux frontières administratives et non à des limites géographiques physiques prend tout son sens dans ce cadre. L’État a renoncé à la gestion de ce canal et en a laissé la responsabilité aux administrations territoriales, qui produisent des documents en conséquence.





Abordé précédemment sur le point de vue sociologique au travers du travail des forçats, il s’agit ici de s’intéresser à la fonction des biefs de partage et rigoles71 d’approvisionnement en eau dans le système canal.
Ces biefs de partages sont donc les points culminants du canal. Se pose alors la question de l’acheminement de l’eau. En effet, l’eau s’écoule des deux côtés du bief au travers des remplissages et vidages successifs des écluses dans les systèmes d’échelles. Pour éviter que la tranchée ne se retrouve à sec, les ingénieurs ont dû penser un système de rigole qui approvisionnent en eau le point culminant du bief. Trois biefs de partage sont franchis par le canal : Bout-de-bois, Hilvern et Glomel. Les figures 21, 22 et 23 illustrent les stratégies d’approvisionnement en eau appliquées à chacun de ces biefs.
Bout-de-bois est situé au début du canal, en Loire-Atlantique. Il est alimenté par le petit canal, un ouvrage long de 21 km et qui transporte l’eau depuis le lac de Vioreau et l’étang de la Provostière72. À Nochère,
71 Contrairement au sens commun du terme, une rigole d’approvisionnement en eau peut ici avoir des dimensions importantes, jusqu’à 100m de large pour Hilvern.
72 « Le canal de Nantes à Brest – Le petit canal », [en ligne], valderdre.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 30.11.2022
près de Nort-sur-Erdre, un petit aqueduc est édifié (fig1). La rigole franchit grâce à cet ouvrage un vallon et continue sa route vers le canal de Nantes à Brest. Il existe trois autres aqueducs sur le parcours du petit canal, celui du gué de la Roche, du Mesnil et du Quiquengrogne, qui permettent au tracé d’éviter de longs méandres73.
Le second bief, à Hilvern, est alimenté par une rigole homonyme, c’est la ramification la plus impressionnante du canal par sa longueur, 65km74. L’eau est ici tirée du plan d’eau de Bosméléac. Ce plan d’eau est provoqué par la construction d’un barrage illustré par la figure 22. En 1980 des travaux de restaurations de la rigole sont menés suite à son envasement. Lors de ces travaux, la couche d’argile de 40cm qui isole la canalisation est abimée. Dès lors la rigole fuit et nécessite l’usage de pompes électriques d’appoints. Certaines parties descendent à 90cm de hauteur d’eau75.
Le dernier bief de partage, Glomel, est le véritable point culminant du canal, à 184m d’altitude. L’eau est puisée dans de vastes étangs tels que celui du Coronc qui recouvre 75 hectares76. La figure 23 exprime l’étendue de ce réservoir. L’obstruction de l’étang par
73 « Le canal de Nantes à Brest – Le petit canal », [en ligne], valderdre.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 30.11.2022
74 « Rigole d’Hilvern », [en ligne], cotesdarmor.com, mise en ligne inconnue, consulté le 24.11.2022
75 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, 2006
76 « Glomel, la tranchée des bagnards », [en ligne], canauxdebretagne.org, mis en ligne en 2019, consulté le 30.11.2022
un barrage permet d’agrandir la réserve d’eau et de l’acheminer jusqu’au canal adjacent. La rigole d’approvisionnement n’est donc pas aussi spectaculaire que celles des deux autres biefs de partage en raison de la proximité immédiate de la ressource en eau.
Les figures 22 et 23 sont des photographies de Jules Duclos. Né en 1824 à Quimper, ce photographe à la renommée régionale se spécialise dans la photographie de paysages et d’objets des grands chantiers industriels du XIXe siècle. Sa production documente l’arrivée du chemin de fer en Bretagne ainsi que la construction de phares modernes77. En 1890 une série de 12 photographiques de Jules Duclos sont publiées78. Commandées par le service des ponts et chaussées ces dernières illustrent les infrastructures du canal de Nantes à Brest et son réseau secondaire de rigoles d’approvisionnement en eau. Cette publication semble avoir été faite à titre posthume, car le photographe décède en 1879.
77 « Jules DUCLOS », [en ligne], portaitsepia.fr, mis en ligne en 2022, consulté le 30.11.2022
78 « Notice du recueil - Canal de Nantes à Brest- image fixe numérisée », [en ligne], catalogue.bnf.fr, mis en ligne en octobre 2007, consulté le 30.11.2022

L’histoire du canal de Nantes à Brest est une histoire infrastructurelle, mais aussi une histoire humaine de la vie quotidienne des hommes et femmes qui ont habité et travaillé sur le canal durant presque 5 générations79. Si la date de début des travaux est à peu près admise, le 7 juin 181180, définir le jour du début de l’exploitation est plus complexe. En effet, les différentes sections sont rendues navigables les unes après les autres, en commençant par les extrémités du canal. La rivière Aulne est ainsi ouverte en 1829 alors que l’Isac et l’Erdre doivent attendre 183181. C’est finalement 5 ans plus tard82 que la totalité de l’itinéraire est livrée. Le développement de la batellerie bretonne se fait donc progressivement, les tonnages transportés chaque année passent de 10.000 tonnes en 1859 à un maximum de 174.000 tonnes en 191183. Mais cette logistique n’aurait pu exister sans les éclusiers, ingénieurs hydrauliques, agents de capitaineries, véritables chefs d’orchestre du fonctionnement du canal et de son exploitation. Cette partie tend à décrire une histoire quotidienne des gens du canal. Nous nous consacrerons tout d’abord à l’essor de la nouvelle batellerie bretonne, puis aux points névralgiques que constituent les interfaces ferroviaires et maritimes avant de s’intéresser aux excroissances bâties et évolutivités. Enfin, le déclin et l'abandon du canal seront évoquées.
79 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017
80 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
81 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
82 Idem
83 « Les veilleurs du canal : bénévoles et participatifs », Le Télégramme, octobre


La batellerie bretonne est le fruit de l’exploitation du canal par des Hommes et leurs embarcations. Ils sont tout d’abord pionniers. En effet, la batellerie n’existe pas en Bretagne au XIXe siècle, ce sont les mariniers de Loire qui vont les premiers explorer le canal et l’utiliser à des fins commerciales. Leur déracinement fait suite à l’arrivée du chemin de fer parallèle à la Loire qui rend leur activité vaine84. Les villes dont ils proviennent, Montjeansur-Loire, Chalonnes et Ancenis, ont développés toute une économie autour de l’exploitation et du commerce de la chaux. C’est donc la première marchandise transportée par les chalands jusqu’au cœur de la Bretagne. La chaux y est alors employée comme engrais pour fertiliser les sols réputés acides. Afin de ne pas faire le voyage retour à vide, les premiers bateliers achètent du bois, du charbon et des céréales à Pontivy et Malestroit et les acheminent jusqu’à Nantes. En 1837, une cargaison typique chargée par un marinier à Pontivy se compose de :
- 495 tonnes de noir animal85
- 31 tonnes de froment
- 60 tonnes de fer et de fonte
- 11 tonnes de briques et de carreaux
- 80 tonnes d’ardoise
- 64 tonnes de charbon
- 10 tonnes d’épicerie
- 20 tonnes de sable de mer
- 14 tonnes d’avoine
- 280 tonnes de bois de marine
- 6 tonnes de briques réfractaires
- 40 tonnes de chaux
- 3 tonnes de liquide divers86
Le canal n’est donc pas tout d’abord employé dans son entièreté et tel qu’il a été conçu, de Nantes à Brest, mais uniquement sur le secteur Nantes – Pontivy. La figure 24 est une photographie de la famille Bureau qui interrompt le chargement du chaland de bois pour poser. Issu des archives personnelles de la famille Bureau, ce document témoigne aussi de la volonté de certaines familles de documenter leur vie de tous les jours en investissant dans un appareil photo. Dans son reportage, Emmanuel Rousseau fait appel à des témoignages d’anciens mariniers. Ces derniers expliquent la structuration de la batellerie bretonne autour de familles. Tout
85 Un engrais à base d’os calciné
86 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
le monde à bord devient marinier par procuration et participe à la navigation et à l’entretien du chaland87. De plus, la vitesse des embarcations de ces premiers pionniers est très réduite, car ils n’ont pas les moyens d’acheter des chevaux de trait. Le remorquage se fait alors « à la bricole »88, c’est-à-dire tiré par un homme ou une femme qui porte un harnais spécial. Interdit progressivement à la fin du XIXe siècle, le halage par cheval de trait s’impose enfin et chaque équipage investit dans un animal. L’huile sur toile peinte par Maurice Grun (fig. 26) illustre l’un de ces équipages qui utilisent la force de l’animal pour tracter l’embarcation. Les vitesses atteintes ne sont pas plus rapides que lors du halage à la bricole, mais le batelier peut désormais économiser ses forces. Les chalands s’agrandissent et contiennent parfois une écurie, un petit poulailler et quelques bacs à légumes. En effet, les bateliers travaillent, vivent et dorment sur leur embarcation et développent des stratégies pour assurer une production agricole et de pêche d’appoint.
À partir de 193089 les chalands sont progressivement motorisés. La vitesse de déplacement est sérieusement accélérée et demande plus d’attention dans le pilotage. Les activités secondaires ne perdurent pas et l’activité se concurrentialise.
87 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017
88 Idem



Les appellations des embarcations sont précises et variées : le nom le plus fréquent est cependant le chaland, qui renvoie à un bateau à fond plat destiné au transport de marchandises diverses. La péniche, quant à elle, est une embarcation habitable. Le cahotier est utilisé pour le transport de pierre, et adopte une typologie adaptée, alors que les gabereaux sont plus petits et ont une proue pointue90. On les utilise pour le transport du sable de Loire. Certaines dénominations sont issues de contexte géographique défini : Le kobar est la traduction bretonne du mot angevin gabare, tandis qu’une pénette est un assemblage de deux embarcations qui passent les écluses l’une après l’autre. Il s’agitlà d’une invention de mariniers de Redon. L’arrivée de moteurs à hélice va venir bousculer ces appellations, toute embarcation est désormais appelée automoteur. Les matériaux employés dans la construction des bateaux sont eux aussi multiples, principalement faits en bois avant 1930 ils évoluent cependant rapidement vers l’acier. Certains exemplaires employés à Nantes dans les travaux des ponts et chaussées sont même réalisés en ciments. La construction de ces embarcations se fait dans différents chantiers navals qui vont se moderniser petit à petit. Les principaux sont à Nantes, Saint-Malo et Hennebont, mais quelques chantiers navals à Nort-sur-
90 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986–
Erdre, Redon et Pontivy sont aussi à évoquer. Parfois, les chalands sont commandés par groupes de plusieurs unités par les grandes familles de bateliers. Les embarcations sont dès lors des sisters-ships car du même modèle et sont baptisés selon les noms de membres de la famille des propriétaires : Bertrand, Charles, Jacquelines, Jean Éric, Jean-Noël, Jean-Philippe, Yvones, Lucienne, Nina ou encore Pascal et Patricia. D’autres sont encore plus explicites : Les Quatres Frères, Les Deux Frères…
Une fois chargée par les mariniers, le chaland part pour son premier voyage. Certains passages du canal sont plus compliqués à passer que d’autres. C’est notamment le cas de l’Erdre, au nord de Nantes. À cet endroit, il n’est pas possible de haler le chaland à cause de l’absence de chemin de halage. Alors, les bateliers déploient une petite voile, lorsque la météo est favorable (fig. 27), ou bien poussent le chaland à l’aide de longues perches. Plus tard, un remorqueur permettra aux chalands de rejoindre facilement et par tout temps Nantes (fig. 28). Un second passage complexe et même périlleux se situe à Redon. Là, le canal croise la Vilaine à angle droit. Les bateliers qui continuent le voyage doivent alors traverser avec un fort courant de travers. La manœuvre n’est presque pas faisable seul. Alors les mariniers sont solidaires et s’entraident. La figure 29 représente le Mistral tenter de pénétrer dans l’écluse n18bis de Redon. Le fort courant de la Vilaine en crue ce jourlà fait dériver le chaland. Pour contrer ce phénomène, l’Ideal vient simplement le pousser avec sa proue afin de le redresser et de lui permettre de rentrer dans l’écluse.
La figure 30 est un document intitulé « carte de navigation à destination des mariniers ». Son usage est bien défini, c’est un plan qui permet au batelier de repérer les obstacles et de savoir quelle distance il a parcouru. Le cadrage de ce plan se concentre sur la 2e subdivision de Redon. On remarque notamment le croisement avec la Vilaine à gauche du plan. Cette projection ne représente pas la géographie et les méandres du canal, mais simplifie la réalité en une simple ligne. Les informations principales rapportées sont les différents points de confluence, la matérialité de la berge, les écluses, ponts et déversoirs, mais aussi la toponymie des lieux traversés, les limites de communes et les principales routes et voies ferrées rencontrées. Toutes ces informations ne sont pas utiles à la navigation, mais constituent des points de repère paysagers utilisés par le batelier pour s’assurer de la bonne direction à suivre. Les parties supérieures et inférieures du plan sont des zooms sur les franchissements à effectuer. De façon plus précise, il s’agit de plans et d’élévations d’écluses et de déversoirs.




La figure 31 est la page 4 du « Cours de la Vilaine de Redon à Rennes en vue cavalière ». Une autre page de cet ensemble de plans datant de 1543 a pu être analysée précédemment. Cette planche numéro 3 représente la cité fortifiée de Redon au XVIe siècle. On remarque tout d’abord une perspective sans point de fuite, c’est la réduction de l’échelle des objets représentés qui donne l’effet de plans et d’éloignement. L’orientation du plan concentre l’information sur la rivière, ici la Vilaine, et les paysages qui l’entourent. À gauche de l’eau sont représentées des prairies remplies de gibiers alors qu’à droite on retrouve un paysage de landes. Au dernier plan la rivière se jette dans la mer et permet à des bateaux de remonter le cours d’eau jusqu’à la ville. Cette représentation nous donne ainsi l’information de l’utilisation de la Vilaine comme voie commerciale sur ce site bien avant la construction du canal de Nantes à Brest. En effet, la ville de Redon est un port fluviomaritime qui se développe au moins dès le IXe siècle et la construction
d’un ermitage91. La « Note sur les travaux dans les ports bretons au XVIIIe siècle » écrit par Henri Sée nous renseigne un peu mieux sur l’emplacement stratégique de la ville : « Situé au débouché de la Vilaine, il servait au ravitaillement de la ville de Rennes. Des relations assez actives existaient avec La Rochelle et surtout Bordeaux »92.
Le port de Redon est donc aux XVIIIe et XIXe siècles une interface entre les voiliers en provenance de l’embouchure, et les barques à fond plat qui prennent le relai en amont de Redon, lorsqu’il n’y a plus assez de fond. Les figures 32 et 33 sont de cette manière des témoins de ces voiliers de cabotage93 présents dans le port de Redon.
Mais Redon n’est pas le seul port à accueillir des embarcations maritimes : on retrouve ce type de voiliers bien évidemment à Nantes, la Loire étant facilement empruntable par des embarcations faites pour naviguer sur les océans. Mais aussi à Port-Launay, à l’autre extrémité du canal. Ce petit port va revêtir une importance particulière une fois de plus dans une dynamique multimodale. En effet les ressources récoltées dans et hors de la rade de Brest sont conditionnées et chargées sur des Chalands à Port-Launay. Ensuite, ils sont
91 « Histoire fluviomaritime du Pays de Redon et Basse Vilaine », [en ligne], amarinage.com, mise en ligne inconnue, consulté le 05.12.2022
92 SÉE Henry, « Note sur les travaux dans les ports bretons au XVIIIe siècle », Dans « Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest », Presses universitaires de Rennes, p. 417, 1932
93 Renvoie à un transport effectuant la même route de manière récurrente.




acheminés jusqu’à Carhaix, Pontivy ou même Nantes. La ressource principale est ici le sable extrait de bancs de sable finistériens. La figure 34 représente les quais de Port-Launay stockant les piles de sable. Plus tard, les bateaux à vapeur remplaceront ces voiliers caboteurs, mais les routes empruntées resteront les mêmes. La figure 35 est une photographie de l’un de ces bateaux à vapeur, Le Hoche, à la sortie de la dernière écluse, celle de Guily-Glaz. La figure 36 est une remarquable carte postale illustrant un voilier caboteur amarré à Port-Launay. L’inscription dans le coin supérieur droit indique : « De beaux voiliers venus aux heures de marées donnent un charme nouveau à ce coin déjà si pittoresque ». Comme nous aurons l’occasion de le voir plus tard, l’artialisation du canal est déjà en marche au travers de cette illustration. Ce court texte nous apprend aussi que le navire a profité de la marée haute pour accéder au port, ce qui sous-entend que le port est soumis aux phénomènes de marées. C’est une observation exacte, le port est assez proche de l’embouchure de l’Aulne et donc du canal pour observer des niveaux d’eau variables dans la journée. C’est aussi le cas des deux autres villes évoquées précédemment, Redon et Nantes94. À l’arrière-plan de l’illustration, on remarque un grand viaduc qui est ici utilisé par la voie ferrée.
94 Ce sont les 3 seuls lieux du canal soumis à la marée



Si les connexions maritimes existent sur le canal, même de manière réduite, les connexions ferroviaires, elles, sont assez courantes. Le transport ferroviaire va de fait se développer en même temps que le canal de Nantes à Brest et les marchandises transportées par les chalands vont évoluer pour s’adapter à la concurrence du rail95. Tout comme la batellerie, le rail a besoin d’infrastructures. Ainsi, rail et canal peuvent interagir de deux manières : soit la voie de chemin de fer longe le canal et les deux modes de transports évoluent de manière parallèle, soit les deux voies se croisent et le transport ferroviaire nécessite alors ponts et viaducs pour traverser le canal. La figure 37 illustre ce premier cas ou le chemin de fer passe au-dessus du canal au niveau de Saint-Nicolas des eaux.
La seconde image (fig. 38) montre un pont d’une matérialité différente : c’est un pont ferroviaire métallique, ici à Nantes. C’est l’embouchure du canal de Nantes à Brest dans la Loire qui est représentée. On comprend grâce à cette carte postale la densification progressive de la ville de Nantes au XIXe siècle qui aboutira à l’enfermement des premières centaines de mètres de l’Erdre dans un tunnel, le tunnel Saint-Félix.
95 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
Les deux autres cartes postales (fig. 39 et 40) représentent des haltes et gares ferroviaires, là aussi à Nantes, mais aussi à Gouarec. Nous sommes dans la seconde situation, ou l’interrelation entre le canal et le rail se fait de manière parallèle. La ligne de chemin de fer s’approche au plus près de l’eau afin de faciliter le chargement. Ces gares sont donc des zones multimodales ou les marchandises peuvent être chargées et déchargées d’un moyen de transport à l’autre. Sur la photographie du haut, à Gouarec, on retrouve des grues de chargement en bois, des balles stockées ainsi que des wagons en cours de chargement. Un chaland est amarré à l’arrière-plan.
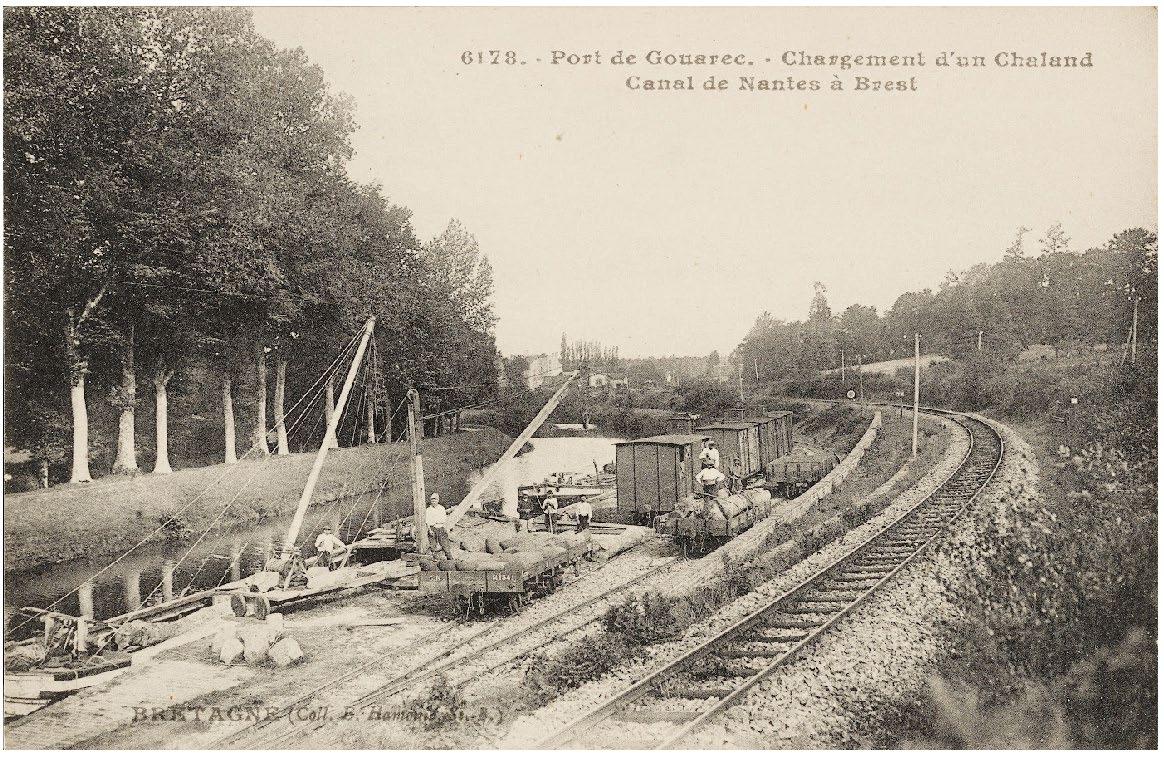



Afin de faire passer le chemin de fer au travers du relief, les ingénieurs ont construit des ouvrages d’exceptions en nombre, mais le plus emblématique est surement le viaduc de Port-Launay. C’est un édifice assez remarquable et dont la construction est bien documentée. Les figures 41 à 44 sont les plans, sections et détails utilisés dans la réalisation du viaduc. Le premier document est une élévation générale. Seules deux arches se fondent dans le canal, la principale difficulté à traverser est donc la topographie de la vallée et ses fortes pentes. Les figures 42 et 44 sont des détails en coupe décrivant de manière précise la mise en œuvre des matériaux et l’utilisation des machines de chantier. Le premier détail précise le fonctionnement d’une grue permettant d’acheminer les pierres de taille depuis les embarcations sur la rivière jusqu’au niveau de l’assise96 en cours de maçonnerie. Le deuxième détail (fig. 44) est très intéressant : il représente la machinerie nécessaire à la construction des fondations. Un caisson est tout d’abord construit, puis une barque chargée d’une pompe doit s’approcher de la fondation afin d’en extraire l’eau. Le viaduc n’est pas conçu comme un simple équipement, c’est au contraire une véritable architecture monumentale. À ce titre on peut retrouver des modénatures sur le niveau supérieur de l’ouvrage, avec un gardecorps en pierre sculpté et des avancées soutenues par des corbeaux maçonnés couronnant les colonnes.




Le canal traverse un territoire très étendu avec une évolution de paysages notamment, selon les différentes vallées empruntées. Cependant, un certain élément du langage ingéniérique est récurrent tout au long de l’itinéraire. Il s’agit du plateau éclusier et plus précisément de la maison éclusière. En effet, ce petit ensemble mêlant infrastructure technique et petite habitation constitue une architecture technique banale.
La conception et la construction d’une maison éclusière répondent avant tout à des contraintes économiques. L’architecture doit être facilement répétée, édifiée à moindre cout et avec des ressources faciles d’accès. La figure 45 est un document dessiné par Jean-Marie De Silguy en 1824. Il conçoit le type de la maison au travers de son plan et de son élévation. Le plan est de forme rectangulaire, mais l’édifice est extrêmement orienté. La façade donnant sur le canal est la seule disposant initialement d’ouvertures, deux fenêtres, et de la porte d’entrée. Le peu de détails sont là aussi concentrés sur cette façade. L’espace intérieur est
divisé en deux espaces : La pièce de vie où les usages de cuisiner, recevoir et stocker se côtoient, ensuite vient la chambre. On remarque une cheminée dans la pièce principale utilisée à la fois pour chauffer l’espace et faire à manger. Le principe structurel est extrêmement simple avec des murs périphériques porteurs. L’architecture de la maison éclusière est donc extrêmement simple et basée sur des règles élémentaires de composition symétrique, rigoureuses, en plan comme en coupe. La qualité de l’espace intérieur est réduite, on remarque une absence évidente d’ouvertures sur l’extérieur, de surface habitable et de lieux de stockage. Ces contraintes importantes vont rapidement mener les éclusiers à modifier leur lieu de vie. Certaines altérations sont assez récurrentes : De nouvelles fenêtres sont percées au RDC ainsi que dans la toiture afin de rendre les combles habitables, un escalier ou une échelle permet l’accès depuis l’extérieur. Des pièces de stockage sont accolées au bâtiment, parfois un four à pain est édifié. Enfin, une seconde cheminée est souvent construite sur le côté opposé du bâtiment, assurant un meilleur confort thermique. Ces modifications sont plus ou moins longues, mais s’articulent toujours dans une logique d’ailes.
Si le plan et l’élévation sont les éléments irréductibles de l’architecture des maisons éclusières du canal de Nantes à Brest, le choix des matériaux, lui, fluctue selon les régions traversées. La pierre de taille est utilisée en Loire-Atlantique, alors que du granit maçonné est préféré dans le Morbihan et le Finistère. Cette matérialité du mur n’est originalement pas per-
ceptible, les façades étant chaulées97. Les toitures sont toujours couvertes d’ardoise. Cet emploi de matériau local, par choix économique, renvoie à un archétype vernaculaire. Des concepts vernaculaires bioclimatiques de base, tels que l’orientation optimale du bâtiment, ne sont cependant pas appliqués. L’implantation du bâtiment se fait toujours de manière parallèle au canal, afin d’ordonnancer la façade principale.
Le type développé par Jean-Marie De Silguy est respecté sur toutes les maisons éclusières, sauf une. La figure 45’ représente cette exception, qui se situe au Bellion, au niveau de la jonction avec la Vilaine98. L’utilisation de cette écluse permet d’accéder à la Vilaine, puis à l’Océan, les dimensions du plateau éclusier sont donc plus grandes. La complexité de la manipulation de l’écluse nécessite plusieurs ingénieurs hydrauliques, la maison éclusière est donc pensée en conséquence. Le plan est plus vaste et comporte quatre pièces au RDC. Un étage est présent dès la version initiale du projet, et l’escalier intégré à l’intérieur du volume. De plus, pas moins de trois orientations sont exploitées pour éclairer les différentes pièces. L’écriture de la façade reprend le langage de la maison éclusière classique, mais une fois de plus avec des dimensions supérieures.
97 Technique d’enduit a base de chaux qui s’applique sur la facade.
98 « L’architecture des maisons éclusières du Canal de Nantes à Brest », [en ligne], canal-nantes-brest.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 05.12.2022
Il faut aussi évoquer l’utilisation du premier type décrit ci-avant sur des ouvrages qui ne sont pas des maisons éclusières. En effet, le réseau secondaire est pourvu de six maisons de cantonniers afin de surveiller et piloter les rigoles d’alimentation en eau, ainsi que deux maisons de barragistes, au plus près des réservoirs. Enfin, une maison portuaire est construite dans le centre de Redon afin d’administrer le canal et le port fluvial de la ville99.
La construction de ces maisons éclusières est confiée à des promoteurs privés suite à des appels d’offres publics. Elles sont donc pour la plupart construites unitairement.
« Inscription architecturale dans le territoire. Les gares en série »100 est un article d’Alexandrina Striffling-Marcu qui s’intéresse à la série architecturale de la gare, à ses caractéristiques et sa patrimonialisation. Les analyses et conclusions qu’elle produit sur les gares peuvent s’appliquer de la même façon au type de la maison éclusière. Tous deux sont des architectures infrastructurelles répétées en série. L’auteur trouve la qualité urbaine de ces architectures banales dans leur réticularité, c’est-à-dire leur mode de fonctionnement en réseau : « La réticularité du patrimoine ferroviaire
99 « Maison liées à l’activité du canal de Nantes à Brest : maison éclusière, maison portuaire, maison de barragiste, maison de cantonnier », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022
100 STRIFFLING-MARCU Alexandrina, « Inscription architecturale dans le territoire. Les gares en série », Cahier thématiques n°20, janvier 2022
est précisément ce qui l’extrait de la simple répétition d’objets »101. Prise individuellement, ce sont des habitations communes, banales, qui relèvent du petit patrimoine local. C’est par leur mise en relation globale que chacun de ces plateaux éclusiers devient un exemple exceptionnel d’architecture sérielle dans le territoire. Le processus de répétition vient alors mailler un territoire long de 360km, et créer un lien au paysage et au territoire particulier. Alexandrina Striffling-Marcu dénonce trois phénomènes dans le processus de patrimonialisation de ces séries : une dérive monumentaliste qui ne s’intéresse qu’aux bâtiments spectaculaires. Une dérive architecturale qui réduit le bâtiment à un style. Et une dérive de l’inconscience qui, à terme, simplifie à l’extrême le bâtiment et lui ôte une partie de ces caractéristiques propres102. Ces dérives peuvent mener à une perte de sens de la série. En effet, la rupture de ce lien réticulaire entre les éléments ramène à l’appréhension unitaire et isolée des éléments. L’essence territoriale même de la série est gommée. Une partie du patrimoine est alors perdue et disparaît.
101 Idem
102 STRIFFLING-MARCU Alexandrina, « Inscription architecturale dans le territoire. Les gares en série », Cahier thématiques n°20, janvier 2022










Le canal de Nantes à Brest constitue une voie d’eau utilisée à des fins de transport. Nous avons pu voir précédemment que son exploitation nécessite différentes infrastructures qui peuvent prendre des formes variées. Écluses, déversoirs, maisons éclusières, rigoles d’approvisionnements et réservoirs fonctionnent en réseau. Mais d’autres infrastructures sont aujourd’hui présentes au bord du canal, ce sont des excroissances bâties secondaires, dans le sens qu’elles ne sont pas essentielles ni même utiles au fonctionnement de la machine hydraulique.
Les figures 47, 48 et 49 représentent des industries, manufactures ou carrières qui trouvent divers avantages à s’implanter à proximité immédiates du canal.
Le première est l’utilisation de l’eau comme ressource énergétique. En effet, de nombreux moulins à eau sont construits en bord de rivière dès le XIIe siècle103. Ils permettent de moudre le grain des paysans en faisant tourner une meule mue par la force de l’eau. L’étude menée par Pauline Peter sur l’archéologie du Blavet révèle un positionnement judicieux de chaque moulin en fonction du courant : « Ils sont répartis de façon assez hétérogène à l’échelle du territoire, mais sont globalement situés à l’entrée ou à la sortie d’un méandre, la configuration du
103 « Le Blavet au fil de l’eau… (2/3) : les industries fluviales », [en ligne], Ici et là, 2018
cours d’eau influant sur la puissance du courant.»104. La canalisation du fleuve va détruire certains sites et les survivants ne pourront plus continuer leur travail de la même manière, la force du courant étant dorénavant maitrisée. La plupart vont alors stopper leur activité, déjà soumise à la concurrence depuis la révolution industrielle, mais d’autres vont se reconvertir en minoteries105. La typologie des bâtiments va évoluer suite à ce nouvel usage et plusieurs nouveaux étages sont construits afin de multiplier les surfaces de plancher. C’est le cas de la figure 47, une minoterie située à Josselin.
La figure 48, quant à elle, représente la tannerie de Rieux, à St-Martin-sur-Oust. La tannerie est une industrie qui utilise elle aussi la ressource eau, non pas pour sa force hydraulique, mais pour l’apport permanent d’eau. Pour fabriquer du cuir, les peaux doivent être trempées dans des bassins dont l’eau est constamment renouvelée106. Afin de garantir cet accès à l’eau, une dérivation du canal est creusée. L’eau est acheminée ainsi jusqu’aux bâtiments de la tannerie, implantés perpendiculairement au chenal. L’architecture de cet édifice renvoie à un archétype d’agrégation. Différents bâtiments séparés n’en deviennent qu’un seul
104 PETER Pauline, « Du fleuve au canal : enquête sur le patrimoine fluvial du Blavet (Bretagne) du Moyen Âge à nos jours », Revue Archéologique de l’Ouest, 2021.
105 Type de moulin utilisant une machinerie électrique afin de moudre de plus grandes quantités de grains.
106 « Les procédés : la tannerie », [en ligne], inventaire.poitou-charentes.fr, mis en ligne en juin 2017, consulté le 06.12.2022
suite à une densification progressive de la parcelle107. Les matériaux employés sont locaux et renvoient aux constructions vernaculaires alentour. Cependant, c’est dans l’échelle du bâti que l’on perçoit la dimension industrielle de la tannerie de Rieux.
Plus loin vers Brest, le canal emprunte la rivière Aulne qui méandre dans les contreforts des montagnes noires. Des collines d’ardoises sont visibles depuis le halage au niveau de St-Goazec. Il s’agit des carrières ardoisières du Rik, les plus grandes de Bretagne et exploitées jusqu’en 1940. La concurrence angevine aura raison de l’activité de la mine. De la même manière que les infrastructures analysées précédemment, les ardoisières sont présentes avant la construction du canal. Cependant leur développement devient exponentiel à partir de 1942108. Ainsi, l’ouverture d’une voie commerciale va permettre le transport rapide et facile de la ressource exploitée jusqu’à Port-Launay puis Brest. La figure 49 est une carte postale représentant cette carrière du Rik. La carrière est donc exploitée à ciel ouvert et le creusement se fait par marches successives. Les ressources sont chargées dans des wagons tirés par des chevaux. Au centre de l’image, les carriers posent sur un mur de soutènement massif qui stabilise le sol. Le canal de Nantes à Brest se trouve juste de l’autre côté de ce talus.
107 JOVIN Servane, « Implantation et architecture des tanneries et mégisseries d’Ille-et-Vilaine au XIXe et XXè siècles » Dans « Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest », Presses universitaires de Rennes, p. 85-109, 1998
108 GOUEROU Christian, « Le canal, la voie bleue de l’ardoise », Ouest-France, mai 2019
La figure 50 est une gravure de la pêcherie d’Elorn présente sur le Blavet, vers Châteaulin. Il s’agit ici d’un ouvrage qui utilise le canal pour sa ressource en poisson. Il en existe plusieurs types, cependant la pêcherie représentée est assez perfectionnée. Cet ouvrage est antérieur à la construction du canal et a probablement été détruit lors de la révolution, cependant d’autres pêcheries sont présentes en nombre tout au long des 364km de canal. Il s’agit aujourd’hui de ruines visibles sur le canal. La pêcherie du Blavet s’organise autour de piles maçonnées qui supportent des coulisses permettant de disposer des herses ou des filets entre chaque pile109. Ainsi, l’eau peut s’écouler, mais les poissons restent prisonniers. Le détail de la figure 51 montre plus précisément la manipulation de la pêcherie. Ces dernières sont le plus souvent implantées proche des déversoirs ou sur ces derniers. La gravure de Diderot et d’Alembert de la pêcherie du Blavet témoigne de l’importance de cet équipement pour la noblesse : il n’est pas pour eux un moyen de subsistance par la pêche, mais une façon d’user de leur droit seigneurial en prélevant une taxe d’usage110.
109 « La pêcherie royale de Pont-Christ », [en ligne], andre. croguennec.fr, mis en ligne en février 2012, consulté le 07.12.2022
110 LE CALVEZ Caroline, « Rétablir la libre circulation piscicole dans les vallées fluviales : mise en perspective des enjeux et des aménagements à partir du cas de l’Aulne (XIXè-XXè siècles) », NOROIS, 2015






L’usine hydro-électrique est un type d’infrastructure qui vient altérer l’ouvrage qu’est le canal de Nantes à Brest au même titre que les constructions telles que la tannerie et la minoterie. Cependant, nous allons voir que les usines hydro-électriques auront des conséquences bien plus grandes. Les figures suivantes représentent les usines hydro-électriques de Coatigrac’h et de La Née. La première, située à St-Coulitz près de Châteaulin, est notamment la première usine hydro-électrique à être édifiée en Bretagne, en 1886111, et la troisième Française. L’étude de la photographie (fig. 52) et du plan (fig. 53) démontrent une construction similaire aux moulins à eau implantés sur le site depuis le moyenâge. Un petit canal de dérivation est construit et permet à l’eau de rentrer dans le bâtiment au travers d’une ouverture. À l’intérieur du bâtiment, l’eau actionne une turbine (fig. 54) qui produit l’électricité. Les figures 55 et 56 représentent quant à elles les détails de vannage et du canal de dérivation qui permettent de manipuler le niveau d’eau. L’édifice est construit en maçonneries de grès. Les linteaux et arcs en plein cintre sont plus massifs. La construction de l’édifice est un réel événement, 10.000 personnes auraient assisté à l’inauguration112.
111 « Usine hydro-électrique, coatigrac’h (Saint-Coulitz) », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 08.12.2022
112 Idem
L’électricité produite aux usines hydro-électriques de Coatigrac’h et de La Née va permettre d’alimenter très rapidement les fermes alentours, mais aussi les lanternes éclairants les rues de Châteaulin113. La carte postale (fig. 52) nomme même l’édifice d’après la destination de l’électricité produite : « Châteaulin – L’Usine d’Éclairage de Coatigrac’h ».
113 « Usine hydro-électrique, coatigrac’h (Saint-Coulitz) », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 08.12.2022





La situation de l’électrification de la Bretagne au tournant du siècle est limitée. Si les villes s’équipent progressivement, la modernisation des campagnes est plus inégale. La très faible densité de ces territoires ruraux induit des coups de raccordements au réseau général insoutenable pour les administrations. Les équipements électriques restent ponctuels, tels que les sites hydro-électriques de Coatigrac’h et de St-Coulitz, et n’alimentent que quelques dizaines de kilomètres de lignes. La situation évolue au lendemain de la Première Guerre mondiale : « Les « Poilus » qui ont survécu à la Grande Guerre ont constaté l’importance prise par l’électricité dans la vie quotidienne des villes qu’ils ont traversées en se rendant sur le front »114. Pour les poilus redevenus fermiers, l’application de cette énergie dans l’agriculture est révolutionnaire. Ils comprennent l’intérêt de l’utiliser afin de faire fonctionner les machines agricoles. L’énergie électrique reste cependant mysti-
114 BERTHONNET Arnaud, « L’électrification rurale ou le développement de la fée électricité au cœur des campagnes françaises dans le premier XXe siècle », Histoire et Sociétés Rurales, p. 193-219, 2003
fiée en ce début de XXe siècle, et l’on vante les effets de la « fée mystérieuse 115» sur les épisodes météorologiques, les processus de vinification ainsi que de stérilisation et même sur la psychologie des animaux116. Les politiques publiques bretonnes vont alors s’intéresser à quelques expérimentations comme l’utilisation de la force marémotrice, en plus de multiplier les petites usines de rivières. La production n’est cependant ni continue ni suffisante. La technologie de la centrale hydraulique à haute chute bénéficie de deux atouts majeurs : c’est une énergie renouvelable, mais surtout hautement pilotable. Il est donc envisagé de construire des barrages en Bretagne pour compenser les périodes de creux des usines marémotrices côtières117.
Joseph Ratier, alors sous-préfet de Pontivy en 1921 118, repère le site de Guerlédan qui présente des qualités certaines : le lieu est situé en aval du point culminant du canal de Nantes à Brest, au niveau d’une rupture de pente dans un coude du Blavet. Le potentiel énergétique est donc maximum, par l’altitude à laquelle se trouve le réservoir en eau. Le second avantage est l’état du village de Guerlédan. Implanté
115 Terme que développe Arnaud Berthonnet dans son article
116 BERTHONNET Arnaud, « L’électrification rurale ou le développement de la fée électricité au cœur des campagnes françaises dans le premier XXe siècle », Histoire et Sociétés Rurales, p. 193-219, 2003
117 GAUTIER Marcel, « L’électrification de la Bretagne » Dans « Annales de géographie », Armand Colin, p. 472-480, 1939
118 « Un peu d’histoire », [en ligne], lacdeguerledan.com, mis en ligne en 2014, consulté le 07.12.2022
dans une vallée reculée cerné de grandes parois de granit, l’économie du village est au point mort. Ainsi peu d’habitants vivent encore sur place et de nombreuses masures sont en ruines. L’expropriation peut se faire rapidement et à moindre cout119. Le barrage prévu a des dimensions hors norme pour l’époque, 215m de long par 46m de hauteur120, et nécessite l’emploi du béton121, une première sur ce type d’ouvrage.
La figure 57 est une affiche représentant le futur barrage de Guerlédan. Issue des archives de la ville de Pontivy, elle est datée du début du XXe siècle. Le cœur de l’illustration représente le barrage ainsi que les bâtiments de l’usine hydro-électrique et le déversoir latéral. L’image dépeint un paysage paisible, union de la nature et des infrastructures humaines. Les inscriptions supérieures et inférieures détaillent les caractéristiques de l’ouvrage : « Union hydro-électrique armoricaine […] puissance prévue : 16.000 chevaux – hauteur de chute 45 mètres – Barrage-réservoir de 50.000.000m3 ». Cette affiche porte le message d’une Bretagne en voie de modernisation au travers de chantiers phares tels que la construction du barrage de Guerlédan.
La figure 58, quant à elle, est une huile sur toile de Léon Hamonet qui représente le paysage nouveau issu de la construction du barrage de Guerlédan.
119 « Le barrage de Guerlédan », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
120 GAUTIER Marcel, « L’électrification de la Bretagne » Dans « Annales de géographie », Armand Colin, p. 472-480, 1939
121 « Un peu d’histoire », [en ligne], lacdeguerledan.com, mis en ligne en 2014, consulté le 07.12.2022


La construction du barrage de Guerlédan induit l’apparition d’un lac réservoir de 10 km de long. Les écluses n°120 à n°136 sont englouties122 par les eaux. Le continuum du canal de Nantes à Brest est stoppé net, l’itinéraire coupé en deux. Dès lors, la partie septentrionale du canal va péricliter, le trafic commercial décroit rapidement. Les écluses ne sont plus entretenues et le canal s’envase. La partie méridionale du canal subsiste et l’itinéraire reste empruntable et emprunté de Nantes à Redon, Josselin et Pontivy. Le contrat du projet originel du barrage de Guerlédan comprend la création d’une voie secondaire, permettant aux chalands de continuer leur route jusqu’à Brest. Le décret de concession signé par la Société Générale d’électricité en atteste : « le concessionnaire sera tenu d’assurer à travers la chute de Guerlédan, à ses frais et sous sa responsabilité le passage des bateaux fréquentant le canal de Nantes à Brest et des marchandises qu’ils transportent »123. Elle ne sera jamais réalisée par manque de financements. Certains projets réapparaissent régulièrement et proposent des dérivations, ou même des ascenseurs à bateaux de type écossais124 afin de reconnecter le continuum originel, mais aucun d’entre eux n’est sérieusement pris en compte.
122 Voir annexe liste écluses
123 « Le barrage de Guerlédan », [en ligne], patrimoine-archives. morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
124 SIGOURA Isabelle, « Ascenseur à bateaux à Guerlédan : une étude sur la pertinence du projet », Ouest-France, octobre 2021
Le lac de Guerlédan connait plusieurs assecs dans son histoire, en 1966, 1975, 1985 et 2015125. Seul le premier d’entre eux a été figé par une photographie aérienne. Celle-ci est reprise en figure 59. La campagne et les forêts du centre de la Bretagne sont interrompues par la figure du lac, au Sud-Ouest. Deux informations sont à repérer dans l’épaisseur de la trace laissée par l’assec : la figure la plus claire correspond à l’emprise habituelle du lac tandis qu’un mince filet d’eau serpente au milieu de la figure. Il rend ainsi visible le tracé premier du cours du Blavet et du canal et les anciennes écluses et maisons éclusières sont rendues visibles.
La photographie de Jules Duclos (fig. 60) illustre les sites éclusiers n°135 et n°136 en 1890. Le cours du Blavet est large et a creusé au fil des siècles une vallée plutôt profonde pour la région. Le paysage photographié par Duclos est aujourd’hui submergé par le lac de Guerlédan.
Les figures 61 et 62 sont aussi des photographies, mais bien plus récente. Elles datent en effet de 2015, lors de l’assec le plus récent, et ont été prise par Samuel Hense, photographe nantais. Les thèmes favoris de cet artiste sont l’urbanité et l’appropriation des espaces publics par l’humain126. Il questionne aussi des thématiques autres comme la relation mémorielle que l’on entretient au territoire, au travers de l’exploration de traces laissées par l’Homme. Ses photographies témoignent
125 « Un peu d’histoire », [en ligne], lacdeguerledan.com, mis en ligne en 2014, consulté le 07.12.2022
126 « Samuel Hense », [en ligne], hanslucas.com, mis en ligne en 2022, consulté le 07.12.2022
des écluses disparues, ramenées à la surface, mais aussi de la trace de l’eau anthropisée sur le paysage. La ligne d’horizon de la photographie correspond au lit maximal atteint par l’eau, et l’impact est impressionnant : la végétation s’arrête brutalement après cette ligne et la roche change de teinte. Ces photographie se démarque nt de beaucoup d’autres prises lors de l’assec de Guerlédan par l’association faite entre recherches plastiques lumineuses et la volonté documentaliste de l’artiste.






L’édification du barrage de Guerlédan constitue un tournant majeur dans la batellerie bretonne et signe le début du déclin de l’activité commerciale du canal. Elle subsiste tout de même jusqu’en 1977 et un dernier transport de sable de Loire127. Mais la rupture du continuum Nantes Brest n’est pas la seule raison et d’autres facteurs sont à prendre en compte. C’est en réalité la concurrence, du transport ferroviaire puis routier, qui va rendre la batellerie non rentable. Nous allons évoquer certaines caractéristiques du canal qui ont bridé la compétitivité de l’exploitation de cette voie commerciale.
Le canal de Nantes à Brest est constitué d’un ensemble infrastructurel qui nécessite un entretien, le canal doit donc être asséché, nettoyé et dévasé chaque année. C’est aussi l’occasion pour les bateliers comme pour les éclusiers d’effectuer les réparations nécessaires sur leur outil de travail. Durant cette période le canal n’est pas empruntable, les éclusiers sont en période dite de chôme et les bateaux sont immobilisés à quai. La figure 63 montre l’un de ces étés ou les chalands sont parqués, ici près de Redon.
Mais à ces assecs récurrents, il faut ajouter les sécheresses qui immobilisent là encore toute navigation sur l’ouvrage. Dans son huile sur toile de 2013 (fig. 64), George Briot dépeint l’une de ces sécheresses. Il n’y a plus qu’un filet d’eau dans le tracé du canal et les bateaux sont
127 LICOYS Capucine, « Le canal de Nantes à Brest, 180 ans d’histoire », Ouest-France, Aout 2022
tous en cale sèche. La sécheresse de 1976 empêche les chalands d’effectuer leurs routes pendant six mois128, ce sera la plus longue. Durant ces six mois, les bateliers ne touchent aucun salaire et sont de plus en plus précarisés.
Le canal de Nantes à Brest est extrêmement connecté au réseau hydrique naturel du territoire qu’il traverse. Ce réseau est plus ou moins saturé d’eau selon les saisons, le débit est généralement plus important en hiver. Mais parfois, de véritables crues adviennent et les chalands doivent être stoppés, car le franchissement des écluses n’est plus assurable. Ces crues endommagent l’infrastructure, qui nécessite alors des réparations qui peuvent prendre jusqu’à plusieurs semaines129. En 1925, une crue fait déborder le canal à Pontivy. L’eau submerge les quais et envahit les rues adjacentes. La figure 65 est une photographie documentant cet épisode. Les limites entre le canal et la ville sont indéfinies, l’eau recouvre tout. Au milieu de l’image, un marinier téméraire manœuvre son chaland en tentant de suivre le cours de la rivière.
Enfin, un dernier aléa climatique assez exceptionnel est à évoquer. Lors des hivers les plus rigoureux, l’eau du canal peut venir à geler et le trafic doit être une fois de plus immobilisé. C’est le cas de l’hiver 1879, notamment. La figure 66 illustre l’Erdre gelé à Nantes cette même année, les embarcations sont toutes prises dans la glace.
128 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017
129 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015


Exploité durant un peu plus d’un siècle, le canal tombe ensuite dans l’oubli, de la construction du barrage de Guerlédan jusqu’à la fin de la batellerie bretonne. Ce déclin et cet abandon dureront près de 40 ans. Cependant, on observe depuis 15 ans un renouveau basé sur une toute nouvelle activité économique : le tourisme. Itinéraire aujourd’hui reconnu nationalement, il est parcouru chaque année par plus de 150.000 touristes130. Nous allons maintenant analyser, au travers de la troisième partie de ce corpus, ce développement touristique, ses causes et ses effets. Le nouvel attrait touristique du canal de Nantes à Brest passe effectivement par un changement de paradigme dans la perception paysagère. Le canal n’est plus une infrastructure technique, militaire et commerciale, mais un site touristique remarquable, naturel ou non. Le développement touristique va multiplier le nombre d’usagers, et amplifier la quantité de documents produits, qui se développent sur de nouveaux médiums. L’étude des documents suivants permet de mieux comprendre l’apparition du tourisme sur le territoire étudié : « Comment l’analyse des imaginaires et de leurs fondements idéologiques, esthétiques, philosophiques et politiques peut-elle permettre de suivre la trajectoire touristique d’un lieu ? »131. Nous allons nous intéresser tout d’abord au glissement d’une esthétique romantique au pittoresque, avant d’aborder le loisir et le tourisme. Enfin, il s’agira de comprendre la place qu’entretiennent aujourd’hui les traces de la machine hydraulique du canal de Nantes à Brest.


Avant d’analyser les toiles dépeignant le canal de Nantes à Brest et la posture des artistes, il faut recontextualiser l’objet canal comme choix d’objet d’étude dans la peinture française du XVIIe siècle au XXe132. Avant l’impressionnisme, il n’existe presque pas de représentations de canaux en France. C’est en revanche une spécialité des peintres hollandais et vénitiens qui en font un motif important. Pour eux, peindre les canaux revêt une importance d’identité nationale133. Leurs œuvres vont finalement influencer quelques-uns de leurs contemporains travaillant en France : deux maîtres sont alors à évoquer en la figure des peintres Alfred Sisley134 et Albert Marquet135. Ce sont les premiers à peindre les canaux comme objet principal du dessin, et non comme décor relégué à l’arrière-plan. S’ils fréquentent leurs
132 LASALLE Christian, « Les canaux dans la peinture et la photographie », p. 369 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
133 Idem
134 1839-1899
135 1875-1947
contemporains les plus renommés (Sisley se lie d’amitié avec Pissarro, Monet et Renoir alors que Marquet entretiendra une correspondance avec Matisse)136, ils ne connaitront pas le même succès. Dans son article traitant de la représentation des canaux au travers d’une iconographie variée, Christian Lassalle identifie ces deux peintres comme des exceptions dans la peinture française : « Seuls quelques artistes de grande envergure tels que Sisley et Marquet montrèrent un engouement constant pour le paysage du canal, comme lieu idéal pour leurs recherches picturales sur la lumière, les couleurs, le cadrage et signe d’un état d’esprit, de rêve, d’activité et de tranquillité tout à la fois, qui était le leur.137»
Au contraire de Sisley et Marquet, les peintres présentés ci-après ne se caractérisent pas par une production picturale spécifiquement dirigée vers l’objet canal. Leurs œuvres sélectionnées dans le présent corpus sont souvent leur unique représentation de canaux. Cependant, il est intéressant de s’intéresser à leur travail sur le canal de Nantes à Brest, car ce sont les pionniers de l’apparition d’une nouvelle esthétique sur ce territoire.
Charles Leroux né à Nantes en 1814. Ce peintre paysagiste se concentra à représenter les paysages de campagne et de marais de son pays, l’embouchure de
136 LASALLE Christian, « Les canaux dans la peinture et la photographie », p. 369 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
137 Ibid
la Loire de Nantes à Saint-Nazaire138. Ces toiles sont profondément romantiques, et laissent transparaitre les grandes caractéristiques de ce mouvement : Charles Leroux peint ses émotions engendrées par son rapport à un paysage, ici à la rivière Erdre (fig. 67). L’utilisation du clair-obscur dirige le regard vers le centre de l’image et le dégagement d’un horizon lumineux. Cette œuvre mystifie le cours d’eau qui apparait sombre et dangereux. Les ombres menaçantes des arbres envahissent le centre de l’image et font face à une falaise abrupte. Des rochers émergent de la surface de la rivière, qui semble indomptée et non navigable. Charles Leroux figure dans son tableau une nature sauvage, tranquille, mais hostile à l’homme.
Maxime Maufra139 est un élève de Charles Leroux qui peint dans la première partie de sa carrière des paysages naturels à l’image de son maître. Il découvre lors d’un voyage au Royaume-Uni les peintres anglais Turner et Constable140, et va dès lors se rapprocher de la mouvance impressionniste. Il rejoint l’école de Pont-Aven, groupe formé par Paul Sérusier, Émile Bernard, Paul Gauguin et Gustave Loiseau. Sa peinture évolue et reprend les considérations impressionnistes sur la lumière et la clarté tout en gardant un degré de figuration plus important que les œuvres
138 « Charles Le Roux 1814-1895 », [en ligne], charlesleroux.com, mise en ligne inconnue, consulté le 08.12.2022
139 1861-1918
140 « Maxime Maufra », [en ligne], museothyssen.org, mis en ligne en 2022, consulté le 09.12.2022
de ses pairs141. En ça, il peut être considéré comme un postimpressionniste142 . En 1912, Maxime Maufra peint « Les bords du Blavet » (fig. 68). La toile dépeint un paysage pittoresque du centre de la Bretagne, calme et tranquille. La rivière serpente entre des bosquets dans une prairie. Cette peinture se caractérise par une utilisation de couleurs vives, utilisées ici pour raconter une saison, l’automne. Le vert des étendues enherbées contraste avec les teintes orangées des feuilles et du ciel. La présence humaine est matérialisée par une maisonnette isolée à l’arrière-plan, peut-être une maison éclusière ?
Paul Sérusier est lui aussi un membre éminent de l’école de Pont-Aven. Sa rencontre avec Paul Gauguin va influencer largement sa peinture143. Sa pratique impressionniste se détache encore un peu plus du réalisme; c’est la création du mouvement nabi144. « Paysage à la rivière (ou canal vu d’en haut) » (fig. 69) est une œuvre qu’il réalise vers la fin de sa vie, en 1923. Elle représente le canal de Nantes à Brest en plongée, vue depuis le sommet d’une colline. On remarque cependant une absence de perspective. Le paysage est décomposé en formes que l’artiste vient déformer puis peindre par aplats de
141 Ibid
142 Postimpressionnisme : Ensemble de tendances artistiques de la fin du XIXe et du début du XXe s. qui divergent de l’impressionnisme ou s’opposent à lui. Définition Larousse.com
143 AULNAS Patrick, « Paul Sérusier », [en ligne], rivagedeboheme.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 10.12.2022
144 Groupe de jeunes peintres indépendants qui se constitua en 1888 et qui tenta d’adapter les tendances symbolistes à l’art de la peinture. Définition cnrtl.fr
couleurs vives et exagérées. Les teintes utilisées sont or, vertes et bleues. Dans cette toile, Paul Sérusier s’oppose au naturalisme et à toute posture trop documentaliste de la réalité. Le canal de Sérusier est ainsi poétisé et empreint de mysticisme. Fervent catholique, il peint un paysage parfait, créé par la main de Dieu. Ainsi, il ne peut se résoudre à représenter les aménagements humains, et donc la canalisation du Blavet, ses écluses, déversoirs et chemins de halage. En effet, l’imperfection de la nature et la nécessité qu’a l’Homme à la conformer à ses usages anthropiques ne peut être accepté par le peintre qui revendique par là une forme de subjectivité145.
Figure majeure du cubisme français, Roger de La Fresnaye146 ne peindra qu’une fois le canal de Nantes à Brest. Ses pairs ne sont pas plus enthousiastes face à cet objet d’étude. Né en 1885 au Mans, Roger de La Fresnaye fréquente dans sa jeunesse des membres du mouvement nabi. Paul Sérusier va notamment l’influencer147. Ses principaux chefs-d’œuvre représentent des scènes de la Grande Guerre, quelques paysages et les enjeux de son temps, comme la conquête de l’air. « Le canal, paysage de Bretagne » (fig. 70) témoigne du statut de l’artiste : il est le plus figuratif des cubistes148. Ainsi, on perçoit au premier plan des figures humaines
145 MAINGON Claire, « Les Nabis en 3 minutes », [en ligne], beauxarts.com, mis en ligne en mars 2019, consulté le 10.12.2022
146 1885-1925
147 « Roger de La Fresnaye (1885-1925) La tentation du cubisme », [en ligne], musee-paul-dini.com, mis en ligne en octobre 2018, consulté le 10.12.2022
148 Idem
sur le chemin de halage, puis l’espace du canal occupé par des lavandières et des barques. Enfin, l’arrière-plan se compose de la silhouette des maisons traditionnelles et de collines. De La Fresnaye rompt dans son tableau avec toute norme perspectiviste, mais dispose les différents objets sur des plans différents. Le peintre gomme les contours des formes géométriques qui composent le tableau. Ainsi, toutes les figures semblent flotter dans un tout homogène, vaguement profond149. Au contraire de Paul Sérusier, Roger de La Fresnaye peint ici un paysage communautaire150 humain qui comprend le canal comme les maisons. La dissolution des limites mène à un rapprochement entre le canal, la ville et l’Homme. La subtilité de cette peinture laisse Christian Lassalle regretter l’absence d’autres toiles du même artiste dans sa période bretonne151.
149 « Roger de La Fresnaye », [en ligne], larousse.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 10.12.2022
150 Terme emprunté à François Pouthier dans son article :
POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016
151 LASALLE Christian, « Les canaux dans la peinture et la photographie », p. 369 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986




Si les œuvres du canal de Nantes à Brest peinte par les grands noms de l’histoire de l’art sont extrêmement réduites en nombre, elles jouent tout de même le rôle primordial de pionnier dans l’émergence d’une nouvelle esthétique. Cette nouvelle esthétique se développe en parallèle de l’amplification puis du déclin de la batellerie bretonne, mais en rejette les thèmes. Les artistes, qu’ils soient naturalistes, impressionnistes, ou bien nabis et cubistes, donc postimpressionnistes, sont animés par une quête de la beauté ou d’une harmonie régionaliste. Ces œuvres vont alors mener au développement d’une nouvelle esthétique pittoresque, qui va se diffuser dans la Bretagne. Les artistes ordinaires qui peuplent les territoires traversés par le canal vont alors s’emparer de ces représentations. Ils choisissent cet objet d’étude pour sa proximité plus que par choix artistique. La qualité des toiles est assez variable, la plupart d’entre elles relèvent d’un art commun, marqué par l’impressionnisme et le fauvisme. Ces toiles participent à la création d’une nouvelle esthétique du canal.
Les figures 71 à 76 suivantes sont issues de cette production artistique. Les artistes sont Claude Marchalot, Danny Wattier, Jean Parraud, Bruno De Nardy, Georges Briot, Cathou-Bazec, mais de nombreux autres
peintres pourraient compléter cet échantillon. On remarque une hétérogénéité des outils de représentation, certains préférant l’aquarelle, d’autres l’acrylique ou la peinture à l’huile. Ces techniques sont parfois secondées par l’utilisation de pastels (fig. 72). Toutes ces toiles sont donc caractérisées par des couleurs vives souvent utilisées pour raconter une certaine saisonnalité ou temporalité. L’objet principal de la représentation, le canal de Nantes à Brest, est mis en scène de façon centrale et marque la profondeur. On remarque aussi une composition de l’image astreinte au regard humain et à la position du peintre. Ce dernier va souvent peindre depuis le chemin de halage, ou bien depuis un pont (fig. 76).
Au travers de ces œuvres, les peintres évoqués s’efforcent d’illustrer les effets combinés de la lumière et de l’eau. On retrouve souvent des motifs de reflets, de tourbillons, d’ondes, voire de transparence. Les artistes dépeignent des scènes quotidiennes : un pécheur sur sa barque (fig. 71), des kayakistes (fig. 72) ou bien des paysages vides de toute présence humaine (fig. 75).
Si le statut de chef-d’œuvre des toiles présentées ici reste discutable, leur participation à la construction de récits communs est certain. C’est la thèse que défend François Pouthier152. Selon lui, l’implication des habitants du territoire dans la fabrication de nouveaux récits territoriaux est cruciale et résulte d’une logique de
152 POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016



transmission de type Bottom-up 153: « Cette transmission, transcendée par des projets culturels et artistiques, se révèle plus simplement par des processus ascendants, mis en œuvre par les personnes elles-mêmes, que ceux produits de haut en bas, par les mécanismes de l’action publique et les - experts nommés -.154» L’auteur va jusqu’à nommer ces artistes locaux des « experts du quotidien »155.
Ce sont finalement les interrelations entre les logiques de représentations ascendantes et descendantes qui vont mener à la fabrication d’une nouvelle esthétique paysagère du canal de Nantes à Brest, esthétique que l’on pourrait qualifier de pittoresque.
153 Bottom-Up : Se dit d’une démarche procédurale hiérarchiquement ascendante, qui va du bas vers le haut, analyse les détails ou les cas particuliers pour généraliser SOURCE : lalanguefrancaise. com
154 POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016
155 Idem

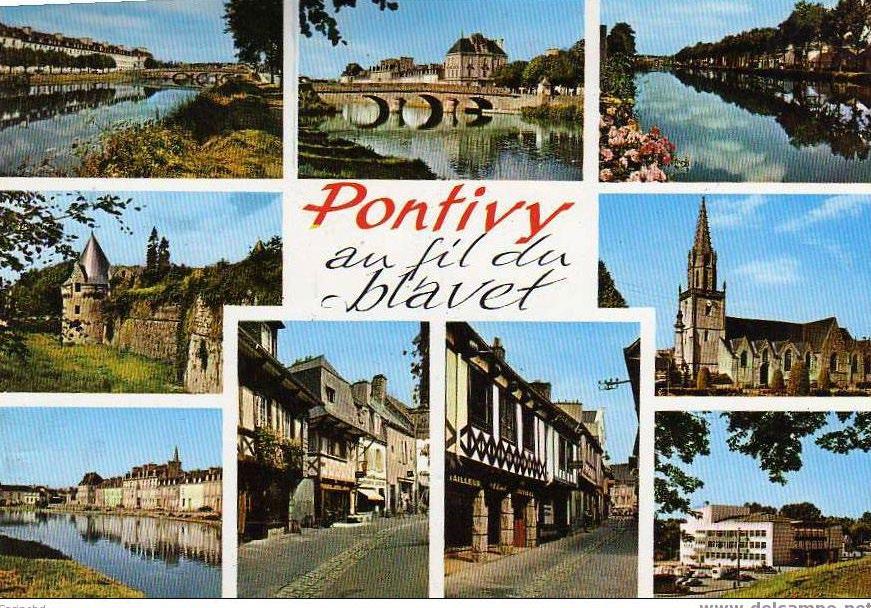

Le pittoresque est l’adjectif ( et nom ) de quelque chose « qui attire l’attention, charme ou amuse par un aspect original 156» . Cette définition démontre que l’aspect originel du territoire pittoresque est au cœur de cet adjectif. Cependant, le pittoresque fait parfois référence à un passé idéalisé, souvent non pertinent sur le plan historique. Il s’agit donc d’une notion profondément subjective, que certains auteurs dénoncent lorsqu’il s’agit de représentations du paysage. C’est le cas de François Pouthier dans son article, mais aussi de Christophe Guilbert et Anaelle Paul. Ces derniers alertent sur l’écueil que peuvent rencontrer les décisionnaires face au pittoresque : « La difficulté, évoquée par des élus locaux ou des associations, est de préserver la logique historique et identitaire du patrimoine sans pour autant se perdre dans une industrie patrimoniale, une logique marchande ou de sombrer dans un certain - folklore -157 » . Pour François Pouthier, la préservation à outrance du territoire revient à le « vitrifier »158 et à le réduire à un objet inerte qu’il revient de valoriser d’un point de vue marketing dans un contexte de mise en concurrence des territoires.
156 Définition lerobert.com
157 GUIBERT Christophe, PAUL Anaëlle, « Usages et intérêts différenciés des espaces maritimes et fluviaux patrimonialisés. Les cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et du canal de Nantes à Brest », NOROIS, 2013
158 POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016
Les figures 77 et 78 sont des cartes postales qui compilent différentes photos des villes de Pontivy et de Josselin. On remarque tout d’abord que les cartes postales présentées ici sont assez différentes de celles qui parsèment le reste du corpus. En effet, la carte postale prend la forme d’un assemblage de photos de monuments de la ville, et perd sa qualité documentaliste en délaissant les scènes de vie quotidienne. Les images illustrent ici une ville belle, propre et fleurie, toujours photographiée sous un ciel bleu qui se reflète dans le canal. Ces particularités visent à mettre en scène la ville et la montrer sous un jour accueillant. Les titres de ces cartes postales : « Pontivy au fil du Blavet » et « Souvenir de Josselin » ainsi que leurs images réduisent ces deux lieux à une dimension vacancière et à une saisonnalité bien précise : l’été. La carte postale de tourisme telle que présentée ici est donc un outil marketing au service de la ville dans une politique d’accroissement de l’attractivité. Contrairement à d’autres médiums, la carte postale participe de manière active au développement touristique, sa capacité de diffusion étant son principal avantage.
La figure 79 est une aquarelle sur canson qui représente un chaland sur le canal de Nantes à Brest halé par un cheval de trait. L’image est colorée et très claire. La représentation d’une nature paisible, d’une eau calme et d’un ciel bleu est mise au service d’une scène heureuse et pittoresque. Cette illustration du canal et de la batellerie est en réalité très fantasmée. En effet, les témoignages de bateliers confirment que leur
emploi était évidemment un travail dur et épuisant159. La nature initiale du canal, une machine hydraulique dédiée à une activité militaire, mais surtout utilisée à des fins commerciales, est reniée par ces représentations trop pittoresques. En ce sens, nous pourrions nous questionner sur le sens de telles représentations et leur impact sur la construction d’une mémoire collective.
159 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017







Si le développement du tourisme se fait sur le canal depuis le début des années 2000, son usage à des fins de loisirs n’est absolument pas nouveau. La figure 80 démontre la plaisance sur l’Erdre au moins dès le début du XXe siècle. La photographie se situe à Sucésur-Erdre et fige des petits canaux à voiles navigants sur le canal. La berge est aménagée en une longue promenade d’agrément. La figure 81 est une gravure datant de 1830 qui représente l’Erdre à la Jonnellière. C’est le paysage romantique d’une vallée sinueuse surplombée par les ruines d’un château perdu dans la végétation. La ruine est un thème classique de la peinture romantique qui renvoie ici ouvertement à la littérature de roman, comme l’indique l’inscription sous la gravure : « Ruines du château de Barbe-bleue ». Cette perception romantique du territoire va conduire à un aménagement tout aussi romantique du territoire, car l’essentiel est de « rendre sur le terrain l’effet qu’un peintre rend sur sa toile »160. Alors, des manoirs et autres riches de-
160 THOUIN G., « Plans raisonnées de jardins », 1819. In : EMERIAU Justine, « La vallée de l’Erdre de la rivière, aux plateaux agricoles », ENSAPBX, février 2022
meures vont être construits dans ce lieu dès la fin du XVIIIe siècle161, plus d’une vingtaine de folies au total162. Le paysage marécageux, quant à lui, va être remodelé pour correspondre à un idéal de parc. Ce sont les familles bourgeoises et aristocrates de la ville de Nantes qui commandent ces travaux, et font de la vallée de l’Erdre un lieu favorisé de retraite campagnarde. La photographie de la figure 80 illustre donc des usages de plaisance en filiation directe avec les représentations et aménagements bourgeois des deux siècles précédents.
Mais l’usage du canal comme lieu récréatif n’est pas réservé aux classes les plus riches. Les collectivités territoriales aménagent les bords du canal pour rendre la baignade plus accessible parfois. Par exemple, la municipalité de Pontivy construit en 1938 une piscine municipale implantée directement au bord du canal (fig. 83). La piscine, surnommée « plage publique », se décompose alors en deux parties : le bassin et la plage. Cette architecture constitue un premier pas dans le processus de connexion de la ville à sa rivière. La dimension publique de l’édifice permet de démocratiser l’accès à la rivière pour des usages de loisirs, qui est alors considérée comme un bien commun. L’architecture monumentaliste de l’ouvrage se réfère au néo-classicisme du début du XXe siècle avec ses colonnades et emmarchements.
La piscine publique assure dès lors un rôle de monument dans la ville de Pontivy ; ville qui entretient déjà une relation particulière à la figure monumentale dans son urba-
nité depuis les plans d’aménagements napoléoniens163.
Les loisirs liés au canal ne nécessitent pas toujours d’architecture telle que la piscine de Pontivy et tirent simplement parti de l’aménagement du canal de Nantes à Brest. La figure 82 est une photographie de la course de hors-bord qui a eu lieu à Lestitut, sur le cours du Blavet, en 1960. La foule amassée sur les berges du canal observe les embarcations se livrer à une compétition féroce : l’un des participants semble avoir une panne, son bateau est à l’arrêt. Les figures 84 et 85 représentent des scènes de loisirs bien plus récentes que les documents précédents. Il s’agit de photographies prises en 1991 sur la tranchée de Glomel et le réservoir alimentant le bief de partage. La machine hydraulique du canal est donc détournée de son usage premier par les canoés et planches à voile, qui trouvent dans ces étendues d’eau des qualités de plaisance certaines.




Hier comme aujourd’hui, les loisirs révèlent le passé mémoriel de l’histoire du canal de Nantes à Brest lors de temporalités exceptionnelles : les fêtes. Le XXe siècle voit un recul des identités régionales bretonnes dans les campagnes. Alors, les habitants des villes se saisissent de ces identités lors de fêtes qui deviendront plus tard les premiers Fest-Noz164 : « Tandis que la population rurale abandonne costumes, danses et autres traditions, des citadins les reprennent à leur compte à des fins spectaculaires, confortés par le développement du tourisme. »165. La figure 86 est une photographie d’une fête de ce type à Josselin. C’est une procession de Bagads166 traditionnels, qui passe sous le renommé château de la ville. La figure 87 est une représentation de la fête du canal et de la culture bretonne organisée à Redon au milieu du XXe siècle. On y aperçoit le chaland Marguerite qui aborde pour l’occasion des hermines, symbole de la région. Le chaland automoteur est utilisé pour tracter toute une variété de petites embarcations, canoés, radeaux et autres barques. La foule emprunte les chemins de halage et de contre-halage, de part et d’autre du canal afin
164 Fête bretonne traditionnelle, au cours de laquelle on danse. Définition lerobert.com
165 POSTIC Fanch, LAURENT Donation, SIMON Jean-François, VEILLARD Jean-Yves, « Reconnaissance d’une culture régionale : la Bretagne depuis la Révolution », Ethnologie Francaise n°33, p. 381389, 2003
166 Formation musicale à base d’instruments traditionnels de Bretagne (bombardes, cornemuses, binious), qui joue de la musique de marche. Définition lerobert.com
de suivre le trajet du Marguerite. Les femmes, hommes et enfants sur ce chaland sont déguisés, ils portent entre autres des tenues bourgeoises du XIXe siècle.
L’un d’entre eux arbore même un bicorne napoléonien.
L’illustration 88 est une photographie illustrant un événement bien plus actuel qui a eu lieu en 2022. Il s’agit de la traversée fluviale du Finistère. Organisé par l’association « La route de l’ardoise », il consiste à retracer l’itinéraire des chalands sur la section septentrionale du canal, de l’écluse de Goariva jusqu’à Châteaulin167. L’événement regroupe différentes embarcations de plaisanciers, qui se suivent le long de l’itinéraire.
À l’opposé du canal, on retrouve les rendez-vous de l’Erdre, un événement regroupant plaisanciers et habitants autour d’un festival de jazz (fig. 89). Les sites sont dispersés dans 14 villes. Le rapport entretenu à la mémoire territoriale est plus superficiel que lors de l’événement de « La route de l’ardoise ». Cependant, l’appropriation de l’espace du canal est intéressante : les différentes scènes sont flottantes et investissent la voie d’eau. Les spectateurs, quant à eux, peuvent assister au concert depuis les berges comme de leurs embarcations. Là encore, ces événements participent à l’implication des habitants du territoire dans la transmission et la fabrication de récits communs. Les fêtes actuelles s’inscrivent dans une filiation vis-à-vis des processions plus anciennes. Ce sont en effet durant ces temporalités particulières que l’appropriation du canal et de sa mémoire se fait plus intense qu’au quotidien.
167 TOURCHON Olivier, « Canal de Nantes à Brest : Traversée fluviale du Finistère entre nature et patrimoine », [en ligne], bateaux.com, mis en ligne en février 2022, consulté le 12.12.2022




La labellisation de sites du canal de Nantes à Brest est un outil majeur des politiques de développement touristique telles que menées par les territorialités. Elle s’opère à travers l’action cumulée de stratégies marketing et de classements patrimoniaux de sites168. Le patrimoine évoqué ici est un «construit social et culturel»169, tel que défini par François Pouthier.
Le canal intègre l’itinéraire cyclable Eurovélo 1, présenté par la carte figure 90, en 1995. C’est un tracé européen à vocation touristique. Long de 11.500 km, il relie le cap nord, point le plus au nord de la Norvège à Sagres au Portugal. Les autres pays traversés sont le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne170. La majorité du canal de Nantes à Brest, entre Nantes et Carhaix-Plouguer, fait partie de ce très long itinéraire cyclable. Cette labellisation a conduit à une explosion du cyclotourisme sur le chemin de halage et a induit des retombées économiques importantes sur les territoires traversés171.
168 GUIBERT Christophe, PAUL Anaëlle, « Usages et intérêts différenciés des espaces maritimes et fluviaux patrimonialisés. Les cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et du canal de Nantes à Brest », NOROIS, 2013
169 POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016
170 « Atlantic Coast Route », [en ligne], eurovelo.com, mise en ligne inconnue, consulté le 13.12.2022
171 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
Le développement de ce cyclotourisme plutôt intensif a nécessité la construction d’équipements relatifs à cette nouvelle activité : gites étapes, garages vélo, tables et bancs, mais aussi travaux de rénovation des pistes et chemins pour les rendre empruntables aux vélos. C’est finalement tout l’aménagement du canal qui a été remis en question. C’est le canal en tant que voie bleue et verte à l’échelle territoriale qui est valorisée par ce label172.
La labellisation Eurovélo 1 est la seule qui considère le canal de Nantes à Brest dans sa globalité ou comme une figure linéaire, les labels présentés ci-après se concentrent sur certains points remarquables précis du canal. La figure 91 est un plan cavalier de la ville de Josselin dressé par les architectes Damien Cabiron et Anne Holmberg. Ce dessin fait partie d’une grande série173 de plans cavaliers commandés par la région Bretagne et les municipalités afin de représenter toutes les villes de ce territoire bénéficiant du label « Petites cités de caractère ». Le label récompense les villes protégées au titre des monuments historiques, de taille réduite et assez dense pour posséder un centre assimilable au terme de « cité »174. Ce label est lui aussi assez important à obtenir pour les agglomérations
172 GUIBERT Christophe, PAUL Anaëlle, « Usages et intérêts différenciés des espaces maritimes et fluviaux patrimonialisés. Les cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et du canal de Nantes à Brest », NOROIS, 2013
173 La ville de Malestroit, traversée par le canal, faut aussi partie de cette série.
174 « La charte nationale de qualité », [en ligne], petitescitesdecaractere.com, mis en ligne en 2018, consulté le 13.12.2022
revendiquant une forte attractivité touristique. Il ne prend cependant pas en compte le passé mémoriel de l’eau dans ses critères de sélection, alors que c’est un élément au cœur du dessin de Cabiron et Holmberg.
Certaines sections du canal de Nantes à Brest bénéficient d’une protection renforcée, car inscrites à la liste des sites Natura2000. C’est le cas des marais de la Vilaine à Redon, de la vallée de l’Aulne près de Châteauneuf-du-Faou ainsi que des marais de l’Erdre. L’inscription de parties du canal à l’inventaire des sites naturels trahit une certaine perception ou non-perception du canal : le patrimoine socioculturel de la machine hydraulique de Kersauzon et Bouessel est rejeté au profit de biotopes à préserver. Ces milieux ainsi que la biodiversité qui les habitent sont cependant considérablement anthropisés. La figure 92 est une carte pli de ce même territoire au nord de l’agglomération nantaise. Il représente par une axonométrie coloré et ludique ces marais de l’Erdre et les usages qui l’habitent. Cette carte est associée à un atlas des usages pris individuellement et isolés de la carte du territoire avant d’être repositionnés sur un fond blanc. Certains pictogrammes représentent des thèmes ou des objets évoqués précédemment : on peut notamment repérer un chaland et une demeure « folie »175 du XIXe.
Ces représentations, que ce soit le plan cavalier de Cabiron et Holmberg ou la carte nautique de Grrr Design révèlent la nécessité qu’ont les adminis-
175 EMERIAU Justine, « La vallée de l’Erdre de la rivière, aux plateaux agricoles », ENSAPBX, février 2022
trateurs à communiquer sur les labels obtenus. Ces documents basés sur la narration du territoire sont des outils marketings communiqués par les villes dans leur mise en concurrence. On peut désigner toutes ces représentations comme issues d’une logique top-down176 de la fabrication des imaginaires.
Un autre impact de ces labels est à aborder : ils permettent de resituer le canal de Nantes à Brest dans un ensemble plus grand à l’échelle européenne (Eurovélo 1), nationale (sites Natura 2000) ou régionale (petites cités de caractère).
176 Se dit d’une démarche procédurale hiérarchiquement descendante, qui va du haut vers le bas, part du général pour aller au particulier. Définition lalanguefrancaise.com




Les touristes parcourant le canal chaque année, à pied, vélo ou bateau constituent un flux de 150.000 personnes177. Leur impact sur la mise en récit du canal n’est pas neutre : au contraire, ils sont partie prenante dans le processus de fabrication de l’imaginaire territorial par leur production iconographique et artistique. L’activité touristique sur le canal de Nantes à Brest prend une forme particulière : c’est une itinérance, un voyage de plusieurs jours liés à un mode de déplacement pédestre, cycliste ou nautique et son rapport au paysage. Les touristes pratiquent une forme de déracinement, un retour temporaire au nomadisme.
Sur notre objet d’étude, il faut évoquer Jacques Clouteau, qui fait figure de pionnier. Il parcourt en 1995 les 365 km du canal accompagné par son âne178. Au retour de ce voyage, il désire transmettre l’expérience qu’il a vécue et se lance avec sa fille dans la rédaction d’un guide touristique. Au contraire de guides spécialistes de régions entières, celui-ci se concentre sur la figure du canal de Nantes à Brest, qu’il décompose en une succession de plans (fig. 93) de 2 km par 6 km. Graphiquement, il représente le canal comme une voie de transport linéaire en faisant le choix de réutili-
177 L’HOURS Dimitri, « Tourisme. Le canal de Nantes à Brest à la côte », Le Télégramme, aout 2019
178 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, p. 11, 2015
ser la symbologie de l’autoroute et ses sigles. Outre la bonne direction à suivre, le guide de Clouteau repère différents lieux liés à l’itinérance et utiles au voyageur : les gites, camping et chambres d’hôtes, mais aussi les lieux de restauration, d’information, les épiceries et les pharmacies sont indiquées. Pour ce qui est de l’hébergement et de la restauration, les prix sont aussi indiqués dans la légende. Le guide est mis à jour et réédité régulièrement afin de prendre en compte les évolutions du territoire. Cependant, l’arrivée d’internet et surtout des smartphones, en accélérant l’accès à l’information, vont rendre inefficaces les guides tels que celui de Clouteau sur le canal de Nantes à Brest.
Cette même arrivée d’internet va faire sortir un type de médium des bibliothèques et des archives privées : les carnets de voyage. Ils sont réalisés sur place, lors de l’itinérance, et ont pour but de documenter les lieux visités et de témoigner de son passage. Les figures 95, 96 et 97 sont des extraits du carnet de Catherine Michel lors de son voyage de Nantes à Carnac en 2016. Le carnet se compose d’un ensemble de dessins à l’aquarelle, d’annotations et de collages. Les scènes peintes à l’aquarelle représentent des paysages, des détails végétaux ou bien des profils toutes vouées à retranscrire une « ambiance globale » bucolique. On retrouve assez fortement dans ce carnet de voyage la volonté de l’auteur de témoigner de son passage. Les tampons des hôtels et restaurants sillonnés laissent une trace sur le papier du carnet, mais l’on peut aussi repérer des tickets d’entrée, comme celui du musée de la batellerie de Redon.
Le développement exponentiel des réseaux sociaux affecte certains de nos modes de vie comme le rite social que constitue le tourisme. Le touriste contemporain se sert des réseaux sociaux avant, pendant et après son itinérance (fig. 94). Ils lui permettent avant tout de planifier l’itinéraire, de se renseigner sur les endroits à visiter ou les mauvais à éviter. Durant le voyage, les réseaux sociaux font office de moyen de communication du périple, mais servent aussi à la diffusion des photographies prises ou des dessins effectués. Enfin, la dernière phase d’utilisation est celle du retour sur expérience par la notation des différents lieux, afin d’aiguiller les futurs voyageurs.
Cette importance des réseaux sociaux dans la pratique du tourisme contemporain est un enjeu compris par les territorialités : « L’internaute n’est donc plus passif devant une communication territoriale, il en devient un véritable acteur, vecteur, ambassadeur voire évangélisateur, cherchant à s’impliquer autant que le ferait le territoire lui-même.179»
Le touriste nomade contemporain s’inscrit finalement dans un processus participatif et cyclique d’évaluation du territoire, qui devrait être sujet à débat.
179 BARABEL Michel, MAYOL Samuel, MEIER Olivier, « Les médias sociaux au service du marketing territorial : une approche exploratoire », Management et Avenir n°32, p. 233-253, 2010





Le développement d’un tourisme sur le canal de Nantes à Brest est une nouvelle activité économique qui rompt avec la batellerie traditionnelle et ses équipements. Nous avons pu voir précédemment que ce tourisme contemporain s’appuie sur un renouveau esthétique du patrimoine socioculturel du canal, immatériel comme matériel. En effet, les artefacts du passé du canal, qu’ils appartiennent à la machine hydraulique ou à l’histoire de la batellerie bretonne, sont toujours présents. Nous pouvons nous interroger sur l’impact qu’a eu le tourisme sur ces formes, qu’elles soient ou non architecturales.
La figure 98 est une photographie de la maison éclusière de Cramezeul à Nort-sur-Erdre. Suite à un appel à projets temporaires de la région en 2017, le projet de « La cueilleuse » est sélectionné et réalisé. Le programme se divise en trois : le fournil est le lieu de production de pains et de galettes bretonnes issus d’une agriculture de proximité. La maison éclusière présentait initialement une pièce dédiée à la fabrication boulangère, que le projet réutilise. Le café est un lieu de restauration et de rencontres prisé des touristes. Enfin, le bivouac est une zone à l’arrière de la maison éclusière où les vacanciers peuvent planter leur tente gratuitement pour une nuit. Le projet de « La cueilleuse » comprend aussi l’organisation récurrente d’événements culturels et musicaux. Cette réhabilitation d’une maison éclusière est un
exemple parmi d’autres de mise à disposition du patrimoine éclusier du canal par la région. La série de maisons éclusières devient alors le support d’expérimentations de façons d’habiter différentes. Ces expériences mettent à l’épreuve des hybridations programmatiques dans des territoires ruraux, des productions maraichères en agriculture biologique ou encore des bâtiments autonomes en énergie180. Ces projets ne comprennent cependant qu’une infime partie des maisons éclusières, la plupart sont encore en activité et habitées par des éclusiers, donc propriété du Conseil Départemental.
Quant aux chalands, ils sont pour la plupart laissé plus ou moins à l’abandon dans les ports des villes de Nantes, Blain, Redon, Josselin, Guenrouet et Port-Launay. Cependant, certains chalands ont étés achetés et transformés en habitations. L’appellation change, on parle dès lors de péniche181. Les figures 99 et 100 montrent les modifications conduites sur "Le Massena", l'un des chalands les plus anciens encore à flot. Il a été en effet construit en 1906. Utilisé depuis toujours comme habitation, sa réhabilitation l'a en réalité conduit a perdre sa qualité première et son mode d'habiter particulier: le nomadisme.
180 « La cueilleuse », [en ligne], lacueilleuse.com, mise en ligne inconnue, consulté le 14.12.2022
181 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017


Le corpus iconographique présenté et analysé tout au long du développement de ce mémoire nous a permis de cheminer au travers du canal de Nantes à Brest, aussi bien spatialement que temporellement. Ce long panorama de la Bretagne intérieure et de son histoire fait écho à des questionnements contemporains complexes. Nous héritons ainsi d’une machine hydraulique ancienne et fonctionnelle, voie de transport à l’échelle régionale et porteuse de récits partagés influents.
Les projets d’aménagement du territoire portent depuis plusieurs décennies une attention particulière au site et à son contexte, en appliquant un régionalisme critique182. Cette posture tente de réparer des territoires abimés par l’internationalisation de l’architecture moderne et postmoderne183, par l’utilisation de stratégies résilientes. Dans ce contexte, que nous apporte l’analyse empirique du corpus iconographique du canal de Nantes à Brest ? C’est une ressource à convoquer dans le proces-
182 Le régionalisme critique est une approche à l’architecture par laquelle il cherche à opposer à l’idée d’un manque d’identité et / ou l’appartenance à une architecture moderne faisant usage de l’environnement géographique du bâtiment. Le terme a été introduit par les théoriciens Alessandro Tzonis et Liane Lefaivre, puis, avec un sens légèrement différent, il a été utilisé par l’historien-théoricienne Kenneth Frampton. Définition bookwiki.info
183 Architecture postmoderne : En architecture, mouvement contemporain fondé sur la remise en cause des théories modernistes et de l’emprise, durant un demi-siècle, du style international. Définition larousse.fr
sus de fabrication d’un territoire en commun. Nous admettons ici que les différentes représentations d’un lieu jouent un rôle fondamental dans la création d’imaginaires communs. Ces imaginaires peuvent mener à une poétisation du territoire, ou non. Ils sont cependant fondamentaux à la formation d’un sentiment d’appartenance territorialisé. En ce sens, les représentations du canal de Nantes à Brest peuvent devenir un futur levier qui peut être utilisé par les différents concepteurs dans une démarche d’aménagement du territoire souhaitable et durable.
Les thématiques soulevées par l’analyse du corpus sont aussi diverses et variées que la composition du corpus en tant que telle :
L’eau en commun
L’eau en commun est le premier thème abordé dans l’introduction de ce mémoire. Cet enjeu est complexe, car il peut s’appréhender sous plusieurs aspects. Tout d’abord, l’eau est une ressource qui va venir à manquer dans le futur et dont les questions de gouvernance doivent être posées. Qui possède et distribue l’eau aujourd’hui et demain ? Ensuite, nous pouvons considérer les architectures de l’eau comme une ressource. Véritable héritage du passé, certains canaux comme le canal de Nantes à Brest ont été restaurés et sont aujourd’hui en bon état. Quels peuvent être les potentiels de développement pour une industrie, une agriculture et un commerce en voie de décarbonation ? Enfin, à la question du commun doit s’ajouter la question de l’espace public. Les travaux de Paola Vigano pour le « Blue Space of the Eurometropolis Lille – Tournai – Courtai » se fondent sur cette appréhension du canal comme une marge fondatrice de nouveaux lieux publics. « Ces lieux deviennent les espaces publics de la ville diffuse du XXIe siècle. Ces lieux sont la pierre angulaire de la conception des espaces publics à la grande échelle. »
Le vivant Comme le montrent les documents liés à la labellisation du canal de Nantes à Brest, le vivant constitue une réserve de biodiversité importante. L’espace aquatique du canal accueille une faune et une flore adaptées au milieu de la rivière et à son anthropisation. Il ne faut cependant pas sous-estimer le rôle de la berge dans les dynamiques environnementales. En effet, la berge et sa ripisylve constituent un écotone crucial entre « milieux terrestres et aquatiques »184. Ce milieu n’est pas uniquement un
espace transitionnel transversal au canal, c’est aussi un corridor écologique parallèle à la voie d’eau empruntée par une faune variée et fragile 185 La préservation de cette biodiversité n’est pas seulement une nécessité à assurer, mais peut devenir la fondation d’un projet de plus grande envergure. Selon l’analyse de Sophie Bonin, les aménagements de l’espace de la berge ont subi d’importants changements en l’espace de 50 ans : « On est passé d’une logique de développement sectoriel et d’intégration des différents secteurs économiques institutionnalisés (navigation, énergie, irrigation, surtout) à la mise en avant d’une logique de requalification d’espaces naturels, de réouverture au public, finalement de revalorisation paysagère »186
L’expérience du tourisme sur le canal de Nantes à Brest est une expérience en marge du tourisme de masse contemporain pour deux raisons majeures : la lenteur et les inspirations du road-movie. Les modes de déplacements admis sur la voie d’eau comme sur le chemin de halage sont des modes lents. La navigation en péniche et les randonnées piétonnes ou cyclistes contrastent en effet avec les modes de déplacements rapides du monde moderne, qu’ils soient routiers, aériens ou ferroviaires. Alors, cette perte de vitesse permet de changer le paradigme de la perception et de l’attention portées au paysage. C’est en ralentissant que l’on commence à être plus attentif au temps, au climat, à l’environnement… L’article « Vers un retour de la lenteur et des communs »187 met en corrélation le ralentissement des modes de vie avec le redéveloppement de communs oubliés et la fabrication de nouveaux. Le tourisme sur le canal de Nantes à Brest n’est pas uniquement déterminé par la lenteur, mais aussi par l’absence d’attache et donc, par le nomadisme. Ce mode de tourisme reprend les codes d’un genre cinématographique liés à l’itinérance : le road-movie. Ce genre catégorise les films « exploitant le thème de la route, de la traversée des grands espaces »188. Il se caractérise par un voyage initiatique dans un paysage panorama, un héros vagabond aventurier en quête d’un Nouveau Monde et un retour à une simplicité de vie et à une nature : la nature pittoresque189. Ainsi, les touristes itinérants du canal sont à la recherche d’un anti-voyage en marge du tourisme de masse contemporain.
recherches, applications et lacunes, p. 17, juin 2010
185 Idem
186 BONIN Sophie, « Fleuves en ville : enjeux écologiques et projets urbains », Strates, 2007
187 MEZOUED Aniss M., KAUFMANN Vincent, NASDROVISKY Boris, « Vers un retour de la lenteur et des communs ? », Espaces et sociétés n°175, avril 2018
188 Définition Lerobert.com
189 ARGOD Pascale, « Du road movie au – voyage sauvage - : la quête d’aventure sur la route et le mythe du voyageur héroïque », Via tourism review, 2018
Quel est le territoire imaginaire fabriqué par les représentations du corpus iconographique présenté ? En quoi diffère ou concorde-t-il de la réalité géographique, historique et culturelle du canal de Nantes à Brest ? Comment les diverses représentations s’articulent-elles ? Contribuent-elles toutes à la même hauteur à la fabrication du paysage et de sa narration ? L’analyse de la composition et de la situation du corpus d’étude au travers de la carte pli (annexe 1) nous permet de répondre à certaines de ces questions.
Spatialement d’abord, tous les lieux sont-ils représentés de la même manière et avec la même récurrence ? En réalité, on remarque que les villes monopolisent la majorité des représentations alors qu’elles ne représentent statistiquement parlant qu’une infime partie de l’itinéraire. En effet le canal de Nantes à Brest traverse majoritairement des territoires ordinaires marqués par l’agriculture et l’élevage, et parfois par des zones naturelles remarquables. Tous ces lieux ne sont que trop peu représentés, ce qui traduit un manque de représentations ou d’accès aux représentations. En analysant plus dans le détail la situation du corpus et en excluant les villes, on remarque une seconde limite : en effet les territoires agricoles et naturels les plus représentés sont ceux traversés par les portions du canal en bon état, navigables et empruntables à vélo et à pied. Ainsi, les sections de Pontivy à Guerlédan et de Coat-Natous à Pont-Triffen sont sous-représentées et non navigables190. Cela représente près de 75,9 km de halage.
Temporellement ensuite, nous avons pu diviser l’histoire du canal en grandes parties selon un plan chronothématique. La réalité est un peu plus complexe et les transformations plus progressives. Cependant, certaines périodes sont absentes du corpus. Tout d’abord, les débuts de la batellerie bretonne. En effet, si le processus de conception du canal est bien représenté, sa construction tout comme son exploitation initiale sont souvent floues. La raison peut être la distance temporelle qui nous sépare de cette période induisant une perte et une destruction de certains documents. Ceux qui nous arrivent sont conservés pour leurs qualités patrimoniales propres et ne sont pas représentatifs de toute la réalité historique. Les sujets de la représentation sont aussi limités et excluent le labeur et la pauvreté. Une deuxième période de crise de la représentation du canal s’ouvre en 1930 lors de la création du barrage de Guerlédan. L’activité batelière périclite et ses représentations avec. Seuls quelques passionnés, souvent
retraités de la batellerie, réalisent un travail d’archive et de tri de leurs mémoires. Ce travail n’est pas communiqué et peu atteignable. C’est finalement le renouveau touristique du canal qui va fabriquer de nouvelles représentations et de nouveaux récits à partir de 1990. Historiquement, le type de médium produit évolue donc en fonction des usages et des nécessités selon les intentions des auteurs. Mais l’on remarque aussi que l’intensité de la production de médiums fluctue fortement tout au long de la période couverte par l’étude. Ainsi certaines ères sont plus représentées que d’autres.
Ces résultats doivent être mis en perspective au regard de la méthodologie adoptée. En effet, l’échelle de l’objet d’étude, 364 km linéaires sans compter le réseau secondaire et les villes de Nantes et de Brest, est trop grand pour pouvoir être cadré précisément. S’assurer de collecter l’intégralité des données sur ce territoire est une tâche sans fin, la composition et la sélection du corpus présenté ici ayant notamment évolué constamment jusqu’au 17 décembre 2023. Le corpus ainsi composé ne peut pas être et n’est pas exhaustif. Cette critique requestionne alors l’accès à l’information pour tous, que ce soit au travers de consultations d’archives, d’exploitations des ressources de correspondants ou de l’usage d’outils du quotidien tels qu’internet. La méthodologie utilisée pour composer le corpus est semblable à une enquête, avec ses évidences et ses écueils.
Une deuxième critique pourrait être faite au corpus, non dans sa compilation, mais dans sa sélection et sa mise en avant. Une infime partie des documents collectés sont finalement présentés. Il y a donc un processus certain de mise à l’écart de certains documents, et il s’agit d’en comprendre les raisons.
Tout d’abord, les documents de mauvaise qualité. S’il n’est pas possible de les restaurer et de les augmenter, ces documents sont éliminés. Vient ensuite les doublons. Nous avons pu voir que certains secteurs du canal sont sur-représentés ; dans ce cas de très nombreux documents doivent, eux aussi, être délaissés. Certains documents, aussi importants soient-ils, souffrent d’une absence de source de bonne qualité. Dans ce cas, leur utilisation est rendue trop compliquée et ils ne peuvent perdurer dans l’iconographie finale. Enfin, le processus de sélection finale vise à mettre en correspondance certaines de ces iconographies afin de créer des thèmes spécifiques et représentatifs de l’histoire du canal de Nantes à Brest. De nombreux documents de bonne qualité, mais qui ne racontent pas grand-chose doivent être abandonnés une fois encore.
Nous avons donc pu identifier ici deux limites subies lors des phases de compilation et de sélection. Il en découle un processus qui se veut le plus efficace possible, mais qui n’atteint réellement ni l’exhaustivité totale ni l’objectivité parfaite.
Finalement, ce mémoire tend à être un outil pour potentiels concepteurs, sorte d’état des lieux des représentations présentes et passées de l’objet d’étude. Il tend ainsi à fournir une analyse sur l’appropriation d’une infrastructure hydraulique, sur le sentiment d’appartenance à différentes échelles ainsi que le sur le rapport à l’eau et à l’art. Ces thèmes sont tous des portes d’entrée du projet. Si le corpus iconographique permet d’analyser les processus de construction du paysage et de mise en récit de l’histoire du territoire, il faut aussi concéder qu’il participe aux mêmes processus. La redécouverte de certaines archives, leur association, combinaison puis exposition dans ce mémoire contribuant au cycle de la fabrication de récits communs.
Nous avons pu précédemment revenir sur les potentiels de projets issus de l’analyse des représentations du canal de Nantes à Brest. Cependant, ce travail de mémoire vise avant tout à retrouver les imaginaires partagés et à comprendre leurs processus de fabrication. Il n’y a finalement pas un paysage, ni une narration commune, mais une multitude d’entre eux. L’écosystème des imaginaires est hérité d’une forme de stratification historique palimpseste, qui complexifie temporellement la narration du canal. Si les imaginaires sont de plus en plus nombreux, ils se distinguent spatialement : À Glomel le canal est celui des bagnards, alors qu’à Pontivy il est l’ouvrage de Napoléon. Le canal des ingénieurs est quant à lui présent aux échelles d’écluses comme à Hilvern. Certains lieux portent ainsi plus ou moins de signification au regard de certaines périodes ou thèmes historiques. La fabrication d’imaginaires et de paysages est le fruit de plusieurs acteurs, qu’ils soient décisionnaires ou usagers, mais relève d’une construction mentale. Selon Francois Pouthier, le rôle de l’art est précisément de « mettre en lumière ce construit social »191. Pour aller plus loin, nous pourrions nous questionner sur quels procédés adopter pour collecter les mémoires encore enfouies des usagers du territoire. Mais aussi comment permettre à chaque citoyen de participer à la fabrication d’imaginaires des territoires habités ce qui, finalement, relève d’un enjeu démocratique.
◌ BENFERHAT Kader, AUBERT Sandra, « Le canal de Nantes à Brest », Éditions OuestFrance, 1999
◌ BOURGEOIS-GIRONDE Sacha, « Être la rivière », Presses universitaires de France, 2020
◌ Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986
BEAUDOIN François, « Histoire de France de la navigation intérieure », p. 92
LEMOINE Bertrand, « L’évolution de la technique de construction des canaux », p. 176
PICON Antoine, « De l’hydrostatique à l’hydrodynamique, la théorie hydraulique au Siècle des Lumières », p. 181
PINON Pierre, « Notes sur quelques ouvrages et chantiers », p. 186
PINON Pierre, « Des monuments du paysage », p. 241
PICON Antoine, « Les canaux et le travail de l’ingénieur à l’âge classique », p. 272
BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301
LASALLE Christian, « Les canaux dans la peinture et la photographie », p. 369
PINON Pierre, « Entreprise et financement des canaux », p. 379
◌ CHALINE Olivier, « Les États de Bretagne : Une diète à l’Ouest de la France ? » Dans
◌ FIGEAC Michel, « noblesse française et noblesse polonaise, Mémoire, identité culture XVIè-XXè siècles », Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2006
◌ CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015
◌ COCHET Yves, SINAÏ Agnès, THEVARD Benoit, « Bioregion 2050, l’ile de France après l’effondrement », Institut Momentum, octobre 2019
◌ GAUTIER Marcel, « L’électrification de la Bretagne » Dans « Annales de géographie », Armand Colin, p. 472-480, 1939
◌ HAUDEBOURG Guy, « Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXème siècle », Presses universitaires de Rennes, Chapitre 2 p. 61-102, 1998
◌ JOVIN Servane, « Implantation et architecture des tanneries et mégisseries d’Ille-etVilaine au XIXè et XXè siècles » Dans « Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest », Presses universitaires de Rennes, p. 85-109, 1998
◌ KERGRIST Jean, « La vie au camp de Glomel », Éditions des Montagnes-Noires, 2011
◌ MARSEILLE PROVENCE 2013, « GR 2013, un sentier métropolitain de randonnée pédestre », WildProject, 2013
◌ ROGER Alain, « Court traité du paysage », Gallimard, 1997
◌ SÉE Henry, « Note sur les travaux dans les ports bretons au XVIIIème siècle », Dans « Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest », Presses universitaires de Rennes, p. 417, 1932
◌ SHUKLA P.R, SKEA J., SLADE R., AL KHOURDAJIE A., VAN DIEMEN R., MCCOLLUM D., PATHAK M., SOME S., VYAS P., FRADERA R., BELKACEMI M., HASIJA A., LISBOA G., LUZ S., MALLEY J., « Climate Change 2022 : Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change », Cambridge University Press, 2022
◌ SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, 2006
ARTICLES DE REVUE SCIENTIFIQUE :
◌ ARGOD Pascale, « Du road movie au – voyage sauvage - : la quête d’aventure sur la route et le mythe du voyageur héroïque », Via tourism review, 2018
◌ ASTIER Claire, « Sublime : les tremblements du monde », Critique d’art, 2016
◌ BARABEL Michel, MAYOL Samuel, MEIER Olivier, « Les médias sociaux au service du marketing territorial : une approche exploratoire », Management et Avenir n°32, p. 233-253, 2010
◌ BERTHONNET Arnaud, « L’électrification rurale ou le développement de la fée électricité au cœur des campagnes françaises dans le premier XXè siècle », Histoire et Sociétés Rurales, p. 193-219, 2003
◌ BONIN Sophie, « Au-delà de la représentation, le paysage », Strates, janvier 2004
◌ COURBEBAISSE Audrey, « Esthétique(s) de la répétition dans la conception architecturale », Dans REYNES Laurent, « La plastique dans la conception architecturale », Éditions universitaires européennes, 2020, p. 108
◌ DERAMOND Sophie, DURAND Marc-Antoine, « Les infrastructures dans la littérature française contemporaine. Vers une poétique/ critique des marges. », Dans LAMBERT-BRESSON Michèle, TERADE Annie, « Paysages du mouvement. Architecture des villes et des territoires XVIIIè – XXIè siècles. », Éditions recherche / Ipraus, 2016
◌ EVETTE A., CAVAILLÉ P., LAVAINE C., « Quelle biodiversité pour les ouvrages de protection de berges de rivières de montagne ? » Dans « Génie végétal en rivière d’altitude ou à forte pente : recherches, applications et lacunes, p. 17, juin 2010
◌ GUIBERT Christophe, PAUL Anaëlle, « Usages et intérêts différenciés des espaces maritimes et fluviaux patrimonialisés. Les cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et du canal de Nantes à Brest », NOROIS, 2013
HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011
◌ LE CALVEZ Caroline, « Rétablir la libre circulation piscicole dans les vallées fluviales : mise en perspective des enjeux et des aménagements à partir du cas de l’Aulne (XIXèXXè siècles) », NOROIS, 2015
◌ MEZOUED Aniss M., KAUFMANN Vincent, NASDROVISKY Boris, « Vers un retour de la lenteur et des communs ? », Espaces et sociétés n°175, avril 2018
◌ MONAQUE Rémi, « Le blocus de Brest par les Anglais au début du consulat : Latouche-Tréville anime la défense » p. 83-93 Dans BOIS Jean-Pierre, « Défense des côtes et cartographie historique. Actes du 124e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques », Milieu littoral et estuaires, 1999
◌ PETER Pauline, « Du fleuve au canal : enquête sur le patrimoine fluvial du Blavet (Bretagne) du Moyen Âge à nos jours », Revue Archéologique de l’Ouest, 2021.
◌ POSTIC Fanch, LAURENT Donation, SIMON Jean-Francois, VEILLARD Jean-Yves, « Reconnaissance d’une culture régionale : la Bretagne depuis la Révolution », Ethnologie Francaise n°33, p. 381-389, 2003
◌ POUTHIER François, « Paysages d’estuaire(s), des artistes et des habitants co-producteur d’un bien commun patrimonial et passeurs de territoires ? », Paysages et patrimoines, 2016
◌ STRIFFLING-MARCU Alexandrina, « Inscription architecturale dans le territoire. Les gares en série », Cahier thématiques n°20, janvier 2022
◌ VERDIER Nicolas, « Les formes du voyage : cartes et espaces des guides de voyage », In Situ, juin 2011
ARTICLES DE PRESSE :
◌ « De Nantes à Brest : l’histoire d’un canal de 364 km de long », Ouest-France, octobre 2014
◌ HUET Yann-Armel, « A Pontivy, ils ont été les derniers soldats à cheval », OuestFrance, septembre 2014
◌ GOUEROU Christian, « Le canal, la voie bleue de l’ardoise », Ouest-France, mai 2019
◌ SIGOURA Isabelle, « Ascenseur à bateaux à Guerlédan : une étude sur la pertinence du projet », Ouest-France, octobre 2021
◌ LICOYS Capucine, « Le canal de Nantes à Brest, 180 ans d’histoire », Ouest-France, Aout 2022
◌ « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre 2006
◌ « Les veilleurs du canal : bénévoles et participatifs », Le Télégramme, octobre 2005
◌ L’HOURS Dimitri, « Tourisme. Le canal de Nantes à Brest à la côte », Le Télégramme, aout 2019
◌ « Les méga-bassines, vraie parade aux sécheresses ou aberration environnementale ? », La Montagne, novembre 2022
◌ « Le Blavet au fil de l’eau… (2/3) : les industries fluviales », [en ligne], Ici et là, 2018
CONFERENCES :
◌ Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, « Colloque L’eau : Un projet de territoire – Paola Vigano », centre des congrès de Lyon, 29 novembre 2013
◌ EUROPAN, « Europan Forum Day 3 : Lecture by Paola Vigano », Polydôme de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2022.
VIDEO :
◌ ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017
MEMOIRE :
◌ EMERIAU Justine, « La vallée de l’Erdre de la rivière, aux plateaux agricoles », ENSAPBX, février 2022
◌ « Présentation du canal de Nantes à Brest » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022
URL: https://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/presentation-du-canal-de-nantes-abrest/006678aa-7848-4c14-a633-a59828e97ab3
◌ « Bief de partage, dit -la Grand Tranchée- ou – Tranchée de Glomel - » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022
URL: https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/bief-de-partage-dit-la-grande-tranchee-ou-tranchee-de-glomel/a7891bad-b8bb-4c4e-ae01-fea81a129ef1
◌ « Canal du Blavet, les déversoirs », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022
URL: https://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/canal-du-blavet-les-deversoirs/e86b319ea95c-4d46-973e-bf8667c27e40
◌ « Maison liées à l’activité du canal de Nantes à Brest : maison éclusière, maison portuaire, maison de barragiste, maison de cantonnier », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022
URL: https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/maisons-liees-a-l-activite-du-canal-de-nantes-a-brestmaisons-eclusieres-maison-portuaire-maisons-de-barragiste-maisons-de-cantonnier/d19c80a4-986e-4dd9-ae62b28d0ade7137
◌ « Usine hydroélectrique, coatigrac’h (Saint-Coulitz) », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 08.12.2022
URL: https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/usine-hydro-electrique-coatigrac-h-saint-coulitz/27c26adadd18-4dca-83df-798420838a55
◌ « Viaduc de l’Aulne et voie ferrée, Guily Glaz (Port-Launay) », [en ligne], patrimoine. bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 06.12.2022
URL: https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/viaduc-de-l-aulne-et-voie-ferree-guily-glaz-port-launay/ c7e8c0df-e352-480e-91a6-e3b319bf8a5e
◌ « -Suivant le fleuve- : trois expositions et un parcours immersif à découvrir » [en ligne], muuuz.com, mis en ligne en avril 2022, consulté le 08.12.2022
URL: https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/arts/8531-suivant-le-fleuve-trois-expositions-et-un-parcours-immersif-a-decouvrir.html
◌ « Le Temps Fleuve » [en ligne], jeremieleon.com, mis en ligne en 2012, consulté le 08.12.2022
URL: https://jeremieleon.com/Le-Temps-Fleuve-1
◌ « L’art des Rives », [en ligne], atlasofplaces.com, mis en ligne en octobre 2018, consulté le 08.12.2022
URL: https://www.atlasofplaces.com/photography/rhodanie/
◌ « 7 septembre 1811 : Pose de la première pierre du canal de Nantes à Brest » [en ligne], bcd.bzh, mis en ligne en novembre 2016, consulté le 16.11.2022
URL: https://bcd.bzh/becedia/fr/7-septembre-1811-pose-de-la-premiere-pierre-du-canal-de-nantes-a-brest
◌ « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022
URL: https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/les-millesimes-du-patrimoine/le-canalde-nantes-a-brest
◌ « Grande tranchée des bagnards », [en ligne], cirkwi.com, mis en ligne en 2020, consulté le 24.11.2022
URL: https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/1167839-grande-tranchee-des-bagnards
◌ « La tranchée des bagnards – Canal de Nantes à Brest », [en ligne], cotesdarmor. com, mise en ligne inconnue, consulté le 24.11.2022
URL: https://www.cotesdarmor.com/fr/fiche/patrimoine-naturel/la-tranchee-des-bagnards-canal-de-nantes-a-brestglomel_TFOPNABRE0220HA625B/
◌ « Rigole d’Hilvern », [en ligne], cotesdarmor.com, mise en ligne inconnue, consulté le 24.11.2022
URL: https://www.cotesdarmor.com/fr/fiche/patrimoine-naturel/rigole-d-hilvern-saint-caradec_TFOPNABRE0220HA6303/
◌ « Le canal de Nantes à Brest – Le petit canal », [en ligne], valderdre.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 30.11.2022
URL: http://valderdre.fr/wrdp/canal_petit/
◌ « Glomel, la tranchée des bagnards », [en ligne], canauxdebretagne.org, mis en ligne en 2019, consulté le 30.11.2022
URL: https://www.canauxdebretagne.org/canaux-de-bretagne_association_adherents_fiche_625.htm
◌ « Jules DUCLOS », [en ligne], portaitsepia.fr, mis en ligne en 2022, consulté le 30.11.2022
URL: https://www.portraitsepia.fr/photographes/duclos-2/
◌ « Notice du recueil - Canal de Nantes à Brest- image fixe numérisée », [en ligne], catalogue.bnf.fr, mis en ligne en octobre 2007, consulté le 30.11.2022
URL: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384932516
◌ « Histoire fluvio-maritime du Pays de Redon et Basse Vilaine », [en ligne], amarinage. com, mise en ligne inconnue, consulté le 05.12.2022
URL: https://amarinage.com/histoires-fluvio-maritime-pays-de-redon-et-basse-vilaine/
◌ « L’architecture des maisons éclusières du Canal de Nantes à Brest », [en ligne], canal-nantes-brest.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 05.12.2022
URL: https://canal-nantes-brest.fr/architecture-maisons-eclusieres/
◌ « Les procédés : la tannerie », [en ligne], inventaire.poitou-charentes.fr, mis en ligne en juin 2017, consulté le 06.12.2022
URL: https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/1028-les-procedes-la-tannerie
◌ « La pêcherie royale de Pont-Christ », [en ligne], andre.croguennec.fr, mis en ligne en février 2012, consulté le 07.12.2022
URL: http://andre.croguennec.pagesperso-orange.fr/pecherie.htm
◌ « Un peu d’histoire », [en ligne], lacdeguerledan.com, mis en ligne en 2014, consulté le 07.12.2022
URL: http://www.lacdeguerledan.com/Guerledan-2015/Un-peu-d-histoire
◌ « Le barrage de Guerlédan », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 08.12.2022
URL: https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/un-objet-des-histoires/le-barrage-deguerledan
◌ « Samuel Hense », [en ligne], hanslucas.com, mis en ligne en 2022, consulté le 07.12.2022
URL: https://hanslucas.com/shense/series
◌ « Charles Le Roux 1814-1895 », [en ligne], charlesleroux.com, mise en ligne inconnue, consulté le 08.12.2022
URL: http://www.charlesleroux.com/Charles_Le_Roux/Charles_Le_Roux_-_Biographie.html
◌ « Maxime Maufra », [en ligne], museothyssen.org, mis en ligne en 2022, consulté le 09.12.2022
URL: https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/maufra-maxime
◌ AULNAS Patrick, « Paul Sérusier », [en ligne], rivagedeboheme.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 10.12.2022
URL: https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-19e-siecle/paul-serusier-et-les-nabis.html
◌ MAINGON Claire, « Les Nabis en 3 minutes », [en ligne], beauxarts.com, mis en ligne en mars 2019, consulté le 10.12.2022
URL: https://www.beauxarts.com/grand-format/les-nabis-en-3-minutes/
◌ « Roger de La Fresnaye (1885-1925) La tentation du cubisme », [en ligne], museepaul-dini.com, mis en ligne en octobre 2018, consulté le 10.12.2022
URL: https://www.musee-paul-dini.com/expositions/roger-de-la-fresnaye-1885-1925-la-tentation-du-cubisme/
◌ « Roger de La Fresnaye », [en ligne], larousse.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 10.12.2022
URL: https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Roger_de_La_Fresnaye/152870
◌ TOURCHON Olivier, « Canal de Nantes à Brest : Traversée fluviale du Finistère entre nature et patrimoine », [en ligne], bateaux.com, mis en ligne en février 2022, consulté le 12.12.2022
URL: https://www.bateaux.com/article/39194/la-navigation-sur-le-canal-de-nantes-a-brest-dans-sa-partie-finisterienne
◌ « Atlantic Coast Route », [en ligne], eurovelo.com, mise en ligne inconnue, consulté le 13.12.2022
URL: https://fr.eurovelo.com/ev1
◌ « La charte nationale de qualité », [en ligne], petitescitesdecaractere.com, mis en ligne en 2018, consulté le 13.12.2022
URL: https://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/la-charte-nationale-de-qualite
◌ « La cueilleuse », [en ligne], lacueilleuse.com, mise en ligne inconnue, consulté le 14.12.2022
URL: https://lacueilleuse.com/home/lelieu/
URL: https://batelleriebretonne.piwigo.com/
































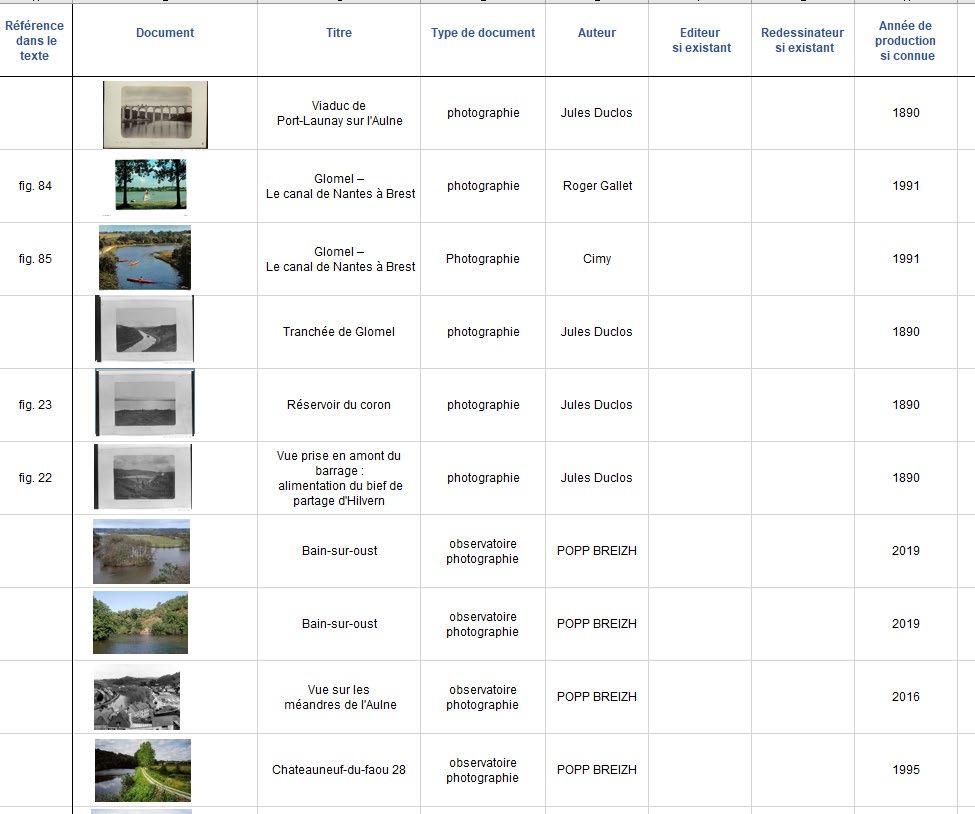
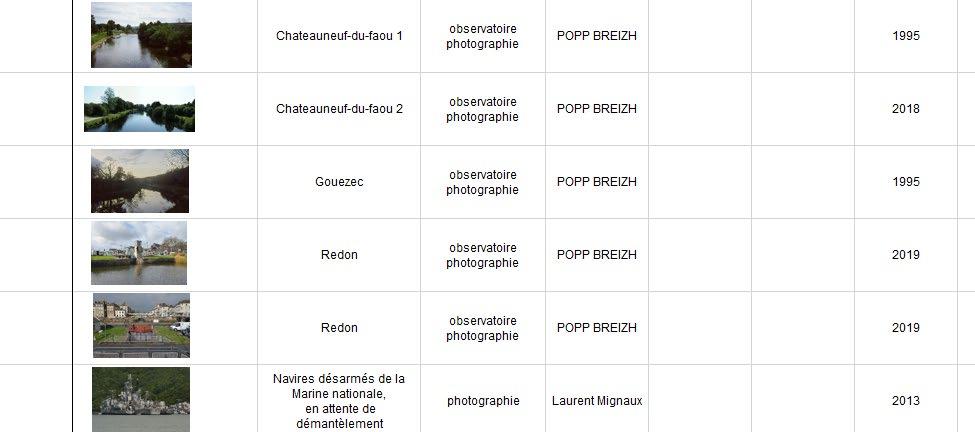





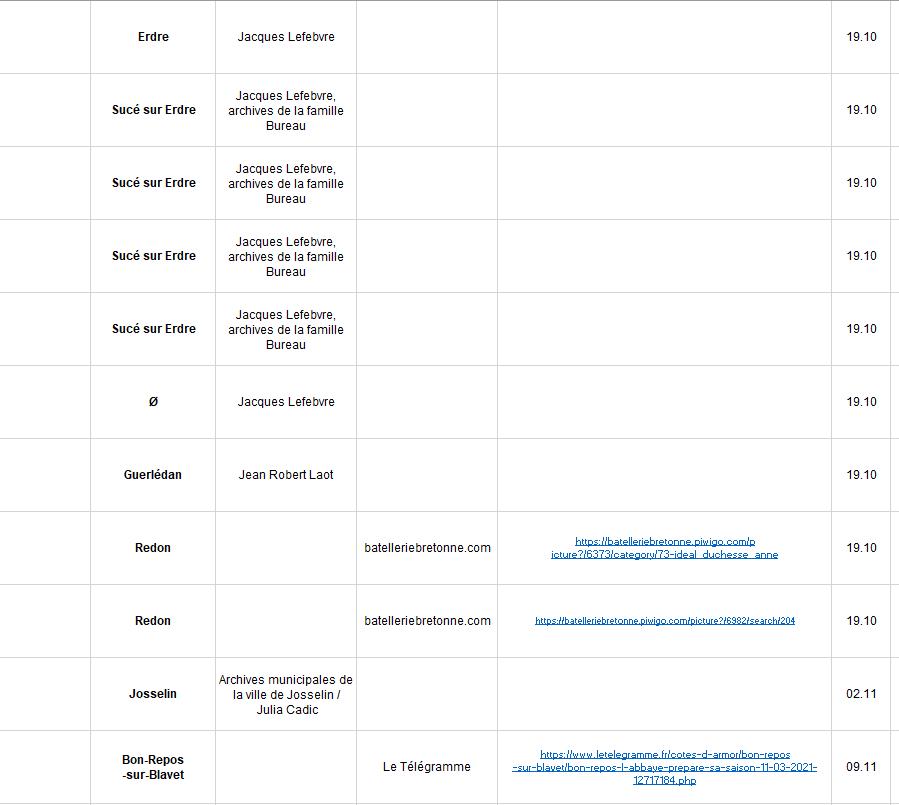














Port-Launay le 28.10.2022












Reconduction, 28.10.22
Reconduction, 28.10.22
ARCHIVES LE DORÉ, Port-Launay vue de la promenade, 2013










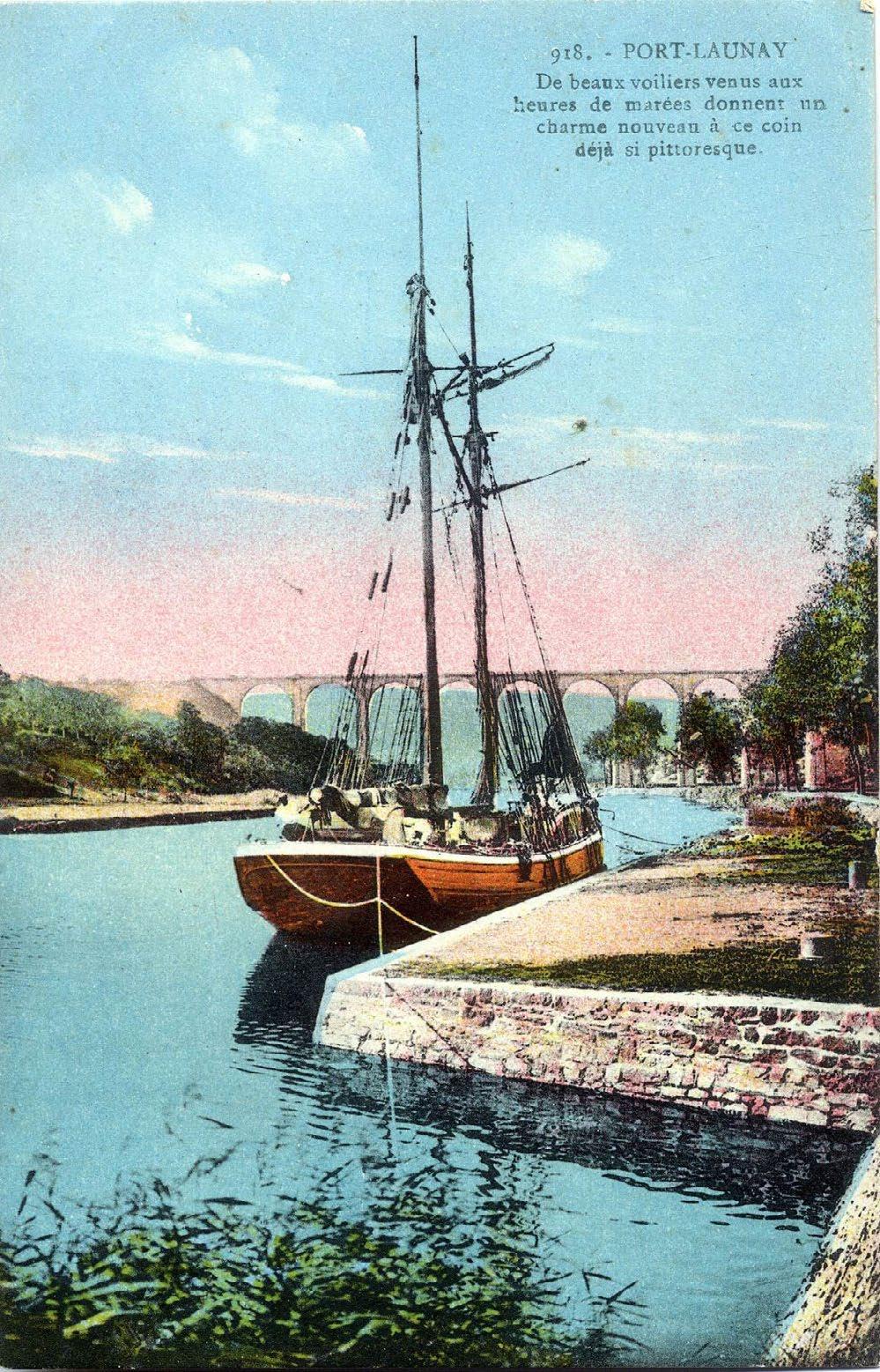


























































































Ouvrages de référence et sites utiles
Patrimoine.bzh : Ce site est un portail de la Région lié à l’inventaire du patrimoine culturel en Bretagne. On y recense de nombreux fonds et notamment le fond de Silguy, composé de documents de conception du canal. Plans, profils et élévations, mais aussi des plans de parcellaire ayant trait à l’expropriation des riverains sur les terrains réquisitionnés par les travaux. Un second fond a quant à lui trait au recensement des maisons éclusières du canal de Nantes à Brest, à leur diagnostic et à leur identification192. Il comporte en plus des maisons éclusières une maison portuaire, à Redon, ainsi que deux maisons de barragistes liés aux ouvrages d’approvisionnements en eau du canal de Coronc et Bosméléac, ainsi que quatre maisons de cantonniers, associés à la rigole d’Hilvern.
Batelleriebretonne.com : Ce site internet tenu par l’Association des Amis de la Batellerie de l’Ouest à Redon compile 5692 photographies et cartes postales anciennes, toutes spatialisées sur les canaux de Bretagne ou la partie de la Loire entre Angers et son Estuaire. Cette source ne concerne pas uniquement le sujet d’étude du canal de Nantes à Brest, il faut donc vérifier la locali-
192 « Maison liées à l’activité du canal de Nantes à Brest : maison éclusière, maison portuaire, maison de barragiste, maison de cantonnier », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022
sation des archives. Ces photographies sont extrêmement bien classées dans près de 150 différents albums. Ces albums regroupent pour la plupart toutes les photographies connues d’embarcations bien précises, le titre de l’album en portant le nom. Cependant quelques albums dépeignent des phénomènes, comme les crues et certaines fêtes ou encore des lieux précis du canal, chantiers navals, et villes importantes. L’association s’est attardé à légender de manière extrêmement précise chaque photographie, des informations sont disponibles sur le nom des passagers et pilotes de chaque embarcation ainsi que les liens familiaux qui les unissent : « Dans le canal de Nantes à Brest la famille Henry pose pour la photo sur LA LORRAINE 1re, à la barre Baptiste le père, son fils Jean Baptiste avec un balai, la femme de Baptiste et à droite Gustave le 2e fils de Baptiste et un jeune garçon ? »
Artmajeur.com : Ce site est simplement un portail d’achat et de vente d’objets d’art à travers le monde. Près de 1.000.000 d’œuvres y sont recensés, certaines de grands peintres, mais aussi beaucoup d’artistes locaux beaucoup plus modestes. C’est donc une ressource très intéressante pour accéder à cette seconde catégorie d’œuvre d’artistes plus ou moins débutants, mais qui n’ont pas de véritable renommée dépas-
sant la ville ou la région. Leur enracinement quasi systématique dans le territoire qu’ils habitent fond de leurs œuvres des descriptions uniques de lieux peu représentés.
Photothèque TERRA : Portail des ministères de la transition écologique, de la Cohésion des territoires et de la mer, la photothèque TERRA est un fond servant à illustrer les politiques publiques dans les domaines de la « biodiversité, logement, climat, économie circulaire, transports, urbanisme ». Un reportage photo est ici particulièrement intéressant, il concerne les boucles de l’Aulne maritime, situé géographiquement à l’embouchure du canal de Nantes à Brest dans la rade de Brest.
Delcampe : Delcampe est un site internet de vente d’objets d’art de collection entre particuliers. Le site est spécialisé dans les timbres, les anciennes monnaies et surtout les cartes postales. Cette dernière catégorie est particulièrement intéressante, elle regorge en effet de très nombreuses cartes anciennes représentant différentes sections du canal de Nantes à Brest.
Mairie de Port-Launay : Ces documents concernent particulièrement le viaduc ferroviaire de Port-Launay. Les documents sont des plans, sections, élévations et détails expliquant le projet de viaduc, mais aussi sa mise en œuvre. En effet, construire un édifice de 357m de long nécessitant pas moins de 22 arches demande de lourds efforts193 Le reste de l’envoi se constitue de photographies d’époque et de cartes postales.
Mairie de St-Coulitz : La commune de St-Coulitz a la particularité de bénéficier d’une usine hydro-électrique. Ils possèdent donc les documents liés à la conception de l’ouvrage.
René Guillaume : Cet interlocuteur a pu me faire parvenir des documents concernant la construction d’une usine hydro-électrique à Saint-Martin sur Oust. Elle est nommée la Née. À savoir qu’une partie des documents sont plus tardifs et concernent des modifications effectuées et des réparations nécessaires.
Jacques-Henry Lefebvre : Il s’agit ici d’archives personnelles et notamment de photographies de la famille Bureau.
Mairie de Josselin : La mairie de Josselin a pu me faire parvenir un ensemble de photographies, dessins, gravures et cartes postales représentant la ville de Josselin et surtout son château.
Bibliothèque de Châteaulin : La bibliothèque possède une collection de peintures de la rivière Aulne à Châteaulin à des stades différents de son aménagement. Certains documents représentent même le VieuxPont, un édifice détruit en 1821 et remplacé par des ouvrages plus récents, notamment construits par Jean-Marie De Silguy.
Loïg Le Callonec : Loïg Le Callonec a pu fournir un ensemble de cartes nautiques servant à la navigation des chalands et à leur repérage le long de l’itinéraire.
193 « Viaduc de l’Aulne et voie ferrée, Guily Glaz (Port-Launay) », [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 06.12.2022
Exposition de la collection Le Doré : Cette exposition de plein air prend place sur les quais de Port-Launay. Elle se compose d’un ensemble de photographies anciennes et de
cartes postales tirées des archives Le Doré.
Kader Benferhat : Kader Benferhat immigre en France dans les années 70, il est originaire d’une Oasis saharienne. Aujourd’hui très impliqué dans les instances de gestion de l’eau au niveau régional, il découvre tout d’abord le Canal de Nantes à Brest par la préservation de la Rigole d’Hilvern avant d’écrire plusieurs livres sur ce sujet . La rigole d’Hilvern 1828-1838, Polycopie, 1983 ; Guerlédan, Polycopie, 1986 ; Le Canal de Nantes à Brest, Iconoguide Ouest-France, 1995 ; Le Canal de Nantes à Brest, Éditions Ouest-France, 1999.
Laurianne et Jacques Clouteau : C’est en 1995 que Jacques Clouteau arpente pour la première fois au côté de son âne le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest. Il décide à la fin de ce voyage d’écrire l’un des premiers guides pour touristes sur le sujet : le guide du Randonneur 360km, Éditions du vieux crayon. Il sera réédité pour être actualisé de nombreuses fois. Dans cet ouvrage les auteurs tracent tout d’abord un jeu de cartes qui décompose le canal en cases de 2km par 6km. Des informations pratiques sont alors ajoutées aux cartes : Les gués, les bourgs les auberges ou s’arrêter, les différents hôtes avec des estimations de prix pour la nuit. Certains monuments remarquables comme de vieux clochers sont aussi repérés. Tous ces éléments sont représentés par des sigles repris de la signalétique de l'autoroute. Ce choix peut s'expliquer par une volonté d'efficacité de compréhension, ces sigles étant connus par tout le monde.
permis de révéler une partie de l’histoire du canal, les travaux de la tranchée de Glomel. Il s’agit cependant d’un roman qui ne s’attache donc pas à l’exactitude des faits historiques. Il s’agit donc d’une source à écarter pour ce travail de mémoire, même s’il est important de la citer afin de recontextualiser l’état de la littérature sur le sujet.
Thierry Guidet : Le canal : à pied de Nantes à Brest, Édition La Part Commune, 1991 est un ouvrage écrit par Thierry Guidet après avoir arpenté lui-même l’entièreté de l’itinéraire à pied. Il ne s’agit pas ici d’un guide de voyage ni d’un roman, mais plutôt du témoignage d’une expérience personnelle marquante qui est ici narrée.
Jacques Guillet : De Nantes à Brest, les gens du canal, Édition Coop Breizh, 2015 aborde le sujet du canal de Nantes à Brest par un angle particulier : celui des carnets de bords des anciens mariniers. Ce travail d’archive est secondé d’un carnet de voyage.
Jean Kergrist : Il est l’auteur du roman Les Bagnards du canal de Nantes à Brest : La vie au camp de Glomel, Édition des montagnes noires, 2011. Cet ouvrage a

BLOTIN Paul
Directeurs d’étude: Jean-Baptiste Marie & Victoria Mure-Ravaud
janvier 2023
Voulu par Napoléon pour désenclaver une Bretagne assiégée, le canal de Nantes à Brest est le chantier majeur de la région au XIXè siècle. Cet ouvrage impressionne par sa taille, 364 km mais aussi par les systèmes hydrauliques qu’il déploie au travers de pas moins de 238 écluses. La Bretagne, intérieure, le territoire dans lequel il s’implante, verra passer les ingénieurs bretons, arriver les bataillons de bagnards impériaux et naviguer les premiers chalands de la nouvelle batellerie bretonne.
L’histoire du canal de Nantes à Brest est l’histoire de la relation entre l’Homme et le territoire, entre aménagement, exploitation et délaissement. Alors, l’Homme n’a jamais cessé de représenter ce territoire, pour communiquer une vision à ces semblables, planifier un aménagement ou documenter une scène de vie. Ce mémoire s’intéresse aux représentations du canal, leurs auteurs, leurs intentions qu’elles soient ou non artistiques et leurs fins. Il se concentre donc à exposer un vaste corpus iconographique hétérogène, qui, malgré sa non-exhaustivité, témoigne des imaginaires du canal de Nantes à Brest.
Au travers de trois chapitres compilant peintures, cartes, photographies, documents d’ingénieries, cartes postales et de nombreux autres médiums, nous sommes invités à découvrir un lent panorama de la Bretagne intérieure, road-movie le long du chemin de halage.
