

VOUS ATTENDEZ UN ENFANT ? ORDONNANCE VERTE
deux séances de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens
paniers de légumes bio locaux offerts chaque semaine pendant votre grossesse

Infos et inscriptions :
strasbourg.eu/ordonnance-verte
Renseignez-vous auprès de votre médecin
ISLANDE MERVEILLES
Patrick Adler, directeur de publication« Une destination n’est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. »
HENRY MILLER, ÉCRIVAIN (1891-
1980)
Destinations de légende.
Voilà sous quel titre Jean-Luc Fournier nous prit déjà dans ses bagages par le passé, chers lecteurs d’Or Norme.
Ainsi vous visitâtes entre autres destinations, la Namibie, Israël ou encore la Thaïlande
Nous renouons, dans ce dernier numéro de l’année, avec cette envie irrépressible de vous faire découvrir de nouveaux horizons, mais aussi d’aller à la rencontre de l’autre.
Grâce à Solveen Dromson, Consule d’Islande à Strasbourg, et à l’occasion de la présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, notre invitation au voyage prend la direction plein Nord, à la découverte d’un pays merveilleux et encore méconnu, l’Islande donc.
Sur presque quarante pages de ce numéro exceptionnel qui en compte 164, vous allez
découvrir des merveilles, en Islande certes, mais aussi à Paris avec ces « Expos TGV » que vous aimez retrouver chaque mois de décembre dans notre magazine.
Munch, Kokoschka, Monet, Mitchell, entre autres, vont également vous donner l’envie de vous échapper pour un voyage, certes moins lointain, mais tout aussi scintillant.
Mais la destination peut être bien plus proche : SurréAlice et Illustr’Alice, respectivement au MAMCS et au Musée Ungerer, nous feront traverser le miroir du monde de Lewis Carroll d’une façon bien originale et à découvrir jusqu’au 26 février 2023.
Nous avons voulu, avec ce numéro de fin d’année, vous emmener ailleurs, et à l’instar de sa magnifique photo de couverture, allumer quelques magiques lumières et vous souhaiter de magnifiques et réconfortantes fêtes de fin d’année.
Par84 « Le lien avec les auteurs est essentiel dans le métier d’éditeur. »

Robot
Franck Horand
l’Alsace
Apéro mortel La mort se dépoussière (↑) 6-11 b Grand entretien Jean-Luc Barré
Le digital nomadism Nouvel eldorado des générations Y – Z


La Caténaire Plus qu’un Tiers lieu...
Islande La nature en V.O. (→) Carnet de route 56 dans l’Est Reykjavik

62
Micro-capitale, méga plaisir… Ces Alsaciens
66
Sous les aurores boréales La belle histoire 76 Partir, se trouver, revenir… L’Islande à Strasbourg
80
82
La Halle gourmande réussit son pari
Amenez vos vinyles... et écoutez l’amer au LAÀB
Factoryyy Contre l’obsolescence dans l’Industrie
Le parti-pris de Thierry Jobard
Chronique Moi, Jaja…
Actualités E Société 144 Événement Or Norme 146 Des bouteilles pleines de vie Atelier Sglà’s
88 SOMMAIRE DÉCEMBRE 2022 12-34 c Dossier Expos TGV 14 Musée d’Orsay Edvard Munch 18 Musée d’Art Moderne de Paris Oskar Kokoschka 22 Fondation Louis Vuitton Monet et Mitchell 26 Centre Pompidou Alice Neel 30 Musée Maillol Hyperréalisme 32 MAD Années 80 (←) 34 Hôtel de Ville de Paris Capitale(s) 4 №47 — Décembre 2022 — Merveilles

De 1972 à 2022, 50 ans de service client. Notre résolution
pour 2023 ?
Toujours être à vos côtés pour réaliser vos projets et construire ensemble un avenir serein.

Découvrez nos vœux













Jean-Luc Barré
Profession : éditeur
Ce n’est pas si souvent, au fond, qu’on peut recueillir les paroles d’un éditeur, cette profession dont les contours exacts restent assez mystérieux pour le profane amoureux des livres et des auteurs. Rencontre avec l’un d’entre eux, Jean-Luc Barré (Éditions Bouquins), connu comme le loup blanc sur la place de Paris et qui sera présent à la session de janvier des Bibliothèques idéales avec deux de ses récents auteurs, Jean-Pierre Elkabach et Guillaume Durand…
L’entretien avait été convenu dans l’appartement privé de Jean-Luc Barré à Paris. Au cœur de l’île Saint-Louis, l’éditeur y vit en étant littéralement cerné par les livres, partout omniprésents, bibliothèques, étagères, table basse du salon…
La simple évocation des maisons d’édition, avec lesquelles il a collaboré (ou publié) depuis son arrivée dans la capitale à peine ses vingt ans sonnés, situe bien son niveau d’expertise : Plon, Fayard, Perrin, Stock, Grasset, Robert Laffont… Chez cette dernière, il est devenu, en 2008, directeur de la célébrissime collection Bouquins, succédant à Daniel Rondeau. Et depuis deux ans, il dirige sa propre maison d’édition au sein du groupe Éditis. Comme un judicieux et délicieux clin d’œil, il a œuvré pour qu’elle s’appelle Bouquins et d’entrée, il a publié La Nef des fous de Michel Onfray, le volume de correspondances de Jean d’Ormesson, Des messages portés par les nuages et Les Lettres inédites de Rilke à une jeune poétesse. Une belle entrée en matière pour une des plus jeunes maisons d’édition, que Jean-Luc Barré évoque avec, en permanence, la passion dans la voix…
Les Éditions Bouquins ont été créées il y a deux ans maintenant, vous en êtes le directeur, mais vous dirigiez auparavant la Collection du même nom au sein de Robert Laffont. Que s’est-il passé ?
C’est très simple. En accord avec le groupe Editis dont fait partie Robert Laffont, j’ai obtenu mon autonomie et je dirige en effet désormais cette nouvelle maison d’édition, Bouquins, incluant naturellement la collection éponyme. La plupart des auteurs dont je publiais les livres chez Robert Laffont – Michel Onfray, Catherine Nay, Frédéric Martel, Jean-Marie Rouart, entre autres – me sont restés fidèles. Le lien avec les auteurs est essentiel dans le métier d’éditeur, dont la valeur humaine dépasse la logique comptable auquel on le réduit trop souvent. J’ai eu la chance, de surcroît, de pouvoir fonder cette nouvelle maison avec toute l’équipe qui était déjà à mes côtés, renforcée par l’arrivée de deux jeunes éditeurs de grande qualité.
J’imagine qu’une des premières questions qui s’est posée était de savoir comment s’appellerait cette nouvelle maison… Bien sûr… Dans un premier temps, on a longuement discuté du fait qu’il fallait éviter l’ambiguïté qui aurait pu exister entre deux structures portant le même
lien
nom. Après avoir écarté d’emblée l’option qu’on m’avait proposée d’une maison qui se serait appelée « Jean-Luc Barré Éditions » et beaucoup phosphoré pendant tout un week-end sur d’autres éventualités, je me suis dit qu’il existait déjà une enseigne emblématique, qui allait de soi, qui était enracinée et que tout le monde connaissait, c’était évidemment Bouquins. Au départ, je savais qu’il faudrait compter avec un risque de confusion, car, dans ce pays, si on adore le changement, tout le monde s’effraie dès qu’il se produit… Tout le monde a bien compris aujourd’hui que la maison d’édition Bouquins et la Collection du même
nom obéissent à une identité distincte et, qu’elles se distinguent notamment par le format, le papier bien sûr, mais aussi par le fait que l’une s’inscrit davantage dans la création ou la réflexion immédiate et l’autre dans le patrimoine littéraire et intellectuel. Leur point commun est d’embrasser tous les domaines, mémoires, essais, romans français ou étrangers et même les beaux livres comme on peut le voir avec celui de Guillaume Durand qui vient de remporter le Renaudot Essais. La seule chose nouvelle, au fond, ce sont les passerelles établies entre les deux entités, à travers les œuvres de Michel Onfray, Catherine Nay, Pascal Ory entre autres…
Le
avec les auteurs est essentiel dans le métier d’éditeur, dont la valeur humaine dépasse la logique comptable auquel on le réduit trop souvent. »
Au vu de votre long parcours, et de vos succès aussi, on peut imaginer que cette nouvelle aventure constitue un défi qui ne vous déplait pas…
Cette étape est logique, pour moi. Je n’ai jamais été ce qu’on appelle un carriériste : j’ai écrit des livres, travaillé pour la radio et la presse. J’ai fait de la politique, également. J’ai tout appris sur le terrain, en quelque sorte. Au début des années 80, quand j’ai commencé à travailler dans ce milieu, je n’ai pas emprunté la voie classique des jeunes éditeurs dont le travail essentiel consiste à travailler sur un manuscrit pour le modeler en prévision de sa publication. J’avais déjà envie de prendre des voies
qui ne semblent pas, a priori, les plus ordinaires… Mon apprentissage a donc commencé par ces liens un peu particuliers qu’il faut savoir établir avec les auteurs, ce qui est l’essence même du métier d’éditeur. Il ne limite pas à un simple contrat qu’on passe avec un auteur dont on attend ensuite patiemment le rendu de sa copie. C’est évidemment une alchimie très différente qui doit s’opérer et cette première expérience m’a beaucoup apporté. Elle m’a permis de me situer plus près de la naissance d’un livre et de mieux comprendre par quelles souffrances, par quelles angoisses, par quelle patience passe l’auteur au moment d’écrire puis de livrer son manuscrit…
Puisqu’on est là sur le plan de l’intimité profonde entre un auteur et son éditeur, peut-être peut-on souligner que pour nombre de duos auteur/éditeur, il s’agit de parvenir à un moment où la complicité est telle que l’auteur finisse par trouver très légitime le fait que l’éditeur intervienne sur le manuscrit pour essayer de polir au plus près sa pensée…
Vous avez raison, c’est très exactement ça. J’ai connu en particulier deux éditeurs qui ont beaucoup compté pour moi, Nicole Lattès et Claude Durand, le PDG de Fayard, qui a été mon maître dans ce métier. Il m’a appris à quel point l’éditeur peut devenir indispensable à l’auteur. L’écriture est un métier de solitaire : certes, on se réveille le matin et on s’impose une régularité dans l’écriture, mais on finit aussi tôt ou tard envahi par le doute ou le découragement en se demandant pour qui au juste on écrit… je pense sincèrement que si je suis un éditeur, disons pas trop mauvais, c’est parce que je suis aussi un auteur. Claude Durand l’était. Jean-Marc Roberts aussi. Ce cas est hélas moins fréquent aujourd’hui…
Puisque vous évoquez votre activité d’auteur, on va rappeler que vous avez écrit une biographie de François Mauriac dont les deux volumes ont été unanimement salués comme une œuvre remarquable par la critique, mais on se doit bien sûr aussi d’évoquer votre rencontre avec Jacques Chirac. Avec l’ex-président de la République, vous avez entretenu une relation absolument privilégiée en rédigeant avec lui ses Mémoires, parus en 2009 et 2011 et qui se sont vendus à plus de 500 000 exemplaires. Outre le fait que l’univers politique de Jacques Chirac ne vous était pas inconnu puisque vous aviez envisagé un temps une carrière politique sous la bannière du RPR, vous n’avez pas hésité longtemps pour vous lancer dans ce travail qui, à l’évidence, allait marquer votre parcours d’écrivain…
C’est Nicole Lattès, alors directrice de Robert Laffont, qui m’a informé, peu avant un diner à son domicile, que Jacques Chirac cherchait quelqu’un pour l’accompagner dans l’écriture de ses Mémoires. Elle m’a proposé de le faire. Moi qui suis assez fasciné par les grands hommes en général, j’ai dû mettre une seconde et demie à lui dire oui ! C’est d’ailleurs à cette époque-là, on doit être début 2008, que Daniel Rondeau a annoncé qu’il quittait la direction de la Collection Bouquins. Et je me revois encore, sortant d’une réunion avec Nicole Lattès où nous avions parlé du livre de Jacques Chirac

dans son bureau, revenir illico sur mes pas et lui dire : « Au fait, Nicole, je suis candidat pour Bouquins… » Le poste était très convoité, quantité de candidats avaient écrit des lettres de candidature, pas moi, qui a réagi à l’instinct. Je suis donc devenu directeur de la Collection l’année suivante tout en terminant l’écriture du premier volume des Mémoires de Chirac.
Parlons-en de ce travail avec l’exprésident. Vous ne l’aviez jamais approché personnellement durant sa longue carrière politique. Dans ce contexte aussi particulier de la fin de sa carrière politique qui était récente, et pour tout dire
de la fin de sa vie tout court, comment aborde-t-on la collaboration puis le travail avec une telle personnalité ? Et, plus précisément, comment pétrit-on cette matière brute qu’il ne cesse de vous délivrer pour que soit au final publié un livre à la hauteur de ses ambitions ?
Jacques Chirac ne se considérait pas comme un auteur, mais c’est lui qui a apporté l’essentiel de ce livre, ses souvenirs, ses réflexions sans quoi rien n’aurait pu être écrit. Se trouver devant lui était souvent impressionnant, mais j’aimais et admirais cet homme de longue date et j’étais bien sûr au courant de son état de sa santé que je savais fragile. Je me suis rendu compte

qu’en fait, il n’avait aucune envie d’écrire ses Mémoires et que c’est Claude, sa fille, qui l’avait beaucoup poussé en ce sens. J’ai donc dû commencer par le convaincre de l’intérêt qu’il y avait à les écrire. Comme il était très souvent dans l’autodérision, il me disait en rigolant : « Vous devriez signer le livre vous-même, on mettrait “en collaboration avec Jacques Chirac” et ça ferait l’affaire. De toute façon, ça ne se vendra pas, je n’intéresse plus personne… » Bon, on a quand même vendu ses Mémoires à 500 000 exemplaires… J’ai très vite compris que j’étais dans la position d’un acteur qui, pour entrer dans son rôle, doit savoir se dédoubler. Attention, je ne dis pas que je me prenais pour Jacques Chirac, mais je me suis senti quelque part tenu d’entrer dans sa peau pour parvenir à atteindre notre but. Il fallait absolument que je comprenne tous les ressorts de cet homme et la manière dont il aurait pu s’exprimer s’il avait écrit lui-même son livre. Que je parvienne à une forme de communion qui me permette de restituer sa voix, son ton, sa façon de s’exprimer. C’était assez difficile avec Chirac : il y avait chez lui cette espèce de gouaille, en privé, qui ne pouvait évidemment pas être restituée telle quelle dans ses Mémoires, et une forme d’humour qu’il fallait préserver sans perdre de vue que l’homme qui s’exprimait avait occupé les plus hautes fonctions. Il fallait restituer tout ça et je crois que nous y sommes parvenus. Mais après lui, j’ai refusé toute autre collaboration du même genre parce que cette expérience était restée à mes yeux unique et irremplaçable. L’idée de travailler avec un historien et non un journaliste l’a rassuré, de surcroît.
À l’époque, nous en avions parlé tous les deux. Et j’avais été alors frappé par ce qui sautait aux yeux : vous l’aimiez, cet homme…
Oui, profondément. Je trouvais qu’il avait été un bien meilleur président de la République qu’on avait bien voulu dire. Je l’ai toujours trouvé digne de la fonction. Force est de constater que ce fut plus rarement le cas après lui. Non seulement j’aimais Jacques Chirac, mais j’avais adhéré au RPR dès l’âge de dix-huit ans, nous avions le gaullisme en commun, même si le sien était davantage teinté de pompidolisme. Le personnage m’avait toujours intrigué et je m’étais souvent dit que je devais écrire sur cet homme qu’on ne connaissait pas, au fond. Il faut dire qu’il ne faisait rien pour qu’on le connaisse mieux. Il y avait l’homme public puis l’homme tout court, loin, très loin derrière. C’est sur le tard qu’on a fini par savoir qui il était vraiment : aujourd’hui,
« Moi qui essaie d’être romancier, mais qui suis aussi biographe, et qui ai
des ressorts intimes des individus, c’est sans doute ce qui m’a le plus intéressé chez Jacques Chirac. »
quand je vais au musée du quai Branly, je sais que Jacques Chirac est là. Il est là dans ce monde qui était son monde intérieur. En écrivant ce livre, j’ai aimé un homme dont je cherchais à résoudre l’énigme, en quelque sorte. Nous avons pu terminer ses Mémoires avant que la maladie ne l’affaiblisse trop et ne finisse par l’emporter quelques années plus tard. Je voyais bien que quand j’arrivais dans son bureau, il était content que je sois là. Notre travail en commun a fini par le galvaniser et il l’a été encore plus avec le succès du premier tome, en 2009. Sa confiance envers la suite du projet s’en est trouvée renforcée. Deux ans plus tard, à la fin du second volume, il était encore bien, mais il devait alors affronter son procès. Il y tenait absolument avec ce côté « cheval fou » qu’il gardait encore malgré le grand âge et qui affolait ses proches. En juin 2011, il a quand même réalisé un acte de transgression incroyable en appelant à voter pour François Hollande contre Sarkozy. Je l’avais pressenti, cette volonté de battre le président sortant, je l’avais vue mûrir. Ce fut son dernier acte politique, une manière de signifier qu’il était toujours en vie. Ensuite, il n’a pas pu se rendre à son procès, il a été condamné sans bien comprendre pourquoi et il s’est enfoncé alors dans une longue nuit durant laquelle il n’avait plus aucune raison de se battre…
Au final, que vous aura appris le fait de côtoyer aussi longuement et intensément un tel homme d’État ?
Cela m’a appris à toujours essayer de voir au-delà des apparences, cela m’a donné une plus grande curiosité encore pour comprendre les ressorts secrets des gens de pouvoir. Moi qui essaie d’être romancier, mais qui suis aussi biographe, et qui ai cette curiosité des ressorts intimes des individus, c’est sans doute ce qui m’a le plus intéressé chez Jacques Chirac. J’ai compris à quel point on peut construire tout un destin sur à peu près le contraire de ce que l’on est profondément. Elle a été là, la tragédie de Chirac. C’est un homme qui n’a pas construit sa vie sur ce qu’il souhaitait ou aimait, mais sur ce qu’il s’est laissé imposer. C’est le mystère de la construction de soi, que j’avais déjà abordé avec un livre sur le général de Gaulle, comment on se construit quand on est un tel homme politique et comment tout ce parcours peut être jalonné de malentendus et de contresens. C’est en cela que j’ai parfois senti chez lui un homme moins heureux qu’il voulait le laisser paraître.
Je voudrais terminer en recueillant vos sentiments sur le monde de l’édition. Ce secteur est aujourd’hui traversé par des événements considérables, lié à la
cession du groupe Éditis, auquel votre maison d’édition Bouquins appartient, cette cession devant permettre à Vincent Bolloré de prendre définitivement le contrôle du groupe Lagardère et de son fleuron, Hachette.
La direction d’Éditis m’a fait confiance pour diriger une des maisons qui lui appartiennent encore à l’heure où nous nous parlons. J’ai pris un jour un petitdéjeuner avec Vincent Bolloré et il m’a expliqué pourquoi il s’intéressait au monde de l’édition. Sa mère avait été lectrice chez Gallimard, son oncle l’un des fondateurs des éditions de La Table Ronde après la Libération. Pour autant, je n’ai jamais été associé à son projet de fusion avec Hachette, qui ne relevait pas de mes compétences. Ce que je puis dire, en revanche, c’est que depuis deux ans, je n’ai jamais subi la moindre pression de qui que ce soit à l’intérieur du groupe. J’ai toujours pu agir sur le plan éditorial avec une liberté et une autonomie totales. Je ne suis pas sûr que j’aurais trouvé les mêmes dans d’autres maisons présumées vertueuses. Ceci dit, comme tout le monde, je souhaite qu’on retrouve très vite une stabilité indispensable à notre propre équilibre professionnel, à la qualité de nos relations avec les auteurs et à la réussite de nos objectifs communs… » b
cette curiosité
EXPOS TGV
Munch, Kokoschka, Monet, Mitchell, Neel, Street Art, Hyperréalisme …

Le cru Paris-2022 est exceptionnel !
Comme chaque début d’hiver, revient l’immense plaisir de vous inciter à visiter durant les fêtes de fin d’année les grandes (et moins grandes…) expos de la capitale, désormais si facilement accessibles grâce au précieux TGV. Sur les cimaises des musées parisiens de cette fin d’année, l’art scintille de toutes parts. Réservez train et hôtel, on s’occupe du reste, marchez sur nos pas…

MUSÉE D’ORSAY
Edvard Munch, le merveilleux indocile
C’est bien sûr l’expo-événement de cette fin d’année à Paris et les impressionnantes files de visiteurs qui se forment sur le parvis d’Orsay sont là pour attester de la réelle attente du public concernant un des monstres sacrés de la peinture du début du XXe siècle. Par la grâce d’un accrochage d’une rare pertinence, « Edvard Munch, un poème de vie, d’amour et de mort » est une expo qui se vit avec un plaisir infini, chaque visiteur ayant bien conscience qu’on côtoie là le plus précieux d’une époque quasi indépassable de l’histoire de l’art…
Une confirmation, tout d’abord : le célébrissime Le Cri n’est pas là (mais une petite lithographie l’évoque). Inutile, cependant, de chercher des poux dans la tête des promoteurs de l’expo d’Orsay, la prestigieuse toile est désormais sertie pour toujours dans l’écrin du tout nouveau Musée Munch d’Oslo, ce spectaculaire bâtiment de verre et d’acier, reconnaissable entre mille par son plan incliné supérieur, qui domine de ses soixante mètres de haut la capitale norvégienne qui vient de l’inaugurer. De toute façon, depuis son vol en 2004 (en même temps qu’une autre toile très connue du peintre norvégien La Madone) et, deux ans plus tard, le retour des deux œuvres retrouvées (mais pas les voleurs), Le Cri est devenu un véritable trésor national et ne voyage plus.
Son absence est parfaitement assumée et on ira même jusqu’à dire qu’elle permet de braquer les projecteurs sur l’œuvre prolifique (plus de 1 700 toiles, dessins,
lithographies en près de soixante ans…) du maître norvégien.
Libérée du carcan de cette toile emblématique mondialement connue, la commissaire de l’exposition (et toute nouvelle directrice du musée de l’Orangerie) Claire Bernardi nous offre le magnifique cadeau de nous présenter une centaine de toiles et de dessins constituant un formidable aperçu de la totalité de l’œuvre du peintre norvégien.
La maladie, la folie et la mort
Edvard Munch fut le contemporain septentrional des Kandinsky et autres Klimt, Schiele, Kokoshka (lire l’article page 18), tous acteurs de l’Art moderne, cette période bénie de l’histoire de l’art. Pour autant, largement autodidacte, il est au final inclassable puisqu’on décèle dans sa peinture des influences naturalistes, impressionnistes, fauvistes, lui, qu’on considère aussi comme un des précurseurs de l’expressionnisme.
L’expo parisienne d’Orsay montre bien son indocilité et sa grande liberté esthétique, Munch se préoccupant uniquement, en dehors de toute contrainte, de fixer sur une multitude de supports sa vision personnelle et intime du monde et de la vie.
Ainsi, les thématiques morbides traversent toute son œuvre. Dans un de ses innombrables carnets de notes, Munch écrit : « La maladie, la folie et la mort étaient les anges noirs qui se sont penchés sur mon berceau ». Comment pouvait-il en être moment : la tuberculose lui enlève sa mère alors qu’il est seulement âgé de cinq ans, cette même maladie faisant disparaitre, dix ans plus tard, Sophie, sa sœur ainée. À l’âge adulte, Laura, une autre de ses sœurs, sera internée à vie pour d’intenses troubles psychiatriques et son frère Andrea décédera brutalement d’une pneumonie, à l’âge de vingt-cinq ans. Parmi d’autres, quatre œuvres symbolisent cette importante et incontestable part de noirceur : une lithographie de L’enfant malade (la
toile originale date de 1885-86) où la mort s’apprête à engloutir une pauvre enfant au visage diaphane, Désespoir (1892) où l’on retrouve le ciel tourmenté du Cri accablant la forme d’un homme sans visage qui fixe le noir qui coule sous la rambarde d’un pont, le célébrissime tableau Soirée sur l’avenue Karl-Johan (1892) avec le défilé des bourgeois des rues de Christiana devenus des spectres aux visages sans expression mangés par des yeux fixes et inhabités et enfin, Vampyr (1895) cette somptueuse allégorie de la cruauté de l’amour, cette toile superbement traversée par la lumière provenant de la crinière rousse qui dévore…
Toute l’œuvre d’un géant…
Heureusement, l’exposition d’Orsay, dans son souci de présenter la palette complète des talents de Munch, propose également, en majesté, les « extérieurs » du peintre norvégien, si délicatement matérialisés

« L’exposition d’Orsay, dans son souci de présenter la palette complète des talents de Munch, propose également, en majesté, les “extérieurs” du peintre norvégien. »
par Les jeunes Filles sur le pont (1927) –a-t-on mieux qu’Edvard Munch réussi à fixer sur une toile la lumière si particulière des régions septentrionales ? – ce tableau étant aussi prolongé par une superbe gravure sur bois, prouvant l’universalisme de la démarche de l’artiste, répétant souvent les mêmes motifs et les mêmes thématiques en peinture, en gravure, en sculpture… Sans prétendre rivaliser à distance avec l’exhaustivité de la plus belle des expositions jamais montées sur Munch (c’était en 2003 pour la réouverture de l’Albertina de Vienne avec toutes les toiles majeures de l’œuvre du Norvégien, dont Le Cri, et une invraisemblable kyrielle de Madone sur tous les supports possibles, huile sur toile, fusain, gravure, sculpture sur bois…), l’expo parisienne s’attache formidablement à rendre hommage à un artiste réellement hors du commun.

Indocile, vous dit-on : en 1937, 82 de ses toiles se verront classées (quel hommage !) comme « art dégénéré » par l’Allemagne nazie. Sept années plus tard, sous l’occupation de la capitale norvégienne par l’armée allemande et malgré la soumission quasi totale des édiles municipaux d’alors, la Norvège organisera pour son peintre emblématique des obsèques quasi nationales.
Ultime touche de raffinement : la coédition avec la RMN d’un petit livre, Mots de Munch, où, en regard de la plupart des œuvres du maître norvégien, figurent ses innombrables citations. Parmi elles, celle-ci, datant de 1930, « Nous ne mourons pas, c’est le monde qui meurt et nous abandonne »… c
EDVARD MUNCH, UN POÈME DE VIE, D’AMOUR ET DE MORT
Jusqu’au 22 janvier 2023 Musée d’Orsay Paris (7e)
Tél. : 01 40 49 48 14 du mardi au dimanche, de 9h30 à 18h, le jeudi jusqu’à 21h45
Accès : Métro ligne 12, station Solférino
Billetterie (prudent de réserver) : www.musee-orsay.fr
Entrée de 10 € à 16 € (bravo pour ces prix modérés !)
Rosa Bonheur, la star de la peinture animalière
Orsay fête le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, cette dessinatrice-virtuose et peintre légendaire du règne animal.


MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS c DOSSIER – EXPOS TGV PARIS
Si elle existait, sa collection de passeports dirait tout du destin d’Oskar Kokoschka, lui qui fut successivement de nationalité austrohongroise, tchécoslovaque, britannique et enfin autrichienne, au fil des événements de ce XXe siècle qui ont bouleversé l’Europe. L’anecdote ne vaut pas que pour son originalité : c’est bien l’engagement permanent qui a dicté les pérégrinations géographiques de ce peintre peu montré en France et à qui le Musée d’Art Moderne de Paris offre enfin l’exposition qui lui manquait dans notre pays…
Oskar Kokoschka, Le joueur de transe (Ernst Reinhold), 1909

S
on nom scintille pour l’éternité parmi ceux des fameux Sécessionnistes viennois fédérés par Gustav Klimt dès la toute fin du XIXe siècle et qui créèrent de toutes pièces le mouvement de l’Art nouveau, cet écrin brillantissime d’une inoubliable kyrielle d’œuvres majeures. Oui, à peine âgé d’une vingtaine d’années, Oskar Kokoschka se mesurait déjà avec les Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser, les architectes Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich et Otto Wagner et une flopée d’artistes réunis autour du concept d’art total au sein du Wiener Werkstätte (L’Atelier d’Art de Vienne).
L’oubli est donc réparé et on le doit à Fabrice Hergott, l’ex-directeur des Musées de la Ville de Strasbourg, poste qu’il quitta en 2006 pour justement prendre la direction du Musée d’Art Moderne de Paris. Depuis, dans la capitale européenne, le départ de Fabrice Hergott reste unanimement regretté par toutes celles et ceux qui aiment l’art…
Ce sont donc près de 150 toiles et œuvres sur papier qui rendent enfin
18 c DOSSIER — Expos TGV №47 — Décembre 2022 — Merveilles

hommage à Oskar Kokoschka dans les immenses salles du musée de l’avenue du président Wilson, à deux pas du Trocadéro. Bien sûr, elles couvrent toutes les époques de l’œuvre de l’artiste, les toutes dernières étant aussi bien représentées que ses premiers pas viennois.

Un engagement total
Il y a donc Vienne, jusqu’à la Première Guerre mondiale. La Grande Faucheuse n’aura pas voulu d’Oskar Kokoschka qui, grièvement blessé à deux reprises, réussit néanmoins à survivre. En 1916, démobilisé, il rejoint son galeriste Paul Cassirer qui œuvre à Berlin puis il enseigne à Dresde jusqu’en 1923. Dans la décennie suivante, ponctuée par de nombreux séjours à Paris et à Londres, villes où il était strictement inconnu avant sa venue, il voyagera beaucoup, en Europe, mais aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Son retour à Vienne, en 1932, assoira sa notoriété devenue internationale. Mais c’est à Prague qu’il résidera ensuite pendant quatre ans, cette capitale de la Tchécoslovaquie qu’il fuira également, sentant arriver l’occupation nazie. À Londres de 1938 à 1946, il finira par se fixer en Suisse jusqu’à sa mort en 1980 à l’âge de 94 ans.
C’est peu dire que, si peu casanier, le sécessionniste viennois fut marqué également par ces deux terribles guerres
mondiales des années de plomb du XXe siècle durant lesquelles son engagement fut total. Engagé volontaire en 1914 puis farouche opposant aux hordes nazies montantes à la fin des années trente ce qui lui valut de figurer parmi les artistes de l’art dégénéré en 1937, un an après qu’une de ses toiles se vit découpée au couteau par un abruti apprenti-gestapiste à Vienne. Beaucoup de ses toiles ont par ailleurs disparu ensuite, lors des spoliations antisémites.
À Paris et à Londres, on releva son nom parmi les adhérents des associations venant en aide aux artistes allemands en exil. Après la guerre, Kokoschka continua son parcours militant, s’opposant à la prolifération de l’arme nucléaire, affichant sans relâche son pacifisme et soutenant avec force l’Union européenne alors naissante. Jusqu’à sa mort, sa rage de peindre ne faiblira pas et il ne cessera d’affirmer jusqu’au bout sa conviction que la peinture, par sa subversion, est une arme essentielle pour lutter contre les dictatures.
OSKAR KOKOSCHKA, UN FAUVE À VIENNE
Jusqu’au 12 février 2023 Musée d’Art Moderne de Paris 11 avenue du président Wilson Paris (16e)
Tél. : 01 53 67 40 00 du mardi au dimanche, de 10h à 18h, le jeudi jusqu’à 21h30
Accès : Métro ligne 9, stations Iéna ou AlmaMarceau
Billetterie : www.mam.paris.fr Entrée de 12 € à 16 € (bravo là encore pour ces prix modérés !)
L’expo du Musée d’Art Moderne de Paris fait la part belle à ses fameux portraits qui le firent connaître dans le monde entier, particulièrement ceux manifestement
inspirés des techniques et couleurs des Nolde, Kirchner et autres artistes du mouvement Die Brücke créé à Dresde en 1905.
D’entrée, dès le seuil de l’expo, on découvre le portrait de son ami Ernst Reinhold, un comédien, qui nous hypnotise avec son étrange regard bleu, mais on se sent très vite perturbé par les quatre phalanges boursouflées de sa main gauche, apparaissant comme une puissante griffe animale…
Une grande partie de l’œuvre de OK (sa signature emblématique) échappe pour beaucoup à la compréhension usuelle, car ses toiles sont souvent autant d’allégories assez mystérieuses où le grotesque le dispute à la colère et même la rage. C’est cet engagement permanent, presque atavique, qui fit déboucher le peintre autrichien en pleine lumière et qui, aujourd’hui, frappe par sa modernité au point que beaucoup de ses œuvres d’après-guerre pourraient de nos jours figurer sans problème sur les cimaises des plus grands rendez-vous mondiaux de l’art contemporain.
Rien de cela n’a échappé à Fabrice Hergott, qui cite dans son avant-propos publié dans le catalogue de l’exposition, la formule de l’écrivain autrichien de l’entredeux-guerres Karl Kraus selon laquelle « le grand mensonge qu’est l’art parvient à dire la vérité ». L’œuvre de Oskar Kokoschka est une des plus belles illustrations de la pertinence de ce propos… c
Oskar Kokoschka, Londres – Petit paysage de la Tamise, 1926« Ce grand mensonge qui parvient à dire la vérité… »


Joan Mitchell, la peintre expressionniste abstraite américaine est née en 1925, à peine deux ans avant la disparition du père de l’impressionnisme, Claude Monet. Et pourtant, magie de l’art et du talent de la directrice artistique de la Fondation Vuitton, l’impressionnante Suzanne Pagé, le vieux lion et la viscérale anticonformiste se sont enfin rencontrés à l’aube de la troisième décennie de ce XXIe siècle. Outre la rétrospective de l’artiste américaine au niveau -1 de la Fondation, le dialogue Monet/Mitchell se dévoile sur les trois niveaux supérieurs du bâtiment et le tout surprend et émerveille…

Avant tout, il faut faire part d’une intense émotion que tous les amateurs d’art qui visiteront la Fondation Vuitton d’ici le 27 février prochain vivront comme un cadeau précieux et incroyable.
Dans la monumentale Galerie 9 de la Fondation, un mur immaculé et immense accueille le majestueux triptyque L’Agapanthe, peint par Claude Monet vers la toute fin de sa vie, à partir de 1914, dans le cadre de ce qu’il a appelé « Les Grandes Décorations ». Monet a fait construire un atelier spécial pour pouvoir créer ces très grands formats dont aucun ne sera jamais montré avant sa mort, douze années plus tard. « Dès lors, il ne représentera plus le monde tel qu’il le voit, mais il imagine un monde de peinture. Produire des œuvres pleines d’harmonie est pour lui une forme de résistance au chaos de la guerre » dit Marianne Mathieu, directrice scientifique du Musée Marmottan Monet qui a contribué à l’événement de la Fondation Vuitton. Oui, il faut sortir les superlatifs pour
faire partager l’émotion suscitée par cette œuvre quasi incroyable. Les trois panneaux constituent un triptyque de treize mètres de long pour une hauteur de deux mètres ! Monet a mis dix ans pour le réaliser, modifiant et remodifiant plusieurs fois la composition de ce bassin de nymphéas où domine un mauve lavande d’une infinie douceur…
Mais le plus ahurissant est ailleurs : cette œuvre n’a non seulement jamais été vue par le public français sur le territoire national, mais ses trois éléments ont été réunis par Suzanne Pagé en provenance de trois musées américains différents. Le premier a été expédié par le Saint-Louis Art Museum qui en a fait l’acquisition en 1956. Le second, celui du milieu, est arrivé en provenance du Nelson-Atkins Museum de Kansas City qui en est devenu propriétaire en 1957. Enfin, la troisième partie du prestigieux triptyque a été acquise par le Cleveland Museum of Art en 1960. Tour à tour, se prêtant mutuellement leurs

« Oui, il faut sortir les superlatifs pour faire partager l’émotion suscitée par cette œuvre quasi incroyable. »Joan Mitchell Two pianos
acquisitions, ces trois institutions ont accueilli la totalité de l’œuvre à la fin des années 1970, avant que la Royal Academy of Art de Londres en fasse de même, en 2016, dans une présentation en U des trois éléments.
Presque un siècle après sa réalisation en France par Claude Monet, L’Agapanthe peut donc enfin être vu à Paris dans son intégrité. C’est évidemment un événement considérable et unique… et le public peut donc enfin admirer sans compter les grands espaces colorés par ces « radeaux de nénuphars » comme le dit Suzanne Pagé « et la grande liberté dans les touches, la subtilité de palette, avec des notes pêche, lavande, roses, lilas. Monet est parti d’une représentation réaliste pour aboutir à un résultat presque abstrait » complète-t-elle.
Enfin, la rencontre…
La prouesse de la reconstitution originelle de L’Agapanthe s’inscrit donc dans le cadre de cette formidable rencontre Monet – Mitchell. La peintre expressionniste abstraite américaine n’avait certes que deux ans quand Claude Monet rendit son dernier soupir, mais, déjà reconnue sur la scène américaine de l’après-Seconde Guerre mondiale, elle s’enticha très vite de Paris en multipliant les aller-retour entre la France et son atelier de Saint Mark’s Place à New York. À l’évidence pour finir de marquer sa farouche indépendance, elle s’installa définitivement dans la capitale française, rue Frémicourt, au début des années soixante.

Elle qui avait toujours tenu à imposer son propre rythme et dicter ses propres règles ne pouvait certes pas ignorer la peinture de Monet, plébiscitée depuis longtemps par les États-Unis qui le considérèrent très tôt comme le précurseur du modernisme américain.
Joan Mitchell avait-elle en tête les conditions d’une rencontre encore plus intime avec Claude Monet quand, en 1968, elle décida de s’établir à Vétheuil, à l’orée de la Normandie, dans une propriété, La Tour, sertie dans une nature si superbe que les paysages qui l’entouraient n’allaient plus jamais cesser ensuite de l’inspirer ?
Le plus extraordinaire est cependant ailleurs : quand les yeux de Joan Mitchell embrassaient les panoramas qui s’offraient à ses yeux, elle fondait alors son regard avec celui de Claude Monet qui, pendant quatre ans, jusqu’en 1881, vécut dans une maison à quelques centaines de mètres en contrebas de la propriété de l’Américaine !
C’est cette magie-là qu’on retrouve sur les murs de la Fondation Vuitton, cette couleur qui interfère en permanence avec la lumière, l’eau dont les effets miroirs sont archiprésents chez les deux artistes (Le bassin aux nymphéas pour lui, la Seine pour elle) et surtout, bien sûr, les grands formats (depuis toujours pratiqués pour elle et enfin affrontés à la fin de sa vie, pour lui).
Quand on sait cela, on est en permanence à la recherche de cette complicité à des décennies de distance et souvent, elle saute aux yeux. C’est plus qu’émouvant de voir leurs paysages se fondre dans ces océans de couleurs, tout en douceur chez Monet avec l’application de frottis monochromes, beaucoup plus brutalement chez Mitchell dont les touches énergiques ont scandé l’ensemble de l’œuvre.
Cette expo unique ne doit pas être ratée. On a envie de dire « Merci Mme Pagé » d’avoir su diriger notre regard vers la magie du travail de ce couple improbable, mais si formidablement réuni… c
MONET-MITCHELL
Jusqu’au 27 février 2023 Fondation Louis Vuitton 8 Av. du Mahatma Gandhi Paris (16e)
Tél. : 01 40 69 96 00
En période de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 9h à 21h ainsi que les samedis et dimanches. Le vendredi de 9h à 23h.
Accès : Navette (payante) au départ du haut de l’avenue de Friedland (face au n° 44), près de l’Étoile.
Billetterie : www.fondationlouisvuitton.fr
Entrée de 5 € à 16 € Billet famille panachable.
Claude Monet Nympheas, 1910/1918«
I am the century - Je suis le siècle » avait coutume de dire Alice Neel née en janvier 1900 et décédée en 1984. Trop longtemps occultée de son vivant, la peintre réaliste américaine se voit enfin offrir sa rétrospective en France. Et c’est une démarche provocatrice intense et ininterrompue que le Centre Pompidou expose sur ses cimaises, une recherche permanente de la vérité qui n’aura jamais craint de bousculer durant des décennies. C’est bluffant…

Il suffit de lire le récit des trois premières décennies de Alice Neel pour comprendre cette rage qui l’a habitée quasi en permanence et qui, à l’évidence, a rugi sur ses peintures, de la première à la dernière.
Née donc avec le XX e siècle en Pennsylvanie, elle intègre dès ses dix-huit ans la Philadelphia School of Design, non sans avoir servi son pays en tant que secrétaire au sein de l’Army Air Corps. En 1924, elle se marie avec Carlos Enriquez, un artiste cubain. Tous deux s’installent à Cuba où nait leur fille deux ans plus tard. Santillana del Mar ne vivra qu’un an, emportée par la diphtérie alors que le couple venait juste de rentrer à New York.
L’année suivante nait une seconde petite fille, Isabetta, mais deux ans plus tard, Enriquez rentre brutalement à Cuba, enlevant Isabetta à l’affection de sa mère. Désespérée, Alice Neel tombe dans une grave dépression et tente de se suicider. Elle séjournera pendant un an dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes à la veille du krach de 1929 et son cortège de malheurs…
Témoigner des délaissés de la société…
Dès 1931, Alice Neel entamera son long parcours artistique, sans doute déjà bien mûri par une farouche volonté de peindre envers et contre tout. Elle vivra un autre dramatique épisode en 1934 quand son compagnon d’alors brûlera ses dessins et lacèrera ses tableaux, suite à une crise de jalousie. Se relevant une fois de plus, elle se met alors à peindre d’innombrables portraits de toutes les classes sociales vivant autour d’elle à New York, de ses proches aussi –amis, amants, voisins, artistes, poètes, critiques d’art – mais aussi des délaissés et ignorés de la société – les immigrés latinos et portoricains, les Noirs, les petites frappes n’ayant que la rue pour royaume sans oublier, effet miroir, les mères de famille élevant seules leurs enfants.
CENTRE POMPIDOU c DOSSIER – EXPOS TGV PARIS 26 c DOSSIER — Expos TGV №47 — Décembre 2022 — Merveilles
Alice Neel, Rita and Hubert, 1954Dans les années 50, elle n’échappera pas à l’inquisition de la Commission McCarthy. Elle sera longuement interrogée puis inquiétée par le FBI en raison de sa proximité avec le parti communiste américain.
Parallèlement à cette vie qui ne la ménage pas, elle continue à peindre avec ce style engagé et quasi brutal qui est le sien, affrontant crânement la bonne société américaine de l’époque. Bien entendu, elle n’a ainsi que peu de chance de voir ses toiles achetées par les mécènes newyorkais d’alors, mais, pour autant, elle ne cède rien. En 1963, elle expose enfin à la Graham Gallery qui la représentera pendant les vingt années suivantes.
Alice Neel ne cessera jamais de militer, dénonçant notamment l’absence d’artistes femmes et africains-américains dans l’exposition The 1930’s. Panting and sculpture in America au Whitney Museum of American Art. Elle s’élève l’année suivante contre l’absence d’artistes noirs dans l’expo Harlem on My Mind au MoMA.

En 1970, le vent commence enfin à tourner : son portrait de la féministe Kate Millet fait la une du Times Magazine, la plus belle vitrine que l’Amérique d’alors pouvait offrir à un artiste. Andy Wahrol pose pour elle puis, en 1974 (elle a alors 74 ans !) survient la consécration : le Whitney Museum lui offre sa première grande rétrospective (un beau succès). Dès lors, Alice Neel fera l’objet de toutes les attentions, y compris internationales.
En 1983 sortira sa première monographie, mais, atteinte par le cancer, la rebelle rassemblera ses dernières forces pour recevoir le célèbre photographe Robert Mapplethorpe qui capturera son visage quelques jours seulement avant sa disparition, le 13 octobre.
Une femme libre et indépendante
Une telle vie conditionne bien sûr toute l’œuvre d’un artiste. L’expo parisienne a été montée par Angela Lampe, conservatrice
« Elle continue à peindre avec ce style engagé et quasi brutal qui est le sien, affrontant crânement la bonne société américaine de l’époque. »
au Musée national d’Art Moderne intégré au Centre Pompidou. Il suffit de l’écouter parler du choc Alice Neel et de la puissance de ses convictions : « Traversant les périodes de l’abstraction triomphante, du pop art, de l’art minimal et conceptuel, Alice Neel, une femme libre et indépendante, est restée avec sa peinture figurative à contre-courant des avant-gardes qui marquent la scène de New York où elle avait élu domicile au début des années 1930. Habitant dans les quartiers populaires et multiethniques – Greenwich Village d’abord, Spanish Harlem ensuite – Neel, vivant des aides sociales et mère célibataire, se sent proche de ses modèles, auxquels elle cherche à s’identifier. Son engagement n’est jamais abstrait, mais nourri de vraies expériences. Peindre l’histoire sans le filtre d’une proximité intime ne l’intéresse pas. À l’instar de l’œil de la caméra, Neel fait entrer dans notre champ de vision des personnes qui auparavant restaient dans l’obscurité et tombaient dans l’oubli. C’est son premier geste politique. Le second réside dans son choix de cadrage – une frontalité qui interpelle. L’artiste nous place droit devant ses modèles. Avec une grande puissance picturale, Neel nous les impose : regardez-les ! »
L’extrême crudité de l’œuvre de Alice Neel n’est pas occultée dans cette rétrospective française enfin consacrée à la peintre réaliste américaine sans doute la plus marquante de la seconde moitié du XXe siècle.

Jamais sans doute l’expression « la rage de peindre » n’aura été aussi évidente à souligner… c
ALICE NEEL, UN REGARD ENGAGÉJusqu’au 16 janvier 2023 Centre Pompidou Paris (4e)
Tél. : 01 44 78 12 33
Du mercredi au lundi de 11h à 21h
Accès : Métro Ligne 1 Station Hôtel de Villes ou Ligne 4 Station Les Halles, RER A Station Les Halles
Billetterie : www.centrepompidou.fr
Entrée de 12 € à 15 €
« L’extrême crudité de l’œuvre de Alice Neel n’est pas occultée dans cette rétrospective française. »
Ce Garouste qui bouscule nos certitudes
Pompidou consacre pas moins de dix-huit salles à Gérard Garouste, un des plus importants peintres français. Une exposition du vivant d’un artiste (Garouste est aujourd’hui âgé de 76 ans) est bien sûr un événement rarissime et ce sont ainsi dix-sept œuvres majeures (dont certaines sont monumentales) qu’on peut découvrir…
Peut-on (doit-on ?) dissocier la vie et l’œuvre d’un artiste ? Éternel débat. En tout cas, sous le signe de l’étude, mais aussi de la folie, la vie et l’œuvre de Gérard Garouste « l’intranquille » se nourrissent mutuellement en un dialogue complètement saisissant.

Adepte d’une figuration sans concession, le peintre développe depuis toujours le sens énigmatique de ses œuvres et n’hésite pas à mobiliser les grands récits littéraires classiques, telle la Divine Comédie de Dante, qu’il utilise comme une sorte d’introduction aux différents niveaux de lecture biblique.
Depuis le milieu des années 90, Garouste s’est consacré plus que longuement à l’étude du Talmud et du Midrash et, dès le début du siècle actuel, toute sa production artistique a été influencée par cette obsession.
Ses œuvres mobilisent ainsi fortement le regard et la pensée, car elles sont déroutantes, souvent indéchiffrables pour le profane.
Parmi elles, deux moments d’étonnement : La Dive Bacchuc, une immense toile inspirée de Rabelais, tendue sur une sorte de manège en fer battu de 7,52 m de diamètre (!). La toile est peinte sur ses deux faces, la face intérieure ne se découvrant qu’à travers une douzaine d’œilletons répartis sur tout le pourtour de l’œuvre.
Vers la fin de l’exposition, au détour d’un décor du parcours, on est littéralement happé par un immense triptyque de 9 mètres de long, Le Banquet, qui renvoie à de multiples clés de lecture : la fête du Pourim, mais aussi Le Tintoret et même Kafka. Un coup de poing au plexus !

Gérard Garouste
jusqu’au 2 janvier 2023
Centre Pompidou – Niveau 6, galerie 2 Paris (4e)
Tél : 01 44 78 12 33
Du mercredi au lundi de 11h à 21h
Billetterie : www.centrepompidou.fr
ET PUISQUE VOUS ÊTES TOUJOURS AU CENTRE POMPIDOU (BIS)…
Evidence, la belle surprise de Soundwalk Collective & Patti Smith
De la chance de posséder un outil culturel exceptionnel et modulable à souhait : au cœur du Centre Pompidou, un sombre parallélépipède géant accueille une « œuvre totale » surprenante et étincelante inspirée d’un emblématique triptyque de poètes français magnifiés par la voix lancinante de Patti Smith…
Soundwalk Collective est un collectif berlinois d’arts sonores contemporains formé par l’artiste Stephan Crasneanscki et la musicienne Simone Merli. Le collectif développe des projets sonores spécifiques à un lieu ou un contexte à travers desquels il déroule des thèmes conceptuels, littéraires ou artistiques. Soundwalk Collective accumule depuis l’origine les collaborations créatives, hier avec le regretté Jean-Luc Godard, la chorégraphe Sasha Waltz, l’actrice Charlotte Gainsbourg et pour le Centre Pompidou, la chanteuse et l’auteur Patti Smith, qu’on ne présente plus.
Evidence, c’est un parcours visuel et sonore qui tisse un voyage audiovisuel à partir de l’œuvre des poètes français Arthur Rimbaud, Antonin Artaud et René Daumal qui, tous trois, ont voyagé vers divers horizons pour tenter de découvrir une nouvelle perspective d’eux-mêmes et de leur art.
Entre 2017 et 2021, Soundwalk Collective a collaboré à la création de Perfect Vision, un triptyque d’albums qui puise son inspiration dans les textes de ces trois poètes.
Ces trois albums ont été enregistrés respectivement dans la Sierra Tarahumara au Mexique, les montagnes de l’Abyssinie en Éthiopie et au sommet de l’Himalaya en Inde.
Chaque album, restitué par bribes dans le casque wifi dont chaque visiteur est équipé, est revisité par la voix lancinante de Patti Smith. Alors, forcément, même si on ne déambule que sur quelques mètres carrés, on voyage en XXL en réalité et l’expérience est assez fabuleuse, entre sons, films, images de synthèse, un mur d’objets ayant appartenu à ces trois poètes mythiques sans oublier les photographies, les textes et les œuvres de Patti Smith. Ne ratez pas ce moment unique et d’une folle originalité.
Evidence – Soundwalk Collective & Patti Smith
Jusqu’au 23 janvier 2023 – Centre Pompidou – Paris (4e)
Tél : 01 44 78 12 33
Du mercredi au lundi de 11h à 21h
Billetterie : www.centrepompidou.fr
Attention ! L’installation Evidence est accessible au niveau 4 (Galerie 0) du Centre avec le billet d’entrée Collection (de 12 € à 15 €), mais la réservation d’un créneau horaire de visite est impérative et se fait aux guichets principaux au rez-de-chaussée. En même temps, vous recevrez un bon pour l’indispensable casque audio individuel qui vous sera remis à l’entrée de l’installation.

Corps étranger MUSÉE MAILLOL
Après une tournée internationale, de l’Australie à la Belgique en passant par l’Espagne, l’exposition Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, s’installe en France, à Paris, au Musée Maillol et jusqu’au 5 mars 2023. L’occasion de découvrir un courant artistique qui, au-delà de son incroyable technique, impressionne par les questionnements qu’il soulève.

Mouvement apparu aux États-Unis dans les années 60, l’hyperréalisme sculptural fait écho à l’esthétique dominante de l’époque, le Pop art et le photoréalisme. Ici, l’artiste hyperréaliste cherche à atteindre la représentation parfaite de la nature et à créer le trouble auprès du spectateur. Formes, contours, textures, le corps humain est reproduit à l’identique dans un méticuleux travail d’illusion. Pari réussi donc pour cette exposition qui réunit plus de 40 sculptures d’artistes internationaux de premier plan dont : George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde De Bruyckere, Duane Hanson, Carole A. Feuerman, John De Andrea… À peine la visite commencée, on ne sait plus ce qui relève de la copie ou de la réalité (âmes sensibles, s’abstenir) et les visiteurs de parfois sursauter comme dans un musée des horreurs !
Tératologie et eschatologie
Même parfaitement reproduits, ces corps n’en sont pas moins monstrueux, car leur ressemblance et leur permanence nous renvoient à notre condition humaine, changeante et éphémère. C’est là toute la force de l’exposition : montrer ces corps copies, ces corps miroirs qui nous interrogent sur le sens de nos vies. Bronze, plâtre, silicone, résine ou encore polystyrène, les artistes utilisent différents matériaux, toujours à la recherche d’un rendu faisant illusion. Pourtant, la copie pure n’est pas nécessairement la finalité du processus hyperréaliste. Le corps, parfaitement reproduit, est ainsi modifié en profondeur, toujours dans l’idée de révéler son potentiel expiatoire. Corps décapités, étirés, tatoués, en lévitation, anamorphosés, automatisés ou lycanthropes, les mises en scène poussent le dispositif jusqu’au trouble, dans un jeu d’attirance-répulsion qui donne à réfléchir. Mi-fasciné, mi-effrayé, l’on parcourt les salles à la recherche d’un frisson alors que ce sont nos propres peurs qui s’expriment là.
À l’époque de l’onanisme iconophile à grands renforts de selfies, l’exposition Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps recentre le débat et nous prouve que l’existence se trouve par-delà l’apparence.
Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, Musée Maillol, jusqu’au 5 mars 2023
c
« Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail. »
Léonard de Vinci
« Le corps, parfaitement reproduit, est ainsi modifié en profondeur, toujours dans l’idée de révéler son potentiel expiatoire. »
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Indécente décennie
Si l’on considère qu’il faut laisser passer une génération pour pouvoir jeter un œil critique sur le passé, l’exposition Années 80. Mode, design, graphisme en France arrive à point nommé. Le Musée des Arts Décoratifs de Paris propose ainsi jusqu’en avril 2023 une rétrospective des modes d’expression de cette décennie aux idées et à l’esthétique résolument hétéroclites.
C’est accueilli par le portrait de François Mitterrand que l’on débute l’exposition, nous sommes en 1981 et La force tranquille vient de gagner les élections. Tournant politique, mais aussi culturel et donc artistique, les années 80 seront celles du fun et de la prospérité (pour un temps du moins), celles où l’on célèbrera, « le droit à la vie, le droit au bonheur », selon la formule du ministre de la Culture d’alors, Jack Lang… Ce sont ainsi tous les médiums qui seront sommés d’exprimer le potentiel créatif et la réussite à la française. Design, graphisme, publicité, haute-couture, culture underground, tout affiche le clinquant d’une société fric et frime qui s’essaie à la surconsommation. Dans un parcours à la fois historique et ludique, l’exposition du MAD revient sur les grandes figures et les temps forts qui firent les années 80, de Jacques Séguéla (à qui l’on doit justement le slogan gagnant de la Gauche), à la Fête
« L’avant-garde se mue parfois en kitsch et donne à réfléchir sur l’évolution de notre société. »
de la Musique, en passant par les défilés de Jean-Paul Gaultier, les créations de Philippe Starck et les tubes de Lio…
La fête est finie
Si le génie de Jean-Paul Goude ou du collectif Grapus n’est pas à remettre en cause, la nostalgie des affiches, clips publicitaires ou musicaux (dont on connaît encore et toujours les slogans et paroles) n’empêche cependant pas quelques grincements de dents. Sexisme, racisme, certains des codes des années 80 ne passent plus 40 ans après. L’avant-garde se mue parfois en kitsch et donne à réfléchir sur l’évolution de notre société. Enfin, certaines publicités nous rappellent qu’au-delà des tenues extravagantes et des prouesses de l’industrie automobile, les années 80 sont aussi (et surtout), celles du début des ravages du SIDA, campagnes Act Up à l’appui…
L’exposition Années 80 est celle de toutes les générations, du souvenir à la découverte ; elle est celle d’une société qui s’auto-réfléchit à travers ses propres artefacts dans une sorte d’archéologie du présent. Entre carambolage et marché aux puces, la culture de ces années reste malgré tout porteuse de sens, spontanée, libre, éphémère. c
Années 80. Mode, design, graphisme en France, Musée des Arts Décoratifs de Paris, jusqu’au 16 avril 2023

« La passion du siècle, c’est le réel, mais le réel, c’est l’antagonisme. »
Alain Badiou

HÔTEL DE VILLE DE PARIS
Un passionnant panorama du Street Art
« Une expo où on n’apprend rien » : c’est le jugement laconique d’un pseudo site branchouille d’information à propos d’une exposition qui, pourtant, présente avec exhaustivité et rigueur factuelle toute l’évolution du Street Art parisien depuis les années 70 jusqu’à il y a peu. Un conseil pour l’apprenti-critique : « Et si tu te bougeais pour juste aller voir, en laissant tes a priori à l’entrée ? »


CAPITALE(S)
Jusqu’au 13 février 2023
Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau, Paris 4e
Tél. : 01 40 69 96 00
En période de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 9h à 21h ainsi que les samedis et dimanches. Le vendredi de 9h à 23h.
Accès : Métro Ligne 1, Station « Hôtel de Ville »
Billetterie : l’accès est gratuit, mais I’inscription est obligatoire via un module de réservation accessible sur www.paris.fr.
Le billet gratuit est à imprimer et vous sera demandé à l’entrée. Dernier accès à l’exposition : 17h45. Nocturne le jeudi jusqu’à 20h15. Horaire de réservation à respecter impérativement. L’exposition est fermée les dimanches et les jours fériés.
Ce sont plus de 70 artistes dont les productions sont mises en scène sur les deux niveaux de la Salle SaintJean de l’Hôtel de Ville de Paris et, pour être franc, se balader au beau milieu de près de six décennies de créations visuelles souvent ébouriffantes fait un bien fou.
Beaucoup pensent que le Street Art est en fait le principal mouvement artistique de ce début de XXIe siècle. On peut bien sûr discuter éternellement du postulat, mais, pour le moins, l’avis n’a rien de fantaisiste.
Si Londres (Bricklane, Shoreditch, Camden Town et maintenant le prolifique East End…) et Berlin postulent depuis longtemps pour le titre de capitale européenne du Street Art, Paris, sincèrement, n’est pas loin.
Le Street Art et Paris, c’est un couple fantasque qui s’est formé dés les années 1970, lorsque les premiers Éphémère de Gérard Zlotykamien sont apparus sur les palissades du chantier de Beaubourg, près du célèbre « trou des Halles » qui allait plus tard donner naissance à un centre commercial alors prométhéen… Zlotykamien bombait alors en costume trois-pièces, avec un attaché-case dans lequel il cachait sa poire à lavement, ancêtre de la bombe aérosol !
Puis vint 1971 : pour fêter le centenaire de la Commune, c’est le sublime Ernest Pignon Ernest qui peignait son célèbre La Commune ou les gisants (près de 200 sérigraphies noir et blanc, directement appliquées sur les escaliers du Sacré-Cœur, à Montmartre, en hommage aux Communards victimes de la répression versaillaise lors de la Semaine sanglante. Quasi premier acte d’un engagement politique s’insérant dans un lieu, la marque de fabrique d’un véritable génie. L’art envahit alors la rue, bien loin des galeries et des musées… Depuis, bon nombre d’artistes se sont succédé dans les rues et sur les façades d’immeubles de la capitale, bravant la loi et tombant sous le joug de multiples condamnations. C’est tout cela ce que l’expo Capitale(s) donne à voir. Avec Zloty (le pseudo de Gérard Zlotykamien), on y retrouve, entre plein d’autres, la regrettée Miss.Tic (récemment disparue), Jef Aérosol, Blek le rat, Invader, et, plus récemment, Shepard Fairey alias Obey, Jr, ou Codex Urbanus…, autant de noms qui résonnent fort et parlent haut, pour peu que l’on s’intéresse à l’art urbain contemporain ou plus ancien.
C’est la galeriste Magda Danysz qui s’est vue confier le commissariat de cette exposition remarquable. Contrairement à l’avis péremptoire du site branchouille, on y apprend beaucoup et plus d’une fois, on se dit qu’on aurait bien aimé, époque après époque, découvrir tout ça de nos propres yeux depuis le tout début… c

SURRÉALICE ET ILLUSTR’ALICE ALICE DÉCONSTRUITE
Alice a la tête en bas, Alice a le corps coupé en deux, le monde d’Alice est bizarre, inquiétant, autant que l’inconscient d’un enfant. Ce monde est le centre de deux expositions à Strasbourg, l’une au MAMCS quant à l’influence importante de Lewis Carroll (1832-1898) sur les surréalistes, l’autre au Musée Ungerer sur l’illustration d’Alice, notamment par les femmes.
I l s’agit principalement, dans ce musée Ungerer plein de charme, des illustrations d’Alice au pays des merveilles (1865) dans les éditions enfantines, certaines étant de toute beauté comme celle de Trnka, le célèbre tchèque, d’autres sobres comme celles d’Antony Browne, plus inquiétantes de Tove Janson ou douces de Marie Laurencin, plus cruelles pour Nicolas Claveloux, féeriques pour Adrienne Ségur, beaucoup plus absurdes pour Ralph Steedman ou Mervin Peake.

Le monde d’Alice est celui du non-sens, de l’absurde, du jeu. Tout se joue dans la figure d’une carte à jouer, sa figure coupée en diagonale. C’est un monde transgressif où rien ne va de soi, où le corps d’Alice est enfantin autant qu’il n’est pas innocent, où plantes et animaux s’expriment à égalité de l’humain. Une manne pour les surréalistes qui s’en trouvent très inspirés.
Le MAMCS met merveilleusement cela en scène. En dehors de l’entrée de la grotte faite dans des matériaux pauvres qui ne correspond pas à l’élégance des salles, le reste de l’exposition est somptueux, avec ces quatre salles noire, rouge, vert sombre, bleu clair, montrant différentes éditions d’Alice, mais aussi les tableaux de Max Ernst, de Dali, travaux d’André Breton, photos d’Hans Bellmer, illustrations très étonnantes de Frédéric Delanglade de Victor Brauner ou de Dali, superbes également celles de Dorothéa Tanning ou Leonora Carrington et de la si rare Unica Zürn, ainsi qu’un texte très cruel de la très précoce Gisèle Prassinos.
La grande réussite de cette exposition – Barbara Forest et Fabrice Flahutez en sont les commissaires – est son intelligence. Les peintres connus côtoient d’autres moins connus, les femmes
Ralph Steadman, Alice and the Wasp, 1971sont reconnues à leur valeur d’artistes à part entière, on a la chance d’assister à une très fine compréhension de l’univers d’Alice en tout sens, femme-enfant centrale, sous les trois grands thèmes du jeu, du langage et de l’image. Le rapport image/écriture est l’écho du monde de Lewis Caroll chez les surréalistes des années 20 aux années 60. « Nous avons conçu un parcours immersif où l’on peut entendre tant des chants populaires que du jazz ou des classiques tels que Tchaikowsky, Schubert, Wagner, Liszt… » précise Mathieu Schneider.
C’est un vrai théâtre qui se joue là, dans un décor où de cet univers en apparence velouté émane tous les rêves et les abécédaires d’une enfant prodige, magnifiquement folle, objet des rêves et œuvres des plus grands artistes.
Lewis Carroll, gaucher maladroit, sujet au bégaiement, a inventé une figure intemporelle.
« Comment savez-vous que je suis folle ? », dit Alice.
« Vous devez l’être », dit le chat, « sans cela vous ne seriez pas venue ici. »
Souhaitons plein de fous pour aller voir cette exposition dont la beauté est tellement nécessaire. a
SURRÉALICE, LEWIS CARROLL ET LES SURRÉALISTES

MAMCS
1 pl. Jean-Hans Arp Strasbourg 19 novembre 2022 au 26 février 2023
ILLUSTR’ALICE
Musée Tomi Ungerer 2 bd de la Marseillaise Strasbourg Mêmes dates



VITRA DESIGN MUSEUM LE GESTE ET LA PAROLE
Industrie, vie quotidienne, culture populaire, les robots sont parmi nous. À l’image d’un design réussi, confortable et facile d’utilisation, leur présence est devenue plus qu’une évidence, un irremplaçable prolongement. Pensés à l’origine pour nous aider, les robots nous assistent, nous surveillent, voire s’émancipent et surtout, nous interrogent.
L’exposition du Vitra Design Museum, Hello, Robot. Le design entre Homme et Machine, revient sur notre rapport à cet outil qui, depuis bientôt un siècle, ne cesse d’évoluer. Imaginé par l’écrivain Karel Capek en 1924, le terme robot est un mot tchèque, luimême dérivé du mot robota qui signifie travail, corvée…
L’exposition, déployée sur 4 salles, met en lumière les relations que l’on entretient (parfois même sans y penser), avec ce que l’on pourrait qualifier d’espèce robot. Science-fiction, travail, vie sociale, avenir, chaque groupement d’œuvres est présenté sous une question, Faites-vous confiance aux robots ? Pensez-vous que votre travail pourrait être effectué par un robot ? Aimeriezvous qu’un robot s’occupe de vous ? Le robot prendra-t-il la première place dans l’évolution ? Sorte de parcours-sondage, cette déambulation au milieu de figurines de films, de bras automatisés ou d’interfaces gérées par des intelligences artificielles fascine, et parfois aussi dérange ; une nouvelle espèce dominante seraitelle sur le point d’émerger ?
INÉLUCTABLE SINGULARITÉ ?

« Les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. »
Audre Lorde













 Kingsley Coman porte la nouvelle PUMA Ultra. rendez-vous sur puma.com
Kingsley Coman porte la nouvelle PUMA Ultra. rendez-vous sur puma.com
Jentrevoir le fameux point de singularité, événement qui désigne le dépassement de l’humain par la machine. Si ce changement de paradigme technologique n’est pour le moment qu’une théorie, force est de constater qu’un changement est d’ores et déjà en cours : un outil est en passe de devenir notre condition d’existence. En 1984, la philosophe Donna Haraway disait d’ailleurs déjà, « le cyborg est notre ontologie ; il nous dicte notre politique. » Hello, Robot, presque 40 ans après, confirme cette formule avec notamment les créations de la dernière salle de l’exposition qui évoquent la fusion entre le vivant et la machine, souvent pour le meilleur, mais jusqu’à quand ?

Alors que les vidéos de l’athlétique Atlas, le robot anthropomorphe de l’entreprise Boston Dynamics, défraie les Internet (allez voir, c’est terrifiant !), au geste et à la parole, ne manque plus que l’esprit. a
HELLO, ROBOT. LE DESIGN ENTRE HOMME ET MACHINE
Vitra Design Museum, jusqu’au 5 mars 2023
« UNE NOUVELLE ESPÈCE DOMINANTE SERAIT-ELLE SUR LE POINT D’ÉMERGER ? »

Il fallait bien que ça arrive un jour
Depuis sa nomination en 2019, Solveen Dromson, grande amie de Or Norme, est aussi Consule de la République d’Islande à Strasbourg, perpétuant ainsi une tradition familiale entamée par son père, Patrice, malheureusement disparu en 2018. Sur son agenda était cochée depuis longtemps la date du 9 novembre dernier : ce jour-là, l’Islande prenait la présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Cette présidence tournante de six mois, qui échoit tour à tour à chacun des 46 pays membres, Solveen l’a depuis longtemps imaginée comme une occasion unique d’apparaître en pleine lumière pour ce petit pays aux confins de l’Atlantique-Nord. D’ici fin mai prochain, les événements culturels vont se succéder à Strasbourg, comme autant de rendezvous avec cette étonnante et sublime Islande que nous vous proposons de mieux découvrir dans les très nombreuses pages qui suivent. Car, évidemment, Solveen a pensé à Or Norme, passionnée qu’elle fût il y a quelques années par nos numéros spéciaux « Destination de légende » où nous nous en allions au bout du monde rencontrer les Alsaciens vivant à l’étranger et leur demandions de nous faire découvrir leur pays d’adoption.
Oui, il fallait bien que ça arrive un jour… Nous renouons donc ici avec une belle tradition et nous nous sommes mis en quatre à la fin septembre dernier pour fouler cette terre sublimement attirante et mystérieuse qu’est l’Islande et vous ramener des histoires de feu, de glace, de volcans et d’êtres souterrains qui, dit-on, président encore au destin de ce morceau de terre unique au monde…
Nous en avons ramené de belles histoires et de beaux témoignages, mais… en sommes-nous vraiment revenus ?
Merci Madame la Consule !
Jean-Luc Fournier Directeur de la rédaction
Islande La nature en V.O.
C’est l’histoire d’une terre à nulle autre pareille, fouettée par les vents, sculptée par l’eau et la glace, ravinée par de monstrueux flots incandescents où l’homme, contre toute attente, a réussi à vivre…

La plage noire de Reynisfjara à la pointe sud de l’Islande. Falaises de basalte, sable volcanique, léger brouillard sur l’océan : l’Islande de légende.
 Photo : VisitIceland
Photo : VisitIceland
La sublime nature des hauts-plateaux dans le centre du pays.
 Photo : Christian Barret
Photo : Christian Barret

Le rocher de Hvítserkur sur la Côte-Nord de l’Islande.
 Photo : Christian Barret
Photo : Christian Barret


Située à l’exacte intersection de deux gigantesques plaques tectoniques, l’Islande est une terre de volcans. À tout moment, l’un d’entre eux peut entrer en éruption...
 Photo : VisitIceland
Photo : VisitIceland
 Les incroyables montagnes de Landmannalaugar, à l’ouest de l’immense glacier Vatnajökull.
Photo : VisitIceland
Les incroyables montagnes de Landmannalaugar, à l’ouest de l’immense glacier Vatnajökull.
Photo : VisitIceland
Le moindre village islandais arbore le Rainbow Flag ou pare ses rues des couleurs de la tolérance – ici, à Seyðisfjörður, dans l’Est du pays.
Photo : VisitIceland

Islande Carnet de route dans l’Est
Bientôt, dès l’ouverture de lignes directes pour l’aéroport régional de Egilsstaðir, l’Asturland (les régions de l’Est) permettra de découvrir un autre visage du pays : on y admire des paysages grandioses et sauvages souvent à 360°, des chutes d’eau gigantesques et des canyons de basalte surgis de nulle part. Il suffit juste de se souvenir que ce sont les premières terres qu’ont vues les Vikings en débarquant ici. Rien ou presque n’a changé et c’est superbe…
Dès qu’on approche du cercle polaire et comme toujours sous ces latitudes (64°08’07’’ pour Reykjavik, pour les spécialistes), le soleil ne monte jamais très haut dans le ciel.
Ce matin de la fin septembre dernier, il est 7h et il vient à peine de se lever sur le petit aéroport de Reykjavíkurflugvöllur, à quelques kilomètres à peine du centre de la capitale islandaise. Et ce matin-là, ce quelquefois si rare soleil islandais inonde le tarmac de sa lumière rasante qui se reflète sur le fuselage du DASH 8-400 de Icelandair, prêt à décoller pour une heure de vol et sa destination, Egilsstaðir, dans l’est du pays. Nous sommes cinq journalistes de la
presse française, invités à découvrir l’est de l’Islande, largement méconnu. Noémie, de l’agence parisienne Group’Expression, sera celle qui, méticuleusement et très professionnellement, assurera la logistique de ce groupe gentiment turbulent, avec une permanente bonne humeur. Elle est accompagnée de Thordis, une jeune guide dépêchée par Visit Iceland, l’office du tourisme national, qui affiche déjà un beau sourire, ravie de côtoyer pendant les trois prochains jours des journalistes français, elle qui connait quasiment Paris et ses restaurants comme sa poche…
Et chacun de se réjouir de cette belle météo, gage d’un vol agréable…
Cette courte heure de vol sera magique. Le DASH 8-400 ne vole pas très haut (5 000 mètres, peut-être…) et sous ses ailes, c’est un paysage déjà incroyable qui défile sous nos yeux.
Le trajet permet de survoler longuement le flanc nord-ouest de l’immense Vatnajökull, ce glacier de 8 300 km2 (soit plus de 95 % de la superficie de la Corse) et qui couvre à lui seul 8 % de la superficie de l’Islande). Plus loin, l’avion survolera aussi les hauts-plateaux centraux de l’île. Ce matin-là, avec ce soleil rasant qui fait étinceler le moindre lac ou névé sous les ailes de l’avion, c’est toute l’Islande qui se révèle dans sa magnificence naturelle.

Un patchwork unique de tourbe, de glace, d’eau, de roches, sans la moindre trace humaine et se déroulant sur une immensité sans fin. Devant ce spectacle fascinant et cette nature quasi indécente, peu d’entre nous parviennent à détourner leur regard à travers les hublots, ne serait-ce que quelques secondes…
Et quand l’avion plonge plus tard dans le brouillard cotonneux à l’approche de l’aéroport régional de Egilsstaðir, nous savons tous déjà que l’Islande vient de nous offrir d’entrée un spectacle inouï, comme si elle nous faisait déjà entrevoir le meilleur d’elle-même…
À l’aéroport, c’est Helga qui nous attend. Toute l’année, sa société, Tinna Adventure, organise des road trips pour les touristes. Nous sommes immédiatement surpris par le véhicule qui va nous permettre de découvrir l’Austurland (la province de l’est du pays) : un monster-truck rallongé et rehaussé par quatre énormes roues. Il sera quelquefois très utile dans les jours qui suivront, car le macadam ne sera pas toujours la surface sur laquelle nous circulerons le plus…
Un petit topo succinct nous donne l’essentiel de ce qui explique notre présence ici. Le boom touristique des quinze dernières
années (plus de deux millions de visiteurs annuels) met Reykjavik et la région qui l’entoure sous une grande pression, l’essentiel des sites recherchés par les visiteurs se concentrant au sud de la capitale d’où ils sont très facilement accessibles.
Pour le pays, il s’agit donc de communiquer sur ses nombreuses autres richesses et, pour cela, l’Austurland est la région idéale. Déjà, les ferrys venus du Danemark, de Norvège ou des îles Féroé accostent tous au port de Seyðisfjörður au nord de la région et des vols internationaux directs sont à l’étude pour rejoindre l’aéroport de Egilsstaðir sur lequel nous venons d’atterrir. À l’évidence, ces portes d’entrée devraient séduire nombre de visiteurs dans un avenir proche…
Un seul chiffre dit tout : les régions est de l’Austurland sont très peu peuplées. À peine plus de… 12 000 habitants (on respire…) se regroupent dans de très petits villages, pour la plupart abrités au fond de superbes et majestueux fjords qui n’ont rien à envier aux plus beaux de leurs équivalents norvégiens à 1 500 km de là. Les principaux d’entre eux (Seyðisfjörður, Fáskrúðsfjörður et Mjóifjördur) sont reliés par une très sinueuse route côtière qui constitue l’artère vitale de toute la région.
Bien entretenue, elle se transforme malgré tout quelquefois en piste qui fait goûter aux joies de la gravel road durant la « belle » saison ou à l’enfer de la circulation « à l’aveugle » en période de blizzard, l’hiver (lire le témoignage de Thomas Waeldele page 74).
Une courte étape au Guesthouse Vinland (à une demi-heure de Egilsstaðir) pour saluer deux éleveurs de rennes, Fannar Magnússon et Björk Björnsdóttir, qui ont ému toute l’Islande. En mai 2021 lors d’une sortie en moto-neige dans les hauts-plateaux du centre du pays, ils ont recueilli deux bébés rennes âgés d’une semaine et manifestement abandonnés par le reste du troupeau. Sans leur intervention, les jeunes rennes n’auraient pas survécu. Fannar et Björk ont obtenu l’autorisation de les soigner et les élever à Vinland. Aujourd’hui adultes, Garpur et Mosi, quasi domestiqués, font la joie des visiteurs dans leur enclos. Au passage, on y souligne que les premiers rennes sont venus de Norvège vers la fin du XVIIIe siècle et ne sont parvenus qu’à s’acclimater dans l’est du pays. Les effectifs actuels (environ 7 000 têtes) sont strictement contrôlés, l’Islande ne souhaitant pas une forte présence de ces animaux sur son territoire.

Bryndis
On reprend la route plein Nord et elle est somptueuse. Les paysages minéraux se succèdent. Lors de quelques haltes photographiques, l’Austurland se dévoile à 360°, des rais de soleil transpercent les nuages et peignent sur l’herbe rase des taches de lumière du plus bel effet.
Le petit village de Borgarfjörður Eystri nous permet de découvrir la minuscule maison Lindarbakki. Faite de briques, de bois et recouverte de gazon, elle semble littéralement surgir de terre. « Elle était encore habitée il y a quelques années par une vieille dame solitaire », nous raconte une jeune femme, Bryndis, qui nous entrainera ensuite sur le sentier des Elfes.

Les Elfes : voilà une de ces merveilleuses découvertes que nous a réservée l’Islande.

Les Elfes sont de petits êtres d’à peine plus d’un mètre de haut, aux oreilles franchement pointues et aux vêtements désuets qui vivent la plupart du temps cachés aux yeux des humains. Les fêtes de fin d’année sont généralement propices pour apercevoir les Elfes ; à Noël et au Jour de l’an, ils sont de sortie, à la recherche d’un nouveau foyer…
Un sondage réalisé il y a quelques années a annoncé que 54 % des Islandais croient en leur existence ou disent qu’il est possible qu’ils existent. La preuve : le tracé de routes en construction a été dévié à proximité d’amas rocheux où les Elfes sont censés s’établir.
Rien de remarquable n’est visible sur le sentier des Elfes de Borgarfjörður Eystri. Il serpente en montant doucement au sommet d’une mini-colline qui offre un beau point de vue sur le village et son fjord. Là-haut,

Bryndis déroule la légende : « La chapelle qu’on voit au bord du littoral devait auparavant être bâtie au sommet de cette colline, dès l’arrivée des premiers marins sur ce rivage. Mais, la veille du début de la construction, la reine des Elfes leur est apparue durant leur sommeil et les a mis en garde : ne construisez pas votre chapelle en haut de mon sentier, les pires malheurs s’abattraient alors sur vous… Prudemment, ils ont obéi. Et tout s’est bien passé… » conclut Bryndis.
Si vous interrogez un Islandais, il vous dira bien sûr que les Elfes n’existent pas, mais… que la simple idée qu’ils puissent exister ne lui déplait pas. Une phrase qui participe à la légende ? Non, et il ne faudra pas longtemps pour le constater : en redescendant le sentier des Elfes, on s’apprête à ramasser un joli petit caillou blanc qui brille sous un rayon de soleil. Mais Helga, la pilote du monster-truck, nous en dissuade fermement : « Il y a les mêmes au débouché du sentier, plus bas. On ne ramasse rien sur le sentier des Elfes… ». Sérieux ? Oui, sérieux. On n’insiste pas…
Le long de la côte, on longera quelques habitations de bois en bien mauvais état. Un couple est là, en train de réparer d’importants dégâts. La femme nous montre sur son téléphone portable ce qu’elle a filmé la veille, lors d’une gigantesque tempête qui a frappé toute la côte. Sur l’écran, d’immenses rouleaux gris de deux mètres s’abattent sur les quais de bois et les baraques du bord de mer sous d’impressionnantes rafales de vent. On devine à quel point la nature peut se déchaîner dans ce fjord largement ouvert sur la mer et surmonté par deux mystérieuses montagnes noires...
Plus tard, une petite maisonnette nous ouvre ses portes. C’est le royaume de Ragna Óskarsdóttir et de sa société Icelandic Down. Quand Ragna est arrivée dans ce petit port en 2017, elle a aussitôt visité l’élevage de canards eiders de Oli et Johann, deux fermiers locaux, dans le fjord quasi déserté de Loðmundarfjörður, à quelques kilomètres au sud. « Les canards étaient partout, dans les prés, dans les cours des habitations… », raconte-t-elle. La tradition ancestrale de l’élevage de canards voulait que le précieux duvet récolté s’en aille loin de l’Austurland pour être travaillé et pour garnir ensuite toutes sortes de couettes ou oreillers assurant la prospérité de manufactures lointaines. L’idée de créer Icelandic Down est née aussitôt.
Aujourd’hui, la société de Ragna produit sur 380 micro-zones sanctuaires un duvet
La maison Lindarbakkiirréel, totalement épuré de tout corps de plume même minime puis purifié avec soin pour être finalement annoncé comme le duvet le plus doux au monde. Ragna n’hésite pas à nous inciter à plonger les mains au cœur d’une grosse boule compacte de ce duvet. Malgré son volume, elle ne pèse que 32 grammes, sur la balance ultra-sensible du magasin de vente, mais la sensation qui file entre nos doigts est purement magique. Entièrement prélevé et « filtré » à la main, ce duvet d’exception a un prix et il est élevé : une couette 200 X 200 garnie chaudement pour l’hiver s’affiche à 7 978 € (!), sa version « allégée » pour l’été vous coûtera 5 319 €. Les couettes et autres oreillers sont fabriqués à la commande et sont expédiés directement chez vous environ sept semaines après la réception de votre paiement. (www.icelandicdown.com)

Le soir venu après ce premier jour au cœur de l’Austurland nous voit être accueillis au très beau Blábjörg Resort, un hôtelspa entièrement bâti par une famille qui emploie pas moins de 48 personnes en haute saison (14 en permanence), « contribuant ainsi considérablement à l’économie locale » comme le dit fièrement Audur Vala Gunnarsdóttir, la directrice du lieu. Dans quelques mois, un impressionnant complexe thalasso sera ouvert et d’ores et déjà, on peut déguster chaque soir un gin ou un Landi local dans la micro-brasserie attenante. Au restaurant du complexe, l’agneau, cuit doucement durant huit heures, est une véritable tuerie. Après tout ça, on dort d’un sommeil profond et apaisé…
Le programme du deuxième jour de notre périple dans l’est de l’Islande s’annonce
somptueux et il tiendra ses promesses. On quitte Borgarfjörður Eystri pour revenir vers les terres intérieures et bientôt s’enfoncer dans la vallée Jökuldalur où nous attend le prometteur Stuðlagil Canyon (page suivante). Récemment découvert après l’assèchement de la rivière Jökla dû à la construction d’une retenue d’eau en amont pour alimenter une centrale hydroélectrique, le site est somptueux avec ses imposantes colonnes de basalte qui évoquent irrésistiblement des orgues naturelles. On peut le découvrir par sa rive Est grâce à un raide escalier métallique dont on peut descendre (mais il faut ensuite remonter !) les 248 marches.
La vision de cette merveille est cependant mille fois plus spectaculaire vue de l’autre rive, surtout si l’on a le courage de descendre au ras de l’eau.

Monolithique, redoutablement imposant, massif et altier, le Stuðlagil Canyon est incontestablement une des plus belles merveilles naturelles du pays.
La route, toujours la magique route islandaise au milieu d’une nature toujours aussi somptueuse et grandiose pour rejoindre Egilsstaðir et piquer au sud pour rejoindre l’étape du soir, le village de Fáskrúðsfjörður, au bord d’un immense fjord très étroit.
Le Fosshotel Eastfjords nous reçoit. On y est accueilli par Fjolà qui semble être omniprésente dans ce petit village. Après nous avoir fait visiter une expo photos des plus belles aurores boréales capturées par un couple de photographes locaux, elle commence à nous raconter tranquillement l’histoire de ce village de pêcheurs qui, à la fin du XIXe siècle est devenu une étape majeure pour les pêcheurs français venus si loin de leurs bases de l’Ouest et du Nord de la France pour gagner leur vie. La plupart étaient issus du port de Gravelines, près de Dunkerque.
Le cimetière des marins français à Fáskrúðsfjörður

Beaucoup, vivant et travaillant dans des conditions extrêmes que les mots peinent à décrire, ont vu leur vie s’interrompre en ces lieux si étranges. En contrebas, sur les rives du fjord, un petit cimetière marin accueille quelques tombes sur lesquelles figurent les noms de nos lointains compatriotes, un petit monument en répertoriant 49 autres, y compris quelques marins d’origine belge.
Au moment du dîner, nous apprenons que le Fosshotel Eastfjords occupe un bâtiment qui fut il y a un siècle et demi un hôpital pour ces marins français du bout du monde…
Le Stuðlagil Canyon

Pour notre troisième et dernier jour en Austurland, le programme prévoit dès le petit-déjeuner avalé la visite du Musée Français, installé juste en face de l’hôtel, dans l’ancienne maison du médecin de l’époque. Dans un tunnel souterrain reliant les deux bâtiments, on a reconstitué l’intérieur saisissant d’un bateau de pêche de l’époque. Quelques mannequins simulent de façon réaliste les marins…
Nous quittons Fáskrúðsfjörður en fin de matinée, l’exquise Fjolà nous aura accompagnés et guidés depuis l’après-midi précédent, passionnée et fière de vanter sa région, professionnelle, délicieusement amicale et complice…
Il faudra bien se résoudre à refaire la route à l’inverse, vers l’aéroport de Egilsstaðir où nous attend l’avion du retour nocturne vers Reykjavik. Mais, outre la visite d’une imposante cascade perdue dans l’immensité d’une incroyable vallée d’origine volcanique, deux étapes-surprises nous auront encore été réservées.
C’est d’abord, une balade à cheval dans ces paysages délirants de beauté sauvage, juchés sur ces chevaux islandais aux longues crinières blondes si remarquables. Le cheval islandais est souvent, et à tort, confondu avec un poney, car il est de petite stature. Importée par les Norvégiens il y a mille ans, la race s’est éteinte complètement sur le continent, mais pas en Islande qui a su préserver les chevaux des influences extérieures pendant tous ces siècles…
Le pays est amoureux de ses chevaux : la langue islandaise comprend plus d’une centaine de mots pour décrire leurs robes…

C’est enfin l’expérience si longtemps vantée des fameux bains dans l’eau des résurgences chaudes. En Islande en effet, l’eau chaude jaillit des entrailles de la Terre, naturellement, et de partout…
Les Vök Baths du Lac Urridavatn, près de Egilsstaðir, sont en fait trois piscines serties dans le lac. On entre, via la première piscine, dans une eau à 38° qui permet en quelque sorte de doucement s’acclimater. La sensation est en effet purement divine, en contraste avec les frais 7° de la température extérieure. Le temps de déguster un bon cocktail servi par un bar donnant directement sur la piscine, il faut sortir de l’eau, marcher une vingtaine de mètres (brrrr…) sur une passerelle de bois clair avant de se glisser dans les 40° de l’eau de la seconde piscine. Douce sensation de nouveau, le corps se détend, on en sommeillerait presque…

Comme le temps presse un peu, il faut se résoudre à entrer dans l’eau de l’ultime piscine, à 42°. Là, l’impression est un peu plus violente, mais étant là à l’ultime étape du parcours, on peut alors plonger sa main à l’extérieur du bassin, dans l’eau naturelle du lac. Elle est à 4°, et le contraste produit une très étrange sensation…
Et dire qu’on se disait trente minutes plus tôt qu’on se la jouerait à l’islandaise. La tradition locale veut en effet qu’après quelques instants dans la troisième piscine (on ne reste pas longtemps dans une eau à 42°, croyeznous…) on plonge et on ressorte rapidement dans l’eau du lac. Un violent choc thermique de plus de 35° d’écart qui détend prodigieusement et promet quelques heures de félicité ensuite, paraît-il. Oui, paraît-il, car pourtant partis résolument pour vivre ce moment à plein, on n’a finalement pas osé… Ne vous moquez pas trop vite, si vos pas vous amènent un jour dans ces lieux, essayez et… vous comprendrez.
Une heure plus tard, dans l’avion, je crois que nous avons tous sommeillé paisiblement au moins quelques minutes…
À notre arrivés vers 21h30, nos quatre collègues parisiens ont rejoint le même bel hôtel que quelques jours plus tôt, près de l’aéroport international de Keflavik d’où ils allaient prendre leur avion de retour vers Paris tôt le lendemain matin.
Pour nous, c’était direction le centreville pour quatre jours supplémentaires en solo, à la rencontre de la capitale islandaise et des Alsaciens qui y vivent et y travaillent… c
Reykjavik Micro-capitale, méga plaisir…
La plus septentrionale des capitales de la planète offre le spectacle d’une petite ville cool, aérée, colorée et très paisible. En Islandais, son nom signifie « La baie des fumées », nom donné par les fondateurs stupéfaits de la vapeur qui s’échappait alors des nombreuses sources thermales. Entre océan et proches montagnes volcaniques, Reykjavik regorge de richesses artistiques et culturelles, surtout dans l’art contemporain, en s’avérant vite familière, et c’est un énorme avantage…


Les statistiques historiques parlent. Ici, au bord de la péninsule de Reykjanes, il n’y avait pas 600 habitants à la fin du XVIIIe siècle quand l’autorité danoise, dont dépendait alors l’actuelle Islande, accorda le statut de ville à Reykjavik, lui conférant du coup, dans cette colonie insulaire, le rôle de capitale.
En 1980, ils étaient 80 000. Aujourd’hui, la capitale islandaise compte 133 000 habitants (240 000 pour l’agglomération totale) soit près des deux tiers de la population totale du pays, 370 000 habitants.
Un élément de comparaison qui parlera, lui aussi : l’Eurométropole de Strasbourg et ses 33 communes comptent plus de 505 000 habitants…
La capitale islandaise est presque comme une énorme carte postale. Non loin des premiers volcans et des montagnes environnantes, elle s’étend face à l’océan le long d’une large baie fermée par le Mont Esja.
La ville s’enorgueillit d’un petit quartier historique (mais ici, l’histoire est très récente, ne comptez pas y admirer de très vieilles pierres…) et son front de mer est ourlé d’immeubles modernes à l’image du fameux Harpa dont nous reparlerons, prolongés par un port encore actif où fleurissent aussi les quartiers branchés et festifs ainsi que de vastes entrepôts superbement reconvertis en musées, lieux de vie et boutiques plutôt luxueuses.
Rien n’oppresse dans ces rues-là et si les transports en commun (ni métro ni tram dans cette petite ville), essentiellement des bus, quadrillent bien la ville, ils sont presque inutiles pour le visiteur qui n’usera que très parcimonieusement ses semelles pour passer d’un quartier à un autre. À bien des égards, Reykjavik sait se laisser découvrir tendrement…
Comme un fanal incontournable, le petit centre-ville de la capitale islandaise est dominé par la célèbre Hallgrímskirkja, cette spectaculaire église luthérienne, à l’immanquable flèche de béton qui s’élève à 75 mètres. Terminée en 1986, son architecture est remarquable et gracieuse, évoquant irrésistiblement les colonnes de basalte des plus spectaculaires sites islandais. Des rues nombreuses y convergent, donnant autant de perspectives aux innombrables photographes. Est-ce voulu ou cela correspond-il à une raison historique précise, on ne sait pas, mais l’orientation de cette flèche audacieuse et de sa façade très minérale fait que le soleil la lèche latéralement de flanc à flanc, durant toute sa course quotidienne. Lesdits photographes sont donc
un peu à la peine pour leurs réglages (on ne peut pas avoir à la fois le soleil dans le dos et la façade frontale devant l’objectif). Les vues de nuit, avec l’éclairage splendide du bâtiment, font découvrir la Hallgrímskirkja dans toute sa sobre beauté…
Sur la majestueuse place au pied de la Hallgrímskirkja trône la statue d’Éric le Rouge, le célèbre norvégien bien connu par les amateurs de la série Vikings , qui a été banni d’Islande aux environs du premier millénaire.

De là partent plusieurs rues tranquilles qui permettent de rejoindre très vite les deux principales artères commerçantes de la ville, Bankastræti prolongée par Laugavegur et Skólavörðustígur, où l’on trouve aussi les principaux restaurants ou bars très fréquentés dès 17h…
Tout est à deux pas : au bord de l’océan, il y a cette vaste promenade où s’est échouée Sólfar, (le voyageur
du soleil, en Islandais) une fine et élégante sculpture réalisée en acier qui évoque irrésistiblement la silhouette d’un bateau viking qui se dirige droit vers le soleil couchant…
À deux cent mètres, le bloc de verre et d’acier du Harpa, une gigantesque salle de concert-palais des congrès, se dresse telle une massive vigie contemporaine. L’élégance de l’architecture extérieure n’a rien à envier à un aménagement intérieur d’une rare majesté. Ses opposants ont tenté en vain d’accréditer l’idée que ses proportions sont complètement surdimensionnées pour les besoins d’une aussi faible population. Peine perdue, un référendum a tranché, le Harpa a été terminé, quitte à provoquer une substantielle rallonge sur les impôts locaux. À l’intérieur, le complexe abrite quatre salles de concert dont l’une de 1800 places à l’acoustique renommée dans le monde entier, et une infinie variété d’espaces d’expositions,
L’incontournable HallgrímskirkjaLe Harpa


le tout sublimé par un formidable kaléidoscope de plus de 10 000 vitres en nid d’abeilles qui, orientées au sud, reflètent une lumière irréelle à certains moments de la journée. Du grand art architectural, incontestablement…
Plus à l’ouest, dans le prolongement du port traditionnel, c’est le quartier de Kvosin, bien rénové, qui abrite musées, galeries d’art, boutiques et restaurants. Il fait bon y flâner le nez au vent et les jetées, quand le soleil se couche, s’embellissent d’une belle lumière qui fait irrésistiblement penser à celle de certains tableaux du norvégien Edvard Munch qui savait si bien peindre les clartés nordiques. (lire les pages 14 à 17 dans ce même numéro)
Dans ce même quartier ou pas loin, on découvre aussi trois attractions dont les Islandais (et leurs visiteurs…) sont très friands : le Saga Museum où on peut
Un kaléidoscope de couleurs
se balader parmi les grandes figures historiques islandaises, Whales of Island (les baleines d’Islande) qui reproduit le plus souvent à leur taille réelle les cétacés de l’Atlantique-nord et surtout, l’extraordinaire Fly Over Iceland : installé dans une sorte de nacelle géante devant un gigantesque écran semi-sphérique, les pieds ballants (au-dessus d’un vide… inexistant) vous vous envolez bientôt tel un oiseau migrateur pour un voyage au-dessus de ce pays fantastique. Volcans, geysers, splendides pics rocheux, vertigineuses plongées dans des gorges de basalte… se succèdent devant vos yeux ébahis. L’illusion est parfaite (jusqu’aux micro-gouttes d’eau qui viennent vous asperger quand vous traversez les nuages… et votre siège qui s’incline ou se redresse en fonction de mouvements de la caméra). Fly Over Iceland est bien plus qu’une attraction, c’est une expérience…
On le répète, Reyjavik se parcourt quasi entièrement à pied, tranquillement. Deux, voire trois jours ici se dégustent comme un vrai privilège tant la ville, et ses habitants, se laissent facilement conquérir.
Ces derniers entretiennent un art de vivre assez remarquable. Comme l’ensemble de ceux que nous avons rencontrés nous l’ont dit (lire les pages suivantes), tous cultivent cette espèce de coolitude qui finit vite par déteindre sur vous. Tout cela se vérifie à partir de la fin de l’après-midi : les rues centrales de la capitale islandaise s’animent, les restaurants et bars sont alors tous ouverts. Dehors, on picole et on rigole à qui mieux mieux, c’est alors toute une jeunesse qui profite de la vie et même cette satanée météo (« S’il pleut, attends cinq minutes, ça va passer » dit le célèbre proverbe local) ne fait fuir personne.
Reykjavik est un bien bel endroit… c
Ces Alsaciens sous les aurores boréales
Ils s’appellent Karim, Catherine, Valentin, Florent ou encore Thomas…
Tous ont en point commun un désir d’Islande, survenu plus ou moins tôt, prémédité ou moins, mais, au final, toujours assouvi, car tous ont osé franchir le pas et se mesurer à ce pays unique et quelquefois si étrange. Nous les avons rencontrés à Reykjavik ou en France. Ils racontent ce qu’ils vivent ou ont vécu. Dans leurs yeux se reflètent les mille nuances de l’Islande. Et l’émerveillement ne les a jamais quittés…



Ces Alsaciens sous les aurores boréales Karim Dahmane : l’Islande, comme une évidence…
Il est Strasbourgeois d’origine et il avoue bien volontiers « avoir depuis toujours eu la bougeotte ». Alors, très tôt, il a assumé ses envies et le voyage est devenu pour lui une seconde nature. « L’Islande m’a permis de devenir celui qui est au fond de moi » dit-il joliment…
Voyager a toujours été un objectif quasi obsessionnel pour vous…
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, très vite, j’ai eu en tête l’idée de pouvoir joindre à l’utile à l’agréable c’est-à-dire d’être à même de voyager, mais aussi de vivre ma vie depuis une destination lointaine. Je travaille donc dans le tourisme depuis trente ans. J’ai commencé à travailler comme guide à Terres d’aventures, me spécialisant sur les zones désertiques, sahariennes principalement. J’emmenais les gens marcher. Peu à peu, j’ai ajouté les zones arctiques, le Groenland et le Spitzberg, à mon programme…
Au tout départ, j’ai posé pour la première fois le pied sur le sol islandais pour une question liée à l’impératif d’une escale lors d’un vol aérien vers le Groenland. Et j’ai fait la connaissance d’un ami qui vivait en Islande ce qui m’a permis de multiplier les petits séjours lors des escales, dans les années 90. Il y a eu ensuite pas mal de choses qui ont changé au sein des agences de voyages pour lesquelles je travaillais, des rachats et regroupements surtout. Comme

Comment s’est passée votre rencontre avec l’Islande ?
notre statut de travailleur indépendant est d’une grande fragilité, j’ai réalisé que je n’allais pas tarder à rencontrer des problèmes et qu’il allait falloir que je me prépare une solution de sortie. Je restais cependant très attaché à mon point d’ancrage qui était Strasbourg et à ma terre d’Alsace…
Comment les choses ont-elles bougé ?
Le tourisme n’a jamais été pour moi une fin en soi, mais j’y ai toujours cherché un réel potentiel de rencontres, car ce sont ces rencontres qui, pour moi, nous font évoluer et génèrent le changement. J’ai donc un temps arrêté de collaborer avec les sociétés habituelles et au début des années 2000, mon ami en Islande m’a incité à venir dans l’île où j’ai commencé à guider jusqu’à finir par rencontrer Silja, une FrancoIslandaise qui est devenue depuis la mère de mes enfants. Elle vivait à Paris et elle venait en Islande pour encadrer des voyages d’été. On a décidé de s’installer là-bas parce que je me disais que c’était un beau pays où nous pouvions à l’évidence réaliser pas mal de choses. C’est donc l’amour qui m’a amené vers l’Islande et j’ai très vite réalisé que ce
pays me permettait de devenir celui que j’avais au plus profond de moi depuis toujours. Elle me paraissait bien, cette idée. Nous nous sommes installés en Islande en 2008. Au meilleur moment…
C’est à dire au moment où la crise financière mondiale a éclaté…
C’est cela. Ce fut un enfer. heureusement, le pays a pu assez rapidement rebondir. Et nous avons fini par pouvoir nous intégrer assez correctement. J’ai beaucoup de reconnaissance pour ce pays où j’ai finalement pu me réaliser. J’en ai aussi pour les Islandais qui, en référence à un passé historique qui n’a pas toujours été pour eux une partie de plaisir, savent aujourd’hui se battre et affronter crânement l’adversité. Ils l’ont notamment prouvé dans les années 60/70 où ils ont su affronter les bateaux anglais qui venaient pêcher dans leurs eaux territoriales en vertu d’acquis historiques qui n’avaient aucune légalité justifiée.
Comment votre activité s’est-elle finalement développée ?
Malgré l’éruption-surprise de l’Eyjafjallajökull deux ans après avoir
lancé mon agence, ce qui est venu encore un peu plus compliquer les choses, sur le coup, je peux dire aujourd’hui que ça marche plutôt pas mal. En fait, j’ai profité du boom touristique que nous connaissons depuis dix ans en Islande…
Parmi toutes les qualités que vous reconnaissez à ce pays et parmi tout ce qui fait que vous avez décidé d’y construire votre vie, quel est peut-être le point le plus remarquable que vous avez envie de souligner ?
Il y en aurait à l’évidence plus d’un. Mais je voudrais mettre en valeur le fait que les Islandais sont des gens fantastiques notamment pour le fait que s’ils constatent que vous avez trouvé votre chemin et que vous avez une idée qui vous porte, ils vous font très facilement une place. Vous n’avez aucunement besoin d’apparaître comme quelqu’un qui brasse beaucoup d’argent, vous pouvez être un artiste ou simplement quelqu’un qui s’est fait son petit boulot, ils vous intègrent bien. Ici, au final, j’ai donné une autre direction à ma vie, j’ai élevé mes enfants. L’Islande m’a ouvert ses bras… » c
Ces Alsaciens sous les aurores boréales Catherine Ulrich, l’Islande au cœur…
« Alsacienne et Strasbourgeoise de souche » tient-elle d’entrée à préciser, Catherine Ulrich vit depuis toujours une incroyable histoire d’amour avec l’Islande. Nos rencontres à Strasbourg d’abord puis à Reykjavik – pour son 77e séjour là-bas ! – ont révélé chez elle un attachement quasi viscéral à l’île perdue dans l’Atlantique-Nord dont elle nous parle avec une passion intacte. Portrait…
Nous sommes dans les années cinquante.
C’est un simple livre dans une bibliothèque familiale d’un appartement strasbourgeois de l’allée de la Robertsau. La petite fille a sept ou huit ans, peut-être… Elle est devenue octogénaire aujourd’hui (même si on lui donne facilement quinze ans de moins), mais elle se souvient bien de ce livre et surtout de sa couverture : « Il appartenait à mes parents » raconte Catherine Ulrich avec une pointe de nostalgie dans la voix « et je me souviens comme si c’était hier de sa couverture et de la photo de cette église de Háteigskirkja et ses quatre clochers (une église d’un quartier de Reykjavik – ndlr). Le cliché avait dû être pris au lever ou au coucher du soleil, je pense, car je me rappelle bien de ses couleurs orangées. Ce livre, j’ai dû le feuilleter des centaines et des centaines de fois. Je ne rêvais pas encore de volcans ou de geysers, mais pour moi, toute petite fille, ce livre et cette couverture résumaient l’Islande. Et je me suis mise à me passionner pour ce pays… Mais, malgré tout cela, j’ai mis très longtemps avant de poser le pied sur cette terre. Je suis devenue veuve très tôt, j’élevais seule mes trois enfants et se rendre à quatre en Islande, à cette époque, était largement hors de mes moyens pour la simple professeur de musique que j’étais. Mais je me suis toujours sentie attirée par les pays nordiques, alors nous avons souvent voyagé l’été en Norvège, on louait
des huttes sur les campings, on a même poussé un jour jusqu’au Cap Nord. Mais l’Islande, pour moi, restait inatteignable, malgré ma connexion persistante avec le petit livre de mon enfance… »
Un heureux engrenage
La vie, quelquefois, souvent, se charge de mettre sur pied ces rendez-vous qu’on croit impossibles, qu’on s’imagine ne pouvoir ne vivre que dans nos rêves. Pour Catherine, c’est la rencontre avec celui qui deviendra son deuxième époux.
Il y a trente ans, pour ses cinquante ans, elle se voit offrir le précieux cadeau, son premier voyage en Islande. Elle se souvient parfaitement de sa première sensation : « À l’époque, l’aéroport international de Keflavik (situé à 50 km de Reykjavik) n’existait pas, on atterrissait sur l’aéroport de Reykjavíkurflugvöllur, à proximité immédiate du centre de la capitale islandaise (cet aéroport est réservé aujourd’hui aux vols intérieurs du pays – ndlr).
Ma toute première sensation, je m’en souviens comme si c’était hier, c’est, dès avoir quitté le tarmac, avoir marché comme sur la lune, sur ces roches volcaniques si particulières. Une sensation quasi identique à celle que j’avais déjà ressentie dans l’enfance quand le concierge de notre immeuble vidait chaque matin la chaudière des restes du charbon consumé, les scories du combustible avaient le même aspect et on entendait ce crissement très particulier
quand on marchait dessus. Ce qui m’avait également aussitôt frappé lors de mon tout premier voyage, c’était les lumières tout à fait singulières qui baignaient ce pays. Les ciels sont très souvent bas, mais rarement lourds ou oppressants. Je crois que c’est la proximité du pôle Nord qui explique ce phénomène. J’ai toujours eu l’âme très sensible et pour moi, les ciels d’Islande me rapprochent des disparus qui me restent chers. Ce fut un véritable voyage initiatique et comme j’étais membre très active d’une chorale et d’un orchestre, je me suis tout de suite dit qu’il fallait que j’amène tout le monde dans ce pays. Ça s’est fait sous la forme d’un échange avec une chorale islandaise de la Côte-Nord de l’île… »
Sans le savoir, Catherine Ulrich venait de mettre le doigt dans un (heureux) engrenage. Un voyage, puis un autre, puis encore un autre et, très vite, elle sera à l’origine de la création de Alsace-Islande, une association culturelle qui deviendra une vraie référence en matière… d’organisation de voyages et de conférences. « Ce n’était pas notre seul but » commente Catherine « mais c’est vrai que je me suis passionnée pour cet aspect-là de notre activité associative. Peu à peu, j’ai développé une sorte d’expertise, j’avais mes parcours, mes références d’hébergements, mes restaurants incontournables et le bouche-à-oreille a fait le reste. L’Islande est devenue ma destination privilégiée, voire unique, et je n’ai cessé d’éprouver du plaisir à la faire découvrir à des centaines de gens, au fil des
ans. Je n’ai jamais cessé d’être bénévole, je n’en ai jamais fait un métier, mais j’ai sans cesse su m’adapter. Par exemple, il y a une quinzaine d’années, j’ai eu affaire à de plus en plus de femmes seules et des exigences d’un hébergement plus confortable se sont faites jour. Alors, j’ai fait évoluer en conséquence ma gamme d’hôtels, un peu comme l’agence de voyages que nous n’étions pas, mais dont je m’efforçais de copier le professionnalisme. J’ai même un jour pu organiser un voyage pour une cinquantaine d’étudiants d’une école d’ingénieurs, l’INSA, venus sur place pour étudier concrètement la géothermie, notamment. Ils en gardent tous un superbe souvenir, je crois… (des propos que confirme un grand ami de Or Norme , leur ex-professeur Armand Erb, aujourd’hui à la retraite – ndlr). Voilà pourquoi je peux aujourd’hui afficher 77 voyages en Islande à mon compteur » sourit Catherine qui compte bien atteindre le chiffre rond de cent voyages. Mais ce ne seront plus des voyages qu’elle
organisera, car elle a mis fin à cette activité quelques mois avant que le Covid ne vienne tout perturber.
Les solides particularités d’un si petit peuple…
Reste que, parfaitement bilingue, la néo-octogénaire reste une formidable personne-ressource : quand nous avons en partie préparé notre voyage là-bas avec elle, il n’y a pas un lieu, un site, un hôtel ou un restaurant d’étape qu’elle ne connaissait pas. Quasi incroyable…
Cette parfaite connaisseuse de l’Islande est bien placée pour évoquer l’évolution contemporaine de ce pays, elle qui l’a connue à une époque où il restait assez enclavé, mais si follement « nature ». Je me souviens même » raconte-t-elle, « qu’il y a trente ans, on roulait sur des routes sans asphalte vers le Snaefellsjökull (le glacier
qui inspira Jules Verne pour son formidable Voyage au centre de la Terre – ndlr) et qu’on suivait parfois une arroseuse publique qui projetait de l’eau sur la piste pour qu’elle ne s’érode pas trop quand elle devenait trop sèche. Ce type de routes existent encore aujourd’hui, mais l’asphalte est devenu beaucoup plus fréquent, bien sûr.
Ceci dit, l’Islande contemporaine a beaucoup évolué, à l’évidence. Le tourisme est arrivé en masse, surtout à Reykjavik et dans l’ouest du pays et il a forcément eu un impact, car moins de 400 000 Islandais vivent sur leur ile. Mais, néanmoins, ce petit peuple, par le nombre d’âmes, conserve ses solides particularités : il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais parmi elles, il y a par exemple cette tradition d’accueil concernant les émigrés. Il y a ici beaucoup de gens d’origine polonaise, voire russe, beaucoup d’Asiatiques aussi et même, ces derniers temps, des Ukrainiens et les Islandais que je connais vivent ça plutôt bien. Certains revendiquent même ce brassage de population, car cela permet de “mélanger leur sang” comme ils disent. En effet, les risques de consanguinité ne sont pas rares dans une population aussi petite.
J’admire aussi leur façon d’éduquer leurs enfants, très vite et de façon très surprenante pour nous autres Français, les jeunes couples islandais leur accordant une autonomie qui ne cesse de grandir, et çà, je le constate depuis trente ans, en effet. Au bord des cascades, ils laissent leur bébé trottiner tout seul, car il doit apprendre le plus vite possible à se sentir le plus indépendant possible. Quasi impensable en France…
Je crois que pas mal de nos compatriotes seraient très étonnés des particularités réelles de ce si petit peuple… » conclut Catherine, la passionnée, dont l’œil ne cesse de briller dès que le mot Islande est prononcé.
Tout cela grâce à la magie aujourd’hui lointaine, mais toujours présente d’une couverture orangée dans la petite bibliothèque de son enfance… c

Ces Alsaciens sous les aurores boréales
Valentin Fels-Camilleri, le battant…

Aussi loin qu’il se souvienne, ce Haut-Rhinois d’origine, passé par Strasbourg pour ses études supérieures à la Faculté des Sciences du sport, a toujours voulu voyager et élargir son horizon. Après quelques étapes déterminantes, il s’est fixé à Reykjavik où nous l’avons rencontré. Il nous parle avec une belle jubilation de sa nouvelle vie en Islande…
On découvre le Mjölnir (le nom islandais du marteau du dieu Thor) en haut d’une mini-colline, quasi protégé des regards dans une zone sans commerciale sans âme de la proche banlieue de la capitale islandaise. Le bâtiment ne paie pas trop de mine, mais sa visite, aussitôt entamée en suivant les pas de Valentin Fells-Camilleri, révélera vite qu’il est plutôt bien pensé, suffisamment en tout cas pour avoir gagné assez vite ses galons de premier club de sport de Reykjavik. Autour d’une tasse de café, Valentin se prête avec un entrain non feint au jeu des souvenirs…
Tu n’as que 31 ans, mais ton parcours révèle déjà une belle appétence pour l’ailleurs, les voyages, la découverte de beaucoup d’horizons…
C’est certain. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu voyager, mais j’ai commencé somme toute assez tard. L’Islande, une première fois, fut mon premier grand voyage sans mes parents. J’avais 21 ans. Et j’ai passé des vacances ici après avoir rencontré un Islandais, Gunnar, qui était jeune homme au pair à Colmar et avec lequel j’ai bien accroché. C’est lui qui m’a fait découvrir l’Islande durant trois semaines à l’été 2012. J’ai été immédiatement et totalement séduit. C’était avant le boom touristique de ces dernières années et j’avais été fasciné par ces paysages grandioses quasi vides de toute présence humaine. J’ai ensuite continué mes études à Strasbourg et s’est présentée une superbe opportunité à six mois de la fin de ma cinquième année de Master à Strasbourg où j’ai pu bénéficier d’un stage de fin d’études en Australie, au laboratoire de sport et de nutrition de
l’Université de Brisbane. Six mois fantastiques où j’ai pu continuer mes entrainements de jiu-jitsu et même participer à quelques compétitions, en même temps que je finissais ma thèse. Une fois le stage terminé, j’ai passé quelques jours en Asie puis en Nouvelle-Zélande, j’ai fait le tour du coin, quoi (rires). De retour en Alsace, mon diplôme en poche, j’ai fini par tourner un peu en rond, j’ai eu du mal à développer l’activité de coach que j’avais prévu d’exercer et, pour être franc, j’ai compris que si je voulais continuer à développer mon entrainement et être au top de mon sport, il allait falloir que je parte. J’ai pensé à Paris, aux États-Unis, j’étais très indécis… Au printemps 2016, je suis revenu à Reykjavik, à Mjölnir, pour
préparer les championnats d’Europe et le staff du club m’a alors dit que le club allait se développer en ouvrant une structure plus grande et m’a fait comprendre qu’il y aurait sans doute une opportunité pour moi. À mon retour en France, j’ai mis un maximum d’argent de côté et je suis finalement revenu en Islande au début de l’automne en me disant que je ne risquais rien à tenter ma chance au club, d’abord en m’y entraînant puis peu à peu, en y prenant des responsabilités en tant que salarié. Je raccourcis le récit, mais le hasard a bien fait les choses, vers la fin de l’année : le responsable de la section de compétition de jiu-jitsu a annoncé qu’il quittait son poste pour un autre job et, immédiatement, on m’a proposé sa place ! J’ai
accepté, mais franchement, je me sentais un peu nerveux : cet homme était mon modèle et je me suis dit qu’il allait vraiment falloir que je sois convaincant pour m’affirmer. Je me suis lancé, et, au fur et à mesure, tout s’est bien passé côté professionnel puisque je suis devenu entraîneur en chef de cette section de compétition, mais aussi au niveau sportif avec une belle troisième place à l’équivalent des qualifications européennes pour les JO, une victoire aux championnats nationaux chaque année depuis quatre ans et récemment une prestation remarquée lors du plus grand show européen de mon sport. Enfin, j’ai ouvert ma propre structure à Akranes (une localité à une cinquantaine de kilomètres du nord-est de Reykjavik – ndlr). Bon, j’ai volontairement occulté jusque-là une des raisons principales qui m’avaient fait m’établir durablement dans ce pays : je suis tombé amoureux d’une Islandaise, Tina, que j’ai rencontrée il y a cinq ans. On a eu notre bébé, Lena-Katrin, il y a deux ans… Tina est originaire de Akranes, voilà pourquoi nous vivons là-bas.
C’est une très belle histoire. Parle-moi maintenant des Islandais, vus avec les yeux de l’Alsacien que tu es toujours, mais qui vit à demeure depuis plus de six ans dans ce pays surprenant…
Sincèrement, je vois que beaucoup de mes habitudes ont changé. Je pourrais raconter une multitude d’anecdotes, évidemment… L’une est assez révélatrice, surtout avec l’époque que nous vivons aujourd’hui. Au début de ma vie de couple avec Tina, j’avais du mal à comprendre un truc qui était incroyable à mes yeux : les gens gardaient tout le temps les lumières allumées et ils n’étaient absolument pas économes avec l’eau, par exemple. Tout cela me paraissait aberrant, au vu de mon éducation française même si la latitude de l’Islande fait qu’en décembre ou janvier, on n’a au mieux que trois heures de lumière du jour quotidiennement. Au début, je passais systématiquement derrière elle pour éteindre la lumière et elle la rallumait aussi sec. C’est d’ailleurs devenu un jeu entre nous, depuis. Mais le prix de l’électricité, ici, c’est peanuts compte-tenu qu’elle est quasiment entièrement d’origine géothermique ou hydraulique. C’est pareil pour le chauffage, les gens laissent couramment les fenêtres grandes ouvertes et le chauffage à fond, ce n’est pas un problème. Les voitures électriques sont en plein boom dans le pays et la recharge est tout aussi peu coûteuse…
Sur un autre plan, il m’a fallu m’adapter. Tiens, rien que la traditionnelle bise à la française. Tant au niveau des hommes que des femmes, elle n’est pas du tout dans la culture islandaise. Ça ne se fait pas du tout ici. D’ailleurs, assez souvent, même dire bonjour ou au revoir n’est pas usuel non plus. Ça doit tenir au fait que nous sommes, au fond, une petite communauté, moins de 400 000 personnes sur toute l’île. Avec mes potes on se quitte le soir sans se saluer et le lendemain, en se retrouvant, on peut même redémarrer la conversation là où on l’avait laissée la veille. C’est assez étrange hein ?
Quelles sont les deux ou trois qualités, en général, que tu apprécies le plus chez les Islandais ?
Il y a cette valeur bien spécifique au peuple islandais qui est l’entraide. Sans doute là encore est-ce dû à cette petite communauté que nous formons. Les connexions spontanées sont beaucoup plus importantes que partout ailleurs. Si je rencontre quelqu’un que je ne connais pas, je peux être à peu près certain que pas mal de mes amis le connaissent. Alors, si on essaie de promouvoir des valeurs comme la bonté ou l’empathie par exemple, il y a de bonnes chances que beaucoup de rencontres deviennent très vite très positives. Bon, ça marche aussi dans l’autre sens, s’il y a un problème ça se sait très vite. Du coup, énormément d’opportunités inattendues se présentent : par exemple, je me suis souvent retrouvé dans des tournages de séries hollywoodiennes ou chinoises qui recherchaient des acteurs pour des séquences de combat. Dans un autre pays, il y aurait un casting d’acteurs, mais ici, c’est tellement petit qu’ils passent au club de sport le plus renommé et ils tombent vite immanquablement sur toi…
Si je me base sur les gens que j’ai connus ici, dès qu’on dépasse la première couche de personnalité juste après la rencontre, ils deviennent vite très authentiques et s’étalent alors volontiers sur qui ils sont, ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils vivent, ce qu’ils pensent. Mais je reviens sans cesse sur cette solidarité qui les caractérise tous. Je crois bien qu’elle est là la toute première qualité des Islandais. Elle se manifeste d’autant plus dans les tout petits villages : quand tu y arrives, tu n’auras sans doute pas droit tout de suite aux grands sourires et aux grands discours, mais l’entraide se manifestera assez vite.
Du côté du très positif, je pense aussi à la façon dont est considérée la maternité.
J’en ai évidemment bien pris conscience en devenant père il y a deux ans, c’est bluffant. Le congé de maternité, ici, c’est six mois pour la mère et cinq mois pour le père, sans parler d’un ou deux mois supplémentaires auxquels tu peux avoir accès en option. Au total, ton bébé peut rester avec toi pendant plus d’un an et tu es encore payé. Et ça vaut aussi pour les indépendants, ce n’est pas que pour les salariés. J’ai eu de la chance : en ajoutant les effets du Covid, j’ai eu ce privilège et ce bonheur d’être près de ma petite fille pendant presque deux ans. Elle comprend le français aussi bien que l’islandais et la connexion que j’ai avec elle est merveilleuse…
Et puis, il faut que je parle de cette ville étonnante qu’est Reykjavik. Bien sûr, elle n’est ni Londres ni Paris, mais il y a ici des intellectuels, des artistes, des créateurs et toutes sortes de gens curieux de tout, qui ne cessent de développer des modes et des tendances… Et comme la ville est petite, on les rencontre très facilement. Et je ne te parle même pas de l’atout le plus fantastique de la capitale : en moins de dix minutes de voiture, tu as accès à cette nature brute, l’océan, les montagnes… ça c’est un vrai, un gros, un énorme atout. Ici, le mix entre l’urbain et la nature est fantastique.
Et, a contrario, le négatif ?
En toute sincérité, pas grand-chose, vraiment… En me creusant fort, je dirais que nos quatre saisons traditionnelles en Alsace me manquent et il en va de même avec la langue française : comme je suis en contact avant plein d’Islandais, je parle tout le temps en anglais. Mon islandais est celui d’un gamin de cinq ans, j’avoue, mais je comprends l’essentiel de ce qui se dit. Du coup, en te parlant de ça, me vient à l’idée un trait de caractère qui serait un tantinet négatif : quand ils sont en groupe et que tu es avec eux, ils basculent très vite de l’anglais à l’islandais. Bon, rien de grave, c’est malgré eux, rien de volontaire… Finalement, ce qui est le plus handicapant est lié à l’insularité. En partir et y revenir est très coûteux, c’est une réalité.
Mais, tu vois, je cherche et je cherche pour trouver des choses à redire et au fond, il y en a si peu. Il y a un dicton, ici, qui dit un truc du genre : « Bah, pas de souci, ça va le faire… » Les Islandais sont un peu les Brésiliens de l’Europe : ils vont être un peu en retard, pas tout à fait carrés, mais, pas de souci, ça fonctionnera quand même, ils vont s’adapter tout en restant cool, mais, au final, tout se fera toujours comme prévu ou comme promis… » c
Ces Alsaciens sous les aurores boréales
Florent Gast « Mes attaches sont désormais dans ce pays… »
Alsacien d’origine puisque natif d’Obernai (mais il a vécu dans les Vosges dès l’âge de deux ans), Florent Gast, 34 ans, est passé par la Fac de Nancy pour une licence d’Anglais puis un Master de Français - Langues étrangères qui l’aura finalement amené en Islande pour un stage d’un semestre à l’étranger. Et ce fut le coup de foudre…

Il avait prévenu : la rencontre et l’interview ne pourraient se faire qu’avec ses deux filles, dont il avait la charge lors de la semaine. Aucun problème pour un tel deal sauf qu’on ne peut pas contraindre deux enfants de moins de dix ans à rester stoïquement sages pendant cinquante minutes, pendant que le papa raconte tant de choses à ce monsieur étranger qui veut tout savoir. « Pas de problème, je vais choisir un endroit où elles pourront jouer dehors… » avait dit Florent qui avait fixé le rendez-vous une fin d’après-midi, dans un bar à proximité immédiate de l’aéroport de Reykjavíkurflugvöllur réservé aux vols intérieurs islandais.
Situé à peine quelques kilomètres du centre de Reykjavik, l’endroit ressemble à une vague zone commerciale un peu désertée et le bar convenu occupe un de ces ex-hangars typiques de l’armée de l’air, avec son toit arrondi, qui pullulent dans la zone. L’intérieur, cependant, est joliment agencé et décoré et s’avère être un des spots les plus tendance de la capitale islandaise.
Florent n’aura besoin que d’un rapide coup d’œil, après avoir stationné son véhicule, pour juger l’endroit tout à fait sûr et pendant une heure, Andrea et Júlia gambaderont en totale liberté au milieu de quelques jeux d’enfants en plein air. Une seule fois durant l’heure de l’interview, leur papa sortira du bar pour jeter un coup d’œil : ce n’est pas la première fois où on réalise que, décidément, les enfants bénéficient ici d’une éducation à la responsabilité qui ne pourrait certainement pas s’exercer ainsi en France…
L’Islande en tête
« Pour ce trimestre à l’étranger dans le cadre de mon Master » raconte Florent, « j’avais postulé un peu partout, en
Norvège, en Lituanie mais aussi en Islande. En fait, j’avais depuis longtemps l’Islande en tête : je suis passionné de volcanisme depuis toujours et cette passion est née grâce à deux héros alsaciens, Katia et Maurice Krafft, cet incroyable couple de vulcanologues qui ont été victimes de leur passion en 1991, Katia et Maurice Krafft ont été emportés le 3 juin 1991 par une coulée pyroclastique sur les flancs du volcan Unzen au Japon. » (Un très beau doc réalisé par Werner Herzog, Requiem pour Katia et Maurice Krafft est encore disponible en streaming sur le replay de Arte – ndlr). « Je me souviens aussi des images de l’éruption de Heimaey sur les îles Vestmann, au large de l’Islande, que j’avais découvertes dans un livre qu’on m’avait offert alors que j’étais encore enfant. Et je ne vous parle même pas, bien sûr, de l’éruption de l’Eyjafjallajökull, en 2010, situé à peine 150 kilomètres de l’endroit où nous nous
En 2011, Florent postule donc pour un stage à l’Alliance française de Reykjavik,
programmé dans le cadre de son mémoire de Master. Début février, sous le statut de freelance, il enseigne le français à l’Alliance puis il profite d’un poste d’assistant de direction qui se libère pour se fixer en Islande. « Le poste recouvre en fait une multiplicité de responsabilités qui vont de l’administratif à la communication en passant par l’organisation d’examens et l’animation culturelle. Le tout notamment au profit d’une communauté française qui tourne autour de 300 résidents permanents mais il y a aussi pas mal de saisonniers qui s’ajoutent à ce nombre. Mais mon rôle principal n’est pas de m’adresser spécifiquement à eux, au contraire il s’adresse aux Islandais auprès de qui nous essayons de diffuser la culture française sous toutes ses formes ainsi que la Francophonie… »
« On m’a fait confiance dès le départ… »
Le temps de prendre quelques instants pour se lever et jeter un rapide coup
d’œil sur ses deux filles qui jouent à l’extérieur, Florent se met à commenter sa vie à Reykjavik : « Au niveau privé, j’ai un conjoint avec qui je vis et ce sont ses deux enfants naturels, je me suis donc très naturellement intégré à cette famille. Ici, tout est très ouvert d’esprit sur ces sujets, très gay friendly… Cela fait maintenant dix ans que je vis en Islande et franchement, je m’y sens très bien dans ma peau. En dehors de mon job à l’Alliance, je guide durant les mois d’été ce qui fait que je connais bien le pays. Au fur et à mesure de ces dix ans, j’ai appris l’islandais, ce qui me permet également de faire un peu d’interprétariat. La société islandaise est tellement petite que, très souvent, on rencontre des gens qui ont plusieurs casquettes, plusieurs cordes à leur arc. C’est fréquent. Mes activités me permettent donc de rencontrer beaucoup de gens et c’est autant d’échanges d’expériences.
Depuis 2010, il y a eu un boom touristique impressionnant et cet engouement pour l’Islande ne s’est pas démenti depuis. C’est d’ailleurs ce phénomène qui m’a permis de devenir guide, il y avait un fort manque local en ce domaine. On m’a fait confiance dès le départ, ça c’est un trait de caractère local. Ici, se lancer dans des projets transversaux est somme toute assez facile, au contraire de la France où il faut être bardé de diplômes et d’expérience.
Aujourd’hui que je suis devenu islandais de nationalité, je me sens suffisamment implanté pour essayer de parler de ce pays. Pour moi, il y a eu un avant et un après l’apprentissage de la langue. Quand on ne parle pas l’islandais, on a l’étiquette du visiteur qui finira toujours par repartir un jour ou l’autre : les gens sont polis et courtois mais ce sera assez difficile de nouer de vrais liens d’amitié. Mais l’islandais reste une langue très difficile à apprendre, ce qui est un handicap pour le pays qui a beaucoup besoin d’émigrés pour se développer. Sincèrement, les portes ne se sont vraiment ouvertes pour moi que lorsque je me suis senti assez confiant pour parler la langue quasiment en permanence… Alors, je pense que je suis légitime pour parler des Islandais : ce sont des gens chaleureux, sympas, sans doute un peu froids en apparence lors des premiers échanges, un peu comme des volcans qui seraient recouverts par un glacier ; l’image n’est pas de moi, elle est d’une jeune femme expatriée que j’ai connue ici… C’est peutêtre aussi dû au climat : il pleut souvent, il peut faire froid même si, curieusement, il fait en moyenne moins froid en Islande qu’en Alsace ! Il y a aussi ces deux mois
d’hiver où la luminosité manque. Alors, il faut s’occuper, il faut avoir des amis, il faut faire du sport et tout ça permet d’oublier et de surmonter cette obscurité qui n’est quand même pas totale : au solstice d’hiver, le soleil le lève vers onze heures le matin et se couche vers quinze heures. En attendant, nos deux filles ont eu droit à leur cuillère de foie de morue chaque matin à l’école : c’est un puissant apport de vitamine D… »
Une société paisible
Mais c’est sur les thématiques liées à la tolérance que Florent s’exprime le plus volontiers. Il en souligne les aspects très particuliers : « Ici, à Reykjavik, la gay pride annuelle est comme une institution, elle n’est pas fêtée que par les gays ou les transgenres. C’est une fête familiale, c’est la fête de l’amour universel. Quant au profil atypique de notre famille, il n’a jamais fait l’objet du moindre questionnement autour de nous, à l’école par exemple. En fait, j’oublie totalement ce qui pourrait être considéré comme une exception en France : certes, nous ne vivons pas comme la majorité des gens autour de nous mais ce n’est pas un sujet, je ne me pose pas de questions. Je n’ai jamais éprouvé le besoin de me justifier.
Sur un plan plus global, je sens que l’Islande est dans la bonne direction. L’insularité et le faible nombre d’habitants imposent que ce pays puisse s’ouvrir et c’est le cas, les Islandais le souhaitent dans leur très grande majorité. Les gens sont conscients que cet apport d’immigrés est indispensable.
Il n’y a globalement pas de gros problèmes de sécurité en Islande, vous le voyez bien d’ailleurs, mes deux filles jouent tranquillement dehors sans que je n’éprouve le besoin de les avoir sous les yeux toutes les cinq minutes. Dans le quartier que j’habite ; c’est très cool aussi. Les enfants prennent très vite l’habitude de se fréquenter dans les familles. Nous sommes tous reliés par une petite application style WhatsApp et quand je pose la question : « Où est Andrea ? », la réponse arrive vite : « Elle est chez nous, en train de prendre son goûter… » J’avoue que nous vivons dans une société paisible et c’est très agréable, je le vis comme un privilège. C’est sans doute un des pays du monde où élever ses enfants est le plus facile et le plus agréable… Ceci dit, le fait d’être un petit peuple n’est pas sans inconvénient : c’est très difficile de sortir sans rencontrer quelqu’un qu’on connait. Ce sentiment est permanent. Quelquefois, on aimerait bien vivre dans un certain anonymat. Du coup,
ça peut provoquer d’étranges sensations. Regardez nos maisons : elles n’ont pas de volets, elles ont de grandes baies vitrées, on ne cache rien, il n’y a rien à cacher… »
J’ai vraiment grandi…
Très vite, au cœur de ce bar branché de la capitale islandaise, la conversation bifurquera vers des thématiques liées à l’art et à la culture. Là encore, Florent n’est pas avare quand il s’agit de manifester sa satisfaction quant à son pays d’adoption : « On en a parlé, le climat et la luminosité quelquefois insuffisante poussent les gens à s’occuper de quelque façon que ce soit et dans ce cadre, l’art et la pratique artistique sont florissants. D’ailleurs, les Islandais consacrent beaucoup d’argent pour la décoration de leur intérieur et pour l’achat d’œuvres d’art. Il en va de même pour les équipements publics en la matière… » Et, très vite, de citer le Harpa, cette gigantesque salle de concerts et de conférences, à l’architecture d’une folle audace, construite à proximité immédiate du port, face à l’océan. « Je le raconte souvent quand je guide : la construction du Harpa a débuté très peu de temps avant la crise financière de 2008 et son édification a très vite été hors de prix. Il a même été question de stopper immédiatement les travaux. Mais il a été décidé que le contribuable mettrait la main à la poche et les travaux ont pu continuer. Quand il s’agit d’art, les Islandais réclament le meilleur et ce bâtiment est devenu finalement un marqueur, un emblème pour leur capitale… »
Tout au long de l’entretien, Florent sera resté soucieux de ne jamais employer un vocabulaire trop dithyrambique pour parler de ce pays qui l’a accueilli et où il se sent si bien tant professionnellement qu’humainement. Pour un peu le provoquer, en conclusion, on le pousse à se demander ce qu’il ferait si on lui proposait le même job très loin d’ici, avec un salaire doublé à la clé : « Pourquoi pas ? C’est d’ailleurs peut-être un projet de partir un temps ailleurs, oui, pourquoi pas ? Mais ce serait pour revenir tôt ou tard en Islande. Je sens que mes attaches sont désormais dans ce pays, il y a ici comme une forme d’insouciance, j’utilise mon vélo pour aller au travail, je suis à deux pas des montagnes et de l’océan, et partout en Islande, il y a cette belle ouverture d’esprit et ce gros potentiel d’opportunités. On m’a fait confiance sur énormément de choses. J’ai vraiment grandi. Je ne vois pas, pas plus en France qu’ailleurs, un pays où j’aurais pu réaliser aussi vite tout ce que j’ai fait ici… » c
La belle histoire Partir, se trouver, revenir…
Qui d’entre nous n’a jamais eu cette idée folle de tout plaquer pour « lever le camp », se frotter au grand frisson de l’aventure toutes voiles dehors, le temps au moins de faire peau neuve et se retrouver au plus intime de soi ? À bien y regarder, cette idée reste très souvent un simple projet pour beaucoup d’entre nous. Pas pour Thomas Waeldele, qui a sauté le pas il y a trois ans : cap vers l’Islande !
Il se pose devant nous dans l’intimité d’un petit bar de quartier près des Halles et instantanément, le courant passe. Peut-être parce qu’on se connait déjà un peu sans s’être rencontrés puisque la Consule d’Islande à Strasbourg, Solvenn Dromson, nous a remis le livre-photo que Thomas a réalisé pour conserver une trace de son périple au pays des Vikings… Il ne faut donc pas longtemps avant que ce gaillard aux yeux déterminés nous raconte tout ce qu’il a vécu il y a près de quatre ans. Et ça devient vite hyper passionnant… est au fond de moi » dit-il joliment…
À un léger détail près… Je n’étais pas heureux…
« C’est un énorme parcours personnel qui m’a conduit en Islande » racontet-il. « J’avais 43 ans en 2019, quand j’ai vraiment réalisé qu’à force d’essayer de rentrer dans des cases sans y parvenir, il me fallait bien envisager d’absolument tout changer. Peu de temps avant, j’étais encore Expert produits pour un grand constructeur automobile allemand, je passais mon temps à expliquer aux clients de A à Z comment faire fonctionner le
véhicule qu’ils venaient d’acheter. Ça me plaisait assez, car j’ai toujours été un passionné d’automobile. Ça, c’est pour la case boulot, mais j’ai coché également toutes les autres : marie-toi, je me suis marié ; fais un enfant, j’en ai fait un ; un bel appartement ? J’en avais un aussi. Et puis, une belle voiture, au vu de ma profession, ça n’a pas posé de problème… Bon, voilà, je cochais donc toutes les cases. Les copains, la famille, tout était super. À un léger détail près… Je n’étais pas heureux. Ma perception du monde me disait que j’avais envie de faire des choses avec beaucoup plus d’envergure.
Je me suis lancé… J’ai commencé par mettre fin à mon contrat avec l’envie d’entreprendre quelque chose plus en accord avec moi. L’option gestion de chambres d’hôtes s’est présentée : j’ai suivi quelques pistes, dans les Vosges et même jusqu’en Lozère, car je me sentais déjà très attiré par les coins un peu paumés où il n’y avait pas grand monde, au cœur des grands espaces. Rien de totalement convaincant, au final. En février 2019, je me retrouve une première fois en Islande, en vacances avec ma fille, sans doute influencé par un effet de mode qui avait vu tous les grands constructeurs autos se rendre là-bas pour tourner
leurs pubs dans des décors naturels quasi uniques au monde. À notre retour, je me suis en quelque sorte un peu fâché avec la France, car je trouvais que c’était un pays où c’était compliqué pour bosser, du moins avec ma vision des choses… »
Tempête sous un crâne, car manifestement, la volonté de radicalement tout remettre en cause venait de se faire jour. « Je me suis posé très franchement la question : je pars où ? Et l’idée de l’Islande est venue assez vite… » poursuit Thomas. « Après avoir un peu potassé le sujet et m’être notamment aperçu que le pays était classé deuxième au classement international de l’indice du bonheur de vivre, j’ai pensé que ça pouvait se tenter. À un moment donné, début décembre, je me suis décidé : après avoir vendu mon appart et m’être débarrassé d’un tas de trucs accumulés au fil du temps, j’ai mis le reste dans mon break et je suis parti par la route pour le Danemark avec l’intention de prendre le premier ferry pour l’Islande et de m’y installer. On était en plein Covid et je savais pertinemment que n’importe quel douanier avait alors parfaitement le droit de me refouler : l’air fatigué, fiévreux, je n’aime pas votre tête, je pense que vous
Les cristaux de glace en altitude irisent le ciel de Vik, la plage la plus au sud de l’Islande.


La route

avez le Covid, bref, vous faites demi-tour, vous n’entrez pas au Danemark… Mais c’est passé. En arrivant en Islande, j’avais une semaine devant moi, c’était prévu, car je devais m’isoler à cause des conditions sanitaires. Mais au-delà de cette semaine, c’était l’inconnu total ! »
poussé à partir au cœur de l’hiver, dans des régions aussi inhospitalières : « Je m’étais dit que quitte à partir dans un pays compliqué, autant vivre ça tout de suite au degré maximum » répond-il sans rien éluder. « Aller quelque part quand il fait beau, c’est facile, mais ça ne permet pas de se rendre compte de grand-chose. Le choix de partir en hiver, avec quelques heures à peine de faible luminosité par jour, était vraiment délibéré… »
ne connaissais vraiment pas grand chose du pays. Je me suis donc débrouillé tout seul pour tout et ce ne fut pas une mince affaire, avec les trois mots d’islandais que je baragouinais.
Immédiatement, la réalité de la situation a eu vite fait de se rappeler au bon souvenir de Thomas. C’est donc l’hiver et, à partir de Seyðisfjörður, le petit port de la côte est où accostent les ferrys, cet hiver-là ne fait pas de cadeau : « La météo est le critère absolu, elle dicte sa loi et s’impose à tout » dit Thomas. « En même temps, j’ai immédiatement compris qu’elle façonne ce trait de caractère spécifique des Islandais : ils vivent au jour le jour et ne prévoient que rarement à moyen ou long terme. Même prévoir un week-end est impossible pour eux !
À Seyðisfjörður, je suis dans le bain dès le premier jour et je réalise instantanément ce qu’est la spécificité d’un fjord : on arrive au niveau de la mer, mais à peine quelques kilomètres plus tard, on se retrouve sur des routes de montagne. Je n’avais pas trop potassé tout ça, mais je me suis vite rendu compte que même avec les quatre roues motrices et les pneus neige, ça allait tout de suite se compliquer considérablement… Je me suis souvenu de ce que m’avait dit un chauffeur de bus au mois de février précédant, ou plutôt un pilote de bus tant conduire est compliqué dans ces régions : il faut apprendre à conduire entre le haut des piquets qui balisent la route. J’ai vite compris là encore, car tout est soudain devenu brutalement tout blanc, la route, les bascôtés, le ciel… La seule solution : se concentrer au maximum pour rester tant bien que mal entre les fameux piquets. J’étais sous pression, d’autant plus que juste avant mon départ, il y avait eu un glissement de terrain dans le village qui avait emporté une trentaine de maisons ! Dans ma tête, je me disais : il n’y a pas 24 heures que tu es là, le blizzard est arrivé, il y a eu un gigantesque glissement de terrain… OK, c’est L’Islande, ça va être du brutal. Sincèrement, par moments, je me suis dit qu’il allait falloir essayer urgemment de comprendre ce que survivre voulait dire… »
Bien sûr, en écoutant Thomas raconter ce genre d’épisodes, on ne peut que se poser la question de savoir ce qui l’avait
Le trajet prévu emmenait l’aventurier à longer la côte Sud du pays en évitant l’immense et impressionnant glacier du Vatnajökull qui barre tout le sud-est du pays, l’objectif étant de passer le Nouvel An à Reyjavik, qu’il atteindra après trois semaines passées au pied du célèbre volcan Eyjafjallajökull, désormais rendormi depuis son éruption catastrophique de 2010.
Passés les dix jours dans la capitale islandaise, Thomas s’est consacré au woofing , cette pratique qui consiste à travailler bénévolement dans une ferme en échange du gite et du couvert. « Et c’est là que j’ai commencé à me poser les vraies questions concernant les raisons profondes de ma présence ici » se souvient-il. « Je me rendais compte chaque jour de la chance que j’avais : tu bosses, tu tournes la tête, tu as un glacier avec un volcan en-dessous, tu te retournes et à peine deux kilomètres plus loin, tu as l’océan Atlantique ! Souvent, le soleil ne montant vraiment pas très haut et pas longtemps dans le ciel, les lumières en-dessous des nuages étaient fantastiques… Mais, malgré tout, au bout de trois semaines, je me suis senti devenir un peu blasé de l’endroit… Je me suis dit que je vivais ce que j’avais envie de vivre, certes, mais que mon voyage intérieur était bien plus gigantesque encore…
J’ai donc repris la route, des heures et des heures à ne croiser aucune voiture, Covid oblige. Mais des haltes inoubliables face à des paysages incroyables et inédits. Trois mois après mon arrivée sur la côte Est, j’avais effectué le tour complet de l’île, quasiment 9 000 km… »
Il me fallait cette violence-là…
Aujourd’hui, trois ans après son incroyable périple au cœur de l’hiver islandais, Thomas Waeldele reconnait avoir eu la réponse à beaucoup de questions qui le harcelaient. « L’avantage de ce voyage a été de me retrouver en perte totale de repères, car à mon arrivée en Islande, je
Ce voyage m’a fait comprendre une réalité profonde : je n’étais plus fait pour les grands systèmes, tels que ceux dans lesquels je baignais depuis si longtemps. Quelque chose d’autre a joué aussi dans le sens d’une prise de conscience totale : il y a quand même eu une paire de jours où j’ai réalisé de près que ma vie pouvait s’arrêter dans les minutes qui suivaient. Quand tu roules à peine à 10 km/h dans le blizzard, les feux plein pot, que tu passes le fameux piquet sans voir le suivant et que tu sais que d’un côté tu as la falaise et de l’autre le ravin, ça t’amène à profondément réfléchir, tu relativises beaucoup de choses, crois-moi…
Il me fallait cette violence-là pour pouvoir vivre ce que j’avais au plus profond de moi. Et ce que j’avais, c’était la conviction que c’est le local avant tout qui m’inspire : ça repose sur une seule envie, à partir de là où on habite, pouvoir construire son logement, se nourrir et pouvoir éventuellement trouver les plantes pour se soigner.
Fort de cette réalité, ma réalité en fait, de retour en France, j’ai entamé une formation de naturopathe, mais je l’ai arrêtée, car elle m’emmenait de nouveau dans le schéma que j’avais si mal vécu auparavant.
Alors, depuis la mi-mai dernier, j’ai entamé un tour de France dans un fourgon aménagé pour rencontrer toutes sortes de gens dans des écolieux, des communautés, pour voir comment ils vivent avec des formats de vie plus simples mais ensemble ! La prochaine étape sera de m’installer quelque part : soit je crée mon lieu de vie, soit je m’intègre dans un lieu de vie existant et qui me correspond. Je viens de terminer une formation de permaculture en Bretagne pour acquérir les bases de l’essentiel du cycle de la nature et travailler les ressources qu’on a naturellement autour de soi. Et à partir du printemps prochain, je vais reprendre la route… Je vais ainsi continuer de cultiver ce que j’ai appris de la phrase du grand aventurier Mike Horn : “Pour commencer à marcher, il suffit d’avoir la réponse à 5 % des questions qu’on se pose. Le reste, les 95 %, ils viennent en marchant…” Et puis, il y a cette conviction que j’ai acquise grâce à l’Islande et qui est désormais si enracinée en moi : j’aurai ce qu’il faut au moment où il le faudra… » c
OK, c’est L’Islande, ça va être du brutal…

L’Islande à Strasbourg Six mois de découvertes
Depuis novembre dernier (et jusqu’au 1er juin prochain), l’Islande présidera le Comité des ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Les 46 pays membres de l’Institution alternent à cette fonction tous les six mois. Autant dire que, pour chacun d’entre eux, leur présidence représente une rare et unique occasion de concentrer la lumière sur leur pays. L’Islande a décidé d’en profiter à plein pour qu’on parle beaucoup d’elle dans notre capitale européenne…
Le visage de l’Islande à Strasbourg est celui de deux femmes à la réelle complicité qui ont beaucoup œuvré de concert pour que les six mois de la présidence islandaise du Comité des ministres du Conseil de l’Europe mette dans la lumière le pays cher à leur cœur.
Ragnhildur Arnljótsdóttir, Ambassadrice de l’Islande à Strasbourg
L’Ambassadrice de l’Islande à Strasbourg, Ragnhildur Arnljótsdóttir, entourée par son staff opérationnel, nous accueille plus que chaleureusement à la Représentation Permanente du pays dans la capitale européenne.
« Cette présidence représente pour mon pays une superbe opportunité. Nous sommes bien sûr très fiers de présenter nos priorités à cette occasion » résume-t-elle spontanément avant que nous l’interrogions sur nos perceptions ramenées de notre séjour en Islande. En tout premier lieu, la tolérance dont on a le témoignage presque partout, même dans les villages les plus reculés, avec la mise en valeur du fameux « Rainbow Flag » aux frontons des bâtiments officiels : « Votre remarque est très judicieuse » réplique tout de suite Ragnhildur Arnljótsdóttir, « l’égalité
est au centre de notre vie sociale en Islande et les programmes officiels du pays en tiennent compte. Pour l’Islande, c’est au cœur de la notion de liberté. Par exemple, la Gay Pride qu’on organise chaque mois d’août dans le pays est devenue une immense fête populaire qui va bien au-delà de ses motivations initiales. En fait, l’Islande respecte au plus haut point le droit de chaque individu de vivre de la façon dont il a choisi de vivre, voilà tout… »
Presque dans la logique de ses derniers propos, Ragnhildur Arnljótsdóttir développera ensuite longuement tous les espoirs mis par son pays dans l’éducation des jeunes générations que l’Islande aimerait « voir érigée en modèle pour d’autres pays européens ».
Revenant à ce « moment important et exceptionnel » qu’est la présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe par son pays, l’Ambassadrice tient à « mettre en valeur le programme culturel que l’Islande propose aux Strasbourgeois pendant les six mois à venir soit une dizaine d’événements dont certains assez exceptionnels tels, notamment, un concert avec une soirée à l’Opéra le 24 février ou encore, La passion selon Saint-Jean à la Cathédrale de Strasbourg le 29 mars… »
Nous incitant longuement à commenter notre perception de son pays à l’issue
de notre périple de septembre-octobre dernier, s’amusant de l’une ou l’autre de nos réflexions, l’Ambassadrice aura finalement cette conclusion spontanée : « J’ai vraiment hâte de vous lire… »
Voilà qui est fait, Madame…
Solveen Dromson, Consule et amoureuse dingue de l’Islande
Blonde comme les blés et porteuse de ce prénom aux consonances nordiques, on pourrait jurer qu’elle est née au pays de la glace et du feu. Mais non, Solveen Dromson est bel et bien alsacienne. « Notre famille a des origines suédoises en fait, L’Agence immobilière Dromson, que je dirige depuis le décès de mon père, est en effet bien connue à Strasbourg. C’est une histoire d’amitié entre mon père et le Consul général qui a conduit mon père à devenir Conseil honoraire de l’Islande à Strasbourg, après que le pays ait décidé de ne plus maintenir son Consulat général à Strasbourg, en 2008. Papa s’est alors consacré à plein à son rôle, il a multiplié les séjours en Islande et a noué ici un nombre impressionnant de partenariats culturels ou économiques. Il s’est pris au jeu et s’est vraiment donné à fond, il aimait vraiment faire découvrir
ce pays à un maximum de gens. À mon niveau, j’ai toujours été assez fascinée par l’Islande où je m’étais rendue une première fois dès le début des années 2010. Et mon père m’a incluse dans certains des projets qu’il a menés, notamment l’invitation de l’Islande au Marché de Noël de Strasbourg, en décembre 2017. Ce pays est mystérieux, envoûtant, et je suis très sensible à toutes les légendes qu’il a pu engendrer depuis ses très lointaines origines : les elfes, les volcans, les conditions de vie qui ont longtemps été d’une extrême rudesse… »

À la disparition de son père, en 2018, Solveen Dromson se voit être choisie par l’Islande pour devenir à son tour Consule à Strasbourg. « Il y avait plusieurs candidats, comme toujours en pareil cas, et le choix qui s’est porté sur moi m’a bien sûr beaucoup émue. J’ai été nommée en novembre 2019. Il y a bien sûr eu la période du Covid où tout a été fermé et c’est durant cette période que le ministère des Affaires étrangères m’a avertie qu’une Représentation permanente du pays allait s’ouvrir à Strasbourg. Pour moi, c’était inespéré, j’allais avoir une équipe avec qui travailler. L’intégration à cette équipe a été immédiate et nous avons beaucoup travaillé depuis pour être à la hauteur de ces six mois où l’Islande préside le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Avec cette équipe, nous avons monté


le programme culturel de ces six mois et j’ai fini alors par me rappeler soudainement des fameuses “Destinations de légende” que la rédaction de Or Norme avait imaginées il y a quelques années. J’avais adoré cette idée d’aller très loin pour rencontrer les Alsaciens qui vivent et travaillent à l’étranger. L’idée de recréer cette thématique avec l’Islande est née de là et je suis vraiment folle de joie à l’idée de lire dans Or Norme le récit de votre voyage et de vos rencontres là-bas… La Représentante permanente, Ragnhildur Arnljótsdóttir, a tout de suite adhéré à cette idée elle aussi et elle partage le plaisir qu’elle aura à voir son pays ainsi exposé dans vos colonnes… » c
 Solveen Dromson, Consule d’Islande à Strasbourg
Patrice Dromson
Un tram aux couleurs de l’Islande circule à Strasbourg
Ragnhildur Arnljótsdóttir, Ambassadrice d’Islande à Strasbourg
Solveen Dromson, Consule d’Islande à Strasbourg
Patrice Dromson
Un tram aux couleurs de l’Islande circule à Strasbourg
Ragnhildur Arnljótsdóttir, Ambassadrice d’Islande à Strasbourg
La Playlist de Emmanuel Didierjean L’Islande, Terre de feu musicale
L’Islande fait partie des pays où la proportion de musiciens par habitant est parmi les plus importantes au monde. Le climat et le caractère des Islandais s’accommodent en harmonie avec les musiques. Vraiment plurielles.
1. BJÖRK
Artiste complète, Björk est aussi connue pour son tempérament que pour son travail. Parmi ses disques les plus significatifs, Medúlla, uniquement composé et travaillé à la voix, en compagnie de Robert Wyatt (Soft Machine), Mike Patton (Faith No More) ou encore le beatboxer américain Rahzel.

2.SKÁLMÖLD
Le viking metal est un genre musical à part, très présent dans le nord de l’Europe. Et Skálmöld en est un digne représentant. Leur musique ? Un mélange entre la puissance des guitares et la finesse de la musique folk. Le président islandais Guðni Th. Jóhannesson est un fan, qui a même écrit quelques lignes dans la biographie du groupe parue en 2021.
3.ASGÉIR
Cet auteur-compositeur mélange les musiques folk, rock et électro pour un résultat léger comme une bulle, minéral comme l’eau des volcans. Une musique portée par une voix aigüe rare chez un chanteur. Son dernier album, Time on my hands, est sorti cette année.
4. JÙNIUS MEYVANT
Un crooner soul au look de viking ? Ça existe. De son vrai nom Unnar Gísli Sigurmundsson, il prouve que si l’habit ne fait pas le moine, le talent fait tout. Son album Guru, publié en 2022, est un bijou de douceur.
5. JÓNSI
Que ce soit avec son groupe Sigur Ros, avec son compagnon dans le duo Jónsi & Alex ou en solo, Jón Þór Birgisson promène sa voix de fausset sur des chansons dont la langueur et le spleen font le charme absolu et discret.
6. SÓLSTAFIR

Entre la furie du metal et le mysticisme nordique, Sólstafir a décidé de ne pas choisir. Le groupe propose depuis plus de 25 ans une musique mystérieuse. Leur album Ótta (2014) est inspiré par ce moment, entre 3 et 6h du matin, quand la nuit cède face au jour naissant.
7. EMILIANA TORRINI
Islandaise d’origine napolitaine, Emilana Torrini c’est la rencontre entre le Stromboli et le Sneffels, les deux volcans de départ et d’arrivée d’un certain Voyage au centre de la Terre. Douceur pop et incandescence rock.
8. HATARI
Représentant de l’Islande à l’Eurovision 2019, où ils ont atteint la 10e place, un record, ce trio bien bourrin propose un mélange de musique électronique et de musique industrielle. Leur nom signifie Haineux.
9. HILDUR GUÐNADÓTTIR
Le film Joker, inspiré du célèbre méchant de l’univers Batman a obtenu 2 Oscar. Un pour son acteur, Joaquin Phoenix. L’autre pour Hildur Guðnadóttir, violoncelliste et auteure de cette bande originale. On lui doit aussi les trames de la série Chernobyl ou du film Sicario avec Jóhann Jóhannsson.
10. JÓHANN JÓHANNSSON
Décédé en 2018, il était l’un des plus prolifiques compositeurs de musique contemporaine islandaise. Compositeur aussi pour la télé et le cinéma, il laisse une œuvre riche entre néo-classique, rock et pop.






Apéro mortel
La mort se dépoussière
L’association strasbourgeoise Maintenant, l’après organise des Apéros mortels pour discuter, sans tabou, de toutes les questions autour de la mort et des obsèques. Dès l’an prochain, elle proposera aussi des services de pompes funèbres, via une coopérative funéraire en cours de création.
Les fausses araignées et les poupées sanguinolentes qui décorent le Café Grognon – saison d’Halloween oblige – ne troublent pas la dizaine de personnes rassemblées dans une pièce privatisée. « On se retrouve ce soir pour discuter du métier de croque-mort. Toutes les questions sont bienvenues et nous y répondrons autant que possible », annonce Valentine Ruff. Membre fondatrice de l’association Maintenant, l’après, elle anime cet Apéro mortel, organisé dans le cadre des Rendez-vous mortels de la semaine de la Toussaint.
À ses côtés, Caroline Laemmel, croquemort de son état, débute la conversation.

« Jusqu’à la fin du monopole des pompes funèbres en 1993, on parlait de “régleurs”, puis sont apparus les assistants funéraires. Aujourd’hui, l’intitulé exact de notre métier est conseillé funéraire : notre travail consiste à écouter les familles afin de les accompagner au mieux dans l’organisation des obsèques de leur proche, expose-t-elle d’une voix posée. De la gestion administrative au déroulement de la cérémonie, nous sommes un peu des couteaux suisses. »
Il n’en fallait pas davantage pour briser la glace. Autour des petites tables, quelques femmes et un peu moins d’hommes d’âges divers sont venus, qui
Mélissa Bissessur, présidente de l’association.

par curiosité, qui en écho à une expérience personnelle, qui encore pour avancer sur un projet de reconversion professionnelle… « Est-ce que les pompes funèbres sont les premières personnes à appeler en cas de décès à la maison ? » « Peut-on trouver des pierres tombales d’occasion ? » « Nous avons dispersé les cendres de mon père dans les vignes, mais en avait-on le droit ? »
OBSÈQUES ÉTHIQUES
Même quand les questions pourraient paraître saugrenues ou que les témoignages convoquent des souvenirs douloureux, les échanges ne tournent jamais au vinaigre. C’est précisément pour offrir ce type d’espaces de discussion que l’association Maintenant, l’après a été créée en 2019. « Notre objectif, c’est à la fois de dédramatiser le sujet de la mort et de réfléchir au sens que l’on donne aux rites funéraires », précise Mélissa Bissessur, la présidente de l’association.
Il faut bien reconnaître, en effet, que la mort a déserté nos quotidiens. Elle survient le plus souvent à l’hôpital ; le deuil est devenu un cheminement essentiellement intime et ne se porte plus guère en public. Pour autant, les questions n’ont pas disparu, bien au contraire. L’affaiblissement des croyances et des rituels religieux ouvre le champ des possibles : que faut-il expliquer aux enfants ? À qui peut-on confier ses dernières volontés ? Peut-on choisir un texte pour ses propres obsèques ? Autant de thèmes abordés au cours des Apéros mortels organisés régulièrement. Mais l’association veut aller plus loin. « Nous avons à cœur de faire bouger les lignes pour que les cérémonies et les choix funéraires puissent correspondre aux valeurs des personnes décédées et de leur entourage », résume Mélissa Bissessur. Concrètement, les bénévoles de Maintenant, l’après militent pour que de nouvelles solutions soient autorisées par la loi, notamment l’humusation des corps. Une coopérative funéraire est également en cours de création et démarrera ses activités à Strasbourg début 2023. « Grâce à des partenariats avec des artisans et des artistes locaux, nous pourrons proposer des obsèques différentes, plus éthiques », promet Valentine Ruff. Elle-même s’est formée au métier de conseiller funéraire et elle officiera au sein de la coopérative. De quoi rendre la mort un peu plus vivante. S
Plus d’infos : www.maintenant-lapres.fr
« Notre objectif, c’est à la fois de dédramatiser le sujet de la mort et de réfléchir au sens que l’on donne aux rites funéraires. »

Le digital nomadism
Nouvel Eldorado des générations Y – Z
Plus encore depuis la crise sanitaire, le digital nomadism séduit de plus en plus d’indépendants ou de salariés qui n’ont besoin que d’un ordi et d’une connexion Wifi pour travailler, sans contrainte géographique. Rencontre avec trois Strasbourgeoises qui ont sauté le pas.
Troquer son fond d’écran pour une vraie vue océan. Bosser pour soi ou profiter de la poussée des remote jobs, ces CDI 100% en télétravail, pour travailler où le vent nous porte. Le digital nomadism a de quoi séduire les flippés du métro-boulot-dodo et du traintrain quotidien. En 2020, ils étaient 6,3 millions de travailleurs dans le monde à avoir adopté ce mode de vie. Quelques confinements plus tard, on en comptait déjà 10,2 millions, selon plusieurs études statistiques récemment compilées par Passport photo online. 59% d’entre eux seraient des hommes, avec un temps de travail hebdomadaire de 46h et un revenu mensuel moyen de 4 475€.
Être digital nomad, c’est pouvoir bosser partout dans le monde – en prenant en compte le décalage horaire – avec un ordinateur et une bonne connexion internet. Sans surprise, ce mode de vie attire surtout les indépendants dans le numérique (rédacteur, monteur, community manager, développeur, etc.), de la génération des Millenials (nés après 1980) pour 44% d’entre eux, suivis de près par la génération Z, née après 1995.
Mais concrètement, ça fait quoi de larguer les amarres, sans domicile fixe ? Témoignages de trois Strasbourgeoises. S
Krystel, 36 ans, community manager établie à la Réunion
Une révélation
Krystel a débarqué dans la capitale alsacienne à contrecœur. « Je rêvais plutôt de sud ou d’étranger, sourit-elle. Mais j’avais un prêt étudiant à rembourser… » Pendant sept ans, elle fait ses armes chez Novembre, une agence de pub, avant de se lancer en solo. « Je n’ai jamais été sereine en tant que salariée, je sentais que je pouvais davantage m’épanouir. Je me suis mise à mon compte, je voulais ne dépendre de personne et voyager comme je le voulais. » Son premier voyage de deux mois en 2015 en Amérique du Sud marque le début de sa nouvelle vie : « C’était comme une révélation. J’ai eu l’idée de monter une boutique en ligne pour valoriser l’artisanat local, de lancer mon blog. L’idée était de
combiner mon expérience de voyage avec un business. » Elle fait un tour du monde en solo en 2018 et rentre avec 18 kilos de stock sur le dos. En six mois, tout est écoulé. « C’était une année exceptionnelle, avec 30 000 visites par mois sur mon blog, des partenariats, des chroniques sur RBS…. »

unepartdumonde.fr
Instagram : @unepartdumonde_
Mélanie, 28 ans, Entrepreneuse
À son retour à Strasbourg, elle sent déjà l’envie de repartir. « En 2020, je voulais faire le tour de l’Afrique et renflouer ma boutique. Et puis le COVID est arrivé. » Elle ne restera qu’une semaine au Sénégal avant de revenir en urgence. Déprime totale. En octobre, elle décide de partir sur un coup de tête à la Réunion. « J’avais constitué mon réseau professionnel, mes clients sont essentiellement Strasbourgeois. Ils sont super open et m’apportent une vraie force pour continuer mes voyages. Ils me suivent, ça les fait rêver quelque part. Quand je vais dans des zones où j’ai peu d’Internet comme récemment à Madagascar, je les préviens. Tout est question d’organisation. »
Hyperactive, Krystel ne compte pas ses heures. Ses journées démarrent par une heure de surf, elle fait au moins une randonnée en semaine et bosse le reste du temps. Sur l’île, elle se sent ancrée, à sa place. « Pour la première fois de ma vie, j’ai moins la bougeotte. J’ai une réflexion plus poussée sur l’avion aussi : si je pars, c’est minimum un mois. » Le secret pour réussir le travail à distance : « Être responsable de ses heures et de ce que l’on produit. Le seul frein, c’est la peur... » S
«
Après le COVID, comme beaucoup, on a eu envie de voyager, avec mon compagnon, Samuel. On a lâché notre appart, acheté un camping-car qu’on a baptisé Léon, et sillonné la France pendant un an. Lui a pris un congé sabbatique. Moi, comme je venais de monter ma boîte, j’ai continué à travailler. J’ai pris un deuxième téléphone, avec 200 Go pour le partage de connexion. Mon copain a pris un convertisseur pour pouvoir jouer à la console la nuit ! Je me versais 2 500 euros par mois pour nous deux, comme lui n’avait pas de salaire. Vivre dans un camping-car, ça coûte plus cher, il fallait rembourser notre crédit, changer la bombonne à gaz tous les cinq jours, prévoir le budget visites, stationnement, courses… Cela suffisait pour nous deux sans être très confortable ! On restait trois semaines/un mois ou quelques jours au même endroit. Moi je bossais la journée, mes clients étaient super compréhensifs.


J’ai travaillé pendant toute l’année. Une société sur le net, c’est plus facile à gérer à distance. Mais parfois, on a dû se déplacer par manque de réseaux. Au bout d’un moment, j’ai ressenti le besoin de rentrer en Alsace, de retrouver ma famille. Travailler dans un camping-car, ce n’est pas évident, tu as l’impression d’être en vacances ! J’ai besoin de stabilité, d’un endroit dédié pour travailler. Samuel, lui rêve de repartir. Peut-être plus tard… » S
www.laplumerose.fr www.writeandgoldagency.com
Krystel allie voyages et boulot depuis 2017.Mélanie, Samuel… Et Léon !
« J’ai finalement eu besoin de retrouver une stabilité »
Cécile, 25 ans, salariée dans une agence de marketing digital irlandaise

Après le COVID, les embauches étaient plus compliquées, j’ai décidé de passer un deuxième master en Angleterre. Je suis restée un an là-bas. Au début, j’ai eu le mal du pays, et puis j’ai décidé de sortir de ma zone de confort, de m’intégrer. En février, j’ai décroché un poste dans une agence de marketing digital irlandaise. Tous les 300 salariés sont en total remote, CEO inclus. Je suis revenue en Alsace en avril pour revoir ma famille – les déplacements étaient compliqués pendant le COVID. Mais début 2023, j’ai décidé de faire un mois, un pays, en Europe ou en Afrique du Nord, en sous-location ou en coliving. Je reviens de trois semaines au Canada, et travailler avec le décalage horaire est plus compliqué. Mon entreprise nous laisse organiser nos journées, le deal dans le télétravail, c’est de rester joignable et d’être organisé. Sans un minimum de To do list , tu es facilement noyé !
Je suis en portage salarial, j’ai juste pour obligation de revenir tous les trois mois en France. Si tu veux vivre à l’étranger ou dans une autre ville française, il faut selon moi aller à la rencontre des gens, sortir de son cocon. C’est comme cela que je vis les choses. J’ai construit beaucoup de bouts de vie un peu partout, on y laisse toujours un morceau de nous. Je ne sais pas si je pourrai vraiment revenir à Strasbourg, j’ai toujours envie de repartir à l’aventure. » S.
Instagram : @cecilesfr
« J’ai toujours envie de repartir à l’aventure »

La Caténaire
Plus qu’un Tiers lieu, un Lieu pour des tiers
Virginia Woolf voulait « une chambre à soi », la foisonnante tribu de « La Caténaire » voulait « une pièce vide » dans ses locaux, un de ces espaces dont on rêve tous, un lieu laissé vacant pour y accueillir l’inattendu. Et, en fait de « pièce vide », ce sont trois salles parfaitement équipées qui ont été dégagées au rez-de-chaussée du 17 rue d’Obernai à Strasbourg.
Indépendantes les unes des autres et toutes ouvertes sur une de ces cours intérieures dont le quartier Gare a le secret, elles peuvent être louées « pour des cours de yoga, des ateliers, des journées de formation professionnelle, des réunions, des projections, des expositions, des conférences de presse et pourquoi pas des résidences d’artistes ».
Un tiers lieu en quelque sorte ?
Plutôt « un lieu pour des tiers », nuance Thierry Danet, qui co-dirige Artefact, la structure aux manettes de La Laiterie et du festival des cultures numériques L’Ososphère.
C’est autour de ce festival passionnément connecté à l’espace urbain que se sont rencontrés les occupants du lieu en 2009 : Quatre 4.0 – L’Ososphère bien sûr, mais aussi l’Agence Candide, CNb.archi et Radio en Construction (REC) bientôt rejoints par Creative Vintage créé en 2015 par une ancienne collaboratrice de l’agence Candide.
Une tribu au plus beau sens du terme, des partenaires dotés de leur propre parcours, mais habitués « à faire des choses ensemble » et à les faire « en partageant les mêmes points de vue sur ce qu’il y a à faire et la manière de le faire ».
Rassemblés depuis mai dernier dans l’immeuble de la rue d’Obernai, leur but n’était pas d’aménager « juste de beaux bureaux », mais de « créer
Partagez une cuisine de cœur et de saison. Retrouvez-vous autour de déjeuners, d’apéros ou de dîners.

un lieu » qui ait du sens dans « une ville qu’ils aiment » au sein d’un passionnant quartier Gare qui est « tout sauf un quartier concept ».
« On veut contribuer à sa dynamique et le faire vivre autrement que par la spéculation immobilière », confirme la joyeuse équipe.
DES SALLES OUVERTES À TOUS LES USAGES
Le nom de « Caténaire » est lui-même porteur de sens et renvoie à l’histoire de ce quartier Gare qu’ils affectionnent.
Bien identifiable par la fresque de basketteur qui orne sa façade de briques, l’immeuble a abrité les bureaux et entrepôts de l’entreprise Ihm und Weber au début du XXe siècle avant d’être cédé en 1924 à la Société des équipements des voies ferrées pour y installer des ateliers de petite mécanique et électricité. Des rails anciens subsistent sous le dallage de la cour et
renvoient à ce passé industriel, l’idée de « caténaire » est née de ces vestiges et elle a fait mouche. « Quoi de mieux que de se placer sous le patronage de ces structures porteuses de lignes d’énergie ! »
Quant au basketteur, pas question de s’en séparer. Il « signe » la façade et rappelle qu’au début des années 2000, l’immeuble abritait un magasin de sport.
Répartis sur trois niveaux, les membres de « La Caténaire » occupent de beaux espaces de bureaux et soulignent qu’il reste de la place à l’étage de Creative Vintage.
Les « pièces vides » du rez-de-chaussée sont quant à elles ouvertes à la location depuis début décembre. Les réservations ont débuté, les « lignes d’énergie » circulent à « La Caténaire ».
Ouverte à tous et à tous les usages, elle se veut « un lieu pour la ville » animé par une équipe fédérée autour de trois mots : « enthousiasme, complémentarité, synergie ». S
L’équipe de La Caténaire au grand complet. De gauche à droite : Maxime Gil (Radio en construction), Isabelle Poutard (Agence Candide), Thierry Danet (L’Ososphère), Laure Patry (Agence Candide), Guillaume Christmann, Xavier Nachbrand (CNb.archi), Jeff Loth (Creative Vintage).
La Caténaire Contact : info@ktnr.eu Insta : @lacatenaire


Le bistrot « plus » Le Frech Dàcks
Bistrot, café, salle de spectacles… Le Frech Dàcks, c’est le cabinet de curiosités de Strasbourg. Un lieu de vie, d’échanges, d’éveil des papilles, d’accès à la culture populaire ou popularisant la culture, c’est selon.

Mi-novembre, le Frech Dàcks fêtait ses 100 jours. Première belle victoire pour ce « gamin effronté » en alsacien, qui a connu un sacré retard au démarrage en raison des confinements successifs. Pas de quoi décourager ses darons, Christian Ruppert et Franck Mothes, qui se sont rencontrés sur cette idée inédite à Strasbourg d’allier spectacle vivant et bistronomie. Niché rue Bucher, la petite ruelle piétonne attenante à l’avenue de la Marseillaise, le Frech Dàcks, c’est un bistrot, un café, une salle de spectacles, « un lieu de joie, de papilles et de découvertes, où l’on vient pour s’amuser », confie Franck Mothes, en charge de toute la partie restauration. « Lors des dîners-spectacles ou des soirées musicales, la salle se transforme en stammtisch géant. On permet aussi aux acteurs culturels locaux de se faire connaître. C’est un peu une thérapie de groupe ! ».
« C’EST UN CABINET DE CURIOSITÉS QUI INVITE À SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT »
Jazz, pop, blues, blind test, karaoké, théâtre, musique lyrique… La programmation construite par Christian, le créateur de l’agence de communication Graffiti, se veut éclectique. « L’idée, c’est de permettre de s’ouvrir à des choses que l’on n’irait pas voir forcément, souligne Franck. Le Frech Dàcks, c’est un cabinet de curiosités invitant à sortir de sa zone de confort. »
Côté planning, le gamin effronté propose entre jeudi et samedi deux soirées musicales où l’on dîne à la carte. Son concept repose aussi sur un
Marie Bouttier, Sans titre , vers 1899, 32 x 25 cm, mine de plomb, collection privée, courtoisie galerie J.-P. Ritsch-Fisch


dîner-spectacle par semaine au tarif unique (entre 49€ et 55€), incluant entrée, plat, dessert, et show. « Les Strasbourgeois ne sont pas encore habitués à ce concept de menu qui existe déjà à Paris ou Lyon, certains aimeraient juste prendre une bière et regarder le spectacle, mais nous voulons pouvoir continuer à payer les artistes. C’est difficile à défendre, mais c’est notre parti-pris, et le seul moyen de continuer avec une jauge de 70 personnes. » Et à bien y réfléchir, dans les restos strasbourgeois, on a vite fait d’atteindre les 49€ par personne, et sans spectacle… « Ce qui nous surprend agréablement, c’est l’ambiance de ces soirées, rapporte Franck. Notre clientèle a plutôt trente-quarante ans et plus, ils sont plus enclins à participer que les jeunes, et davantage volontaires à s’amuser ! »




Pour 2023, les deux acolytes envisagent de proposer des soirées « improsplanchettes » les mardis un peu plus calmes, et d’accorder davantage de place au théâtre dans leur programmation. Le Frech Dàcks est aussi ouvert à l’heure du déjeuner, avec un plat du jour à 13€ et une ardoise changeant régulièrement, selon l’arrivage du marché.
Un bistrot canaille, culturel et décalé, en résumé, où il fait bon vivre, que ce soit sur sa terrasse d’été avec vue sur l’un des plus jolis ponts de Strasbourg. Ou en intérieur l’hiver, dans un cadre feutré propice à refaire le monde, à rire, vibrer, et déguster. S


Frech Dàcks – 4 rue Pierre-Bucher, Strasbourg Toute la programmation sur lefrechdacks.com Réservation recommandée.




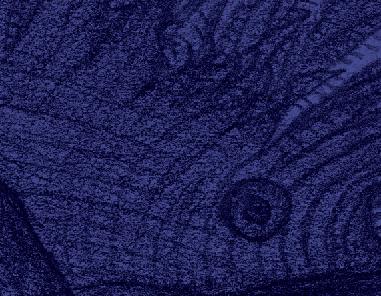







« On permet aussi aux acteurs culturels locaux de se faire connaître. C’est un peu une thérapie de groupe ! »
La Halle gourmande
réussit son pari
possibilité de déguster sur place. On y fait ses courses – les plus pressés peuvent même utiliser le click & collect – on peut y déjeuner ou y prendre un snack, sur le Food court central orchestré par le Théâtre du vin. C’est d’ailleurs le seul point à améliorer, pour fluidifier l’attente des gourmands et faire comprendre aux clients qu’ils peuvent choisir leur plat ou encas sur les stands, avant de s’attabler pour commander un bon verre de vin, un soft ou un café. Le groupe Géraud, à l’initiative de la Halle et représenté par le Strasbourgeois Vincent Léopold, a ainsi embauché une personne dédiée pour guider les clients un peu perdus.
Inaugurée mi-octobre au Marché gare, la Halle gourmande, réunissant 14 commerçants de bouche ultra select autour d’un Food court dédié à la dégustation, démontre, s’il était besoin, que les Strasbourgeois attendaient ce concept depuis longtemps.

On se doit de l’avouer, on faisait partie des sceptiques : qui pourrait avoir envie d’aller faire ses courses au Marché gare, aussi léché soit le concept ? Eh bien, un monde de dingue ! Notamment le week-end.
Il faut dire que le concept est séduisant, pile dans l’air du temps : une halle, entièrement dédiée aux bons produits, dans un cadre soigné, avec en plus la
Poissons, fruits de mer, viandes, fromages, fruits et légumes, fruits secs, produits italiens, pains et pâtisseries, condiments, traiteurs… La Halle concentre tout ce dont on a besoin, sans – trop –tabasser niveau tarifs. Chaque semaine, les commerçants proposent aussi une offre promotionnelle.
Ce qu’on aime ? Pouvoir y accéder facilement à vélo ou en voiture, au choix. On attend aussi la navette bus proposée lors du dernier conseil municipal pour en faciliter l’accès. À en croire ce démarrage des plus prometteurs, « les commerçants ont a minima atteint leurs objectifs de chiffre d’affaires », confie Vincent Léopold, on se prend à espérer une petite sœur de la halle gourmande en plein cœur de Strasbourg… Et pourquoi pas dans l’ancien immeuble du Printemps ? S
41 rue du Marché Gare – Strasbourg. Du mardi au dimanche. Halledumarchegare.fr
 Marine Dumény
Marine Dumény
Amenez vos vinyles...
...et écoutez l’amer au LAÀB
Il a débarqué à Strasbourg le 18 juin, 2021. Non loin des bords de l’Ill, près de la caserne de secours et incendies, de grandes tablées s’alignent jusqu’à une porte en bois massif. Imposante, rouge. L’entrée franchie, nous voici mis dans le bain : des vinyles parent un mur et annoncent la couleur. Attention à la synesthésie, et bienvenue au « LAÀB », bar musical !



L a chaleur du bois enveloppe les lieux et se marie à la décoration haute en couleur, souvent « faite maison ». Néon, planche de skate, sombrero et instruments… L’ambiance est résolument accueillante. Anthony Rousseau et Emmanuelle « Manue » Lesquerade ont travaillé des années ensemble dans la restauration, jusqu’en 2019, avant de monter ce projet. Ils possèdent, chose rare et notable, chacun 50% des parts de l’affaire, et à les entendre, il est aisé de comprendre pour quelles raisons. Ils travaillent de concert, et se complètent. Leur terrain d’entente – outre le bar ? La musique. Manue est guitariste et Anthony, grand amateur de notes.
Plus de 300 vinyles sont contenus dans la bibliothèque d’Anthony et du LAÀB. « Vous pouvez amener le vôtre », ou faire votre choix parmi ses références. Ici, pas d’ACDC, pas de Johnny. « Et nous avons un droit de véto ! », plaisantent (mais pas trop) les propriétaires du bar. Le client trouvera une sélection faite de
« bons groupes », parfois plus confidentiels, avec une grande part de « rock indé, de post wave ou de punk rock ».
Toutefois, lorsque le vinyle est choisi, c’est dans son intégralité, et « dans l’ordre », insiste Anthony, qu’il faudra l’écouter. Pourquoi ? Pour le simple fait que la plupart de ces petits bijoux ont une construction réfléchie et définie, « chose qui a disparu avec le CD ». Vous l’aurez saisi, nous sommes chez des passionnés. Or, qui dit passion, dit partage.
LIVE, QUIZZ ET RENCONTRES : LA MUSIQUE SOUS TOUTES SES FORMES
Ce partage, les deux comparses le font vivre sous forme de concerts, de scènes ouvertes et autres Jam, réguliers. La programmation varie. Les thématiques également. Et ils mettent un point d’honneur à rémunérer autant que faire se peut les artistes qui se produisent en
 Anthony Rousseau et Emmanuelle « Manue »
Anthony Rousseau et Emmanuelle « Manue »


« Ici, le cadre, et le service, signent l’identité du bar.
“On ne peut pas plaire à tout le monde”, dit l’adage, et ce n’est pas le but de l’établissement. »
concert, notamment grâce à une aide (le GIP café-culture, dont les fonds sont issus du Ministère de la Culture et des collectivités territoriales – ndlr), et sur fonds propres, à proposer lorsque c’est possible un ingé son, et à accueillir les groupes avec un minimum de matériel. Sur sept mois, à raison de deux ou trois par mois, ce sont 29 groupes rémunérés qui se sont produits au LAÀB. Et ce, sans compter les Jam et autres scènes.
ET AVEC CETTE BONNE MUSIQUE, ON CONSOMME QUOI ?
Une fois par mois, des quizz musicaux sont organisés avec un groupe live. « Nous réfléchissons aussi à un blind test avec les vinyles, un karaoké avec un groupe. Mais aussi de nouvelles animations en plus de nos rencontres autour des musiques brésilienne (Roda de Choro), celtique ou encore du Moyen-Orient, ou des cafés thématiques », complète Manue.
Omettre la dimension « bar » du LAÀB serait une erreur. Une fois musicalement satisfait, le curieux, ou l’habitué, n’a plus qu’à s’installer au comptoir pour choisir une bière – de préférence locale, ou toute autre boisson, ou aller se poser en salle (ou au sous-sol lorsque celui-ci est ouvert). Une petite faim ? Une fois encore la rigueur est présente dans la carte, par exemple : « des AOP, et du lait cru pour les fromages ». L’idée est de servir de la qualité, dans les assiettes ou les tartines, en composant avec un prix abordable. Derrière le comptoir, Manue, Anthony ou encore Léandre, le troisième larron du bar, sauront vous conseiller dans la joie et la bonne humeur. « Même en plein rush ! », rit Manue.
Ici, le cadre, et le service, signent l’identité du bar. « On ne peut pas plaire à tout le monde », dit l’adage, et ce n’est pas le but de l’établissement. Dernière information, et pas des moindres pour cerner le décor ? « LAÀB, c’est pour la mer à boire/ l’amer à boire ». S
Le LAÀB – 1 rue du bain Finkwiller Strasbourg Ouvert du Lundi au vendredi, de 16h30 à 1h et le samedi à partir de 18h. Happy Hours : 17h-20h Pour la programmation : page facebook et IG @laab.strasbourg









C’est à Strasbourg et c’est unique en France !
Contre l’obsolescence dans l’Industrie
Factoryyy est strasbourgeoise, et unique en France. Ses clients sont des industriels. Depuis 2017, elle leur offre la possibilité de contrer l’obsolescence programmée de leur matériel en leur recréant, parfois même sur mesure, des pièces désormais introuvables ou hors de prix. Car, si vous trouvez que votre lave-linge ou votre téléphone ne dure pas dans le temps, dites-vous bien qu’il en est de même pour une entreprise. Une durée de vie programmée pour une pièce industrielle, en voilà une aberration !
L’adresse ne manque pas de cachet. Le quai Koch offre une vue imprenable sur la Gallia, Saint-Étienne et les berges de l’Ill. De l’autre côté de l’imposante porte du numéro 4, Sylvain Claudel, fondateur et directeur technique, nous invite à le rejoindre en salle de réunion. Avec vingt ans de carrière dans l’industrie à son actif, l’ingénieur en plasturgie n’en est pas à sa première structure.
La création de Factoryyy tient à une anecdote, qui prend place durant l’Hacking Industry Camp, d’Alsace Digitale, vous nous la racontez ?
Durant cet évènement, ÉS (Électricité de Strasbourg) était venu avec une pièce que leur compagnie ne parvenait plus à sourcer. Des tentatives pour imprimer la pièce en 3D avaient été menées, mais la pièce avait cédé. Le matériau utilisé n’était pas le bon. J’ai tout de suite identifié la technologie, vu de quelle façon on
pouvait relancer la pièce. Une rencontre s’est faite, et nous avons fait le job. Pour l’anecdote, lors de l’entretien de remise de la pièce, nous avons mélangé, au gré des manipulations, toutes les pièces sur la table. La mienne n’étant pas marquée, nous avons confondu celle d’origine avec ! Très satisfait, ÉS a ramené un carton de pièces avec, entre autres, une pièce métal.
Cette pièce image en grande partie une nécessité du secteur industriel, pouvez-vous nous expliquer en quoi ?
C’est un cliquet d’enclenchement, de la tringlerie. Vous retrouvez ça dans des disjoncteurs HTA. Le principe est similaire à un disjoncteur classique : la pièce permet d’ouvrir les contacts comme à la maison… Sauf qu’on est sur du 63 000 volts ! Il s’agit d’une pièce de sécurité.
Le problème avec les pièces détachées, ce sont les délais de confection et de livraison. La structure a été construite autour de
cette idée, notamment dans les domaines de l’industrie et de l’énergie, puisque nous avions commencé avec ÉS. Ce sont souvent des fournisseurs qui font faillite et ne livrent plus, ou qui choisissent de ne plus faire une gamme d’appareils et les prix explosent parfois jusqu’à fois 10, fois 100 pour inciter à racheter du matériel neuf. Et ce, sans parler des périodes d’obsolescence : 10 à 15 ans.

Vous avez misé sur le local pour vos partenaires, à 90 %. Pourquoi est-ce important pour vous ?
JLa région a un bassin de compétences très intéressant. Et la proximité permet d’avancer très rapidement sur des problématiques complexes. En outre, il faut absolument solliciter et entretenir l’industrialisation de la région. Surtout au vu de l’excellente réactivité obtenue. Factoryyy, c’est donc 99 % de partenaires en France (90 % dans le Grand-Est). Le reste de nos fournisseurs se trouve en
« Le problème avec les pièces détachées, ce sont les délais de confection et de livraison. La structure a été construite autour de cette idée. »Sylvain
Claudel, directeur de Factoryyy
UE. Nous ne nous tournons vers la Chine que pour tout ce qui ne présente pas d’alternative, notamment les aimants néodyme.
Qu’en est-il du coût, le local revient-il plus cher ?
La comparaison entre nos prix et ceux de Chine ne peut pas se faire. Nous gagnons beaucoup en délai de réalisation. Ce que cherchent nos clients, c’est de la réactivité, de la qualité, et un bon service client. En cas de besoin d’ajustement, c’est important. Il arrive qu’à 0,5 mm près il faille rerégler certaines pièces. Un exemple pas si anodin puisqu’on a d’ailleurs eu le cas avec un client, sur une pièce qu’on a refaite spécifiquement pour lui.
Ces délais tiennent entre six semaines et un an. Le processus débute au démarchage, vient ensuite la création du jumeau numérique de la pièce (après réception), puis les plans en 2D et 3D pour plus de précision et la prise de côtes et un dessin (pour vérifications). Une fois à ce stade, on consulte nos partenaires, avant de lancer la production. Nous sommes systématiquement sur la bonne matière, grâce à du « reverse engineering » (une méthode d’étude et d’analyse, ici de matériaux –ndlr), qui est un vrai gain de temps. Le contrôle qualité et la validation sont faits
par nos fournisseurs-partenaires, qui expédient dans la foulée les pièces. Au besoin, un stock est créé. À noter que pour certains assemblages, nous faisons appel à un ESAT.
Factoryyy est encore en développement, quelle sera sa direction ?
D’un point de vue technologie, nous allons bientôt en tester une nouvelle, pour réaliser des moules en 3D et y injecter la matière voulue, ce qui réduirait les coûts.

Concernant le commercial, après une période prolifique avec le Covid, notre CA est multiplié par deux ou trois tous les ans. L’an passé était plus complexe, l’activité a connu un blanc jusqu’en mai, cependant nous revoici en course, avec des consultations à la SNCF par exemple, ou encore à l’étranger. Nous avons un projet avec Safran.
Enfin, nous travaillons à mettre l’accent sur la partie RSE, puisque, même si ça n’intéresse pas forcément les gens sur le terrain, ça intéresse leurs responsables, à Paris. En effet, des pièces produites en France, c’est déjà un impact carbone amoindri. Factoryyy permet de prolonger la durée de vie des machines. Et en prime, on augmente la sécurité grâce à notre réactivité. Le marketing et le ciblage vont être retravaillés en ce sens. S
Les pièces conçues pour ÉS« La région a un bassin de compétences très intéressant. Et la proximité permet d’avancer très rapidement sur des problématiques complexes. »






Franck Horand
Les gens sont
tous
extra-ordinaires…
Après des études d’arts plastiques à l’université de Strasbourg, où il a exploré peinture, sculpture et, faute d’atelier, art conceptuel, Franck Horand s’est dirigé vers la photographie. Donner à voir, révéler, raconter, comprendre que la photographie n’est que rencontre avec des histoires, des histoires de rencontres, voilà ce qu’il travaille chaque jour, après l’avoir enseigné en tant qu’instituteur.
« À mes élèves j’ai appris, pour citer Paul Klee en le détournant un peu, que “photographie et dessin sont identiques en leur fond” dit-il. En ajoutant : “Pour raconter ces histoires, j’ai toujours privilégié le portrait, à la rencontre des gens, les gens qui sont tous extra-ordinaires quand on les aime de nos yeux de photographe. Depuis maintenant plus de deux ans, je construis un projet de mémoire de demain, Unchain my Hoerdt, en photographiant les 4 500 habitants de Hoerdt, le village où je me suis installé”.
le suivre sur instagram @franckhorand @unchainmyhoerdt sur facebook Franck Horand Photographie Unchain my Hoerdt
Contact : franckhorand@gmail.com








LA PROPRETE N’EST PAS NOTRE UNIQUE TALENT, NOUS NOUS ENGAGEONS AUSSI DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.
La nature est fragile, protegeons-la !
22, rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden Tél. : 03 88 20 23 81 www.hygiexo.fr
TERTIAIRE - INDUSTRIEL - ERP ET COLLECTIVITES - SECTEUR DE LA SANTE - COPROPRIETES - COMMERCES

REVISITER BASHUNG FIGURE LIBRE
Quarante ans après sa sortie, Figure imposée, album déjanté et Dada d’Alain Bashung, renaît à la vie. Pascal Jacquemin, auteur des textes, s’est entouré des musiciens historiques du grand Alain pour Rejouer Figure imposée. L’un des projets rocks les plus excitants de ces dernières années.
Àpresque un demi-siècle de distance, c’est facile à dire bien sûr, mais il n’empêche : à la réécoute, Figure imposée a tous les attributs d’une matrice. Il y a dans ce disque inclassable et très (trop) mésestimé l’essence même de l’œuvre de Bashung. Le Bashung de Roulette russe et de Pizza , et puis celui d’après, le Bashung de P assé le Rio Grande , de Chatterton , de Fantaisie militaire et on peut même pousser jusqu’à celui de l’impeccable Bleu pétrole sans forcer.
Aussi imparfait soit-il, et imparfait il l’est assurément, cet album est un moment charnière dans la carrière de l’interprète de Gaby , peut-être pas au creux de la vague ce serait exagéré, mais entre deux eaux c’est certain.
Play blessures , coécrit avec Serge Gainsbourg, opus sombre et dépressif, teinté de ce soupçon de new-wave qui lui allait si mal au teint était sorti l’année d’avant et avait été un échec foudroyant, de ceux dont on peut ne pas se relever. Bashung, lui, s’en était remis comme on sait. Figure imposée ne lui a peut-être pas permis de rebondir, mais au moins de savoir quelle direction il voulait prendre.
« Alain avait une grande peur, celle d’être un chanteur “kleenex”, ça l’obsédait », se souvient Pascal Jacquemin, parolier de Figure imposée. « Il ne voulait pas qu’on le résume à des tubes. Il en avait besoin bien sûr, mais il avait des choses à dire, des choses profondes. Il savait où il voulait aller ».
Retour en 1983. Le monde va mal (déjà) et Bashung pas très bien non plus. Nous sommes en pleine guerre froide, les missiles du Pacte de Varsovie sont pointés sur ceux de l’OTAN et inversement. Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre incarnent un ultralibéralisme qui fera les ravages que l’on sait, Lennon et Bobby Sands sont morts, le punk pas encore. L’Iran et l’Irak sont en guerre,
Alain Bashung, auteur-compositeurinterprète et acteur français, né à Paris à 1947 et décédé en 2009.

Jl’Afghanistan aussi. Malouines, Sabra et Chatila, Sida, Khomeini sont des noms qui résonnent si forts qu’ils en deviennent assourdissants.
En France, la gauche, elle, a déjà pris le tournant de la rigueur, l’espoir d’un nouveau monde s’est fracassé sur l’écueil de la réalité. Il y a décidément longtemps que Trenet chantait Y’a d’la joie , on dirait que c’était il y a un siècle et ça n’en faisait qu’à peine la moitié. Figure Imposée est le reflet de cette époque, de ce chaos intérieur.
Après des années de galère, Alain Bashung, lui, a touché le sommet. Voilà deux ans que, Pizza, son troisième album, porté les énormes tubes que sont Vertige de l’amour et Gaby Oh Gaby, cartonne. En pleine ascension, il décide subitement de couper les gaz et d’interrompre sa collaboration avec Boris Bergmann. Il veut expérimenter d’autres voies. Tout risquer plutôt que de se perdre. « Alain était en recherche permanente, il n’arrêtait jamais de se remettre en question », dit son épouse, la chanteuse Chloé Mons. Ce sera d’abord Play blessures donc et
dans la foulée ou presque Figure imposée re-donc, avec sa sublime pochette très réalisme soviétique des années 30 signée Pierre Buffin.
IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE D’OÙ VIENT CET OVNI…
Pascal Jacquemin a 26 ans à l’époque, il a découvert la musique de Bashung par hasard un soir alors qu’il avait trouvé un job d’été dans une station-service du Haut-Rhin. Musicien lui aussi, le voilà à Paris. Il s’est mis en tête de rencontrer Bashung, au moins de lui faire écouter une cassette de sa musique. De fil en aiguille, parce que l’époque était comme ça aussi, le voilà guitariste sur la deuxième partie de la tournée Vertige de l’amour et puis parolier de ce nouvel album qui ne doit ressembler à aucun autre.
Ils sont sur scènes et rejouent Figure imposée. De gauche à droite, Yan Péchin, Bobby Jocky, Arnaud Dieterlen, Basile Jacquemin, Pascal Jacquemin et Fred Poulet.

« ALAIN ÉTAIT EN RECHERCHE PERMANENTE, IL N’ARRÊTAIT JAMAIS DE SE REMETTRE EN QUESTION. »
« Avec Gainsbourg et Bergmann, c’était plus prestigieux, mais il se sentait peutêtre moins libre, je ne sais pas, confie aujourd’hui Jacquemin. Alain voulait du sang neuf, mais que ce Chloé Mons J



J soit quand même dans la continuité, que ça ne le fasse pas complètement dérailler non plus. Pour moi, à l’époque, c’était un sentiment étrange, entre préoccupation et insouciance en fait. Ce qui m’importait, c’était que les textes ne soient pas anodins, je voulais des choses profondes, mais avec une légèreté quand même, tous les deux on était raccords là-dessus. Il n’y avait pas de retenue, pas de règle. Et au final, l’album est une sorte de mash-up qu’on a construit ensemble. »
Si le terme d’OVNI n’était pas aussi galvaudé, il aurait été une parfaite définition de cet album un peu Dada, un peu baroque, profond et léger, carrément barré. Une « dinguerie assurément, et c’était là toute sa force... et sa faiblesse (commerciale) » dit aujourd’hui Pascal Jacquemin. Impossible alors de comprendre d’où vient cet Ovni. La critique ne l’a d’ailleurs pas compris et le public pas davantage. Si Figure est aussi solaire et énergique que Play était ténébreux et dépressif, l’échec commercial est le même. Le public boude et la critique s’écharpe entre ceux pour lesquels cet opus est l’équivalent du disque blanc dans la carrière des Beatles et ceux pour qui c’est l’album « le plus chiant de l’année ».
Quarante ans plus tard, le débat est tranché, ce n’est ni l’un ni l’autre. Figure imposée est un creuset et puis une passerelle, un point d’appui aussi. En février 1984 dans Libération , le critique Philippe Barbot expliquait ça autrement et bien plus poétiquement : « c’est une sorte de château hanté. Personne n’est assez crétin pour y croire tout à fait, mais tout le monde sait confusément qu’il est vraiment habité. » Sous-entendant que celui qui l’habite ce château, c’est l’esprit, peutêtre même la substance de Bashung.
Au-delà du coup déjà fait de la nostalgie, Rejouer Figure Imposée est avant tout et par-dessus tout un geste artistique, d’une « richesse incroyable », dit Pierre-Jean Ibba, le directeur de la salle de spectacles l’ED&N (prononcer Eden) à Sausheim, dans le Haut-Rhin qui a soutenu le projet. « Il est porté par des musiciens qui sont de sacrées pointures. Je ne me rendais pas compte que c’était ambitieux à ce point-là. Ce n’est pas un album forcément facile d’accès, mais c’est ça qui est passionnant. Tous les mots ont un sens, tous les mots ont du sens. »
Le spectacle, car ce n’est pas uniquement un concert et un disque c’est
un spectacle, est aussi une expérience. Totalement originale puisque quarante ans ont passé, que le monde a changé et la musique aussi (les solos de saxo ne se font plus trop).
« La figure imposée demandée à cette formation de rêve est de donner envie aux spectateurs d’écouter ou de réécouter la version originale bien sûr, mais aussi de s’immerger dans un album complet, avec les émotions et la puissance de l’interprétation live, mêlées aux vibrations d’aujourd’hui, dit encore Jacquemin. « Ce sera également le moyen de se replonger dans le début des années 80 et à la création de ce disque, grâce au film de Fred Poulet. »
De l’hypnotique S piele mich an die wand à What’s in a bird , interprété par Rodolphe Burger, en passant par Elégance , Poisson d’avril , Hi , Chaque nuit bébé ou Imbécile , il y a dans cet album très largement de quoi s’amuser et réinterpréter. D’autant que le spectacle s’annonce évolutif au fur et à mesure qu’il avancera dans le temps et dans l’espace, et que des artistes viendront poser leur voix sur les morceaux. En perpétuelle (r)évolution. a

ON PEUT SE TROMPER DE FORMATION
mais l’erreur c’est de ne rien faire pour en changer et préparer dans les meilleures conditions la vie professionnelle de ses rêves !
NE PERDEZ PAS DE TEMPS, LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE DÉCALÉE DE MARS SONT OUVERTES. Venez découvrir nos formations ECS & SUPDEWEB en 1ère année dans les univers de la communication et du digital sous toutes ses formes.
Campus MediaSchool Strasbourg
16 rue du Bassin d’Austerlitz Strasbourg 1er étage, au-dessus du restaurant Léon de Bruxelles en empruntant l’escalier métallique. 03 88 36 37 81 strasbourg@mediaschool.eu

Vingt ans de concerts, de créations, de rencontres et de mutations, ça se fête. Le groupe Ozma s’est plié d’excellente grâce à la formalité, et a mis le feu à la Briqueterie de Schiltigheim pour l’occasion. « Ce concert du 8 octobre restera dans nos mémoires ! », souffle Stéphane Scharlé, batteur et compositeur de cette formation « explosive jazz », comme ils le revendiquent.
Fondé au tournant de l’année 2002 à Strasbourg, à l’occasion du concours d’entrée au Conservatoire du guitariste Adrien Dennefeld, le groupe a grandi avec ses musiciens. « Nous étions étudiants, à peine vingtenaires, lors des premières répétitions. Ozma a accompagné et participé à nos vies d’adultes », résume Stéphane. Ozma joue en quintet depuis 2004, une musique à l’écriture pointue et précise, mais ouverte à des influences allant du funk à l’électro. Sur scène règne une grande générosité, héritée notamment des racines rock qu’ils ont en partage.
Ces ingrédients ont fait la recette du concert anniversaire, baptisé Ozma XX et programmé dans le cadre de la saison Jazz d’or 2022-2023. Les membres actuels du quintet ont laissé leur place à des anciens le temps de quelques morceaux, et se sont serrés pour accueillir à leurs côtés une kyrielle d’invités : des musiciens des Percussions de Strasbourg, le griot burkinabé Moussa Coulibaly, des cuivres de l’expérience « Ozma Orkestrâ » ou encore des étudiants du Conservatoire.
MATIÈRE MOUVANTE
(Hélas) peu prophètes en leur pays, les jazzmen ont construit l’essentiel de
JAZZ OZMA, EN APOTHÉOSE
Le quintet strasbourgeois « d’explosive jazz » a fêté ses 20 ans lors d’un concert mémorable le 8 octobre, à la Briqueterie. L’occasion de célébrer deux décennies de tournées internationales et de dessiner de nouveaux projets.
leur carrière lors de tournées internationales. C’est pourtant à Paris que leur trajectoire a été impulsée, en 2006, lorsqu’ils ont remporté le concours Jazz à la Défense. Les portes de la professionnalisation s’ouvrent alors, de même que les frontières. Allemagne, Hongrie, Ukraine, Suède, Inde, Chine, Brésil, Burkina Faso, Namibie… leurs instruments accumulent les visas.

Jusqu’aux États-Unis, quelques jours à peine après le concert Ozma XX. « Pour des raisons administratives, nous avons dû recruter un saxophoniste américain pour jouer avec nous là-bas. Il a enrichi la musique de sa propre histoire et de son jeu. » Plus que jamais, Ozma est une matière mouvante, autour d’un noyau
Les musiciens d’Ozma sur la scène de la Briqueterie.
dur qui garantit son identité : Stéphane Scharlé, donc, à la batterie, et Édouard Séro-Guillaume à la basse et aux claviers. Sous une forme ou une autre, le quintet n’a pas l’intention de s’arrêter : ils seront en tournée en Europe début 2023. Un second projet prend également forme : le programme Propulsion, partagé entre Strasbourg et le Luxembourg, pour accompagner deux jeunes groupes de jazz pendant un an. Qui ne pourraient rêver de meilleurs mentors ! a
Dates, vidéos et infos : www.ozma.fr
La Terre demande toute notre attention

D’ÉMISSIONS CARBONE -15% 2023
La Terre demande toute notre attention, est l’engagement de chacun d’entre nous à être, chaque jour, totalement impliqué à atteindre nos objectifs, ambitieux et passionnants, éthiques et pragmatiques, pour l’environnement.
Au programme : neutralité carbone en 2050, recyclabilité et réutilisation à 100% de tous nos nouveaux produits et préservation de la biodiversité dans tous nos sites. Parce que notre engagement doit être durable, nous avons créé notre programme d’actions collaboratives « Tous engagés pour la Terre ». wienerberger.fr
L’AMÉRIQUE DU NORD ET LA FRANCE DE MOLIÈRE M. SOUL, DU MANITOBA À L’ALSACE
Crinière blanche, répartie agile et humour en bandoulière, M. Soul parle d’abondance et chante comme il respire. En français et en anglais, car ce désormais Strasbourgeois est né à Winnipeg dans la province anglophone du Manitoba d’une mère canadienne et d’un père… breton…
L’
Alsace, il l’a découverte au gré d’un parcours haut en couleurs d’abord mené de ville en ville au Canada et en Amérique du Nord. Winnipeg, Vancouver, Montréal, Minneapolis, etc., l’auteur-compositeur-interprète s’est produit partout ou presque, dans des concerts et festivals où des amis cajuns l’ont un jour convaincu d’écrire en français.
Marcel (M.) Soulodre (Soul) a dit « banco » et s’est mis en quête d’un co-parolier jusqu’à ce qu’une amie de RadioCanada lui suggère Bernard Bocquel un journaliste installé à Winnipeg, mais originaire du… Neudorf à Strasbourg.
Ensemble ils ont écrit une chanson puis de plus en plus de chansons et enregistré un album que Marcel est allé présenter à Paris après avoir rencontré la famille de Bernard en Alsace.
Quelques aller-retour transatlantiques plus tard, il s’est installé chez nous en 2010 pour proposer une musique bien à lui entre rock, blues, folk, country et chanson.
UN AUTOPORTRAIT MUSICAL

Tout un monde entre deux mondes, l’Amérique du Nord et la France de Molière. Pour le meilleur de la variété dont se revendique « le chansonneur ».
Présenté au centre culturel de Drussenheim à la rentrée, son dernier album s’intitule Hello Out There – Le Manitoba vous répond, clin d’œil à l’album d’Hergé Le Manitoba ne répond plus » découvert enfant dans la bibliothèque municipale de Saint-Boniface, quartier francophone Winnipeg.
M. Soul y dresse, en anglais et en français, un autoportrait musical où transparaissent son amour de la vie et des voyages, mais aussi ses inquiétudes. Galère raconte la fatigue, Swingtime Baby alerte sur l’urgence climatique, Birthday questionne la pression des technologies sur nos vies…
« I’m a storyteller » résume l’artiste… a www.m-soul.com
Véronique Leblanc Bartosch Salmanski

MICRO-UTOPIES TÔT OU T’ART, UNE HISTOIRE DE REG’ART
« Être utile à vivre et à rêver » chantait jadis Julien Clerc et ces mots auraient pu être écrits pour l’association TÔT ou T’ART née en 2001 et aujourd’hui nichée au sein de « La Fabrique », rue du Hohwald.
Cécile Haeffelé, directrice de TÔT ou T’ART
F ondée sur la conviction que l’accès à l’art sous toutes ses formes a le pouvoir de bousculer notre rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres, cette structure se veut courroie de transmission entre les institutions culturelles alsaciennes et les personnes confrontées au handicap, à la pauvreté, à la réinsertion.
Pour sa directrice Cécile Haeffelé, « il est essentiel de reconnecter les publics fragilisés aux lieux de culture parce la culture nous fonde tous, y compris ceux qui en sont éloignés ».

Pas moins de 95 structures alsaciennes jouent le jeu, précise-t-elle en citant, entre autres, l’Opéra du Rhin, l’Orchestre philharmonique, le TJP, le Maillon, Pôle Sud, l’Espace Django, le Vaisseau… Sans oublier les musées, les châteaux, les cinémas et autres festivals. En début de saison, toutes transmettent un lot d’entrées gratuites à TÔT ou T’ART
qui peut ainsi installer une billetterie solidaire, mais, précise Cécile, « il s’agit aussi pour nous d’aller plus loin et de mettre en place l’accès à une pratique artistique qui soit une expérience de reconnexion à soi et à la vie ».
VIVRE ENSEMBLE
« Ce n’est pas simple pour les personnes fragilisées », ajoute-t-elle. Si nous voulons créer les conditions de confiance, nous devons compter sur la médiation des travailleurs culturels, sociaux et médico-sociaux. »
« L’échange est essentiel entre tous ces acteurs, y compris les artistes qui s’investissent de plus en plus. Il faut réfléchir aux objectifs, aux formats, créer des partenariats pour faire vivre une démocratie culturelle aux couleurs du vivre ensemble. Chacun apporte sa contribution et notre rôle est d’être aux endroits de mutualisation ».
Rencontrée lors de la préparation d’une action « arts plastiques » organisée pour des patients du CHU d’Erstein dans le cadre de l’exposition d’art brut au musée Würth, Cécile évoque aussi des réflexions en cours avec l’équipe du cinéma Cosmos qui ouvrira après les travaux entrepris dans l’ancien « Odyssée ».
L’action sera menée à destination des personnes malvoyantes, précise-t-elle en rappelant aussi « La Ronde des livres », opération désormais bien installée qui permet non seulement de donner des ouvrages aux enfants et adultes éloignés de la lecture, mais aussi d’organiser des ateliers d’écriture créative ou des visites ludiques de médiathèques.
« Les ressources culturelles des personnes que nous accompagnons sont immenses », conclut-elle, « à nous de créer les micro-utopies où elles puissent s’épanouir sans complexe ». a www.totoutart.org

Là où les idées naissent et les projets grandissent. Merci aux partenaires Or Norme pour leur soutien.














Le club des partenaires




















le tueurMon voisin
Comme le disait un grand historien, la mémoire ça sert surtout à oublier. Il est regrettable qu’un pays comme le nôtre, si entiché de commémorations n’ait pas consacré plus d’attention à ce qui arriva il y a tout pile 450 ans : la Saint-Barthélémy. Où l’on apprendra que, dans un monde où règnent actualité et muséification, les vieilles histoires ont beaucoup à nous apprendre.
On peut le concevoir, reparler d’un massacre entre français, qui plus est au cours d’une guerre de religions, n’est pas toujours du meilleur effet dans le Grand Récit National. Du moins percevrait-on au passage que la religion nous ayant suffisamment emmiellés, il serait bon qu’elle restât une affaire privée. Le xxe siècle s’étant surpassé dans l’abject, un petit massacre à l’ancienne pourrait sembler dérisoire. Dagues et pertuisanes sont bien peu de choses face à une chambre à gaz. De sorte que si on mesure le progrès technique dans l’art de la tuerie, on morigène sur ces hommes qui, décidément, sont bien vils. Faut-il se résigner ? Certes pas, et c’est la gloire des historiens de nous montrer quelques traits saillants parmi des événements qui diffèrent cependant toujours.
Dans un magnifique livre récemment paru, Jérémie Foa revient sur le massacre du 24 août 1572. (1) Pour ce, il a entre autres sources étudié les archives notariales qui, malgré toute la froideur tabellionnaire idoine, révèlent tout un monde englouti et poignant. Car la Saint-Barthélemy n’est pas un massacre comme un autre, c’est un « événement de proximité ». Rappelons que, dans un premier temps, ce sont les chefs Huguenots (rassemblés à Paris pour le mariage de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, c’est bien pratique), au premier rang desquels l’amiral Coligny, qui sont visés. Ensuite, et au signal du tocsin vers 4 h du matin, la boucherie s’étend à tous les Protestants. La milice bourgeoise (commerçants, artisans) rassemble les plus furieux. Les assassins opèrent par quartiers : qui se connaît bien
se massacre bien. D’autant plus que les Protestants ont été en butte pendant les années précédentes à d’incessantes persécutions et souvent arrêtés puis relâchés. Mais fichés au préalable.
Ce qui fait que lorsque les bourreaux arrivent, les choses se passent fort civilement : on sonne avant d’entrer. Ne se méfiant pas, les victimes ouvrent leurs portes à leurs connaissances, à leurs voisins, à leurs collègues. Mais aussi à leurs cousins, à leurs beaux-frères, à leurs neveux. On se tue donc entre chrétiens, mais aussi entre membres d’une même famille. D’où par exemple, parmi tant d’autres, ce témoignage : « Le commissaire Aubert demeurant en la rue Simon le frac près la fontaine Maubué, remercia les meurtriers qui avoyent massacré sa femme ». La Saint-Barthélemy regorge de ces histoires atroces de violences interfamiliales et de spoliations en tous genres. On tue et on vole puisqu’on ne risque rien. Le pouvoir royal laisse faire, dépassé. Mais pas de préméditation d’une Catherine de Médicis inspirée par les enseignements de Machiavel, ni de foule parisienne déchaînée. Pas de planification, mais une envie entretenue depuis des années en espérant
pouvoir la satisfaire un jour. Les bourreaux portent une croix ou un brassard blancs, ils ont des signes de reconnaissance, des mots de passe. De sorte qu’il est à peu près impossible de fuir. Si vous restez chez vous, les maisons sont fouillées, si vous sortez, on vous reconnaît. Les mots mêmes perdent leur sens, par l’usage de termes euphémisés ou doublement connotés (2). Le roi est un tyran, la paix est une fourberie, les huguenots des suppôts du diable. Tous les repères se brouillent et les liens sociaux se délitent. Certains abjurent, cela peut sauver. Beaucoup attendent les coups en priant. Mais ce n’est pas tout.
ON TUE L’AUTRE, PAS LE MÊME
Dans le fameux tableau de François Dubois (1529-1584), peintre ayant assisté au massacre, on voit, à peu près au centre, Coligny défenestré puis son cadavre décapité et émasculé. Il sera ensuite traîné dans les rues par des enfants (meurtriers d’autres enfants) et enfin exposé au gibet de Montfaucon. La Seine regorge de corps et l’image du fleuve rouge de sang qu’emploie notamment Agrippa d’Aubigné n’est

Pas de planification, mais une envie entretenue depuis des années en espérant pouvoir la satisfaire un jour. »
Le Massacre de la Saint-Barthélemy, par François Dubois, vers 1572-1584
«
faut
différencier,
Mais tuer ne
faut
pas une licence poétique. Les Parisiens s’abstiendront de consommer du poisson les semaines suivantes au vu du nombre de corps en décomposition qui s’y trouvent.
Massacre de proximité donc, massacres interfamiliaux, la sauvagerie semble ne pas avoir de limite et je ne m’attarderai pas sur les descriptions de mutilations et de femmes enceintes éventrées. Pourquoi cet acharnement ? Par peur déjà. Le pas si beau xvie siècle baignait dans une angoisse de fin du monde. (3)
On prie le Dieu de l’Ancien Testament, beaucoup moins cool que le Petit Jésus. On croyait voir partout les signes de l’Apocalypse proche et les Guerres de religion, soit des guerres civiles, marquant la fin de l’unité chrétienne (notamment face à la menace turque) entretenaient cette crainte d’un ennemi si proche qu’il en était semblable. Qu’y a-t-il de plus proche qu’un Parisien, qu’un boulanger, qu’un orfèvre sinon un autre parisien, un autre boulanger, un autre orfèvre ?
On tue l’autre, pas le même. Il faut donc différencier, se différencier, afin de faire advenir l’autre comme autre. La propagande, les rumeurs, les calomnies sont une première étape. Mais tuer ne suffit
pas, il faut déshumaniser, rendre méconnaissable. D’où les humiliations (dénuder les victimes), les mutilations, les défigurations. Rendre l’autre totalement autre.
On retrouve là un thème décelé par Freud dans ce qu’il appelle « le narcissisme des petites différences » (4) qui deviennent insupportables et qu’il s’agit donc de porter à l’extrême pour accroître la distance entre la victime et son bourreau.
TOUS SOUDÉS PAR ET DANS LE SANG VERSÉ
On tue donc pour « purifier » le corps social, pour purifier la religion et pour se purifier soi-même, parce qu’il a bien fallu qu’on ait péché bien fort pour s’attirer une telle calamité, l’hérésie. Et pour que l’immolation joue également ce rôle, il faut qu’elle soit collective. On tue en groupe et chacun doit faire sa part sous le regard des autres, encouragé par les autres, tous soudés par et dans le sang versé. Pas d’irrationnel cependant, mais, selon la formule de Jacques Sémelin, une « rationalité délirante ». (5)
Au lendemain de la Saint-Barthélemy, le silence se fait. L’acmé de sauvagerie
atteint, l’événement se referme sur luimême et semble un cauchemar dont on se réveille engourdi. Pourtant que d’enseignements dans tout cela. Je prendrai deux autres exemples. Dans un livre précisément intitulé Les Voisins (6), Jan Gross revient sur ce qui s’est passé en Pologne à l’été 1941, dans la petite ville de Jedwabne. Une moitié de la population a massacré l’autre moitié, hommes, femmes et enfants juifs. Les nazis ne sont pas dans le coup, pour une fois. Aucune pression extérieure donc, les Polonais ont assassinés, après les avoir battus à coup de gourdins et de barres de fer, ceux avec qui ils vivaient depuis toujours. On reprochait aux Juifs de supposées relations avec les Soviétiques (7) , on lorgnait sur leurs biens, on colportait des débilités au sujet de rituels avec du sang d’enfants chrétiens, etc… Là encore le piège est sans issue puisque les victimes et les lieux sont connus. On a même invité ceux des villages voisins pour participer.
« Paradoxalement, le poste de la gendarmerie allemande fut ce jour-là l’endroit de la ville le plus sûr pour les Juifs ». (8) Au total 1600 morts. Bien entendu, dans la Pologne actuelle, il n’est
« Il
donc
se différencier, afin de faire advenir l’autre comme autre.
La propagande, les rumeurs, les calomnies sont une première étape.
suffit pas, il
déshumaniser, rendre méconnaissable. »
COMME EUX, LOUEZ VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL SUR LES







CHAMPS-ÉLYSÉES
PORTRAIT DU MOIS / DOMICONUS
Créée par Dominique Flota en 2017 et implantée dans le Sundgau, au cœur de la région des Trois-Frontières, Domiconus est spécialisée dans l’élevage de cônes marins et a 2 objectifs. Le premier est médical grâce au prélèvement du venin de ces cônes dont les bénéfices thérapeutiques sont testés sur certains modèles de pathologies et maladies (douleur, oncologie, maladies dégénératives et d’autres à l’avenir). Une application en cosmétique est aussi à l’étude. Le second est environnemental car l’étude en ferme aquacole de ces cônes va permettre de les préserver, les récifs coraliens les abritant étant menacés. En 5 ans, Domiconus est devenue la première venumthèque de cônes marins au monde et est en pleine expansion. Elle vient d’entrer dans le Club des 100.

Dominique Flota s’est lancé dans ce projet suite à un accident grave en tant que pompier volontaire, il se découvre intolérant aux dérivés morphiniques et cherche alors une solution pour soulager les douleurs des personnes confrontées à la même problématique que lui. Avec 20 ans d’expérience en biologie animale, à travers différents postes occupés au sein de Novartis, de l’Université de Zurich et de l’Ecole Polytechnique de Zurich, il est passionné par la recherche et s’investit pleinement dans cet élevage aquacole unique au monde et novateur. www.domiconus.com


Jpas bien vu de rappeler que la barbarie ne fut pas que nazie. J’ajoute que d’autres meurtres antisémites eurent lieu après la fin de la guerre.
« NOUS DÉRANGEONS
LES GENS »
Dernier exemple, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. Là encore, et davantage, les bourreaux sont des voisins, des amis, voire des époux. Et la violence est intrareligieuse puisque des catholiques ont tué (coupé disait-on) d’autres catholiques. Avec des prêtres des deux côtés. Les églises, refuges habituels, ont souvent servi de théâtre aux massacres. Des barrages sur les routes entravaient toute fuite. Ici aussi une propagande mise en place bien avant (notamment via la trop fameuse RTLM, Radio Télévision des Milles Collines), l’exacerbation des différences (les Tutsis sont plus grands, plus pâles, plus ceci plus cela), la déshumanisation dans les mots (ce sont des cafards, des cancrelats, des serpents), puis dans les corps. À la machette. La chose était prévisible, annoncée, « l’accumulation d’un immense savoir sur les génocides et les massacres de masse depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale n’a-t-elle été d’aucune utilité pour prévenir et empêcher la catastrophe de 1994 » ? se demande Stéphane AudoinRouzeau.(9) Mais là les choses semblent en suspens. Des Tutsis disent : « Si on s’endormait, le génocide ne tarderait pas », « Nous dérangeons les gens »…
Les massacres prennent sens dans leur contexte historique et social, chaque fois différent. Notons cependant certains traits communs. Dans l’influence de la propagande d’abord et du rôle d’un vocabulaire orienté. Puis dans le rôle de l’État, soit faible (France, Rwanda, Pologne), soit se sentant menacé (pour l’Allemagne nazie). Le traitement des victimes ensuite, mises à part et rabaissées avant d’être exécutées et souvent rendues méconnaissables. Enfin, et c’est le cœur du problème : la facilité avec laquelle un individu, tout un chacun, peut devenir non seulement un meurtrier de masse, mais surtout de ceux qu’il connaît, quand le groupe auquel il appartient l’y autorise. En devenant encore meilleur à sa tâche avec l’habitude. Et sans regrets.
Je ne suis pas sûr que la psychologie positive pourra nous éclairer sur ce point. Mais je vous souhaite, sincèrement, un joyeux Noël. a
1- Jérémie Foa, Tous ceux qui tombent, éditions La Découverte, 2021. Massacre, précisons-le, qui se prolongea plusieurs mois et dans toute la France.
3000 Protestant-e-s tués à Paris, 10 000, 15 000, voire 30 000 selon certains pour toute la France.
2- Selon une figure rhétorique, la paradiastole, pour ceux qui voudront briller dans les dîners mondains.
3- Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu, Champ Vallon, 1990.
4- Notamment dans Malaise dans la civilisation 5- Jacques Sémelin, Analyser le massacre, Réflexions comparatives, in Questions de recherche, n° 7, septembre 2022.
6- Jan T. Gross, Les Voisins, 10 juillet 1941, Les belles Lettres, 2019.
7- La chose se passe après l’invasion de la partie de la Pologne occupée précédemment par les Russes, comme convenu lors du pacte Germano-Soviétique de 1939 (un détail omis par le camarade Poutine dans sa réécriture de l’histoire russe).
8- Les Voisins, p.79.
9- Une initiation, Rwanda (1994-2016), Seuil, 2017.

Qu’est-ce qu’on fout encore là ? Moi Jaja…
Tu ne t’es jamais demandé ce que l’on foutait encore là ? J’ai demandé à Tato, un de ces petits matins, là, sur une plage de Ligurie, à deux pas de Gênes. On aime bien faire ça, avec Tato : se barrer de chez nous, prendre la route, quand trop c’est trop, et aller voir mes potos oiseaux au bord du lac Léman, leur donner deux trois trucs à grailler, face au Mont-Blanc et se dire qu’on pourrait pousser un peu plus loin encore, traverser les Alpes, se taper le Saint-Bernard – pas le chien –, longer la côte et envoyer tout balader. Un court instant au moins…




C’est comme ça, la nuit à peine écoulée, qu’on a fini allongés face à la mer, mes pattes et mes ailes roses dans le sable, couverts du corps de Tato et de son long manteau à capuche. « On n’est pas bien ? Paisibles, à la fraiche, décontractés du gland ? », j’aurais pu « valser » à Tato. Mais allez savoir : alors que les premiers rayons d’un soleil automnal apaisaient une houle nocturne, c’est à ça que j’ai songé : qu’est-ce qu’on fout encore là ? À quoi bon se battre, quand tant de gens brillants qu’on connait, tous autant que nous sommes, ont déjà jeté l’éponge ?
SORTIE D’ŒUF
« Tu parles de quoi Jaja ? Du réchauffement climatique ? ». « Tu crois vraiment que j’en ai quelque chose à cirer du climat ? Tu m’as bien vu ? », je lui ai renvoyé dans ses poils d’humain. « Sérieux ! Yangzhou, Gdansk, Munich, Kryvyi rih, Zaporijia, Perzemysl, Strasbourg : à moi tout seul je fais le bilan carbone de dix Yann Arthus-Bertrand, si l’on compte mon temps passé en zones industrielles. « Et puis d’abord on ne dit pas réchauffement, mais dérèglement climatique.
Il ne t’a tout de même pas échappé que même au Qatar et en Arabie Saoudite y a plus de réchauffement ? Les premiers te mettent la clim dans des stades ouverts, les seconds construisent des pistes de ski au milieu du désert ». Et puis, à quoi bon ? Poutine a déjà tout réglé. Plus de chauffage, plus d’électricité, plus de gaz, plus de pétrole. L’on peut critiquer autant qu’on veut le bonhomme, mais avouez qu’en moins de temps qu’une sortie d’œuf de pingouin, le gars a fait mieux que l’ensemble de la communauté mondiale écologique réunie. Quant au reste des préoccupations de la classe politique, il les gère déjà avec brio : surconsommation alimentaire, pauvreté, migrations ; le tout sur fond de Wagner. Même le Pangolin n’a pas mieux fait ! « En moins de temps qu’une sortie d’œuf – j’te dis –, le mec nous a fait un strike : plus de céréales, d’engrais, c’est davantage de famines, d’émeutes de la faim et des mecs qui finiront d’ici peu par se tirer dessus sans avoir eu à s’offrir une scolarité américaine. Tu vas voir : d’ici peu, même l’Ocean Viking, on n’en entendra plus parler faute de croisiéristes ». Cerise sur le gâteau : avec moins d’humains, on tend vers le plein emploi à l’échelle






mondiale. « J’te l’dis, Tato : Poutine c’est le Einstein du xxie siècle, le mode d’emploi de la bombe en plus. C’est le Free du moment : Il a tout compris ».
ÉGAREMENTS

Tato était sans voix. Je le revois encore, interdit, qui me fixait, comme Pouxit aurait pu le faire un soir d’élections après avoir soupé un bol d’algues vertes. Un peu comme moi qui dévisage Tato lorsqu’il gobe la dernière sardine grillée du déjeuner, sans le moindre soupçon de culpabilité. Ou, alors, avec un peu de recul, lorsque sa conscience lui joue des tours, tel un archevêque qui comprendrait que mettre la main au panier n’est pas une discipline sportive ; encore moins spirituelle. Ironie de l’actualité, c’est alors que M gr Jean-Pierre Grallet reconnaissait « s’être égaré » que la SIG égarait son entraîneur Lassi Tuovi. De quoi me faire aimer un peu plus encore le foot : au Racing, cette année au moins, pas de risque de s’égarer. Les lois de la physique sont formelles : pour s’égarer faut-il encore préalablement avancer. Et là, aucun risque, au point que s’il fallait attribuer un animal Totem au Racing, je lui choisirais le paresseux : le seul animal dont l’extrême lenteur rend quasi impossible la détection de ses mouvements par ses prédateurs. Avec 11 points en 15 matchs, je parierais même que peu de ses adversaires l’ont vu sortir des vestiaires avant la 90e
« FJANDINN, HVERNIG ER REYKJAVÍK STAFSETT?!»
Non, par « là », j’entends « chez nous », à Stras, capitale de l’Alsace, mais à condition de ne pas se développer plus vite que Mulhouse, Colmar ou Sélestat. Capitale du Grand Est, pour peu que le GrandEst n’existe pas. De l’Europe, pour peu que recouvrir un tram d’un « Happy 70th birthday Parliament » ou d’un « Fjandinn, hvernig er Reykjavík stafsett?! »* suffise à asseoir son osmose transpartisanne dans la défense d’un siège que nul ne semble encore vouloir si ce n’est pour gratter quelques millions à l’État à des fins toutes autres qu’européennes. Capitale des Droits de l’Homme qui se résume au travail d’une institution, d’une Cour ou de quelques citoyens bénévoles pour combler l’absence de logements, de nourriture, de cours de langue intensifs, pour des femmes et des enfants dont on ne cesse de vanter la bravoure de leurs frères
et époux qui protègent, bien malgré eux, nos frontières extérieures. « Appartenance à notre belle famille européenne », qu’ils disent. Chair à canon pro-européenne, plutôt, oui ! Si tu vas au Neuhof, ce n’est pas une équipe d’administratifs, mais Kim, un migrant sud-coréen qui les aide à se nourrir. Au port du Rhin, ce sont des déplacés temporaires ukrainiens qui le font. Entre Strasbourg et Kharkiv ce ne sont pas des officiels qui financent et qui livrent des ambulances en mode Mario Kart sur une route jonchée de missiles, mines et autres roquettes, mais des étudiants étrangers comme Pablo, qui t’envoie des « selfies cœur » pour te signifier qu’il est encore en vie dans une zone de guerre dont il ne maîtrise que cinq mots. Au centre-ville, ce n’est pas la capitale des droits de l’homme qui augmente ses capacités enseignantes, mais des gars comme Édouard, un Allemand qui vit à Strasbourg, qui les supplées pour un forfait de 23 euros annuels versés à son association. Je veux bien qu’on me parle d’autres nationalités, mais pas de privilèges autres que la rapidité d’obtention d’un titre de séjour pour celles et ceux dont on vante le courage et la résilience à longueur de réceptions officielles. 316,20 euros mensuels pour une mère et sa fille : c’est aujourd’hui tout ce que l’État – pas même la ville – offre à des citoyens d’un pays membre du Conseil de l’Europe pour leur épargner le jeu de la roulette russe. Capitale européenne des droits de l’homme, mes ailes !
DÉNI DE LUCIDITÉ
Alors, je le regarde, ce grand sapin de Noël solidaire et je m’interroge. C’est quoi la

prochaine étape ? Financer sur les fonds publics un récital à la con pour leur dire combien on les aime ? Jouer à pierre feuille ciseau avec la préfète quand ils finiront sous des tentes ? Nous désespérer d’un ou deux degrés de moins pour faire face à notre facture énergétique ? Polémiquer sur ce qu’il est permis ou non de vendre sur le Marché de Noël pour ne pas nous éloigner de nos fondamentaux ? Défendre la munsterflette contre la tartiflette ? Des tartes, oui, j’te dis !
Tu vois, Tato, je l’aime notre ville, tellement. Mais parfois elle me fait honte, notre capitale qui, après l’avoir aussi été de Pâques, le sera mondialement du Livre en 2024 – notre grande fierté du moment ou du moins de quelques-uns, à l’heure où tant de parents préfèrent pourtant planter leurs gosses devant Animal Crossing, Tik ToK et autres Disney+ plutôt que de les emmener dans une bibliothèque ou sur un terrain de sport non genré, comme on dit désormais, de peur de froisser quelques radicaux ou radicales de la syntaxe. C’est vraiment ça, notre ville, Tato ? Des mots, juste des maux ? En capitales ? « Un jour, une chanteuse nord-irlandaise a déclaré que sa ville, Belfast, était la plus belle au monde, pour peu qu’on la quitte souvent pour réussir encore à l’aimer », m’a alors répondu Tato, alors que le ciel génois commençait à se couvrir. « Alors profite, profite de l’instant, Jaja. Profite des vagues, de la plage. Et la prochaine fois qu’on passe par le Saint-Bernard plutôt que par le Gothard, de tes amis à plumes. Parce que c’est ça, aussi, Strasbourg : une ville frontière qui te permet de t’en éloigner quand elle te fait pleurer ». S
* M..., ça s’écrit comment Reykjavík ?
« Strasbourg : une ville frontière qui te permet de t’en éloigner quand elle te fait pleurer. »

L’actu Jak Krok'
Retrouvez chaque semaine sur notre page Facebook le regard sur l’actualité de l’illustrateur Jak Umbdenstock !






É V ÉNEMENTO R EMRON
OR NORME CHEZ AEDAEN ET ST-ART
Le 16 novembre dernier, le Club des Partenaires Or Norme s’est réuni lors d’une magnifique soirée chez Aedaen Place, avant de se retrouver pour le vernissage de ST-ART le 24 novembre.








S B O U T E I L LES PLEINES DE V I E S
Les beaux verres à vin me font un petit quelque chose. Dans la continuité du bien boire, on joue de leur forme pour étaler les attraits du vin.
Les verres tulipe, idéaux pour la dégustation d’un effervescent, s’entrechoquent à l’occasion d’une fête, ou célèbrent les coquillettes au jambon du mardi. À chacun ses petits bonheurs.
Puis la bouteille terminée s’en va rejoindre la benne à verre. Issue de la tradition des arts du feu, la flûte d’Alsace avec son surplus d’élégance n’y échappe pas. Du côté de Lutzelbourg, l’atelier S’Glàs leur offre une retraite dorée.
Situé dans une ancienne usine d’agrafes, le Pôle Konzett est un lieu où cohabitent différents créateurs et entrepreneurs. C’est dans cet écosystème que le talent de Maya Thomas trouve ses aises depuis août 2021. Parce qu’on vit dans une poubelle qui grandit chaque jour un peu plus, l’envie de faire quelque chose qui a du sens anime la Strasbourgeoise de cœur.
Maya aime le verre. L’objet certes, mais surtout la matière, qu’elle recycle avec habileté. La partie supérieure des bouteilles est découpée, passée au four, puis aplatie. Les pièces ainsi profilées s’assemblent et composent des vitraux. La partie inférieure trouve écho dans les arts de la table. La matière s’affiche alors en verres, bocaux, et carafes.
Feuille jaune, marron glacé, chêne…à l’atelier S’Glàs, les couleurs sont automnales. Les flûtes au teint chlorophylle – celles qui fricotent avec le kitsch – prennent des airs sobres, minimalistes, et design. Véritables phénix du folklore Alsacien.
Un système de récupération de bouteilles, mis en place avec une poignée de professionnels, permet d’obtenir une matière première ayant déjà quelques gouttes de vécu. Les flacons sont ensuite coupés à l’aide d’une scie à eau à lame diamantée. C’est que la dureté du verre appelle les mêmes outils que ceux des tailleurs de pierre. Différents ponçages permettent, notamment, de sécuriser le toucher de bouche des verres. L’eau accompagne les gestes précis et artistiques de l’artisane verrière. Le polissage, la gravure, le nettoyage, puis l’emballage précèdent la commercialisation.
À l’approche de Noël, les commandes s’accumulent. Les créations défilent déjà sur quelques tables strasbourgeoises, dont l’hôtel Léonor et le restaurant La Fignette. En cette fin d’année, je ferai une infidélité à mon amour pour les verres à pied en allant zieuter les réalisations de l’Atelier S’Glàs. Maya, elle, travaille le verre vide, mais apprécie son verre paré du cépage Auxerrois. E










































SPECTACLES FESTIVAL, LIVRES GALERIES, ETC.
Chaque trimestre, la rédaction de Or Norme a lu, écouté, visionné l'essentiel de ce qu'on lui fait parvenir. Cette sélection fait la part belle à ses coups de cœur...
1KFESTIVAL À Pôle-Sud,
« L’Année commence avec elles »
Créé par la directrice du Centre chorégraphique Joëlle Smadja afin de « donner de la visibilité » aux spectacles écrits, pensés et dansés par les femmes, ce festival déclinera onze propositions tout au long de janvier. Elle nous en parle.
Quel était votre objectif en créant ce festival ?
Toucher à la question du « elle », montrer ce qui n’est pas visible. La question du genre n’est pas le sujet en soi, mais j’ai constaté que les sujets traités par les femmes n’étaient pas les mêmes que ceux dont s’emparaient les hommes. Je voulais sortir de l’ombre des questionnements plus larges qui correspondent à de nouvelles générations de public, entamer une réflexion qui n’existait pas avant et qui correspond à une société nouvelle où la complexité inhérente à la vie trouve enfin sa place.
Quels sont ces sujets ?
Le viol par exemple, traité tout en délicatesse dans Rain de Meytal Blanaru ; la femme scandaleuse du XIXe siècle abordée par la vie de la danseuse d’avantgarde Ida Rubinstein dans Ida don’t cry me love de Lara Barsaq ; la question des origines, le travail sur la figure du monstre et les croyances dans Mascarades, solo sans concession de Betty Tchomanga… Les onze pièces sont puissantes tant dans l’originalité des propos que dans la manière de les présenter.
Des spectacles dont vous êtes persuadée qu’ils peuvent parler à tous… C’est ce qui ne cesse de me surprendre avec la danse. Il suffit d’être accessible à l’émotion pour être spectateur ou spectatrice. Il n’y a pas besoin de « s’y connaître » pour ressentir. a
Images : Betty Tchomanga, Mascarades


EXPOSITION 2K
Michel Bedez, artiste autodidacte, émergent sur le tard, présente ses Idoles au Musée Wurth en lisière de l’exposition Art Brut. Un dialogue singulier avec la Collection Würth ». Au cœur du Val d’Argent, dès le plus jeune âge, Michel Bedez est fasciné par les statues polychromes de la petite église, les légendes des forêts habitées, les tarots sur les tables des bistrots.
C’est ainsi que sont nées ses « Idoles », ses petits dieux qui ont le pouvoir de soigner les maux des hommes et de la société, un mélange du saint et du païen, du céleste et du tellurique. Au Musée Würth, Michel Bedez a créé une chapelle païenne, un sanctuaire populaire, une caverne ombrageuse pour les installer et retrouver l’émotion du sacré. Les statues sont présentées sur un monticule de charbon qui rappelle l’histoire des origines du créateur. a


Image : Michel Bedez /Loïc Bosshardt
S ur quelques deux mille œuvres encore non attribuées appartenant à des juifs spoliés par les nazis, notamment au profit du plus grand voleur jamais référencé, Hermann Goering, vingt sept sont en Alsace et actuellement exposées à la Galerie Heitz, sous la dénomination MNR soit Musées Nationaux Récupération, ce qui signifie sous la protection de l’État, leurs propriétaires étant encore inconnus. Elles sont simplement répertoriées, et à la garde des musées.
Dès 1940 en raison de ces vols et des ventes des juifs euxmêmes pour avoir un peu d’argent avant de fuir ou de se cacher, le marché de l’art explose. Puis quand la spoliation est prouvée, la plupart des biens sont restitués, grâce notamment au travail clandestin de Rose Valland, sorte d’espionne de l’art répertoriant ce qu’elle voit disparaître, puis de Hans Haug, qui a recherché et restitué ces œuvres. Ce sont de très belles œuvres d’art, exposées avec goût, souvent de poètes du Nord, avec quelques nus languides et doux, des paysages fins comme celui de Sisley, quelques meubles, un petit coffre en bois, une boîte en cuir. Le plus émouvant est le petit portrait anonyme, datant du XVIe siècle d’un Enfant tenant une poire, ayant traversé le temps et les saccages, mais ayant gardé son innocence. a
Impression & fabrication de haute qualité, respectueuse





Toute notre production est réalisée dans nos ateliers. Notre parc machines est de dernière génération et vous garantit une qualité irréprochable d’impression, de façonnage avec des délais raccourcis et une organisation « orientée client ». Depuis 2011, DS Impression a fait le choix de machines à encres UV ou Latex, qui s’imposent comme la solution la plus écologique. Les encres UV permettent des impressions éclatantes et durables, aussi bien pour une utilisation en extérieur qu’en intérieur.










CONCERTS 3K LIVRES 4K
EVE d’Europe, EVE d’Asie
Du rêve à la réalité, il ne faut parfois que la force d’une amitié. Celle qui lie Catherine Bolzinger, cheffe du Chœur philharmonique de Strasbourg et directrice artistique de Voix de Stras’ à Selvam Thorez directeur du Chœur amateur de l’Asian Université for Women de Chittagong au Bangladesh a donné naissance à EVE (Empower Vocal Emancipation), projet au long cours dont la première tournée sera lancée en février au Parlement européen et se terminera en mai à l’ambassade de l’Union européenne à Dacca.
Musique française et musiques orientales traditionnelles dialogueront dans un élan vocal né de la rencontre entre des chanteuses de 15 pays et 4 continents différents.

Portée par les valeurs d’égalité, de solidarité et d’émancipation féminine, cette synergie culminera avec une création du compositeur Lionel Ginoux à partir des chants collectés auprès des chanteuses du chœur asiatique.
Heureux de cette perspective « de partage musical et d’échange culturel », celui-ci se dit persuadé qu’il est « indispensable d’avoir des temps pour connaître l’autre et s’enrichir de nos différences ».

On ne saurait rêver plus belle invitation aux concerts qui se tiendront en février à Strasbourg, Breitenbach et Mulhouse, mais aussi à l’UNESCO à Paris, à Genève et à Kehl avant de se lancer dans une tournée de printemps au Bangladesh. a
Au pays des merveilles Nathalie Bittinger
Agrégée de Lettres modernes et maître de conférences en études cinéma à l’Université de Strasbourg, Nathalie Bittinger a déjà édité plusieurs ouvrages dont Or Norme vous a parlé.
Pour ces fêtes de fin d’année 2022, elle nous a mitonné un amour de beau livre sur tout le cinéma d’animation japonais qui, dans le sillage du maga dont les ventes explosent littéralement, a le vent en poupe.

La Strasbourgeoise a réussi ce petit prodige de réunir une véritable somme scientifique sur ce cinéma particulier tout en l’écrivant et l’illustrant comme un ouvrage très grand public. C’est vraiment le cadeau idéal pour un adepte du genre, mais aussi pour le néophyte qui, comme nous, y apprendra beaucoup de choses. Pour couronner le tout, la maquette est sublime et l’objet magnifiquement édité… a
Aupaysdesmerveilles–Trésors
del’imaginationjaponaise, NathalieBittinger

Vous avez adoré ou vous avez été intrigué par les mystérieux Elfes dont nous parlons dans les pages de notre dossier spécial Islande de ce magazine. Alors, faites comme nous lors de notre voyage là-bas et plongez-vous dans la lecture de ces vingt petites histoires tirées du folklore islandais. Chacune est accompagnée d’un commentaire passionnant sur le contexte dans lequel elle s’enracine. Vous finirez par dire (et penser) comme tous nos interlocuteurs de la terre de glace et de feu nous l’on dit : « Bien sûr, les Elfes n’existent pas. Mais bon… on aime cette idée qu’ils puisent être réels… » a
Les lecteurs de Or Norme se souviennent des belles images de Stéphane Spach publiées en portfolio dans notre numéro 30 de septembre 2018. Difficile de résumer ici l’univers de ce photographe inspiré. Dans sa préface, joliment titrée « Le Temps et l’Intemporel, dans les choses muettes de Stéphane Spach », Jérôme Thélot évoque « un platonisme photographique ». C’est une superbe métaphore. Ce livre photo se feuillette avec délicatesse et envie… a

C'est tous les ans le même (très beau) rite. Les marchés de Noël s’installent et Simone Morgenthaler est au rendez-vous pour un nouveau livre. Cette année, elle ausculte avec talent les mots orduriers du dialecte alsacien qui sont quelquefois de véritables « bombes atomiques » d’une poésie et d’un humour ravageurs.

Tiens, au hasard de ces délicieuses 200 pages : « d’Mùckeversschissenitàpetefràtz », littéralement : la gueule tapissée de chiures de mouches ».
Comme tu es vulgaire, Simone ! Comme c’est bon… a

UNE INSPIRATION SANS LIMITES
POUR LA CRÉATION, LA RÉNOVATION ET L’ AMÉNAGEMENT DE VOTRE ÉTABLISSEMENT



OSEZ LA DIFFÉRENCE… ON S’OCCUPE DU RESTE.
Chez Creatio, nous avons des solutions originales et un savoir-faire unique pour optimiser vos espaces et vous offrir la singularité qui vous ressemble.
Notre équipe de professionnels vous accompagne de la conception à la réalisation de votre projet afin de définir un univers incomparable. Le vôtre.

Quelle excellente idée d’édition ! Plantée au beau milieu d’un immense couloir migratoire, notre cathédrale sert d’étape et d’abri (de garde-manger, aussi) à de très nombreuses espèces d’oiseaux.
Paulien Bugeaon et Cédric Chambin, tous deux passionnés de nature ont passé deux ans à explorer et recenser les traces d’oiseaux et du monde sauvage au cœur de notre ville. Le photographe Alain Mauviel a immortalisé cet incroyable microcosme vivant. Le livre est surprenant et superbe… a

C'est un énorme pavé de près de 1 000 pages superbement édité par l’Atelier Contemporain qui réunit les écrits du prolixe peintreécrivain-polémiste, ordonnancés et éclairés par l’éditrice Christine Gouzi. Près de six décennies de textes, notes, écrits en tous genre qui, ainsi rassemblés et commentés, laisseront donc désormais une trace unique dans l’histoire de l’art… a


L'éditeur strasbourgeois FrançoisMarie Deyrolle (L’Atelier Contemporain) rend un formidable hommage à Michel Butel, le journalisteécrivain créateur de l’Autre Journal, dont nous sommes nombreux, dans cette profession, à nous rappeler qu’il fut parmi nous un des tout meilleurs. Quelle belle idée de rééditer, en fac-similé, les 56 numéros de L’Azur, une autre de ses créations. La maquette a certes vieilli, mais bon sang, pas un mot qui ne soit pas frais comme un gardon. Parallèlement le même éditeur réunit dans L’autre Livre les cinq magnifiques romans-récits que Michel Butel, disparu il y a déjà quatre ans, publia… a



QUI SONT-ILS ?
Pourquoi, en période de difficultés financières, s’en prennent-ils avant tout à la culture ?
Et pourquoi avoir visé une institution comme les musées, en imposant dorénavant deux jours de fermeture hebdomadaire ? Sans doute avec la conviction que cela ne concernait qu’un public restreint et passif – une « élite » ! Qu’une municipalité ignore le poids symbolique de la culture, est en soi très alarmant. Mais qu’une telle ignorance s’exprime dans une ville comme Strasbourg – avec un urbanisme exemplaire, une tradition musicale unique en France, un patrimoine architectural et muséal d’un intérêt artistique exceptionnel, et je pèse mes adjectifs – c’est une faute politique.
Et d’abord, savent-ils seulement de quoi la culture est le nom ?
Hannah Arendt a rappelé qu’elle est devenue un bien public dans l’Empire romain. Le mot « culture », et ceci devrait intéresser les écologistes, vient du latin colere, c’est-à-dire cultiver, veiller sur, honorer, préserver ! Le mot tire son origine et son emploi du soin que prenaient les Romains de la nature : ils considéraient devoir à la culture de l’esprit les mêmes soins qu’ils apportaient à la nature.
À partir du siècle des Lumières, la notion de culture désigne des savoirs, des sensibilités, la conscience d’appartenir à une histoire. Enrichir ces savoirs, affiner cette sensibilité, éclairer cette conscience, c’est se cultiver. C’est aussi contribuer à développer l’esprit critique. C’est l’un des objectifs de l’enseignement, mais aussi des institutions culturelles auxquelles il peut s’adosser – le théâtre, les musées – ou des outils à sa disposition comme la lecture, le cinéma, la musique…
La mission d’un pouvoir politique, quel qu’il soit, lorsqu’il est en charge des affaires d’une ville, est d’assurer la transmission des biens culturels aux générations futures en garantissant leur conservation, leur promotion et leur accessibilité, car ils sont un bien commun. Comment osent-ils en disposer ?
« Verdir » la cité ne doit pas avoir pour contrepartie de considérer le patrimoine ancien ou contemporain, cette composante essentielle de la culture, comme une variable d’ajustement.
Qui sont-ils ?
Ce sont les nouveaux commissaires du peuple qui savent ce qui est bon pour lui. Et ce qui est bon pour le peuple passe nécessairement à leurs yeux par une redéfinition de la culture, voire une éradication de ce qu’ils pensent être la « haute culture ». Car leur ennemi juré, c’est l’élite. Une catégorie générique d’individus qui auraient le privilège d’accéder à la culture « du haut ». C’est pourtant grâce à cette « élite » – mécènes, collectionneurs, interprètes, enseignants, éditeurs, etc. – que les œuvres laissées par les créateurs du passé existent encore.
Le terme « participatif » est devenu le maîtremot de ces populistes qui se méprennent sur leur véritable responsabilité. En instaurant le « participatif », pensent-ils combler le vide de leur propre inculture ? Le vide de leur inaptitude à faire le choix de la création, de l’innovation ? Le vide, enfin, de leur incapacité à avoir une véritable conscience historique ? a
Roland Recht, historien de l’art, universitaire et conservateur de musée, chroniqueur et critique d’art. Directeur des musées de Strasbourg entre 1986 et 1993.
Or Champ est une tribune libre confiée à une personnalité par la rédaction de Or Norme. Comme toute tribune libre, elle n’engage pas la responsabilité de la rédaction de la revue mais la seule responsabilité de son signataire.





OR NORME c
4 numéros trimestriels + Newsletter Or Norme = 40€ / 1 an
NOS
NUMÉROS
OR DU COMMUN c c 4 numéros trimestriels + Hors-séries + Newsletter Or Norme = 60€ / 1 an



OR PAIR c c c 4 numéros trimestriels + Hors-séries + Newsletter Or Norme + Invitations régulières aux événements de nos partenaires (Concerts, avant-premières, spectacles...) = 80€ / 1 an




1 LIVRE CADEAU












Pour tout versement de 50€ minimum ou pour la mise en place d’un versement programmé 3 sur un livret d’épargne.


