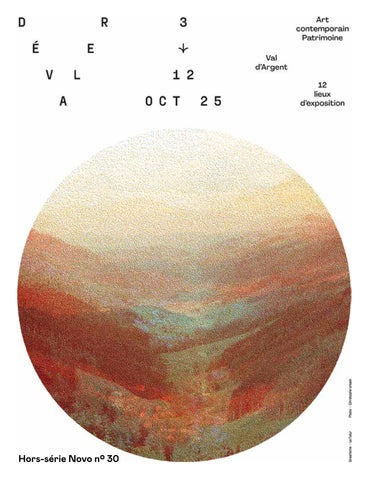La grâce des vallées
Par Clément Willer ~ Photos : Christophe Urbain
Rencontre avec Michel Bedez et Christophe Urbain au café Brant à Strasbourg, le
mardi 26 août 2025.
« Dévaler » : aller de l’avant, malgré la mélancolie. Le nom du parcours d’art contemporain à travers le patrimoine de la vallée de SainteMarie-aux-Mines, imaginé par l’artiste Michel Bedez et le photographe Christophe Urbain, est programmatique. À l’occasion de sa deuxième édition, qui se tiendra du 3 au 12 octobre, on pourra déambuler dans les rues de Sainte-Marie-auxMines et de Sainte-Croix-aux-Mines pour découvrir des œuvres d’Arthur Metz, Lisa Mouchet, Émilie Vialet ou Marius Pons de Vincent dans l’ancien lycée, des photographies de Stéphane Spach dans l’église Saint-Louis, des peintures de l’écrivain Pierre Pelot dans une usine désaffectée. Autant de rencontres entre des œuvres contemporaines et des lieux historiques, qui nouent une alliance prometteuse entre art et patrimoine.
Est-ce que vous pourriez nous raconter l’histoire de la naissance de « Dévaler », qui en est à sa deuxième édition, et qui prend place à SainteMarie-aux-Mines aux côtés de l’aventure « C’est dans la vallée » initiée par Rodolphe Burger ?
Michel Bedez : Je suis originaire de la vallée, et j’ai fréquenté le même lycée que Rodolphe à SainteMarie-aux-Mines. Je m’étais dit que ce serait amusant d’imaginer un événement autour de l’art contemporain. J’avais envie que les gens viennent aussi pour découvrir la richesse patrimoniale et artistique de la vallée. Sainte-Marie-aux-Mines

semble une ville oubliée mais elle est en fait d’une richesse magnifique. Son histoire est composée de différentes strates, celle de l’exploitation minière, puis celle de l’industrie textile. Au départ, il s’agissait de rendre hommage au passé de la vallée, mais aussi à son présent, aux artistes et aux gens qui travaillent là, vivent là. De nombreux artistes

sont issus du Val d’Argent et des vallées en général, chose que l’on ne sait pas forcément, et que « Dévaler » veut mettre en lumière.
Christophe Urbain : Notre amitié avec Michel repose sur le fait qu’on aime bien ce qui gratte un peu. On ne cherche pas à exposer de l’art
contemporain dans un endroit très lissé. On cherche à donner forme à notre amour pour les habitants des vallées, ces personnages un peu oubliés de l’histoire contemporaine. Ces fonds de vallée sont souvent pris de haut, mais ils sont pleins de talents, d’énergie, de potentiel, de parcours de vie insoupçonnés.
Christophe Urbain et Michel Bedez

M. B. : Oui, c’est cela qui nous touche : cette mélancolie, cette richesse, cette vie, tout simplement, qu’on trouve dans les vallées, et qui sont rarement prises en compte. Notre idée, c’est d’éclairer ces lieux qui sont un peu restés dans l’obscurité. C’est ce que fait déjà Rodolphe avec son festival, et nous voulons donner un rayonnement supplémentaire à ce geste.
C. U. : Le plus important, c’est ça. Rodolphe, c’est un ami de longue date maintenant, et j’ai toujours aimé l’idée du festival qu’il organise, qui consiste à faire venir des Strasbourgeois, des Mulhousiens, des Parisiens dans la vallée, à se battre pour faire quelque chose là où l’on est né. C’est une espèce de décentralisation culturelle. Et d’une certaine
manière, on vient de là. Pour ma part, je viens d’une banlieue plutôt populaire dans le Jura, et quant à Michel, il est originaire de Lièpvre. On se sent bien, dans la vallée. Je retrouve cette forme simple de contact humain, qui m’est beaucoup plus naturelle que les interactions parfois un peu ampoulées que j’ai dans mon domaine, celui de la photographie et de l’art contemporain.
Ce qui me semble particulièrement intéressant, dans cette démarche de décentralisation et de démocratisation qui est la vôtre, c’est qu’il ne s’agit pas d’apporter le grand art contemporain dans des lieux considérés comme délaissés, mais plutôt de faire émerger ce qui se fait comme différentes formes d’art dans ces lieux-mêmes.
C. U. : Beaucoup d’artistes reconnus viennent des vallées, ce dont on n’a pas forcément conscience au premier abord. Ici, on peut citer Rachid Taha, le plasticien Gérard Collin-Thiébaut, et tout proche l’écrivain Pierre Pelot, sans compter la nouvelle génération fraîchement installée, composée d’Émilie Vialet, Éric Antoine ou Arthur Metz.
M. B. : Je crois qu’il ne faut pas sous-estimer l’impact des paysages, dans une démarche artistique. Les gens qui sont touchés par la grâce des vallées ou qui sont nés là ont une manière de voir le monde légèrement différente. Ils sont touchés par la nature d’une autre manière. Mais ils sont touchés également par les friches industrielles qui les entourent. Dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, on trouve également une vingtaine d’édifices sacrés, des églises, des temples, qui ne sont pas sans lien avec cette atmosphère singulièrement propice à la création. À Lièpvre, par exemple, Charlemagne a fondé l’une des plus grandes abbayes de son empire, même s’il n’en reste plus rien. On raconte aussi qu’au Chalmont serait enterrée sa fille, avec le trésor des Francs. Au Taennchel, un pont fantastique aurait été construit par des géants, qui reliait ce lieu reculé à la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Il y a des histoires et des mystères partout. C’est une terre qui porte en elle des sortes de forces telluriques. Quelque chose s’est passé et continue de se passer là, dans ce territoire tour à tour florissant et déflorissant.
Vous évoquez souvent cette tension entre mélancolie et optimisme, qui semble centrale concernant « Dévaler ». Ce nom, pour moi, a d’ailleurs quelque chose de beckettien. Il me rappelle les dernières lignes de L’Innommable : « Je ne peux pas continuer, je vais continuer. » D’une certaine manière, on pourrait dire : « On ne peut pas dévaler, on va dévaler. » C’est comme un élan de vie malgré tout, malgré le déclin économique de cette vallée minière et industrielle. Quelle est la signification, pour vous, de ce verbe programmatique : dévaler ?
C. U. : C’est exactement ça, c’est un verbe qui recèle une grande ambivalence. D’un côté, « dévaler » renvoie l’image d’une course joyeuse à travers champs et vallons, un peu comme dans La Petite Maison dans la prairie. D’un autre côté, dévaler peut aussi signifier chuter. On se situe sur un fil entre les deux, entre cette joie d’aller de l’avant et cette peur de la chute.
M. B. : Aujourd’hui, la vallée se bat vraiment pour renaître de ses cendres. On n’est pas les seuls à
participer à ce mouvement vers l’avant, on s’inscrit dans une tendance plus large. Tous les ans a lieu, par exemple, le salon de minéralogie Mineral & Gem, l’un des plus grands du monde, ainsi qu’un salon de patchwork, lié à la culture amish qui est née à Sainte-Marie-aux-Mines. On fait partie des gens qui veulent faire émerger, sans trop trébucher, la vallée. Ça nous ravive, ça nous ressource. Mais il faut garder à l’esprit que cette volonté est nécessairement ambiguë, tissée d’optimisme et de pessimisme, car l’ambiguïté est nourricière. Cette tension, ça crée des choses.
C. U. : Il ne s’agit pas de dire que tout est merveilleux, loin de là. D’une certaine manière, c’est comme en art : il ne s’agit pas de faire que du beau, il faut rester fidèle à la complexité de ce qui est.
M. B. : Un des artistes qui participe à cette nouvelle édition, Arthur Metz, parle très bien de ça. Âgé d’une trentaine d’années, il a fait ses études à la Kunstakademie de Stuttgart, puis il est revenu dans la vallée, habiter la ferme de son grand-père, pour s’en servir comme d’un atelier. Ce que l’on dit me rappelle ce qu’il a écrit quelque part pour se présenter, évoquant la rudesse et la beauté de la vallée : « Aujourd’hui j’y vis, dans une vieille ferme au pied d’une montagne, entouré de la beauté de la forêt (de ses rigueurs aussi parfois), et je bénis et maudis tour à tour mon isolement. »
Vous retracez l’histoire de la vall ée de SainteMarie-aux-Mines à travers une constellation d’œuvres qui ont un lien, d’une manière ou d’une autre, avec ces terres. Mais cela semble dessiner une identité de ce territoire qui n’est pas figée, qui est ouverte, à l’inattendu, aux rencontres, aux retrouvailles, comme en témoigne le parcours sinueux d’Arthur Metz, non ?
M. B. : Oui, c’est vrai. Arthur Metz ressemble un peu à Ulysse, qui a fait un long voyage, puis qui est revenu aux sources. On observe une trajectoire non linéaire assez semblable chez l’artiste Christian Pion, qui est né à Dijon, qui fut autrefois marchand de vin, et qui est venu s’installer dans la vallée. La vallée apporte de la matière à utiliser. De la matière dans le sens premier du terme, de la terre, de la pierre, des feuilles. Mais aussi de la matière dans un sens poétique, quasiment sacré.
C. U. : Je crois que cela s’inscrit dans tout un mouvement, que l’on peut repérer en prêtant attention à des livres marquants comme Retour à Reims de Didier Eribon paru 2019, ou Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu et Ceux qui restent :
Faire sa vie dans les campagnes en déclin de Benoît Cocquard, parus à la fin des années 2010. Je trouve qu’on observe de plus en plus ce mouvement-là, de retour à une identité provinciale, à une terre d’origine. Il faudrait aller plus loin, et interroger ce que signifie, politiquement, ce fait de retourner habiter les vallées. Cela paraît témoigner d’une volonté de plus en plus forte de ne pas tout centraliser, de montrer qu’on peut réussir ailleurs qu’à Paris, que d’autres lieux plus méconnus sont favorables à la création et à l’inspiration.
M. B. : Cela demande de se défaire de la honte d’avoir un accent, ou d’être né dans une maison en formica… Ce n’est pas évident, car ce sentiment de honte avait une grande emprise, jusque-là. Cela demande aussi de tisser des relations véritablement humaines, de sincérité et de camaraderie, dans les lieux que l’on investit. C’est ce que l’on cherche à faire, à tous les niveaux. Cela me rappelle une petite histoire. L’année dernière, un agriculteur de la région est venu au festival « Dévaler ». Il est tombé amoureux d’une œuvre, mais il n’avait pas les moyens de l’acquérir. Il l’a finalement échangée avec l’artiste, contre de la viande bio, contre un produit de son savoir-faire à lui. Une forme de noblesse s’observe dans cet échange. Dans les galeries d’art contemporain, ce ne serait certainement pas possible. C’est quelque chose d’assez beau.
Pourriez-vous nous parler un peu plus en détail des œuvres et des artistes qu’on rencontrera dans cette nouvelle édition, de ce qui a compté pour vous dans ces choix ?
C. U. : Ce sont chaque fois de vrais coups de cœur. Ce sont tous des artistes qu’on aime, et qu’on suit. Il règne également un certain esprit de famille, de camaraderie comme disait Michel. Christian Pion, dont nous avions exposé des travaux l’an passé, fait partie du groupe d’organisation : on a passé plusieurs soirées chez lui à discuter, et presque tous les artistes de la nouvelle génération que nous proposions, comme Arthur Metz ou Marius Pons de Vincent, il les connaissait. C’est un signe. C’est la preuve qu’il existe un lien fort, humain et artistique, qui nous réunit autour de « Dévaler ».
M. B. : On travaille patiemment avec chaque artiste, pour voir la direction qu’on va prendre. Tous les artistes qu’on expose sont très différents. Ce qui compte, c’est de conserver une cohérence dans notre ligne, tout en laissant une marge d’expression à la singularité de chaque artiste. C’est tellement beau de voir quelqu’un qui commence à prendre le projet à cœur.
C. U. : À vrai dire, dans l’œuvre d’un même artiste, on essaie de présenter ce dont on pense que ça va fonctionner au sein de « Dévaler ». Chez JeanChristophe Schieber, par exemple, on a choisi une partie seulement de son œuvre prolifique : non pas la partie la plus ésotérique, qui s’éloigne de notre ligne directrice, mais un ensemble de travaux en noir et blanc, un peu abstraits, très beaux. Avec le photographe Éric Antoine, c’est un peu la même chose. Il travaille essentiellement la technique du collodion sur plaque de verre, et comme c’est un processus extrêmement long, il produit peu : tous ses travaux partent sans attendre dans les musées et les galeries, il ne possède pas de stocks. Mais au fil de nos discussions, il nous a parlé tout de même de quelques peintures qu’il n’avait jamais exposées et qu’il gardait chez lui. Il a accepté de nous les prêter, et nous allons être les premiers à montrer cette série assez fascinante. Ce qu’il peint, comme ce qu’il photographie, donne naissance à des images négatives : ce sont des paysages de petits formats, sur grand papier, c’est très beau. En tant que photographe, j’ai été particulièrement touché par ces œuvres de peinture inspirées des procédés photographiques, qui sont d’une grande délicatesse.
M. B. : Par ailleurs, nos choix cherchent aussi à souligner un lien avec la vallée de Sainte-Marieaux-Mines. Plusieurs artistes exposés vivent et travaillent dans la vallée, comme Jacques Battais, dont on montrera certains travaux cette année, ou comme Christophe Meyer, connu notamment pour son bestiaire, qu’on avait exposé l’année dernière, qui était en classe avec moi à Sainte-Marie-auxMines, avant de partir pour New York, où il a fréquenté dans le métro Jean-Michel Basquiat et Keith Harring… C’est drôle, les gens ne savaient pas qu’il venait de la vallée. Certains artistes travaillent également dans d’autres vallées cousines, comme Stéphane Spach de la vallée de la Bruche ou Pascal Poirot du val de Villé. D’autres artistes, enfin, travaillent avec la matière d’ici, comme Étienne Champion qui va chercher la pierre dont il a besoin pour ses statues, du grès notamment, dans les carrières vosgiennes. Il se sent vosgien, c’est comme s’il était mû par l’énergie des pierres d’ici. Je crois que la situation géographique, les atmosphères des lieux, influencent profondément les êtres humains, et que c’est cela qui nous relie le plus profondément.
Peindre la nuit
Par Clément Willer ~ Photos : Christophe Urbain
Entretien avec Arthur Metz
au Bardu, le bar du cinéma Le Cosmos, à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
À midi, dans la petite salle aux murs noirs tout au fond du bar du Cosmos, il fait sombre comme en pleine nuit. On ne pouvait imaginer mieux pour parler, avec Arthur Metz, de ce que signifie le fait de vivre dans une vallée reculée, de se consacrer aux tâches domestiques ou administratives le jour, et de peindre la nuit.
Pourriez-vous nous raconter votre parcours de peintre, qui vous a mené, après vos études à la Kunstakademie de Stuttgart, à vous installer dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines ?
Après mes études, je n’imaginais pas vraiment rester à Stuttgart. L’id ée fut d’abord de nous installer, avec ma famille, à Strasbourg, à la frontière franco-allemande. C’est la ville où mon père est né, où mes parents se sont rencontrés, où cependant je n’ai jamais vécu ; j’aurais bien aimé renouer avec cette histoire. Mais nous n’avons pas trouvé d’appartement à Strasbourg, le marché de l’immobilier n’était pas à la portée de notre situation financiè re. Dans la vallée de SainteMarie-aux-Mines, ma famille possède une vieille ferme, où j’ai passé tous mes étés, enfant : c’est là que nous nous sommes finalement installés. Elle se trouve à Rombach-le-Franc, au pied d’une montagne ; c’est la dernière maison avant la forêt. Au départ, on pensait rester seulement quelques mois. Cela fait maintenant trois ans… Cette vie dans la nature a un côté profondément heureux. Je suis le premier à la romantiser, mais elle possède aussi un autre côté plus sombre : on y vit isolé, il y fait froid et humide, il y a toujours des travaux à faire, et en hiver le soleil ne dépasse pas souvent la cime des sapins.

Depuis quelques années, il semble qu’une volonté diffuse de décentralisation, de ralentissement se fasse de plus en plus sentir. Pourrait-on dire que votre choix s’inscrit dans cette mouvance, qu’il était en partie motivé par une certaine vision du monde, éthique et politique ?
Oui, ce fut aussi motivé par quelque chose comme ça, absolument. Je reviens d’ailleurs de Paris, où je me rends chaque fois compte, en discutant avec des amis, du stress et de la dureté qu’implique la vie en ville. Si l’on veut se consacrer à la peinture, cela implique d’avoir assez d’espace, de pouvoir jouir d’un certain calme, et d’avoir du temps. En ville, c’est très compliqué, tandis qu’à la campagne, c’est un peu plus facile. Pour chaque artiste, l’idéal est bien sûr d’avoir à la fois une maison à la campagne et un appartement en ville. La vie à la campagne offre de meilleures conditions pour se concentrer, pour travailler. Mais en tant qu’artiste, on a besoin également d’être en ville, pour rencontrer des gens, montrer ce que l’on fait, nouer des relations avec des galeries et des collectionneurs. Ce que je ne fais que trop peu. C’est le danger de vivre retiré. Ou bien le salut?
La vie à la campagne implique par ailleurs des obligations que l’on ne soupçonne pas quand on est habitué au mode d’existence urbain, comme celle de préparer des stères de bois pour l’hiver, ainsi que vous me l’avez raconté. Est-ce que ces tâches domestiques ont une influence, d’une façon ou d’une autre, sur votre manière d’envisager la peinture ?
Une influence sur mes courbatures, certainement ! Sans poêle et sans bois, on a froid l’hiver. Ce concret est assommant, et l’artiste que je suis aimerait souvent s’en libérer, mais j’apprécie le rapport plus direct aux choses qu’impose la vie à la campagne. Il force à être conscient, et à se préparer, même si ce n’est jamais assez. Quant à leur influence sur ma manière de peindre, je l’espère la moins grande possible. Je pourrais seulement dire que je me sens proche de la forêt ; c’est quelque chose que j’aime voir, et que j’aimerais savoir peindre. Vivre dans la nature me permet d’être proche des paysages que je veux peindre. En même temps, ça me coupe d’autres choses que je voudrais peindre aussi : des scènes politiques, des événements d’actualité. Je ne m’interdis pas de les peindre pour autant, en espérant que le recul et la distance me permettent d’en donner une vision plus complète. Par exemple, j’ai commencé à peindre un paysage de dévastation au Japon, après le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011. Quand je le peins, replié dans une forêt vosgienne, j’en suis très loin ; je peux me rater complètement. Chaque tableau est un risque.
Cette tension entre le fait de vivre isolé, et le fait de tendre à se rapprocher des choses, du cœur brûlant de l’histoire contemporaine, me paraît fondamentale.
Le plus souvent, l’isolement me fait du bien, pour peindre, pour penser. Quand je lis des entretiens avec des écrivains racontant qu’ils aiment écrire dans les café s, entourés de monde, j’ai du mal à m’y identifier. C’est pour cette raison que je travaille la nuit, pour être au calme. La solitude est indispensable, mais aujourd’hui, elle est un luxe. En ville, beaucoup de gens vivent dans des conditions matérielles qui empêchent d’avoir du temps pour soi, du temps pour penser ; il leur manque l’espace, le silence, le calme. Au quotidien, on vit sans songer à ces conditions usantes qui sont les nôtres, alors qu’elles ont une influence directe sur nos humeurs, notre vision du monde, de la société. À notre époque, on aurait pourtant tout ce qu’il faut pour pouvoir donner du temps aux choses essentielles, mais cela demanderait une transformation de nos habitudes en profondeur… En attendant, ce qui est dur pour moi, c’est de faire de la peinture et de faire simultanément d’autres choses à côté, qui sont pourtant nécessaires dans la vie ordinaire. Les artistes doivent travailler sur leurs œuvres, tout en entretenant les conditions matérielles et é conomiques qui leur permettent de créer ces œuvres : ces deux dimensions de l’activité artistique sont essentielles, mais elles sont totalement antinomiques.
Pourriez-vous nous parler des œuvres que vous allez présenter pour cette édition de « Dévaler », notamment de ces scènes de la vallée peintes sur d’anciennes têtes de lit ?
Ce sont d’anciennes têtes de lit en chêne qui se trouvaient dans la maison de Rombach. Sur ces panneaux qui proviennent de lits où tous les membres de ma famille ont dormi, je vais peindre deux scènes de la vallée. Je voudrais peindre des scènes heureuses, qu’on pourrait recevoir au premier degré, sans ambiguïté. Peut-être aurontelles aussi quelque chose de mélancolique, mais il s’agirait d’une mélancolie heureuse. La première sera un Speckfest devant la maison, quand on fait un feu pour y griller du lard et du pain sur des piques, en famille ou entre amis. Je voudrais peindre cela en m’inspirant des livres pour enfants que je lis à mon petit garçon, de leur fantaisie foisonnante de détails. L’autre scène que je prévois de peindre se situera dans la forêt : elle représentera une petite chapelle qui se trouve au-dessus de Sainte-Croixaux-Mines, la c hapelle de la Goutte. Plusieurs légendes existent pour expliquer son origine : on raconte qu’on la construisit pour y prier durant la Révolution ; qu’on y trouva une statue de la Vierge qui ne voulait rester qu’à cet endroit ; qu’elle fut

bâtie par un homme victime d’un accident, qui s’était promis que, s’il en réchappait, il construirait cette chapelle dans la forêt… C’est un endroit très beau, perdu dans la forêt, que j’ai découvert par hasard, et que beaucoup d’habitants de la vallée chérissent.
Vous peignez souvent la nuit. L’obscurité audehors, le silence d’un village de montagne, les forêts non loin : on imagine un calme envoûtant. Finalement, ce calme, est-ce la chose qui compte le plus pour peindre ?
Ce calme qu’on trouve la nuit a une importance primordiale pour moi. D’un côté, peindre la nuit, c’est la manière que j’ai trouvée de me dédoubler,
d’être à la fois pè re, le jour, et artiste, la nuit. D’un autre côté, je travaille mieux le soir, depuis toujours. Je me sens proche de la nuit, j’aime vivre la nuit, quand les autres dorment. Quand j’habitais en ville, j’aimais faire la fête les soirs de semaine : dans les rues ou dans les bars qui sont moins denses de monde que les soirs de week-end, je me sentais bien. Vivre la nuit, ça donne aussi l’impression de pouvoir inventer autre chose en dehors du cadre de vie standard, qui ne me correspond pas. Ça me rappelle un film, L’Amour l’apr è s-midi, d’Éric Rohmer… Le personnage principal, qui travaille dans un petit cabinet d’avocats parisiens, rencontre une vieille connaissance : ils se confient leur « angoisse de l’après-midi », et disent ne se sentir rassurés qu’une certaine heure passée…
Les pierres racontent des histoires
Par Clément Willer ~ Photo : Michel Bedez
Rencontre avec Étienne Champion dans son atelier à Strasbourg, le vendredi 5 septembre 2025.

Étienne Champion est sculpteur de masques de théâtre, mais aussi d’œuvres qu’il décrit comme « sans destination », cherchant seulement à rendre compte des entremêlements d’ombre et de lumière qui font les visages. Il se décrit comme un chiffonnier, récupérant ici une chute de granit à l’occasion d’aménagements de la voirie dans son quartier, là une suggestion technique en échangeant avec des ouvriers des travaux publics croisés au hasard des rues. Dans la chapelle de la Madeleine, on pourra contempler le fruit de ces déambulations dans l’univers des formes et des matières.
Pouvez-vous nous raconter comment s’est fait le choix des œuvres que vous allez exposer, comme cette série autour de la figure énigmatique du marcheur de Koenigshoffen ?
À la chapelle de la Madeleine seront exposées essentiellement des terres cuites et des sculptures en pierre, en grès, ainsi qu’une peut-être en trapp. La terre, on la trouve partout ; certains sculpteurs de Mongolie sont d’ailleurs capables de prendre n’importe quelle terre et d’en faire de l’argile qu’ils peuvent ensuite sculpter. La pierre, c’est différent, son origine lui donne souvent une singularité. Pour ma part, je travaille beaucoup le grès des Vosges, ainsi que le trapp de Raonl’Étape : deux pierres vosgiennes s’il en est, région à laquelle je suis profondément attaché. Pour ce qui est du marcheur de Koenigshoffen, l’élaboration des formes a commencé par une photographie, à partir de laquelle j’ai fait une série de dessins, avant de réaliser des sculptures en terre qui me servent ensuite de modèles pour la dernière étape, consistant à travailler la pierre. C’est ainsi que je procède dans mes recherches, qui cherchent à saisir les effets de l’ombre et de la lumière sur les visages, sur les êtres.
Comment envisagez-vous la résonance de vos œuvres dans ce lieu où elles vont être présentées, la chapelle de la Madeleine, édifice sacré du xiie siècle, lui-même en grès rose des Vosges ?
Évidemment, il existe un écho entre la matière du lieu et la matière des œuvres, c’est le même grès, mais ce ne fut pas le plus déterminant. Avec Michel Bedez, nous étions également allés voir une autre chapelle, dans laquelle Hervé Bohnert avait exposé l’an dernier. Mais la chapelle de la Madeleine m’a semblé mieux correspondre : à cause du volume, à cause de l’espace. Mes travaux nécessitent une certaine intimité, ce qui suppose du temps, pour regarder, pour s’approprier les formes, qui ne sont pas des formes faciles. Il faut pouvoir s’arrêter un instant, en faire le tour, vraiment prendre le temps. J’ai réagi au lieu de manière intuitive : il m’est apparu qu’il permettrait aux visiteurs de prendre ce temps. Quant au fait que ce soit un lieu sacré, cela a peut-être eu une influence cachée, subconsciente, mais je ne pourrais pas l’affirmer.
Pourriez-vous nous raconter ce qui vous relie à la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et au massif vosgien ?
C’est à vingt-cinq ans que j’ai découvert le massif vosgien, tandis que j’habitais à Épinal, où j’ai développé ma technique de sculpture de masques en bois pour le théâtre. J’ai alors parcouru ce massif en long, en large et en travers, surtout son versant lorrain. Aujourd’hui, j’explore plus le versant alsacien, à l’occasion de longues randonnées, de sorties pour cueillir des champignons. C’est aussi de là que viennent la plupart de mes matériaux, en particulier les pierres. En travaillant la pierre, je me suis penché sur des questions de géologie. J’ai appris notamment qu’autour de SaintDié se trouvent d’anciens volcans, des champs magmatiques, et que ce qu’on voit était à l’origine quatre fois plus haut. Les pierres racontent ces histoires. Quand on les écoute, notre relation au lieu gagne en profondeur.
On pourrait dire qu’il existe nécessairement une interdépendance entre une œuvre et une terre, mais que cette dimension est particulièrement consciente chez vous.
Oui, entre une œuvre, une terre, et une culture. Aller acheter des matériaux, du bois, de la pierre, c’est s’immerger dans la culture vosgienne. Dans les années 1990, j’ai suivi une formation en alternance dans la filière du bois, à Mirecourt : j’ai alors arpenté les forêts des environs, pour acheter et vendre du
bois. Cela m’a permis d’entrer en contact avec un matériau, mais aussi avec les gens qui travaillent dans cette filière. Les matériaux forment les gens. Quand vous rencontrez un bûcheron qui a trente ans de métier, vous remarquez qu’il a été formé par la forêt, par le bois. Quand vous rencontrez un carrier, vous remarquez un certain caractère que la pierre lui a imprimé. Mes premiers contacts avec les exploitants de carrières ou de scieries ont été assez compliqués, car ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Aujourd’hui, je vais acheter mon bois dans une scierie à Hilsenheim, dans le Ried. Le patron a une soixantaine d’années, comme moi, et a l’habitude de parler alsacien avec ses clients. Pour ma part, je ne parle pas alsacien, mais on a réussi à s’entendre malgré tout. La première fois, je lui ai dit : « Je veux du chêne sur quartier, hors cœur, je suis prêt à payer ce qu’il faut. » Il m’a d’abord regardé sans rien dire, avant de répondre : « Hm, c’est exigeant ça. » On a ri, et c’est comme ça qu’une vraie relation entre nous est née. Son fils a pris la relève, avec la même qualité de contact.
Vous n’achetez pas seulement vos matériaux dans les scieries et les carrières ; vous vous définissez aussi comme un chiffonnier, non ?
Oui. Il m’arrive de récupérer de la pierre dans des carrières abandonnées, ou de ramasser des chutes de granit à l’occasion d’aménagements de la voirie dans le quartier. Il m’arrive également de recevoir des choses de la part d’amis ou de personnes que je rencontre. Là-haut, dans mon bureau, j’ai un bloc de genévrier qui est passé par le feu, donné à mon attention à des comédiens qui portaient mes masques par un monsieur qui travaille le bois en Corse. Il a vu mes masques et leur a dit : « Tenez, donnez ça au sculpteur qui fait ces masques. » Des relations fortes et inattendues s’établissent au travers des matériaux. J’ai travaillé en Chine, aux ÉtatsUnis, en Suède, au Venezuela, et la recherche des matériaux revenait chaque fois à entrer dans un langage qui va au-delà de la langue. En Suède, les scieurs que j’ai rencontrés, de vieux messieurs, ne parlaient pas anglais. Je leur explique qu’il me faut telle chose, en leur montrant, et on se comprend, sans avoir besoin de parler la même langue. Ainsi aije compris, sans passer par les mots, que le chêne suédois est beaucoup plus clair, qu’il a reçu plus de lumière, alors que c’est la même variété, Quercus robur.
En somme, votre pratique de la sculpture implique une grande attention pour les matières, le bois, la pierre, autant que pour les êtres humains que vous rencontrez.
En dehors des mois d’hiver, je travaille dans mon garage, qui la plupart du temps reste ouvert sur la rue, au cœur de Koenigshoffen, un quartier populaire de Strasbourg. Il m’arrive souvent de parler avec les gens qui passent. Ma première sculpture en trapp représentait une main avec une pierre dedans ; je l’avais intitulée Première pierre. Des ouvriers des travaux publics sont passés quand je travaillais dessus et se sont arrêtés. Nous avons longuement parlé, tant de questions techniques liées au matériau, que de la pierre que j’avais sculptée dans le creux de cette main. On se demandait quelle était sa fonction, à cette pierre, et la discussion a finalement pris une tournure philosophique et politique. Pour autant, je ne communique jamais de signification particulière à mes sculptures. Je travaille d’après des modèles vivants, explorant seulement ce que la lumière et l’ombre ont raconté au moment précis où j’ai rencontré cet humain. Je travaille sans mots. Le sens qui est porté par la forme appartient aux gens qui la regarderont.
Décomposition et floraison
Par Clément Willer ~ Photos : Christophe Urbain
Vermoulu de Lisa Mouchet et Franck Rausch, fruit d’une résidence vosgienne dans le cadre de « Dévaler ».

Étape essentielle du parcours à travers le patrimoine de la vallée, l’ancien lycée de SainteMarie-aux-Mines accueillera une constellation de jeunes artistes : Arthur Metz, Lisa Mouchet, Marius Pons de Vincent, Franck Rausch, Émilie Vialet, Éric Antoine. Leurs couleurs vives et leurs nuances délicates miroiteront comme des lueurs, à travers la brume de nos sombres temps. En résidence « Dévaler » dans une fermette de montagne à quelques encablures de la vallée, Lisa Mouchet et Franck Rausch ont réalisé pour cette occasion une œuvre en commun, en immersion dans les villages et forêts vosgiennes, intitulée Vermoulu.
Diplômée de la Haute École des arts du Rhin (HEAR), comme plusieurs autres illustratrices talentueuses de la scène contemporaine, Lisa Mouchet donne vie à un univers poudreux, qui nous plonge dans un étrange ravissement où la distinction entre ce qui est flou et ce qui ne l’est pas n’importe plus. Elle dessine, munie de ses pastels, peint, écrit également. Ses dessins ont illustré les pages de Libération, du New Yorker ou du New York Times, mais son œuvre prend également d’autres formes, multiples : objets imprimés, fresques, fanzines, textiles, et même banquets. Les images qu’elle compose avec minutie témoignent souvent d’une grande attention pour la vie silencieuse et magique des choses : celle des petits pois qui restent au fond d’une assiette, d’un cigare qui fume encore dans le cendrier, d’un verre à l’abandon, dans A heavy breakfast

Franck Rausch, quant à lui, a suivi un cursus en Allemagne, avant de s’installer entre Bruxelles et Paris pour continuer à creuser son sillon dans la peinture. Ce qu’il représente s’ancre dans la vie quotidienne la plus ordinaire, et la plus énigmatique en même temps : une tasse Monsieur Heureux délaissée sur une table, le visage mélancolique d’un chien, l’attitude silencieuse et nocturne d’un homme qui mange des frites dans un snack de rue, ou encore deux personnages concentrés sur un live diffusé par un téléphone, en se partageant une paire d’écouteurs. Sa peinture nous incite à regarder ce qui se trouve dans les marges, ce qui pourrait être emporté par la banalité des jours qui passent, si le regard de l’artiste n’en faisait pas la source d’une illumination fugitive. Elle nous met en présence d’intensités de couleurs, d’une certaine texture de la lumière, de regards fugaces : à nous, ensuite, de recomposer la narration nimbée de mystère.
Vermoulu, à quoi Lisa Mouchet et Franck Rausch ont travaillé ensemble, manifeste leur fascination partagée pour les scintillements secrets de l’ordinaire, qui n’est ordinaire qu’en apparence : verres vides, bougies soufflées, assiettes où gisent des restes. Cela peut faire songer aux « tableauxpièges » de Daniel Spoerri, qui les composaient en figeant à la colle, à la fin de repas entre amis, restes dispersés et vaisselle sale sur la table. Mais sans doute est-ce le poème composé par les artistes qui parle le mieux de leur œuvre :

« Alors les assiettes sont vides, Et les verres sont vides, Plus rien à manger, plus rien à boire
On quitte la table. On quitte la pièce, puis les lieux.
Ici ni conte de fée, ni bougeoir bavard.
La théière ne prendra pas le soin de consoler une assiette mal coiffée des restes d’un convive peu gourmand.
Ce qui reste est oublié et se décompose.
Le délaissement laisse place à la pourriture.
Débute un cycle flou et invasif
La chance d’une floraison nouvelle. »

Les traces du passé
Par Clément Willer ~ Photo : Christophe Urbain
Entretien avec David Bouvier, archiviste et animateur du patrimoine de la communauté de communes du Val d’Argent,
le mercredi 10 septembre.
Archiviste et grand connaisseur du patrimoine de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, David Bouvier collecte les traces du passé, nombreuses dans cette région récemment labellisée Pays d’art et d’histoire. En tirant ces histoires petites et grandes de l’oubli, c’est l’art de réenchanter les lieux qu’on pratique.
Quel fut votre rôle dans la préparation du festival « Dévaler », qui investit des lieux chargés d’histoire du Val d’Argent que vous connaissez bien ?
En tant qu’archiviste et animateur du patrimoine, mon rôle fut de documenter les différents lieux choisis par Michel Bedez et Christophe Urbain, où seront exposées les œuvres contemporaines. Pour la plupart, ce sont des lieux insolites. On est souvent assez surpris de découvrir ce qu’abritent les façades des maisons qui bordent les rues de SainteMarie-aux-Mines. On peut songer, par exemple, à l’ancienne brasserie Fichter, rue Reber : derrière le portail d’entrée se trouvent un immense jardin ainsi qu’une cave à bières, dont on ne soupçonne pas l’existence depuis la rue. Il me semble très intéressant d’éclairer cette histoire secrète de la ville, de se demander quelles fonctions ont pu jouer ces bâtiments, quelles personnalités ils ont pu accueillir. La première impression qu’on a quelques fois, c’est celle d’une ville endormie, émaillée de bâtiments inoccupés, de commerces fermés. « Dévaler » est une très bonne occasion de découvrir certaines œuvres contemporaines qui ont un lien étroit avec la vallée, mais c’est aussi une occasion de découvrir les lieux historiques qui accueillent ces œuvres. Par la force des choses, une œuvre se retrouve intimement liée au lieu où elle est exposée : pour les visiteurs, la rencontre, c’est une rencontre avec une œuvre, et en même temps avec un lieu. Si l’on prend le temps d’explorer ces lieux, on est touché par les traces du passé qui remontent à la surface, et cela donne finalement une tout autre image de la ville, plus lumineuse.
Un exemple me semble assez parlant : celui de l’exposition qui est programmée dans la tissuthèque, faisant dialoguer ses collections avec les travaux d’élèves de la Haute École des arts du Rhin et de l’artiste mulhousienne Dorothée Haller. Comment envisagez-vous cette rencontre entre une jeune génération d’artistes et le passé dense de l’industrie textile sainte-marienne ?
Il est étonnant de remarquer que des tissus qui ont un ou deux siècles d’âge servent encore de source d’inspiration pour la création contemporaine. C’est pour alimenter cette relation inventive au passé que nous avons fondé la tissuthèque, vers 2020. Depuis plus de vingt ans que je suis en poste, j’avais remarqué que les archives textiles étaient dispersées dans différentes institutions du Val d’Argent. Elles dormaient dans des caves, des greniers : à mes yeux, c’était un trésor caché. La première démarche fut de rassembler toutes ces archives au même endroit et de s’assurer qu’elles soient conservées dans les meilleures conditions. Après quoi, il s’agissait également de les valoriser, de montrer que ces tissus peuvent encore servir aujourd’hui, d’une certaine manière. C’est pour
cette raison que nous nous sommes rapidement tournés vers les écoles de design textile. Pour donner naissance à des choses nouvelles, la création contemporaine s’inspire très souvent de modèles anciens. Par exemple, les tissus fabriqués par Chanel dans les années 2000 s’inspirent de la mode des années 1970, de dessins qui avaient trente ou quarante ans. La mode est un éternel recommencement, avec des variations subtiles. De même, ce qu’on possède dans nos collections peut inspirer les jeunes générations de designers et d’artistes, en leur présentant tout l’éventail des motifs et des coloris qui existaient déjà au xix e siècle. C’est Clémentine Canu, chargée de la conservation et de la valorisation des collections textiles, qui accueille les élèves et leur fait découvrir nos fonds. Depuis près de quatre ans, on accueille chaque année des élèves de la HEAR. Pour environ cent mille modèles de tissus, nous avons les fiches techniques associées : on sait comment les fils ont été croisés, la nature des fils utilisés, ce qui est, pour ces élèves de la section textile, du pain béni. À partir de ces modèles qu’ils peuvent étudier en détail, ils proposent des réinterprétations, avec des matières plus contemporaines.
Il semble que les archives, dans ce cas, ne sont pas seulement les traces d’un passé, mais qu’elles ouvrent aussi sur l’avenir.
Oui. Je dis souvent que les archives sont un capital d’expérience : l’expérience est ce qui nous permet d’avancer, de progresser. Les archives constituent un matériau documentaire qui peut inspirer et faire avancer la création contemporaine.
Diriez-vous que cette attention portée à son histoire industrielle est une manière de participer à la résurgence de la vallée, de conjurer le déclin ?
Oui, tout à fait. L’industrie textile, comme l’exploitation minière, est un des éléments fondamentaux du territoire. Leurs histoires ont beau être anciennes, elles nourrissent encore une effervescence d’initiatives. Certes, il n’existe plus d’usines textiles en activité : mais ce n’est pas parce qu’elles sont fermées qu’il nous faut abandonner tout ce pan d’histoire. Une certaine fierté subsiste, si l’on songe au fait qu’on a fait des tissus pour Chanel ou pour Prada, à certaines époques. Mais il ne s’agit pas seulement de glorifier le passé. Il s’agit de le valoriser pour inciter de nouvelles générations à s’en emparer, à en faire quelque chose de nouveau. Il s’agit de faire en sorte qu’ici tout recommence, et que demain nous appartienne.
Dévaler
Du
3 au 12 octobre 2025
À Sainte-Marie-aux-Mines et Sainte-Croix-aux-Mines.
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
• 1er week-end, les 3, 4 et 5 octobre de 14 h à 18 h
• 2e week-end, les 10, 11 et 12 octobre de 14 h à 18 h
En complicité avec le festival musical de Rodolphe Burger « C’est dans la Vallée ».
• La semaine du 6 au 9 octobre à 17 h des visites guidées seront proposées sur inscription auprès de l’Office du tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50
LES ARTISTES EXPOSÉS
Marius Pons de Vincent, Émilie Vialet, Arthur Metz, Éric Antoine, Lisa Mouchet, Franck Rausch, Stéphane Spach, Étienne Champion, Catherine Waller, Lorenz Rommelspacher, Jacques Battais, Jean-Christophe Schieber, Pierre Pelot, Philippe Kurtzemann, Vincent Leroux, François Génot, Duo Y, Adrien Meneau, la HEAR section Textile et l’artiste Dorothée Haller, François Traband.
Une exposition de l’Association internationale des Amis de Tomi Ungerer.
Une exposition collective des artistes de la première édition enrichira également le parcours, avec Stéphanie-Lucie Mathern, Hervé Bohnert, Christian Pion, Gérard Collin-Thiébaut, Guillaume Greff, Pascal-Henry Poirot et ValPareisot, Christophe Meyer, Christophe Bogula, Christophe Urbain et Michel Bedez.
L’accès aux expositions du parcours est gratuit.
OURS
Directeur de la publication et de la rédaction Philippe Schweyer
Direction artistique Starlight
Relecture Manon Landreau
Rédacteur Clément Willer
Photographes Michel Bedez et Christophe Urbain
Directeurs associés et amis pour la vie Michel Bedez et Christophe Urbain
BUVETTE/RESTAURATION À VALEXPO
Horaires de l’espace buvette et restauration (vin nature et raisonné / cuisine maison /produits locaux)
• Vendredi 3 de 17 h à 21 h
• Samedi 4 de 17 h à 21 h
• Dimanche 5 de 17 h à 21 h
Horaires de l’espace buvette (vin nature et raisonné)
• Vendredi 10 de 16 h 30 à 20 h 30
• Samedi 11 de 11 h 30 à 20 h 30
• Dimanche de 12 h à 17 h
Val expo 5 rue Kroeber Imlin 68160
Sainte-Marie-aux-Mines
PARTENAIRES








AVEC LA PARTICIPATION



Imprimeur Ott imprimeurs – Tirage 3 000 exemplaires – Dépôt légal : octobre 2025 – ISSN : 1969-9514 © Novo 2025
Ce hors-série du magazine Novo est édité par Médiapop à Mulhouse.
Abonnement à Novo www.novomag.fr