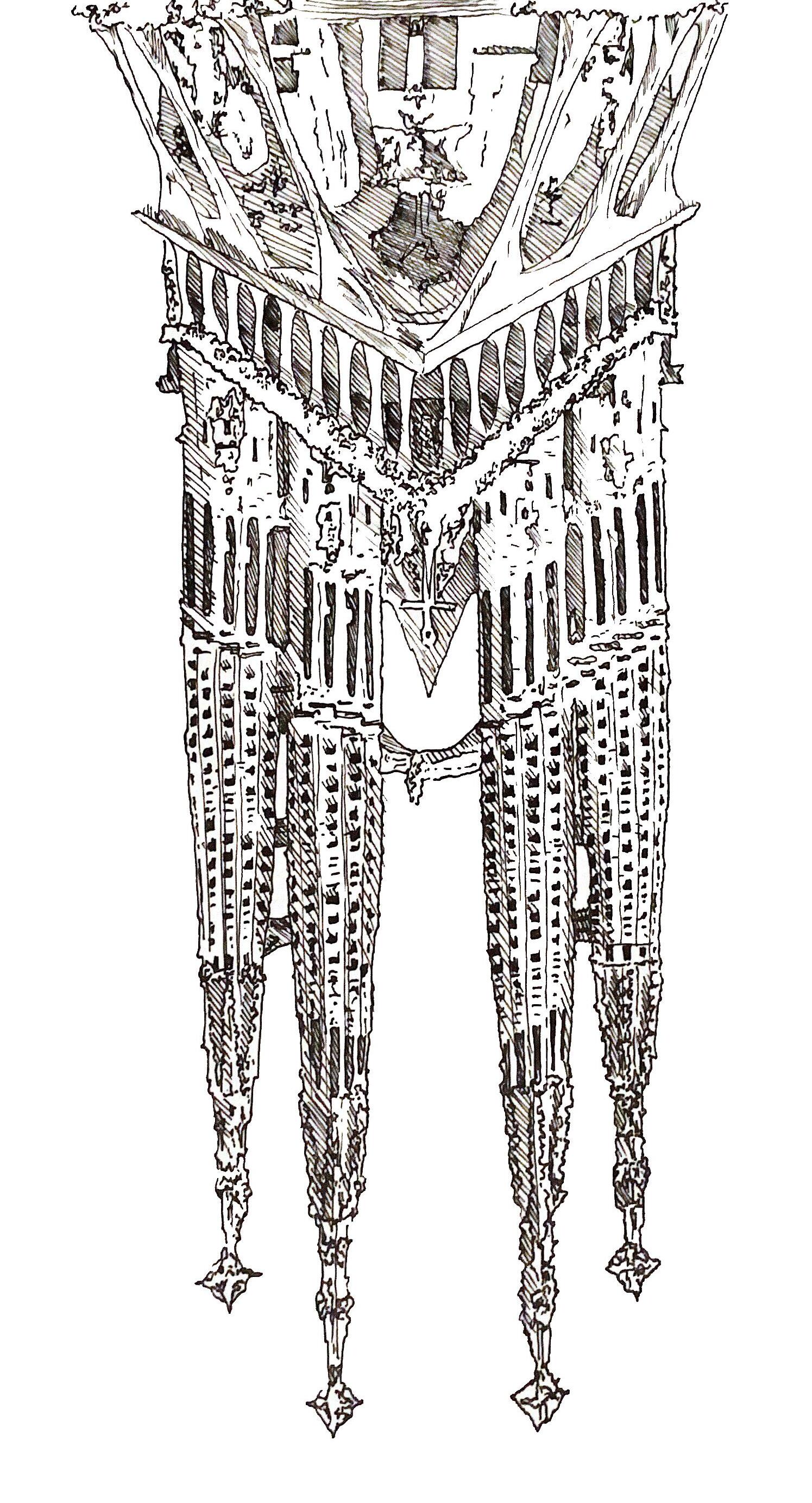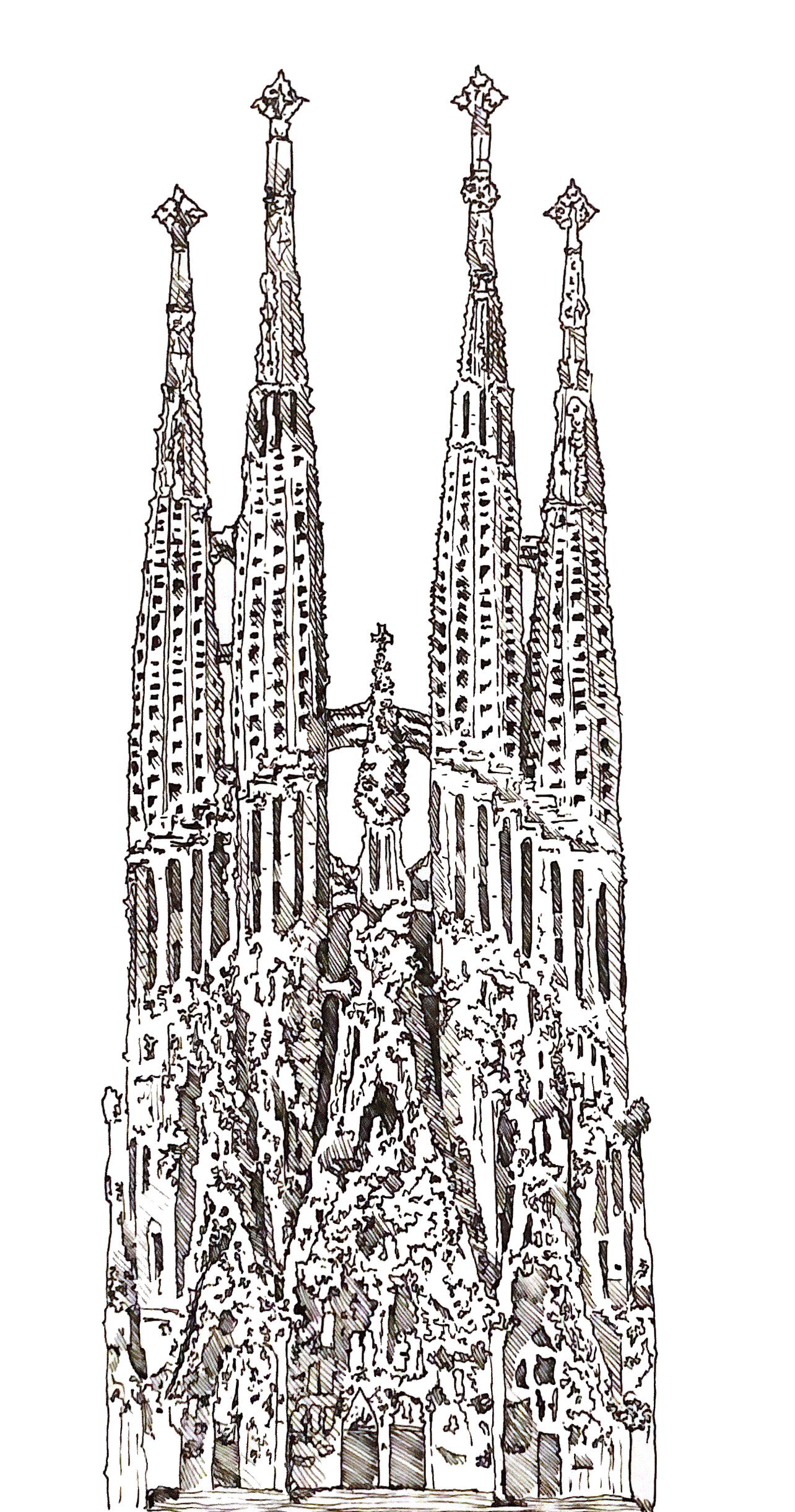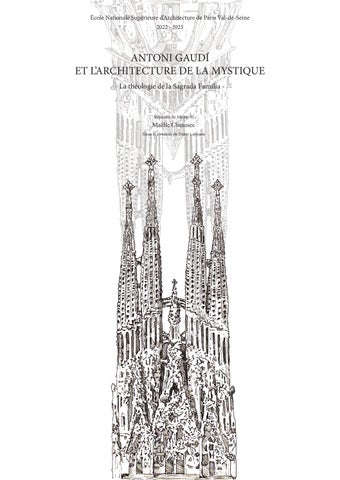2022 - 2023
ANTONI GAUDÍ ET L’ARCHITECTURE DE LA MYSTIQUE
- La théologie de la Sagrada Família -
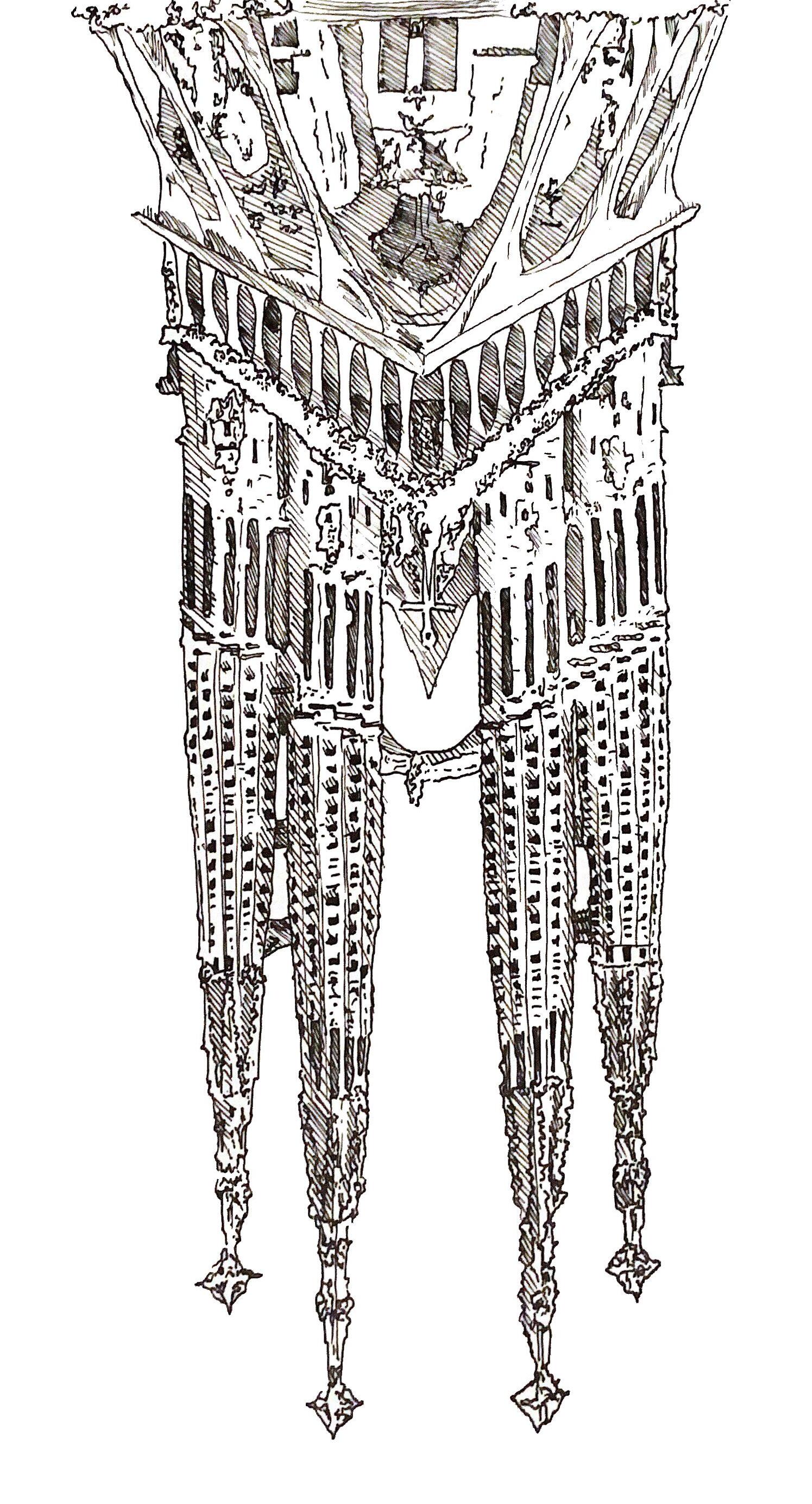
Mémoire de Master II
Maëlle Chaussec
Sous la direction de Didier Laroque
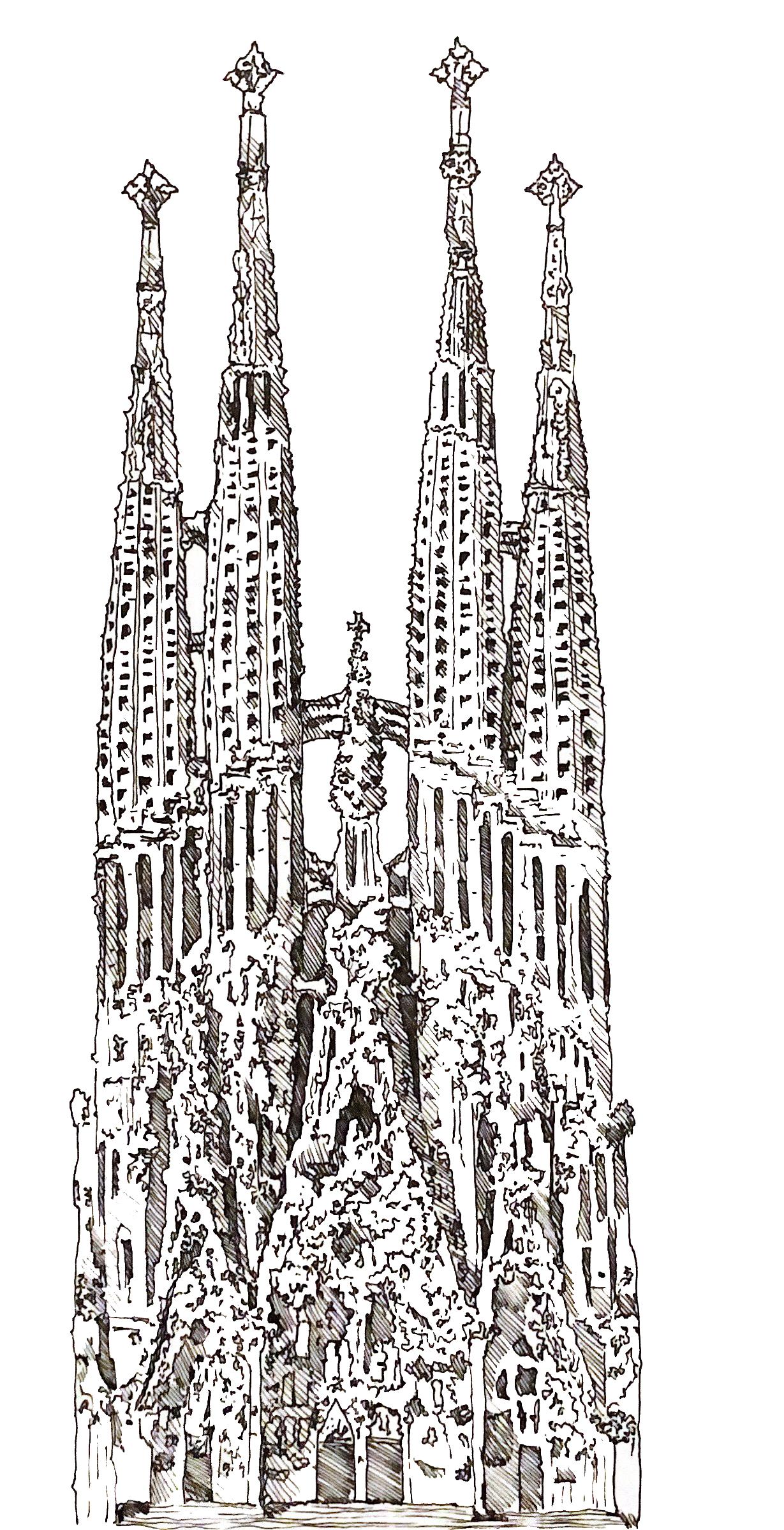
ANTONI GAUDÍ ET L’ARCHITECTURE DE LA MYSTIQUE
- La théologie de la Sagrada Família -
Mémoire de Master II
Maëlle Chaussec
Sous la direction de Didier Laroque
« Ce n’est pas moi qui construis la Sagrada Familia, mais la Sagrada Família qui me construit »
- Antoni Gaudí -
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine 2022 - 2023
Ce mémoire de recherche et de réfléxion à été abouti avec l’aide de plusieurs figures, aussi bien au sein du milieu éducatif et professionnel que dans le milieu familial.
Dans un premier temps, je remercie d’une manière évidente mon professeur référent Didier Laroque qui a très fortement contribué à la stimulation de ma réfléxion.
Je souhaiterai également et tout particulièrement remercier M. David Puig ainsi que M. Seoane Alejandro, Architectes et chefs de projet au sein de la Sagrada Família, pour avoir pris le temps de me recevoir au sein du Temple.
Enfin, je désire exprimer ma reconnaissance envers tous mes proches, qui n’ont cessé de m’encourager et de porter de l’intêret à mon travail. Leur soutien moral tout au long de ce parcours ne peut-être que mis en avant.
INTRODUCTION
I. DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE ESTHÉTIQUE DE GAUDÍ
Vision religieuse et artistique de Barcelone au XIXe siècle
Compétence théologique de Gaudí : introduction à sa pensée esthétique
II. LA SAGRADA FAMÍLIA, ARCHITECTURE DE LA FOI RELIGIEUSE
Théologie de la Sagrada Família : expérience mystique de la foi
Conception ascensionnelle et lévitationnelle du « Temple Expiatoire »
III. ARCHITECTURE MYSTIQUE ET ART TOTAL
Conception naturaliste de la Sagrada Família : idée de non-architecture
La Sagrada Família de Gaudí comme Œuvre d’Art Totale - SOMMAIRE -
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
- INTRODUCTION -
La visée esthétique de l’architecte espagnol Antoni Gaudí semble s’inscrire dans une pensée théologique, c’est-à dire dans l’ordre d’une connaissance des textes et des faits relatifs à la divinité chrétienne et aux dogmes catholiques. La Sagrada Família, ou comme Gaudí la nommait « Le Temple Expiatoire » paraît se présenter comme l’expression architecturale de sa science théologique et de sa vie spirituelle. Nous nous proposons ici d’étudier la qualité théologique et mystique de la Sagrada Família. Nous cherchons à discerner comment le savoir spirituel y est converti en architecture.
Comprendre l’importance de la dimension mystique dans le projet de Gaudí pourrait probablement permettre de comprendre comment Gaudí envisage et pense l’architecture en général. L’architecture pourrait être selon lui une représentation de l’invisible. Nous faisons ainsi cette hypothèse : Gaudí, empreint de sa pratique ascétique et dévotionnelle de la religion chrétienne userait de ses compétences théologiques afin de concevoir son architecture. La Sagrada Família serait de cette manière une représentation de l’absolu, représentation du divin. L’expérience architecturale du « Temple Expiatoire » serait ainsi reconduite en expérience mystique.
Notre étude sera divisée en trois parties : La première s’attachera à définir le contexte dans lequel l’architecte Gaudí développe sa pensée et sa compétence théologique. L’ensemble de son cheminement en tant qu’artiste et chrétien permettra de définir dans une seconde partie ce qui nourrit son expérience mystique et comment cela se mesure dans son architecture. Enfin, la dernière partie éclairera le lien qui subsiste entre la théologie mystique et l’Art (ou Art total) à travers les moyens mis en œuvre au travers de son projet architectural, la Sagrada Família.
DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE ESTHÉTIQUE DE GAUDÍ
VISION RELIGIEUSE ET ARTISTIQUE DE BARCELONE AU XXe SIÈCLE
Etablir le contexte urbain et architectural de Barcelone au milieu du XIXe siècle s’impose comme nécessaire en ce début d’étude. Est déterminé tout autant de poser un contexte sur la vie religieuse et intellectuelle qui l’anime, aussi bien depuis la création des premiers édifices religieux au IIIe siècle qu’en cette période de révolution industrielle et d’ouverture sur le monde. Cependant, bien que l’héritage religieux puisse se révéler marquant dans le processus d’organisation, d’instruction et de construction de la ville, il est évident que la période qui concerne davantage le sujet est celle qui se situe entre le XIXe siècle et le XXe siècle.
L’Œuvre Architecturale de Gaudí semble avoir pris place dans un contexte de forte croissance, que l’on peut désigner comme la «Renaixança» catalane1. Cette croissance ouverte sur le monde, aussi bien économique que politique ou bien même intellectuelle, constitue le berceau dans lequel la pensée de Gaudí évolue et s’épanouie. Cette période fructueuse pour le peuple catalan est marquée par l’émergence et l’affirmation d’une nouvelle esthétique architecturale, désormais connue sous le nom du Modernisme Catalan ou Art Nouveau. Par -esthétique, on entend ici l’étude de la sensibilité artistique et la définition de la notion du beau.2 Ce mouvement, expérimenté et développé durant trois à quatre décennies est justement le fruit de cette renaissance, de cette envie de créer une identité catalane avec un rayonnement qui dépasse la péninsule espagnole. Par ailleurs, si cette identité se ressent autant dans les rues de la capitale catalane, c’est parce qu’ à travers l’expression du modernisme catalan, l’ensemble des traditions historiques, culturelles et sociales du peuple sont non pas remplacées mais transformées dans une forme ici artistique plus contemporaine au XIXe siècle.
1« Renaixança » est un terme catalan qui peut se traduire par Renaissance. Cette expréssion est employé à Barcelone au cours du XIXe siècle pour désigner le mouvement culturel visant à la renaissance de la langue et la culture catalane.
2Définition de l’esthétique proposée par le CNRTL.
« Barcelone, redevenue Barcelone à travers sa tradition retrouvée, pouvait en toute sérénité absorber l’invraisemblable mélange des courants nouveaux. Immédiatement transformée, il devait en surgir presque simultanément une floraison féconde de tous les arts : le rare phénomène de cette époque qui constitue le Modernisme. »3
Ce qui semble ressortir de cette observation de Robert Descharnes c’est véritablement une expression totale de liberté artistique. Aussi, le modernisme serait donc nécessairement l’expression d’une liberté retrouvée.
Cependant, il faut bien mettre en évidence que l’architecte Antoni Gaudí n’a pas développé son esthétique architecturale sur les bases des règles du modernisme catalan4 mais plutôt que l’atmosphère artistique et intellectuelle de Barcelone à cette période-là a favorisé l’essor et la mise en lumière de son Œuvre architecturale. C’est pour cela que l’on parle très précisément de contexte et non d’influence. On pourrait d’ailleurs émettre l’hypothèse que dans une autre capitale possédant déjà à cette époque une forte identité architecturale telle que Paris avec l’émergence de l’Haussmannien (1853-1870), la liberté de conception n’ aurait pas été la même pour l’architecte catalan.
Le Modernisme Catalan, ou Art Nouveau est, si l’on peut le décrire synthétiquement, un mouvement artistique principalement connu pour l’ensemble des productions architecturales appartenant à ce courant intellectuel et artistique. Ce courant est caractérisé par un renouveau formel en opposition au classicisme. Plus précisément, il est question d’une approche plus organique de la forme en lien avec le naturalisme et le symbolisme. Aussi, c’ est ce traitement d’un tout organique où l’aspect constructif et décoratif sont assimilés qui amène très fréquemment une certaine confusion quant à l’appartenance d’Antoni Gaudí au mouvement du modernisme catalan.
3« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Chapitre II, p.21.
4Le modernisme catalan est la dénomination historique de la « Renaixança » dont nous avons parlé.
Barcelone, capitale catalane en pleine explosion tant économique que démographique tira profit de cette nouvelle impulsion artistique et architecturale afin de se constituer une réelle identité à l’échelle nationale et bien évidemment internationale. Autrement dit, c’est par le biais de l’architecture et plus précisément de l’art architectural que cette quête d’identification a pu faire sens en cette période de «Renaixança». Pour autant, cette liberté architecturale ne puit prendre place au sein de la société barcelonaise uniquement parce qu’il devenait nécessaire de repenser la ville dans son intégralité. De cette manière, on peut considérer que ce sont plusieurs facteurs inhérents qui ont permis de créer un environnement propice à l’effervescence de l’architecture gaudienne.
L’historien Fernand Braudel écrit « La condition d’être c’est d’avoir été »5, de même qu’Antoni Gaudí affirme que « pour être original il faut retourner à l’origine »6. Il semble que toute la pensée d’Antoni Gaudí, ainsi que l’évolution de son projet architectural se fonde sur l’idée que ces deux pensées soulignent. C’est cette idéologie qui justement évolue dans une ville en pleine reconstruction aussi bien urbaine, intellectuelle ou économique et qui résonne avec certaines figures relatives au mouvement du Modernisme Catalan. Dans cette idéologie à laquelle nous faisons allusion, il est question notamment de cet attachement à l’artisanat qui renvoie à une certaine idée de tradition mais également à la volonté de représenter le peuple catalan. C’est cette force créative et profondément nationaliste qui serait ce qui permis à Barcelone de s’imposer comme véritable capitale européenne. A une échelle plus restreinte, ce qui aurait permis à Antoni Gaudí d’imposer son Œuvre Architecturale à la ville.
Bien que le Modernisme Catalan et tout ce qui se rapporte à ce mouvement ai une importance majeure dans le développement de la ville de Barcelone, il ne faut pas négliger l’aspect plus urbain et moins artistique de cette expansion urbaine. En effet, si les différents projets d’architecture de Gaudí furent réalisés, c’est également parce que fondamentalement, toute la ville était à redessiner et à repenser.
5« La Méditérranée et le monde méditérranéen à l’époque de Philippe II », Fernand BRAUDEL. Citation que l’on retrouve dans « Gaudí, le scandale », Carles ANDREU,in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ».2002, p.26.
6« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits», Isdre Puig Boada. 2002, Originalité III, p.81.
C’est ce qu’exprime Carles Andreu : « La Catalogne toute entière, mais particulièrement Barcelone, devint un grand chantier. »7 La requalification urbaine de Barcelone conduite par l’ingénieur, architecte et urbaniste Ildéfons Cerdà dans les alentours de la vieille ville médiévale de l’époque contribua à cette re-vitalité catalane.
La Révolution Industrielle qui concerna une grande partie de l’Europe n’eut pas moins de conséquences en Catalogne (et plus précisément à Barcelone) que d’en d’autres villes européennes. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Barcelone est une ville médiévale désorganisée et entourée de remparts. Les rues y sont étroites, peu éclairées et l’architecture y est hétérogène. Seulement, avec la croissance tant économique que démographique de la ville, l’urgence de construire et de prendre exemple sur les modèles de grandes métropoles de l’époque comme Paris s'impose.
En repensant et en recréant la forme de la ville, Ildéfons Cerdà, à sa manière, contribue lui également à cette « Renaixança » et au renouveau de l’identité catalane au sein de la ville. Plus précisément c’est à travers la construction du quartier de l’« Eixample »8, dont la première pierre fût posée en 1860, que cette expansion urbaine pris place au sein de la société barcelonaise. L’Architecture de Gaudí, et plus précisément la Sagrada Família en rapport avec l’objet de l’étude, paraît en somme prendre place dans ce contexte spécifique, où la ville dans son entièreté du fond à la forme est à bâtir.
Ce document cartographique mettant en avant la ville de Barcelone permet nécessairement d’appréhender, de rendre compte de l’organisation urbaine de la capitale comme d’une sédimentation historique. Contrairement à d’autres grandes villes comme Paris, la spécificité urbaine de Barcelone semble notamment résider dans ce contraste très marqué entre le plan de Cerdà et la cité antique, remarquable tant en plan que lorsqu’on se balade dans les rues. En effet, on peut constater la persistance du tracé des remparts sur lequel le plan de Cerdà vient s’accoler.
7« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU,in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ».2002, p.25.
8L’ « Eixample » signifie en français Extension, Elargissement. C’est la plus vaste extension urbaine planifiée de Barcelone, et conduite par l’urbaniste Ildéfons Cerdà.
ÉTAT INITIAL DE BARCELONE AU DÉBUT DU XIXe
Ramparts Cité Médiévale
Cité médiévale avant requalification du plan urbain
PHASE INTERMÉDIAIRE D’EXPANSION URBAINE XXe
Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle
Partie centrale de la ville, époque médiévale
PHASE ACTUELLE D’EXPANSION URBAINE XXIe
Étalement urbain le plus récent, XXe siècle
Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle
Partie centrale de la ville, époque médiévale
FIG.1 : PHASES DE L’EXPANSION URBAINE DE BARCELONE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
« Gaudí vécut en plein dans l’euphorie de cette nouvelle situation, dans cette frénésie de construction qui souleva les Catalans et permit de satisfaire une vraie fringale de création. »9
Cette observation faite par l’auteur Carles Andreu permet de rendre compte de l’importance du contexte historique, économique et artistique dans l’émergence de l’architecture de Gaudí. En accédant à la liberté créatrice dans la ville en approchant dans un premier temps la commande bourgeoise catalane, il parvint à normaliser son architecture. Par normaliser, on entend ici qu’Antoni Gaudí, en multipliant ses projets et démonstrations d’architecture, accède à une certaine reconnaissance de son esthétique architecturale au sein de la ville et de la société catalane. Par ailleurs, Frances Pujols, écrivain et philosophe catalan écrit à propos de Gaudí : « Entre la ville de Barcelone et Gaudí, existe ce phénomène unique d’une convergence de temps, la parfaite harmonie - symbole de toutes les Renaissances »10. Ces mots, de juste valeur, synthétisent ce lien intrinsèque entre l’architecture de Gaudí et le contexte de Barcelone au milieu du XIXe siècle.
En complément de ce cadrage réalisé autour de la situation urbaine et artistique de Barcelone, nous exposons dorénavant son contexte religieux. En effet, on peut émettre l’hypothèse que l’ampleur de la place qu’occupe la spiritualité au sein de la société Barcelonaise à la fin du XIXe siècle eu un impact sur la pensée d’Antoni Gaudí. Autrement dit, faire état de la place du christianisme dans la ville catalane pourrait nécessairement nous apporter des clés de compréhension supplémentaires pour aborder par la suite l’étude plus précise du projet de la Sagrada Família.
Il semble que la religion chrétienne en Espagne et plus précisément en Catalogne détient une place importante au sein de la construction tant sociale qu’urbaine.
9« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits».2002, p.25.
10« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Chapitre II, p.21. Citation à l’origine de Francesc Pujols.
En effet, en raison du passé historique de la péninsule, la spiritualité et la foi occupent encore une place importe au XIXe siècle, à une époque où la diversité religieuse au sein de Barcelone n’est pas encore totalement remarquable.
Si l’on remonte à l’apparition de la pratique religieuse à Barcelone, il faut alors se concentrer sur le IIIe siècle avec la construction de la cité médiévale. Pour autant, il est essentiel de préciser que cette volonté d’unir le peuple autour d’un seul être divin ne fût pas immédiate. Un siècle fût effectivement nécessaire à l’installation dominante de la pratique religieuse dans le rituel quotidien des barcelonais. Plus précisément c’est en 1350 que fût posée la première pierre destinée à la construction d’un édifice religieux. Cette action permit à la fois de revendiquer l’ascendant du christianisme sur la cité médiévale de Barcelone mais elle contribue également, ou du moins elle aspire, à créer une société unie par la foi et le culte de Dieu.
S’il est permis ici de prétendre que Barcelone fait partie du berceau de la chrétienté, c’est parce que finalement la majorité des traditions et croyances de la ville qui sont célébrées depuis le XIXe siècle proviennent d’un mythe qui nous renvoie une fois de plus à la période médiévale. On pourrait sensiblement penser que l’origine même de la construction historique de la ville se baserait sur le mythe dont il est question. En d’autres termes, la religion chrétienne serait fondatrice de l’âme de la ville catalane dans une certaine mesure. Mais quel est ce mythe qui transcende les siècles et les époques ? Plus précisément, permetil de nous faire comprendre et d’expliquer pourquoi encore au XIXe siècle la pratique religieuse habite continuellement la vie quotidienne de la population ?
Cette légende trouve son origine en 1218, dans la nuit du 24 Septembre. Elle fait désormais partie des contes populaires de la Catalogne et trouverait son origine dans les textes fondateurs de l’Ordre religieux de la Merce11 (créé en 1235). Lors de cette nuit marquante, trois personnes virent l’apparition de la Sainte Marie, mère de Dieu.
11« Mercè » en catalan peut se traduire par Miséricorde. L’emploi de ce terme fait référence à « La Mare de Déu de la Mercè », autrement dit Notre Dame de Grâce.
Plus précisément, il s’agirait du roi catalan de l’époque, Jaume I, d’un marchand du peuple, Père Nolasc et d’un religieux dominicain du nom de Ramon Penyafort qui vécurent cette expérience mystique. Cette apparition fût accompagnée d’une mission ; Fonder un ordre religieux dédié au rachat des captifs chrétiens aux mains des musulmans. En résonnance avec la volonté exprimée dans cette mission, précisons que Barcelone fût, de 711 à 726 un territoire conquit par les Omeyyades, une dynastie arabe et musulmane. Seulement, cette légende qui participe au fondement du christianisme au sein de la ville catalane n’est reconnue qu’en 1687. En effet, la population invoqua celle qui fit son apparition quatre siècles plus tôt afin de mettre fin à une invasion de sauterelles dans les rues de la ville. Lorsque l’irruption de ces insectes prit fin quelques jours après, la Mare de Deu de la Merce devint la figure « protectrice de la ville » pour l’ensemble des barcelonais.
Mercè en catalan permet d’exprimer la notion de service, d’aide. Dans une certaine mesure de compassion, de bienveillance et de miséricorde, cette dénomination permet de rappeler les faits de 1687, c’est-à-dire l’aide sainte dont bénéficia le peuple catalan. En instaurant en 1868 des festivités dont l’objet de la fête repose sur cette légende, la ville de Barcelone inscrit nécessairement la religion catholique et chrétienne comme fondatrice de la culture et tradition catalane.
L’évocation de cette partie historique et religieuse semble faire sens dans cet objet d’étude dans la mesure où les croyances et la tradition de la ville de Barcelone reposent sur des faits à consonance religieuse et chrétienne. C’est certainement cet héritage, d’ordre mystique, qui permet de rendre compte de l’importance de la religion au sein de la société catalane à l’époque d’Antoni Gaudí.
Cette force spirituelle qui a fortement évolué et s’est imposée au sein du peuple catalan, se retrouve de manière extrêmement formelle dans l’organisation de la ville. Précisément, on compte deux cent églises et lieux de culte dans la capitale catalane12 contre soixantequinze à Paris.
12Valeur officielle partagée par l’Archidiocèse de Barcelone. (Ind. 2020). A titre comparatif, on compte 455 paroisses à Barcelone en 1999.
Cette valeur, recueillie par l’Archidiocèse de Barcelone confirme du point de vue urbain une très forte place de la religion au sein de la société et de la culture barcelonaise. Cette cartographie illustre justement l’implantation des différents édifices religieux sur l’ensemble du territoire de la ville de Barcelone.
C’est une carte qui se divise en trois parties et qui permet de retracer l’évolution et l’expansion de la ville. Cette division des informations permet également de rendre compte de la diffusion du christianisme à Barcelone et de voir comment cela s’est traduit d’un point de vue architectural et urbain.
La première illustre la cité médiévale de Barcelone lors de sa phase initiale de construction urbaine. Il est possible de le deviner en effet grâce aux remparts qui entourent et protègent la cité. On peut rapidement constater que les bâtiments de culte occupent une place importante dans la ville, d’autant qu’ils sont situés de part et d’autre de celle-ci. Autrement dit, ils sont accessibles et créent même une sorte de croisement en diagonale qui traverse la voie principale. On peut bien évidemment remarquer et comparer l’emprise de ces bâtiments aux habitations. En effet, la taille de la cathédrale, relativement au reste de la cité, permet de rendre compte de l'ampleur matérielle de la religion chrétienne dans la vie quotidienne d’un habitant de Barcelone au IIIe siècle.
La carte suivante représente l’expansion urbaine de cette cité avant que le plan de Cerdà soit mis en application. On observe une construction continue d’édifices religieux dont le but serait que chaque quartier dispose de son lieu de culte. Cette multiplication des bâtiments ecclésiastiques, en plus d’une volonté d’exprimer la domination chrétienne sur la ville, trouve son explication dans le fait que plusieurs ordres monastiques soient créés au sein d’une même religion. On trouve entre autres les Dominicains, les Templiers ou bien même les Trinitaires. De surcroît, on peut également préciser que la ville de Barcelone est même à l’origine de la création d’un ordre monastique, celui justement de Notre-Dame de la Merci. Une telle initiative et prise de décision de la part de la ville concernant l’Église ne peut que révéler une vraie force spirituelle au sein de ses murs.
ÉTAT INITIAL DE BARCELONE AU DÉBUT DU XIXe
Ramparts Cité Médiévale
Édifices religieux
Cité médiévale avant requalification du plan urbain
Centre médiévale initial
PHASE INTERMÉDIAIRE D’EXPANSION URBAINE XXe
Sagrada Família
Ramparts Cité Médiévale
Édifices religieux
Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle
Partie centrale de la ville, époque médiévale
PHASE ACTUELLE D’EXPANSION URBAINE XXIe
Ramparts Cité Médiévale
Édifices religieux
Étalement urbain le plus récent, XXe siècle
Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle
Partie centrale de la ville, époque médiévale
FIG. 2 : ÉVOLUTION DE L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE DANS LA COMPOSITION URBAINE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
Enfin, la dernière représentation cartographique de Barcelone se situe aux alentours des XX et XXIe siècles. Comme évoqué précédemment, avec la contextualisation de Barcelone à l’époque de Gaudí, l’industrialisation et les très petites prémices d’une mondialisation en devenir provoquent une forte explosion démographique. A cette époque, la religion est présente, certes, mais moins que quelques siècles auparavant. Cet effet d’industrialisation et de diversité à la fois culturelle et ethnique ne permet plus à l’Église de construire et d’implanter des lieux de culte de manière aussi importante et récurrente dans le paysage et la composition urbaine. Cependant, comme le montre la carte, certains temples, églises et cathédrales (dont la Sagrada Família) continuent de se construire. Ce sont plutôt des paroisses de taille plus restreinte qui s’élèvent, confondues dans le quadrillage urbain d’Ildéfons Cerdà. C’est certainement pour cette raison que la présence chrétienne se fait moins ressentir. Autrement dit, en sortant de la typologie médiévale et désorganisée de la ville, les grandes cathédrales de l’époque sont maintenant contraintes dans leur forme ainsi que dans leur taille par le plan très régulier et géométrique de Cerdà. C’est pour cette raison que l’on pourrait croire qu’à partir du XIXe siècle la présence de l’Église possède à l'échelle de la ville un rayonnement moins important.
Appréhender la force spirituelle de Barcelone sur la base d’une observation géographique et urbaine permet de nous rapprocher du sujet et de comprendre comment la domination de l’Église a évolué de manière formelle sur le territoire catalan. Cela permet également de nous laisser penser comment Gaudí a pu concilier son envie de projet cathédrale avec les besoins de développement de son époque.
D’un point de vue architectural, ces lieux de cultes, en passant de la simple paroisse à la cathédrale, s’inscrivent pour la majorité d’entre eux dans un style plutôt néogothique. On retrouve ainsi un lexique et un vocabulaire de l’architecture religieuse plutôt uniforme et récurrent à Barcelone lorsqu’au milieu du XIXe siècle, Antoni Gaudí débute sa carrière d’architecte. C’est d’ailleurs dans cette continuité que le temple de la Sagrada Família devait s’inscrire : Un temple avec un plan plutôt classique dans le style néogothique. Néanmoins, il existe et subsiste également quelques édifices de style baroque et roman qui permettent d’offrir à la ville une diversité architecturale.
Cloître attenant à la cathédrale. Elément à distinguer de la figure architectural de la cathédrale gothique
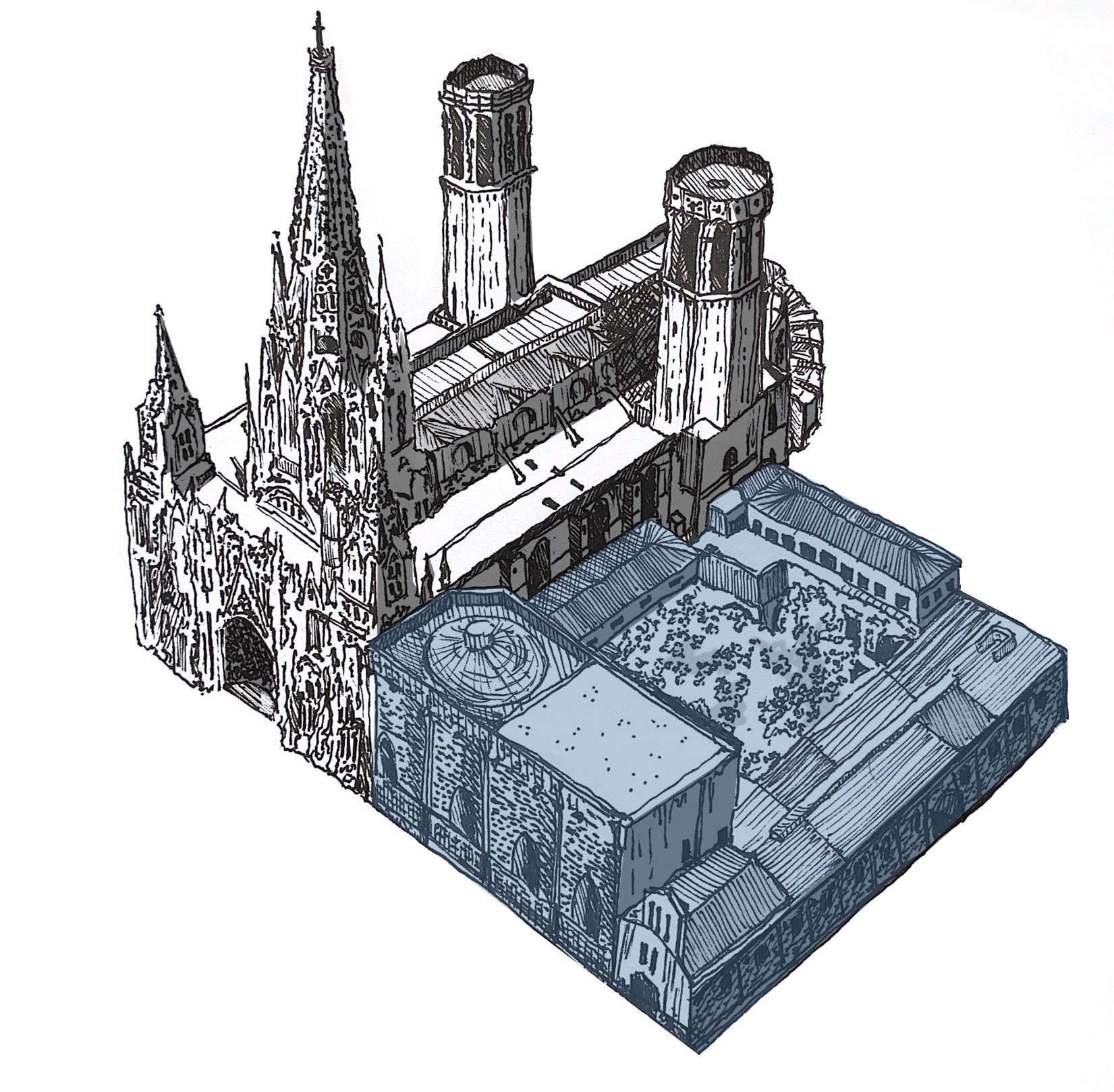
FIG.3 : CROQUIS DE LA CATHEDRALE DE BARCELONE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
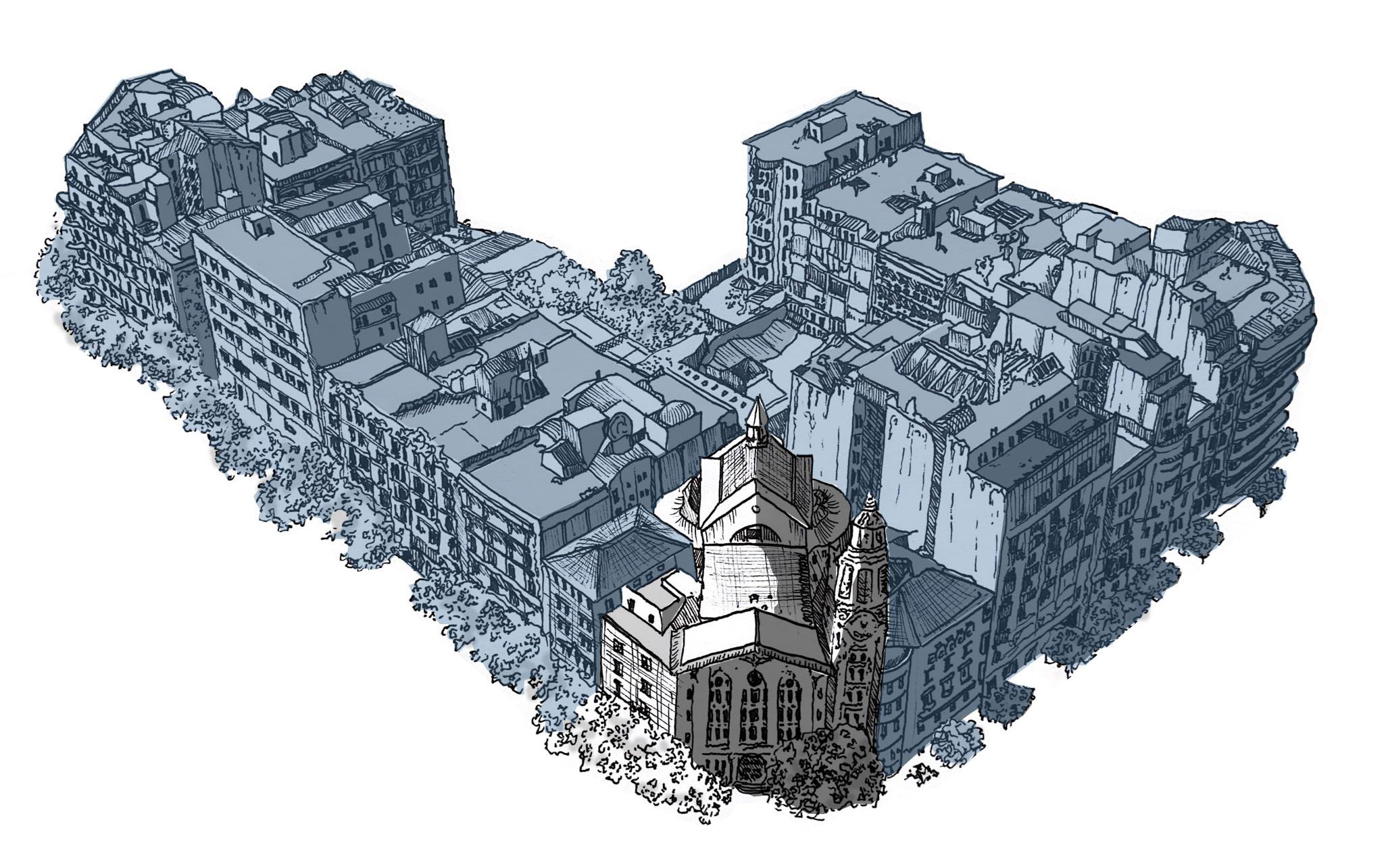
Contexte urbain dans lequel la forme architecturale de l’église s’insère. Habitations et immeubles autour.
FIG.4 : CROQUIS D’UNE ÉGLISE INTRODUITE DANS LE PLAN ORTOGONAL DE CERDA. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
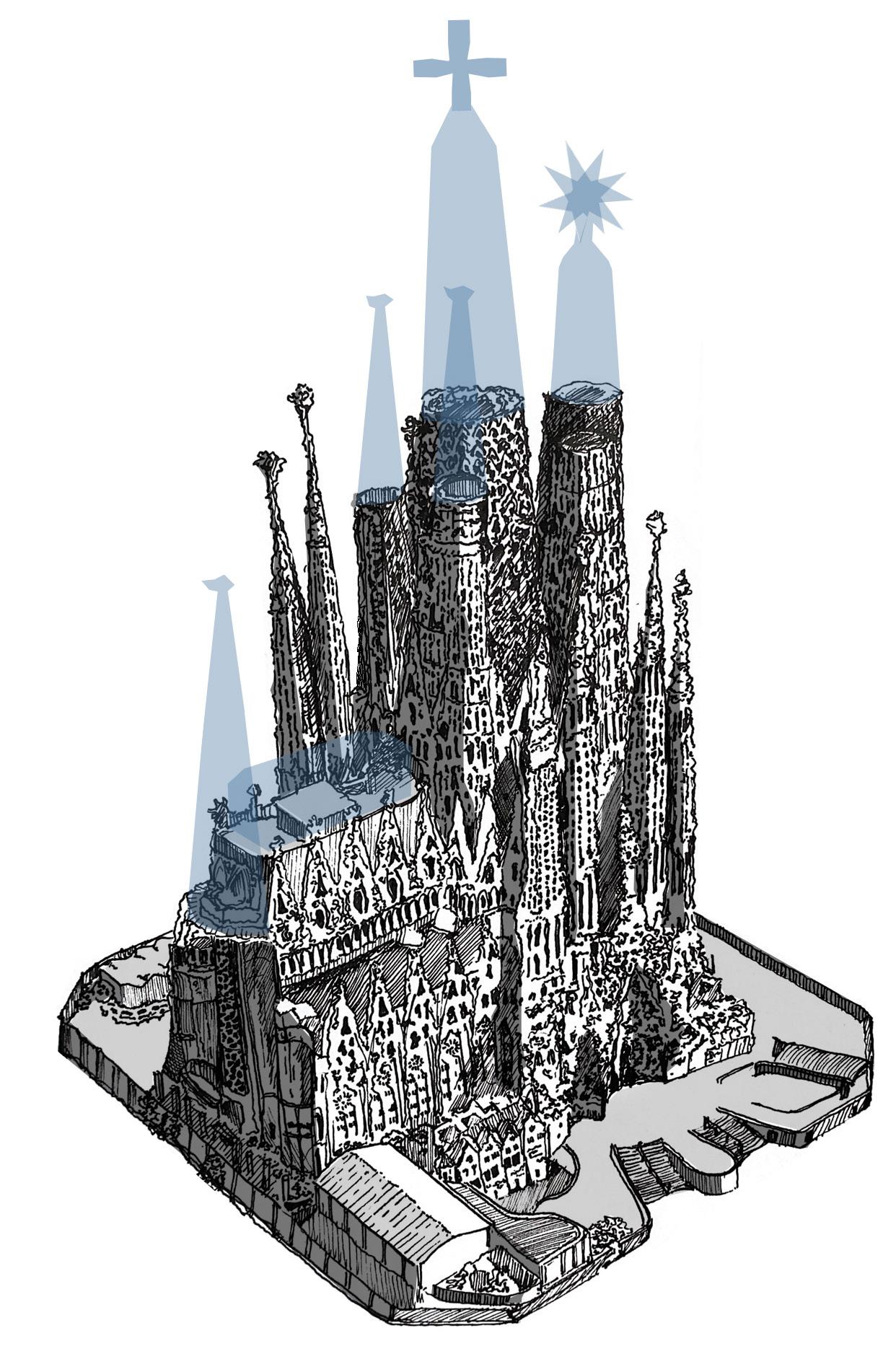
Barcelone, tout au long de sa construction, semble s’affirmer et se revendiquer comme une capitale chrétienne avec une forte spiritualité en son sein. Cette force religieuse qui subsiste pendant plusieurs siècles et qui participe à la tradition et à l’héritage de la ville est certainement, à bien des égards, ce qui constitue les bases de l’enseignement religieux d’Antoni Gaudí. Se manifestant tant en absence par la foi qu’en présence par le médium architectural qui habite les rues, la religion fait partie intégrante de la ville.
L’Œuvre d’Antoni Gaudí tire sa richesse de l’enseignement diversifié et étendu qu’il accumula le long de sa vie. Outre l’aspect architectural non négligeable, il semble que son enseignement religieux ainsi que sa personnalité profondément catalane ont participé au développement de sa pensée esthétique.
Gaudí grandit en suivant une éducation relativement religieuse. Seulement, il fût assez tôt confronté à la douleur du deuil et de la perte. De cette manière, il fût très jeune en proie aux questionnements sur Dieu, sur le sacrifice et sur la souffrance. Ce sont ces premières expériences difficiles avec la foi religieuse qui permettent certainement d’expliquer l’importance de la religion dans la vie quotidienne de Gaudí. Si l’on se concentre sur la période pendant laquelle il se dévoua complètement et littéralement à la construction de la Sagrada Família, il semble important de préciser qu’il vécut comme un moine. Cela signifie que sa piété était tellement forte, que sa foi prenait tellement de place dans sa vie, que seul le dialogue avec Dieu pouvait lui paraître essentiel. Ce dialogue, c’est nécessairement au travers de la construction du Temple Expiatoire qu’il s’établissait.
« Il entreprit un jeune si extrême qu’il le conduisit aux portes de la mort (...) Une sorte de suicide mystique. Mais lorsqu’il recouvra ses forces, il dessina d’un jet la façade de la Passion. »13
Nous parlons d’enseignement mais néanmoins, peut-on parler d’enseignement par l’erreur ou la souffrance ? Le lien direct qui est fait ici entre production architecturale et suicide mystique est évident. Littéralement, c’est par une expérience de la mort, ascétique, qu’il trouva l’inspiration. Comme si en se rapprochant du divin celui-ci lui aurait montré la voie. Par la souffrance il obtient alors l’instruction divine. La notion de souffrance étant familière lorsque l’on parle de Gaudí, il semble que l’on peut admettre que cette expérience mystique constitue fondamentalement une leçon précieuse pour Gaudí.
13« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.34-35.
Outre son parcours religieux, Antoni Gaudí était entouré de personnalités comme l’Évêque Torras i Bages, figure principale du catalanisme chrétien au début du XXe siècle.
C’est d’ailleurs cet évêque qui permit à Antoni Gaudí de se rétablir de son jeûne. En se rapprochant de figures d’autorité religieuses et en optant pour une vie ascétique tournée loin des mondanités de l’époque (desquelles il se détourna rapidement), Antoni Gaudí revint à un état de nécessité. Cela permet de manière évidente de montrer que le chrétien qu’était Antoni Gaudí était aussi (voir plus ?) important que l’architecte qu’il était. Du moins, l’architecte n’existe pas sans le chrétien dans ce cas.
Étant un homme profondément nationaliste et attaché au peuple, il n’est pas étonnant que le personnage biblique qui l’inspira le plus soit Saint Joseph. C’était selon lui la représentation la plus proche du peuple qui puisse figurer dans la Bible, de telle sorte qu’il puisse s’y identifier lui, ainsi que tous les catalans. En effet, en référence à la Bible, Saint Joseph, pécheur qui accueille Dieu comme son propre fils, donne lieu à la constitution de la Sainte Famille. (- Sagrada Família en catalan)
« Caelitum, Ioseph, DECUS, atque nostrae cierta spes vitae, columenque mundi »14 est un extrait d’un chant liturgique. On pourrait le traduire par « Joseph, honneur des habitants du ciel, espoir de notre vie ici-bas et pilier de l’Univers. » Dom Prosper Guéranger, moine bénédictin français, soutient que Joseph est « vraiment un pilier qui soutient le Monde pour que Dieu, en raison de ses mérites et par déférence pour sa prière, le soutienne et le garde malgré les iniquités qui le souillent. Et l’Église le supplie de ne pas abandonner cette mission de protecteur universel . »15
Les propos de Dom Prosper Guéranger semblent faire écho à la volonté de Gaudí. A travers cet enseignement religieux, la construction du temple expiatoire répondrait à cette mission de protéger le christianisme et de faire perdurer les valeurs et la force de la religion chrétienne.
14« Bréviaire Romain », Laudes de Saint Joseph.
15« L’année Liturgique », Dom Prosper GUERANGER.
« Plus qu’un théoricien Gaudí était un artiste doublé d’un artisan qui affirmait avoir appris à manipuler les superficies complexes, hyperboloïdes, hélicoïdales, paraboloïdes, hyperboliques et conoïdales en regardant son père artisan chaudronnier travailler le métal, marteler les plaques de cuivre et d’acier, les courber, les plier, obtenant ainsi le miracle du volume. »16
Ce que nous dit l’écrivain Carles Andreu dans un premier temps au sujet de l’enseignement de Gaudí fait écho à cet attachement pour Saint Joseph et tout ce qu’il peut représenter.
D’après les textes canoniques, Joseph, pourtant issu de la lignée de David, exerce le métier de charpentier. Gaudí quant à lui, grandit et évolue dans une famille artisanale avec un père chaudronnier. Cette proximité de mode de vie du jeune Gaudí et de Saint Joseph peut encore une fois justifier une telle identification et dévotion de l’architecte au personnage biblique.
En outre, ce que nous expose l’auteur c’est également que la base de la connaissance et de l’inspiration d’Antoni Gaudí lui proviendrait de ses plus jeunes années d’observation de son père travaillant les matériaux les plus bruts et durs pour en faire des objets lisses et courbes.
C’est indistinctement cette période de sa vie qui rendrait possible la compréhension de son esprit nationaliste ainsi que celle de son travail, suscitant en grande mesure l’artisanat et le travail local. (Notamment de la serrurerie, ferronnerie ou même céramique).
Assez vite, Antoni Gaudí se passionne et voue un réel intérêt au domaine de l’art. Il n’est pas question uniquement d’architecture, mais également de peinture et de littérature, plus précisément de poésie. En effet, la poésie qu’il lit se rapproche particulièrement de l’affection qu’il porte lui-même à la Catalogne et à cette idée de la Méditerranée.
« La vertu se tient dans le juste milieu ; méditerranée veut dire milieu de la terre. (...) Les Arts de la méditerranée auront toujours une supériorité marquée sur ceux du nord parce qu’ils s’appliquent à l’observation de la nature. (...) Je dois mes qualités grecques à la Méditerranée dont la vue est pour moi une absolue nécessité »17
16« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ». 2002,p.16.
17 « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Méditerranée I, p.71.
L’Emigrant18
Dolce Catalunya,
Pàtria del meu cor,
Quan de te s’allunya
D’enyorança es mor.
I
Hermosa vall, bressol de ma infantesa,
Blanc Pirineu,
Marger i rius, ermita al cel suspesa,
Per sempre adéu!
Arpes del bosc, pinsans i caderneres, Cantau, cantau;
Jo dic plorant a boscos i riberes:
Adéu-siau!
II
¿On trobaré tos sanitosos climes,
Ton cel daurat ?
Mes ai, mes ai ! ¿on troaré tes cimes,
Bell Montserrat ?
Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,
Ta hermosa Seu,
Ni eixos turons, joiells de la corona
Que et posà Déu.
III
Adéu, germans; adéu-siau, mon pare,
No us veuré més!
Oh, si al fossar on jau ma dolça mare
Jo el llit tingués!
Oh mariners, el vent que me’n desterra,
Que em fa sofrir!
Estic malalt, mes ai ! torneu-me a terra,
Que hi vull morir!
L'Émigré
Douce Catalogne, Patrie de mon cœur, Quand elle s'éloigne de toi
Avec nostalgie, elle meurt.
ILa vallée d'Hermosa, berceau de mon enfance,
Pyrénées blanches,
Rives et rivières, ermitage suspendu dans le ciel, Adieu pour toujours !
Harpes de la forêt, pinsons et chardonnerets,
Chantez, chantez ;
Je dis en pleurant aux forêts et aux berges :
Adieu !
II
Où trouverai-je tes climats sains,
Ton ciel d’or ?
Oh là là, oh là là !, où trouverai-je tes sommets, Belle Montserrat ?
Nulle part je ne verrai, ville de Barcelone, Ton beau siège,
Ni ces collines, joyaux de la couronne
Que Dieu a mis sur toi.
III
Adieu, frères ; adieu, mon père, Je ne te reverrai plus !
Oh, oui dans la fosse où ma douce mère repose J’aimerais avoir le lit !
Ô marins, le vent qui me chasse, Qui me fait souffrir !
Je suis malade, mais hélas ! Repose-moi à terre, Je veux y mourir !
18Jacinto Verdaguer, avril 1894. Composé par la suite en chant catalan par Amadeu Vives i Roig.
On peut lire ici un des poèmes de Jacinto Verdaguer19. A la manière de Gaudí à travers l’architecture, Verdaguer à l’aide de sa plume use de son art pour exprimer son amour de la patrie et de la Catalogne. On y voit tout ce que représente la méditerranée avec ces descriptions très visuelles de paysages divers. Jacinto Verdaguer est entre autres une des lectures de Gaudí.
D’autres poètes comme Joan Maragall20 ont nourri l’inspiration de Gaudí mais également des peintres et sculpteurs. Le plus ancien, Jérôme Bosch. Ce peintre du V et VIe siècle appartient au mouvement du gothique puis fantastique. L’inspiration que Gaudí puit avoir pour cet artiste pourtant néerlandais (par conséquent non Méditerranéen) réside certainement dans le profil de l’artiste, c’est-à-dire profondément ancré dans les traditions et également très proche de la religion. C’est justement cette tradition et religion que l’on retrouve dans ses peintures, que l’on pourrait qualifier de chaos organisés, notamment avec son œuvre la plus célèbre, Le Jardin des Délices21 .
Dans un contexte plus architectural, la période des grandes cathédrales (période gothique) est également ce qui constitue la base de l’enseignement de Gaudí. Eugène Viollet-le-Duc, architecte français du XIXe siècle est à quelques années le contemporain de l’architecte catalan. Son ouvrage « Dictionnaire Raisonné de l’Architecture » ainsi que son étude sur la cathédrale idéale participent aux lectures attentives de Gaudí. C’est d’ailleurs à partir du style gothique de l’architecture religieuse que Gaudí conçoit et dessine le projet de la Sagrada Família. Il apparaît donc que le gothique ainsi que les travaux de Viollet-leDuc constituent un point fondamental de son enseignement universitaire.
19Jacinto Verdaguer (1845 - 1902) est un prêtre et poète catalan. C’est une des figures majeures de la « Renaixança » catalane dans le domaine de la poésie et qualifié de « Prince des poètes catalans » par l'évêque Josep Torras i Bages.
20Joan Maragall (1860 - 1911) est également une figure du modernisme catalan. Son oeuvre poétique « Le comte d’Arnau » lui vaut d’être considéré comme l’héritier de Verdaguer.
D’autre part, Owen Jones, architecte et artiste des arts décoratifs à l’époque du XIXe siècle, figure également parmi les inspirations de Gaudí. C’est son appréhension des couleurs ainsi que des formes ornementales qui vont l’animer et participer à l’élaboration de ses multiples mosaïques de céramique. L’attrait pour cet art et ces formes renvoie directement à la culture et architecture byzantine qu’il apprécie très fortement. On trouvera d’ailleurs dans nombreux de ses projets des ressemblances et inspirations de cette architecture qui pour lui représentent tout ce qui renvoie à la tradition et à l’origine. (Prolongation de l’architecture romaine traditionnelle)
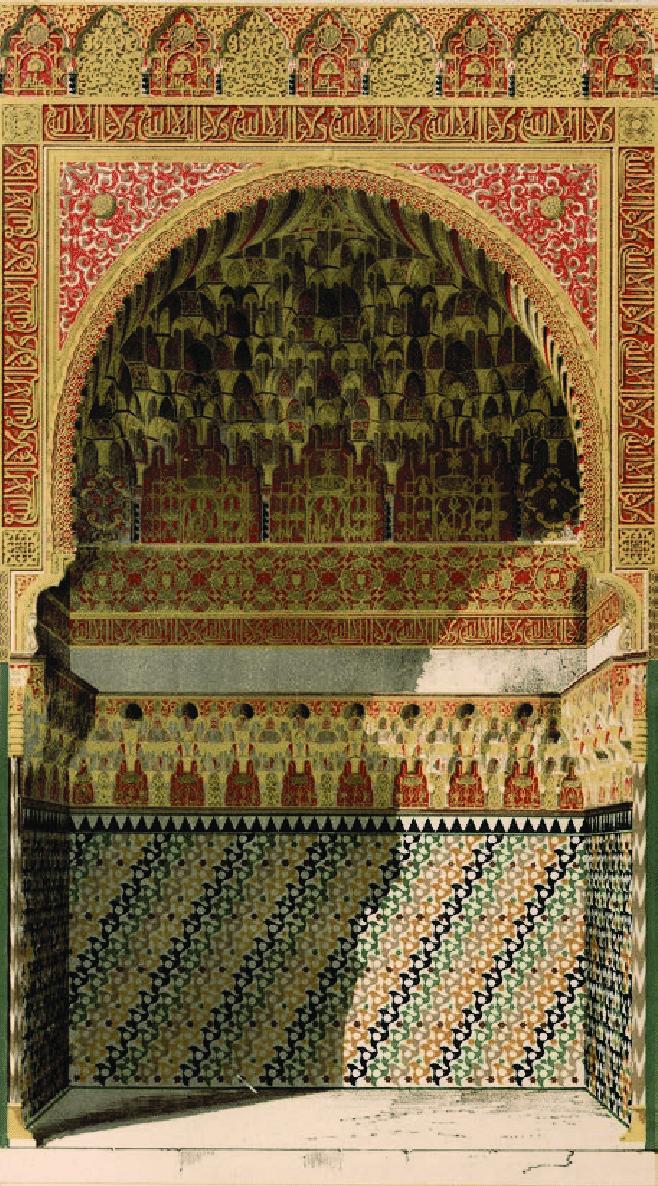
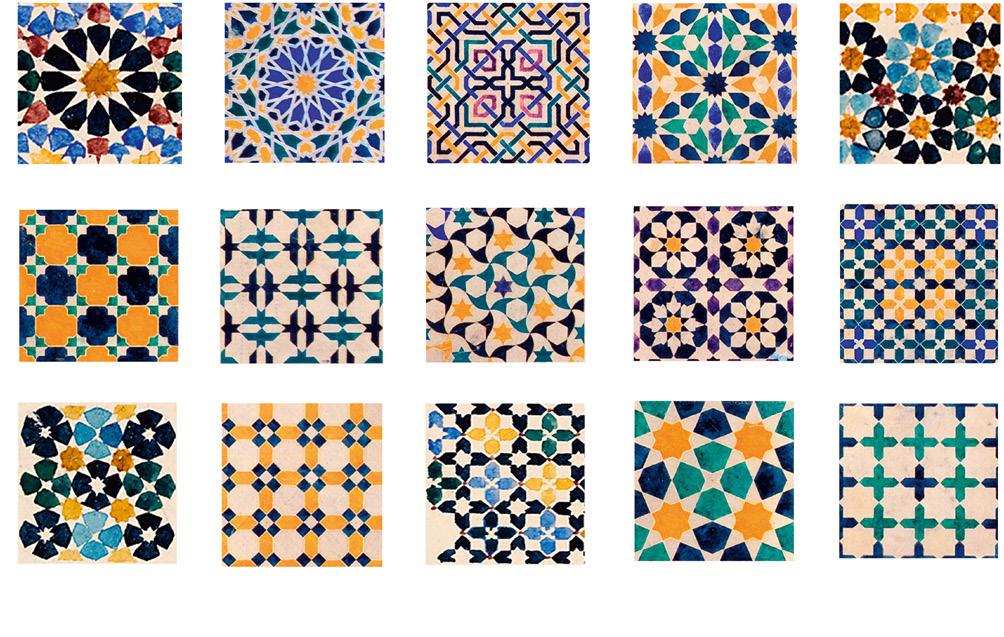

FIG.6 : CROQUIS, « Grammaire de l’ornement ». Jones, OWEN. 1856
FIG.7 : RECHERCHES, ORNEMENTATION ET POLYCHROMIE, « Grammaire de l’ornement ». JONES, Owen. 1856
FIG.8 : RECHERCHES, LA COLONNE DU TEMPLE POLYCHROMÉE, « Grammaire de l’ornement ». JONES, Owen 1856
En guise de note conclusive pour cette mise en contexte favorable nous l’avons vu, à l’émergence de l’architecture gaudienne, il semble important d’évoquer une rencontre déterminante dans la vie d’architecte de Gaudí. Il s’agit de celle d’Eusebi Güell 22. C’est nécessairement la rencontre qui lui ouvre les portes de la commande privée mais qui permet aussi à l’architecte de constituer un nombre important de références pour le reste de sa carrière. On peut d’ailleurs se demander si sans le soutien du comte Güell, Antoni Gaudí aurait eu l’opportunité de réaliser autant d’édifices.
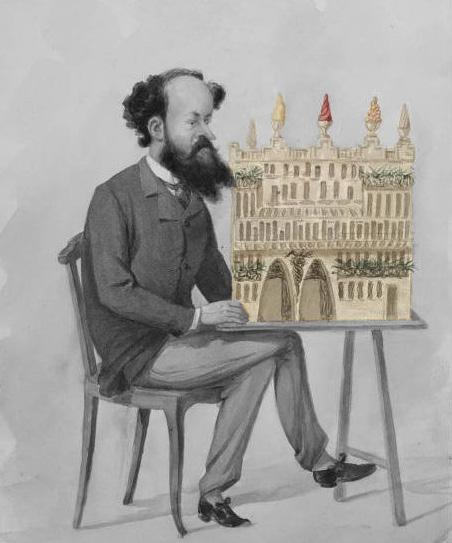
22Eusebi Güell (1846-1918) est un riche industriel et mécène catalan qui permet de mettre en avant l’oeuvre de Gaudi qu’il apprécie particulièrement. Il est d’ailleurs le principal client de Gaudi et deviendra par la suite un ami proche de l’architecte.
COMPÉTENCE THÉOLOGIQUE DE GAUDÍ : INTRODUCTION À SA PENSÉE ESTHÉTIQUE
- SOUFFRANCE ET NÉCESSITÉ -
Comprendre l’architecture de la Sagrada Família, c’est nécessairement voir et appréhender l’esthétique de Gaudí. Comme l’étude du contexte l’a exprimé, la vie de l’architecte est rythmée par sa pratique rigoureuse de la religion chrétienne. Cette foi qui l’anime et le guide occupe par conséquent une imposante place dans la conception de son architecture. L’esthétique de son architecture, reflet de sa dévotion pour Dieu, semble organisée autour de principes d’ordre philosophique et théologique. Par - théologique on entend l’étude de la science de Dieu, de ses attributs, de ses rapports avec l’homme ainsi qu’avec le monde. Seulement, en lien avec l’architecture de Gaudí et l’appréhension de son esthétique architecturale, il serait plus précis de parler de théologie de la mystique (ou ascétique). Et, par théologie de la mystique, on comprend plus précisément la recherche de la perfection de la vie chrétienne. Dans une certaine mesure, on pourrait également associer cela au quiétisme. Le quiétisme est une doctrine mystique permettant d’accomplir un « Cheminement vers Dieu »23. Ce serait la réalisation de cette quête à laquelle aspire Antoni Gaudí par le biais de son architecture. Ainsi, se tourne vers Dieu celui qui en Jésus a dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive ».24
« C’est par l’anéantissement de mon être propre et borné que j’entrerai dans votre immensité divine »25 Cette affirmation énoncée par le mystique Fénelon vient faire écho à la volonté de Gaudí mais également à ce que dit Jésus.
23Définition du quiétisme proposée par le CNRTL. C’est une doctrine religieuse établie au XVIIe siècle par le théologien espagnol Miguel de Molinos.
24« Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu », Chapitre XVI, vers 24.
25« Oeuvre de Fénelon », François DE SALIGNAC DE LA MOTHE-FENELON. Volume 1, II. Pour le jour de Saint-Thomas, p.268.
Effectivement, sa vie, traduite par un profond ascétisme, gage de sa grande piété, n’est que le résultat d’un cheminement vers la pureté, le rapprochement de Dieu. Nous pourrions nous demander en quoi le choix de se tourner vers une pratique mystique de la religion est un outil de mesure et de compréhension à sa pratique architecturale ?
La souffrance, et le retour à l’état de nécessité dont il fait preuve après avoir mené une vie bourgeoise, est certainement ce qui nous permet d’esquisser un début de réponse. Comme nous l’avons vu, la souffrance est un sentiment permanent dans la vie de Gaudí.
Ses fragilités de santé dans son enfance, la mort de plusieurs membres de sa famille ou encore la résignation à la quête de l’amour d’autrui est ce qui constitue la formation d’une forme de souffrance perpétuelle et perpétuée chez Gaudí. Cependant, il soutient que cette souffrance est pourtant nécessaire et même signe de rapprochement envers Dieu.
Ce besoin que ressent Gaudí d’éprouver de la souffrance au point de mener une vie totalement dépourvue de biens et de matériel dans le but de trouver grâce auprès de Dieu rappelle les propos du philosophe Nietzsche. Il énonce dans les pages de son essai « Généalogie de la morale » que :
« L’homme ne refuse pas en soi la souffrance, il la veut, il la recherche même, pourvu qu’on lui en montre le sens, un pourquoi de la souffrance. C’est l’absence de sens de la souffrance et non celle-ci qui était la malédiction jusqu’ici répandue sur l’humanité (...) L’homme préfère encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout. »26
La souffrance de Gaudí est justement porteuse de sens : trouver Dieu. C’est donc à travers l’expression de sa souffrance et pour se rapprocher de Dieu que Gaudí revient à cette pauvreté.
26« Généalogie de la morale », Frédéric NIETZSCHE. IIIe Traité, §28.
La souffrance qu’il s’impose en retournant à l’état de misère matérielle a ainsi pour but de la conduire à la richesse divine. C’’est à travers cet abandon de lui-même pour Dieu qu’il trouve l’inspiration pour son temple expiatoire comme si se dénuer de toute richesse matérielle permettait l’enrichissement intellectuel et spirituel. « Le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer. »27 Cette seconde citation de Nietzsche illustre de manière figurative le propos tenu à l’encontre de la vie ascétique de Gaudí.
Si une grande importance semble accordée à ce sentiment de souffrance que Gaudí exprime une grande partie de sa vie, c’est parce que celle-ci est une des clés de compréhension de son esthétique architecturale et par extension de son projet de la Sagrada Família. En effet, en rapprochant l’état de nécessité comme étant intrinsèque à la question de la beauté, il installe son état de souffrance comme principe actif de sa pensée théologique et architecturale.
« Il ne faut pas confondre pauvreté et misère. La pauvreté conduit à l’élégance et à la beauté, la richesse à l’opulence et à la complication qui ne peuvent être belles. »28
Cette phrase très claire de Gaudí est ce qui permet de confirmer cette importance de la pauvreté dans le processus de conception de l’architecte. Par pauvreté il exprime non pas la pauvreté comme un état négatif mais plutôt comme une manière de pouvoir éliminer tous les artifices que l’on peut trouver dans la bourgeoisie pour atteindre l’essence, la nécessité. Ainsi, la pauvreté en tant que matière est selon lui ce qui pourrait permettre d’atteindre la beauté et la perfection.
Cette idée de la douleur et de la souffrance est également impérative pour Gaudí dans l’exécution de ses œuvres. Celui-ci semblait avoir une vision de l’art très théologique et divine.
27« Le Gai Savoir », Frédéric NIETZSCHE. Quatrième livre, aphorismes 338 à 342.
28« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Pauvreté II, p.160.
L’art, en tant que médium de représentation du Divin, du suprasensible, ne peut être pleinement entrepris par un homme qui n’en ressent pas de la douleur. C’est ce qu’exprime l’écrivain Isdre Puig Boada dans son recueil de paroles et d’écrits de l’architecte.
« Gaudí en était arrivé à penser que la douleur et même la pénurie étaient nécessaires pour contrebalancer l’obsession artistique. Pour que l’artiste ne soit pas déséquilibré par l’exigence de l’art, il doit connaître la douleur et la misère. »29
Il serait possible de lier cette nécessité de douleur pour pouvoir atteindre l’œuvre d’art au concept de la beauté. C’est certainement autour d’une même pensée mystique que ces deux idées sont formées dans la pensée de Gaudí. Dans ce contexte présent, par l’expression du mot mystique, on met en avant les pratiques et croyances qui visent à une union entre l’homme et la divinité 30. Il semble que c’est ce dont il s’agit. En s’imposant une douleur et un rythme de vie ascétique, il espère sans doute se confondre avec Dieu. C’est finalement ce sacrifice d’ordre mystique qui expliquerait le caractère si singulier que l’on peut trouver à la Sagrada Família.
« Le sacrifice est nécessaire au succès des œuvres, même si celles-ci sont longues à réaliser : puisqu’il est impossible de vivre sans se sacrifier, autant le faire pour de bonnes œuvres. »31
Selon les textes bibliques, le sacrifice est un don fait à Dieu. Plus précisément, il s’agirait d’un don qui prend la forme d’un repas lequel est préparé afin de l’honorer. En outre, c’est un terme associé à la notion de dévouement, de privation de bien au service de quelqu’un. L’étymologie du mot « sacrifier » découle de son terme latin -sacrifice, un composé de -sacrum facere qui signifie faire un acte sacré 32
29« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Pauvreté II, p.160.
30Définition de mystique proposée par le CNRTL.
31« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Temple de la Sagrada Familia I, p.176.
32Définition de sacrifice proposée par le CNRTL.
Ainsi, en employant le terme théologique de « sacrifice », Gaudí inscrit sa pratique artistique dans une vision ascétique et mystique.
La souffrance matérialisée par l’action sacrificielle, d’un point de vue théologique, permet de ce fait à Gaudí de trouver l’inspiration, comme si en s’abandonnant à Dieu, celui-ci lui faisait don d’une vision de l’irreprésentable, de l’infini. Cette hypothèse peut non pas se vérifier mais plutôt être illustrée par un fait observé par l’entourage de Gaudí. Comme évoqué plutôt dans le texte, Antoni Gaudí entreprît un jeûne religieux et très extrême qui causa presque sa mort. Seulement, en se rétablissant, il dessina en une seule fois la façade de la Passion (appelée également façade de la mort), pour le projet de la Sagrada Família.
Cette expérience du suicide mystique détermine ici le lien fort qui existe entre l’esthétique de Gaudí, la souffrance et Dieu
« Plus la souffrance s’imposa à lui, plus son œuvre se dresse, figure, représente ce que lui dicte son désir : donner à voir l’irreprésentable. »33
Afin d’accomplir cette première idée selon laquelle le sacrifice et la souffrance seraient partisantes de son esthétique, il semble intéressant de mettre en lumière les propos d’Annie Andreu Laroche. Cette gradation énoncée dans la construction de la phrase par l’expression du « plus » ( à propos de l’expérience spirituelle et mystique que paraît vivre Gaudí ) traduit ainsi une véritable quête de souffrance comme quête de sens, d’inspiration.
Cette idée de la souffrance dans la conception esthétique de Gaudí semble relever d’une importance certaine dans la mesure où celle-ci justifierait dans une certaine mesure la notion de Beauté chez Gaudí. Comprendre ce que la Beauté ou le Beau signifie dans la pensée de l’architecte catalan nous permettrait de déterminer et discerner la conception théologique de la Sagrada Família.
33« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.10.
- BEAUTÉ ET VÉRITÉ -
La Beauté est un concept esthétique et philosophique qu’il semble ainsi nécessaire de définir de manière plus précise. En effet, le principe du « Beau » est un abus de langage et une expression fort peu objective. De ce fait, discerner cette expression communément employée pour exprimer un sentiment, un avis personnel de son véritable sens philosophique parait impératif. Nous allons nous appuyer sur la pensée d’Hegel pour définir cette notion de « Beauté ».
Nous défendons ici l’idée que, comme tout autre concept travaillé et exprimé par Gaudí, la Beauté cultive un lien fort avec la foi chrétienne. En effet, de la même manière que l’ascétisme et la souffrance lui permettent d’accéder à la création artistique, la foi chrétienne lui permettrait également d’atteindre cette idée de Beauté. Hegel, à travers son discours sur l’esthétique, nous permet de soutenir que pour Gaudí, la Beauté est encore une foi liée à la religion.
Hegel, dans sa thèse « Introduction à l’Esthétique : Le Beau » met en lien cette notion avec celle de la Vérité. En effet, le Beau serait la représentation sensible du vrai.
« Nous appelons le beau l’idée du beau. Le beau doit donc être conçu comme idée et en même temps comme l’idée sous une forme particulière, comme l’idéal. (..) L’idée, c’est le fond, l’essence même de toute existence, le type, l’unité réelle et vivante dont les objets visibles ne sont que la réalisation extérieure. (...)Tout ce qui existe n’a donc de vérité qu’autant qu’il est l’idée passée à l’état d’existence ; car l’idée est la véritable et absolue réalité. Tout ce qui apparaît comme réel aux sens et à la conscience n’est pas vrai parce qu’il est réel, mais parce qu’il correspond à l’idée, réalise l’idée. Autrement le réel est une pure apparence (...) Maintenant, si nous disons que la beauté est l’idée, c’est que beauté et vérité, sous un rapport, sont identiques. »34
34« Introduction à l’Esthétique : Le Beau », Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. Chapitre I : De l’idée du Beau en général. p.42.
Ces quelques extraits de la thèse d’Hegel nous donnent la possibilité de définir cette notion de Beauté à partir de la notion d’idée. L’idée ou l’idéal, autrement dit la vérité, est finalement le fondement de la Beauté. Tout ce qui relève de la vérité est par conséquent considéré comme Beauté. Ainsi, au-delà d’être un simple sentiment non objectif, la Beauté relève de la vérité absolue. Gaudí reprend ces termes mais donne une signification supplémentaire à cette notion de Vérité.
« La Beauté est l’éclat de la Vérité. Puisque l’Art est Beauté, sans Vérité il n’y a pas d’Art. L’amour de la Vérité doit être par-dessus tout autre amour. La Création continue et le Créateur utilise ses créatures afin de la poursuivre. Ceux qui cherchent à connaître les lois de la nature pour réaliser leurs œuvres collaborent avec le Créateur. »35
Gaudí, en parlant de l’idée de Beauté, revient également à cette idée de la foi chrétienne. On devine alors que sa conception de la Vérité passe par celle de Dieu. Nécessairement, tout ce qui est vérité selon Gaudí serait d’ordre religieux. Étant donné que Dieu représente cette idée de Vérité, alors la Beauté consisterait à représenter la Vérité et donc à représenter l’irreprésentable. Ainsi, en construisant la Sagrada Família il tend à représenter la Vérité et donc à représenter une idée, Dieu.
Plus précisément en rapport au projet de la Sagrada Família, cette pensée qui fait partie du processus de conception de Gaudí semble de manière déterminante montrer à quel point l’aspect théologique du projet est constitutif de l’ensemble bâti. Par ses mots, Gaudí s’identifie non plus comme un architecte à part entière mais plutôt comme un messager qui ne représente que la Vérité, celle que Dieu lui a enseigné. De ce fait, la visée esthétique de Gaudí n’est pas de concevoir une architecture qui, d’un point de vue non objectif et sentimental serait « belle », ou du moins appréciable par la société, mais conçoit en réalité une représentation de la Vérité divine.
35« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Beauté I, p.77.
C’est certainement pour cette raison qu’Antoni Gaudí est un architecte que l’on ne peut pas intégrer dans un mouvement précis, tout simplement parce que sa conception passe au-delà des questionnements esthétiques liés à l’art et l’architecture. Ils s’orientent plutôt vers une quête de mise en forme, mise en substance de l’infini. Autrement dit, matérialiser l’infini divin dans le fini terrestre.
Finalement, on peut déceler une certaine forme de processus mis en place par l’architecte catalan afin d’atteindre cette Vérité. D’une manière cyclique, on peut émettre l’hypothèse qu’en vivant une vie qui se rapproche du monachisme, celui-ci se rapproche de Dieu pour atteindre la Vérité. Par conséquent en représentant « simplement » cette Vérité, il parvient à atteindre la Beauté.
On pourrait aller plus loin et même contraster cette idée avec la notion du Sublime. Dans les textes philosophiques, l’idée du Sublime surpasse l’idée du Beau. En effet, quand nous avons contemplé et saisi le sublime, il se produit en nous, selon Kant, « Une légère douleur, une sorte d'aspiration vers cet infini du sublime que l'esprit ne peut embrasser tout entier. »36 Il apparaît que, dans la mesure où Gaudí semble conjuguer architecture et pratique mystique de sa foi chrétienne, la Sagrada Família relèverait finalement plus du Sublime que du Beau. Seulement, Gaudí dans les rares paroles qui ont été répertoriées, ne parle jamais du Sublime mais nécessairement du Beau et de la Beauté. Pourtant, l’aspect mystique et transfiguratif de son œuvre semblent bien définir l’ensemble du concept comme tenant du Sublime.
Le propos que la philosophe croyante Simone Weil tient à propos de l’œuvre de Gaudí peut nous permettre d’installer réellement la basilique de la Sagrada Família dans l’idée du Sublime.
36« Essai sur les maladies de la tête : Observations sur le sentiment du beau et du sublime », Emmanuel KANT. 1993
« L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie. »37 Bien que la philosophe nous parle du Beau, on retranscrit dans ses propos comme un état qui la surpasse, qu’elle ne peut expliquer et qui comme elle le dit, « s’impose ». Ce que tente de nous décrire Simone Weil paraît sensiblement correspondre à la définition que Kant nous donne du Sublime.
L’architecture de la Sagrada Família construite sur la base de cette esthétique profondément ancrée dans la religion peut alors poser question. A partir de ce que nous avons étudié quant à la souffrance nécessaire à la création, ou bien la Vérité divine (déterminante elle aussi de la création), on pourrait se demander si finalement l’architecture en ellemême occupe une place importante dans le projet. En effet, toutes les questions d’ordre conceptuel semblent jusqu’à maintenant dictées par des croyances et des idées d’ordre religieux, mystique. Aussi, c’est peut-être en cela que l’architecture de la Sagrada Família occupe une place particulière dans le patrimoine architectural religieux du monde.
Les notions de Nécessité, de Beauté (Sublime ?) et de Vérité sont ainsi liées de manière intrinsèque. Autrement dit, aucune ne semble pouvoir exister sans l’autre dans la pensée de Gaudí. Pour atteindre la Beauté, il convient de revenir à l’état ascétique, de nécessité. C’est en se rapprochant de cette manière de Dieu qu’il pourra atteindre la Vérité. En représentant cette Vérité qui est la vérité dite absolue, il accède donc à la Beauté.
Seulement, comment représenter la vérité dans le fini de la matière lorsque la vérité absolue relève du principe, d’une idée qui ne possède pas de représentation tangible et rationnelle? De manière plus familière, à quoi ressemble la Vérité divine ?
37« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ». 2002, Citation de la philosophe Simone Weil, p.63.
- NATURE -
Comme nous avons pu le constater depuis le début du développement, la religion et la spiritualité de Gaudí occupent une grande place dans sa construction d’architecte mais également d’homme. Cette spiritualité devient centrale dans ses projets d’architecture. Ce sont justement ses projets qui semblent d’ailleurs être sa démonstration de la Vérité Absolue.
« Le grand livre, toujours ouvert et qu’il faut s’efforcer de lire, est celui de la Nature, les autres livres dérivent de lui et contiennent les erreurs et interprétations humaines. Il y a deux révélations : l’une doctrinaire, celle de la Morale et de la Religion, l’autre guidée par les faits, celle du grand livre de la Nature. »38
Cette citation d’Antoni Gaudí mettrait en lien cette idée de Vérité à travers la parole de Dieu et la conception architecturale. En effet, bien que l’idée soit très subjective, on peut discerner le fait que selon Gaudí, la Nature et l’inspiration de la nature permettraient d’atteindre cette vérité en tant que la Nature est le fruit de la production de Dieu. La Sagrada Família ainsi que tous ses autres projets reprendraient les formes et propriétés que l’on trouve dans la nature pour représenter la Vérité et par conséquent, atteindre la Beauté.
De cette même manière, le philosophe René Descartes énonce cette idée 39 : « Deus sive Natura »40 signifiant « Dieu ou la Nature ». Il établit de manière précise le lien ou la similitude entre ces deux termes de sorte que Nature veut dire Dieu et que Dieu veut dire Nature. C’est cette conception matérialiste que le philosophe peut faire de Dieu qui nous renvoie directement à la conception esthétique de Gaudí.
38« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Grand Livre de la Nature I, p.74.
39« Méditation Sixième : De l’existence des choses matérielles, et de la distinction réelle entre l’âme et le corps de l’homme », René DESCARTES, Texte établi par Victor COUSIN. 1824, Tome I, p. 335-336.
40« Deus sive Natura » est une expression créée par Descartes. Vient du latin et signifie littéralement Dieu ou la Nature.
En effet, avec la théorie qu’il développe sur la Création, il donne la possibilité de définir Dieu à la fois comme un Dieu transcendant (ce qui nous concerne dans une certaine mesure dans le cadre de notre étude), mais également comme un Dieu en pensée (substance pensante) et enfin comme un Dieu en matière (substance corporelle). Ici par l’utilisation du nom « substance », il est entendu l’ensemble des choses que Dieu a créé et auxquelles il apporte son concours afin qu’elles continuent à subsister.
La pensée de Descartes renforce cette idée que Nature et Dieu ont un seul et même sens. Alors, si l’on suit la pensée de Gaudí, représenter la Nature permet de représenter la Vérité qui donne lieu d’atteindre la Beauté. En d’autres termes, la Nature équivaut à la Beauté comme Dieu équivaut lui-même à la Beauté. La pensée de Gaudí semble donc déterminée par sa foi une fois de plus dans la mesure où sa principale inspiration en ce qui concerne la formulation de son architecture résiderait dans la restitution de la Nature de Dieu.
« Dans le monde, rien n’a jamais été inventé. La valeur d’une invention consiste à révéler ce que Dieu a mis sous les yeux de toute l’humanité. » (...) « Tout est issu du grand livre de la Nature, les œuvres des hommes sont un livre déjà imprimé. »41
Appréhender la nature en tant que ligne conductrice de la pensée esthétique de Gaudí consent ainsi à lier tout ce qui est, si l’on reprend le discours de René Descartes, en substance pensante à ce qui est en substance corporelle. En utilisant la Nature comme base de son architecture, Gaudí donne une réelle dimension théologique à son œuvre dans le sens où il se servirait de l’architecture comme d’un médium pour révéler la vérité, représenter Dieu.
41« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Inventions II, p.149.
Seulement lorsqu’il en parle, il en ressort une forte impression d’évidence. Comme si finalement, sa méthode et sa pensée architecturale étaient manifestes, indiscutables. De manière plus précise, c’est en définitif comme s’il n’était pas responsable de la finalité formelle de ses projets dans la mesure où il n’a fait que prendre exemple et que par définition, cela suffisait. ( car à travers cette représentation de la nature il parvient à représenter l’idée de Vérité ). Cette hypothèse pourrait éventuellement participer à l’idée de l’architecture transcendante, mystique. (Dans l’idée d’une chose qui surpasse l’entendement, la rationalité).
Cette idée de Nature comme Dieu et inversement, ne se retrouve pas seulement dans les textes littéraires de philosophie mais également dans les textes bibliques, ce qui accroît cette idée que l’architecture de Gaudí, plus précisément celle de la Sagrada Família, est porteuse d’une dimension théologique conséquente.
Dans la Genèse, premier livre de la Bible, on peut lire ces mots : « Dans un commencement, Élohim créa les cieux et la terre. »42 Même si le terme « nature » n’est pas écrit de manière factuelle, on peut dire que le terme de « terre » englobe la notion de nature que nous évoquons. La Nature en tant que nous la percevons s’impose comme le résultat d’un Dieu créateur. Cette mention de l’idée de Nature que nous retrouvons ainsi dans les textes bibliques semble souligner cette pensée que l’architecture de Gaudí est basée sur des formes naturelles qui font lien très directement avec la religion et Dieu.
De ce fait, il apparaît évident que c’est pour cette raison que l’on ne peut classer Antoni Gaudí dans le mouvement artistique de l’Art Nouveau. ( avec le prétexte qu’il produit une architecture naturaliste ). En effet, cette représentation de la nature dont il fait état dans son architecture est, dans son cas, une totale quête de représentation de la perfection à travers la création de Dieu selon sa foi et ses croyances.
42« Bible », Moïse. -400 av.J.-C. Genèse, Chapitre I, verset 1
Gaudí dit : « Dieu n’a fait aucune loi inutile, c’est-à-dire que toute ont leur raison d’être : l’observation de ces lois et de leurs applications révèle concrètement la Divinité. Les inventions sont des imitations imparfaites de ces applications. (..) C’est pourquoi une invention qui n’est pas en harmonie avec les lois naturelles n’est pas viable. »43
Cette croyance pour Dieu qui le guide et dont il fait part une fois de plus ici illustre les propos précédents. Encore plus, on prend réellement conscience ici du rôle de Dieu dans l’architecture de Gaudí. Non seulement c’est un guide spirituel mais également un maître qui a déjà tout inventé et qu’il suffit de suivre afin de concevoir de manière « viable ». C’est intéressant de voir que pour l'architecte, sa culture et sa pratique religieuse ont un rôle davantage voire plus important dans la conception que sa culture et son enseignement universitaire.
Nous pouvons nous demander pour quelles raisons la mise en avant de ces trois notions est importante dans la théologie de la Sagrada Família. La Nécessité, la Beauté et la Vérité sont ici des termes qui reviennent fréquemment dans les propos qu’a tenu Antoni Gaudí. C’est ce qui constitue son esthétique et par conséquent ce qui constitue également la base de la conception de la Sagrada Família. Soit, une base fondée sur des principes spirituels. Sa spiritualité et ses compétences théologiques sont, semble-t-il, ce qui va déterminer la forme du projet architectural du Temple plus que les nombreux textes et revues d’architecture de l’époque.
La Sagrada Família ne serait donc pas un édifice religieux comme on en trouve d’autres à Barcelone mais une représentation matérielle de la vérité, une représentation de la nature divine et une présentation de la Beauté en accord avec la force de sa foi chrétienne.
Qualifier la Sagrada Família sous cet angle de vue ferait d’elle une architecture mystique et transcendante. Autrement dit, une architecture anagogique44. Expliquer son architecture, c’est comprendre son expérience avec la religion mystique.
43« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Inventions I, p.149.
44Par anagogique, on admet plus précisément « l’élévation de l’âme vers les choses célestes ». Définition de anagogique proposée par le CNRTL.
LA SAGRADA FAMÍLIA : ARCHITECTURE DE LA FOI RELIGIEUSE
THÉOLOGIE DE LA SAGRADA FAMÍLIA : EXPÉRIENCE MYSTIQUE DE LA FOI
Si l’on se rapporte au « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne » et plus précisément au chapitre Mystère et Mystique, on peut esquisser dès lors une première définition du mystère : « Pour les pères de l’Eglise, mystique est encore un adjectif. Mais il qualifie tout ce qui se rapporte au Mystère, c’est-à-dire au dessein de Dieu d’unir à lui tous les hommes par la médiation de son Fils, envoyé au milieu des hommes. Toute existence chrétienne prend dès lors valeur mystique, dans la mesure où le chrétien est initié à ce Mystère par l’intelligence des Ecritures, et en vit par la prière, la liturgie et les sacrements. »45
Le mystère, ou bien plus exactement la qualité mystique de la pratique religieuse, réside dans cette substance invisible qui vise l’union de l’homme à la divinité qui est Dieu. C’est la foi de l’homme qui parait être la composante principale de cette notion de mystique, dans le sens où elle permet à l’homme de rendre visible ce qui pourtant ne l’est pas d’un point de vue rationnel. Saint Paul, toujours dans son discours sur le mystère, évoque le terme mustérion qui vient du grec ancien - μυστήριον et qui signifie rite, secret ou bien encore initiation. Le mustérion est justement cette intention divine médiée par le Christ dans le but de créer la symbiose entre Dieu et les hommes. « Accomplissement dans le Christ d’un dessein de Dieu d’abord caché, ensuite manifesté aux hommes. »46 Cette définition que propose Saint Paul met en lumière deux termes qui semblent intéressant dans le cadre de notre étude. Il s’agit nécessairement de « caché » puis « manifesté ». En effet, cela nous ramène une fois de plus au lexique de la vision, mais également à celui de la quête. Cependant, cette vision dont nous parlons n’est que subjective car il s’agit de quelque chose en soi et non de quelque chose de tangible. On pourrait parler de vision aveugle dans le sens où l’homme prend pleine conscience de quelque chose d’invisible, de mystique
45« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». Fasc. LXXII-LXXIII, Avant-Propos, p.4.
46« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1861, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.4.
C’est cette irrationalité et cette capacité du dépassement de l’entendement qui semble définir ce qu’est le mystère. C'est nécessairement pour cette raison que l’ascétisme s’avère propice à la pratique mystique de la religion. L’homme, en délaissant son être physique au profit de son soi intérieur, fabrique et nourrit par la dévotion à Dieu cet accès à la visibilité de l’invisible. C’est de cette manière que Saint Paul écrit à propos du mystère : « D’une autre manière (premier allôs), le message est appelé mystère parce que nous croyons ce que nous ne voyons pas : nous voyons certaines choses, et nous en croyons d’autres. »47
Plusieurs ouvrages de théologie chrétienne dont notamment « Traité de la vie intérieure, Petite somme de théologie ascétique et mystique d’après L’esprit et les principes de saint Thomas d’Aquin »48 ou encore « Précis de théologie ascétique et mystique »49 distinguent les notions d’ascétisme et de mysticisme. Selon les auteurs, l’ascétisme se différencie du mysticisme car il n’est pas le résultat d’une contemplation infuse mais d’une volonté contemplative. Exprimé d’une autre manière, la pratique de l’ascétisme ne serait pas une manière de définir la pratique mystique mais plutôt un chemin vers celle-ci, tout simplement parce que le mysticisme se définit comme un état qui s’impose à travers la foi. Le jésuite Jean-Baptiste Scaramelli détermine justement l’ascétisme comme « les voies ordinaires»50 ce qui assurément induit le fait que le mysticisme serait selon lui « les voies extraordinaires»51 .
47« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1863 - 1864, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.9.
48« Traité de la vie intérieure, Petite somme de théologie ascétique et mystique d’après L’esprit et les principes de saint Thomas d’Aquin », Andrée-Marie MEYNARD. 1885 (publication originale), Tome I
49« Précis de théologie ascétique et mystique », Adolphe TANQUEREY. 1923. (publication originale)
50« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1934, Fasc. LXXII-LXXIII, PHÉNOMÈNE MYSTIQUE, DISTINCTION ASCÉTIQUE-MYSTIQUE, p.154.
51 IBIS.
Il exprime par le biais de ses deux ouvrages « Direttorio ascético » et « Direttorio mistico »52 : « On peut parvenir à la perfection sans l’intermédiaire de la contemplation infuse. Certains, la majorité, y arrivent par le chemin pur et simple de l’exercice des vertus. Il ne s’agit pas de deux itinéraires contraires, ni même toujours parallèles, car le second suppose le premier, quoique celui-ci puisse exister sans l’autre. »53
C’est effectivement cette « voie ordinaire » que semble avoir emprunté Gaudí. Plus encore, c’est cette pensée qui, nous l’avons vu, formerait les bases de la conception de la Sagrada Família. Saint Paul, en parlant de la manifestation de Dieu par la mystique écrit : « Le lieu où s’accomplit le mystère est le Christ Jésus (...) En définitive, le sens le plus profond du mystère est le Christ s’agrégeant l’Eglise comme son Corps, sa Plénitude ou son Achèvement. »54 Si l’on tente d’adapter l’objet d’étude à ce discours, nous pourrions affirmer que la Sagrada Família est justement le corps du Christ que Gaudí tente de représenter de manière architecturale. En d’autres termes, représenter l’absence par la présence. Si l’on suit cette thèse, la Sagrada Família est ainsi le lieu où se produit le mystère et donc Gaudí, l’architecte de l’absence. Par l’expression « architecte de l’absence », on entend ici que Gaudí ne traite pas uniquement le plein de l’architecture mais également le vide afin qu’il devienne aussi visible et lucide qu’un plein. De ce fait, on atteint l’unité et l’harmonie, caractéristiques de la notion du mystère.
« Le trait le plus caractéristique du mystère, c’est qu’il est annoncé partout, et reste cependant inconnu de ceux qui n’ont pas une pensée droite : car ce n’est pas en vertu de la sagesse qu’il est dévoilé, mais de par l’Esprit, dans la mesure où nous pouvons le recevoir. »55
52« Direttorio ascético » se traduit en italien par Annuaire ascétique. « Direttorio mistico » se traduit également en italien par Annuaire mystique.
53 IBID.
54« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1861-1862, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.5.
55« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1863-1864, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE DANS LA TRADITION PATRISTIQUE, Citation de Jean CHRYSOSTOME, p.11. IBID, p.11
Cette vision du mystère que nous donne Chrysostome par la parole de Saint-Paul est également porteuse de sens dans le cadre du projet de Gaudí. Plus précisément, si nous ne nous attachons pas à observer plus loin que ce que nous voyons, dans ce cas le Temple de Gaudí ne reste qu’un des nombreux édifices religieux que l’on peut trouver à Barcelone. La valeur mystique de l’architecture de Gaudí ne semble pouvoir être perçue seulement si l’on rentre dans cette idée de contemplation.
Ce qui paraît important de préciser, c’est que dans le cadre de l’architecture, la qualité mystique d’un bâtiment ne peut pas être perçue par tout type de public. Il faut savoir prendre conscience à la fois de la matière visible mais également prendre conscience de la matière invisible que la visible produit. Si l’on se réfère au projet de la Sagrada Família, nous avons constaté que la centralité de la pensée architecturale de Gaudí réside dans la foi qu’il entretient. Il détermine ainsi la forme architecturale en vue de représenter la perfection, qui résulte bien évidemment de la création divine. De cette manière, en constituant le corps du Christ (si l’on reprend les termes de Saint Paul) par la pierre, il manifeste dans les vides cette « mystique » qui finalement vient englober le projet. La Sagrada Família devient nécessairement un tout.
« Gaudí, profondément religieux, qui voit dans le Temple la construction par excellenceparce que, dédiée à la divinité, elle est spirituellement supérieure aux autres. »56
La particularité que l’on relève dans l’objet d’étude c’est que cette notion de mystique dont nous avons tenté de mieux comprendre le sens ne s’applique pas uniquement à l’homme qu’est Gaudí mais également à son architecture. Autrement dit, ce serait le dessein de l’architecture du Temple de réunir, que dit-on, d’unir Dieu au peuple. C’est en cela que la Sagrada Família lui apparaît comme l’architecture dans sa qualité supérieure, dans sa perfection ultime.
56« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.9.
En somme, l’architecture de Gaudí, par sa compréhension du vide et sa volonté de matérialiser la connaissance absolue, s’inscrit dans un registre que l’on pourrait qualifier de mystique. Plus exactement, Gaudí utilise l’architecture et les qualités de celles-ci afin de représenter Dieu et donc dans une certaine mesure, de représenter la réalité ultime. Dans ce cas présent, nous pourrions nous interroger sur la valeur de l’architecture en tant qu’elle participe à atteindre un état sublime de conscience. C’est pour cette raison que l’on peut émettre des difficultés à définir de manière précise ce que représente l’architecture de la Sagrada Família.
Antoni Gaudí nous propose une expérience de l’au-delà et met en évidence ce que l’on ne perçoit pas. C’est en cela que l’on peut nécessairement se trouver avec une idée confuse du Temple. En effet, comment concevoir l’idée que Gaudí met à disposition du peuple chrétien la doctrine du Salut à travers l’usage de la pierre ?
« Réaliser quelque chose consiste à mettre sa propre loi en accord avec la loi de la Création (autrement elle ne tiendrait pas, elle n’aurait pas de consistance). Pour y parvenir, l’expérience est indispensable. »57
Cette pensée de Gaudí nous donne la possibilité d’amorcer la question de l’expérimentation.
Ce qui relève d’intérêt dans le projet du Temple, c’est que l’architecte comme les visiteurs sont soumis à l’expérience. Bien évidemment, il ne s’agit pas de la même et pourtant, elle permet dans les deux cas d’atteindre un état contemplatif. On pourrait ainsi considérer
Antoni Gaudí comme un médiateur entre la parole de Dieu et le peuple où, par le biais de son architecture, il manifeste l’unité. ( et donc, semble réduire le vide qui sépare le chrétien de son Dieu. )
57« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Architecture I, p.84.
Considérer l’œuvre de Gaudí c’est également prendre en compte ce que l’architecture de celui-ci peut produire. « Les spécialistes et les amateurs de l’œuvre de Gaudí mettent souvent l’accent sur l’aspect douleur ou sur l’aspect joie que suscite la contemplation de ses créations mais pour un chrétien ces deux sentiments ne sont que les deux faces d’un seul phénomène : la transsubstantiation. »58
La pensée esthétique (ou compétence théologique) de Gaudí, alimentée par sa foi, permet à son architecture d’être expressive, comme un miroir de sa spiritualité et de son parcours religieux. En tant qu’elle est le reflet de l’architecte, la Sagrada Família s’anime. On pourrait même évoquer la notion d’architecture animique. C’est ce que l’auteur Carles Andreu souligne lorsqu’il parle de joie mais également de souffrance en faisant référence à la contemplation du Temple. Il fait également mention du phénomène de transsubstantiation. Selon l’Eglise catholique, la transsubstantiation est nécessairement la transformation d’une substance en une autre. Plus précisément, il s’agit d’une doctrine selon laquelle au moment de la consécration, le vin et le pain deviennent le sang et le corps du Christ. Rappelons également l’objet de l’eucharistie. Il s’agit sensiblement d’un évènement pendant la messe qui consiste à rendre mémoire au Christ en le rendant présent par le biais de la transformation du vin et du pain. La nature devient ainsi Jésus Christ par l’Esprit sain. En mentionnant le terme de transsubstantiation, l’écrivain compare ainsi le vin et le pain à la Sagrada Família. De cette manière, il met ainsi en évidence l’idée que par le biais de la pensée religieuse qui nourrit la basilique, la structure du Temple devient la présence réelle de Jésus Christ. Ce phénomène surnaturel que semble décrire Carles Andreu nous renvoie par la même occasion à la notion du mysticisme.
« Le mystère paulinien implique donc une mystique : il produit en effet dans le croyant une lumière et une force qui l’investissent, l’enveloppent et le débordent, mais aussi l’introduisent dans un mouvement de reconnaissance et d’amour effectif à l’exemple du Christ et en communion avec lui. »59
58« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.36-37.
59« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1862, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.6.
La pensée paulinienne ci-dessus semble très justement correspondre au type d’expérience que peut produire l’architecture de Gaudí. Cela voudrait signifier que l’architecte catalan fait d’une expérience architecturale une expérience mystique. On pourrait émettre l’hypothèse qu’il ne conçoit pas la Sagrada Família pour mettre en place une architecture mystique mais plutôt que c’est l’architecture d’ordre mystique de la Sagrada Família qui ne peut que produire pour le visiteur une expérience de l’ordre de l’absolu.
« L’âme est alors dans un tel étonnement qu’elle semble être hors d’elle. La volonté se fait aimante, j’en perds presque la mémoire, la raison ne réfléchit pas, à ce qu’il me semble, mais ne se perd pas non plus, elle est, comme je l’ai dit, rendue inactive et comme saisie d’étonnement devant tout ce qu’elle aperçoit ici. Car Dieu lui fait connaître qu’elle ne comprend pas ce que Sa Majesté lui présente. »60
La caractéristique qui ressort de cette restitution d’expérience est inéluctablement cet aspect d’irrationnalité rationnelle. Ce serait presque impossible à expliquer dans la mesure où ce que l’on tente de décrire n’existe qu’en absence présente. Cette irrationnalité rationnelle reflète simplement le résultat de l’art et de la technique dans sa perfection absolue. C’est-à dire que l’unité qui se fait entre les deux participes de l’architecture est dans un tel état de vérité et de beauté que l’on ne peut distinguer l’un de l’autre. Dans ce sens, l’architecture paraît nécessairement rationnelle car elle répond aux caractéristiques architecturales classiques mais irrationnelle également car conçue dans la volonté d’être un modèle de perfection. Ce sont ainsi deux sentiments contradictoires qui se mélangent lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la basilique mais qui pourtant se distinguent nécessairement l’un de l’autre.
60« Revue des Sciences Religieuses - La mystique comme théologie », Alois M. HAAS. 1998, p.261-288.
« Par moments je perdais la conscience d’être moi. Je sentais des larmes couler et seulement là je me rendais compte que c’était les miennes. Je crois que j’étais tiraillée entre l’envie de m’allonger en plein milieu pour mieux voir au-dessus de moi et celle de sauter d’un coin à l’autre pour pouvoir tout voir, tout toucher, tout comprendre. »61
Le discours que tient ce visiteur de la Sagrada Família illustre cette notion de contemplation et met également en avant une nouvelle idée : celle de la déambulation verticale et horizontale. Ce qui est également exposé grâce à cette reconstitution, c’est la notion de mouvement. En effet, on parle de déambulation mobile lorsque celle-ci s’opère par le corps (Horizontalité), et il semble que l’on exprime une déambulation immobile lorsque celle-ci s’opère par la conscience et l’Esprit. (Verticalité). Par le biais de l’architecture, le sujet s’est comme dissolu en deux entités, l’âme s’est extraite de l’enveloppe physique. Cette perte de conscience dont elle parle n’est, semble-t-il, pas le fait d’une expérience uniquement architecturale mais également mystique.
En somme, l’architecture d’Antoni Gaudí produirait une expérience plus spirituelle et mystique qu’architecturale dans la mesure où l’architecture mute en quelque chose de supérieur. La qualité théologique de l’architecture ne peut plus être dissociée de sorte que le visiteur ne puisse pas percevoir autre chose que la présence de Dieu à travers l’architecture de Gaudí.
La visée architecturale de Gaudí serait de parvenir à un état de transcendance par la contemplation architecturale. C’est l’intuition que nous tentons finalement de vérifier. Cette volonté, ce dessein de traiter l’architecture comme d’un objet mystique et fortement spirituel serait cette manière d’atteindre l’état de transcendance. De ce fait, en réalisant tous ces choix architecturaux relatifs à cette envie de représenter Dieu (par la nature), il se conçoit de manière intrinsèque une architecture absolue et supérieure en tant qu’elle représente la divinité.
61« Expérience personnelle - Sagrada Familia », Article de Milena.P. 2014, l. 16-18.
Le terme transcendant vient du latin -transcendens et exprime cette qualité propre de dépasser le naturel ou l’ordinaire62. Lorsqu’un individu emploie ou évoque la transcendance, il se réfère à une idée de la supériorité, à une certaine altérité. De cette manière, la transcendance suppose que l’on évoque l’intervention d’un « principe extérieur et supérieur ». Autrement dit dans ce contexte, nous parlerions de Dieu. Seulement, étant donné que nous faisons référence ici à la transcendance par l’architecture, il semble plus juste de parler de transcendance de l’esprit par la matière.
1 / “Qu’est-ce que la matière ?
2 / Durera-t-elle toujours ?”
3 / Le Maître répondit :
4 / ”Tout ce qui est né, tout ce qui est créé,
5 / tous les éléments de la nature
6 / sont imbriqués et unis entre eux.
7 / Tout ce qui est composé sera décomposé ;
8 / tout reviendra à ses racines ;
9 / la matière retournera aux origines de la matière.63
Ces vers sont extraits du discours gnostique de l’Evangile de Marie Madelaine. L’adjectif gnostique vient du nom - gnose et se distingue comme le principe philosophique selon lequel il serait possible de connaître les choses divines. Ce passage de l’évangile permet d’établir une distinction entre la matière et l’esprit (ici définit comme l’origine de la matière).
Ce que tente de soutenir Marie Madelaine, c’est que la matière est le fruit de l’esprit, le fruit de la volonté divine et créatrice. Le rapport que l’on fait ici entre l’Esprit et la Matière est alors un rapport de causalité par lequel l’un ne peut exister sans l’autre.
Si l’on met en lien les propos de Marie-Madelaine avec ce qui constitue la transcendance, nous pourrions faire écho à certains aspects de la pensée esthétique et théologique de l’architecte catalan. Antoni Gaudí conçoit la matière à travers son esprit fortement influencé par sa foi chrétienne.
62 Définition de transcendant proposée par le CNRTL.
63 Évangile de Marie Madelaine », évangile apocryphe selon Marie. Traduction française du XIXe siècle, p.7.
En conséquence, son œuvre architecturale ne peut être que la représentation matérielle de son esprit. En ce sens, on retrouve ce principe de causalité selon lequel l’esprit précède forcément de la matière. Seulement, le rapport transcendant que l’on trouve à la Sagrada Família ne s’apprécie pas dans la conception et dans la construction du Temple mais sensiblement par la manière dont on appréhende le projet. Plus clairement, ce qui constituerait le caractère transcendant de la Sagrada Família, c’est cette capacité, par l’état contemplatif, d’atteindre l’Esprit par la matière. En d’autres termes, de représenter l’Esprit. C’est pour cela d’ailleurs que Gaudí parle d’unité et d’harmonie. L’Esprit et la matière ne font plus qu’un.
La contemplation que nous avons associé à l’action transcendante se décompose en trois modes. Cette distinction entre plusieurs seuils de contemplation permet d’identifier là où se situe l’œuvre de Gaudí. Nécessairement, ce serait l’excessus mentis qui conviendrait le mieux à décrire la volonté de l’architecte catalan. Le terme d’excessus mentis, ou d’alienatio mentis (excès de l’esprit ou aliénation de l’esprit) peut se décrire par le théologien Richard de Saint-Victor comme le « Dépassement de soi-même, hors des conditions d’exercice des facultés humaines. Le sens, la mémoire et la raison y défaillent. »64 Ce qui est propre à l’excessus mentis, c’est cette impression de se détacher de son corps et de s’élever vers Dieu. Cet effet sur le corps et l’esprit serait expliqué par le théologien comme une conséquence de l’excès. Comme il le dit : « excès de désir ou dévotion, l’excès d’admiration, l’excès de joie ou d’exultation. »65
« Jusqu’alors la lumière divine était perçue comme une réalité inaccessible. Le rapt va permettre à l’âme humaine de pénétrer en Dieu, ou plus exactement d’être pénétrée par lui. Les signes distinctifs de cet état déjà mentionnés en d’autres ouvrages, sont : l’oubli des réalités terrestres et de soi-même, la mise en veilleuse de toutes les puissances, l’’apaisement des désirs d’ici-bas, un silence comparable à celui dont parle l’Apocalypse. C’est l’alienatio mentis, appelée encore excessus mentis. »66
64« Les quatre degrés de la violente charité », Richard DE SAINT-VICTOR. 2002, Analyse Doctrinale, p.113.
65IBID
66IBID
L’état que décrit ici Richard de Saint-Victor précise cet extase produit par la pratique mystique de la religion chrétienne. Si l’on considère l’excessus mentis comme qualité transcendante de la Sagrada Família, alors Antoni Gaudí serait l’architecte de la révélation. La révélation est un terme considérable dans la religion car il exprime la manifestation de Dieu67. Plus précisément la rencontre entre l’homme et Dieu. Si l’on se rapporte aux volontés de Gaudí quant-à la conception de la Sagrada Família, celui-ci est bien celui qui révèle, ou du moins qui dévoile. Le terme de dévoilement serait d’ailleurs certainement plus approprié dans la mesure où Gaudí fait une mise en évidence à travers l’architecture et non une révélation. Chacun est libre d’y voir, ou non, le caractère transcendant du Temple.
Cette manière d’appréhender la Sagrada Família permet de poser la question de la puissance de l’architecture. Plus précisément, on parle de pouvoir. Au sein du projet du Temple, l’architecture a le rôle important de représenter l’absolu, le suprême. Cela signifie qu’au delà d’être dédiée à Dieu, Antoni Gaudí veut que la Sagrada Família représente Dieu au plus proche. Cette manière et intention de vouloir représenter ce qui est de l’ordre du divin dans la pierre rend l’architecture supérieure. On pourrait même dire qu’elle atteint l’omnipotence68. Il semble alors qu’on ne parle pas exactement d’architecture quand on parle de la Sagrada Família tout simplement parce que ce que produit la basilique est nécessairement supérieur.
Antoni Gaudí admet qu’un architecte n’est pas un frère mais un moine en tant qu’il doit être l’un des garants du message de Dieu. C’est pour cela que l’on ne peut pas parler uniquement d’architecture dans cet objet d’étude.
67Le fait de la révélation dans la « Bible » est exprimé par l’emploi du verbre -galah (grec). La révélation suppose d’après les textes bibliques un processus psychologique chez l’homme qui en est le témoin ou bien le messager. Il s’agit plus précisement d’un rêve ou d’une vision dans la plupart des cas de révélation.
68Omnipotence, autrement dit Toute-puissance. Définition proposée par le CNRTL
Cette comparaison et cette allusion que Gaudí fait au moine nous permet de comprendre que le Temple est également percevable comme une messe faite de pierre, un discours religieux et spirituel que l’architecte catalan matérialise à sa manière. L’architecture devient ici son moyen d’inscrire dans le temps sa pensée et sa dévotion religieuse comme un écrivain le ferait de sa plume.
L’écrivain Patrick Sbalchiero exprime dans son ouvrage l’idée que « Son art ne se comprend qu’au regard de la foi (...) lui qui a conçu la Sagrada Família comme une forêt de symboles pour élever l’âme vers Dieu. »69 Cette conception de l’œuvre de Gaudí fait écho à notre discours. On ne peut comprendre la grandeur de la Sagrada Família si l’on ne saisit pas l’ampleur de la foi de Gaudí. En effet, à travers l’appréciation de sa spiritualité, tous ses choix architecturaux se justifient et prennent sens dans l’espace. Chaque élément possède une justesse de situation qui sert la religion et qui amène à la contemplation. En d’autres termes, sans la foi son projet n’existe pas et ne pourrait permettre d’accéder à cet état transcendant. Antoni Gaudí n’est pas un architecte, c’est un chrétien qui use de ses capacités et de ses talents artistiques afin de retrouver l’unité entre l’homme et Dieu. L’architecture ne devient que le prétexte de ces retrouvailles. Seulement, comment Gaudí retranscrit-il cette compétence théologique et mystique dans son architecture? Par quels éléments architecturaux la qualité transcendante de la Sagrada Família se mesure-t-elle ?
69« Antoni Gaudí, l’Architecte de Dieu », Patrick SBALCHIERO. 2022, p.208.
CONCEPTION ASCENSIONNELLE ET LÉVITATIONNELLE DU « TEMPLE EXPIATOIRE »
- LE GOTHIQUE -
Le Gothique est un style architectural qui se développe en France dans la seconde partie du Moyen-Âge, plus précisément au XIIe siècle. Seulement, dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons de manière plus ciblée au gothique dit « rayonnant » (XIIe - XIIIe siècle), ainsi qu’au gothique dit « flamboyant » (XVe - XVIe siècle). Le gothique rayonnant pourrait se caractériser par l’usage de rosaces et de vitraux notamment pour les cathédrales, tandis que le gothique flamboyant se caractérise plutôt par la mise en avant de l’ornementation et du décor à outrance. La connaissance et la prise en compte du gothique relève d’un intérêt majeur dans cette étude car cela va nous permettre d’analyser la Sagrada Família dans son aspect formel. Lorsque la première pierre de la basilique est posée en 1882, l’architecte de l’époque Francesco de Paula del Villar y Lozano70, imagine un projet de temple néo-gothique, basé sur le modèle de la basilique italienne de Lorette.
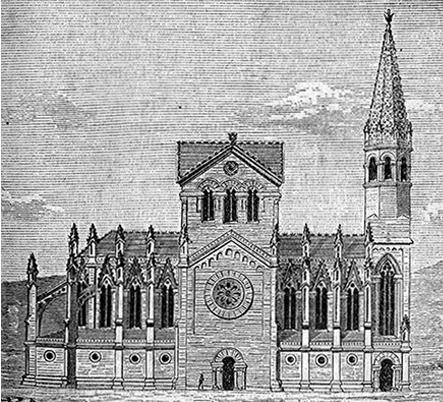
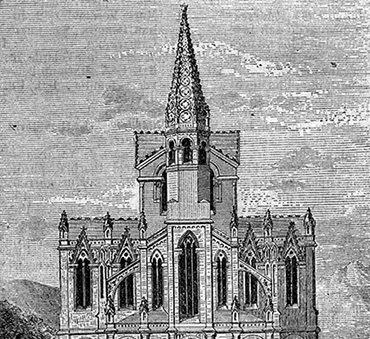
FIG.10 : CROQUIS FACADE PRINCIPALE D’ORIGINE SAGRADA FAMÍLIA. DE PAULE DEL VILAR Y LOZANO, Francesco. 1877
FIG.11 : CROQUIS FACADE D’ORIGINE SAGRADA FAMÍLIA. DE PAULE DEL VILAR Y LOZANO, Francesco. 1877
70Francisco DE PAULA DEL VILLAR Y LOZANO ( 1826-1901 ) est un architecte espagnol. De 1874 jusqu’en 1892 il occupe plus précisement le statut d’architecte de diocèse. Ainsi, il participe à plusieurs projets de restauration et de conception d’édifices religieux dont celui de la Sagrada Família. C’est en 1877 que l’« Associació de Devots de Sant Josep » (Association des dévôts de Saint Joesph) le mandate pour le projet. Il dessine une basilique d’ordre néo-gothique dont seule la crypte sera construite étant donné qu’il se retire du projet en 1883.

Les façades projetées montrent sensiblement que l’apparence du temple à l’époque de l’architecte originel était semblable aux multiples cathédrales françaises que l’on peut trouver entre Chartres, Reims ou encore Orléans. ( avec un lexique architectural typique du néo-gothique que l’on ne rappelle pas ). Seulement, c’est cette architecture qui justement déplait à Antoni Gaudí, et qu’il tend non pas à remplacer ou faire oublier mais plutôt à réajuster, sublimer. C’est pour cette raison que le style gothique détient une place importante dans la conception de la Sagrada Família. En effet, le Temple Expiatoire serait justement une version sublimée du gothique d’après la vision artistique et religieuse de l’architecte Gaudí. Plus précisément, c’est en sublimant l’architecture gothique, qui selon lui est pleine d’erreurs, qu’il parviendrait à exprimer de manière transcendante sa foi dans la pierre et la structure de son temple.
Seulement, afin de vérifier ou bien contredire ces multiples hypothèses, il convient de se concentrer sur la notion d’originalité que Gaudí fait valoir dans son processus de conception du renouveau gothique. En effet, il dit : « L’originalité consiste à se rapprocher de l’origine, à la rejoindre. (...) Il n’y a pas à chercher à être original ; chacun se doit de chercher dans ce qui a été réalisé par le passé, s’il ne le fait pas, il n’arrivera nulle part et tombera dans toutes les erreurs qui ont été accumulées durant des siècles. »71
Il expose ici de manière concise que l’originalité est la parfaite maîtrise entre le passé et le présent. On ne peut créer sans prendre en compte ce qui a été créé. C’est de cette manière que son architecture se forme et qu’il perfectionne, à partir de sa réflexion, le style gothique. (par un retour à l’origine). Mais de quelle origine parle-t-on ? Bien qu’Eugène
Viollet-le-Duc ou encore Boileau soient des piliers de l’enseignement de Gaudí, celui-ci trouve sensiblement dans l’architecture byzantine et hellénique une « vérité » de la forme architecturale qui, à son sens, n’existe plus par la suite dans les différents styles, gothique compris. On retrouve par ailleurs ici cette notion de vérité, importante dans sa conception esthétique, et qui le guide ici encore dans sa recherche formelle pour la restructuration du gothique.
Dans le cadre de sa recherche esthétique et architecturale, il va établir différentes méthodes et produire différents essais en supprimant ou remplaçant certains éléments du gothique qui sont à l'égard de sa vision, en contradiction avec ses principes. En effet, le style gothique s’opposerait selon lui à la représentation de la nature, plus précisément des forces produites par la nature. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il dit : « L’art Gothique est imparfait, à demi résolu, c’est le style du compas, de la formule, de la répétition industrielle. Sa stabilité tient à l’appui permanent des contreforts, c’est un corps invalide qui s’appuie sur des béquilles. Il n’a pas d’unité : la structure ne se fond pas avec la décoration (...) cette décoration, complètement postiche, pourrait être supprimée sans que l’œuvre en pâtisse. »72
71« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Originalité V, p.81. 72« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Style Gothique III, p.89.
La rationalité, ou bien même l’idée de contre-nature semblent ressortir du désaccord que Gaudí voue à l’architecture gothique. En dessinant à l’aide de ses collaborateurs le Temple de la Sagrada Família, il va tenter de solutionner les problèmes qu’il trouve au gothique. En conséquence, le projet devient finalement la réponse à toutes les contraintes et les sujets qu’il a pu mettre en avant lors de ses critiques sur le style architecturale de la cathédrale. Aussi, on peut dire que le gothique ne fût pas un modèle sur lequel s’est appuyé Gaudí afin de concevoir la basilique mais plutôt un problème mathématique et esthétique pour lequel la Sagrada Família est une objection. Néanmoins, il reste intéressant de l’évoquer car c’est à ce moment précis que se concrétise sa pensée architecturale et également que toute sa compétence théologique vient se fondre à l’aspect concret, ancré et matériel de l’architecture.
Gaudí cherche pendant plusieurs années des solutions aux problèmes qu’il reproche au gothique flamboyant qu’il trouve surfait mais pour autant ne va pas appliquer directement les résultats de ses recherches sur le Temple de la Sagrada Família. C’est de cette manière que l’on peut saisir l’importance qu’il voue à ce projet. Il utilise d’autres réalisations et chantiers en cours afin de faire valoir et mettre en application les différentes solutions qu’il met au point. Notamment avec le projet de la Colonia Guëll73 et la crypte inachevée. Afin de perfectionner le style gothique, il inclut et met en œuvre dans ce projet à la fois le système de flexion et celui des lignes continues que l’on trouve dans la nature afin de créer des éléments de structure en adéquation avec les forces dites naturelles.
Le perfectionnement du gothique que vise Gaudí passe également par la confection de nombreuses maquettes à grande échelle qui permettent de réellement trouver la solution parfaite pour le projet de la Sagrada Família. David Puig Boada, assistant de l’architecte en chef actuel de la Sagrada Família a réalisé trois maquettes que l’on trouve dans la crypte du Temple et qui permettent de retracer l’évolution de sa recherche.
73La crypte de la Colonia Güell est un projet inachevé de Gaudí. La conception du lieu de culte débute en 1898 (soit vingt-et-un ans après la sollicitation de l’architecte Del Villar y Lozano pour la Sagrada Família). Elle est partiellement construite entre 1908 et 1914. Son caractère inachevé renforce cette idée de « projet expérimental » dans l’intérêt de celui du Temple.
On distingue à travers ces trois maquettes comment Gaudí se libère des problèmes de structure du style gothique pour se tourner vers une architecture plus naturaliste, avec des formes continues et gracieuses. Ce qui est intéressant ici c’est qu’il parte d’un plan de cathédrale gothique dite « classique » afin de faire évoluer l’architecture selon des principes extérieurs qu’il intègre lui-même. Cela signifie bien que malgré l’apparence de la Sagrada Família, celle-ci est nécessairement d’origine gothique, si l’on peut se permettre l’utilisation du terme d’« origine »
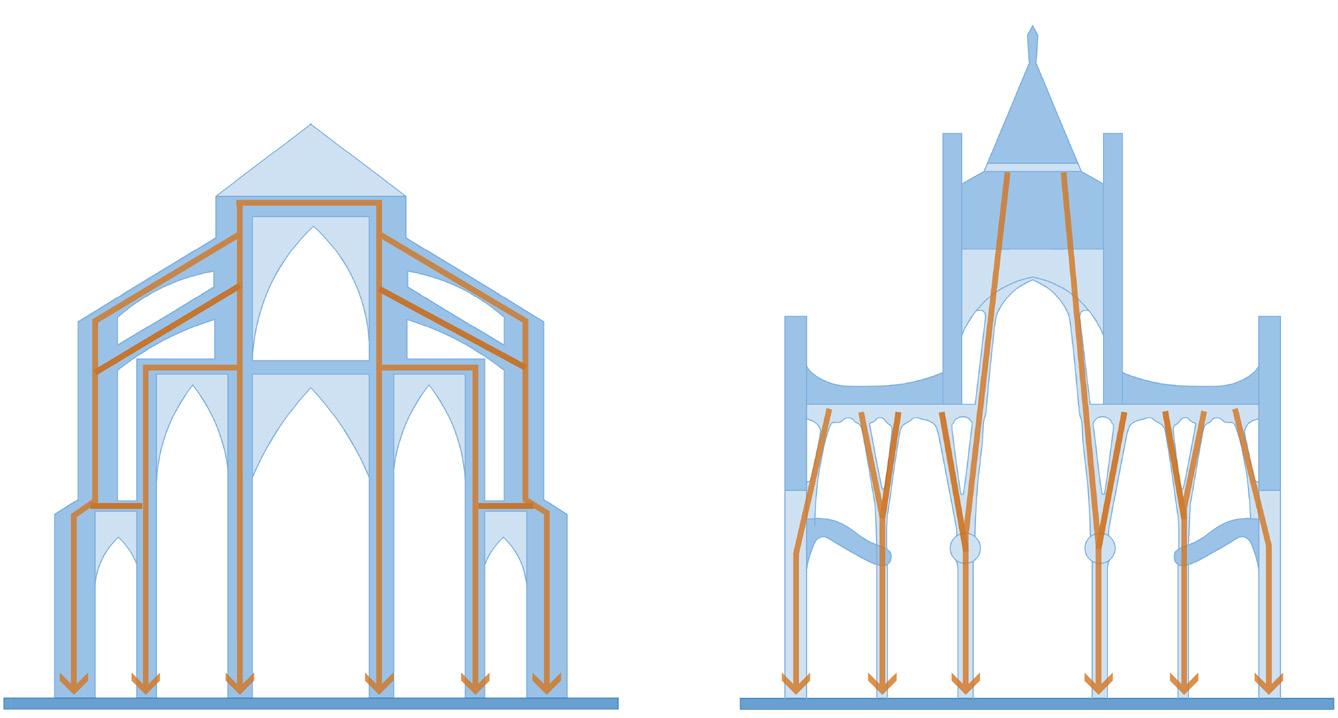
Voûtes, reprises de charges.
Structure extérieure, parois. Descente de charges
FIG.13 : COMPARAISON DES DESCENTES DE CHARGES : ARCHITECTURE GOTHIQUE ET GAUDIENNE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
D’autre part, il semble que ce que rejette Gaudí pourrait résider dans l’idéologie que peut retransmettre les différents défauts constitutifs de l’architecture gothique. Nous avons expliqué précédemment de quelle manière la théologie et la spiritualité étaient ancrées dans la pensée de l’architecte. Les défauts énoncés par Gaudí constitueraient toute l’incohérence symbolique et spirituelle entre le gothique et l’architecture religieuse. Gaudí définit le style gothique comme un « art industriel ». Or l’industrie est un terme qui pourrait être traduit par le regroupement de l’ensemble des travaux humains. Gaudí semblerait sous-entendre ici que l’art gothique est inapproprié car ce n’est pas le résultat de la pensée de l’homme à travers celle de Dieu mais uniquement la pensée de l’homme pour l’homme. De la sorte, le gothique comme il l’est à cette période ne peut pas être un modèle sur lequel s’appuyer intégralement.
Par l’usage de sa compétence théologique au profit du projet architectural, il parvient à réinstaller l’art gothique dans une pensée en adéquation avec la spiritualité où l’homme construit par la pensée de Dieu. D’ailleurs, l’écrivain Annie Andreu-Laroche écrit à ce sujet : « Parce que le fond doit être préféré à la forme, il invente des formes inouïes. »74
« L’art gothique est inséparable des voûtes et des arcs circulaires ; les formes qui, afin de suivre approximativement les funiculaires ne pouvaient être réalisées que d’une façon fragmentaire comme les arcs-boutants, étaient sorties du temple. (...) Les voûtes gothiques représentent une superficie fausse parce que ce sont deux cercles reliés par une droite ; si l’on remplaçait l’un d’entre eux par une ellipse, la superficie deviendrait une hyperbole (...) La voûte en plein cintre est comme la prison ou pour dire mieux comme l’égout, elle représente l’intimité opprimée, la voûte sphérique est comme un four et la forêt donne la sensation de l’intimité mais avec amplitude. Ainsi sera l’intérieur du Temple de la Sagrada Família. »75
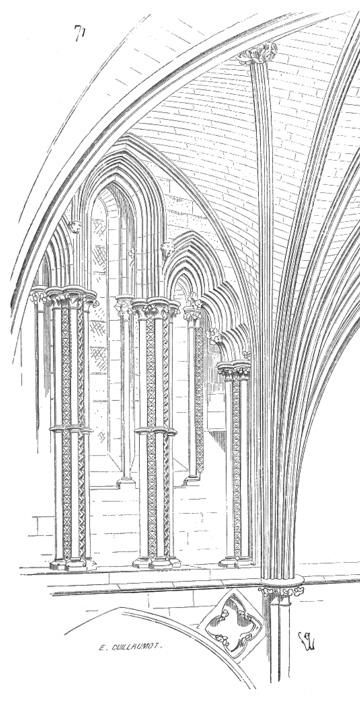
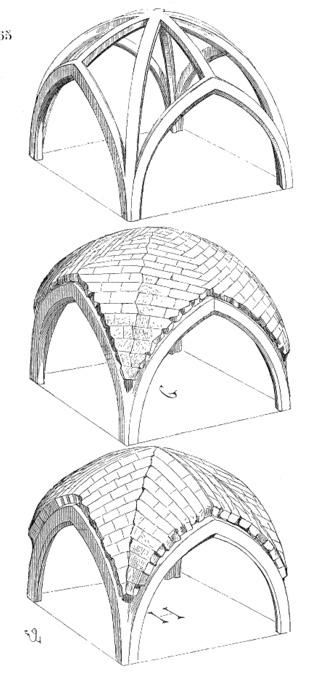
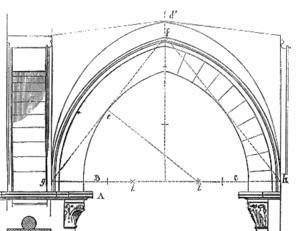
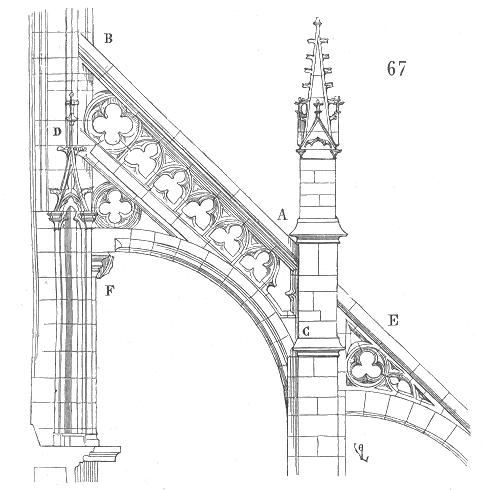
FIG.14 : CROQUIS DU DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L’ARCHITECTURE. VIOLLET-LE DUC, Eugène
74« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.8.
75« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Style Gothique II, p.88-89.
Ces quelques mots de l’architecte Gaudí précisent de manière exacte les erreurs qu’il pouvait trouver au gothique. C’est par la forme arrondie et organique qu’il semble justement trouver réponse satisfaisante au problème et ainsi désindustrialiser l’art gothique de Viollet-le-Duc ou encore de Boileau. La vérité, si l’on peut dire, résiderait dans l’utilisation des formes attenantes à la nature et toutes les figures qui la concerne et notamment comme il le mentionne, avec la figure de l’arbre, de la forêt. Par l’usage de la nature il redonne au gothique un caractère divin qui n’existe pas jusqu’à maintenant. Il redonnerait un sens à la « Grande Église. »76
76« La Grande Eglise » comme le souligne Carles ANDREU est une manière pour Gaudí de désigner l’idée de Cathédrale. « Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002.
- VERTICALITÉ ET DÉMESURE -
Nous avons évoqué l’importance de l’architecture gothique dans la conception et dans la réalisation du projet du Temple de la Sagrada Família. Bien que de nombreux éléments caractéristiques du modèle de la cathédrale aient été remis en question par l’architecte, la notion de hauteur, plus précisément de démesure par la verticalité subsistent et font écho au projet dessiné par Gaudí.
Seulement, la notion de verticalité que l’on peut retrouver pour le projet de la Sagrada Família est à nuancer avec celle que l’on pourrait utiliser pour une cathédrale gothique comme celle de Notre-Dame de Paris. L’usage de la verticalité dans le gothique est avant tout pour s’opposer au style roman et pour matérialiser par l’usage de l’architecture la relation spirituelle entre l’homme et Dieu. On peut observer que la hauteur est plus conséquente pour les cathédrales gothiques que pour les églises romanes. A titre comparatif, l’église romane Saint-Bénigne de Dijon atteint une hauteur totale de 35 mètres, tandis que la cathédrale de Notre-Dame de Paris atteint une hauteur de 69 mètres. Pourtant, de manière très factuelle, il semble que cette idée ne soit pas représentée comme il le faudrait d’après Gaudí. La forme admise par la cathédrale ne permet pas d’aspirer à une élévation de l’homme vers Dieu. Comme on peut le voir sur ces différents schémas de cathédrales gothiques, la partie monumentale ne s’élève pas. Le rectangle admis par la présence des tours jumelles installe nécessairement la masse dans la terre et ne permet pas cette volonté de s’élever. Du moins, c’est infime pour être mis en avant.
FIG.15: SCHEMAS DE PRINCIPE, LA REPRÉSENTATION DU GOTHIQUE EN FRANCE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
A titre non pas exceptionnel mais éventuellement en guise de contre-exemple, on pourrait évoquer le projet de la cathédrale Saint-André située à Bordeaux. L’intérêt de mettre en avant cet ouvrage architectural est qu’il suggère une interprétation différente de la verticalité. L’utilisation de tours sur l’ensemble du projet qui s’amincissent en prenant de la hauteur rappelle l’architecture de Gaudí et pourrait permettre de faire lien entre le gothique et le perfectionnement du gothique. (introduit par l’architecte catalan. )
FIG.16 : SCHEMA DE PRINCIPE, LA REPRÉSENTATION DU GOTHIQUE EN FRANCE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
La notion de verticalité s’impose comme nécessairement plus profonde dans l’architecture de Gaudí. Voyons ici la verticalité comme l’obliquité de l’ordre parabolique77. L’architecte ne se résout pas uniquement à construire un édifice religieux de grande hauteur mais il tente, par l’usage de formes différentes, la matérialisation de la connexion entre la terre et le ciel. Autrement dit une représentation terrestre et tangible de la spiritualité. Cette volonté, certes, déjà présente dans l’architecture gothique est ici requalifiée et également amplifiée, que ce soit dans le fond ou bien dans la forme.
Afin d’approfondir la notion de verticalité, nous allons porter de l’intérêt à la structure de la Sagrada Família. En perfectionnant l’architecture gothique, Gaudí parvient à s’affranchir de toute la structure extérieure, qui concerne les arcs-boutants, les contreforts ainsi que le pinacle.
77L’obliquité ou oblique se caractérise comme l’inclinaison d’un axe vertical ou horizontal. Plus précisement, est oblique ce qui n’est pas perpendiculaire à une ligne ou un plan. Quant à la parabole, il s’agit d’une courbe plane, symétrique par rapport à un axe dont l’apparence se rapproche du U. Dans le projet de Gaudí, ce sont ces règles géométriques qui font office d’éléments verticaux. Autrement dit, la verticalité du projet se mesure par l’emploi de nouvel ordre géométrique.
Ces éléments qu’il qualifiait de « béquilles » représentaient une certaine entrave à l’élancement de la forme générale de la cathédrale vers le ciel. En parvenant à réinvestir les forces dans des éléments de structures internes à l’enceinte du bâtiment, il permet la conception d’une façade lisse dénuée d’éléments structurels qui pourraient venir alourdir son allure générale. C’est cette façade sans « aspérités » qui se présente comme l’élément majeur et constitutif de la définition de verticalité dans le cadre du projet de Gaudí. On précise que l’aspérité évoquée ici n’est nullement en lien avec l’aspect lisse et poli que l’on pourrait attribuer à une surface telle que le verre mais plutôt à cet état de nudité structurelle que parvient à atteindre Antoni Gaudí.
Plus encore, il introduit dans son architecture perfectionnée la notion de démesure, qui réellement donne au terme d’amplification tout son sens. Si l’on compare une seconde fois la hauteur des différents édifices de style gothique à celui de Gaudí, la plus haute cathédrale gothique de France, la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, mesure 142 mètres de haut.
La Sagrada Família quant à elle mesure 172 mètres de haut. A titre comparatif, elle est deux fois plus grande que la cathédrale de Reims. Ce contraste entre les deux édifices confère réellement une dimension légitime à cette idée de démesure.
FIG.17 : COUPE COMPARATIVE DES DIFFERENTS EDIFICES GOTHIQUES A LA SAGRADA FAMÍLIA. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
Outre la hauteur démesurante de la Sagrada Família, l’apparence formelle de celle-ci donne la possibilité d’atteindre cette volonté de renouer entre le ciel et la terre, c’est-à-dire entre Dieu et l’homme.
Là encore, la structure se révèle importante pour nous permettre de définir la valeur théologique et mystique de la Sagrada Família à travers la question de la démesure au sein de l’architecture. Observer la façade de la Nativité permet, paraît-il, de saisir l’importance de la démesure dans la dimension théologique du projet. Contrairement aux édifices gothiques, la Sagrada Família s’élève avec des tours fines. La forme paraboloïdale des tours permet à la masse de s’élever. Plus précisément, les tours permettent de dynamiser la façade de sorte que l’on pourrait croire qu’elle s’étend de manière infinie pour atteindre le ciel. Cette impression, accentuée comme nous l’avions dit par la suppression des éléments de structure extérieurs, est d’autant plus marquée et présente du fait que la forme ne soit pas discontinue.
Ce sentiment de démesure et de grandeur de la structure bâtie n’est pas seulement percevable depuis l’extérieur. En effet, la verticalité du temple est également présente à l’intérieur. Même en se trouvant au sein du bâtiment subsiste cette idée de cheminement vers Dieu par la hauteur. Chose qui, pour le coup, n’était pas le cas dans l’architecture gothique. Ce qui est d’autant plus remarquable, c’est cette notion de continuité. La hauteur se retrouve à l’intérieur, procurant presque un sentiment de vertige tellement c’est démesurant. Par l’utilisation du terme de - vertige on comprend la sensation de déplacement de soi-même dans l’espace. Ici, il s’agirait d’un déplacement vertical avec une ascension spirituelle.
FIG.18 : SCHEMA DE PRINCIPE, LA SAGRADA FAMÍLIA. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
D’après l’élaboration de son esthétique, les formes paraboloïdales et paraboloïdales hyperboliques qu’il emploie pour résoudre les problèmes du gothique seraient la représentation de la Vérité. Il dit à ce sujet : « Le paraboloïde hyperbolique est la représentation parfaite de la sainte Trinité ! Puisqu’il naît de deux droites infinies - le Père et le Fils - unies par le déplacement d’une troisième, comme le Père et le Fils sont unis par le Saint-Esprit... L’espace est intuition infinie, vision de Dieu... »78 En d’autres termes, grâce à la structure du temple, on révèle ce qui est en absence par ce qui est en présence. Par la forme structurelle et la pierre, on atteindrait Dieu.
Les notions de démesure et de vertige se présentent comme mesures de la qualité théologique dans l’architecture du Temple. La verticalité dans l’architecture de Gaudí est en somme fille de continuité. « Les formes continues, poursuit-il, sont les formes parfaites. Les éléments formels d’une œuvre doivent se souder, s’enchâsser, fusionner dans l’ensemble, perdre leur individualité et lui donner ainsi plus d’unité. »79 On parle de continuité en présence par la continuité structurelle mais également de continuité en absence par la continuité spirituelle. La Sagrada fait lien, se présenterait, de la même manière que le voulait Gaudí, comme l’intermédiaire entre l’homme et Dieu.
La hauteur et plus précisément la valeur de la hauteur a une importance relative dans la conception théologique de l’architecte. Nous savons que la Sagrada Família mesurera à la fin de sa construction 172 mètres de hauteur. Il s’avère que cette valeur n’est pas anodine. Gaudí, dans une réflexion spirituelle, a conçu ce qui sera la plus haute cathédrale du monde. Peut-être aurait-elle pu s’élever encore plus haut dans les cieux, mais cela n’aurait jamais été concevable d’un point de vue religieux et anagogique. La Sagrada Família s’élève à un mètre de moins que la montagne de Montjuïc qui se trouve un peu plus au sud de Barcelone.
78« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, La Sagrada Família expliquée par Gaudí, p.56.
79 IBID.
Cela indique que la construction humaine ne dépasse pas la construction divine et en cela il démontre autant sa dévotion que la puissance de sa foi au sein de son architecture.
Gaudí semble ainsi manipuler l’architecture dans le but de connecter le peuple barcelonais à Dieu. Sa recherche architecturale et ses méthodes de conception sont guidées par une volonté mystique et des idées théologiques. Nous avons pu le constater avec la manière dont il dessine le temple et également la manière dont il établit la structure de sa basilique. La verticalité que nous avons mis en avant ici est une des justifications quant à la manière dont il pense l’architecture. Il s’agirait d’une architecture pensée à travers Dieu, pour Dieu et dont l’unique but semble être l’établissement d’un portail entre l’infini et le fini. Nécessairement, la hauteur et le vertige que produit cette altitude architecturale se dressent comme les parois solides de ce portail vers le divin.

- GRAVITÉ NÉGATIVE -
La verticalité (ou l’obliquité de l’ordre parabolique) comme il l’entend, à l’opposé de celle que l’on trouve dans le gothique, est permise par la mise en application de cette « méthode » dont nous avons parlé sans être réellement précis jusqu’à maintenant. On pourrait décrire cette méthode comme la démonstration de la gravité négative. Le principe de ce système à la fois mathématique et physique est d’exploiter les lois de la gravité terrestre. On part de cette pensée que Gaudí détient à propos de l’idée de squelette afin de préciser l’objet de cette méthode : « La beauté est la vie et la vie se traduit dans la figure humaine par le mouvement. Chez l’homme, ce qui se meut est le squelette, ensemble de palans mus par des muscles. Le squelette donne l’expression, le reste est habillage. »80
L’intérêt relatif de l’emploi de ce procédé de conception architecturale serait de constituer un squelette avec des lignes directrices, à partir de la loi de la gravité. Comme on peut le voir sur cette photographie, il va user d’un système élaboré à partir de ficelle et de sacs de sable suspendus afin de créer une structure filaire. Cette méthode permet ainsi de pouvoir définir l’intensité de la courbe que produit la force exercée par le poids du sac de sable. De cette manière, Gaudí expérimente et constitue le squelette de la Sagrada Família. Seulement, ce qui relève ici de ce que l’on pourrait qualifier d’innovant, c’est qu’il conçoit cette structure en négatif, à l’envers. La forme que l’on retrouve par la suite sous forme d’esquisse dessinée est le résultat de cette gravité négative, du retournement du dispositif.

80« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Sculpture, p.111-112.
FIG.20 : PHOTOGRAPHIE DU SYSTEME DE GRAVITÉ INVERSÉE. Auteur Inconnu
Du point de vue de la question structurelle et de l’ingénierie, on pourrait qualifier cette méthode de révolutionnaire. Pour quelles raisons ? Gaudí réalise les premières esquisses de la Sagrada Família dans les années 1880. A cette époque, comme on peut le deviner, il n’existait pas de logiciels de calcul des charges ou de calcul de la masse du bâtiment. A l’aide de cette expérimentation de la forme par la physique, il parvient à déterminer des valeurs qui, avec l’arrivée des logiciels, se révèleront justes. Ainsi, il savait exactement quel poids mettre dans les différentes colonnes qui soutiennent le Temple expiatoire afin de pouvoir atteindre une forme paraboloïdale satisfaisante à ses yeux.
Seulement, existe-t-il une relation entre la qualité théologique de la Sagrada Família et l’utilisation de cette méthode de conception ? Il semble que c’est cette conception sous forme de gravité négative qui pourrait nous permettre de faire le lien entre la méthode - architecture et la théologie. Nous avons vu précédemment que la verticalité avait une importance considérable dans la manière de percevoir la Sagrada Família en tant qu’architecture théologique, mystique. C’est cette méthode qui permet à la structure de s’élancer et de produire cet effet de démesure. Seulement, la gravité négative paraît nécessairement produire par addition un sentiment de lévitation et de suspension de la matière dans l’espace. Le bâtiment se montre alors comme arraché à la terre et en élévation vers le ciel. C’est sensiblement la forme et la grandeur des tours qui semblent nourrir ce sentiment d’apesanteur.
Ce sentiment est d’autant plus présent que le bâtiment se présente comme une masse de pierre et de béton armé. Ce qui en somme est intéressant finalement puisqu’il emploie le matériau le plus lourd et dense que l’on peut utiliser pour représenter un sentiment totalement contradictoire. Ainsi, il renforce cette idée de mystère et par essence mystifie un peu plus l’architecture du temple. La qualité théologique et mystique de la Sagrada Família est d’autant plus présente qu’il utilise le matériau terrestre par définition (la pierre) afin de manifester cette lévitation, cet état ascensionnel vers Dieu. Il semble nécessairement vouloir délivrer la matière de la gravité universelle.
L’Architecte en charge de l’aspect constructif et structurel de la Sagrada Família, Señor Alejandro Seoane a dit une phrase très parlante lors de notre entrevue à Barcelone. « Plus on monte dans la construction de la Sagrada Família, plus cette même construction devient mystique dans le sens où la structure se complexifie (...)De la même manière que l’on se rapproche de Dieu, cela devient complexe et difficile. L’effort devient plus intense qu’à la base mais c’est ce qui permet pourtant d’arriver au plus proche de Dieu. »81
Pour faire suite aux propos de l’architecte, rappelons que le Temple se constitue de dixhuit tours au total. Douze représentent les apôtres de Jésus, quatre représentent les évangiles (Luc, Marc, Mathieu et Jean), une représente Marie et enfin la dernière représente Jésus. Pour quelles raisons accordons-nous une telle importance à la symbolique liturgique de ces tours ? Comme nous pouvons le constater à l’aide de cette esquisse, les tours semblent conçues de sorte à révéler une hiérarchie par la hauteur. La tour représentant Jésus, fils de Dieu, se trouve de manière évidente au plus près de son père.
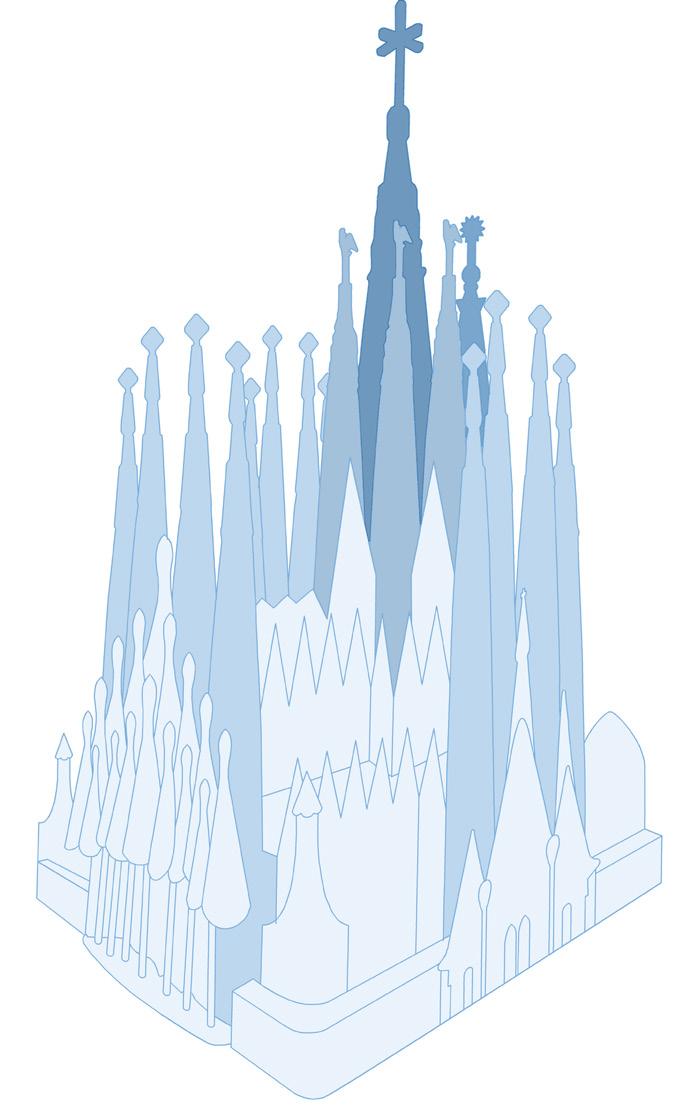
Partie basse de la basilique
Tours clochers des apôtres
Tours des évangiles
Tour de la Vierge Marie
Tour de Jésus
FIG.21 : SCHEMA D’IDENTIFICATION DES TOURS. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
81Entretien avec l’architecte Alejandro Seoane, Département Projet. Barcelone, Septembre 2022.
Ce qui nous intéresse d’autant plus par rapport à l’objet de notre étude, c’est que dans l’aspect constructif et ingénierique du projet, les tours les plus hautes ne peuvent pas être érigées tant que celles du dessous ne sont pas construites. De la même manière que l’histoire de Dieu et de Jésus est portée par les personnages certainement plus secondaires, les tours les plus hautes ne peuvent exister sans les tours les plus basses. On observe ainsi une certaine mystique, ou du moins une intention d’ordre théologique au sein même de la question constructive.
Cette question de la verticalité et de la construction régie selon une logique purement religieuse et spirituelle semble faire sens encore aujourd’hui pour les architectes qui, depuis le début du XXIe siècle prennent en charge le chantier de la basilique. L’architecte Alejandro Seoane tient un propos très intéressant et spirituellement très fort lors de notre rencontre :
« La construction de la Sagrada est un peu une manière de représenter le parcours de la foi ainsi que ses difficultés, mais également ses récompenses. »82
Ces quelques mots qui font sens dans cet objet d’étude nous donnent la possibilité d’attribuer à la Sagrada Família cette qualité théologique. Nous pourrions même mettre en comparaison le parcours spirituel de Gaudí et sa vie ascétique avec les propos de l’architecte. En effet, Gaudí passe par la souffrance afin de pouvoir entrevoir la vérité divine. Ce cheminement vers la vérité, vers Dieu, fût complexe, de la même manière que la construction de la Sagrada Família. Comme si le dessin de l’édifice religieux n’était qu’une représentation matérielle de la difficulté de son parcours religieux. C’est en ce sens, semble-t-il, que l’on peut y trouver également une qualité mystique. Au même titre que pour accéder à Dieu il faut des efforts et une vie dévouée et dépourvue de toute futilité humaine, la Sagrada Família s’élève avec une architecture et des systèmes constructifs de plus en plus complexes.
82Entretien avec l’architecte Alejandro Seoane, Département Projet. Barcelone, Septembre 2022.
Il apparaît également que par le biais de tout ce qui vient d’être énoncé, nous pouvons mettre en évidence le lien entre l’état mystique de communion avec Dieu suggéré par l’architecture et la notion de complexité à laquelle elle renvoie. En effet, que ce soit dans la quête de spiritualité de Gaudí ou bien dans la construction de la partie supérieure de la Sagrada Família, on retrouve ces concepts de difficulté, de complexité, de douleur et d’exigence. Le lexique associé au sacrifice et à la difficulté serait ainsi une manière de percevoir le projet de Gaudí comme d’une architecture divine. Le Temple expiatoire, conçu à partir des sacrifices de l’architecte, financé à partir des sacrifices du peuple, et construit de manière complexe, ne peut-être que le résultat d’un engagement spirituel et d’une dévotion participant à se rapprocher de Dieu. On ne peut atteindre Dieu par la facilité donc on ne peut représenter Dieu par une architecture résultante de la facilité.
La qualité théologique de l’architecture de la Sagrada Família réside égamement dans l’expérience ascensionnelle et lévitationelle que celle-ci propose. En repartant de l’origine, il réintroduit et perfectionne le gothique afin de lui donner sa véritable fonction : représenter l’architecture de celui à qui l’on se dévoue, Dieu.
ARCHITECTURE MYSTIQUE ET ART TOTAL
CONCEPTION NATURALISTE DE LA SAGRADA FAMÍLIA
IDÉE DE NON ARCHITECTURE
- SURNATURE -
La compétence théologique que Gaudí applique à la conception de la Sagrada Família se retrouve non pas seulement dans la structure et dans la pierre mais également à travers d’autres médiums qui permettent de renforcer l’expression de sa foi religieuse. Plus précisément, c’est en faisant usage des éléments mis à disposition par Dieu qu’il vient créer un dispositif architectural qui peut renvoyer à l’idée que nous allons développer : la non architecture. Autrement dit, comment l’architecte Gaudí produit-il de l’architecture sans utiliser de règles d’architecture ou de culture architecturale ? (Notamment avec l’architecture gothique et les codes de la cathédrale).
Gaudí dit à propos de sa vision de l’architecture : « Pour qu’une œuvre d’architecture soit belle, il faut que tous les éléments possèdent une justesse de situation, de dimensions, de formes et de couleurs. Toutes ces qualités sont intimement liées. »83 Cette justesse dont il fait mention et qu’il place au centre de la détermination d’une œuvre dite « belle » résiderait en la nature. Cette nature, équivalente à Dieu et majeure dans la constitution de son esthétique architecturale est participative de cette idée de non architecture que nous souhaitons développer. Plus précisément, on pourrait même parler de surnature.
Par « surnature », on entend nécessairement ce qui procède de Dieu, ce qui est d’une essence supérieure à la nature. Ce terme d’ordre théologique pourrait permettre de faire le lien entre l’architecture de Gaudí et Dieu. En somme, il ferait usage de la représentation naturelle afin de faire d’une expérience architecturale une expérience spirituelle et vraie. (Car la Nature égale la Vérité, cf. I.)
83« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Qualités d’une belle œuvre architecturale, p.84.
Pour parler de la notion de nature dans le projet de Gaudí, il nous faut différencier deux types de nature. La Sagrada Família est un témoignage de représentation des lois divines et terrestres à la fois dans son aspect structurel mais également dans son aspect ornemental. Nous allons commencer par ce que nous pouvons citer comme le squelette de la basilique.
Nous pourrions de manière plus juste parler de la forêt intérieure qui constitue la structure porteuse de la Sagrada Família. Il est possible de rapprocher de manière aisée cette formation architecturale au biomimétisme. Par biomimétisme est entendu littéralement l’imitation du vivant. De manière plus éloquente, le biomimétisme est un terme qui désigne le processus de conception par lequel l’homme, pour des besoins d’ingénierie, s’inspire des solutions de sélection naturelles adoptées par l’évolution.84 Seulement, on ne peut attribuer ce terme à l’architecture de Gaudí qu’à moitié dans la mesure où ici, on ne prend en considération que l’aspect scientifique de la démarche et non l’aspect spirituel. C’est pour cela que l’on ne parlera pas dans le cas de Gaudí de biomimétisme mais plus justement de surnature.
Sachant que la nature est ce qui permet d’accéder à la Vérité absolue et divine (et par conséquent à la Beauté), Gaudí utilise par conséquent les éléments de cette nature pour constituer sa propre architecture. De ce fait, il met au point le principe de la colonne arborescente. La figure de l’arbre dans la religion chrétienne est très symbolique et porteuse de sens quant à l’architecture d’Antoni Gaudí. En effet, l’arbre, et plus précisément l’arbre de vie symbolise et incarne l’amour de Dieu ainsi que la protection qu’il délivre sur Terre. Il est également la représentation de la vie éternelle et de l’accès au paradis.
« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. »85 La figure de l’arbre comme déterminante du péché originel mais également comme image de l’accès au paradis par la rédemption pourrait nous permettre de comprendre l’importance qu’elle occupe au sein du projet de Gaudí.
84 Définition de biomimétisme proposée par le CNRTL.
85« Bible », Louis SEGOND. Apocalypse, Chapitre II, verset 7.
Placer l’arbre au cœur de la représentation naturelle et au cœur de la conception architecturale serait une manière pour lui de montrer sa rédemption au Seigneur afin d’accéder au paradis.
« Cet arbre proche de mon atelier : voici mon maître. »86 Ce qui relève de l’intérêt dans ce que Gaudí dit ici et qui fait sans nul doute écho avec les propos précédents, c’est cette importance de la nature qui surpasse la simple attache spirituelle et qui au-delà, devient un modèle architectural. Un aspect de la qualité mystique de sa conception architecturale tient ici dans le fait que Gaudí pense l’architecture sans architecture. Il ne s’appuie pas majoritairement sur les discours et thèses d’architectes contemporains à son époque comme Eugène Viollet-le-Duc mais plutôt à une figure éternelle et immortelle, l’arbre.
D’un point de vue constructif, la forme et les propriétés de l’arbre permettent la résolution du problème que Gaudí trouve à la structure gothique et ainsi, corrige les erreurs du style architectural sur lequel se base pourtant la construction de la Sagrada Família. « Le but de la construction est de nous protéger du soleil et de la pluie, à l’instar de l’arbre. La ressemblance se retrouve dans tous les éléments, ainsi les colonnes d’abord furent des arbres puis les chapiteaux s’ornèrent de feuilles. Ceci est une justification supplémentaire de la structure de la Sagrada Família. »87
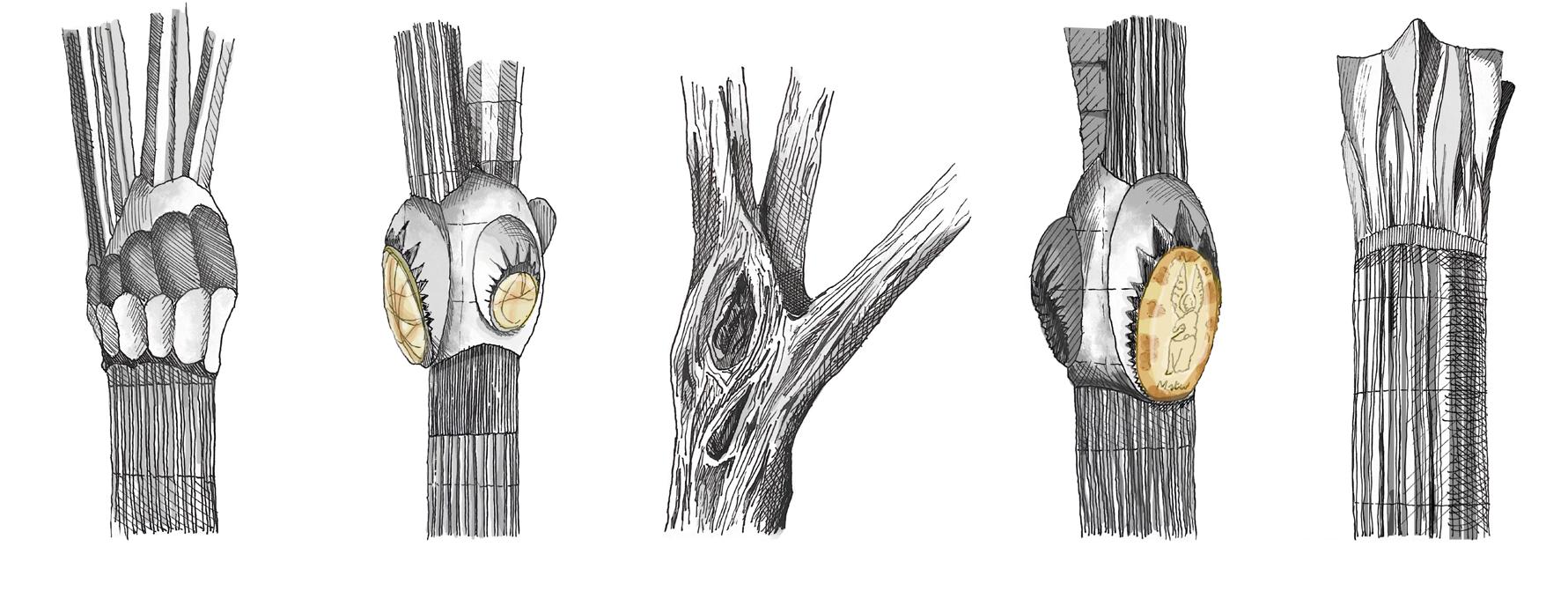
I. II. III. IV.
86« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Grand Livre de la Nature III, p.75.
87« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Grand Livre de la Nature I, p.74. 84
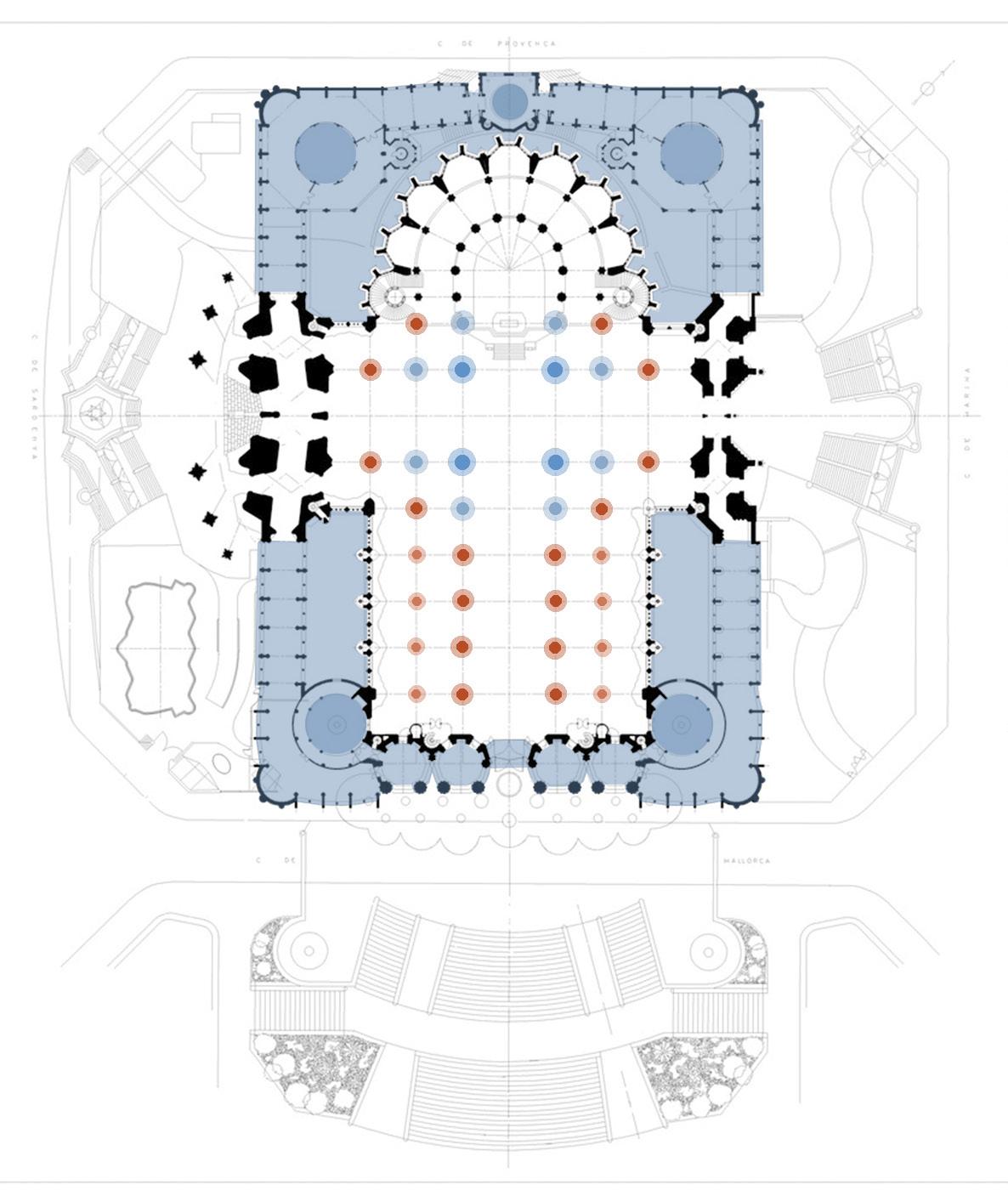
FIG.23 : IDENTIFICATION DES COLONNES DANS LE PLAN DE LA SAGRADA
Retravaillé à partir du plan réédité de ArchDaily. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
Pour Gaudí, l’architecture est la nature. Par conséquent la nature elle aussi est architecture et en ce sens, la partie intérieure de la Sagrada Família peut être à la foi considérée comme une production architecturale mais également comme l’émergence d’une forêt de pierre et de béton. Cette colonne, ou bien cet arbre qui porte la structure du Temple est ce qui contribue à donner à l’architecture de la Sagrada Família cette qualité absolue. On ne peut parler d’architecture dans le cadre de cet objet d’étude sans parler de la nature car Gaudí laisse paraître l’idée que la nature en tant que nature divine est ce qui guide l’architecture. Sans nature il ne peut y avoir d’architecture.
L’attrait de Gaudí pour le naturalisme des formes coïncide avec la publication à Barcelone en 1903 des œuvres du critique d’art anglais et écrivain John Ruskin, qui défend la nature comme « unique source d’inspiration. » De ce fait, pour chaque élément architectural, il « imite » ce que la nature lui met à disposition. Le pilier devient tronc, les piliers supérieurs deviennent les branches, les chapiteaux imitent les nœuds et enfin les voûtes imitent et reprennent l’apparence formelle d’un épais feuillage. De cette manière, il permet à l’intérieur de la Sagrada Família de devenir un extérieur bâti. Il enferme la forêt à l’intérieur de son temple et recréer la nature à travers l’architecture.
Ce qui est d’autant plus pertinent au sein du modèle conceptuel de Gaudí, c’est que l’usage de cette forme est d’autant plus important que la forme en elle-même. On ne se trouve pas devant une simple sculpture d’arbre mais réellement devant un élément porteur qui recréé les propriétés de l’arbre.
Ainsi, on retrouve cette idée de s’opposer à la ligne droite, celle de l’architecture humaine, au profit de formes géométriques tirées de celles de la nature. C’est pour cette raison que l’on attribue à Antoni Gaudí une architecture dite organique. C’est de cette manière que l’on peut nécessairement rendre compte de l’impact inconsidérable de la nature dans la conception architecturale de Gaudí. Et par conséquent, l’impact de sa spiritualité également.
Cette conception de surnature se retrouve et se voit amplifiée également par l’utilisation ornementale des éléments naturels et plus particulièrement en façade. Il s’impose de rappeler que cette accumulation de sculptures et de moulures reprenant les éléments de la nature est permise par les modifications apportées au modèle de la cathédrale gothique (libération des éléments structurels en façade). On peut, semble-t-il, réellement parler de justesse de situation dans la mesure où tous les choix de l’architecte permettent à chaque élément de prendre place dans la composition architecturale. De la sorte, on peut retrouver diverses espèces de la faune et de la flore qui donnent la possibilité à Gaudí de renforcer cette idée d’architecture naturante.
« Ceux qui recherchent les lois de la nature comme support pour leurs nouvelles œuvres collaborent avec le créateur. »88 L’architecte catalan fait le lien sans équivoque de l’architecture avec la nature et la spiritualité. Liés de manière intrinsèques, la nature et la spiritualité deviennent la source de connaissances sur laquelle Gaudí s’appuie pour constituer l’édifice de la Sagrada Família.
88« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Architecture I, p.84.
La question de l’architecture ici occupe une place particulière en raison de la manière dont elle est réfléchie car on ne retrouve aucun élément classique de conception architecturale. Gaudí ne réflechit pas uniquement comme un architecte mais de surcroit comme un représentant de la parole de Dieu. C’est cette valeur ajoutée à la pensée architecturale de Gaudí qui permet de rendre compte de la Sagrada Família comme d’un exemple d’architecture mystique. L’architecture devient plus que de l’architecture. Assurément, elle devient un moyen de représenter l’infini de la spiritualité chrétienne par le fini de la création divine, autrement dit la nature.
- LUMIÈRE -
La conception naturaliste du temple de la Sagrada Família tient également du traitement de la lumière. En effet, ce que l’on capte le plus lorsque l’on s’enfonce dans la structure de cette bible de pierre c’est la luminosité particulière et remarquable qui subsiste. L’impression que cette lumière produit est d’autant plus importante par le contraste qui se forme entre l’aspect extérieur du Temple et l’intérieur. En effet, les vitraux ne sont pas particulièrement mis en valeur en façade. Ils s’effacent même au profit de l’ornementation environnante. Cela nous ferait ainsi presque oublier qu’il existe des ouvertures sur ce bâtiment de sorte qu’en pénétrant à l’intérieur, les vitraux et la lumière se révèlent dans la pureté des formes et des lignes que constituent les colonnes et les voûtes.
« La qualité essentielle de l’œuvre d’art est l’harmonie ; dans les œuvres plastiques elle naît de la lumière qui donne du relief et décore. Je soupçonne que le mot latin « décor » désigne la lumière ou quelque chose lié à la lumière qui exprime la clarté. »89
Cette lumière, centrale dans la conception de la Sagrada Família, serait l'outil de représentation de la lumière divine. Dans la conception architecturale d’une cathédrale gothique, la lumière possède un rôle important. Filtrée par le moyen de vitraux explicitant la plupart du temps des scènes bibliques, elle permet alors de donner un caractère divin à l’espace intérieur. En effet, c’est l’utilisation du vitrail qui contribue réellement à donner à la lumière cette dimension spécifique dans la mesure où ce verre coloré magnifie la lumière de l’extérieur vers l’intérieur. Dans le cadre de notre objet d’étude, il semble que c’est également l’utilisation que fait Gaudí des vitraux qui lui permet de rendre en présence ce qui est en absence. Tel un filtre architectural, il parviendrait à recréer la lumière divine à travers ces ouvertures polychromes.
89« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, L’Œuvre d’Art, p.78.
Parlons justement de cette lumière d’ordre supérieure, divine, dont il est question dans la conception du projet de la Sagrada Família. Les textes bibliques ancestraux font à de multiples reprises référence à la notion de lumière, comme se rapportant au personnage de Dieu. Favorisant la lecture du Nouveau Testament à l’Ancien, Gaudí dû sans nul doute lire ces mots de Saint-Jean : « Il n’y aura plus de nuit : les serviteurs de Dieu se passeront de lampe ou de soleil pour s’éclairer car le seigneur Dieu répandra sur eux la lumière. »90
Nous pouvons comprendre par le biais de cette phrase biblique que la lumière divine, celle de la servitude et de la dévotion semble bien supérieure à la lumière que nous percevons. En d’autres termes une lumière invisible, la lumière de Dieu, serait selon Saint-Jean supérieure à la lumière comme nous la percevons et avec laquelle nous subsistons. Pris de cette manière, ce passage de la bible fait écho à l’esthétique de Gaudí. Depuis le début de l’étude, nous avons compris et intégré l’idée que l’ensemble des choix architecturaux et esthétiques de Gaudí avaient pour but de représenter la vérité, de représenter Dieu. L’utilisation de la lumière de la manière la plus fidèle à la Bible serait une clé de compréhension supplémentaire quant à la façon de mesurer la Sagrada Família en tant qu’architecture mystique et théologique.
Nous pouvons supposer que Gaudí tente de nourrir cette illumination divine du corps et de l’esprit par une lumière plus terrestre. Sa manière de traiter la lumière, que ce soit la lumière naturelle ou artificielle, permet d’alimenter et de révéler de manière suggérée cette lumière supérieure. La lumière comme reflet de la vie, voilà ce qui animerait la conception de l’architecte catalan. Telle une expérience de la divinité et du paradis, Gaudí par le biais de la lumière semble inviter le pèlerin ou le simple visiteur à une prise de conscience de la toute-puissance de Dieu.
90« Bible », Apocalypse de Jean. La Jérusalem future, Chapitre XXII, verset 5.
« Ceux qui croient que beaucoup de lumière sont nécessaires dans les temples se trompent. Il n’en va pas ainsi. La lumière doit être juste : ni excessive ni insuffisante car les deux extrêmes aveuglent et les aveugles ne voient pas. »91
Contrairement à ce que l’on pourrait penser dans un premier temps, révéler à l’esprit la grandeur de la lumière spirituelle ne justifie pas un emploi excessif de sources lumineuses comme le met-en avant Gaudí. C’est nécessairement ici que l’architecture devient importante. En permettant de filtrer et de contrôler la quantité de lumière dans le temple, l’architecture participe à la production de cette lumière mystique. C’est-à dire qu’au-delà de laisser rentrer la lumière, l’architecture la contrôle, l’arrête, la dirige. Cela devient un jeu entre l’ombre et la lumière, entre la révélation, la suggestion et l’apparition.
Gaudí évoque également la notion d’aveuglement. Lorsqu’il dit « La lumière doit être juste : ni excessive ni insuffisante (...) et les aveugles ne voient pas. »92, il entendrait parler d’un état plus profond que le fait de ne pas pouvoir voir. Plus exactement, il exprime l’idée que si l’on ne peut voir la lumière du fait de ce manque de justesse, on ne peut voir la lumière divine. Cette notion de justesse que l’on distingue une fois de plus constitue cet ordre de mesure équivalent à la vérité (celle de Dieu).
Les vitraux, témoignage de son attrait pour la polychromie, sont les éléments majeurs de cette magnificence de la lumière. Ils permettent de filtrer cette source luminescente brute et par conséquent de diriger la manière dont nous devons appréhender et percevoir l’intérieur de la basilique. Rappelons que le vitrail, dans son usage le plus ancien, permettait de représenter les diverses scènes bibliques pour les fidèles qui ne pouvaient avoir accès à la lecture et à l’écriture. C’est ainsi la vue qui permettait d’entretenir une culture religieuse et donc, d’entretenir la foi chrétienne de tout un peuple.
91« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Illumination des Temples, p.102103.
92IBID.
Ce qui est intéressant dans le cas de la Sagrada Família, c’est que l’ensemble des vitraux ne représentent rien de figuratif. Ces assortiments de couleurs sont plutôt des références polychromiques à la naissance du Christ, à sa résurrection mais également à des éléments naturels qui rentrent en lien avec la notion de nature présente dans l’ensemble du projet.93
Il semble important d’indiquer dans une certaine parenthèse que la conception et construction des vitraux de la Sagrada Família pourraient faire foi de cette sédimentation architecturale qui est caractéristique du temple et recherchée par l’architecte Gaudí. En effet, les vitraux de la crypte sont des vitraux « typiques » du style gothique de la cathédrale avec des représentations bibliques comme celles dont nous avons parlé.
Joan Vila-Grau est l’artiste qui a consacré une très grande partie de sa carrière à la conception des vitraux du Temple. Comme l’avait exprimé Gaudí, il aspirait à fabriquer une harmonie lumineuse par le biais des vitraux et de leurs couleurs. « Quand je commençais à penser à la lumière harmonique dans le temple et à la grande symphonie de couleur et de lumière, j’ai découvert un autre commentaire de Gaudí dans lequel il envisageait la Sagrada Família comme un temple de lumière harmonique. C’était exactement l’idée que j’avais. »94
Survient ainsi l’idée infligeante que dans sa conception de la lumière, l’architecte Gaudí, et par extension le peintre Vila-Grau, ont exploité le soleil, source divine, afin de pouvoir faire vivre l’intérieur du Temple. Plus précisément, c’est par l’usage de couleurs dans une disposition adaptée à la course du soleil que la pierre et l’ensemble de la matière de la basilique se transforment et varient d’une heure à l’autre. De ce fait, l’atmosphère présente le matin lorsque le soleil se lève à l’est serait totalement opposée à l’atmosphère du soir.
C’est cette ambiance variable et qui se manifeste par ces jeux de lumière qui donne vie à l’intérieur de la Sagrada Família et qui contribue à la mysticité de l’architecture.
93« Vitrage de la Sagrada Familia : Entretien avec Joan Vila-Grau », Margaret Martlew. Université Sheffield, Numéro 40. A titre exemplaire, Gaudí donna pour unique ligne conductrice à l’artiste à propos des vitraux bleus : « Je suis l’eau de la vie. »
94« Vitrage de la Sagrada Familia : Entretien avec Joan Vila-Grau », Margaret Martlew. Université Sheffield, Numéro 40.
Ce dispositif de l’utilisation naturelle de la lumière pourrait être lié directement à cette idée du cycle de la vie. Autrement dit, grâce à la conception architecturale et artistique des vitraux, on expérimente cette idée du temps et de la vie qui défile au rythme de la course du soleil.
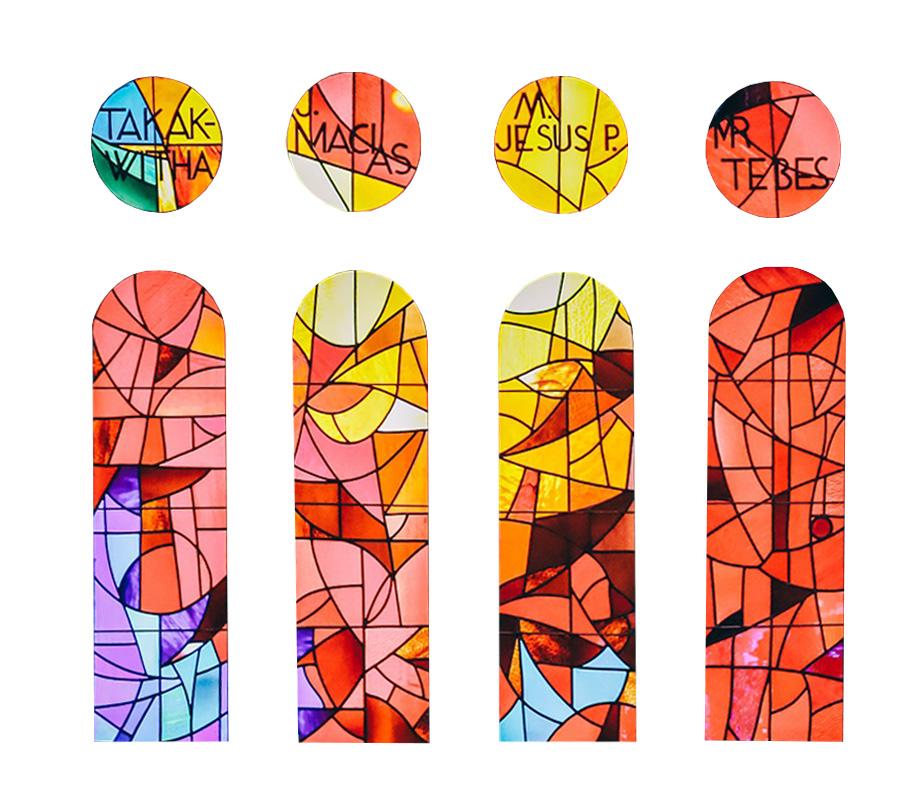




Le peintre Joan Vila-Grau s’exprime d’ailleurs sur cet état que produit la lumière, et plus précisément celle des vitraux dans l’appréhension de la Sagrada Família : « Certains s'attendent probablement à ce que les vitraux suivent la tradition de l'iconographie figurative. Pour moi il fallait créer une atmosphère, une grande symphonie de couleurs et de lumière. Quand on entre dans une église gothique, une cathédrale ou un monastère, la première chose que l'on ressent, c'est l'atmosphère. (...) Eh bien, je pense qu'en créant une atmosphère, vous pouvez donner l'impression d'être dans un endroit différent de tout autre endroit. Je n'aime pas le mot magie mais c'est quelque chose de magique – mystique, c'est peut-être presque la même chose. »95
Outre cette idée de la lumière comme peinture solaire qui vient donner vie à la structure intérieure de la basilique, le mesure de la mysticité de la Sagrada Família se ferait également par la conception que Gaudí se fait de la coupole.
95« Vitrage de la Sagrada Familia : Entretien avec Joan Vila-Grau », Margaret Martlew. Université Sheffield, Numéro 40.
Dans l’architecture religieuse depuis l’Antiquité, la coupole est le moyen architectural d’apporter une source très importante de lumière au niveau de l’abside, assez verticale, de sorte qu’elle représente la lumière sainte, la présence de ce qui est en absence. Dans le cas de la Sagrada Família, cette coupole est d’autant plus exposée qu’elle est ornée d’une mosaïque dorée permettant de mettre en avant le caractère suprême de celle-ci.
L’utilisation de la mosaïque dorée est d’autant plus symbolique qu’utile dans la conception architecturale car elle permet de refléter la lumière afin de la rendre d’autant plus intense. C’est nécessairement par ce procédé architectural que l’on peut rendre compte du caractère divin que Gaudí applique à son traitement de la lumière.
L’architecture devient ici un médium de magnificence de la lumière afin de révéler le caractère divin qui en résulte. Gaudí, par le moyen de la construction, révèle la présence de Dieu par la lumière, elle-même révélée par son architecture. Plus précisément, la lumière semblerait jouer un rôle à double sens avec l’architecture puisqu’elle permet de rendre vivante une masse figée quand l’architecture permet à la lumière d’incarner une présence.
C’est cette complémentarité des deux qui permet de pouvoir inscrire la Sagrada Família dans ce registre mystique.

- ORNEMENTATION ET POLYCHROMIE -
L’utilisation de la nature comme surnature, ainsi que celle de la lumière, permettent d’introduire deux dernières notions constitutives de la pensée architecturale et religieuse de Gaudí : l’ornementation et la polychromie. Ces deux éléments que l’on retrouve aussi bien dans la conception extérieure qu’intérieure conduiraient également à la mise en évidence du lien indiscutable qu’il peut subsister entre l’art et l’architecture au sein de ce projet. Par extension, l’expression de son art dans son projet architectural favoriserait une fidèle représentation de Dieu d’une manière finie et tangible.
Le 10 Août 1878, Gaudí entreprend la rédaction d’un traité sur l’ornementation afin de la rendre intelligible et intéressante. C’est comme s’il justifiait l’usage important qu’il en fait sur la basilique de la Sagrada Família. Au sein du traité appelé Ornementation96 il dit :
« Il faut rechercher une harmonie totale entre le système de construction et la représentation des idées religieuses, ne pas dissimuler les grandes masses mais au contraire ajouter à leur volume en réduisant leur matérialité par une ornementation simple et propice ; les formes extérieures doivent être le reflet des formes intérieures. »97
De cette manière, Gaudí établit dans un premier temps et sans équivoque le lien entre l’ornementation et la spiritualité. L’ornementation serait en quelques sortes une manière d’amplifier de manière figurative ce que l’architecture représente de manière subjective.
96« Ornementation », Antoni GAUDÍ. Traité Théorique, 10 Août au 22 Septembre 1878. Il s’agit du plus long texte théorique que l’on ai pu conserver de l’architecte catalan.
97« Ornementation », Antoni GAUDÍ, 1878 in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, L’extérieur en tant que reflet de l’intérieur, p.239.
C’est cette équité des représentations et plus précisément, cette « harmonie » comme l’exprime Gaudí, qui permet de donner toute son importance à l’ornementation. En effet, nous pouvons observer une façade richement ornementée et même pour certains architectes considérée comme chargée à outrance.
L’intérieur, lui, se présente dépourvu de figures ornementales. Plus clairement, on distingue à l’intérieur une architecture qui révèle et ramène à Dieu par la structure (abstrus) tandis qu’en extérieur nous pouvons remarquer une représentation de Dieu par la nature (figuratif). Nous pouvons penser que cette dualité indubitable est ce qui participe à renforcer la qualité mystique de cette architecture. Il semble alors admis d’arguer que dans la pensée architecturale et religieuse de Gaudí, l’ornementation en tant que médium de représentation de Dieu soit aussi importante que la structure du Temple.
C’est également cet usage de l’ornementation qui permet de renforcer la rupture entre l’architecture gothique et l’architecture de Gaudí. En effet, bien que l’ornementation soit présente sur les grandes cathédrales gothiques, l’harmonie, si l’on en croit le traité de Gaudí, ne serait pas respectée. Sans harmonie, il ne peut y avoir de bon projet d’architecture.
Nous avons à de nombreuses reprises évoqué l’importance de la notion de vérité dans la constitution de la compétence théologique de Gaudí. Cette idée se retrouve également dans les éléments ornementaux de la Sagrada Família. C’est en se basant à nouveau sur les créations divines qu’il établit et compose les fresques sculpturales des différentes façades. Grâce à son étude et l’usage du squelette comme base de son travail sculptural car « L’apparence et le caractère sont fils du squelette. »98, il rétablit à travers le travail d’ornementation la vérité. Alors, si l’ornementation est vérité, l’ornementation ne peut être (selon la pensée esthétique de Gaudí) que beauté. Elle devient ainsi un outil supplémentaire de représentation de sa foi par l’usage de l’architecture, et d’une autre manière, par l’usage de l’art.
98« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Squelette II, p.113.
A travers l’étude de la structure de la Sagrada Família, nous avons eu la possibilité de saisir l’importance de la figure de l’arbre dans l’architecture de Gaudí. L’arbre et ses attributs sont des éléments que l’on retrouve également dans son ornementation. Il semble pertinent de l’évoquer plus particulièrement afin de mettre en avant sa volonté d’exprimer à l’extérieur par l’ornementation ce qu’il révèle à l’intérieur par la structure et la lumière.
C’est de cette manière que l’on peut retrouver en façade l’arbre de vie sous forme sculpturale. Seulement, on trouve également une composition de façade réfléchie de telle sorte que l’on se méprendrait à pénétrer dans un épais feuillage.
Antoni Gaudí fait usage de l’ornementation afin d’apporter une harmonie à l’ensemble de son projet architectural. Cependant, cela ne signifie pas qu’il faille en abuser pour autant.
Ainsi, nous pourrions définir que dans ce cas -harmonie signifie usage nécessaire. On peut dès lors comprendre qu’il n’y ai aucun usage de l’ornementation sur la façade de la Passion (c'est-à dire la façade qui représente par son architecture très géométrique l’idée de la mort et du sacrifice). L’ornementation, dans son usage, devient pour Gaudí une manière d’amplifier l’architecture et de lui donner un caractère plus expressif. (Ou au contraire de renforcer un contraste déjà présent par la forme structurelle de l’architecture)




L’ornementation ou plus précisément l’ornement, se définit et se rapporte à l’idée de décoration. Il semble que dans son traité, Gaudí tente d’élever la fonction de l’ornement de sorte qu’il ne devient plus un simple élément de décoration mais plutôt une partie intégrante du projet architectural. C’est pour cette raison qu’on ne peut séparer l’ornementation de l’aspect théologique de la Sagrada Família. La requalification de l’ornementation dans le projet architectural confère à celle-ci une force spirituelle supérieure mais également une force en présence par la masse. Cela représenterait la symbiose de ce qui est en absence et en présence. En somme, l’harmonie architecturale. Aussi, la qualité mystique de la Sagrada Família se mesure également par l’usage harmonieux d’une ornementation valorisée et sensée.
« L’ornementation a été, est et sera colorée. La nature ne présente jamais aucun objet de façon uniforme. Tout, dans la végétation, dans le règne animal et minéral comporte un contraste de couleurs plus ou moins vif. C’est pourquoi nous devons, nous aussi, colorer obligatoirement, en partie ou en entier, les divers membres architectoniques dont la couleur disparaîtra peut-être mais que la griffe du temps se chargera de recouvrir de cette partie originale et précieuse que donne l’ancienneté. »99
Dans l’Œuvre de Gaudí, on ne peut parler d’ornementation sans parler de couleur. C’est cette combinaison des deux qui peut nous permettre d’évoquer la notion d’art ou bien d’œuvre d’art. Cet attrait pour la polychromie en architecture n’est pas inédit mais original. En effet, on trouve également un fort usage de la polychromie en façade à l’époque de l’Antiquité notamment pour l’architecture des Temples. Les qualités polychromiques de ces modèles architectoniques semblent justement être celles que cherchent à retranscrire Gaudí sur son Temple catalan. Ainsi, comme il l’exprimait, il retournerait à l’origine.
99« Ornementation », Antoni GAUDÍ, 1878 in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, La coloration, p.232-233.
Gaudí dit : « La peinture architecturale possède l’immense avantage de rendre plus énergiques les contours et les plans structuraux. »100 Outre une volonté de revenir à l’origine, l’usage de la peinture dans le projet architectural détient une véritable fonction. La Sagrada Família étant à ce jour inachevé, nous n’avons pas la chance de pouvoir vérifier et analyser cette information avec le Temple. Cependant, afin de pouvoir expérimenter la méthode et la réflexion de Gaudí, nous proposons une esquisse de ce que serait la façade entièrement nuancée. D’après les références de temples grecs et romains mais également d’après le discours d’Alejandro Seoane, on peut observer plus bas la façade de la Gloire polychromée. En partant du principe que la lumière permet de donner du mouvement et du relief à la façade, on peut imaginer qu’avec la couleur, le bâtiment vit et se transforme au fur et à mesure de la journée. Plus précisément, au-delà de rendre plus énergiques les contours de l’architecture, la couleur les anime. La perception de la façade devient ainsi différente selon le temps mais également selon la manière dont on se place pour observer le temple. L’architecture se détache alors de cette image figée et stoïque par le biais de la polychromie. Cette idée se renforce lorsqu’il dit « Le soleil est le grand peintre des terres méditerranéennes ! »101
Seulement, au-delà de cette volonté architecturale, l’utilisation de la couleur relève davantage d’une réflexion à nouveau organisée autour de sa foi et de sa spiritualité. « La décoration a été, est et sera colorée disait Gaudí ; il appuyait cette affirmation en prenant l’exemple de la Nature qui jamais, ne tombe dans la monotonie des nuances, c’est pour cela, ajoutait-il, que l’œuvre architecturale il faut la peindre entièrement ou partiellement. »102 En partant du principe déjà évoqué selon lequel « Dieu ou la Nature », l’utilisation de la couleur est également une manière pour Gaudí de représenter Dieu en représentant l’ensemble des richesses terrestres dont nous pouvons disposer.
100 IBID.
101« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, De la couleur I, p.121.
102« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, De la couleur I, p.121-122





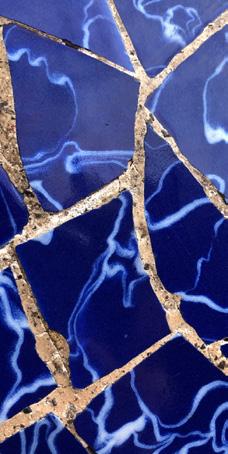
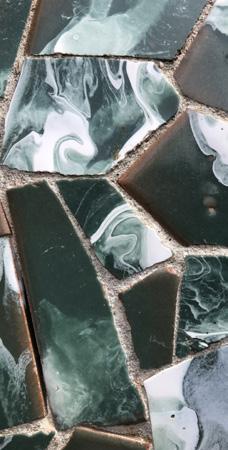
FIG.27 : FACADE DE LA GLOIRE POLYCHROMÉE. Retravaillée sur base de la façade d’Antoni Gaudí. CHAUSSEC, Maëlle. 2023
FIG.28 : DÉTAIL MOSAÏQUE, PARC GÜELL. CHAUSSEC, Maëlle. 2021
En alliant ornementation et polychromie, Antoni Gaudí fait de sa asilique une véritable architecture aux caractéristiques d’œuvre d’art. En effet, il ne semble pas concevoir le projet comme un simple bâtiment mais plutôt comme un objet artistique, comme une sculpture qui évolue et qui interagie avec son environnement. Nous parlons d’art et d’œuvre d’art mais nous oublions l’objet de l’étude. Qu’en est-il de la qualité théologique de la Sagrada
Família lorsque l’on parle d’ornementation et de polychromie ? Le centre de sa réflexion relie la théologie mystique à la conception artistique du Temple. Son appréhension de l’architecture semblant être appuyée sur la Nature est ce qui nous permet de faire lien avec cette notion de théologie. C’est-à dire qu’ici, tout son processus de conception est centré autour de cette idée de Nature divine, de Nature exemplaire.
La Nature, en tant qu’elle est Dieu, renforce cette architecture jusqu’à présent en absence (par la structure et la lumière) par le côté figuratif de l’ornementation et de la polychromie.
Cette symbiose entre l’art et l’architecture conduite par l’idée de la Nature comme Dieu constitue ce que l’on nomme Œuvre d’Art Totale et donc octroie à la Sagrada Família cette qualité mystique que nous tentons de mesurer dans le projet de Gaudí.
Le Temple de la Sagrada Família, en tant qu’édifice religieux consacré à la dévotion de Saint Joseph peut être considéré d’après les nombreux éléments de conception que nous avons étudié comme une architecture fortement théologique. La Sagrada Família se présente ainsi comme une pure et littérale représentation de sa foi et une tentative de représentation de l’irreprésentable. Plus que ça, il produit une architecture sans architecture qui permet justifie l’aspect théologique du lieu et de sa pensée. Par architecture sans architecture, on met en avant l’idée de l’utilisation quasiment majoritaire de références extérieures au domaine architectural, comme la nature ou bien encore l’étude du mouvement du soleil. Tant d’un point de vue constructif qu’ornemental, Gaudí (par le biais de sa compétence théologique) nous accompagne vers un parcours spirituel, une ascension vers le divin. De cette manière, son architecture devient plus que de l’architecture. Plus précisément, elle devient transcendante. Ainsi, au-delà de l’expérience architecturale, le « Temple Expiatoire » s’impose également pour le visiteur comme une expérience mystique.
Comme le dit nécessairement l’écrivain et architecte Carles Andreu : « Une Architecture sans Architecture (...) voici la nature mise au service de l’art. Art Sacré, ici fils de la vision mystique de Gaudí pour qui la lumière naturelle ne pouvait être que le reflet de la lumière spirituelle, elle-même pur reflet de la lumière divine. »103
103« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.13.
LA SAGRADA FAMÍLIA DE GAUDÍ COMME ŒUVRE D’ART
TOTALE
Selon le philosophe Kant, une œuvre d’art est une production artistique qui doit répondre au critère du Beau. D’autre part selon Hegel, une œuvre d’art est plus exactement une manifestation du divin dont l’homme devient le médiateur. De ce fait, la représentation de l’absent ne se fait pas uniquement et nécessairement par la nature qui nous entoure (celle dont parle Gaudí) mais plus justement par la création humaine à travers l’art. La pensée esthétique de Gaudí permettrait de faire lien entre ces deux thèses. En effet, selon Gaudí, ce qui est beau est vrai. Cette vérité qui nourrit le fond de sa pensée trouve sa valeur dans la foi qu’il porte à Dieu. Nous évoquons ainsi la thèse suivante : L’architecture de la Sagrada Família en tant qu’elle est le fruit d’une réflexion purement religieuse serait ainsi une manifestation du divin dans la pierre et par conséquent, une œuvre d’art. Plus encore, pourrait-on parler d’œuvre d’art Totale.
Richard Wagner, compositeur allemand figurant dans la période du romantisme, définit cette idée d’œuvre d’art totale. L’Œuvre d’art Totale, ou bien le Gesammtkunstwerke104 tient en premier lieu d’une volonté qui semble commune à celle que Gaudí entretient : le retour à l’origine. A travers cette doctrine esthétique qu’est l’art total, Wagner tend à retrouver le modèle de la tragédie grecque, perdue à son époque du romantisme.105 Tout comme Gaudí, la production artistique mais surtout la réflexion artistique de l’artiste passe par une volonté de recréer un modèle de perfection antique. Ce « retour à l’origine », il le conçoit en fusionnant l’ensemble des arts afin de refléter l’unité de la vie.
Par l’utilisation de la notion de « vie », on évoque l’idée précise que l’art total, en plus de fusionner les arts, sollicite l’ensemble des sens et émotions de la personne confrontée à cet art.
104« Gesammtkunstwerke» est un concept inventé par Richard WAGNER courant XIXe afin de désigner la notion d’Art Total.
105Le romantisme est un mouvement littéraire et artistique qui trouve son origine en Europe et plus particulièrement en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Il s’oppose à la tradition classique et au rationnalisme en privilégiant l’expression du -moi et la libération des sentiments. De ce fait, les thèmes principalement convoqués dans les œuvres sont la nature et l’amour.
« Quand on contemple une œuvre d’art on fusionne avec elle, on échappe au vouloirvivre. »106 Plus qu’une fusion des arts, Wagner évoque également une fusion du tout. L’art ne reste pas nécessairement un support ou un élément externe de contemplation mais devient un système supérieur de perte de conscience, de libération pour l’homme. De cette manière, la conception d’une œuvre d’art totale implique assurément une part de mysticisme dans la mesure où l’on recherche la délivrance de l’esprit, l’affranchissement du corps dans le but de ne faire qu’un avec l’art.
On ne peut évoquer la pensée wagnérienne sans faire allusion à la pensée philosophique de Schopenhauer qui sont intrinsèquement liées. En effet, lorsque Wagner développe sa théorie esthétique sur l’art total, il reprend en parallèle certains principes d’ordre philosophique mis en avant par Schopenhauer. Ainsi, comprendre de quelle manière se constitue l’art total, c’est également comprendre et entendre la pensée de Schopenhauer.
Ce qui semble caractériser la pensée esthétique de Schopenhauer, c’est dans un premier lieu le pessimisme qui forme l’ensemble de ses idées. Selon lui, l’existence de l’être humain est vouée au désespoir et à la tragédie. C’est ce qu’il appelle plus précisément le « vouloirvivre » et qu’il tente d’expliquer dans la Doctrine sur la primauté de la Volonté. En d’autres termes, il exprime l’idée que la Volonté est ce qui nous ramène à notre condition et à notre douleur. Cette notion de Volonté, centrale dans son discours, est accompagnée de celle du désir. D’après la pensée de Schopenhauer, le caractère tragique et douloureux de l’existence humaine ne serait le résultat que du désir, engendré par la Volonté. C’est cette capacité que l’homme aurait de rechercher la satisfaction d’un désir différent chaque fois qu’il répond à un autre qui serait l’origine de la souffrance. Ce serait cette emprise de la Volonté sur l’Homme qui nous emprisonnerait dans notre existence et notre épanouissement.
106« L’Oeuvre d’art de l’avenir » (Das Kunstwerk der Zukunft) , Richard WAGNER. 1849 (publication originale), Partie I.
Cette pensée, Schopenhauer l’exprime dans sa thèse « Le monde comme Volonté et comme Représentation » : « Tout vouloir procède d’un besoin, c’est-à-dire d’une privation, c’està-dire d’une souffrance. La satisfaction y met fin ; mais pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de plus, le désir est long, et ses exigences tendent à l’infini ; la satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême lui-même n’est qu’apparent : le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, le second est une déception non encore reconnue. »107
La pensée esthétique que Schopenhauer développe est une « solution » à cette souffrance inévitable que conduit l’existence par l’ascendant de la volonté. L’art serait la clé afin de s’assujettir du vouloir-vivre. C’est en cela que nous pouvons sensiblement rapprocher Schopenhauer de Wagner. L’unité de la vie recherchée par Wagner est une idée que l’on retrouve ici avec Schopenhauer dans le sens où par l’art, il serait possible d’accéder à la liberté, à la pleine existence de soi, à la jouissance suprême. Autrement dit, l’art devient une certaine délivrance momentanée où la Volonté n’existe pas car elle laisse place à la Contemplation. Par contemplation, on entend l’expérience esthétique selon laquelle le sujet serait tellement englobé dans l’admiration et la considération d’une œuvre d’art qu’il se détacherait de la réalité et donc de sa volonté. Ainsi, il échappe à la douleur et à la réalité de la vie.
« Le sujet cesse par le fait d’être simplement individuel ; il devient alors un sujet purement connaissant et exempt de volonté ; il n’est plus astreint à rechercher des relations conformément au principe de raison ; absorbé désormais dans la contemplation profonde de l’objet qui s’offre à lui, affranchi de toute autre dépendance, c’est là désormais qu’il se repose et qu’il s’épanouit. »108
107« Le monde comme Volonté et comme Représentation », (Die Welt als Wille und Vorstellung ), Arthur SCHOPENHAUER. 1818 (publication originale), Partie III, §38
108« Le monde comme Volonté et comme Représentation », (Die Welt als Wille und Vorstellung ), Arthur SCHOPENHAUER. 1818 (publication originale), Partie III, §3
L’art, dans toute sa dimension métaphysique, devient un médium d’élévation de l’esprit vers la pureté et la perfection. On peut trouver une dimension sensiblement mystique et religieuse dans la manière dont Schopenhauer considère l’art. Son discours met en avant une idée de l’ordre de celle du principe dans lequel le sujet, en tant qu’il se détache de sa condition et de la réalité, se rapproche du néant. Ce néant serait ici positif car le sujet se libère de sa condition humaine pour accéder à la grandeur et à l’extase. Il semble qu’en se réduisant au néant (au non-être, - être signifiant vouloir selon Schopenhauer), il accède à la perfection.
Par le biais de cette expérience esthétique, Schopenhauer sacralise l’art de sorte que son appréciation et sa contemplation puisse être perçue comme une doctrine du Salut.109 Bien que la qualité mystique de cette expérience esthétique ne soit pas mise en avant dans les écrits du philosophe, nous pouvons cependant penser qu’il s’agit d’une seule et même chose.
Richard Wagner, lorsqu’il entreprend le développement de sa pensée sur le Gesammtkunstwerke, reprend cette idée d’élévation du sujet vers la perfection en ne parlant plus d’art mais des arts. Cette contemplation et cette portée métaphysique décrite par la thèse de Schopenhauer est ici requalifiée d’Œuvre d’Art Totale. Nécessairement, l’art total que Wagner tente de créer dans le domaine théâtral, Gaudí le produirait à son tour au sein du domaine architectural. Bien que les intérêts artistiques des deux hommes divergent, la visée de leur production artistique, elle, reste similaire. Plus justement, ils cherchent à recréer l’harmonie et l’unité en fusionnant les arts et la vie. Cette unité engendrée par cette fusion prodiguerait à l’art cette qualité supérieure, suprême que décrit Schopenhauer.
109Le Salut est une notion spirituelle qui signifie Délivrance et Libération. On l’appelle également la doctrine de la prédestination ou de l’élection. En théologie, la doctrine du salut désigne la libération des péchés. Le croyant, dénué de toute souffrance, colère, peut accéder au paradis et se rapprocher de Dieu. « Dieu seul peut ôter le péché et nous délivrer de son châtiment» ( Timothée Chapitre I, verset 9).
«Nicht eine reich entwickelte Fähigkeit der einzelnen Künste wird in dem Gesammtkunstwerke der Zukunft unbenützt verbleiben, gerade in ihm erst wird sie zur vollen Geltung gelangen.»110
Ce que Richard Wagner en tant qu’artiste complète à la pensée de Schopenhauer, c’est cette idée que la contemplation et l’extase recherchée n’est envisageable seulement si l’on combine plusieurs arts. C’est sensiblement cette fusion de tous les arts en UN art suprême qui permet d’accéder à cette omnipotence.
Le pensée wagnérienne (influencée par Schopenhauer), en tant qu’elle situe le rôle de l’art comme transcendant, fait écho à la pensée gaudienne. Gaudí, révélant l’absence de la foi dans la présence de la pierre par l’architecture répond à cette idée de transcendance du corps et d’élévation de l’esprit. Il le fait certes, dans un sens bien plus religieux que Wagner, mais on retrouve cette idée que l’art devient plus que de l’art. Autrement dit, que l’art détient un pouvoir et une fonction bien supérieure, qui dépasse l’entendement. L’art devient une mesure de la mystique.
Considérer l’œuvre de Gaudí comme totale nécessite de s’appuyer à la fois sur sa pensée mais également sur l’architecture en elle-même du temple. Bien que son travail puisse être comparé à celui du Wagner, il diverge également sur certains points. Ce qui différencie les deux artistes, ce sont les raisons et les croyances sur lesquelles ils fondent leur travail. Gaudí, contrairement à la pensée esthétique de Wagner et Schopenhauer, centralise sa production artistique dans le but de servir Dieu.
Justement, l’écrivain Carles Andreu écrit à propos de Gaudí : « Avant d’être artistique ou fonctionnelle, son œuvre est théologique, chaise réceptacle de la parole faite, écrin visible d’une grâce invisible. »111
110Traduit de l’allemand : « Pas une capacité richement développée des arts individuels ne restera inutilisée dans l’oeuvre d’art totale de l’avenir, c’est précisement là qu’elle prendra tout son sens. »
111« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.16.
Ce que Carles Andreu explique, c’est cette manière dont Gaudí manipule l’art. Assurément, il apparaît que ce soit l’art qui sert la théologie et non la théologie qui serve l’art. De cette manière, l’art ne peut être que représentation physique et présente de l’idée métaphysique, de cette « grâce invisible ». Cela fait sensiblement écho à la définition que nous venons de faire de l’art total. Plus clairement, l’architecture de Gaudí, par son caractère mystique et fortement théologique, surpasse l’aspect fonctionnel et esthétique pour proposer une expérience qui surpasse l’entendement. La compétence théologique et mystique de Gaudí ne peut qu’entraîner la réalisation d’une œuvre d’art totale.
Carles Andreu ajoute également : « Revenons au désir du Maître : transformer la douleur en joie, nous faire jouir. Jouissance esthétique, sensuelle, spirituelle. De là vient la plus-value artistique de son œuvre que nous tous, grands et petits, sages ou ignorants, percevons immédiatement. »112
Nous pouvons saisir ici les similitudes entre l’œuvre de Gaudí et le discours de Schopenhauer. Ce que Carles Andreu soutient, c’est sensiblement cette contemplation que Schopenhauer évoque dans ses textes. Seulement, la transcendance ici ne vient pas essentiellement de l’art mais plutôt de l’art exprimant la spiritualité chrétienne. C’est justement l’aspect inné et universel de l’architecture de la Sagrada Família qui renforce cette idée de contemplation, notamment quand Carles Andreu écrit « que nous tous, (...), sages et ignorants, percevons immédiatement ». De ce fait, si l’art (ou les arts) que produit Gaudí sont de l’ordre de l’évidence et non de l’intelligence, alors, il semble qu’il soit total.
« La synthèse que recherche Gaudí n’est ni mécanique ni simplement fonctionnelle, elle est sagesse c’est à dire art. »113 Gaudí dit justement à propos de la sagesse : « La sagesse est supérieure à la science parce qu’elle se réfère aux faits dans leur totalité, elle est synthèse, elle est la vie. »114
112« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.35.
113« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.8.
114« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Sagesse II, p.147.
La mise en avant de l’idée de sagesse nous permet d’introduire le rapprochement entre la notion d’art total et le projet d’architecture en lui-même. Wagner exprime cette idée que la fusion des arts reflète l’unité de la vie, de même sorte que Gaudí explique que selon lui c’est la sagesse qui illustre cette même idée.
L’architecture aussi bien extérieure qu’intérieure de la Sagrada Família exprime très bien une conception basée sur l’utilisation de plusieurs formes d’art. D’un point de vue strictement visuel, nous pouvons en discerner trois, qui appartiennent plutôt aux arts plastiques. Bien évidemment, il y a l’architecture qui est la discipline artistique centrale et également la base de cette synthèse des arts. Est utilisé également dans le projet la sculpture et tout ce qui traite des arts visuels. Plus précisément, on peut citer le travail de mosaïque présent en façade. Cette mosaïque, caractéristique de l’Œuvre de Gaudí, nous permet de le considérer autant architecte qu’artiste. La fusion des arts est étudiée de manière tellement harmonieuse que même si la sculpture et les arts visuels ne sont que secondaires dans le projet architectural, Gaudí parvient à leur donner de la visibilité et de la pertinence de sorte qu’on ne peut imaginer l’architecture de la basilique sans les autres arts qui conversent et co-créent l’espace ensemble.
C’est ainsi que l’on peut distinguer une œuvre d’art totale : lorsqu’on ne peut plus discerner chaque art au sein d’un même ensemble. Les arts ne deviennent qu’un art à part entière. La Sagrada Família n’est pas exactement un projet d’architecture à part entière mais plutôt une sculpture habitée, une œuvre d’art en trois dimensions qui possède néanmoins des caractéristiques architecturales en priorité.
Jusqu’à maintenant nous évoquons les arts qui suscitent plus particulièrement le sens de la vue. Dans le cadre d’un projet architectural, cela s’impose comme une évidence. Cependant, dans le cadre d’un projet architectural religieux, il semblerait que l’ouïe soit également d’une importance majeure. Ce que nous développons c’est l’idée qu’Antoni Gaudí ai conçu un art auditif à partir de l’art visuel que représente l’architecture.
L’artiste Salvador Dali, dans la préface de l’ouvrage « Gaudí, Vision artistique et religieuse », exprime très bien cette idée d’un projet multisensoriel. L’écrivain Carles Andreu également lorsqu’il écrit « Ces œuvres nous chatouillent les sens et questionnent nos stratégies mentales, nos croyances intimes. »115
Grâce à la masse et à la pierre, Gaudí conçoit le Temple de sorte qu’il y ai des « Tours Orgue »116 qui puissent produire un son suffisamment fort que l’on entende dans l’ensemble de la ville. La conception architecturale peut ainsi être vue comme la conception d’un instrument de musique et pas n’importe lequel, l’orgue. En effet, selon le peintre Roy Jaeggi, « Les orgues ont comme principale fonction, de manifester la recherche d’harmonie entre le soi essentiel et le monde qui nous entoure sous une forme de présence contemplative et mystique. »117 Cette précision quant-à la symbolique de l’orgue permet de faire le lien entre l’architecture de Gaudí, la pratique artistique de Richard Wagner et la définition qu’il fait de l’art total. En considérant l’architecture comme un instrument de musique, Gaudí exécute aussi bien de manière matérielle qu’immatérielle ce que représente l’art total. Par conséquent, nous pouvons très justement parler de fusion des arts.


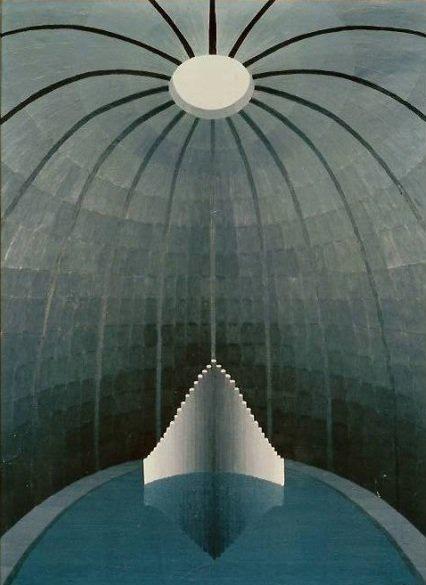
FIG.29 : CREPUSCULE DES DIEUX. Joy Jaeggi. Huile sur Toile
FIG.30 : EQUILIBRIUM. Joy Jaeggi. Huile sur Toile
FIG.31 : PARSIFAL. Joy Jaeggi. Huile sur Toile
115« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.20.
116« Tours Orgue » est un terme employé par Antoni GAUDÍ afin de désigner la forme conceptuelle et la fonction que pourraient avoir les tours abritant les cloches. La tour deviendrait selon sa conception, comme un tuyau d’orgue afin de maximiser le son des cloches.
117« L’orgue en tant que symbole, L’orgue est l’instrument oar excellence de la musique sacrée », Roy JAEGGI. L’artiste place au centre de sa composition picturale l’orgue. Il lui redonne sa dimension sacrée à travers un style minimaliste.
« De ce grand constructeur d’architectures, on a dit très justement qu’il était le poète de la pierre, comme on pourrait dire le musicien, non seulement du silence qui accompagne l’architecture et du vent qui, en coupant d’une façon originale les arêtes des pierres et des murs, chante avec des sonorités très différentes de celles des édifices des autres architectes modernes. »118
Ce que l’écrivain Clovis Prévost écrit à propos des orgues de la Sagrada Família semble faire sens dans ce contexte. Il confirme cette idée que la Sagrada Família est nécessairement par le biais de son apparence formelle, un instrument de musique dont la nature (par nature j’entends le vent) est le musicien. Cela signifierait que la Sagrada Família est un ouvrage architectural qui regroupe quatre formes d’art : l’architecture, la sculpture, les arts visuels et la musique.
Que ce soit dans sa réflexion ou dans son application, le projet de la Sagrada possède toutes les caractéristiques de l’œuvre d’art total. De cette manière, et conformément à la définition de l’art total qu’établit Richard Wagner, on pourrait considérer l’architecture de la Sagrada Família comme un modèle de perfection artistique dans la mesure où elle transcende les arts et les esprits de ceux qui la contemplent.
Dans le discours de Richard Wagner ou bien même dans celui d’Arthur Schopenhauer, la religion et tout ce qui se rapporte à l’expression de la foi chrétienne n’est pas présente, ni même suggerée. Pourtant, c’est ce fond de pensée théologique animant la réflexion de Gaudí qui participe à l’expérience d’exaltation de l’âme dont parle Schopenhauer. En effet, la discordance entre l’œuvre de Gaudí et le discours des deux autres protagonistes est le fait que la conception de l’art selon l’architecte n’a que pour unique but la représentation de Dieu.
118« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Les grandes orgues de Barcelone, p.216.
De ce fait, si l’architecture et les autres arts mis à la contribution de son œuvre inspirent à la représentation de la divinité, alors ce qu’on appelle art total n’est que le reflet d’une expérience mystique et spirituelle. Autrement dit, l’expérience décrite par Schopenhauer et Wagner est sensiblement identique à l’expérience religieuse ascensionnelle recherchée par Gaudí.
Ce que nous tentons de comprendre, c’est la force qui existe entre l’art et la religion au sein du projet de la Sagrada Família. L’art total ne faisant pas mention de cette qualité spirituelle et religieuse, il semble pourtant que le projet de la Sagrada fonctionne en complémentarité en alliant cette idée d’art total avec cette recherche supplémentaire de l’infini divin par l’usage du registre religieux. Le qualité théologique et mystique de la Sagrada Família que Gaudí recherche reste néanmoins plus forte et supérieur à ce qu’expriment Wagner et Schopenhauer. C’est ici l’intuition que nous entendons vérifier.
Pour y parvenir nous pourrions évoquer très rapidement les points de convergence qui existent entre le domaine de l’Art et celui de la Religion. Les représentations divines connues et reconnues sont datées à quelques années près en même temps que l’apparition et les débuts du christianisme dans l’Empire Romain. Cela signifie que le traitement de la foi et la représentation du Christ sont des sujets qui dans l’art détiennent une place relativement importante. Certainement pour une raison bien précise : l’art se présente comme le seul outil de représentation de l’invisible. C’est justement pour cette raison d’ailleurs que l’Eglise fût pendant le Moyen-Age le plus grand commanditaire de peinture en Europe. C’est notamment par cette richesse des peintures religieuses qu’André Félibien, théoricien du classicisme français considère la peinture religieuse comme la plus noble dans la hiérarchie des œuvres picturales.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel est le philosophe qui semble établir le lien le plus fort entre l’art et la religion. Plus précisément, selon sa pensée esthétique, l’art serait même comme englobé dans la religion. L’art ne serait qu’une esthétique de la religion.
Ainsi, contrairement à la pensée wagnérienne, ce serait la religion qui permettrait d’accéder à un état absolu par le biais de l’art. (tandis que pour Wagner, c’est l’art qui créer cet état d’absolu et d’unité). Contrairement à la pensée wagnérienne, ce serait la religion qui permettrait d’accéder à un état absolu par le biais de l’art. (tandis que pour Wagner, c’est l’art qui créer cet état d’absolu et d’unité). Ainsi, il écrit dans « Phénoménologie de l’Esprit » : « La figure (de l’absolu) s’élève à la forme du Soi par la production de la conscience en sorte que celle-ci contemple dans on objet son opération ou le soi. »119 Il semble que ce soit le niveau de la conscience de soi que nous représentons sous la forme artistique qui détermine cet absolu. L’art serait ainsi nécessairement dépendant de notre Soi, tout comme la figure, autrement dit le Divin. Cette pensée qui établit le principe de causalité120 entre l’art et la religion se rapproche sensiblement de la pensée de Gaudí. Elle se rapproche dans le sens où la production artistique et architecturale de Gaudí n’est que la manière de représenter le soi dont Hegel fait mention dans son discours.
De ce fait, l’architecture devient un outil de mesure du soi et donc de révélation de la figure dans la réalité finie. Il s’avère important (dans le cadre de notre objet d’étude) de pouvoir étudier la pratique architecturale autrement qu’à travers la construction et tout ce qui se rapporte à la finitude. En effet, le projet et la pensée de Gaudí (en corrélation avec la pensée d’autres personnalités intellectuelles) démontrent que l’architecture peut posséder cette qualité supérieure qui la rend remarquable et infinie. On peut alors pleinement saisir les possibilités et les pouvoirs que détient l’art architectural dans sa manière de créer des expériences de l’ordre du mysticisme.
Vassily Kandinsky est un artiste contemporain d’Antoni Gaudí qui écrit également au sujet de ce lien entre l’art et la spiritualité. Lui ne fait à aucun moment allusion à l’idée d’art total.
119« Phénoménologie de l’Esprit », Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. 1827 (publication originale), §556.
120Le principe de causalité est le fondement nécessaire de la connaissance même la plus légère du monde, du plus faible soupçon de son existence. La causalité a pour premier terme la cause, c’est-à-dire la nécessité pour chaque partie d’être, par le fait de ce qui est hors d’elle, autre qu’elle ne serait si elle était seule. Définition proposée par le CNRTL.
Néanmoins, il nous permet d’explorer une manière de considérer le lien entre l’art et la spiritualité (depuis la vision d’un artiste peintre) comme étant présent, voir même nécessaire. En effet, il écrit un ouvrage, « Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier », dans lequel il dit « Une œuvre d’art n’est pas belle, plaisante, agréable. Elle n’est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n’est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu’elle est apte à provoquer des vibrations de l’âme, puisque l’art est le langage de l’âme et que c’est le seul. »121
Ce que met en avant Kandinsky122 dans son discours (que l’on discerne également dans le discours de Wagner), c’est cette volonté de réancrer l’art dans un but supérieur que celui de créer la beauté. On observe alors une certaine sacralisation de l’art qui lui permet de devenir l’intermédiaire entre le soi et l’infini. C’est également cette idée qui semble animer Gaudí. Par ailleurs, Carles Andreu l’exprime de manière très juste : « Le défi de Gaudí : re-ancrer l’art dans la transcendance afin d’empêcher qu’il ne devînt un produit parmi d’autres et que la conceptualisation ne vînt remplacer la foi. »123 L’usage de l’idée d’art total pour la Sagrada Família aurait également pour objectif démonstratif le rayonnement et la grandeur de l’art lorsque celui-ci est utilisé afin de représenter l’absolu et le divin.
Dans le cadre de l’objet d’étude, il serait intéressant de pouvoir établir éventuellement un lien étroit entre l’Icône religieuse d’origine byzantine et l’œuvre d’Antoni Gaudí. Le terme icône vient du grec -eikona qui signifie image. Par définition, l’icône est une peinture religieuse vouée à la vénération des fidèles et qui en sa matérialité indique la présence du Christ vivant. De cette manière, elle en devient symbolique dans la relation du croyant à Dieu.124
121« Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier», Vassily KANDINSKY. 1911, Chapitre VI.
122Vassily KANDISNKY (1866 - 1944) est un peintre d’origine russe. Pionner de l’art abstrait et membre du Bauhaus, il marque un tournant dans la naissance de l’abstraction. En effet, il convoque un langage nouveau dans le monde de l’art en exprimant sa « nature intérieure »
123« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.20.
124Définition de l’Icône religieuse proposée par l’Eglise catholique.
Nous avons évoqué au cours de l’étude cette intention de Gaudí de représenter l’infinité dans l’architecture finie. Autrement dit comment vivifier Dieu sur Terre. Ce que l’icône tente de produire est sensiblement identique au dessein de l’architecte catalan. Seulement ici, c’est par le biais de la peinture que cette volonté de rendre en présence ce qui est en absence se matérialise. Antoni Gaudí, fortement animé par ce besoin de retourner à l’origine paraîtrait avoir repris la pensée byzantine à laquelle il s’identifie afin de concevoir son projet de Temple. Il dit nécessairement à propos de son Temple : « Je suis venue reprendre l’architecture là où l’avait laissée l’art byzantin. »125 On peut sensiblement saisir l’inspiration que fût la période de l’architecture et l’art byzantin pour Gaudí.
De cette manière, nous pouvons éventuellement considérer que Gaudí à travers la Sagrada Família recréé à sa guise et par l’intermédiaire de son art-architecture cette icône religieuse. Ce que l’icône byzantine tente de représenter par l’usage de la peinture, Gaudí le représente lui par l’architecture. La Sagrada Família serait l’icône architecturale du peuple catalan.
Dès lors que l’on glorifie la Sagrada Família en icône religieuse du XXe siècle, on ne peut plus, semble-t-il, considérer que l’expérience transcendante que l’architecture produit ne soit que le résultat d’un art total. De cette manière, l’usage d’un art total serait une nécessité pour les besoins créatifs de l’icône. Ce qui signifie que contrairement à la pensée wagnérienne, celle de Gaudí serait plutôt de dire que pour représenter Dieu, il faut créer l’harmonie et l’unité par l’usage de plusieurs pratiques artistiques. Ainsi, l’art total ne serait qu’un acteur dans cette quête de représentation de l’infini.
125« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Séquence, p.92.
« Gaudí, dans le temple de la Sagrada Família, a uni consubstantiellement la vision religieuse avec la vision artistique, faisant d’elles une seule conception et une seule réalisation, parce que ces pierres, comme nous l’avons dit, sont des paroles et ces paroles sont le prêche et la musique du Camp de l’Arpa, qui s’élèvent au milieu de Barcelone pour défendre la religion du roi des Juifs et de sa famille. »126 Cette pensée de l’écrivain Clovis
Prévost met en avant le fait que la pensée religieuse de Gaudí nourrit sa pensée artistique et esthétique. L’art total est une réponse matérielle, que dit-on, la retranscription tangible de sa foi. Ainsi, concernant l’œuvre de Gaudí, si nous parlons de théologie mystique, nous parlons nécessairement d’art total.
126« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Le dernier grand bâtisseur de cathédrale, p.221.
- CONCLUSION -
Le Temple Antique, en tant que représentation architecturale du lien mystique qui unit la Terre et le Ciel semble retrouver sa grandeur perdue dans l’architecture d’Antoni Gaudí. La Sagrada Família, tout comme le Temple, se qualifie comme le lieu sacré où l’union et l’unité opère. C’est cette idée que le Pape Benoît XVI exprime :
« Par son œuvre, Gaudí nous montre que Dieu est la vraie mesure de l'homme, que le secret de la véritable originalité consiste, comme il le disait, à revenir à l'origine qui est Dieu. Lui-même, ouvrant ainsi son esprit à Dieu, a été capable de créer dans cette ville un espace de beauté, de foi et d'espérance, qui conduit l'homme à la rencontre de Celui qui est la vérité et la beauté mêmes. »127
La qualité architecturale de la Sagrada Família paraît relever d’une qualité qui dépasse la condition humaine et qui permet à l’architecte de se rapprocher un peu plus de son inspiration divine. : une qualité anagogique. « Anagogique », c’est-à dire notion ascétique qui désigne l’élévation de l’âme à Dieu. La théologie, et plus précisément la théologie de la mystique qui se révèle centrale dans l’œuvre architecturale de Gaudí devient l’ordre à partir duquel l’esthétique de Gaudí se fonde. Il révèle l’absent dans le présent et l’invisible dans le visible.
La Volonté de Gaudí à atteindre la Vérité constitue le fondement de sa compétence thélogique et esthétique. Seulement, la vérité telle que nous la considérons est un principe philosophique qui nous renvoie au plus proche de sa spiritualité et de sa dévotion pour Dieu. En d’autres termes sans culte, il ne peut exister de projet architectural.
127« Messe de dédicace de la Sagrada Família », Discours du pape Benoît XVI à Barcelone. 11 Juillet 2010.
Cette quête de vérité est ce qui lie l’homme pieux qu’est Gaudí à son architecture dans la mesure où à travers une représentation de la vérité, Gaudí représenterait la divinité. En outre, cette recherche d’atteinte de la Vérité est selon Gaudí fille de Beauté et de Nécessité. Ces trois principes qui sont constitutifs de sa pensée esthétique renvoient justement à sa pratique de la religion et à son enseignement religieux. Nécessairement, c’est ce qui nous conduit à l’expérience mystique.
Le retour à l’origine dont le pape Benoît XVI fait mention dans son discours est la mesure la plus architecturale de son projet que nous pouvons relever. Par son retour à l’origine, Gaudí aspire à reprendre le gothique pour le magnifier, par le biais d’une géométrie basée sur les éléments naturels. Ainsi, La basilique d’origine gothique de Gaudí devient un objet architectural dont la structure rétablit l’objectif originel de ce style architectural : s’élever pour réduire le vide entre la Terre et le Ciel. Cette manière de reconsidérer l’architecture gothique permet ainsi à Gaudí de pouvoir redonner toute sa grandeur à l’architecture du Temple.
L’espace conçu par Gaudí au sein de la Sagrada Família est une déambulation dans un premier temps architecturale qui s’opère à la fois en horizontalité mais également en verticalité. L’horizontalité s’effectue par la gravité et est conduite par les grands vitraux colorés qui permettent d’animer la pierre de la basilique. Plus encore, l’ornementation utilisée et accessible au niveau de l’œil permet de saisir la grandeur conceptuelle et artistique de Gaudí. La verticalité, quant-à elle, s’effectue par cette gravité négative qui se produit grâce à la structure démesurante du Temple. Les colonnes qui constituent la forêt intérieure du Temple et la géométrie libératrice de Gaudí participent à cette ascension et cette déambulation verticale de l’Esprit. De cette manière, la Sagrada Família semble unifier à elle seule par le biais de l’architecture une expérience terrestre et une expérience divine. Notre corps, contraint par la gravité déambule à terre tandis que l’Esprit, par le dessein de l’architecture, peut se trouver dans une certaine forme de lévitation. C’est également cette dualité, produit de la conception architecturale, qui génère une expérience supérieure, mystique.
L’architecture en tant que totalité ou art total devient alors prétexte à l’union, fusion avec la divinité. C’est cette expérience supérieure et qui dépasse l’entendement que nous pourrions considérer comme être l’acte de contemplation. C’est cette contemplation que nous avons défini qui participe à la qualité mystique de la Sagrada Família. Ainsi, l’architecture devient plus que de l’architecture. Elle devient infinie, représentation finie d’un absolu invisible et suprême.
Il semble que si la Sagrada Família soit le parfait reflet de l’architecture totale et sacrée, c’est sensiblement parce que Gaudí la conçu comme une représentation véritable de Dieu. Cette conception ne semble pouvoir exister sans une pensée esthétique profondément influencée, guidée par la liturgie et de surcroit conduite par une expérience mystique. L’architecture religieuse du XXIe siècle paraît différer de cette pensée. En effet, il semble que la crainte de Gaudí que « L’art ne devienne qu’un pur produit parmi d’autres et que la conceptualisation ne vienne remplacer la foi. »128 soit nécessairement une vision assez précise de l’architecture religieuse de notre siècle. Le concept architectural prime sur la foi, la forme prime sur le fond. Seulement, bien que ces nouveaux lieux de spiritualité soient des exemples de traitement de l’ombre et de la lumière ou de prouesses techniques, retrouve-ton pour autant cette qualité transcendante et mystique que produit l’architecture de Gaudí ? L’architecture religieuse de notre siècle semble avoir perdu son âme et son sens, ce qui se traduit par une architecture présente par sa forme, mais absente dans ce qu’elle incarne. Une réflexion s’impose. Nous évoquons ainsi l’idée suivante qui permet de faire lien entre l’architecture de Gaudí et l’architecture contemporaine : L’observation de ce déclin d’identité dans l’architecture religieuse ne serait que la conséquence d’un désintérêt de la religion. Autrement dit, l’architecture religieuse ne serait que la simple représentation de notre rapport intime à la foi, c’est-à dire propre à chacun.
128« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.21.
- BIBLIOGRAPHIE -
OUVRAGES
A.KEMPIS, Thomas. L’imitation du Christ. Traduction du latin, DE LAMENNAIS, Felicité. Editions Seuil. Paris 1999. 247p
BERGÓS, Joan. Antoni Gaudí : l’home i l’obra. ( Antoni Gaudí : l’homme et l’oeuvre ). Editions Ariel. Universitat Politécnica, Barcelon 1974. 184p
BRAUDEL, Fernand. La Méditérranée et le monde méditerannéen à l’époque de Philippe II. Editions Armand Colin. Paris 1985. 800p
CASTELLAR - GASSOL, Joan. Gaudí, la vida d’un visionari. ( Gaudí, la vie d’un visionnaire ) Editions de 1984. Barcelone 1999. 144p
DE MAGDALA, Myriam. L’Evangile de Marie. Traduction, LELOUP, Jean-Yves. Edition Albin Michel. Paris 2000. 240p
DE SALIGNAC DE LA MOTHE - FENELON, François. Oeuvre de Fénelon. Edition Gallimard. Paris 1983. Volume I, 1633p
FLORES, Carlos. Gaudí, Jujol y el modernismo en Catalunya. ( Gaudí, Jujol et le modernisme en Catalogne ). Editions Aguilar S. Madrid 1982. 307p
GUERANGER, Prosper. L’année liturgique. Edition H. Oudin. Paris 1883. Volume I & 2. 584p
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Introduction à l’esthétique - le Beau. Traduction, JANKELEVITCH, Samuel. Edition Champs Classiques. Paris 2009. 379p
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Phénoménologie de l’esprit. Traduction, BOURGEOIS, Bernard. Librairie Philosophique Vrin. Paris 2006. 701p
HUGHUES, Robert. Barcelone, la ville des merveilles. Bibliothèque Albin Michel. Paris 1992. 584p
KANDINSKY, Vassily. Du Spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier. Edition Folio Essais. Paris 1998. 210p
KANT, Emmanuel. Essai sur les maladies de la tête - Observations sur le sentiment du beau et du sublime. Edition Flammarion. Paris 1993. 180p
MARTINELL, Cèsar. Antonio Gaudí 1852 - 1926. Editions A. Hatier. Collection « Arts et artistes », série Les Architectes. Paris 1955. 70p
MEYNARD, André-Marie. Traité de la vie antérieure. Petite somme dethéologie ascétique et mystique d’après l’Esprit et les Principes de Saint Thomas d’Aquin; théologie ascetique. Edition Forgotten Books. Paris 2022. Tome I, 595p
NIETZSCHE, Friedrich. La Généalogie de la Morale. Traduction, WOTLING, Patrick. Edition Le Livre de Poche. Paris 2000. 311p
NIETZSCHE, Friedrich. Le Gai Savoir. Traduction, WOTLING, Patrick. Edition Flammarion. Paris 2007. 448p
PUIG BOADA, Isdre. El pensament de Gaudí. ( La pensée de Gaudí ). Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona 1981. 270p
RUSKIN, John. Les sept lampes de l’architecture. Traduction, ELWALL, George. Edition Klincksieck. Paris 2008. 231p
SBALCHIERO, Patrick. Antoni Gaudí, l’architecte de Dieu. Editions Artège. Paris 2022. 208p
SCHOPENHAUER, Arthur. Le monde comme volonté de représentation. Traduction et préface, ROSSET, Clément. Presses Universitaires de France PUF. Paris 2014. 1472p
STEINER, George. Réelles présences. Les arts du sens, Editions Galimard. Paris 1993. 288p
TANQUEREY, Adolphe. Précis de Théologie Ascétique et Mystique. FV Editions. Paris 2019. 650p
TARRAGOA, Josep Maria. Gaudí, biografia de l’artista. ( Gaudí, biographie de l’artiste ). Editions Proa. Barcelone 1999. 262p
WAGNER, Richard. L’Oeuvre d’art de l’avenir. Traduction, J-G Prod’homme, Dr. HALL, F. Edition l’Harmattan., Collection Les introuvables. Paris 2005. 224P
OUVRAGES COLLECTIFS
ANDREU-LAROCHE, Annie - ANDREU, Carles (préface) - PUIG BOADA, Isdre. Antoni Gaudí, Paroles et écrits. Editions L’Harmattaan. Paris, 2002. 324p
COUSIN, Victor. Oeuvres de Descartes. Textes écrits par DESCARTES, René et rassemblés par COUSIN, Victor. F. G. LEVRAULT Librairie. Paris 1825. 466p
DALÍ, Salvador (préface) - PREVOST, Clovis - DESCHARNES Robert. La vision artistique et religieuse d’Antoni Gaudí. Editions Edita. Lausanne, 2e édition. 1982. 249p
DE SAINT-VICTOR, Richard - DUMEIGE, Gervais. Epitre à Séverin sur la charité : Les quatre degrés de la violente charité. Librairie Philosophique Vrin. Paris 2002. 208p
LE CORBUSIER - GOMIS, Joaquin - PRATS VALLÉS, Joan. Gaudí : fotoscop. R.M. Barcelona 1908. 122p
PINSARD, Pierre - VOLLMAR, Hugo (sous la direction de). MASSU, Claude (préface). Architectures d’églises 1958 - 1981. Editions onTau. Paris 2021
CHAPITRES D’UN OUVRAGE
Extraits de la Bible ( Par ordre d’apparition dans l’ouvrage ) :
Bible, Génèse. Chapitre I, verset - 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. »
Bible, Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Chapitre XVI, verset - 24. « Alors Jésus dit à ses disciples. « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. »
Bible, Apocalypse. Chapitre II, verset - 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. »
Bible, Apocalypse. Chapitre XXII, verset - 5. « Il n’y aura plus de nuit les serviteurs de dieu se passeront de lampe ou de soleil pour s’éclairer car le seigneur dieu répandra sur eux la lumière. »
CAVALLERA, Ferdinand - DE GUIBERT, Jacques-Antoine - RAYEZ, André - VILLER, Marcel (Fondé). DERVILLE, André - LAMARCHE, Paul - SOLIGNAC, Aimé (Continué). Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique in Le Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne. Edition BEAUCHESNE. Paris 1983. p.248
ARTICLES
GESCHE, Adolphe. « Théologie de la Vérité » Revue Théologique de Louvain. 1987. 24p
HAAS, Alois-Maria. « La mystique comme théologie » Revue des sciences religieuses 72-N°3, traduction TSCHABOLD Matthias. 1998. pp 261 - 288
REYMOND, Bernard. « Arts et religion, ces proches parents » Etudes théologiques et religieuses. Tome 89, 2014/4. pp. 435 - 449
SCHAEFFER, Jean-Marie. « Le religion et l’art : un paradigme philosophique de la modernité » Histoire et Théories de l’art, Presses Universitaires de France PUF. N°2, 1994
ENTRETIENS
MARTLEW, Margaret. Vitrage de la Sagrada Família : entretien exclusif avec Joan Vila Grau. Université de Sheffield. N°40, Mai 2010
SEOANE, Alejandro. Entretien avec un architecte de la Sagrada Familia in situ Septembre 2022. Barcelone
SOURCES INTERNET
BONNEFOY, Bruno. Schopenhauer, Le cylce infernal du désir. Septembre 2022 https://major-prepa.com/culture-generale/schopenhauer-cycle-desir/
BUISSIERE, Evelyne. « Le sens spéculatif de l’art ». 2007. https://www.lettres-et-arts.net/arts/art-objet-pensee-philosophique/art-pensee-rationnelle-hegel/sensspeculatif-art+278
JAEGGI, Roy. « L’orgue en tant que symbole - L’orgue est l’instrument par excellence de la musique sacrée »
https://www.royjaeggi.net/oeuvres/orgues/#:~:text=Par%20leur%20repr%C3%A9sentation%2C%20 les%20orgues,irr%C3%A9el%20et%20parfois%20m%C3%AAme%20lunaire.
PERDRIEL, Milena. « Expérience personnelle - Beloved moments - Sagrada Familia ». Novembre 2014
https://www.milenap.com/experience-personnelle-beloved-moments-sagrada-familia/#
PÉREZ, Danièle. « L’art est-il religieux? » Art. 2017
https://perezartsplastiques.com/author/perezartsplastiques/
AUTRES SOURCES
LAHUERTA, Juan José. Gaudí. Exposition Musée d’Orsay. Avril - Juillet 2022