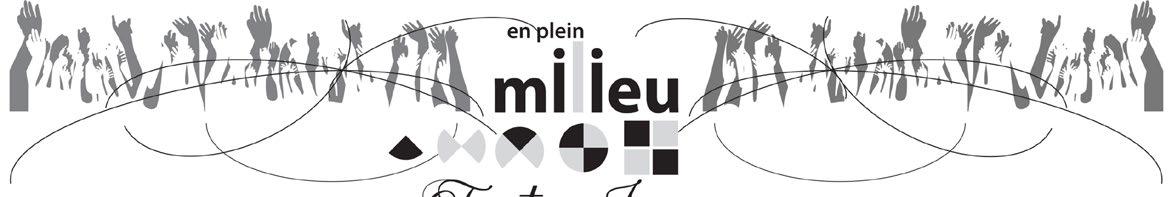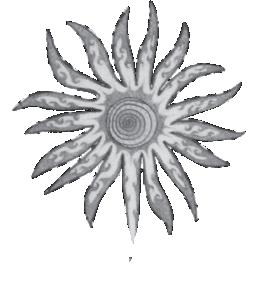3 minute read
Vie normale, dépendance et changement
C ourtoi sie: Martine Corrivault
VIE NORMALE, DÉPENDANCE ET CHANGEMENT
Advertisement
Depuis six mois, la normalité a changé de visage pour les gens qui se sentent désormais dépendants des caprices d’une certaine Covid-19, le virus qui, au début d’août au Québec, avait causé la mort de plus 5 600 personnes. Les règles pour combattre le mal en essayant de protéger les gens ont sérieusement perturbé la vie quotidienne des individus et des familles qui aspirent toujours à retrouver leur vie normale d’avant. Mais les changements risquent d’être plus importants qu’on voudrait le croire.
Plusieurs citoyens s’insurgent contre les contraintes qui bousculent les relations entre les gens et leur environnement, mais l’espérance que tout cela soit temporaire aide les autres à tolérer ce qui les gêne le plus. Quand après quelques semaines d’une pause quasi totale, les autorités ont autorisé la reprise graduelle des activités, on a cru voir la lumière au bout du tunnel. Mais le soulagement a rivalisé avec l’inquiétude quand sont arrivées les vacances, pas toujours marquées par la sagesse, et qu’on a commencé à esquisser un cadre sécuritaire pour la rentrée scolaire. Tout n’allait donc pas revenir «comme avant»?
Tout dépendra de l’évolution de la maladie, mais surtout de l’attitude des gens, désormais plus impatients que tolérants face aux obstacles qui les séparent du retour à la normalité.
Pourtant, cette normalité-là est aussi en voie de subir de profondes mutations, ne serait-ce que par l’invasion des nouvelles technologies dans des champs d’activités qu’on croyait protégés. S’il y avait un complot à imaginer, c’est de ce côté-là qu’il faudrait regarder, si l’on croit le physicien Stephen Hawking qui observait, il y a quelques années déjà, que l’intelligence artificielle fait de grandes choses, mais poussée trop loin, elle pourrait amener la fin de la race humaine. Les coronavirus ne sont donc pas seuls.
La planète a connu bien des fléaux au cours des siècles et notre actuel virus n’est pas la première entité microscopique à y sévir; certains ont même contribué à l’évolution de la vie sur terre. Les premiers êtres vivants se sont adaptés à toutes les conditions; l’humanité a survécu aux grands cataclysmes et même aux guerres qu’elle générait. L’histoire peut le raconter comme elle sait inspirer aux arts les moyens de transmettre les leçons du passé aux populations qui ignorent ces drames dont les anciens ne parlent jamais. Il y aurait pourtant des leçons de survie à en tirer pour les nouvelles générations.
La Covid-19, en privant les habitants des pays développés de leur mode de vie routinier, force les civilisations modernes à réfléchir, mais pour la plupart, la difficulté reste de trouver comment le faire sans mode d’emploi ni tutoriel. Au cours des derniers mois, on a pu observer que dans les familles avec enfants, le bon vieux système D traditionnel pouvait reprendre du service efficacement, quand on lui permettait de le faire sans passer par les règles d’une bureaucratie plus préoccupée d’entretenir la dépendance que d’encourager l’autonomie.
Ailleurs dans la société, la tragédie dans les CHSLD a produit un véritable électrochoc sur les autorités qui, sur le moment, ont voulu rassurer avec des promesses. Reste à voir comment on les tiendra, comme celles faites aux sauveteurs, «nos anges gardiens» des temps difficiles. Les centaines de morts survenues dans ce que les autorités prétendaient être des «milieux de vie» ont forcé tout le monde à réaliser la gravité des lacunes et l’urgence d’y remédier. Mais pourquoi a-t-il fallu tant de morts pour s’indigner et agir? L’argent n’explique pas le manque de respect de certaines personnes responsables.
Pour mon amie Valentine, le grand choc de ces derniers temps aura été de réaliser qu’elle appartient désormais au groupe des 70 ans et plus qu’il faut protéger en les écartant de la vie active, même celle du bénévolat. «C’est pour ton bien» est devenue la phrase la plus détestable à entendre, pour la femme libre et dynamique qu’elle croit encore être. Inutile d’ajouter que le drame des CHSLD l’a confirmée dans son désir de n’avoir jamais à y séjourner et son entêtement à rester là où elle se trouve. Septuagénaire autonome, elle n’a aucune envie de dépendre de qui ou de quoi que ce soit… du moins pour les vingt prochaines années.
«Rien ne vaut une bonne crise pour tester ses convictions», dit-elle en précisant que ça vient de Bill Gates et ajoutant, pour clore la discussion: «Encore faut-il en avoir.»